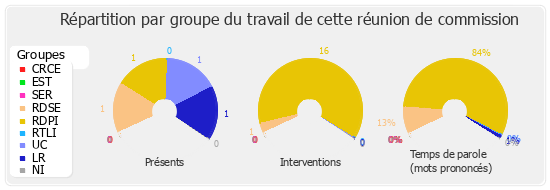Mission commune d'information portant sur les dispositifs médicaux implantables
Réunion du 13 mars 2012 : 1ère réunion
Sommaire
- Audition de mm. jean-luc harousseau président de la haute autorité de santé et jean-michel dubernard président de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (voir le dossier)
- Audition de mm. edouard couty président du conseil d'administration erik rance directeur et mme sabine gibert directrice juridique de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales oniam (voir le dossier)
- Audition de mm. alain sautet secrétaire général de la société française de chirurgie orthopédique et traumatologie sofcot et christian delaunay coordinateur du registre (voir le dossier)
La réunion
Audition de Mm. Jean-Luc Harousseau président de la haute autorité de santé et jean-michel dubernard président de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé
Audition de Mm. Jean-Luc Harousseau président de la haute autorité de santé et jean-michel dubernard président de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé

Nous avons le plaisir d'accueillir le président de la Haute Autorité de santé (HAS) et le président de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS).
Cette mission commune d'information fait suite au scandale des prothèses PIP. L'affaire touche un dispositif médical, ce que le Sénat avait largement anticipé lors de ses débats sur le Mediator et la réforme de la sécurité sanitaire du médicament.
Nous avons élargi notre enquête à tous les produits de santé implantables, qu'ils soient utilisés ou non à des fins esthétiques, pour nous pencher sur la notion de risque acceptable et le régime d'autorisation des produits. De fait, si l'innovation apporte des avancées thérapeutiques, et Le Figaro évoquait la semaine dernière des lentilles pour diabétiques comme futur moyen de lecture de la glycémie, elle doit être encadrée pour garantir la sécurité des personnes.
J'ai demandé au professeur Dubernard de m'accompagner car la CNEDiMTS est autonome au sein de la HAS. On y discute des dispositifs innovants et, c'est logique, des actes chirurgicaux qui leur sont liés. Sa mission, à ne pas confondre avec celle de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), la structure qui remplacera l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), consiste à évaluer les produits de santé dans le but de leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables. Elle apporte également une aide à la fixation des prix. C'est dans ce cadre qu'elle est amenée à débattre des risques potentiels d'un dispositif. Elle n'a cependant pas vocation à mener ce travail sur tous les dispositifs, loin s'en faut : son action se limite aux produits remboursables, c'est-à-dire en ambulatoire, les usages hospitaliers étant pris en charge par les groupes homogènes de séjour (GHS). Jusqu'à la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, la CNEDiMTS ne les évaluait pas. Celle-ci raisonne dans le cadre d'une stratégie thérapeutique suivant les deux grandes modalités d'inscription sur la liste des produits et prestations remboursables, les dispositifs génériques réévalués...
tous les trois à cinq ans...

Les incidents relatifs à la sécurité de dispositifs médicaux implantables, qui se sont répétés ces derniers temps, auraient-ils pu être détectés plus tôt, voire évités ? Quels enseignements en tirer pour l'avenir ? En particulier, qu'en est-il des conditions dans lesquelles sont réalisés les essais cliniques ? D'après vous, faut-il prévoir une autre régulation pour les prêts de matériels aux praticiens ?
Le professeur Dubernard, en plein drame du Mediator, m'avait annoncé que le prochain scandale serait lié aux dispositifs médicaux. D'ailleurs, il n'était pas le seul à le penser. En outre, très vite après mon arrivée en février dernier, la HAS a fait l'objet d'une enquête de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) sur les contrôles internes, et plus particulièrement sur la certification des établissements de santé, l'accréditation des professionnels exerçant dans les spécialités à haut risque et l'évaluation des dispositifs médicaux. Sa conclusion était que le système actuel comportait une part de risque.
Attention à ne pas faire de rapprochements hasardeux entre les différentes affaires récentes. Dans le cas des prothèses PIP, un industriel a fraudé dans le désir de gagner de l'argent. La situation est tout à fait différente de celle des prothèses métal-métal DePuy qui, à long terme, se sont révélées déficientes.
Il existe seulement un marquage CE pour les dispositifs médicaux. Fondé exclusivement sur les caractéristiques techniques, il empêche une approche en termes de bénéfices-risques. Le ministre de la santé travaille actuellement à obtenir davantage au niveau européen. Les essais cliniques, que la directive 2007/47/CE encourage pour les dispositifs de classe III, se mettent en place lentement, les produits étant souvent fabriqués par des toutes petites entreprises pour des publics très ciblés.
Il y a pas moins de 4 000 classes de dispositifs médicaux qui représentent, selon les spécialistes, 160 000 à 800 000 références, des pansements aux valves cardiaques ; impossible, dans ces conditions, de demander des essais cliniques pour tous !
Il faut penser autrement les dispositifs médicaux, qui sont un monde à part de celui du médicament. Au niveau national, et je parle sous le contrôle de Mme Génisson qui a travaillé sur le sujet à l'Assemblée nationale, la réflexion doit porter sur la structure des autorités sanitaires. La Grande-Bretagne a réduit le nombre de ses agences de santé de vingt et un à neuf, avec une économie de fonctionnement de 45 %. C'est le gouvernement de M. Cameron qui a appliqué cette réforme conçue par les travaillistes, preuve que le sujet n'est pas politique. Nous devrions peut-être nous inspirer de cet exemple.
A l'échelon européen, le besoin de construire des coopérations est évident pour les dispositifs médicaux, ce qui est peut être moins le cas pour les médicaments. Pourquoi ? Parce que les implants rétiniens, dont José-Alain Sahel est un pionnier aux Quinze-Vingts, les stents pour les ruptures d'anévrisme, ou les prothèses de cheville concernent un très petit nombre de patients. Avec des coopérations, qui peuvent partir de la base, nous pouvons leur fournir des réponses plus rapides. J'y travaille depuis quatre ans. L'autre question est celle de la restructuration du système européen, qui repose sur le marquage CE et les organismes notifiés. Pourrait-on élargir le champ d'action de l'Agence européenne des médicaments (EMA) ? C'est le problème des politiques avant d'être celui des technocrates européens.
La solution, pour éviter ces scandales, est de renforcer l'Afssaps afin de mieux détecter les signes de faiblesse dans le système de matériovigilance.
Même quand les essais cliniques sont complexes, les grandes firmes ont les moyens de les lancer. En outre, il existe, en France, un programme de soutien aux techniques innovantes coûteuses, le PSTIC, financé par la direction générale de l'offre de soins (DGOS). Grâce à un protocole établi préalablement, il permet de tester les nouvelles technologies contre le standard existant et d'évaluer leur efficience. Seul problème, les délais. Or les patients ne peuvent pas attendre, ils ont besoin de l'innovation. Condition imposée pour leur remboursement par l'assurance maladie, une étude de registre sur trois mille cas a été réalisée et a permis d'évaluer, sur trois ans, l'intérêt et les risques potentiels des nouvelles valves cardiaques aortiques transcutanées. C'est un exemple de mise à disposition immédiate bien encadrée.
Dès mon arrivée à la CNEDiMTS, j'ai pris conscience du besoin d'accompagner petites et moyennes entreprises (PME) et chercheurs pour mener des essais cliniques. D'où ma volonté de mettre en place des plates-formes d'accompagnement, avec le soutien des ministères de la recherche et de l'industrie, à Lyon, Marseille et Paris. Malheureusement, les PME continuent à recourir plutôt à des consultants privés, parfois peu compétents, et qui cherchent seulement à exploiter les possibilités financières de leurs produits.
Autre piste, la réduction des guichets uniques. Depuis que j'ai supprimé celui de la HAS, il en reste deux : à l'Afssaps et au ministère de la santé. Au législateur de rationaliser cette organisation ; il faudrait un seul guichet unique avec des relais locaux.

Comment renforcer l'évaluation médico-technique des dispositifs médicaux par la CNEDiMTS ? Seriez-vous favorable au rapprochement de la CNEDiMTS et de la commission de la transparence pour les médicaments ? Comment la HAS évalue-t-elle la sécurité et l'efficacité des dispositifs médicaux remboursés ? Quelle est la fréquence des contrôles ? Un point sur lequel le Sénat s'est beaucoup interrogé, ces contrôles sont-ils aléatoires ? Enfin, comment le retour d'expérience des défaillances constatées au sein des établissements de santé s'effectue-t-il ?
L'évaluation médico-technique de la CNEDiMTS repose sur le rapport bénéfices-risques en termes de guérison ou de réduction d'un handicap par comparaison avec les stratégies thérapeutiques existantes. Autrement dit, l'évaluation est conduite au regard d'autres dispositifs médicaux, mais aussi d'un acte chirurgical. Nous disposons de deux indicateurs. Premièrement, le service médical attendu (SMA). S'il est suffisant, le dispositif est inscrit au registre des produits et prestations remboursables. Deuxièmement, l'amélioration du service médical rendu, qui aide le comité économique des produits de santé (CEPS) à fixer un prix. Il me semble que ce système fonctionne. La difficulté, nous l'avons dit, tient essentiellement au manque d'essais cliniques de qualité. Il faudrait inciter, plus que ne le fait la directive de 2007, les industriels à lancer des études.
Le rapprochement de la CNEDiMTS et de la commission de la transparence ? Je n'y suis pas favorable. Chacune d'entre elles s'appuie sur une compétence spécifique et toutes deux ont déjà beaucoup de travail. Ensuite, qui dit dispositif médical, dit acte chirurgical. De là, l'intérêt de leur évaluation simultanée au sein de la HAS, et de coopérations avec l'Afssaps en matière de matériovigilance afin que cette dernière invite la CNEDiMTS à revoir une marque ou une description générique complète.
Nous avons, pour l'instant, peu de retour d'expérience sur les dispositifs médicaux au sein des établissements de santé, hormis dans le cas des dispositifs médicaux très innovants, en attendant que soit mise en route l'extension de nos responsabilités prévue par la loi de décembre 2011 sur un certain nombre de dispositifs médicaux compris dans l'intra-GHS.
Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse : si la qualité de notre travail est satisfaisante, il faudrait systématiser les études après l'inscription au registre ou, du moins, les multiplier, même si ce point de vue n'est pas forcément partagé au sein des services de la HAS, car l'augmentation de la quantité de travail pourrait nuire à la qualité de celui-ci.
Ma position est identique à celle du professeur Harousseau sur un éventuel rapprochement avec la commission de la transparence. À ce propos, une question taraude depuis longtemps le transplantologiste que je suis. Les produits issus du corps humain sont considérés comme des médicaments. L'ingénierie tissulaire consistant, par exemple, à fabriquer un poumon à partir d'une matrice prélevée sur un cadavre doit-elle être considérée comme tel, et relever de l'Afssaps ou bien de l'agence de la biomédecine ? La fabrication d'organes étant amenée à se développer rapidement, cela pose problème.
On confond trop souvent le rôle de la HAS avec celui de l'Afssaps. Nous évaluons le bénéfices-risques ; eux, le risques-bénéfices. Nos missions sont très proches, ce qui explique le besoin de monter une cellule de coopération. Reste que la matériovigilance est du ressort de l'Afssaps. Ne peut-on aller plus loin ? Jean-Pierre Door parlait récemment dans Le Quotidien du médecin de confier à celle-ci un rôle de véritable police sanitaire. Je suis pour : nous distinguerions ainsi les deux fonctions de sanction et d'évaluation du risque. En fait, nous avons deux options : créer un mastodonte comme la Food and Drug Administration (FDA), ce qui était l'orientation poursuivie jusque-là, ou renforcer le rôle de l'Afssaps, direction qu'a prise le législateur dans la loi de décembre 2011 en lui confiant l'évaluation du rapport bénéfices-risques. Avec ces évolutions, nous ne savons plus très bien où nous en sommes.

Quel est votre avis sur la qualité de l'information médicale ? Comment la HAS s'assure-t-elle de la connaissance de la réglementation et de son application effective dans le cadre des visites de certification ? La gestion des dispositifs médicaux implantables fait-elle fréquemment l'objet de réserves ou de recommandations ? Dans quelle catégorie d'hôpitaux et dans quelles spécialités ? Une fois l'alerte donnée, comment diffusez-vous l'information aux acteurs ? Certaines de ces questions sont, sans doute, hors de votre champ.
De fait, l'alerte et le retrait ne nous concernent pas. La HAS peut simplement demander le déremboursement. L'information médicale diffère pour les dispositifs médicaux et l'acte qui les accompagne et pour les médicaments. Dans le cas du Mediator, l'information délivrée par l'industriel a conduit à un mésusage du médicament. En revanche, le risque est limité pour les dispositifs qui sont utilisés par des spécialistes.
Ces derniers temps, la HAS a beaucoup travaillé sur les codes de bonnes pratiques, que nous élaborons de plus en plus avec les professionnels. Le problème auquel nous sommes confrontés est celui des conflits d'intérêts, aussi bien avec des firmes qu'entre professionnels. Le point de vue des cardiologues interventionnels n'est pas forcément celui des chirurgiens thoraciques à propos des nouvelles technologies de pose de valve.
Comment nous assurons-nous de la connaissance de la réglementation ? L'accréditation des professionnels exerçant dans les spécialités à haut risque - chirurgiens, obstétriciens, anesthésistes - est une procédure sur laquelle nous pouvons agir pour obtenir le respect des règles. Concernant l'acte plutôt que le dispositif lui-même, l'un de nos objectifs forts est la check-list opératoire qui fait partie des critères de certification des établissements de santé.
La CNEDiMTS dispose de 90 jours pour mener ces évaluations, tout comme le CEPS, ce qui est un temps très court pour trouver les experts compte tenu des éventuels conflits entre spécialités. Le délai de traitement des dossiers est passé de 138,5 jours en 2008 à 85 en 2011. Et ce, sans que nous soyons devenus laxistes : dans 36 % des cas, nous avons jugé le SMA insuffisant. Dans ces conditions, les études post-inscription apportent un complément indispensable. Il est néanmoins difficile de gérer les véritables innovations.
J'ajoute que la HAS a travaillé en amont de la loi de décembre 2011 sur la qualité de la visite médicale à l'hôpital, qu'elle certifie, en mettant au point un guide de bonnes pratiques. Cette certification permet aux firmes de négocier des contrats avec le CEPS. Cela dit, le guide concerne plus les médicaments que les dispositifs médicaux.
J'ai connu les visites médicales collectives pour le médicament il y a quarante ans aux Etats-Unis. Ce n'est donc pas une invention française. Pour les dispositifs médicaux, la présence des techniciens des entreprises dans le service hospitalier pendant des années est effectivement primordiale car les dispositifs connaissent souvent, tout au long de leur durée de présence sur le marché, des améliorations incrémentales.

Ma dernière série de questions portera sur les interventions à visée esthétique. Quelles sont les pratiques dangereuses en matière d'esthétique dont la HAS a connaissance ? Quel rôle joue la HAS dans la procédure d'interdiction des actes à visée esthétique dangereux prévue à l'article L. 1151-3 du code de la santé publique ? Selon quelles modalités la HAS rend-elle l'avis qui lui est demandé ? Concernant l'interdiction des actes de lyse adipocytaire à visée esthétique, où en sont les travaux de la HAS après l'annulation d'une partie du décret d'avril 2011 par le Conseil d'Etat ? Enfin, comment renforcer la formation continue des médecins pratiquant des actes de médecine esthétique ?
Effectivement, la HAS remplit désormais cette mission d'évaluation des interventions à visée esthétique. Sa première délibération, rendue en avril 2011, concernait les actes de lyse adipocytaire. Le ministère de la santé a, sur cette base, pris un décret interdisant les techniques invasives et non invasives. Le Conseil d'Etat a annulé l'interdiction portant sur les techniques non invasives.
En tout, la HAS a fait l'objet de cinq saisines dans le domaine esthétique. La première concerne les techniques de lyse adipocytaire ; la direction générale de la santé (DGS) nous a demandé de réexaminer les techniques non invasives en septembre dernier après l'annulation d'une partie du décret et d'évaluer les effets de ces pratiques en comparaison avec ceux de la chirurgie. La deuxième porte sur les risques liés à la mésothérapie à visée esthétique. La troisième saisine a trait aux appareils émettant des ultra-violets artificiels, en clair, les cabines de bronzage. Nous avons été saisis en septembre 2011, nous avons débuté les études de faisabilité en novembre, et nous publierons nos conclusions en avril. Il y en aurait 40 000 en France, ce qui représente une difficulté supplémentaire pour nous car, derrière une technique, il y a toute une activité économique. La quatrième saisine concerne le dispositif Macrolane, les comblements avec de l'acide hyaluronique, notamment au niveau des seins, pratique que l'Afssaps a interdite en août dernier. La cinquième saisine concerne l'évaluation de l'ensemble des produits de comblement. Nous sommes en train de définir le champ de cette saisine qui nous semble un peu large.
En outre, l'assurance maladie nous a demandé de nous prononcer sur les actes de reconstruction.
Enfin, le Premier ministre souhaite notre opinion sur les échographies foetales à visée non médicale, en gros les « clichés souvenirs ». Avec l'Afssaps, nous nous prononcerons très prochainement.
Lorsque nous sommes saisis par la DGS, nous émettons un avis sur le danger grave ou la suspicion de danger grave. Nous sommes néanmoins confrontés à un problème : il n'y a pas de définition du danger grave, et encore moins de la suspicion de danger grave. Il existe seulement une définition des événements indésirables graves, c'est-à-dire ceux qui seraient susceptibles d'entraîner une hospitalisation ou le décès du patient. Pour les actes à visée esthétique où, par définition, la santé humaine n'est pas en jeu, on peut considérer que le moindre risque doit être évité, d'où la sévérité de notre décision sur la lyse adipocytaire. En outre, nous manquons de données et d'essais cliniques. Nous ne pouvons nous appuyer que sur quelques publications scientifiques, sur les rapports de sinistralité des assureurs, sur les données éventuelles de cosmétovigilance ou de pharmacovigilance, sur l'expérience internationale, et éventuellement sur les réseaux de vigilance des sociétés professionnelles. Il n'y a eu en l'occurrence qu'une suspicion basée sur le mode d'action potentiel des techniques invasives.
Pour répondre à votre troisième question, nous sommes en cours de réévaluation des techniques de lyse adipocytaire non invasives. Il n'est pas exclu que nous n'ayons pas plus de renseignements que lors de la première décision.
Vous m'avez enfin interrogé sur la formation continue des médecins pratiquant des actes de médecine esthétique. Ayez à l'esprit qu'il s'agit non pas uniquement de médecins, mais aussi de kinésithérapeutes et d'esthéticiennes. Pour l'instant, nous nous occupons seulement de la dangerosité de l'acte et non pas de ses modalités de réalisation. Il faudrait pourtant y réfléchir, notamment pour la lyse adipocytaire, où il y a une grande variété de conditions d'exercice.
Je suis en tout point d'accord avec ce qui vient d'être dit.
La HAS a été créée pour procéder à des évaluations scientifiques en vue des remboursements par la sécurité sociale. Or les éléments scientifiques sont très parcellaires en matière d'esthétique. Il faudrait inventer de nouvelles procédures, analyser la littérature et regarder ce qui se passe à l'étranger. Nous voulions aussi organiser une audition des parties concernées, mais les uns et les autres ne sont pas toujours d'accord pour participer ensemble à de tels débats.
Comment renforcer la formation continue ? C'est une très bonne question. Paris VI proposait un diplôme interuniversitaire dans ce domaine, mais il a malheureusement été supprimé. Un diplôme universitaire se met en place à Lyon, sous la direction du professeur Dubreuil, mais un nouveau diplôme interuniversitaire serait vraiment le bienvenu.
Les questions posées à la HAS doivent être extrêmement précises et nous avons besoin de nombreux experts pour pouvoir répondre sur ces sujets conflictuels.

Ne faudrait-il pas, pour argumenter notre jugement politique, différencier plus nettement les fonctions de la HAS de celles des autres agences ? La HAS devrait étendre ses missions, afin de devenir le lieu ressource de la recherche et des scientifiques. Elle pourrait intervenir à tous les niveaux possibles. Les agences, quant à elles, ont un rôle plus concret. En outre, une simplification de l'organisation ne s'impose-t-elle pas ?
Deuxième sujet, ô combien important : les essais cliniques. Nous devons avoir beaucoup d'exigences éthiques et bien définir les liens d'intérêts, qu'il ne faut pas confondre avec les conflits du même nom. Le législateur, s'il veut être légitime, doit fixer des règles claires. Quid de l'évaluation par un clinicien qui implante des dispositifs médicaux ? Pourriez-vous nous soumettre des propositions ?
Oui, les missions de la HAS doivent s'élargir. D'ailleurs, la loi de renforcement de la sécurité sanitaire a par déduction renforcé la HAS, dont la mission, qui consiste en l'évaluation des produits de santé et des actes afférents dans le cadre d'une stratégie thérapeutique, est totalement différente de celle de l'Afssaps, qui s'occupe de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) et du retrait des produits. Nous devrions également pouvoir faire des recommandations aux professionnels de santé. La collaboration est facilitée par mes rapports amicaux avec Dominique Maraninchi : la HAS formulera désormais des recommandations de bonne pratique et de bon usage pour le médicament, parce qu'il s'agit de stratégie thérapeutique.
L'information des professionnels de santé doit encore être améliorée, grâce notamment au développement professionnel continu et à l'accréditation. L'évaluation du produit dans la vie réelle doit, elle aussi, être plus efficace. Certes, elle est prévue par la loi, mais elle doit entrer dans les faits. Comment faire ? Jean-Michel Dubernard a rencontré le président du CEPS. Nous devons avoir recours aux bases de données de l'assurance maladie pour améliorer la qualité des études post-inscription. D'où l'intérêt du groupement d'intérêt public (GIP), créé par la loi de 2011, entre l'Afssaps, la HAS et l'assurance maladie pour mettre au point un outil pour procéder à des études post-inscription.
J'en viens aux études cliniques : nous disposons parfois de peu d'experts et ceux-ci peuvent avoir participé au développement du médicament ou du dispositif médical. Comment utiliser les déclarations d'intérêt et avec quel degré de rigueur ? A la HAS, la règle est de ne pas utiliser un expert en situation de conflit d'intérêts majeur. Nous avons toute une liste de cas dans lesquels un conflit d'intérêts devient majeur. Mais il faudrait que ces règles s'appliquent aussi aux agences. Une uniformatisation est indispensable. Pour certaines maladies, on manque d'experts. En outre, les experts n'ont pas toujours les mêmes missions. Nous essayons de mettre en oeuvre une charte de l'expertise, qui fixera des règles strictes, tout en prévoyant des dérogations. Ainsi, les experts qui auront un conflit d'intérêts pourront être entendus, sans droit de vote, bien évidemment.
Nous n'avons pas assez dit l'importance de l'accord-cadre qui a été signé le 23 décembre 2011 entre vingt-trois fabricants et le CEPS. Les registres ont une signification extraordinaire. On va le voir de nouveau pour les valves cardiaques par voie intrafémorale, qui viennent de faire l'objet d'un article dans le New England Journal of Medicine.
En ce qui concerne l'expertise, la réalité doit primer. Quand on a fusionné la commission des actes et celle des dispositifs médicaux, on devait passer de quinze plus quatre à vingt et un plus cinq membres ; non seulement on ne le fait pas mais quatre personnes doivent encore partir. Comment faire pour les remplacer ? Ainsi, je ne dispose pas d'un expert en rythmologie cardiaque, dont j'ai pourtant besoin pour évaluer les valves cardiaques.
C'est pour cette raison que nous élaborons une charte de l'expertise qui prévoirait des dérogations en cas de besoin.

Il faut distinguer le lien d'intérêts du conflit d'intérêts. L'avis du clinicien est important pour une bonne expertise.

Pour les experts, la loi est soit trop laxiste, soit pas assez. Elle n'a, par exemple, pas prévu les cas exceptionnels. Vous avez parlé d'un accord-cadre avec des industriels. Qu'en est-il exactement ?
C'est un accord très important. Le CEPS bénéficiera ainsi d'une vision beaucoup plus précise.
Cet accord favorisera les études post-inscription. Quand un manque clinique sera constaté, une étude devra être mise en place dès l'inscription. La CNEDiMTS devra ensuite réévaluer le produit.
Et il ne s'agit là que d'un des aspects de cet accord-cadre très important.

Je ne suis pas satisfait par votre développement sur les essais cliniques. La façon dont ils sont menés actuellement n'est pas non plus satisfaisante : ce sont les firmes elles-mêmes qui les réalisent, et elles ne sont pas contrôlées. Une évolution est donc indispensable. Comment remédier à cette situation ?
Quelle fiabilité accorder aux dispositifs médicaux qui ont obtenu le label CE ? Comment ce label est-il contrôlé ? Comment éviter les rétentions d'information opérées par les entreprises qui connaissent des incidents ?
En matière de cancer de la prostate ou de pacemaker, beaucoup reste à faire. Vous avez récemment refusé d'expertiser la télé-cardiologie. Bref, comment remplir toutes vos missions avec des moyens, somme toute, réduits ?
Merci pour cette question ! Il est bon que les parlementaires qui votent la loi de financement de la sécurité sociale se rendent compte que les missions de la HAS augmentent sans que ses moyens suivent le même rythme...
Il faut insister sur la différence entre description générique et inscription sous nom de marque. Dans le premier cas, le fabricant décide simplement que son produit s'inscrit dans une ligne générique. Nous réévaluons cette description tous les cinq ans. Ainsi, les prothèses PIP figuraient dans une telle description. Sur soixante-quatre références bibliographiques sur les prothèses et les implants mammaires, quatre seulement citaient la firme PIP. Parmi d'autres ! Il n'y a jamais eu d'étude clinique spécifique sur PIP. Pour les produits potentiellement dangereux, il faudrait exiger l'inscription sous nom de marque qui est beaucoup plus contraignante.
Reste à savoir comment évaluer les dispositifs à risque, ceux qui restent implantés longtemps. Pour les prothèses de hanche métal-métal, la CNEDiMTS avait tiré le signal d'alarme il y a bien longtemps en soulignant leur SMA insuffisant, mais l'information a mal circulé et l'Afssaps n'a pas retiré le produit du marché.
Le marquage CE est insuffisant car il repose non pas sur des essais cliniques mais sur des spécificités techniques, et il revient à l'Afssaps de contrôler les organismes notifiés de manière aléatoire.
L'organisme notifié allemand est de bonne qualité. Il s'est fait gruger.

Les entreprises mais aussi les produits devraient être vérifiés, sinon les entreprises peuvent abuser les enquêteurs. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit pour les prothèses PIP.
Une meilleure coordination européenne est indispensable. Les essais cliniques sont certes financés par les entreprises, mais il y a des moyens de contrôle et des méthodologies. En revanche, les petites entreprises ont recours à des méthodologistes qui ne sont pas toujours compétents.
La Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), en application de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale introduit par la loi de 2004, peut financer une prise en charge transitoire et dérogatoire des innovations de rupture en matière de dispositifs médicaux. Elle y répugne, car elle craint d'être saisie de toutes sortes de demandes. Il faudrait reposer ces questions durant la campagne présidentielle.

Vous nous avez dit qu'il existait deux systèmes de certification. Qui décide ?
Ce serait indispensable, et aussi bien avant qu'après l'inscription. En outre, nous avons besoin d'instaurer un dialogue approfondi avec l'industriel très en amont. Pour les grandes entreprises, c'est tout à fait possible. C'est beaucoup plus délicat pour des matériels très spécifiques qui sont produits par des petites firmes.
En quelque sorte, avec des essais cliniques. Mais la liste serait très longue.
Il faudra rediscuter des classifications. Quant à la liste des dispositifs prioritaires, notre petite cellule de coordination avec l'Afssaps s'est réunie pour la première fois la semaine dernière.

Il me reste à vous remercier pour toutes ces informations passionnantes.
Audition de Mm. Edouard Couty président du conseil d'administration erik rance directeur et Mme Sabine Gibert directrice juridique de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales oniam
Audition de Mm. Edouard Couty président du conseil d'administration erik rance directeur et Mme Sabine Gibert directrice juridique de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales oniam

Nous accueillons maintenant le président, le directeur et la directrice juridique de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam). Cette audition intervient presque dix ans jour pour jour après la création de l'Oniam par la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé.
Après le scandale des prothèses PIP, il nous a semblé utile de créer une mission d'information car l'équilibre entre bénéfices attendus des dispositifs médicaux et risques encourus par les malades doit faire l'objet d'une réévaluation en profondeur.

L'Oniam dispose-t-il d'une structure interne dédiée à l'indemnisation des accidents liés à l'implantation de dispositifs médicaux ? Cette problématique relève-t-elle de sa mission générale d'indemnisation des accidents médicaux ? La multiplication des incidents liés à des dispositifs médicaux implantables n'appelle-t-elle pas la mise en place, au sein de l'Oniam, d'une structure spécifique pour les accidents liés aux dispositifs médicaux invasifs défectueux ?
Les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation (CRCI) peuvent émettre un avis sur l'existence d'un accident médical non fautif, sous certaines conditions de date (si l'accident s'est produit après le 4 septembre 2001) et de seuil d'incapacité.
A ce moment-là, l'Oniam intervient pour indemniser l'accident. En revanche, dans le cas d'un produit défectueux, c'est la responsabilité du fabricant qui est engagée sur le fondement de l'article 1386-1 du code civil et l'Oniam n'est donc pas concerné.

Et si la responsabilité du producteur n'est pas démontrée ou s'il a disparu ?
Si le produit est défectueux, l'Oniam ne peut intervenir. En cas de disparition ou de non-solvabilité du producteur, les juridictions peuvent être amenées à examiner les clauses du contrat d'assurance.

Dans le cas qui nous préoccupe, les patientes doivent financer en partie les procédures d'explantation et de remplacement de prothèses mammaires. L'Oniam n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit ?
L'Oniam ne peut intervenir que dans le cas des interventions à visée thérapeutique. Les opérations à visée exclusivement esthétique ne sont en aucun cas concernées.
Pas du tout ! Si le produit est défectueux, il appartient à la justice de se prononcer et l'assureur doit intervenir. La loi de 2002 a créé l'Oniam pour permettre l'indemnisation des accidents médicaux sans faute. Si l'assureur se défausse, il est loisible à la victime de demander réparation à l'Oniam qui se retournera alors vers l'assureur.

La création d'une procédure d'indemnisation des incidents liés à l'implantation de dispositifs médicaux défectueux nécessite-t-elle l'intervention du législateur ? Une telle procédure ne vous semble-t-elle pas justifiée au regard des insuffisances majeures du système de certification, de matériovigilance et de surveillance du marché ?
Il ne m'appartient pas de me prononcer sur l'opportunité d'une telle procédure qui est du ressort du législateur. Préciser le rôle qu'y jouerait l'Oniam relèverait également du domaine législatif. Quant aux défaillances dans le système de matériovigilance et de mise sur le marché, cela dépasse complètement le champ de compétence de l'Oniam.
J'ai présidé le groupe de réflexion sur les dispositifs médicaux lors des assises du médicament organisées après l'affaire du benfluorex. Le rapport de synthèse que j'ai présenté et qui a alimenté la loi de décembre 2011 insistait sur le renforcement des essais cliniques en amont, la transparence, une plus grande rigueur dans l'octroi du marquage CE et un contrôle plus poussé des organismes notifiés et de leurs exigences.

Merci de nous transmettre ce document.
Est-il possible d'évaluer le coût prévisionnel d'une indemnisation des incidents liés aux prothèses PIP et DePuy par la solidarité nationale ?
A mon sens, non, car nous peinons à connaître la réalité des dommages puis à déterminer leur imputabilité pour les prothèses PIP et, a fortiori, pour les prothèses DePuy.

Comment une procédure d'indemnisation par la solidarité nationale pourrait-elle s'articuler avec les procédures judiciaires en cours ? Quel régime de responsabilité pourrait-être envisagé ?
Nous sommes très dépendants de la réglementation européenne, laquelle interdit, en l'état, une indemnisation par la solidarité nationale. Cela dit, la récente directive sur la matériovigilance et la sécurité des dispositifs médicaux est en cours de révision. Actuellement, si le caractère défectueux d'un dispositif médical est reconnu, la responsabilité recherchée est celle de l'industriel.
Oui, à moins que l'on ne se trouve dans le cas d'une responsabilité sans faute...
La dichotomie est très claire entre la situation où le produit est défectueux, et celle où l'industriel peut se prévaloir d'une cause d'exonération de responsabilité, ainsi en période de risque-développement. Dès que l'article 1386-1 du code civil ne s'applique pas, nous devons rechercher d'abord s'il y a ou non faute dans le circuit de fabrication du dispositif médical et, en l'absence de toute faute commise par un acteur de santé, l'accident médical sera déclaré non fautif. Dans ce cadre, l'Oniam pourra intervenir au titre des affections iatrogènes non fautives à condition que soient remplies d'autres conditions : une date d'implantation postérieure au 4 septembre 2001, l'anormalité du dommage ou encore les critères de seuil.

L'Oniam a-t-il été sollicité pour des indemnisations d'accidents liés à des dispositifs médicaux défectueux ? Quelles sont les spécialités les plus concernées par ces demandes ?
Les CRCI, puisque c'est le point d'entrée du dispositif, sont parfois saisies de demandes d'indemnisation qui concernent surtout les prothèses de hanche et de genou ; on en revient alors au régime que j'évoquais ; si l'acte a été mal pratiqué, c'est la responsabilité du professionnel de santé qui est susceptible d'être engagée ; l'indemnisation n'est pas retenue pour les difficultés qu'entraîne l'usure des prothèses.
D'après le rapport de l'observatoire des risques médicaux qu'héberge l'Oniam, les médicaments et les dispositifs médicaux représentent 3 % des dossiers de sinistres clos en 2011, sachant que seuls sont pris en compte les sinistres supérieurs à 15 000 euros.
L'échantillon concerne aussi les assureurs.
S'agissant des dispositifs médicaux, principalement la chirurgie orthopédique.

Sur les 3 % que vous évoquiez, quelle est la proportion d'incidents liés aux dispositifs défectueux ? Qu'en est-il des prothèses cardiaques ?
Le comptage de l'observatoire ne distingue pas les dommages liés au médicament et aux dispositifs médicaux. Quant aux prothèses cardiaques, l'affaire a été traitée au contentieux, non par les CRCI, et, en tout état de cause, elles ne représentent pas un nombre très significatif de litiges.

Quelles sont les déficiences majeures du système de matériovigilance et de surveillance du marché ? Comment y remédier ?
Encore une fois, cette question, qui ne relève pas de la compétence de l'Oniam, est à traiter au niveau européen. A titre personnel, je considère que le problème réside, pour l'alerte, dans le recueil et le traitement des effets indésirables et, pour la mise sur le marché, dans le marquage CE. Celui-ci est délivré par des organismes certifiés dans les différents pays européens, un système qui diffère de celui du médicament. Il est pertinent de noter que le choix de l'organisme certificateur appartient au fabricant. Il y a sans doute des marges de progression dans ce circuit. Lors des assises du médicament, nous avions demandé une évaluation plus rigoureuse des organismes notifiés et un renforcement du marquage CE, qui porterait également sur le rapport bénéfices-risques au moyen d'essais cliniques prolongés par un suivi régulier sur l'usage du produit dans la vie réelle. C'est d'ailleurs l'option qui a été retenue dans la loi de décembre 2011.

L'observatoire des risques médicaux est chargé de recueillir et d'analyser l'ensemble des données relatives aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, ainsi qu'à leur indemnisation. Quel rôle pourrait-il jouer dans la mise en oeuvre d'un dispositif d'alerte spécifique sur les dispositifs médicaux invasifs ?
L'observatoire travaille sur un échantillon de sinistres clos et supérieurs à 15 000 euros. Il n'est donc pas le bon outil pour l'anticipation.
L'alerte relève de l'Afssaps, non de l'observatoire rattaché à l'Oniam.

Les incidents liés aux interventions de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique sont-ils nécessairement exclus de toute indemnisation par la solidarité nationale ?
La préoccupation des pouvoirs publics est d'apporter une réponse à toutes les personnes concernées. La loi de 2002, au regard des travaux préparatoires, vise les actes thérapeutiques directs, soit ceux liés à une maladie, sans exclure explicitement les actes esthétiques, contrairement à la loi belge. Il y a donc une marge d'interprétation pour les actes réparateurs liés notamment à un cancer, comme celui du sein. S'agissant des prothèses, les pouvoirs publics ont indiqué que les victimes pouvaient saisir les commissions d'indemnisation des victimes d'infractions (Civi), placées auprès des tribunaux.

Constatez-vous un accroissement des demandes d'indemnisation pour les interventions à visée esthétique ?
Non, les avocats des victimes connaissant mieux les procédures, l'Oniam n'est pas saisi davantage.
Les CRCI et les juridictions judiciaires ont considéré à chaque fois que la solidarité nationale ne pouvait pas intervenir en matière d'actes de chirurgie à visée exclusivement esthétique, à l'exception d'une décision de première instance qui avait semblé entrevoir la possibilité de faire jouer la solidarité nationale, mais pour laquelle la Cour d'appel de Douai a finalement dû requalifier l'intervention en acte de soins.
Audition de Mm. Alain Sautet secrétaire général de la société française de chirurgie orthopédique et traumatologie sofcot et christian delaunay coordinateur du registre
Audition de Mm. Alain Sautet secrétaire général de la société française de chirurgie orthopédique et traumatologie sofcot et christian delaunay coordinateur du registre

Une des réponses pour garantir à nos concitoyens un accès sécurisé à l'innovation passe par la création de registres. Le seul dont la France dispose aujourd'hui porte sur les prothèses totales de hanche, que votre société savante a créé. Dans ce domaine, la France accuse un retard certain par rapport aux pays du nord, d'où l'intérêt de votre témoignage. Mais avant de vous interroger, je dois vous rappeler que cette audition est publique et est retransmise en direct.

Quelles sont les raisons ayant poussé la Sofcot à créer ce registre ? Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? Comment améliorer ce modèle ?
Seule société des chirurgiens-orthopédistes en France, la Sofcot, qui était une société savante, est devenue professionnelle. Depuis 2004, M. Delaunay s'y bat pour la création d'un registre, qui a fini par voir le jour en 2006. Ce modèle existe en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Europe du nord, mais non aux États-Unis ; en Grande-Bretagne, il reste embryonnaire. Basé sur des données épidémiologiques concernant le patient et l'implant, il constitue un outil pour détecter rapidement les défaillances ; nous l'avons vu avec les prothèses ASR dans le registre australien. Néanmoins, un recul de dix ans est nécessaire pour une bonne appréhension du phénomène - à dix ans, 90 % des implants sont encore en place.
Grâce aux déclarations de matériovigilance, nous avons repéré des fractures de têtes zircone anormalement fréquentes.
En fait, le registre n'est pas l'instrument le plus performant pour les fractures. Il est surtout intéressant pour les effets à long terme. Quand des milliers de billes de prothèses ASR rompent en même temps, la défaillance est immédiatement reconnue.
Grâce au registre, nous pouvons noter un taux anormal de reprise de prothèses.
Une de nos difficultés tient au total manque de soutien des pouvoirs publics. Le terme de registre n'était pas utilisé il y a deux ans à la HAS. En Angleterre, il a fallu une catastrophe pour qu'on impose le registre. Il faudrait mieux anticiper. Pourquoi attendre que trois personnes meurent sur le même passage à niveau pour envisager des travaux ?
En France, on pose 144 000 prothèses totales de hanche et reprises et 80 000 à 82 000 prothèses totales de genou et reprises. La tenue d'un registre a donc un coût, que nous supportons.
Une somme comprise entre 80 000 et 100 000 euros pour le développement du registre, à laquelle il faut ajouter un euro par fiche versée à la société serveur. Autre problème évident, le fichier sur les prothèses totales de hanche est fondé sur le volontariat, alors que l'enregistrement entraîne un travail supplémentaire. Cela fonctionne techniquement, même si c'est encore un échec. D'où un taux d'enregistrement de 1 % : 2 000 fiches sur 144 000 interventions...
Quelque trente-deux centres collaborent régulièrement au registre. La difficulté est de motiver les chirurgiens ; actuellement, ils n'ont aucun intérêt à le mettre en oeuvre. Imaginons qu'ils posent cinq prothèses par jour, l'enregistrement leur demandera vingt-cinq minutes de plus devant un ordinateur.

Dans chaque hôpital, il existe un responsable des achats. Il pourrait se charger de cette tâche.
Non, car il ne pourrait pas remplir la partie médicale.
Dans ce cas, ce ne serait plus un registre.
Jeudi dernier, j'ai rencontré M. Grall, le directeur général de la santé. La solution que nous proposions consistant à lier enregistrement des données sur le registre et remboursement, est impossible juridiquement, nous a-t-on expliqué. En revanche, une piste serait de prévoir une clause sur le registre dans le contrat entre les agences régionales de santé (ARS) et les établissements de soins et de l'inclure dans la conduite des bonnes pratiques. Si ceux-ci ne la respectaient pas, ils perdraient leur agrément pour poser ce type d'implant.

Sait-on la répartition des participants au registre entre les secteurs privé et public ?
Sur les trente-trois centres, deux sont des centres hospitaliers universitaires (CHU), trois des hôpitaux privés qui participent au service public et le reste est privé. Des chiffres logiques, 60 % des prothèses de hanche étant posées dans le privé en France.
La constitution du dossier pour la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) n'a pas été une mince affaire ; là aussi, nous aurions aimé plus de soutien des pouvoirs publics.

Vous nous avez dit que votre registre ne permet pas de détecter les incidents en temps réel. Quels enseignements tirez-vous de l'utilité du registre au regard des récents problèmes ?
En temps réel, le registre serait pris de court. On peut, au bout de trois ans, dépister des implants à risque. Le nombre de reprises des prothèses ASR, 12 sur 383 patients, n'aurait pas été anormal. L'important était la cause de la reprise : un motif inexpliqué. Et là, le registre pouvait faire la différence.
Le chiffre est intéressant : 12 sur 383 ! Il y a certainement une sous-déclaration des reprises en France. Il faut renforcer le système de matériovigilance pour obtenir des données plus précises.

Les pouvoirs publics doivent-ils envisager la création d'un registre des dispositifs médicaux au niveau national, voire européen ? Les sociétés savantes ont-elles vocation à participer à leur mise en place ?
Pouvoirs publics et sociétés savantes ont un rôle complémentaire à jouer, même si leurs objectifs ne sont pas tout à fait identiques. Notre registre est totalement ouvert, chacun peut l'utiliser.
Un chirurgien qui débute pose les prothèses qu'il a appris à utiliser...
dans son CHU d'origine. Il n'y a pas de vérité unique ; à chaque cas, sa prothèse. Les congrès sont l'occasion d'améliorer nos connaissances sur les différentes sortes de prothèses.

Par définition, le lobbying pour un seul type de prothèse est donc dangereux... Quid des prothèses DePuy ?
Ce sont des prothèses métal-métal. Le principe est de mettre face à face deux diamants pour limiter les risques d'usure. Il n'y avait pas, je le crois, de mauvaise intention au départ. C'était de l'innovation, non du lobbying.
Par crainte de class actions.
Il y a eu des problèmes plus dramatiques que ceux rencontrés avec l'ASR. Pour nous, ce qui s'est passé avec cette prothèse fait partie de l'histoire de l'orthopédie : certaines innovations se révèlent de grandes réussites, d'autres moins. Le problème avec l'ASR, c'est qu'il fallait poser cette prothèse parfaitement. Dès que l'angle de pose était un peu dévié, la prothèse ne fonctionnait pas et c'est ce qui explique son échec. Mais l'implant était en lui-même très bien conçu et je puis assurer, pour avoir travaillé avec lui, que son concepteur est un homme tout à fait honnête.
Il ne faut surtout pas bloquer l'innovation. Pourquoi ne pas réfléchir à un encadrement de la mise sur le marché ?

Que pensez-vous de l'initiative de la Global Harmonisation Task Force sur l'identification des dispositifs médicaux, à savoir le système UDI (Unique Device Identification) ? Ce système représente-t-il l'étape ultime en matière de traçabilité des dispositifs médicaux à risque, de détection des incidents et de collecte d'informations ?
Nous sommes totalement pour. Je suis le correspondant pour ma société du European Arthroplasty Register qui regroupe les différents registres européens. La FDA nous a reçus il y a quelques mois afin de bénéficier des trente ans d'expérience européenne en matière de registres. Nous travaillons avec les Américains. Nous sommes bien évidemment favorables à un système international qui nous ferait bénéficier de l'expérience des autres pays. Il est impensable que chaque fabricant continue de garder son propre code barre ! Les codes barres devraient être les mêmes. Sans être la panacée, une harmonisation est indispensable pour pouvoir croiser les données.

Un registre tel que le vôtre peut-il être étendu à d'autres implants et à quelle échelle devient-il pertinent ?
La question est technique. Nous avons différents projets. Toutes les sociétés souhaitent créer un registre dans son domaine. Mais les chiffres sont cruels. Ainsi, on pose sept mille prothèses d'épaules par an en France. Si l'on est sûr que les sept mille seront enregistrées, ce sera parfait. En revanche, s'il n'y en a que 1 % dans le registre, quels enseignements pourraient en être retirés ? Aucun. A partir de quel pourcentage un registre est-il pertinent ? Un statisticien pourrait vous répondre, un orthopédiste non. Nous devons donc viser l'exhaustivité, mais le chemin est encore long.
Pour l'orthopédie, les implants qui subissent des usures doivent être surveillés par registre. En revanche, pour les implants traumatologiques, l'intérêt d'un suivi n'est pas aussi évident.
En France, on procède surtout à des implants de hanches (144 000) et de genoux. Viennent ensuite les épaules, 7 000 cas, et les chevilles, 400 cas.

Certes, mais ces interventions chirurgicales vont se développer dans les années à venir.
On reste dans les grosses articulations.