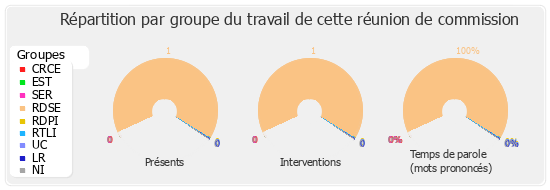Mission commune d'information sur le Mediator
Réunion du 1er juin 2011 : 1ère réunion
Sommaire
- Audition de m. jean-hugues trouvin conseiller scientifique auprès du directeur général pour les produits biologiques ancien directeur de l'évaluation à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (voir le dossier)
- Audition de m. alain-michel ceretti conseiller santé auprès du médiateur de la république auteur d'un rapport sur le bilan et les propositions de réformes de la loi du 4 mars 2001 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (voir le dossier)
- Audition de mm. didier delmotte et jérémie sécher membres titulaire et suppléant de la commission de déontologie formation spécialisée compétente pour la fonction publique hospitalière (voir le dossier)
- Audition de jacques poirier lanceur d'alerte ancien responsable de sanofi-aventis chargé des approvisionnements biologiques du lovenox et de m. emmanuel poirier assureur (voir le dossier)
La réunion
Audition de M. Jean-Hugues Trouvin conseiller scientifique auprès du directeur général pour les produits biologiques ancien directeur de l'évaluation à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Audition de M. Jean-Hugues Trouvin conseiller scientifique auprès du directeur général pour les produits biologiques ancien directeur de l'évaluation à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Nous poursuivons nos travaux avec l'audition du professeur Jean-Hugues Trouvin, conseiller scientifique auprès du directeur général pour les produits biologiques, ancien directeur de l'évaluation à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) de 2001 à 2007.
Je vous rappelle que cette audition est ouverte à la presse et pourra être diffusée sur le site Internet du Sénat ainsi que sur la chaîne Public Sénat. En application de la législation, je vous demanderai si vous avez des liens d'intérêts avec des entreprises produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits.
Je suis praticien hospitalier, professeur des universités et, à ce titre, je n'ai pas de liens d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. En revanche, je dois déclarer un lien familial : mon épouse exerce comme pharmacien responsable dans une filiale française d'un groupe pharmaceutique américain. Ce lien familial, bien antérieur à ma prise de fonctions dans le domaine de l'évaluation du médicament, a été systématiquement déclaré auprès des directeurs généraux de l'Agence du médicament puis de l'Afssaps, alors que les procédures de déclaration n'étaient pas encore en place. Par la suite, bien que les liens familiaux ne figurent pas parmi les motifs de déclaration, je les ai toujours signalés dans la case « autre ».

Qu'est-ce que la Drug Information Association (DIA) ? J'ai eu connaissance que vous aviez été décoré par cette association pour « services exceptionnels rendus à l'industrie pharmaceutique ». Puisque vous travaillez pour le compte de l'Etat dans une agence qui, à mon sens, défend en priorité les patients et la santé publique, je m'étonne de vous voir décoré par cette association.
Je comprends votre étonnement. Je pondérerais toutefois la notion de « décoration ».
Nous pourrions la qualifier plutôt de récompense ou de distinction.
Il s'agit en réalité d'un remerciement. La Drug Information Association (DIA) est une association non-profit qui réunit des autorités réglementaires et des industriels pharmaceutiques.
Elle est financée par des adhésions. Cette association internationale a pour but de partager les informations.

L'Afssaps verse-t-elle une cotisation à cette association ? En fait-elle partie ?
A ma connaissance, non. J'y ai présenté les résultats des travaux que nous menions dans le cadre de la conférence internationale d'harmonisation.
Il s'agit effectivement de l'ICH qui réunit les industriels en parité avec les autorités réglementaires.

Les patients n'y ont donc pas leur place, ni les représentants des professionnels.
Il me semble que l'ICH compte désormais des observateurs, notamment parmi les associations de patients et les professionnels. A l'époque, sous le couvert de mes activités à l'Agence européenne du médicament dans le domaine du médicament et des produits biologiques, j'ai contribué aux réunions de l'ICH. Une convention avait été passée entre la DIA et l'ICH, afin que les participants aux réunions de l'ICH puissent assister régulièrement aux réunions de la DIA pour présenter les résultats des travaux. Ces réunions étaient donc extrêmement ouvertes, à la fois aux industriels et aux autorités de santé.

Ne croyez-vous pas que vous exagérez un peu ? Ces réunions étaient plutôt consanguines. L'ICH comprenait les mêmes interlocuteurs que la DIA. De plus seuls le Japon, les Etats-Unis et l'Europe étaient représentés. Nous pouvons regretter que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) n'ait pas pris en charge cette institution qui concerne pourtant tous les pays de la planète. Les laboratoires commercialisent pourtant leurs produits également dans les pays solvables du tiers-monde. Nous pourrions penser que l'une des missions de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) est de porter les études de l'association et de l'ICH à la connaissance de ces pays.
Je dois avouer que je ne connais pas l'organisation de l'ICH. J'y étais en tant que responsable de la participation pour la partie européenne réglementaire, dans le cadre des groupes de travail et d'expertise sur les développements des médicaments biologiques et biotechnologiques. Les travaux des groupes d'experts ne permettent pas à l'ensemble des participants d'être informés de ces travaux puisque ces groupes étaient en nombre limité : quatre représentants pour la Food and Drug Administration (FDA), quatre pour le système européen, quatre pour le Japon et le même nombre pour la partie industrielle. Il fallait communiquer les résultats des travaux à l'extérieur ainsi que les justifications des décisions ou des recommandations élaborées par le système ICH dans les guidelines.

Pouvez-vous nous exposer les circonstances dans lesquelles vous avez obtenu de haute lutte cette distinction ?
L'organisation DIA a dû prendre en compte le fait que j'avais accepté de participer à quelques réunions pour présenter les résultats des travaux des groupes d'experts, ce que je faisais à chaque fois avec le plein accord soit de l'autorité réglementaire européenne, soit du directeur général de l'Agence à qui j'annonçais cette mission de représentation auprès de la DIA.

En tant que membre de l'Afssaps, l'obtention de cette distinction vous a donc paru normale. Dès 2004, la DIA a reconnu vos mérites.
Mon activité auprès d'ICH a commencé en 1996.
C'est exact.
J'y étais alors en tant que représentant français aux groupes de travail biologie/biotechnologies puisque mon activité auprès de l'Agence européenne - et avant cela auprès du comité des spécialités pharmaceutiques à Bruxelles - a commencé bien avant ma fonction de directeur de l'évaluation.
Il s'agissait pour moi d'une récompense « à la façon américaine », à l'image des brevets remis pour participation à des travaux ou à un meeting. Il me semble que je n'étais d'ailleurs pas présent lors de la remise de cette récompense.

Vous comprenez qu'à l'heure où l'on accuse - à tort ou à raison - l'Afssaps d'avoir des liens structurels et culturels avec l'industrie pharmaceutique, découvrir que tous les directeurs de l'évaluation de cette institution ont été distingués par l'industrie pharmaceutique renforce cette accusation. Il existerait des collusions et des connivences dont cette distinction pourrait être l'une des manifestations objectives.
Je n'avais pas envisagé cette récompense comme émanant de l'industrie pharmaceutique. A mon sens, cette récompense était plutôt une reconnaissance de ma participation à l'échange d'informations sur les travaux notamment de l'ICH, l'élaboration des guidelines et des recommandations pour le développement des médicaments. Cette récompense émanait de la DIA qui est une organisation non-profit et n'est pas, à ma connaissance, sponsorisée par l'industrie pharmaceutique.

Ce sont uniquement les firmes pharmaceutiques qui financent cette association.
Je vous avouerai qu'à l'époque, je ne m'étais pas intéressé de près à la question.

Comprenez-vous qu'aujourd'hui, nous nous intéressions à ces questions ?
Oui, je peux le comprendre. Néanmoins dans le domaine de l'évaluation et du développement des médicaments, je pense qu'il est nécessaire de communiquer avec les industriels qui développent les médicaments.

Vous savez très bien que les industriels siégeaient dans toutes les commissions de l'Afssaps. Plus que de la communication, il s'agissait d'une porosité, voire d'une confusion. Il a en effet fallu que Mme Bartoli mette un terme à cela en février. Jusqu'à présent, personne n'avait relevé cette anomalie. Vous aviez considéré comme normal que les membres et les représentants des entreprises du médicament (Leem) participent de façon permanente aux réunions des groupes et commissions de l'Afssaps, alors que la réglementation ne l'autorisait pas. Il s'agissait d'un véritable problème, ne pensez-vous pas ?
Lorsque j'étais en charge de la direction de l'évaluation, nous avions souvent soulevé cette question. Nous avions d'ailleurs rencontré, avec les directeurs généraux qui se sont succédé à l'Agence, le Leem à maintes reprises pour en discuter.
Les arguments avancés à l'époque pour justifier la participation du Leem aux groupes de travail et à la commission d'autorisation de mise sur le marché (AMM) étaient notamment la transmission de l'information. A l'époque où j'assurais l'organisation des commissions d'AMM, c'est-à-dire de 2001 à 2006, nous avions considéré que le Leem était présent en tant qu'invité et à titre d'information. Il ne participait évidemment pas aux débats. Dès qu'un sujet devait faire l'objet d'une discussion en vue d'une proposition de décision, comme par exemple des retraits d'AMM, le Leem était invité à quitter la salle.

Les rapports récemment rendus publics par l'Igas démontrent pourtant qu'en 2007, 90 % des experts en commission avaient des conflits d'intérêts graves mais n'étaient pas obligés de quitter la séance.
J'observe qu'à la différence des associations de patients, les représentants des laboratoires avaient le droit de participer à toutes les commissions et tous les groupes de travail de l'Afssaps. Le rapport de l'Igas indique que même la présence muette d'un représentant d'une firme ou d'un syndicat de firme pharmaceutique est de nature à influer sur le cours de la réunion. C'est pourquoi ce rapport préconise - et cela vient d'être fait - que les représentants des industries pharmaceutiques ne participent plus à ces commissions et à ces groupes. Jusqu'en février dernier, il a toujours existé une intrication entre l'industrie pharmaceutique et l'Afssaps. Plus qu'un partenariat, il s'agissait véritablement d'une coproduction.
Si vous le voulez bien, nous allons aborder le problème du Mediator. Quand en avez-vous entendu parler pour la première fois ?
Lorsque je suis arrivé en 2001, le Mediator figurait sur la liste des produits en enquête de pharmacovigilance. J'ai donc entendu parler du Mediator en 2001. J'ai également entendu parler à l'époque des dérivés de fenfluramine et norfenfluramine. En effet, lorsque j'étais à l'Agence du médicament puis à l'Afssaps - non en charge de la direction de l'évaluation mais au titre de mes compétences dans le domaine des médicaments biologiques et biotechnologiques - j'étais l'un des deux représentants français au comité des spécialités pharmaceutiques au niveau européen et notamment à l'Agence européenne du médicament. A cette époque, l'ensemble des membres du comité votaient pour les décisions de retrait ou pour répondre aux questions posées par l'industrie pharmaceutique. J'ai donc entendu parler de l'Isoméride, du Pondéral puis du Mediator.

A cette époque-là, aviez-vous eu l'occasion d'examiner la pharmacologie de ce produit ? Pensiez-vous qu'il s'agissait d'un anorexigène ou d'un « antidiabétique mal étudié », selon la formule de l'un de vos prédécesseurs ?
A mon sens, ce médicament était un dérivé proposé dans le traitement adjuvant du diabète mais n'était pas présenté comme un anorexigène.

Ce médicament n'a-t-il pas aiguisé la curiosité du service d'évaluation, en vue d'adopter une démarche proactive ? Ne vous êtes-vous pas comporté comme une véritable agence de contrôle du médicament ? N'avez-vous pas tenté d'effectuer des recherches dans la bibliographie mondiale pour vérifier s'il existait une information partiale ou partielle concernant la nature de ce médicament ? Etes-vous resté passif ?
A chaque fois que ce produit était mentionné, notamment au sein des comités techniques de pharmacovigilance, nous avons probablement manqué de réactivité. Avec le recul, nous pouvons aujourd'hui dire qu'il y a probablement eu une erreur d'interprétation qui a sans doute été alimentée pour partie par une certaine faiblesse des signaux. Il convient de rappeler que les cas de pharmacovigilance, qui sont le plus souvent les éléments permettant de déclencher l'enquête puis la prise de décisions d'évaluation ou de réévaluation, étaient particulièrement peu nombreux.
Ils étaient effectivement graves. Il était probablement difficile de déterminer rétrospectivement les facteurs déclenchants. Nous étions en 1999. Le médicament était parfois consommé ou avait été consommé en association avec des molécules comme la fenfluramine. Il y a probablement eu une non-discrimination suffisamment importante dès l'origine pour le Mediator. Ce produit n'était pas classé parmi les anorexigènes.

Il était classifié par l'OMS comme un anorexigène puisqu'il a été retiré des préparations magistrales.
La classification de l'OMS en dénomination commune internationale (DCI) ou en International Nonproprietary Names (INN) repose sur la structure chimique et la parenté chimique de la molécule. La classification INN ou DCI de l'OMS ne préjuge en rien de l'usage médical ou pharmaceutique qui pourra être fait de cette molécule. C'est lors du dépôt de la demande d'autorisation de commercialisation ou éventuellement lors de l'octroi de l'AMM - au cours duquel sont attribuées les indications thérapeutiques - que peut être donnée une autre classification : la classification anatomique, thérapeutique et chimique (ATC), qui repose sur les propriétés thérapeutiques attendues de la molécule. L'INN anatomique, thérapeutique et chimique ne permettait pas de déduire les propriétés anorexigènes que l'on pouvait attendre de cette molécule, d'autant plus que les données cliniques initiales, voire les données expérimentales sur l'animal telles qu'elles ont été transmises lors du dépôt des dossiers, ne permettaient pas d'identifier une activité sur la prise de poids.

J'imagine que vous avez eu connaissance du rapport de l'Igas faisant référence à des études publiées dans les années 70 qui démontrent que le benfluorex est un anorexigène puissant. En outre, bien que le benfluorex ne puisse pas être considéré comme un anorexigène selon vous, il a été classé comme tel et retiré à ce titre des préparations magistrales en 1995. Vous ne pouvez pas le nier. Il est grave que l'on n'ait pas procédé de la même manière pour les spécialités pharmaceutiques. Je ne comprends pas cette incohérence. Certes, vous n'étiez pas directeur de l'évaluation à cette époque. Considérez donc qu'il s'agit d'une observation et non d'une question.
En 2004 ou 2005, après l'accident avec les préparations magistrales à base de dérivés thyroïdiens, ceux-ci ont aussi été retirés des préparations magistrales pour usage anorexigène. Ils n'ont cependant pas fait l'objet d'un retrait d'AMM puisque leur usage dans la correction des hypo ou des hyperthyroïdies a été conservé parmi les spécialités pharmaceutiques.
Je pense que c'est sur la base des mêmes raisonnements qu'en 1995, le benfluorex a été retiré des préparations magistrales. Il existait alors un risque de mésusage du benfluorex compte tenu probablement de sa parenté chimique et du libellé de l'indication de l'AMM.

Pourquoi le benfluorex n'a-t-il pas été retiré des spécialités pharmaceutiques ?
A l'époque, cette spécialité était présentée comme un antidiabétique.

Lorsque nous avons supprimé l'Isoméride, nous avons pourtant observé une augmentation de la consommation de benfluorex dans des proportions considérables. Même s'il n'était pas présenté comme un anorexigène, dans les faits il était prescrit comme tel.
Ce produit a fait l'objet d'une enquête de pharmacovigilance.
La charge de la preuve d'une action pouvant conduire jusqu'au retrait de l'AMM est le plus souvent, pour ne pas dire toujours, axée sur la mise en évidence d'un risque et de cas notifiés de pharmacovigilance. Dès 1995 ou 1998, puis lorsque j'ai pris mes fonctions en 2001, il y a probablement eu une erreur d'interprétation qui s'est maintenue dans le temps. Compte tenu de la faiblesse et de la rareté des signaux, je crois que non seulement l'Agence, mais aussi les experts qui travaillaient au sein des comités techniques de pharmacovigilance et des centres régionaux de pharmacovigilance n'ont peut-être pas eu la perspicacité suffisante pour pousser plus loin les analyses.

Comment expliquez-vous qu'à aucun moment, la cardio-toxicité n'ait figuré parmi les effets indésirables ? Pour que les médecins puissent songer à imputer une valvulopathie au benfluorex, encore faut-il que cet effet indésirable soit signalé dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP). Or nous recevions quelques jours auparavant le professeur Simonneau qui nous a indiqué que cet effet indésirable n'était pas mentionné sur le Vidal, à sa grande surprise, lorsque le premier cas de valvulopathie a été signalé. Je peux comprendre que cet effet indésirable ne soit pas signalé en 1999. En revanche, je ne peux pas comprendre qu'il ne soit toujours pas mentionné en 2009 ! J'ai interrogé plusieurs personnes de l'Afssaps. Personne n'a été capable de m'expliquer cela. Peut-être pourrez-vous nous fournir une réponse.
Lorsque le RCP est octroyé après une AMM ou une révision de l'AMM, il peut être modifié à tout moment si des informations nouvelles apparaissent. Les demandes de modification de l'information sont souvent le résultat de l'analyse des rapports périodiques de pharmacovigilance. Nous avons une absence de notification ou des cas extrêmement rares.

En 2007, une soixantaine de cas avaient tout de même été relevés. Or la cardio-toxicité ne figurait toujours pas parmi les effets indésirables.
Jusqu'à ce que je quitte la direction de l'évaluation fin 2006, sachant que j'ai exercé une période d'intérim au premier semestre 2007, le nombre de cas restait relativement limité.

L'existence d'une soixantaine de cas était pourtant suffisante pour que la cardio-toxicité figure parmi les effets indésirables, ne serait-ce que pour informer les médecins. Vous leur demandez d'être proactifs et de déclarer les effets indésirables mais vous ne les aidez pas.
Par ailleurs, nous nous sommes aperçus que la modification d'un RCP était précédée d'une demande d'avis auprès du laboratoire. L'avis du laboratoire était souvent suivi. Il est vrai qu'en l'occurrence vous n'avez pas demandé l'avis du laboratoire mais je trouve cela profondément regrettable et inexplicable. Je pense que les patients ne le comprennent pas non plus. Il s'agit d'un dysfonctionnement grave.
Les procédures relatives à la modification du RCP prévoient une période contradictoire avant que le directeur de l'Agence puisse notifier la décision d'un changement d'AMM. Nous avons systématiquement appliqué cette procédure contradictoire.

Vous trouvez donc normal que la cardio-toxicité du benfluorex n'ait figuré à aucun moment parmi les effets indésirables, compte tenu des procédures en cours. Si vous pensiez que cela était normal, il n'y avait donc aucune raison de modifier les procédures.
Je pense qu'il est temps aujourd'hui de proposer des modifications de procédure.

Trouvez-vous normal que la cardio-toxicité du benfluorex n'ait pas figuré parmi les effets indésirables et ce jusqu'à la suspension de ce produit ?
Je ne peux pas me souvenir.

Je ne vous demande pas si vous vous souvenez mais si cela vous paraissait normal.
Il me semble que si les cas avaient été déclarés, reconnus et imputés par le groupe de pharmacovigilance puis par la commission de pharmacovigilance, la demande de modification de l'information aurait dû suivre la logique de cette évaluation.

Nous allons maintenant parler de Regulate. C'était encore une fois extraordinaire mais vous allez sans doute me dire que l'on ne pouvait pas faire autrement. Cet essai Regulate correspond à votre présence à la direction de l'évaluation.
En 1999 ou 2000, ce produit est évoqué à plusieurs reprises au sein des comités techniques voire au sein du groupe de travail de pharmacovigilance de l'Agence européenne. Une demande complémentaire d'étude auprès de la firme a alors été déposée. Le professeur Jean-Michel Alexandre était alors directeur de l'évaluation.
Le médicament était placé sous enquête. Une série de questions a été posée à la firme pharmaceutique exploitant le produit. Ce médicament était également en discussion au niveau européen. A mon sens, il était donc entre les mains des groupes de travail et des groupes d'experts. Il était alors en revue régulière.
Je ne dirais pas cela. Ce médicament ne faisait pas partie des priorités absolues de la direction de l'évaluation, qui devait par ailleurs mettre en place un certain nombre d'autres procédures. J'avais délégué ma compétence en la matière à l'unité de pharmacovigilance, devenue par la suite le département de pharmacovigilance. A cette époque, je dois reconnaître que j'ai suivi les procédures. Je trouve effectivement dommage - il s'agit là de mon point de vue d'ancien responsable et directeur de l'évaluation - que compte tenu des procédures en place, nous n'ayons pas de moyens de gestion supplémentaires et suffisamment proactifs pour obtenir des réponses à des questions que nous posions à l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, des procédures vont être mises en place. Elles envisagent même des pénalités de retard.

A quel point de législation faites-vous référence lorsque vous évoquez les pénalités de retard ?
Il s'agit du nouveau règlement sur la pharmacovigilance et de la directive de décembre 2010.

Vous parlez des essais post-AMM qui peuvent être demandés à tout moment par l'Afssaps.
Absolument. En 2001, la demande d'étude tarde à être réalisée. Les études sont souvent retardées à cause de difficultés méthodologiques. Il faut d'abord s'entendre sur un protocole. Nous nous heurtons parfois à un manque de compliance de l'industriel à se plier à nos exigences.

S'agit-il seulement d'un manque de compliance de l'industriel ou d'un manque de fermeté de l'Afssaps ? Pensez-vous que les autorités sanitaires savent faire preuve de l'autorité qui devrait être la leur pour contraindre le laboratoire à effectuer dans des délais raisonnables des études qui conditionnent le retrait ou la suspension d'un produit ? Il est étonnant que les autorités sanitaires n'aient fait preuve d'aucune autorité. Le laboratoire faisait ce qu'il voulait. Cela a manifestement toujours été le cas. Avez-vous des objections à formuler ?
Je pense que la fermeté ou l'autorité est aussi fonction du niveau d'alerte et de sensibilité d'un sujet. En 1999, 2000 puis 2001, le niveau d'alerte sur la cardio-toxicité de ce produit (les notifications) était relativement faible, pour ne pas dire trop faible, pour susciter une pression trop importante.

Il vous appartenait d'exercer la pression, dès lors qu'une étude avait été décidée avec l'accord du laboratoire et à l'initiative de l'Afssaps. Il était du devoir de l'Afssaps de faire en sorte que cette étude soit menée le plus rapidement possible, d'autant plus qu'elle nécessitait moins d'un an. Or il a fallu dix ans pour ce faire.
Lorsqu'on formule des questions à un industriel, l'attente est fonction du niveau d'inquiétude relatif au sujet.
Jusqu'à ce que le taux de notification augmente et soit constitutif d'une véritable alerte nous conduisant à reconsidérer nos raisonnements, je n'ai pas eu l'impression que le potentiel risque de cardio-toxicité n'ait été le sujet de priorité.
Non.

J'estime qu'une étude n'est jamais prescrite à la légère. Il y avait des raisons à ce que cette étude soit prescrite.
Cette étude visait à obtenir des compléments d'information sur ce produit.

Il a pourtant fallu attendre dix ans pour obtenir une réponse. Vous êtes extrêmement patients. Les laboratoires Servier doivent vous remercier.

Vous venez de nous dire que cette étude n'était pas prioritaire. Pouvez-vous préciser quelles étaient les priorités ?
Nous avions des procédures en cours sur les cerivastatines, le Vioxx, les immunostimulants, les antibiotiques par voie locale, qui ont consommé beaucoup d'énergie et de temps de la part de la commission nationale de pharmacovigilance et des groupes d'évaluation.

Recourir au niveau européen n'a pas de sens ; il s'agit d'une affaire purement française. Plus de 80 % du benfluorex était écoulé en France. Depuis 2003 ou 2005, le benfluorex n'était plus commercialisé en Italie.

En supposant que vous n'ayez pas été alerté par la cardio-toxicité du produit, un autre problème se posait, à savoir celui de son efficacité en tant qu'antidiabétique. Cela ne vous a-t-il pas alerté ?
En outre, il semble que des études parallèles aient été conduites à partir de 1998. En 2001, le professeur Pimpinella a clairement dit que ce produit était toxique et inefficace. Les études concomitantes entre la France et l'Italie ont été brusquement suspendues par l'Afssaps en 2001. Aviez-vous été saisi de ce problème à l'époque ? Avez-vous des explications à nous fournir ?
C'est le laboratoire qui a retiré ce médicament du marché italien, comme il l'avait fait en Espagne, peut-être pour ne pas éveiller davantage l'attention des systèmes de santé sur son produit.
A cette époque, cette information n'a pas été communiquée au comité technique de pharmacovigilance.
Ce sont d'autres facteurs qui viennent s'accumuler.

Vous êtes bien d'accord avec moi que tout ceci n'est pas sérieux. Personne ne vous croira.
Je ne pense pas que l'on ne puisse pas me croire lorsque je dis que l'information n'a pas été communiquée.

Vous pouviez aussi chercher l'information dans la littérature disponible.
Encore une fois, le niveau d'alerte n'était pas suffisant. J'ai vraiment la conviction que les moyens dont nous disposions à l'époque ne nous ont pas permis d'être aussi réactifs et vigilants que ce vous nous proposez aujourd'hui d'être.

Qu'avez-vous à répondre au sujet de l'efficacité du produit en tant qu'antidiabétique ?
Dans les années 2000, l'étude Moulin montre que l'hémoglobine glyquée - qui est le premier critère d'efficacité sur le diabète de type 2 - ne faisait pas plus mal que la metformine ou l'acarbose qui étaient alors les produits de référence.

Monsieur le professeur, j'attire votre attention sur le fait qu'en 1999, la commission de la transparence, dans le cadre d'une réévaluation de 4 000 médicaments, a considéré que le benfluorex faisait partie comme 835 autres produits des médicaments ne présentant pas de service médical rendu suffisant et qu'à ce titre il ne devait plus être pris en charge par la sécurité sociale. Or, c'est en 2000 que la commission d'AMM de l'Afssaps valide une indication pour laquelle la commission de la transparence avait estimé que le benfluorex n'était pas efficace. Cette absence de communication manifeste est regrettable. Avez-vous des explications à nous fournir ?
Le jugement de la commission de la transparence se fonde sur l'évaluation d'un service médical rendu. En revanche, le jugement de la commission d'AMM se fonde sur les indications d'un bénéfice dans un symptôme clinique donné. Les services médicaux rendus (SMR) ou ASMR sont parfois très bas pour des médicaments qui ont pourtant obtenu une AMM. De même, des médicaments qui ne font pas l'objet d'un remboursement conservent leur AMM. A l'époque des déremboursements, il me semble qu'il avait fallu préciser qu'une absence de SMR ne signifiait pas une absence d'efficacité. Le jugement et les critères d'évaluation de la commission de la transparence se fondent sur des comparaisons éventuelles d'efficacité relative de tel produit par rapport à un autre (ASMR) mais ne se fondent pas sur l'efficacité intrinsèque d'un produit.
Non. Il existe une complémentarité des évaluations. Nous pouvons parfaitement admettre que certains médicaments soient déremboursés parce que la commission de la transparence a considéré que les gains thérapeutiques et l'importance de l'effet obtenu par de nouveaux produits commercialisés dans la classe thérapeutique concernée pouvaient être supérieurs à ceux de médicaments plus anciens. La commission de la transparence procède probablement à une réévaluation permanente du SMR ou de l'ASMR, comme il doit y avoir une réévaluation constante du rapport bénéfices-risques.

En 2007, la commission nationale de la pharmacovigilance et la commission d'AMM ont rendu des avis contradictoires sur le benfluorex. En effet, la commission nationale de pharmacovigilance (CNPV) était plutôt favorable à une suspension ou à un retrait, contrairement à la commission d'AMM. Ne serait-il pas préférable de donner la priorité à l'avis de la commission nationale de pharmacovigilance, sans qu'il soit absolument nécessaire que cet avis transite par l'Afssaps ? Le directeur général a finalement opté pour l'avis transmis par la commission d'AMM, à savoir le maintien du produit, ce qui nous a encore fait perdre deux ans. Il est vrai que Regulate n'avait pas encore été réalisée.
Avez-vous eu à intervenir à ce moment-là où avez-vous encore laissé les choses évoluer d'elles-mêmes ?
Ces avis ont été rendus en mars et avril 2007. J'étais alors entre l'Agence et mes fonctions hospitalo-universitaires. Il y a eu à ce moment-là un manque de communication entre la commission nationale de pharmacovigilance et la commission d'AMM ; il aurait probablement fallu une réunion commune. Au cours des six ans de direction que j'ai assumés, j'ai organisé régulièrement - ceci figurera parmi les propositions pour l'amélioration du système de santé - tant avec le président de la commission d'AMM qu'avec le président de la commission nationale de pharmacovigilance, des réunions bipartites pour proposer une décision commune au directeur général de l'Agence. Compte tenu de cette période intérimaire, je regrette de ne pas avoir eu l'opportunité de réunir ces deux commissions pour proposer une décision au directeur général, qu'il aurait suivie ou non. Au plan purement réglementaire, je rappelle que c'est la commission d'AMM qui doit avoir le dernier mot.
Il faudrait, en effet, proposer la réunion d'un comité plus élargi, réunissant à la fois les spécialistes de l'évaluation du bénéfice et les spécialistes de l'évaluation du risque, pour mener une véritable évaluation voire une réévaluation du bénéfice-risque.
Audition de M. Alain-Michel Ceretti conseiller santé auprès du médiateur de la république auteur d'un rapport sur le bilan et les propositions de réformes de la loi du 4 mars 2001 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
Audition de M. Alain-Michel Ceretti conseiller santé auprès du médiateur de la république auteur d'un rapport sur le bilan et les propositions de réformes de la loi du 4 mars 2001 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

Nous poursuivons nos auditions avec M. Alain-Michel Ceretti, conseiller santé auprès du Médiateur de la République et auteur d'un rapport relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dont je vous recommande la lecture. Ce rapport est très intéressant car il fait le bilan de l'application de la loi relative aux droits des malades et propose des réformes. Nous aurons l'occasion de vous poser des questions à ce sujet.
Je vous rappelle que cette audition est ouverte à la presse et fera l'objet d'une diffusion sur le site Internet du Sénat et éventuellement sur la chaîne Public Sénat. Puisque vous n'êtes pas médecin, je n'ai pas à vous demander si vous avez des liens d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. Souhaitez-vous intervenir sur ce point ?
Je tiens à préciser que Xavier Bertrand m'a confié la présidence du Groupe 4 dans le cadre des Assises du médicament. J'ai remis mon rapport hier au rapporteur général, à l'occasion d'une rencontre devant une centaine de personnes dans l'amphithéâtre de la Salpêtrière. Les propositions de réforme du système du médicament suite à l'affaire du Mediator ont fait l'objet d'une présentation détaillée à l'ensemble de la profession.
Oui. Nous sommes en train de finaliser l'écriture sur des points de détail. Les présidents des groupes de travail rendent leur rapport aujourd'hui à Edouard Couty qui est le rapporteur général. Celui-ci doit rendre une synthèse de ces rapports aux ministres courant juin.

Nous souhaitons uniquement obtenir le rapport que vous avez remis à M. Couty.
Nous pourrons en parler. Les échanges d'hier ont été filmés.
Non.

J'ai une question à vous poser concernant les actions de groupe. Vous proposez d'autoriser les actions de groupe dans le domaine sanitaire. Une mission d'étude sénatoriale sur ce sujet a récemment préconisé les actions de groupe à l'exclusion de ce domaine de la santé. Cela me paraît regrettable. J'aimerais donc entendre les raisons pour lesquelles vous faites cette proposition.
Mes raisons sont d'abord personnelles. Il convient de rappeler mon parcours professionnel. Je suis chef d'entreprise dans l'industrie électronique, sans lien avec le médicament. Mon épouse a malheureusement fréquenté la Clinique du Sport. Elle a été opérée en 1991. Une infection vertébrale l'a paralysée. L'établissement ne l'a pas prise en charge. Il a fallu presque sept ans pour qu'un diagnostic soit posé. En 1997, ma femme et moi avons établi le lien de causalité entre l'opération initiale et l'infection. D'autres personnes avaient été touchées ; elles fréquentaient le même établissement à Paris. La question d'une action judiciaire collective s'est donc posée rapidement. Nous avons créé l'association des victimes du xénopi, du nom de la bactérie. Puis cette association s'est transformée, en lien avec les infections nosocomiales.
Ma première démarche en tant que président de l'association a été d'obtenir des pouvoirs publics qu'ils mettent en place des moyens permettant de retrouver les malades. Nous avons dépisté 15 000 personnes et retrouvé 60 contaminées. La deuxième étape a été de trouver une solution d'indemnisation rapide avec les compagnies d'assurance. J'ai une formation personnelle et presque familiale en matière d'assurance. Axa, qui était l'assureur principal de l'établissement, a rapidement accepté le principe de l'indemnisation de l'ensemble des victimes et par la suite de se rembourser auprès des autres assureurs en fonction des responsabilités établies. Les plaintes ont été déposées en 1997. La première instance a eu lieu fin 2009 avec des condamnations de prison ferme en mars 2010. Aujourd'hui nous attendons l'appel.
Les personnes qui n'ont pas pu bénéficier de l'accord que j'ai signé avec Axa pour l'ensemble des victimes, volontairement ou involontairement, sont en cours d'indemnisation pour des préjudices survenus entre 1990 et 1993.
La class action n'existant pas, nous avons proposé à un avocat de mutualiser les coûts pour prendre en charge l'ensemble des dossiers pour les personnes qui le souhaitaient. Nous avons trouvé un avocat qui a porté à lui seul 90 % des affaires. Il avait le sens de l'intérêt général pour les victimes. Cet avocat est devenu familier des magistrats, des compagnies d'assurance et des experts judiciaires. Cette intimité a permis de faire progresser les dossiers très rapidement.
Les affaires sanitaires sont les plus compliquées. Lorsque j'ai plaidé pour la loi du 4 mars 2002, j'ai rencontré un certain nombre de vos collègues et confrères médecins. Nous avions beaucoup parlé des infections nosocomiales. A l'époque, la jurisprudence était extrêmement favorable puisque le doute profitait à la victime. En effet, il n'appartenait plus à la victime de démontrer la faute mais il appartenait à l'établissement privé de démontrer qu'il n'avait pas commis de faute. Dans tous les autres domaines, il fallait que le lien de causalité soit certain et la faute prouvée. Lorsque le lien de causalité est incertain, il ne profite pas à la victime.
Dans le cadre du Mediator, nous n'allons pas opérer les personnes uniquement pour démontrer que les complications cardiaques sont bien liées à ce médicament. Cette question s'était posée pour le xénopi. Certaines personnes avaient été opérées de nouveau pour reconstruire les vertèbres. Pour d'autres personnes en revanche, les antibiotiques ont suffi. Cependant nous ne disposions pas de la preuve bactériologique. Elle nécessite d'effectuer un prélèvement de l'os de la colonne vertébrale pour le mettre en culture. La présomption ne suffisait pas aux compagnies d'assurance.
Il est même possible, en effet, que ce prélèvement crée des complications supplémentaires ; qui en serait alors responsable : le juge, l'expert ?
In fine, le doute a profité à la victime. La loi du 4 mars 2002 était claire : il faut un lien de causalité certain et une faute démontrée. On peut avoir une pathologie cardiaque et avoir pris du Mediator sans qu'il n'existe un lien entre les deux, sachant que 100 % des patients qui ont pris du Mediator ne vont pas développer une pathologie cardiaque. A l'inverse, 100 % des personnes qui ont pris du Mediator et développé une pathologie cardiaque ne peuvent pas affirmer à 100 % ce lien de causalité.
C'est pourquoi les victimes ont besoin d'avocats compétents sur ces questions très techniques. Nous avons donc intérêt à ce que l'avocat gère un maximum de dossiers pour augmenter ses compétences. L'affaire de la Clinique du Sport l'a démontré. De ce point de vue, l'action collective protège surtout ceux qui n'ont pas les moyens de se payer ce type d'avocat. Elle aide les plus faibles en termes de compétences et de revenus ; ce sont souvent les mêmes.
Je ne savais pas que le Sénat s'intéressait à ce sujet tout en excluant le domaine sanitaire. Cela me rappelle une disposition de la loi Kouchner permettant aux associations agréées de santé de se porter partie civile au nom de l'intérêt public. Or, les parlementaires ont introduit une modification interdisant le bénéfice de cette disposition aux affaires de santé. Ils proposaient que seules les associations agréées puissent se porter partie civile dès lors qu'elles se fondaient sur une plainte d'une victime, avec l'accord de celle-ci. Il ne s'agissait donc plus d'une action directe mais indirecte.
Dans l'affaire de l'Hôpital Pompidou en 2001 (épidémie de légionnelle), une personne avait perdu son mari. C'était la seule partie civile. Aujourd'hui, le dossier de cette personne est entre les mains du Pôle santé du tribunal de grande instance de Paris. Cette dame est venue me demander que l'association se porte partie civile en son nom. Je lui ai répondu que la loi l'interdisait. En réalité, j'indique dans mon rapport qu'il n'existe pas une seule affaire dans laquelle une association agréée se soit portée partie civile. Or les personnes adhèrent à l'association en espérant que cette association se porte partie civile.
Le Parlement a simplement voulu protéger la caste médicale. Les médecins parlementaires n'ont pas protégé l'intérêt général ; ils ont protégé leurs confrères.

Ne pensez-vous pas qu'il existe des préoccupations d'un autre ordre, par exemple le lobbying de l'industrie pharmaceutique ?
L'industrie pharmaceutique n'a pas développé d'arguments lors de ces échanges.
Nous sommes face à l'un des premiers grands scandales relatifs au médicament. J'ai suivi beaucoup d'affaires sanitaires. Je n'ai pas le souvenir que l'affaire du Vioxx ait eu un fort retentissement en France.
Je pense que non seulement l'industrie du médicament, mais plus largement le monde médical, ne souhaitent pas voir se développer l'action collective dans le domaine sanitaire. Une affaire du type de celle des irradiés d'Epinal serait de nature à faire exploser les indemnisations. Si l'accès à l'indemnisation devient presque gratuit grâce à l'action collective, personne ne refusera de se rallier à l'action collective pour des raisons économiques. Aujourd'hui la question pécuniaire en constitue le frein principal.

Votre position est extrêmement claire. Nous en tiendrons compte dans notre rapport pour faire une proposition qui aille dans ce sens.
Si le législateur estime que les actions de groupe ne sont toujours pas justifiées malgré l'affaire du Mediator, nous ne pourrons rien changer à la législation pendant vingt-cinq ans.

Il ne suffit pas qu'on propose l'action collective pour qu'elle soit mise en application. Néanmoins je vais tout mettre en oeuvre pour la proposer.
J'aimerais connaître votre avis sur la proposition actuelle du Gouvernement en matière d'indemnisation des victimes du Mediator. Je souhaiterais également savoir votre opinion sur cet empilement de fonds créées à l'occasion de drames sanitaires (Sida, hépatite C, amiante, Mediator, demain peut-être pour le lactose...). Ne faut-il pas réfléchir à un fonds permanent vers lequel orienter les victimes, leur permettant ainsi d'être dédommagées beaucoup plus rapidement ?
Nous disposons d'un bel outil : l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam), La situation des victimes d'accidents sanitaires est en effet meilleure depuis l'Oniam. Toutefois, l'Oniam n'a pas été construit pour gérer des problèmes sériels mais des situations individuelles (une difficulté opératoire, une infection nosocomiale). Par la suite, l'Oniam a récupéré le contrôle et le pilotage des fonds antérieurs à son existence. Grâce à la compétence, à l'intelligence et à la vivacité de son directeur actuel, l'Oniam a bien fonctionné dans l'affaire sérielle des irradiés d'Epinal. Il s'agissait de commencer à indemniser les personnes avant d'obtenir les expertises nécessaires pour les indemniser de façon définitive et donc d'effectuer une avance à la place de l'assureur.
Il faut conserver cet outil. Le personnel de l'Oniam est compétent car habitué à régler des sinistres corporels. En revanche la dotation financière de l'Oniam doit être à géométrie variable. Toutes les règles applicables aux accidents médicaux (seuils de gravité etc.) doivent être mises de côté pour envisager un traitement particulier. Nous devons abonder avec de l'argent frais - souvent issu de l'assurance maladie - l'Oniam, qui commence à indemniser pour récupérer ses fonds plus tard. Contrairement aux victimes, l'administration a le temps. N'oublions pas que le grand cynisme des compagnies d'assurance est de jouer sur le temps. Plus la victime vieillit, moins cela devient rentable pour elle de jouer sur le temps pour améliorer son indemnisation.

Vous ne m'avez pas dit ce que vous pensiez de la mise en place d'un éventuel fonds pérenne destiné à indemniser toutes les victimes des accidents médicamenteux de produits commercialisés par n'importe quelle firme pharmaceutique.
Parlez-vous d'un fonds public ?

Non, j'imagine un fonds alimenté par des cotisations de la part des laboratoires, sur le mode du système existant pour les accidents du travail dans les entreprises accidentogènes. Ce système préventif exonérerait peut-être les laboratoires de rendre des comptes devant la justice, sauf en cas de faute. Cela permettrait de créer une structure capable d'intervenir en urgence, sans qu'il soit besoin de recourir à des dispositions exceptionnelles. Un tel système impliquerait un changement de paradigme.
Si l'on évoque uniquement les problèmes de santé, se pose en filigrane la question de la responsabilité. C'est l'affaire du Mediator qui nous amène à réfléchir à ces questions. Dans le cadre du Mediator, nous avons tout lieu de penser à l'existence d'une faute.
Non. D'une manière générale, des responsabilités seront établies, qu'il s'agisse de Servier ou de responsabilités publiques peut-être. Il est difficile de considérer que le Mediator serait un accident sans faute. D'ailleurs, que serait un accident sans faute dans le domaine du médicament ?

Prenons l'exemple des médicaments qu'on utilise dans la goutte. Ces médicaments peuvent générer le syndrome de Lyell. Nous savons qu'il y aura un certain nombre de victimes, sans que nous puissions pour autant en imputer la responsabilité à une disposition génétique particulière. C'est inévitable.
L'Oniam indemnise ces cas.

Il semblerait que l'imputabilité ne soit pas toujours admise par les tribunaux saisis. Il faut faire quelque chose.
L'Oniam est compétent en matière de produits de santé. Il indemnisera au titre de la solidarité nationale dès lors qu'il n'y a pas de faute et que les conséquences de l'accident sont d'un certain niveau de gravité. Nous avons abaissé les seuils très récemment ; nous pourrions encore les baisser. Il faut que le lien de causalité soit parfait et démontré.
Créer un fonds qui indemnise sur une présomption d'imputabilité revient à sortir du champ légal de la responsabilité - médicale ou non - pour remettre en cause les règles d'assurance et faire supporter une présomption de lien de causalité comme celle qui pèse sur les infections nosocomiales. C'est pourquoi les assureurs ont menacé en 2003 de ne plus assurer. Dans le cadre de la loi du 30 décembre 2002, il a été proposé que seule une partie des infections nosocomiales soit de la responsabilité des assurances. En effet, les assureurs ont estimé qu'ils ne pouvaient pas payer les conséquences d'un risque incertain, ce qui est compréhensible.
Vous proposez aux victimes d'avoir un niveau d'exigence très inférieur à ce qui serait demandé dans un tribunal par un juge ou un expert, ou à l'amiable par une compagnie d'assurance. Je trouve qu'il s'agit d'une bonne proposition.

Cette proposition émane d'une association de victimes du syndrome de Lyell et de Stevens Johnson. Je la teste auprès de vous qui êtes un spécialiste.
Il faudra nécessairement faire une sélection à l'entrée. Or, cela va nourrir des sentiments d'injustice. Faut-il indemniser les personnes pour lesquelles le lien de causalité n'est pas établi ? A quel titre ?

Ce problème se posera quelle que soit la nature du fonds. Nous ne pouvons évidemment pas résoudre tous les problèmes.
L'accord que j'avais conclu avec Axa dans le cadre de l'affaire de la Clinique du Sport était satisfaisant. Le lien de causalité était clair. Nous avions une liste établie par le ministère de la santé. Nous n'avions pas déterminé de seuil de gravité. Or, tant que les expertises ne sont pas menées, l'indemnisation ne peut pas être faite. Nous avions donc sélectionné deux types de malades sur la base de deux critères : la reprise chirurgicale réparatrice ou l'antibiothérapie longue. Les victimes qui ont bénéficié de l'antibiothérapie longue ont touché 10 000 euros. Les personnes qui ont bénéficié de l'antibiothérapie longue et de la chirurgie lourde ont vu doubler leur indemnisation. Cela a permis aux victimes de bénéficier immédiatement d'une somme importante pour un lien de causalité établi. La part variable de l'indemnisation a été déterminée en fonction des résultats de l'expertise. Les conséquences d'un même accident médical peuvent être très différentes d'un cas à l'autre. Quels que soient le fonds et sa formule de financement, nous n'échapperons donc pas à une expertise qui déterminera les conséquences exactes pour chacune des victimes.

Nous allons maintenant aborder les Assises du médicament. Pouvez-vous nous résumer les conclusions auxquelles est parvenu votre groupe à l'issue de quatre mois de réflexion ? Je rappelle que votre groupe est intitulé « Développer l'information sur les produits de santé ».
Sept thèmes ont été abordés :
- la formation initiale des médecins sur le médicament ;
- la formation médicale continue ;
- la visite médicale ;
- la prescription en dénomination internationale commune (DCI) ;
- l'information médicale disponible pour le médecin (bases de données) ;
- l'information disponible pour le grand public ;
- l'information médicale en temps de crise.
Irène Frachon a participé activement à ce groupe. La présence des laboratoires était très importante.
Je vais vous exposer ce qui m'a surpris en tant que citoyen non médecin et qui a d'ailleurs été rappelé hier par Michel Chassang, qui a souhaité prendre la parole sur la question de l'AMM et de la prescription hors AMM. Nous avons évoqué la formation initiale et l'information sur le médicament durant l'activité médicale. La question des logiciels de prescription s'est posée.
J'ai été abasourdi de constater que la formation initiale en pharmacologie était absente, voire ténue. J'ai utilisé un terme hier qui n'a pas plu aux représentants du Conseil de l'Ordre. Ce terme n'est pas méchant ; il est simplement la conséquence de cette incompétence, incompétence voulue semble-t-il puisqu'en faisant en sorte que la pharmacologie soit presque absente des études de médecine, l'on reporte la compétence sur le pharmacien. Nous observons ainsi une « porosité » de la promotion du médicament auprès des médecins et notamment des médecins isolés dans leur cabinet, pour qui l'information sur le médicament est issue à 90 % de la visite médicale et à 10 % éventuellement de la revue médicale qu'ils lisent. D'ailleurs l'indépendance de la presse médicale à l'égard de l'industrie n'est pas démontrée.
Cela fait partie de mes propositions. Dès lors que ces revues veulent être reconnues dans le cadre du développement professionnel continu ou de la formation continue, elles devront répondre à un strict cahier des charges en matière de publicité, dont la part devrait être limitée à 10 % ou 15 % maximum.
Les syndicats de ces revues revendiquent 20 %. Ils sont inquiets.
S'agissant de la prescription hors AMM, Michel Chassang a dit hier : « Les médecins savaient-ils au moins ce qu'est l'AMM ? »
La formation initiale ne donne pas aux médecins les outils nécessaires à l'exercice d'un esprit critique à l'égard d'une industrie omniprésente, laquelle « surfe » allègrement sur cette compétence à géométrie très variable. La promotion des médicaments est souvent la seule information dont dispose le médecin, lequel est par ailleurs demandeur d'information sur les médicaments.
J'ai en outre été surpris que l'Afssaps exerce un contrôle a priori de l'information à destination du public mais un contrôle a posteriori sur l'information à destination des médecins.

Cela fait partie des propositions que j'avais formulées en 2005 dans le rapport sénatorial Restaurer la confiance. Je vous souhaite bien du courage. Nous allons le proposer à nouveau.
Monsieur le sénateur, j'ai appris très récemment que la commission de la publicité à l'Afssaps avait un temps de retard de près de deux mille dossiers, soit un temps de traitement d'un an à un an et demi. Cela signifie qu'elle se prononce une fois la campagne publicitaire passée. Si les médecins sont imperméables à la publicité, ils n'ont pas fait de mauvaises prescriptions hors AMM. Or ce n'est pas du tout ce que nous avons démontré lors de ces Assises.

Les médecins seraient bien les seules personnes totalement imperméables à la publicité. Ce seraient des surhommes !
Lorsque j'ai auditionné Gilles Bouvenot, il m'a dit en souriant qu'il recevait parfois des visiteurs médicaux, dans un cadre professionnel. Le dernier visiteur médical lui a vanté les mérites d'une molécule à ASMR 5, en lui rappelant que 5 était la meilleure note. Gilles Bouvenot a beaucoup ri mais combien de médecins l'ont pris pour argent comptant ? Tant que les compétences des médecins en matière de pharmacologie ne seront pas renforcées, nous devons être vigilants à l'égard de la publicité et de la visite médicale. L'industrie pharmaceutique se comporte un peu comme Tartuffe.
J'ai reçu de nombreux visiteurs médicaux ; certains m'ont été envoyés par le Leem. Entre les deux, les discours n'étaient pas les mêmes. Au cours des vingt dernières années, leur métier a changé de par la capacité de leur employeur à disposer d'informations de plus en plus précises sur les habitudes de prescription des médecins de leur région. En tant que citoyen français, j'ai été extrêmement choqué que ces informations puissent non seulement être disponibles mais aussi commercialisées. Il s'agit ni plus ni moins des prescriptions de nos médecins transmises par les pharmacies de ville à une société américaine de surcroît Health pharmaceutical intelligence (IMS). Un tiers de confiance anonymise ces données, les renvoie vers l'IMS qui les vend à prix d'or sans doute aux laboratoires.

Je vous signale que l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes) utilise aussi les données de l'IMS.
Ces données sont pertinentes ; tout dépend de l'usage qu'on en fait. Lorsqu'on les utilise pour cibler des médecins qui ne prescrivent pas assez de molécules inefficaces, je ne vois pas où se situe l'intérêt général !
Nous devons donc rendre les laboratoires un peu myopes. Je propose d'interdire non pas cette commercialisation, mais qu'elle ne descende pas en dessous du département, de sorte que l'employeur d'une équipe de visiteurs médicaux n'ait pas les chiffres de prescription officine par officine au sein d'un même arrondissement. Les visiteurs médicaux considèrent d'ailleurs que leur métier a été dénaturé : il consiste à fournir de l'information aux médecins mais on leur demande aujourd'hui de réaliser du chiffre.
Le Leem a admis qu'il est problématique que la part variable des visiteurs médicaux soit exclusivement liée à la vente de boîtes. Comment admettre la moralité de la visite médicale si la part variable des visiteurs médicaux tient non à des indicateurs de qualité mais à des résultats commerciaux ? La visite médicale représente le « quart monde » de l'industrie du médicament : ils ne sont pas bien payés ni toujours bien traités. Il faut que ces personnes voient leur métier revalorisé, si ce n'est sur le plan financier. C'est pourquoi je propose que la part variable de leur rémunération (20 % de la rémunération globale) soit assise sur des critères de qualité. Les Etats-Unis ont bien mis en place un programme d'amélioration de la qualité de la visite médicale. Il s'agit de mesurer la qualité de la visite médicale et de sanctionner fortement les dérives. Il est demandé aux médecins de participer à l'information sur les dérives. Un numéro vert ainsi qu'un site Internet dédié ont ainsi été mis en place pour qu'ils puissent témoigner de la mauvaise qualité de la visite médicale qu'ils viennent de recevoir. La Food and Drug Administration (FDA) applique des amendes très lourdes.
Les laboratoires ont demandé au centre de gestion, de documentation, d'informatique et de marketing (CeGeDIM) de mettre en place un programme d'évaluation de la visite médicale à partir de médecins sentinelles chargés de noter les visiteurs médicaux.

Une opération de ce type avait déjà été lancée par la revue Prescrire. Elle a été abandonnée il y a quelques années.
Le Leem a officiellement fait une proposition écrite aux Assises du médicament pour demander la mise en place d'un observatoire de la qualité de la visite médicale et remettre en cause la part variable de la rémunération des visiteurs médicaux exclusivement fondée sur les volumes de ventes de boîtes. J'ai eu une altercation avec M. Lajoux car il estimait scandaleux d'évoquer l'hypothèse même d'une part variable qui ne soit pas liée au moins en partie à un volume de boîtes. Or ce n'est que la démonstration de ce qu'est la visite médicale, sinon elle n'existerait pas ! Il a demandé un statut de la promotion et de la publicité du médicament.
Comme nous nous apercevons que l'information sur les médicaments dont disposent les médecins provient pour l'essentiel de la visite médicale, nous essayons de lui donner un enrobage satisfaisant. Cependant nous n'y arriverons jamais : c'est de la publicité.

Vous avez beaucoup parlé des médecins mais très peu des pharmaciens. Ils font tout de même partie de la chaîne du médicament. J'ai le sentiment que leur formation en pharmacologie est meilleure que celle des médecins. Ils ont des responsabilités au moins théoriques puisqu'ils sont censés vérifier les ordonnances qu'ils reçoivent et peuvent vendre un certain nombre de médicaments sans ordonnance. Ils reçoivent aussi des visiteurs médicaux. Ne devons-nous pas juridiquement élargir leur rôle, tant en sentinelle qu'en contrôle au regard de la vente de médicaments ?
Je vous renverrai vers mon rapport. Les pharmaciens étaient très présents dans les Assises du médicament et notamment dans le Groupe 4, pharmaciens d'officine compris.
Le groupe propose, sauf si le malade ne le souhaite pas, que l'indication figure sur l'ordonnance, pour que le pharmacien puisse détecter les aberrations éventuelles. Cela permet aussi d'effectuer un suivi du lien entre la pathologie et le médicament. Le Conseil de l'Ordre des médecins s'est montré très défavorable à cette proposition. En fait, je ne pense pas qu'il s'agisse de la position du Conseil de l'Ordre mais de celle de la personne qui s'est exprimée, le Conseil de l'Ordre n'ayant pas débattu avec nous sur cette affaire. Il faut que l'information figure dans le dossier pharmaceutique. Ce dossier doit pouvoir jouer un rôle de sentinelle ; la pharmacovigilance en découle. Alors que j'ai représenté pendant plus de dix ans les usagers, me dire qu'il s'agit d'un retour en arrière sur le secret médical, c'est faire une insulte à l'intelligence des patients.

Le pharmacien n'est pas stupide. Neuf fois sur dix, il sait pour quelle affection l'ordonnance a été prescrite.
Il y a parfois plusieurs affections.

Je dois interrompre cette audition qui a été particulièrement intéressante. Je vous en remercie.
Merci de m'avoir reçu.
Audition de Mm. Didier delMotte et jérémie sécher membres titulaire et suppléant de la commission de déontologie formation spécialisée compétente pour la fonction publique hospitalière
Audition de Mm. Didier delMotte et jérémie sécher membres titulaire et suppléant de la commission de déontologie formation spécialisée compétente pour la fonction publique hospitalière

Bienvenue. Nous poursuivons nos auditions avec MM. Didier Delmotte et Jérémie Sécher, membres titulaire et suppléant de la commission de déontologie (formation spécialisée compétente pour la fonction publique hospitalière). Je vous signale que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle sera diffusée sur le site Internet du Sénat et éventuellement sur la chaîne Public Sénat. Nous avons souhaité vous auditionner pour évoquer le problème que peut poser le passage de fonctionnaires dans l'industrie pharmaceutique et inversement et connaître votre pratique sur ce sujet. Vous pouvez commencer par une déclaration liminaire.
Je tiens à vous remercier de votre invitation à cette audition. Nous représentons la Fédération hospitalière de France (FHF) au sein de la commission de déontologie. C'est donc à ce titre que je me permets de souligner que nous allons nous exprimer sur le sujet qui est le nôtre aujourd'hui. Je souhaite vous faire part des salutations de Gérard Vincent.
La commission de déontologie est compétente pour se prononcer dans le champ de la fonction publique hospitalière sur l'appréciation d'un certain nombre de conflits d'intérêts lorsqu'un fonctionnaire de la fonction publique hospitalière est amené à envisager une activité dans une organisation privée, qu'elle soit à temps complet ou à temps partiel. L'hôpital public est évidemment concerné par les préoccupations de transparence et de régulation en la matière. Les hôpitaux publics emploient environ un million de professionnels, dont 800 000 fonctionnaires. Chaque année, 13 milliards d'euros sont dépensés pour des prestations médicales ou des services. Ces établissements sont des acteurs économiques importants pour la santé et ont des relations régulières avec les industriels, organisations et entreprises variés qui interviennent dans le champ de la santé.
Pour apprécier ces situations, il convient de se poser deux questions différentes. La première concerne les fonctionnaires et la deuxième les agents publics, en l'occurrence les médecins. Si vous le voulez bien, je traiterai le premier sujet et M. Delmotte évoquera le second dans le cadre de cette audition.
S'agissant du premier sujet, la commission de déontologie a eu une appréciation constante des situations qui lui sont proposées. Elle examine les relations qui ont eu lieu ou ont pu avoir lieu depuis trois ans entre un professionnel et une organisation donnés. Il est ensuite possible de déterminer la compatibilité ou non d'exercer soit un cumul d'activité, soit une activité par voie de détachement ou de disponibilité auprès d'une organisation privée. La commission de déontologie applique donc le critère des trois ans d'exercice apurés de tout lien avec une organisation privée. Les professionnels plus spécifiquement concernés par ce type de question sont d'une part, les décideurs, d'autre part, les acheteurs publics puisque la fonction achat public est assez importante dans les hôpitaux.
Concernant les décideurs publics, la question posée est celle du dirigeant hospitalier qui est amené à passer un certain nombre de marchés avec des entreprises privées ou des laboratoires. De ce point de vue, la Fédération hospitalière de France souscrit parfaitement aux propositions qui ont été effectuées par la mission de prévention des conflits d'intérêts. Il nous semble qu'au-delà des dispositions existantes que je viens d'évoquer - l'examen de la compatibilité de la fonction envisagée par rapport aux trois ans d'exercice passés - il convient d'adopter une logique de déclaration préalable d'intérêts, notamment pour les chefs des plus gros établissements tels que les emplois fonctionnels et les directeurs généraux de CHU.
La deuxième catégorie professionnelle plus spécifiquement concernée par la question des conflits d'intérêts est celle des acheteurs publics au sein des hôpitaux. Chacun doit garder à l'esprit que la fonction publique hospitalière a été très fortement professionnalisée ces dernières années et fait l'objet d'un encadrement très strict en vertu du code des marchés publics. Cet encadrement contribue largement en pratique à la prévention des difficultés, même si cela n'empêche pas les professionnels concernés d'être examinés assez régulièrement par la commission de déontologie sous l'angle de la compatibilité de leurs fonctions.
Si vous le voulez bien, je laisse la parole à Didier Delmotte pour aborder la question des médecins.
Pour le corps médical, deux types de problème se posent. Le premier est celui de l'installation. Jérémie Sécher pourra peut-être continuer à en parler car il a suivi le sujet du départ d'un médecin de l'hôpital et de son installation dans le secteur privé. Une nouvelle jurisprudence de la Commission de déontologie s'applique désormais à ce sujet. Le second type de problème est celui du lien avec l'industrie pharmaceutique, que j'évoquerai plus particulièrement.
Merci monsieur le Président. La Commission de déontologie est amenée depuis quelques mois à se prononcer sur des situations relatives au personnel médical, ce qui n'était pas son habitude, pour étudier les situations dans lesquelles un médecin hospitalier est amené à quitter l'établissement hospitalier pour aller travailler dans une clinique privée. La jurisprudence récente de la commission de déontologie sur le sujet est néanmoins constante. Si le départ du praticien hospitalier vers une clinique privée de l'agglomération ou de la commune a des conséquences de nature à déstabiliser le service public et à être appréciées de façon défavorable sous l'angle de la déontologie, la commission considère que l'avis de compatibilité ne peut être rendu que sous réserve d'une non-installation dans la commune ou l'agglomération des établissements de santé pour une période de trois ans. Nous retrouvons donc cette périodicité qui prévaut de manière plus générale pour les personnels fonctionnaires.
Si vous le permettez, je vais évoquer surtout évoquer les problématiques de l'expertise scientifique médicale et de la transparence de cette expertise médicale. J'étais encore directeur général de CHU il y a quelques jours. Les établissements hospitaliers sont très concernés par ce sujet car les experts sont des hospitalo-universitaires, qui sont des hospitaliers la plupart du temps. Or nous devons assurer la transparence et l'indépendance de l'expertise, à la fois lorsque l'expertise a lieu dans l'établissement universitaire et lorsqu'elle a lieu dans les différentes agences.
Les CHU jouent un rôle important en termes de soins mais également d'enseignement et de recherche. Ils sont principalement tournés vers la recherche clinique et les essais cliniques. C'est dans ce cadre que nous retrouvons la problématique des conflits d'intérêts. La problématique est celle du lien direct qui s'établit entre l'expérimentateur - que l'on appelle souvent le leader d'opinion - et le laboratoire pharmaceutique. Cela pose des problèmes d'indépendance, de transparence et de liberté d'action.
Les lois de 1993 reprises par M. Kouchner ont veillé à ce que la rupture du lien entre l'industrie pharmaceutique et l'expert scientifique soit assurée. Or cela s'avère très difficile à mettre en oeuvre au sein d'un établissement. Je vous parle d'expérience, pour l'avoir vécu pendant des années. Nous avons du mal à faire passer le message auprès des investigateurs. Nous intervenons dans la commission médicale d'établissement avec un juriste pour expliquer que la loi existe et que les protagonistes pourraient être poursuivis. Nous expliquons aux médecins qu'ils peuvent être responsables de gestion de fait si leurs associations ne sont pas reconnues officiellement et qu'ils pourraient être poursuivis fiscalement concernant les recettes de ces associations.
Nous avons proposé de verser les fonds des essais cliniques à l'hôpital nous engageant à les reverser intégralement, sans charge de gestion, aux équipes. Un certain nombre de pôles acceptent ce challenge. Une autre solution consiste à constituer une association externe, indépendante de l'industrie pharmaceutique, pour recueillir les fonds avant de les reverser aux investigateurs. A Lille, cette association s'appelle Adrinord (Association pour le développement de la recherche et de l'innovation dans le Nord-Pas-de-Calais). Pour autant, parvenons-nous à couvrir l'ensemble du champ et à éviter le lien direct ? Ce n'est pas simple. J'avais par exemple essayé de négocier avec un grand laboratoire une sorte de garantie de chiffre d'affaires sur une année. Je m'engageais à ce que des moyens d'investigation soient mis en place à cet effet. Cependant le laboratoire a refusé. En effet, les laboratoires veulent conserver ce lien direct avec l'investigateur principal.

Je pense que cela ne vous étonne pas. Vous en comprenez sans doute les raisons.
J'en comprends les raisons mais trouve cela fort dommageable. L'industrie pharmaceutique devrait y réfléchir.

L'industrie pharmaceutique réfléchit beaucoup à ces questions actuellement.
Hormis le problème de l'investigation, se pose aussi celui de la formation. Vous l'avez d'ailleurs bien relevé dans votre mission puisque j'ai lu la déclaration de Martin Hirsch, que vous avez auditionné en mars. Il considère la formation initiale pour les médecins généralistes et la formation continue pour les hospitaliers comme une problématique de fond. Nous le comprenons. Puisque les ressources de l'industrie pharmaceutique résultent du prix du médicament et sont donc portés par la sécurité sociale, Martin Hirsch a proposé que ces ressources alimentent un fonds spécifique - qui pourrait d'ailleurs être géré, paritairement, avec la possibilité pour l'industrie pharmaceutique d'être observateur ou décideur - et indépendant. Les CHU sont incapables de payer les congrès et les déplacements de nos professeurs. Actuellement, le fonds de formation médicale à l'hôpital est insuffisant. Nous devons être réalistes et adopter un autre mécanisme.
Une dépêche du 27 mai d'AstraZeneca indique clairement qu'il va cesser de financer les déplacements des médecins dans le cadre des congrès médicaux. Nous avons ainsi l'impression que cette problématique est en train d'entrer dans la culture des laboratoires et des médecins. Je rejoins tout à fait cette proposition de Martin Hirsch. La FHF propose d'ailleurs d'être à l'initiative de la création de ce fonds. Un dispositif existe pour les personnels non médicaux : l'Association nationale pour la formation hospitalière (ANFH), qui est un organisme paritaire (syndicats et employeurs représentés). Nous pouvons imaginer un dispositif de ce type. L'ANFH est candidate pour recevoir les fonds du développement professionnel continu (DPC) et assurer l'alimentation des formations continues. La Fédération hospitalière de France (FHF) a déjà engagé des négociations avec les syndicats médicaux.
Il convient d'aborder à présent le sujet des agences. Nos professionnels sont dans les agences : HAS, Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) etc. J'ai lu récemment la position que vient de prendre la Haute Autorité de santé (HAS) sur les recommandations concernant la maladie d'Alzheimer. Je les ai lues avec attention puisque l'un des professionnels du CHU de Lille est concerné par la problématique des conflits d'intérêts. Je peux cependant témoigner que cette personne n'a reçu aucun fonds personnel. J'avais même reçu sa déclaration d'intérêts. Les recommandations sur la maladie d'Alzheimer portent pour une part très réduite sur le médicament, dans la mesure où les trois quarts des recommandations portent sur l'attitude que le médecin généraliste doit adopter lorsqu'il reçoit un patient ayant des signes de cette maladie. Le généraliste ne peut pas ordonner les médicaments.

A ma connaissance, cette disposition n'a pas encore été annulée mais l'HAS l'a retirée avant même de connaître l'avis du Conseil d'Etat.
Vous voyez que les sociétés savantes considèrent que le généraliste va être sans filet lorsqu'il reçoit un malade dans son cabinet. En 2010, après la grippe, le comité d'animation du système d'agences (Casa) avait pris l'initiative de mettre en place une charte nationale de l'expertise scientifique. Je crois que nous devons adopter une telle démarche.

Cette charte a, semble-t-il, été établie par le Casa en janvier 2010 mais n'a malheureusement pas encore été publiée. Il en est fait état dans les rapports de l'Igas sur l'expertise sanitaire.
Le Conseil national de l'Ordre n'a pas vraiment envie que les publications de conflits d'intérêts soient rendues publiques. Je pense qu'il faudrait suivre les recommandations du rapport Sauvé qui demande la création d'une Haute Autorité de la déontologie de la vie publique, qui pourrait comporter un département « expertise médicale ». Cet organisme recevrait les déclarations d'intérêts et les mettrait en ligne ou au moins répondrait aux utilisateurs. Toutefois tant que nous n'aurons pas déterminé le destinataire de ces déclarations, elles resteront dans les tiroirs des agences ou du Conseil de l'Ordre. La mise à disposition de ces déclarations au public pose un véritable problème.
J'ai également relevé les propositions des Assises du médicament qui se tiennent actuellement sous la présidence de M. Edouard Couty. Il me semble important de renforcer l'expertise interne professionnelle, c'est-à-dire d'avoir des experts à temps plein, mis à disposition ou détachés de leurs fonctions.
Je crois qu'il faut un corps d'experts dans pratiquement toutes les disciplines. Il faut aller vers une professionnalisation.
Enfin j'ai retenu un élément très important : la collégialité des avis. Lorsque l'avis est pris, il est procédé à un vote officiel. Les avis contraires sont relevés. En cas de débat, ces avis peuvent ainsi être consultés.
J'ai souhaité vous apporter mon éclairage en tant que directeur d'un CHU. Le directeur d'un CHU est chargé d'assurer une partie de cette déontologie au niveau de son établissement. Nous devons assurer la rupture du lien. Une initiative intéressante a été prise par les entreprises du médicament (Leem) avec le centre national et des centres régionaux de gestion des essais des produits de santé (CeNGEPS). Il s'agit d'un groupement d'intérêts public (Gip) regroupant les CHU à 51 % et le Leem à 49 % pour promouvoir les essais cliniques en recrutant mieux des personnels pour accompagner ces essais, de manière mutualisée. Le Parlement avait voté une taxe sur l'industrie pharmaceutique pour instituer un fonds chargé de créer ce centre. Nous avons ainsi développé les essais cliniques de façon plus transparente puisque c'est le CeNGEPS et non un laboratoire qui finance le réseau d'expertise.
Il existe effectivement un registre public.
Je retiens aussi du rapport Sauvé la proposition de créer un réseau de déontologues. Chaque CHU pourrait avoir un tiers référent pour veiller à la bonne application des règles de déontologie sur chaque site.

J'ai encore une question à vous poser. Sur quelle base fondiez-vous les autorisations de départ d'un fonctionnaire au profit de l'industrie ?
Dans ces cas de figure, la commission de déontologie interroge l'établissement et le professionnel concerné pour étudier sa situation au travers de deux critères. Le premier est celui de l'absence de relation dans les trois années précédentes avec l'organisation d'accueil. Le deuxième critère, qui fait souvent l'objet d'une réserve dans l'avis de compatibilité émis par la Commission de déontologie, est celui de l'engagement à ne pas avoir de contact direct, au sein de l'établissement d'accueil, avec les professionnels en charge de l'achat public dans l'hôpital d'origine.

Je ne parle pas seulement de l'hôpital mais aussi des fonctionnaires qui exercent dans des autorités sanitaires et qui ont l'intention de travailler dans l'industrie pharmaceutique ou avec des organes liés à cette industrie.
Je n'ai pas eu de dossier de ce type.
Ce ne sont effectivement pas des questions que nous ayons été amenés à traiter en tant que représentants des hospitaliers à la commission de déontologie.

Cette question devra donc s'adresser à ceux qui traitent de la fonction publique d'Etat. Nous vous remercions.
Audition de jacques poirier lanceur d'alerte ancien responsable de sanofi-aventis chargé des approvisionnements biologiques du lovenox et de M. Emmanuel Poirier assureur
Audition de jacques poirier lanceur d'alerte ancien responsable de sanofi-aventis chargé des approvisionnements biologiques du lovenox et de M. Emmanuel Poirier assureur

Nous allons terminer cette matinée d'auditions avec M. Jacques Poirier, lanceur d'alerte, ancien responsable de Sanofi-Aventis chargé des approvisionnements biologiques du Lovenox ainsi que son fils. M. Didier Levieux, chercheur à l'Institut national de la recherche agronomique (Inra) n'a pu être présent à cette audition pour des raisons personnelles.
Je vous signale que cette audition est ouverte à la presse et sera diffusée sur le site Internet du Sénat et éventuellement sur la chaîne Public Sénat. Monsieur Poirier, puisque vous êtes docteur vétérinaire, je dois vous demander si vous avez des liens d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique.
J'ai travaillé de 1980 à 2003 pour le compte de Rhône-Poulenc, qui est devenu Aventis et s'appelle maintenant Sanofi-Aventis. Depuis que j'ai quitté cette entreprise, je n'ai plus de lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique.

Merci. Emmanuel Poirier, avez-vous des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique ?
Je ne suis pas médecin mais je travaille pour une compagnie d'assurances qui défend les médecins.

Souhaitez-vous faire une intervention liminaire pour expliquer à nos collègues en quoi votre affaire a un lien indirect avec celle du Mediator et nous exposer les difficultés que vous avez rencontrées pour vous faire entendre en tant que lanceur d'alerte ?
Je propose de faire une exposition liminaire du contexte pour montrer cette évolution à travers un certain nombre d'irrégularités observées pendant vingt ans. Rien n'a pu se faire sans la mansuétude de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps). En répondant à vos questions, je prouverai que mes affirmations sont basées sur des faits.
Le Lovenox s'appelle l'enoxaparine en dénomination commune internationale. C'est une héparine, c'est-à-dire une substance anticoagulante obtenue de façon biologique, à partir de tubes digestifs de porc. Il faut un tube digestif de porc pour fabriquer une dose de produit, ce qui représente la mise à disposition d'environ 600 millions de porcs annuellement pour 600 millions de doses, soit un chiffre d'affaires supérieur à 3,2 milliards d'euros aujourd'hui - le quasi-équivalent du chiffre d'affaires annuel de la société Servier.
En 1991, la haute direction de Rhône-Poulenc me demande urgemment de mettre en oeuvre un système destiné à sécuriser les approvisionnements en enoxaparine qui à l'époque représente un chiffre d'affaires de 2 milliards de francs. J'indique à mes supérieurs et mes collègues commerciaux qu'il faut être extrêmement vigilant au regard des tubes digestifs de porcs importés de Chine. En effet, en avril 1991, la Commission européenne venait de produire un document qui a toujours force de loi concernant les risques de transmission de maladie de la vache folle, variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Ce n'est que cinq ans plus tard que des morts seront observées en Grande-Bretagne. Ces mesures de précaution de l'administration européenne étaient d'autant plus pertinentes que cinq ans plus tard, à partir d'une cohorte de dix jeunes adultes, nous avons pu démontrer que la variante de cette maladie était transmise de l'animal à l'homme simplement par voie orale, via la consommation de viande bovine.
Le Lovenox est administré par voie parentérale et non orale. La production de plusieurs dizaines de médicaments d'origine bovine, ovine ou caprine, c'est-à-dire provenant de ruminants, a été arrêtée. Mon rôle était de coordonner un certain nombre de réflexions et d'actions sur l'ensemble de la chaîne de production de l'enoxaparine. Dès cette époque, j'avais alerté qu'il fallait assurer la traçabilité d'origine animale et géographique. Il fallait être vigilant à l'égard des approvisionnements en provenance de la Chine, qui représentait alors plus de 25 % des approvisionnements, cette part étant aujourd'hui supérieure à 50 %. J'ai aussi souligné qu'il faudrait mettre au point des méthodes analytiques susceptibles de déceler la présence de matières interdites dans les lots de fabrication. Des essais, non concluants, sont conduits en interne. En mars 1996, alors qu'éclate la crise de la vache folle, j'ai enfin été autorisé à prendre contact avec la recherche publique (l'Inra), en la personne du docteur vétérinaire Didier Levieux. En quelques semaines, ce dernier met alors au point une première méthode pour déceler les fraudes dans les lots de fabrication.
Le docteur Levieux s'aperçoit que la société refuse de mettre en oeuvre ces méthodes. Progressivement - parce qu'elle est acculée - elle les applique en France dans les abattoirs de porcs. Or, dans les abattoirs français de porcs, ne peuvent être abattus que des porcs. Par conséquent ces méthodes n'ont été mises en oeuvre que dans des endroits où l'on savait parfaitement que l'on allait obtenir de bons résultats. Parallèlement, il s'avère que l'enoxaparine était - et est toujours - largement exportée aux Etats-Unis. La Food and drug Administration (FDA) a exigé qu'aucun produit obtenu à partir de matières premières en provenance de Chine ne soit autorisé à pénétrer sur le territoire américain. Elle a également exigé que la première méthode établie par Didier Levieux et l'Inra, financée par Sanofi-Aventis, soit systématiquement mise en oeuvre. C'était une deuxième protection pour s'assurer que les tubes digestifs soient bien « pur porc ».
On pourrait se demander pour quelle raison la précaution de la FDA n'était absolument pas prise par les autorités françaises. Didier Levieux a adressé des courriers de plus en plus fermes, dans lesquels il s'indignait de la manière avec laquelle Sanofi-Aventis, qui avait financé ces études, ne les mettait pas en oeuvre alors que le concurrent de l'époque, Sanofi-Synthélabo, avait décidé d'interdire les importations de matières premières en provenance de Chine sur un produit voisin de l'enoxaparine, la Fraxiparine. J'essayais d'alerter la direction de ma société en interne.
En 2003, je suis vraiment à bout. Je prends acte de la rupture de mon contrat de travail avec la société Sanofi-Aventis et me trouve d'une certaine façon « libéré » de cette obligation de réserve. C'est à cette époque que les écarts se sont élargis entre le règlement, ce qu'affichait l'Afssaps et ce que faisait la société. Je vous remettrai des publications diverses de la presse médicale, comme La Recherche, ce sujet faisant aussi l'objet d'un chapitre complet de l'ouvrage Alerte santé d'André Cicolella.
En 2008, des morts en série surviennent aux Etats-Unis suite à l'administration d'héparine à des patients dialysés. L'enquête montre qu'il s'agit de produits commercialisés par le laboratoire américain Baxter, sur quelques lots tous d'origine chinoise. Cela ne pouvait pas être un produit de chez Sanofi-Aventis puisque les Américains avaient pris la précaution de commander de l'enoxaparine uniquement à partir de porcs français. Nous nous sommes aperçus quelques jours plus tard qu'un produit avait été ajouté frauduleusement : la chondroïtine sulfate, pour reproduire en quelque sorte les effets anticoagulants de l'héparine. Selon les dires de l'Afssaps, il n'y aurait pas - ce qui est faux - suffisamment de porcs à la surface du globe pour répondre à la demande en héparine. La tentation est donc grande de faire appel à des procédés prohibés. Il y a eu plus de quatre-vingts morts aux Etats-Unis suite à l'administration de ces produits frelatés et environ huit cents chocs qui auraient pu se terminer de façon aussi dramatique. En Allemagne, au moins cinq morts ont été homologuées.
L'Afssaps a recherché la présence de ce produit ajouté frauduleusement sur des lots d'enoxaparine provenant de Chine. Onze lots étaient contaminés. Ces produits ont été consignés. Je vous exposerai le devenir de ces lots si vous me posez la question.
Devant le risque de pénurie, l'Afssaps a finalement libéré ces lots au motif que la substance létale était en quantité bien moindre que celle qui avait tué aux Etats-Unis et avec la recommandation d'administrer l'enoxaparine par voie sous-cutanée.
L'Afssaps modifie la réglementation en matière d'approvisionnements en matières premières le 25 avril 2008. Je vous communiquerai ce document intitulé Exigences de l'Afssaps pour les héparines du marché national. La méthode permettant de détecter la chondroïtine sulfate est rendue obligatoire et rapidement mise en oeuvre. Cela sous-entend - j'en ai d'ailleurs la confirmation et Didier Levieux aussi - que cette méthode existait auparavant mais n'avait pas été rendue obligatoire.

Ces mesures ont peut-être été prises car elles correspondent à la prise de fonctions du Professeur Lechat.
C'est vous qui le dites.
Je lis : « Il est demandé de justifier de la capacité du procédé de fabrication à éliminer les contaminants ovins, bovins ou caprins. »
Il a en effet été omis !
Plus fort encore, je lis : « En cas de pénurie globale, il pourra être envisagé de s'écarter de ces exigences dans certaines limites, après concertation avec l'Afssaps et de distribuer les lots concernés. » Autrement dit, on passe outre les décisions de la commission d'autorisation de mise sur le marché (AMM). Par un document du 10 juin, puis un autre en date du 24 juillet 2008, l'Afssaps rend possible la fabrication d'enoxaparine à partir de tissus de ruminants (« tubes digestifs de ruminants »). La Commission européenne, à travers sa direction générale chargée de l'emploi et des affaires sociales, avait pourtant édicté une classification en fonction de la dangerosité des tissus de ruminants, comprenant quatre classes avec les niveaux de parité croissants de la classe 4 à la classe 7, et dans lesquelles on retrouve :
- en classe 1 : oeil et système nerveux ;
- en classe 2 : tubes digestifs.
Contre toutes les réglementations européennes et internationales, l'Afssaps autorise donc la fabrication d'héparine à partir de produits prohibés et qui n'existent d'ailleurs pas puisqu'ils doivent être détruits. Didier Levieux dit régulièrement : « Lorsque je demande un échantillon de 10 centimètres de longueur d'un tube digestif de ruminant pour effectuer des analyses, je suis obligé de remplir plusieurs demandes d'autorisation. »
On est en droit de s'interroger sur la manière dont on est arrivé à de telles irrégularités. Au début, seule la société essayait de s'arranger avec la réglementation. Didier Levieux dispose d'échanges de courriers avec les responsables de Sanofi-Aventis. Le relais est pris par l'Afssaps.
Il y a un mois, vous receviez Philippe Lechat qui est directeur de l'évaluation du médicament d'origine biologique à l'Afssaps. Vous avez commencé par parler de l'enoxaparine.
Je vous remettrai un courriel dans lequel M. Lechat explique les raisons pour lesquelles il a pris des libertés par rapport à la réglementation internationale, dont la réglementation européenne.
Aucun de ces documents n'est confidentiel.

Il est étonnant que cette affaire n'ait eu qu'un écho médiatique relativement faible. Avez-vous un bilan chiffré à nous communiquer ?
Je n'en ai aucun. Ce n'est pas de mon domaine de compétences.
Il suffit de taper sur Google « héparine chinoise ». Vous verrez que M. Lechat s'est félicité de la manière dont s'étaient déroulés les évènements en France. Il avait oublié de mentionner ce conflit d'intérêts auprès de l'EMA qui est l'agence européenne du médicament. Or, il s'agit d'une infraction. M. Lechat a pourtant fait partie de la commission ad hoc qui en 2008 a laissé à la discrétion de chaque Etat membre l'utilisation des lots contaminés.
La plupart des journalistes font remarquablement leur travail. Cependant il faut croire que des pressions s'effectuent sur les directions.

En tant qu'ancien expert de l'Agence française de sécuritaire sanitaire des aliments (Afssa), dans quelle mesure estimez-vous que l'expertise des agences sanitaires est dépendante des laboratoires ?
Excusez-moi si je ne réponds pas directement à votre question. Vous pouvez vous reporter à une lettre du pharmacien responsable de Sanofi-Aventis, M. Alain Saint-Pierre, destinée à la rédactrice en chef de la Recherche. Il lui explique qu'elle prend un grand risque et l'invite à prendre contact avec l'Afssaps car cette agence connaît très bien le dossier. Nous pouvons donc subodorer l'existence de liens.

Comment expliquez-vous que ce procédé n'ait apparemment pas provoqué de victimes en France ?
L'utilisation des anticoagulants se fait préférentiellement par voie intra-veineuse aux Etats-Unis alors que la France privilégie la voie sous-cutanée. Les résultats obtenus sur les onze lots frelatés d'enoxaparine contenaient des concentrations significativement plus faibles. En outre depuis 2008, nous mettons systématiquement en oeuvre une méthode de détection de la présence de chondroïtine sulfate.

Ces précautions ne vous semblent pas suffisantes pour éliminer tout risque.
Cela n'a rien à voir avec l'opinion. J'ai été licencié sur des motifs inavoués. Mes échanges avec Sanofi-Aventis sont suffisamment clairs à cet égard, de même que les témoignages de Didier Levieux. On voulait m'impliquer dans des approvisionnements en Chine que je considérais comme dangereux. De plus la société ne gérait pas la sécurité comme un « bon père de famille ». Nous observions une divergence entre le traitement destiné au marché américain et celui destiné au marché français ; entre le comportement de la société Aventis et celui de la société Sanofi, qui étaient alors concurrentes.
Ce sujet est hautement d'actualité. Aujourd'hui le fait que l'administration française ne soumette pas la Chine aux mêmes obligations drastiques - alors que ce sont des produits que nous recevons, autrement dit le fait que l'Afssaps autorise des produits interdits, qui ne doivent même pas exister, prouve que les irrégularités perdurent, alors que l'Afssaps s'érige à la fois en juge et partie. En effet il est régulièrement demandé à la Commission européenne, notamment à la Direction générale compétente, de réévaluer le risque. Or, en ce qui concerne l'alimentation humaine, cette direction a récemment confirmé les interdictions d'utiliser les « produits à risque spécifié », c'est-à-dire classifiés par ordre de dangerosité.
Depuis 1991, une réglementation très stricte interdit l'utilisation de toute muqueuse d'intestin de boeuf. Il faut les détruire. Dans les hôpitaux, des mesures extrêmement drastiques visent à prévenir tout risque de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Malgré tout, en 2008, l'Afssaps, de sa propre autorité, décide qu'à partir de maintenant des intestins de bovins peuvent être injectés par voie sous-cutanée chez des êtres humains alors que la provenance de ces produits est par ailleurs incertaine. Je me demande comment, de sa propre autorité, une autorité sanitaire peut s'affranchir des règles d'interdiction européennes, de surcroît après la survenue d'un accident.

C'est une bonne question que nous poserons à l'Afssaps.
Cette contribution est très intéressante même si elle peut sembler éloignée du Mediator. Les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Nous pouvons imaginer qu'une liberté prise dans l'application de certaines réglementations puisse conduire à terme à des dommages qu'il sera très difficile de prendre en charge. Dans ce domaine, il vaut mieux prévenir que guérir.
Nous vous remercions.