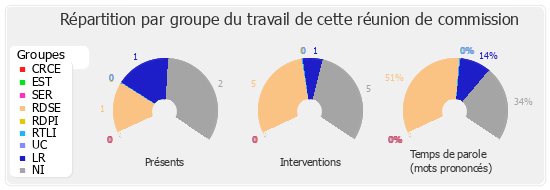Mission commune d'information sur le Mediator
Réunion du 15 février 2011 : 1ère réunion
Sommaire
- Audition de m. noël renaudin président du comité économique des produits de santé ceps (voir le dossier)
- Audition de m. didier tabuteau conseiller d'etat ancien directeur général de l'agence du médicament 1993-1997 ancien directeur-adjoint du cabinet du ministre de l'emploi et de la solidarité 1997-2000 ancien directeur du cabinet du ministre délégué à la santé 2001-2002 (voir le dossier)
- Audition de m. didier houssin directeur général de la santé (voir le dossier)
La réunion

J'ai le plaisir d'accueillir M. Noël Renaudin, président du comité économique des produits de santé (CEPS).
Je souhaite tout d'abord savoir si le CEPS est soumis à l'article L. 1421-3-1 du code de la santé publique, dont l'alinéa premier dit : « Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ne peuvent, sans préjudice des peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Ils sont tenus au secret et à la discrétion professionnelle dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.»
Ma réponse ne sera pas strictement juridique.
Tout membre du comité remplit chaque année une déclaration d'intérêts, qui est rendue publique et figure dans le rapport annuel transmis au Parlement. Cette règle de conduite est d'une application simple au CEPS car, outre les représentants de l'administration, nul membre de cette instance n'a d'intérêt, même indirect, dans l'industrie pharmaceutique, hormis, parfois, le fait qu'un proche y travaille.

J'ai lu dans La Lettre A un article intitulé « Cure de lobbying à Lourmarin », dont la première phrase commençait par les mots : « Les universités d'été de Lourmarin, orchestrées par Daniel Vial, mêlent des représentants des pouvoirs publics et de l'industrie pharmaceutique ». Il était précisé que, du 17 au 19 novembre, des responsables des laboratoires et des représentants de l'administration se sont retrouvés comme tous les ans pour une discrète université d'été organisée à Lourmarin, en Provence. Les laboratoires étaient représentés par quelque 180 invités ; Mme Roselyne Bachelot aussi avait fait le déplacement, son cabinet ayant assuré que sa visite n'avait pas d'objet particulier en plein débat sur la réforme de l'assurance maladie, de même que le président du CEPS et le Maltais M. John Dalli, Commissaire européen à la santé. Ces rencontres sont l'oeuvre de M. Daniel Vial, âgé de soixante ans, qui a fait une carrière à la lisière de l'industrie, de la presse médicale et du conseil. Il a notamment créé le Quotidien du médecin, puis la Revue pharmaceutique, une publication dont le numéro de novembre comportait votre photo. Naguère conseiller de M. Douste-Blazy lorsqu'il était ministre de la santé, M. Vial travaille aujourd'hui avec le directeur général de Sanofi-Aventis, ce qui ne l'empêche pas de recevoir les concurrents du groupe français, puisque les universités d'été se déroulent dans sa propriété.
Votre présence à ces événements est-elle compatible avec l'article du code de la santé publique que j'ai cité ? Sans que je ne mette en doute votre intégrité...

qui est irréprochable, des esprits malveillants ne pourraient-ils y voir un conflit d'intérêts ?
Je ne m'abriterai pas derrière le fait que je ne sois pas seul représentant de l'administration à cette réunion, qui n'était d'ailleurs pas organisée dans la propriété de M. Vial, mais dans un lieu ouvert au public, comme de nombreux congrès. En pratique, on retrouve à Lourmarin presque tous les participants au débat sur l'industrie pharmaceutique, pas seulement sur des questions économiques, mais aussi au titre de la sécurité sanitaire ou de l'éthique.
J'ai été nommé en avril 1999 président du comité économique du médicament - puisque telle était la dénomination en vigueur à l'époque. Depuis, j'ai participé à toutes ces universités d'été mi-septembre, où j'interviens le vendredi après-midi et le samedi pour exposer à l'industrie la politique du Gouvernement dans le domaine du médicament. De même, je participe à de très nombreuses autres manifestations, organisées avec ou sans le concours de l'industrie pharmaceutique. Je le fais parce que c'est mon devoir. Au demeurant, il n'y a là rien d'un plaisir : je sors épuisé de cet exercice difficile. Si je le pouvais, je me passerais d'y assister professionnellement.
Non. J'y vais spontanément, car j'estime que cela fait partie de mon travail.

Nous auditionnerons aussi M. Vial, pour entendre sa version.
Souhaitez-vous commencer cette audition publique par une brève déclaration ?
Disons par une brève introduction.
Le CEPS, qui était le Comité économique du médicament quand j'en ai pris la présidence, n'est compétent ni juridiquement ni techniquement pour apprécier la sécurité des produits pharmaceutiques. Vous le savez, mais il n'est pas inutile de le rappeler. Il en va de même pour l'inscription au remboursement, la suppression du remboursement et la fixation du taux : ces prérogatives relèvent du ministre, sauf la fixation des taux, transférée en 2004 au directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (Uncam).
Pour le comité et pour moi-même, le Mediator était un des nombreux médicaments dont la commission de transparence avait estimé le service médical rendu (SMR) insuffisant. A l'évidence, ces produits ne sont pas sans importance pour l'industrie pharmaceutique. C'est à ce titre que plusieurs ministres m'ont consulté au sujet du Mediator.
J'ai été nommé en 1999 président du comité, pendant que la commission de transparence conduisait la réévaluation générale engagée à l'initiative de Mme Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité. Celle-ci m'a demandé de consulter les entreprises pharmaceutiques au sujet des produits à SMR insuffisant, ce que j'ai fait. J'ai consulté les plus grandes entreprises françaises sur le marché en termes de chiffre d'affaires. Rendant compte de mes entretiens, j'ai formulé des propositions dans une note intégralement reprise par l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) dans son rapport. Concrètement, les laboratoires acceptaient plutôt le principe de la réévaluation et même la perspective de déremboursements, pourvu que l'évolution ne soit pas trop brutale.
Il me semblait impossible de supprimer le remboursement de toutes les spécialités concernées, pour des raisons industrielles car une telle mesure toucherait principalement des usines françaises, mais aussi envers les patients et leurs médecins. J'ai donc recommandé une démarche progressive fondée sur une baisse des prix et une modification du taux de remboursement, pour concilier les intérêts de l'assurance maladie, ceux des professionnels de la santé et ceux des malades, tout en conservant sa crédibilité à la politique du médicament axée sur le remboursement du juste soin. J'ai même rédigé un projet de lettre que Mme Martine Aubry aurait diffusée aux professionnels de la santé, dont je revendique la paternité. Reprise en annexe dans le rapport de l'Igas, cette missive avait pour ambition d'expliquer la réévaluation en cours, le sens du moindre remboursement et le calendrier des déremboursements.
Ces orientations ont été acceptées dans le principe : on m'a demandé de réduire de 20 % la somme des remboursements opérés pour ces produits à l'horizon de trois ans. Dans ce cadre, le Mediator a été traité comme les autres spécialités : son prix a baissé de 10 % en 2000, puis de 7 % en 2001. L'année suivante, nous avons demandé une nouvelle baisse de 5 %. Quasiment seuls parmi les entreprises pharmaceutiques, les laboratoires Servier l'ont refusée, comme pour d'autres produits, et le ministre a alors dû prendre un arrêté unilatéral de baisse des prix. Par la suite, le CEPS n'a plus jamais eu à connaître du Mediator.
Quand M. Mattei a été nommé ministre de la santé, le processus de déremboursement s'est passé en bon ordre.
Non ! M. Mattei a eu la bonne idée de classer en trois paquets les médicaments à SMR insuffisant. Le premier groupe concernait les médicaments nécessitant une action urgente, la commission de transparence ayant déclaré qu'ils n'avaient plus leur place dans une stratégie thérapeutique. Ces médicaments ont effectivement été déremboursés assez vite. Le deuxième paquet concernait des médicaments dispensés de prescription obligatoire, qui pourraient servir pour l'automédication, et dont les patients assumeraient le coût. Enfin, le troisième paquet était constitué par les produits soumis à prescription obligatoire, dont le déremboursement était à l'évidence plus difficile, faute d'offres remboursables dotées d'un bon SMR. M. Mattei a eu le temps de traiter le premier paquet.
Ensuite, la loi de 2004 a créé la Haute Autorité de santé. Bien que je n'en sois pas certain, il me semble que M. Bertrand, devenu ministre de la santé, l'a priée de se prononcer à nouveau sur les produits à SMR insuffisant. En 2006, elle a repris l'essentiel des avis déjà formulés à leur propos. J'ai été associé à ces réflexions, avant que M. Bertrand n'ouvre le sas de 15 % pour les médicaments à prescription facultative, finalement déremboursés au moment prévu. En revanche, les produits à prescription obligatoire, dont le Mediator qui n'était alors pas identifié en particulier, ont bénéficié d'un sursis. Je tiens à préciser que les considérations industrielles n'ont joué aucun rôle en 2006.
L'observateur que je suis pense que les motivations ayant conduit la ministre à ne pas dérembourser certains produits étaient dues premièrement à la situation des patients, secondairement à celle des médecins.
Je ne le crois pas. J'ai expliqué clairement que les questions industrielles pouvaient être réglées avec du temps. Oui, cela a joué dans les délais, pour l'adoption de mesures progressives, mais pas dans la décision finale de ne pas engager formellement de déremboursement. En tout cas, ce n'est pas l'impression que je retire des discours de cette époque.
Tout au long de cette affaire, la dangerosité du Mediator n'a pas été mentionnée, non plus que celle de tout autre médicament.

Vos propos confirment ceux tenus par M. Jean-François Mattei la semaine dernière sur les trois étapes du déremboursement.
Au plan scientifique, les laboratoires Servier ont-ils produit des résultats d'études sur lesquels vous avez pu procéder à des expertises ?
Votre comité a-t-il échangé avec la commission de transparence au sujet du Mediator ou d'autres médicaments déremboursés ? Pourriez-vous préciser le cadre et les critères retenus dans les conventions générales avec les entreprises du médicament (LEEM) fixant les prix des médicaments pour une période de quatre ans ?
La vocation et la compétence du CEPS ne sont pas d'examiner des études au cours de la vie du médicament. Pour le comité, le Mediator était non pas un coupe-faim, comme on le sait aujourd'hui, ni un antidiabétique comme le souhaitaient les établissements Servier, mais un médicament destiné à combattre les dyslipidémies, une famille de produits qui se partagent en quatre groupes : on y distingue les statines, les fibrates, les résines échangeuses d'ions - représentées par un médicament unique - et un dernier groupe de deux médicaments, largement dominé par le Mediator, dont les ventes devaient s'élever à l'époque à 200 millions de francs par an. L'autre médicament de ce groupe était le Fonlipol. Ces deux produits affichaient qu'un SMR insuffisant, mais c'était une caractéristique partagée avec huit cents autres spécialités.
Les relations entre le CEPS et la commission de la transparence sont limitées à la transmission des avis de la commission. C'était une position très ferme que j'ai prise dès mon entrée en fonctions comme président du Comité économique du médicament en 1999. Le Comité économique du médicament était alors soupçonné d'exercer - en sens inverse - des pressions sur la commission de la transparence pour obtenir des avis négatifs et faire ainsi des économies. J'ai donc décidé de ne pas avoir de rapports avec la commission de la transparence, et que le comité se bornerait à utiliser - sans les commenter - les avis écrits formulés par la commission de la transparence, mais il n'y a pas de dialogue entre ces instances. Bien sûr, il m'arrive de rencontrer mon homologue, mais nous ne parlons pas de produits spécifiques.
J'en viens au prix des médicaments. Commençons par un peu d'histoire : juste avant ma nomination en 1999, le Parlement avait institué une « contribution de sauvegarde ». Au terme de ce dispositif, le prix des médicaments serait dès lors fixé par convention entre le CEPS et les entreprises, ces dernières devant acquitter une « contribution de sauvegarde » si leurs ventes excédaient le plafond fixé par le Parlement, sauf accord sectoriel avec le CEPS les exonérant de ce paiement. Ma première tâche a donc été de construire concrètement le nouveau dispositif en élaborant les conventions qui exempteraient les entreprises de la contribution de sauvegarde. J'ai négocié un accord essentiellement de procédure avec le Syndicat national de l'industrie pharmaceutique (Snip), avant de déterminer unilatéralement le dispositif des remises quantitatives de fin d'année éventuellement versées par les laboratoires ayant signé un accord sectoriel avec le comité en cas de dépassement des ventes. Je devais faire en sorte que l'assurance maladie ne soit pas perdante par rapport au dispositif légal des « contributions de sauvegarde ». Cet objectif a été constamment tenu depuis dix ans. Nous devions donc ramasser autant d'argent, mais selon des modalités plus conformes à la politique du Gouvernement que les critères plus rustiques du chiffre d'affaires ou des dépenses de publicité. C'est pourquoi nous n'avons pas taxé le chiffre d'affaires des génériques, ni celui des produits thérapeutiques innovants. Tel était le contenu du premier accord avec le LEEM.
Par la suite, le Parlement a conféré une valeur législative à l'accord sectoriel, rebaptisé « accord-cadre ». Je souligne toutefois que le fond reste inchangé : il s'agit presque exclusivement d'un cadre de procédure. La seule règle en matière de fixation des prix résulte des instructions ministérielles : les principales innovations doivent être mises en vente à des prix de niveau européen, au moins pendant un certain temps. Le reste n'est qu'une question de procédure, à l'exception des médicaments orphelins. Ainsi, nous ne contractualisons pas avec l'industrie pharmaceutique pour les règles de fixation des tarifs des médicaments. Chaque année, l'annexe du rapport du CEPS explicite la méthode utilisée, en application du code de la sécurité sociale.
La doctrine s'élabore de manière unilatérale.

Il existe toutefois la procédure des dépôts de prix qui, pour les médicaments efficaces, laisse les laboratoires fixer librement leurs prix, sous la seule réserve d'un référencement par rapport à la moyenne européenne. C'est pourquoi les médicaments à amélioration du service médical rendu (ASMR) 1, 2 ou 3 et une partie de ceux à ASMR 4 sont habituellement plus chers en France.

J'en viens à ma question. Avez-vous eu l'occasion, pendant le délai de quinze jours dont vous bénéficiiez, de mettre en cause le dépôt de prix effectué par un laboratoire ? Pour préserver le budget de l'assurance maladie, la baisse des prix est plus efficace que la contribution annuelle dont vous avez parlé, qui ne me semble toucher que les produits à ASMR 5. Est-ce exact ?
Non, car les dépôts de prix sont très rares, ce que je regrette. Je pense que nous n'en avons accepté qu'un en 2010. Cela s'explique par l'existence de nombreuses et fortes contraintes : il ne doit pas y avoir d'équivalent sur le marché français qui rendrait ce prix non justifié. Outre la référence européenne, le laboratoire doit prendre des engagements proportionnés aux circonstances. La plupart du temps, les produits coûteux ne donnent de SMR élevé que pour un faible nombre de personnes, alors qu'on pourrait les utiliser dans bien plus de cas. Nous demandons alors à l'industrie de s'engager sur des reversements, parfois importants, dans l'hypothèse où les prescriptions déborderaient la population cible. Je comptais beaucoup sur le dépôt de prix pour alléger nos procédures. Mais il est toujours difficile de faire coïncider les déclarations spontanées des entreprises et les attentes du CEPS. Nous avons même dû inventer le « pré-dépôt de prix », pour négocier avant ce dépôt.
Mais la complexité est inhérente à la fixation des prix, la première difficulté consistant à déterminer la population cible, la deuxième étant de rétablir un équilibre entre ce que l'on exige d'une entreprise et le besoin que ce médicament soit sur le marché pour les malades. Le dépôt des prix n'est pas une cause de prix élevés pour les médicaments.
Il est d'autre part inexact de dire que les remises perçues par le CEPS proviennent principalement des produits à ASMR 5 : c'est le contraire, car ils procurent des économies à la sécurité sociale.
C'est la vocation de ces produits. Les médicaments à ASMR 5 font faire des économies à la Sécurité sociale. Nous demandons des remises sur les produits qui, eux, sont trop chers.
D'où viennent les remises ? D'une part, elles portent sur le coût du traitement journalier. Par exemple, quand nous négocions avec une entreprise qui vend un anti-hypertenseur selon trois ou quatre dosages, nous ne pouvons pas connaître à l'avance le dosage qui sera le plus commercialisé. Nous contractons donc sur la base d'un coût de traitement journalier. Lorsque le coût est supérieur aux prévisions, des remises sont demandées. Cette procédure spécifique aux produits coûteux peut s'appliquer aussi à des médicaments n'apportant aucune amélioration du SMR. Ainsi, le sixième sartan comporte une clause de cette nature. Si la répartition des ventes selon les dosages n'est pas conforme aux prévisions, nous demandons à être remboursés du surcoût.
Une deuxième origine des remises, beaucoup plus importante, correspond aux médicaments à fort SMR, avec une logique purement commerciale après que nous avons dû accepter le prix européen : nous demandons un rabais de quantités, en observant que nous sommes de très bons clients. La deuxième grande masse de versements concerne les spécialités dont l'amélioration du SMR est circonscrite à une fraction de l'indication. Dans ce cas, la remise est due lorsque la commercialisation excède la population cible. Elle est alors fondée sur le calcul du surcoût par rapport aux spécialités de comparaison.

Estimez-vous que le prix des médicaments est supérieur en France au reste de l'Europe ? Son niveau gêne-t-il les spécialités en pédiatrie et en gériatrie ?
Parmi les quelques études indépendantes, l'une d'elles présente des conclusions sans appel. Commençons par les médicaments d'ASMR 1, 2 et 3 pour partie : pendant les cinq ou six premières années de leur vie, leurs prix sont analogues à ceux constatés dans le reste de l'Europe. Les autres produits (à ASMR 4 ou 5) sont vendus 15 % à 20 % moins cher. Fait par des observateurs indépendants du CEPS, ce constat est logique puisque la France est le seul pays à respecter le principe : « si ce n'est pas mieux, ce doit être moins cher ». Ainsi, dans les autres pays d'Europe où les prix sont libres, le deuxième sartan coûtait plus cher que le premier, le troisième plus cher que le deuxième et ainsi de suite ; en France, le premier sartan a bénéficié d'une tarification élevée en raison d'un ASMR 3, le deuxième a été sensiblement aligné sur le premier, mais les prix ont baissé pour les autres sartans.
Après les médicaments sous brevet, j'en viens aux génériques. La France semble se situer dans la moyenne basse des prix européens : les tarifs y sont plus élevés que ceux en vigueur au Royaume-Uni, mais inférieurs à ceux pratiqués en Allemagne, par exemple. C'est un choix délibéré, car les génériques vont devenir bientôt l'étalon-or du médicament, et non plus des produits supplétifs destinés à réaliser des économies. Ils sont les seuls disponibles pour certains traitements et je souhaite que l'approvisionnement soit assuré par des entreprises ayant pignon sur rue, avec une bonne pharmacovigilance. Pour les génériques, nous ne sommes ni plus chers, ni moins chers.
Les médicaments pédiatriques bénéficient de dispositions très favorables au sein de l'accord-cadre, suivant deux règles. D'une part, un nouveau médicament pédiatrique est vendu à un prix journalier comparable à celui de la spécialité pour adultes, bien que les doses administrées soient plus faibles. D'autre part, ces produits bénéficient, en outre, d'un SMR relevé d'un cran pour l'application des règles de tarification. Par ailleurs, nous avons exempté de toute remise certains médicaments pédiatriques. Leur liste est établie par l'Afssaps.
Enfin, la France est le pays le plus généreux pour les médicaments orphelins.
Je pense que les spécialités spécifiquement gériatriques bénéficieront d'un régime comparable à celui des produits pédiatriques ou orphelins.
Il emploie au total treize personnes, outre votre serviteur et deux vice-présidents, y compris pour effectuer les activités de gestion qui relèveraient normalement du ministère de la Santé. Nous ne sommes pas des budgétivores !

Avez-vous recours à des experts ? Sont-ils membres de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) et de la commission de la transparence ?
Non, l'expertise est largement faite à l'extérieur du comité. Au sein de celui-ci, la collégialité d'une réflexion conduite par des personnes instruites sur le médicament suffit à donner de bons résultats. A fortiori, nous n'avons recours à aucun expert provenant de la commission de transparence : celle-ci ne nous transmet que ses avis.
Il arrive que les entreprises que nous auditionnons se fassent accompagner leurs représentants par des experts. Nous entendons alors ces derniers non en tant qu'experts, mais comme personnes envoyées par le laboratoire.
Il n'y a strictement aucun conflit d'intérêts.

Le classement du Mediator comme anorexigène, son nom scientifique étant le benfluorex, a-t-il constitué une alerte pour vous ?
En 2001, ce produit a coûté 30 millions d'euros à la Cnam, une somme très largement supérieure à celle correspondant à une consommation suivant les indications d'autorisation de mise sur le marché (AMM). Le CEPS s'est-il interrogé à ce propos ?
La première alerte de toxicité remonte à 1999, après que des produits semblables au Mediator eurent été interdits aux Etats-Unis. Une deuxième alerte s'est produite en 2003, lorsqu'il a été exclu du marché espagnol. Cette interrogation sur la toxicité est-elle parvenue au CEPS ?
Jusqu'à l'arrivée des génériques, nous ne connaissions que la dénomination commerciale des médicaments, pas la dénomination commune internationale (DCI). Au demeurant, aurais-je su que le Mediator s'appelait benfluorex en DCI, que cela ne m'aurait rien dit.
Je n'osais le dire. Je connais bien le professeur Abenhaïm, pour l'avoir fréquenté pendant trois ans lorsqu'il était directeur général de la santé. Il aurait sans doute réagi en apprenant l'appellation « benfluorex ».

Tout comme M. Mattei, vous avez dit qu'il était très difficile de retirer un médicament à SMR insuffisant. Le plus simple serait de ne pas commercialiser chaque année de nouveaux médicaments à SMR faible.
Cette situation conduit à des situations aberrantes. Je vais citer deux exemples d'actualité, faisant intervenir des spécialités ASMR 5 mises sur le marché pour faire réaliser des économies par la Sécurité sociale et qui figurent sur la fameuse liste des soixante-dix-sept médicaments sous surveillance : à l'absence de tout progrès thérapeutique s'ajoute donc une suspicion de dangerosité en cas de prise continue.
Comment pouvez-vous faire réaliser des économies en vendant des produits deux fois plus chers que ceux déjà présents sur le marché ?
Premier exemple, le Multaq, un anti-arythmique cardiaque avec une ASMR 5 figurant sur la liste des soixante-dix-sept médicaments surveillés : le traitement coûte 83,60 euros par mois, contre 39,32 euros pour un générique comme l'amiodarone Biogaran. Comment faites-vous des économies avec un médicament plus cher ?
Deuxième exemple, le Nexen, un anti-inflammatoire non stéroïdien qui est également un médicament de ASMR 5 inscrit sur la liste des soixante-dix-sept médicaments surveillés : il coûte 49 centimes d'euros par jour, contre 30 centimes pour l'Ibuprofène !
En quoi la recommandation de médicaments plus chers et qui n'améliorent pas le SMR des médicaments existants, peut-elle représenter une économie pour la sécurité sociale ? Si vous parvenez à nous en convaincre, bravo ! Ensuite, à la lecture des comptes rendus, j'apprends que, pour parvenir à de telles recommandations qui défient le bon sens, vous avez contesté et corrigé l'avis de la commission de transparence : n'est-ce pas outrepasser vos compétences légales ?
La comparaison des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens est très difficile à établir. Du point de vue de l'effet du médicament, on ne peut pas comparer l'Ibuprofène 200 mg et le Nexen, la question de sa dangerosité étant quelque chose de tout à fait différent sur laquelle je n'ai pas d'opinion.
Ensuite, je n'ai jamais dit que le Multaq ferait faire des économies à la sécurité sociale. Le Comité n'est pas lié par les avis qu'il reçoit de la commission de la transparence : il est dans son droit, et c'est même son devoir, de décider en opportunité, comme le fait du reste le ministre. Nous suivons l'avis de la commission de la transparence dans 99 % des cas. Dans le cas de Multaq, certains sont allés jusqu'à prétendre que la commission de la transparence aurait subi des pressions pour changer l'appréciation du SMR du Multaq : je trouve choquant de laisser entendre que les membres de cette commission pourraient se laisser influencer à ce point ! La vérité, c'est qu'elle est revenue sur sa position, après un débat contradictoire, et que le second avis était meilleur !
Certainement, mais pas d'entendre que j'aurais outrepassé mes compétences légales, que j'aurais violé la loi en ne suivant pas l'avis de la commission de la transparence !
Le Multaq appartient à la famille des anti-arythmiques, une famille de médicaments complexe qui comprend quatre classes, où l'amiodarone constitue pratiquement une classe à elle toute seule : ces médicaments ne sont donc pas substituables entre eux, et il n'y a pas eu d'anti-arythmique nouveau depuis des années.

Est-ce le président du CEPS ou de la commission de transparence qui s'exprime ?
C'est le président du CEPS, évidemment, qui vous répond, et dont le métier est de prendre des décisions. Nous avons estimé que le Multaq était le seul successeur des anti-arythmiques de classe 3, aux effets indésirables moins dangereux que ceux de classe 5. Le CEPS, au vu de ces éléments, a considéré que le Multaq pouvait être utile à ces patients : c'est le sens du changement de SMR. Nous avons attribué à Multaq une ASMR 3.

Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il était de votre compétence de passer outre l'avis de la commission de la transparence ? Quel est l'article applicable du code de la sécurité sociale ?
Un principe général du droit est qu'une autorité n'est pas liée par un avis, sauf lorsque celui-ci doit être conforme : l'administration fonctionne de la sorte.
Si, parce que la prise en charge médicale n'est pas une affaire seulement scientifique, et que nous avons pris nos responsabilités. C'est ce que nous avons fait pour Multaq, avec la direction générale de la santé, en considérant que ce médicament pouvait présenter un intérêt pour les personnes ayant des antécédents de fibrillation auriculaire et qui sont en fibrillation non permanente. Il fallait également prendre en compte deux autres sous-populations que nous avons identifiées : les patients intolérants à l'iode contenue dans l'amiodarone ; enfin, les patients souffrant d'insuffisance coronarienne. En conséquence, nous avons passé contrat avec Sanofi-Aventis, pour un prix réglé sur ces sous-populations cibles, avec une pénalité lourde en cas de dépassement, puisque le laboratoire nous rendrait la différence de prix. J'ai entendu dire que nous aurions fait là un cadeau à notre champion national en faisant payer un prix dix fois plus élevé que celui de l'amiodarone, mais il suffit de regarder de plus près pour voir qu'il n'en n'est rien : le prix du Multaq a été fixé en France plus tard qu'ailleurs, car la négociation y a duré plus longtemps qu'ailleurs, et aucun pays n'a imposé de conditions aussi restrictives que les nôtres.

Mais vous savez bien que la moitié des prescriptions sont hors AMM, et que c'est bien là le problème !
Les prescriptions hors AMM sont un problème à part entière : vous savez bien que certaines d'entre elles sont nécessaires pour soigner certains patients, mais qu'elles sont critiquables dans d'autres cas, et que ce sont ces cas que nous essayons de limiter, avec l'assurance maladie. S'agissant du Multaq, le problème ne se pose pas, puisqu'on imagine mal un cardiologue prescrire ce médicament en dehors du risque de fibrillation auriculaire...

Effectivement, c'est un médicament très spécialisé, utilisé contre une maladie elle-même assez rare et prescrit seulement par des cardiologues : nous sommes loin du risque d'une prescription hors AMM !
En revanche, je trouve choquant l'usage qui est fait de la liste des soixante-dix-sept médicaments surveillés. On y trouve en particulier le Lévothyrox, qui est très utile dans le traitement des malades de la thyroïde. En tant que médecin, je ne juge pas pertinent de prendre comme exemples, dans la liste des soixante-dix-sept médicaments, l'Advil, le Multaq ou encore le Lévothyrox.

Vous nous dites que le comité a eu connaissances d'études : dans quels cas ? Figurent-ils, ou non, dans la liste des soixante-dix-sept médicaments surveillés ?
Dans le prolongement de notre mission de 2006 sur le médicament, nous recherchons à améliorer la politique du médicament dans son ensemble : quelles vous semblent être les meilleures pistes d'une telle réforme ?
Les études portent presque exclusivement sur l'inscription de nouveaux médicaments. Nous les examinons pour mieux comprendre l'avis de la Haute autorité de santé (HAS), voire, dans des cas exceptionnels, pour ne pas suivre cet avis : c'est le cas pour le Multaq ou encore récemment pour un médicament antiparkinsonien, dont nous avons estimé qu'il manquait dans la panoplie des médicaments disponibles. Dans le cas du Multaq, une grande étude Athena nous a paru intéressante, à la direction générale de la santé et au CEPS, car elle a permis d'identifier des sous-populations pour lesquelles le Multaq était approprié. Nous avons aussi examiné les études scientifiques pour un anti-agrégant plaquettaire, qui était un médicament nouveau concurrent de Plavix, en essayant d'identifier une sous-population pour laquelle ce médicament était utile.
Sur la réforme de la politique du médicament, je crois que le CEPS n'est pas le mieux placé pour dire son avis et je ne me pense pas autorisé à dire quelles seraient les bonnes pistes.

Le rapport d'activité de la HAS souligne le petit nombre d'études post-AMM : des médicaments autorisés depuis 2004, seuls 19 % ont fait l'objet d'une étude terminée et 34 % sont en cours d'examen, ce qui veut dire que pour 47 % d'entre eux, le protocole d'études reste en cours d'expertise, voire n'a pas encore été déposé par l'industriel. Le Parlement a autorisé le CEPS à sanctionner les laboratoires qui ne réalisent pas d'étude, l'accord-cadre a inscrit ce nouveau pouvoir à son article 6 : dès lors, comment expliquez-vous que vous n'ayez encore pris aucune sanction ?
Si le comptage avait commencé un an après que ce nouveau pouvoir a été effectif, on aurait comme résultat 100 % d'études non commencées... Le processus démarre, il s'intensifie : les demandes sont faites, mais la négociation puis la conduite des études demandent du temps, et un nombre toujours plus grand de médicaments arrivent sur le marché, ce qui explique que le stock d'études à faire demeure plus important que celui des études réalisées.
Il y a cependant bien eu un problème au démarrage. Mais les torts sont difficiles à établir. Dans la convention que nous passons alors avec l'entreprise, nous tâchons de définir le cahier des charges de la manière la plus juridique possible, avant que l'étude soit approuvée par une formation resserrée, émanant de la HAS, et dénommée groupe de travail « Intérêt de santé publique et études post-inscriptions » (ISPEP). Cette procédure initiale est apparue comme une source de retard, du fait notamment que l'ISPEP était trop exigeant sur les protocoles, ce qui pouvait entraîner des échanges d'informations à l'infini. Nous avons donc modifié l'accord-cadre pour obliger l'entreprise à commencer l'étude sans attendre l'avis de l'ISPEP. D'importantes études ont d'ores et déjà été réalisées, comme celles sur les COX-2 et les glitazones.
Pourquoi n'avons-nous pas encore pris de sanction ? Parce que les choses sont plus complexes qu'il n'apparaît. L'an passé, nous avons notifié à une entreprise notre projet de la sanctionner pour défaut d'étude post-AMM ; ses responsables ont demandé à être entendus et c'est sur la base du dialogue contradictoire que nous avons eu avec eux et qui a fait apparaître l'intrication des responsabilités dans le retard de l'étude post-AMM, que le CEPS a renoncé à sanctionner. Mais le comité n'est pas soupçonnable de faiblesse, quant à son pouvoir de sanction : nous sanctionnons souvent des entreprises en matière de publicité et je ne doute pas que nous ferons de même avec notre nouveau pouvoir de sanction en cas de défaut d'étude post-AMM.

Merci pour toutes ces précisions. Nous avons appris que le CEPS pouvait aller contre les avis de la commission de transparence, c'est très instructif !

Effectivement, nous n'avions pas pris acte de ce que cet avis n'était pas conforme.
Audition de M. Didier Tabuteau conseiller d'etat ancien directeur général de l'agence du médicament 1993-1997 ancien directeur-adjoint du cabinet du ministre de l'emploi et de la solidarité 1997-2000 ancien directeur du cabinet du ministre délégué à la santé 2001-2002
Audition de M. Didier Tabuteau conseiller d'etat ancien directeur général de l'agence du médicament 1993-1997 ancien directeur-adjoint du cabinet du ministre de l'emploi et de la solidarité 1997-2000 ancien directeur du cabinet du ministre délégué à la santé 2001-2002

Monsieur Tabuteau, vous exerciez des responsabilités éminentes lorsque le problème du Mediator est apparu, puisqu'en 1995 vous étiez depuis deux ans le - premier - directeur général de l'Agence du médicament, avant de devenir le directeur-adjoint du cabinet de Mme Aubry au ministère de l'emploi et de la solidarité, entre 1997 et 2000, puis, en 2001-2002, directeur du cabinet de M. Kouchner alors ministre délégué à la santé. Nous souhaitons vous interroger sur les épisodes passés qui ont conduit à ce drame du Mediator, mais aussi sur les réformes, à votre avis, nécessaires pour qu'un tel drame ne se reproduise pas - vous écrivez sur la sécurité sanitaire depuis de nombreuses années, votre avis nous intéresse à ce titre.
Mais d'abord, je dois vous poser la question : entretenez-vous des liens d'intérêts avec des entreprises sur les questions dont nous allons parler ?
Comme je l'ai dit devant la commission d'enquête sénatoriale sur la question de la grippe H1N1, je suis depuis sept ans en position de disponibilité du Conseil d'Etat, dans le secteur privé, et je dirige la chaire « Santé » à Sciences Po, laquelle bénéficie du mécénat de sociétés comme Ipsen, Sanofi-Aventis, Abbott France, mais aussi Orange ou, auparavant, la Caisse d'Epargne ; je participe à des formations et donne des conférences à des acteurs du monde de la santé, de même que j'écris dans des journaux professionnels, en particulier dans la revue « Les Tribunes de la Santé ». Je n'ai jamais été lié aux laboratoires Servier.
Ceux qui ont contribué à la mise en place d'un système de sécurité sanitaire, aujourd'hui pris en défaut, ont eu la grande ambition - ce qui rend plus douloureux l'échec constaté actuellement - de créer un service public de sécurité sanitaire. Les constats dressés alors étaient sans appel : retards, absence d'expertise, dépendance financière vis-à-vis des laboratoires, laboratoires de contrôle littéralement sinistrés, inspections lacunaires...
L'Agence du médicament est créée en 1993, avec pour mission notamment de mettre en place un dispositif d'inspection et de participer à l'Agence européenne. On peut mettre à son actif d'avoir installé en quelques années un dispositif capable de prendre des mesures importantes de retrait du marché, en particulier de certains tests du Sida, mais aussi d'avoir renforcé les moyens de la pharmacovigilance et d'avoir mis en place une inspection d'essais cliniques.

Pendant trente ans, les laboratoires Servier ont prétendu que le Mediator n'était pas un anorexigène, qu'il ne comportait pas de fenfluramine mais qu'il ne servait qu'à traiter le diabète de type II, sans que l'administration n'y trouve rien à redire. Pourquoi l'administration n'a-t-elle fait que reproduire cette thèse fallacieuse, en se montrant incapable de penser par ses propres moyens ? C'est une question de fond, je doute que nous y répondions complètement aujourd'hui, mais je crois utile de vous la poser. Le professeur Edouard Zarifian l'avait constaté dans l'un de ses livres, Le Prix du bien-être. Les sociétés savantes sont devenues incapables d'élaborer un discours autonome, elles se contentent de reproduire la littérature promotionnelle des laboratoires : pourquoi ?
Je crois que le drame du Mediator révèle que notre système de sécurité sanitaire est resté en vase clos, nourri d'informations scientifiques circulant en circuit fermé ; le principe du contradictoire doit être un principe du système public de sécurité sanitaire. Il faut écouter davantage les experts dissidents, multiplier les auditions publiques, les bilans d'activités, pour que l'information soit diffusée et débattue. Je crois aussi que les divers acteurs devraient faire un bilan périodique de leur action, de leurs tentatives, de leurs échecs et de leurs questions. C'est ce qu'avait fait M. Bernard Kouchner en quittant le ministère de la santé, en organisant une conférence de presse pour faire le point sur tous les dossiers qu'il avait traités. Je crois que ce type de démarche est de nature à éviter l'enfermement de la connaissance et de l'expertise.

Avez-vous ressenti, comme président de l'Agence du médicament, que l'administration était incapable de penser par elle-même ?
Non, parce que le système que nous venions tout juste de renforcer, produisait un nombre qui me paraissait important d'alertes et de décisions, en particulier de retraits de produits sanguins et dérivés, dans le contexte que l'on sait de l'affaire du sang contaminé. La France, par exemple, a été alors le premier pays à retirer tout produit sanguin provenant d'un donneur qui pourrait être porteur de la maladie de Creutzfeld-Jacob.

Votre pouvoir d'influence ne vous a-t-il pas permis d'alerter les autorités sur le fonctionnement même du système ? De demander une mise en réseau plus efficace, plus ouverte à l'extérieur, en particulier aux associations ? Quelles ont été les alertes de pharmacovigilance qui ont été suivies d'effets ?
L'urgence de l'époque était de construire un réseau efficace de pharmacovigilance ; nous partions de loin et nous avons doublé les moyens des centres régionaux, de 6 à 10 millions de francs à l'époque. J'avais également proposé au cabinet du ministre, en 1996 me semble-t-il, d'ouvrir le dispositif aux représentants des associations et des usagers de la santé par voie réglementaire.
L'Agence du médicament a pris de nombreuses décisions de retrait du marché, que je ne peux vous citer toutes de mémoire. Il y a eu, en particulier, le retrait de tests du Sida, à plusieurs reprises, de l'hépatite C, de la rubéole, ou encore de l'Ananxyl, fin 1993. L'Agence réévaluait et retirait du marché, cela sans texte législatif l'y autorisant, et de façon inédite à l'échelle internationale. La pharmacovigilance a aussi permis le retrait ou l'encadrement drastique de médicaments comme le Praxilène, le Teldane, ou le Telebrix.
Sur la méthodologie même de la pharmacovigilance, je ne me sentais pas légitime pour contester ni même modifier ce qui faisait alors autorité. J'avais hésité à prendre la tête de l'Agence, à trente-quatre ans, car je n'étais pas un scientifique, et si je l'ai acceptée c'était avec l'idée d'y faire entrer davantage de scientifiques, et parce que la mise en place d'un tel dispositif nécessitait de la construction administrative.

Comment analysez-vous ce qui s'est produit en 1995 ? M. Renaudin nous a dit qu'à son avis, le déremboursement n'était pas le facteur déterminant de la prise de décision : qu'en pensez-vous, et quelle part faites-vous aux pressions exercées par les industriels ?

En 1995, la fenfluramine et le benfluorex, deux amphétamines anorexigènes, ont été retirés. Pourquoi le mouvement s'est-il fait en deux temps ? Pourquoi le cas des préparations magistrales a-t-il été traité par le ministère, et celui des préparations pharmaceutiques, par l'Agence du médicament ? Pensez-vous, que si l'Agence avait eu le monopole des préparations, les choses auraient été différentes ?
Ensuite, si votre décision rapide a réduit au dixième le nombre de boîtes de Mediator vendues, pourquoi n'y a-t-il pas eu pour autant une suspension de l'AMM ? Aux Etats-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) a retiré l'Isoméride en dix-huit mois, après quelques cas seulement d'hypertension artérielle, mais il vous a fallu plus de soixante cas et sept à huit ans pour parvenir au retrait de l'Isoméride et du Pondéral, et encore, par la décision même des laboratoires Servier qui ont prétendu agir « par précaution ». Pourquoi une telle différence d'un côté et de l'autre de l'Atlantique ? Quelle part faire aux pressions des industriels, dans cette différence de traitement ?

Pourquoi la décision de retrait a-t-elle visé seulement les préparations magistrales et non les médicaments ?
La décision de retrait, en 1995, a été le fait de la Direction de l'évaluation et du dispositif de pharmacovigilance, j'ai suivi exactement les avis que je recevais, car je ne disposais pas d'autres éléments. Cela renvoie à la nécessité de rendre l'expertise contradictoire. La décision a été suivie d'un effet immédiat : les produits retirés ont quasiment disparu du marché français.
La FDA est une agence ancienne, créée au début du XXème siècle, et qui a servi de modèle : elle a pourtant enregistré l'Isoméride en avril 1996, alors même qu'elle disposait de toutes les analyses que notre Agence, bien plus jeune et bien plus modeste, avait réalisées. La décision d'interdiction a été prise ensuite, en 1997, après survenance d'autres cas de valvulopathies, qui n'avaient pas été constatés en France. Qui a été le plus précautionneux ? Vous voyez que la réponse ne va pas de soi... J'aurais aimé que l'agence américaine prenne les mêmes précautions que nous au moment de l'agrément...

Et vous pensez qu'il serait encore sur le marché, dans ces conditions ?
Non. En ce qui concerne les préparations magistrales : le benfluorex fait partie d'une liste, établie par la commission de pharmacovigilance à la suite d'une saisine de la Direction générale de la santé. Il s'agit alors, j'imagine, d'une attitude de précaution visant à éviter les reports de prescription. Cette liste comporte trente à quarante substances actives. Je n'ai aucun moyen de déceler qu'il y a là une spécialité pharmaceutique, le Mediator, qui ne suit pas le régime des autres.

Vous n'aviez pas alors connaissance du segment clé retenu par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), « orex » ? D'où l'utilité d'user de la dénomination commune internationale. Il eût ainsi été plus facile de démasquer le benfluorex sous le Mediator.

Il semble que vous n'ayez guère été aidé par votre directeur de l'évaluation. Nous ne l'avons pas encore entendu, mais qu'il me suffise ici de citer le rapport : il affirmait alors que le benfluorex n'est pas un anorexigène mais un « antidiabétique mal étudié ». Et il le répète en 2011 ! C'est pour le moins inquiétant.
Il est légitime de supprimer le benfluorex des préparations magistrales pour éviter les reports de prescriptions, mais la suspension de l'Isoméride a eu pour conséquence des reports de prescription sur le Mediator : il y a là quelque chose qui a échappé au directeur de l'évaluation. Cela m'étonne. Quels rapports entreteniez-vous avec lui ?
Je ne peux pas répondre à la place de Jean-Michel Alexandre. Trois objectifs étaient fixés à l'Agence : excellence scientifique ; efficacité administrative, rigueur déontologique. C'est dans le souci de répondre au premier de ces objectifs qu'a été recruté Jean-Michel Alexandre, qui était le numéro un en matière d'évaluation du médicament en Europe, ce dont témoigne son élection par ses pairs au comité des spécialités pharmaceutiques de l'Agence européenne du médicament. Sa présence au sein de notre Agence constituait un gage de crédibilité scientifique. Je l'ai rencontré lorsque j'en préparais la mise en place, et il m'a fait comprendre qu'il serait prêt à s'engager, mais pour une année seulement. Il est finalement resté. Son aura scientifique en France et en Europe était un atout. Lorsque la commission de pharmacovigilance et la commission d'autorisation de mise sur le marché proposaient, ce devait être validé par Jean-Michel Alexandre. Même chose pour les lettres aux prescripteurs, primordiales, signées par des professeurs de médecine et des médecins, et cosignées par Jean-Michel Alexandre et Jean-François Girard, directeur général de la santé.
Je ne suis pas en mesure de vous dire pourquoi les préparations magistrales n'entraient pas dans le champ de l'Agence du médicament qui, comme établissement public, ne disposait que d'une compétence d'attribution. La compétence des préparations magistrales ne figurait pas dans le texte adopté par le Parlement. Vous vous souvenez de sa genèse : l'amendement qui la créait avait, après avoir été une première fois retiré, été réintroduit dans le projet de loi portant réforme de la transfusion sanguine mais sans être réécrit sous l'angle de la sécurité sanitaire. Peut-être est-ce à cela qu'il faut-il attribuer la chose ?

Indépendamment de l'expertise avant autorisation de mise sur le marché, l'essentiel du travail porte sur la pharmacovigilance. Avec des erreurs manifestes, quelle que soit la qualité des experts. La triste expérience de l'Isoméride aurait dû alerter. On a du mal à comprendre ce terrible temps de latence sur le Mediator, qui a continué à être prescrit avec beaucoup de complaisance...
Est-il inenvisageable que ceux qui sont appelés à prendre les décisions publiques en viennent à atteindre un seuil de compétence qui leur permette de lutter à armes égales avec les chercheurs des laboratoires ?
Atteindre un haut niveau scientifique faisait bien partie des objectifs assignés à l'Agence, comme à toutes les instances chargées de veiller à la sécurité sanitaire. Comment y parvenir ? A cet égard, le travail de l'Igas, dans les mois à venir, sera décisif. Il y a eu défaillance grave sur le Mediator. Il faut en examiner les raisons comme on conduit l'analyse d'un crash aérien, pour savoir s'il est imputable aux circonstances, à une défaillance spécifique ou si c'est un schéma structurel qui peut donc se reproduire.
Vous m'interrogez sur les compétences en matière d'évaluation. Nous disposons d'un vivier de chercheurs et de praticiens hospitaliers de talent. Le métier de l'évaluation gagnerait à être mieux valorisé, il devrait faire naturellement partie d'une carrière de service public. Le développement des procédures contradictoires sont propres également à stimuler le système, à toutes les étapes : la vigilance scientifique peut s'émousser, il faut la stimuler. Il serait utile, enfin, de renforcer la veille scientifique en amont, qui n'était ni suffisamment développée, ni assez valorisée en 1997. Voyez ce que fait aujourd'hui l'Igas : elle va rechercher les publications anciennes qui auraient dû alerter. Mais au-delà des experts, il est bon d'associer aussi l'ensemble des professionnels à notre système de vigilance, pour développer une dynamique de santé publique.

Vous rejoignez là les propositions qu'avait formulées le Sénat en 2006, à la suite de l'affaire du Vioxx.
Vous nous dites que vos compétences ne sont pas scientifiques. Mais c'est bien le directeur général de l'Agence qui est responsable des décisions scientifiques, qu'il signe.
C'est en effet au directeur général qu'il revient non seulement d'organiser le système, mais de prendre les décisions. S'il ne le fait pas, il est fautif. Mais il n'a pas les compétences scientifiques nécessaires pour refaire l'analyse qui a été produite au sein de l'institution. Avant de signer, il s'assure qu'il y a bien eu analyse et que les propositions des instances scientifiques sont bien conformes aux conclusions de cette analyse.

Vous avez évoqué le rejet par l'Agence de tests de dépistage du Sida. Ne pensez-vous pas qu'il est des sujets sur lesquels on est plus vigilants que sur d'autres ? Je reviens d'une réunion de l'Académie de médecine où j'ai vu des chercheurs s'interroger sur le Subutex... Ma question est la suivante : y a-t-il des médicaments dont on tait systématiquement les effets secondaires possiblement nocifs ? Je pense notamment aux médicaments post-ménopause ou à l'association de contraceptifs avec d'autres principes actifs, dont on ne dit rien. Le levier du déremboursement est puissant, mais le contexte de l'information compte aussi : il peut conduire à occulter certaines pathologies aux conséquences majeures.
Je ne suis pas pharmacologue, mais il est vrai qu'à l'époque, certains produits jugés sensibles étaient très suivis. Je pense en particulier aux produits sanguins. Cela étant, au vu des alertes et des décisions de pharmacovigilance, il me semble que le spectre du contrôle était très large et je n'ai pas l'impression que nous ayons été affligés de myopie sur certains secteurs. On sait aujourd'hui que l'on peut laisser de côté une question lourde, mais je n'en avais pas le sentiment alors.

M. Mirassou comparaît les « sachants » des laboratoires privés aux « sachants » des opérateurs publics. Mais je rappelle que ce sont toujours les laboratoires privés qui fournissent les études. Lorsqu'ils les transmettent, ce n'est pas sans quelques malencontreux coups de gomme. Je pense notamment à cette phrase, hélas disparue, d'une étude de 1999, qui signalait que « le benfluorex n'est qu'un précurseur de plusieurs métabolites immédiats dont la norfenfluramine ». Je me demande également si le système ne souffre pas d'avoir trop longtemps tenu à l'écart les lanceurs d'alerte. Il faut entendre les victimes, les médecins comme Irène Frachon. Il faut que leurs appels entrent dans un dispositif officiel.
Il faut que les pouvoirs publics aient les moyens de conduire des études pharmaco-épidémiologiques et de pharmacologie clinique, financées sur fonds publics. Dès 1995, l'Agence a engagé quelques tentatives, en créant un comité d'appels d'offres - la première portait notamment sur les médicaments et la grossesse - afin que les pharmacologues cliniciens hospitaliers puissent mener de telles études sur crédits publics. Le niveau des crédits dont nous pouvions disposer était, certes, sans commune mesure avec ceux que peuvent mobiliser les laboratoires pour les autorisations de mise sur le marché, mais il nous gardait néanmoins d'une totale dépendance vis-à-vis des laboratoires - dont il reste juste, cependant, que des études leur soient imposées sur leurs produits pour éclaircir des points jugés douteux.
Je vous rejoins sur les lanceurs d'alerte. Ils ont besoin d'un statut protecteur - et cela, on sait le faire : on l'a fait sur la maltraitance. Il faut également que les alertes « dissidentes » puissent être entendues. Celles des associations de consommateurs ne suffisent pas. Des auditions publiques conduites à un rythme semestriel ou annuel en matière de pharmacovigilance ou d'autorisations de mise sur le marché donneraient l'occasion aux lanceurs d'alerte de développer leur discours devant une commission de scientifiques. C'est une démarche à mon sens indispensable. Les crises de sécurité sanitaire ont montré que les alertes étaient souvent la meilleure voie pour mettre au jour ce que même les meilleurs systèmes d'expertise n'avaient pas vu.

Entendez-vous qu'il faille en mettre en place dans tous les domaines ? Je pense aux sujets occultés, comme celui des implants mammaires. Mais cela a un coût...
Tous les domaines touchant à la sécurité sanitaire méritent d'être couverts : produits de santé, pratiques médicales, environnement, alimentation... Autant les études pharmacologiques sont onéreuses, autant une meilleure prise en compte des lanceurs d'alerte, via des auditions publiques, ne l'est pas. Cela mobilise davantage les moyens de l'institution, sur quelques jours, que des crédits. Et cela constitue un utile instrument de pression sur les instances d'expertise.

Mais comment passer de ce dialogue scientifique à la prise de décision ?
Lorsqu'un débat public a lieu, la presse s'en mêle, tous ceux qui ont leur mot à dire peuvent le faire valoir... Je n'imagine pas que les autorités sanitaires puissent rester sans rien faire dès lors qu'un problème aurait émergé. Y aurait-il eu un débat public, il y a quelques années, sur le Mediator et sa parenté chimique avec l'Isoméride, elles auraient inévitablement agi. La contradiction publique est indispensable.

Il est vrai qu'une meilleure prise en compte des alertes est essentielle. Mais j'aimerais, encore une fois, que l'on évite d'aller trop avant dans le diagnostic avant d'avoir procédé à un examen clinique approfondi... Je reviens donc à ce qui s'est passé en 1995. Le rapport de l'Igas indique que, le 18 mai, une enquête officieuse de pharmacovigilance a été ouverte sur le benfluorex. Entre les deux arrêtés sur les préparations magistrales, donc. Etiez-vous au courant ? Qui l'était ? Qui en a pris l'initiative ?

Le rapport dit que vous avez été soumis à des pressions. On accuse beaucoup le groupe Servier de tromperie. Avez-vous le sentiment d'avoir été abusé ? Estimez-vous que les laboratoires Servier pouvaient compter dans la place sur des gens qui n'ont pas recherché, sciemment, la vérité, pour que le benfluorex continue d'être commercialisé ? Les pressions dont il est question sont-elles liées aux décisions qui avaient été prises, qui, même sans être d'interdiction, entravaient le développement du médicament ? J'ai le sentiment que vous n'êtes pas le seul à avoir subi des pressions, puisque le rapport précise que l'on vous a demandé de produire une note d'information à l'intention du directeur de cabinet, M. Philippe Bas, à la suite d'interventions du laboratoire auprès du ministre. La lecture du rapport donne le sentiment que l'on a créé beaucoup de groupes ad hoc, comptant des personnalités qui n'étaient pas sans liens d'intérêts avec le groupe Servier, pour contourner la commission d'autorisation de mise sur le marché. Autant d'éléments qui ne plaident guère en faveur de l'impartialité de l'Agence dans sa prise de décision. Le doute est ravageur, monsieur le Conseiller d'Etat : il faut restaurer la confiance.
Ce que je puis dire, avec la distance du temps qui entame la précision du souvenir, c'est que, d'une manière générale, l'environnement de l'Agence n'est pas simple. Au moment de ma nomination, plusieurs articles sont parus dans la presse expliquant qu'elle était contestable. Ce qui ne facilite pas les choses pour asseoir son autorité... Quelques mois plus tard, une publication du secteur pharmaceutique annonçait que je quittais l'Agence. Episode quelque peu déstabilisant... Ainsi que je l'ai dit à l'Inspection générale, j'ai reçu plusieurs appels anonymes m'appelant à la prudence... Je suis allé voir Philippe Bas pour m'en ouvrir auprès de lui entre octobre et décembre 1996. Mais je ne peux pas affirmer que ces appels étaient liés à l'affaire du Mediator.
Pour le reste, il y a eu de nombreux articles de presse arguant que l'Agence européenne du médicament avait réhabilité l'Isoméride. Nous avons publié un communiqué de presse pour rétablir les faits, et dire que la décision européenne était parfaitement compatible avec la décision prise par l'Agence, un an plus tôt. On m'a demandé de me justifier. J'ai écrit une note pour dire qu'il s'agissait d'une nécessité de santé publique : c'était ce que me disaient les scientifiques, et ma conviction personnelle.

J'en viens à 1999, quand se pose la question de la fameuse réévaluation demandée par Martine Aubry, deux ans seulement après celle qui faisait suite à la directive européenne, laquelle rendait nécessaire la validation de 6 000 spécialités - le benfluorex, soit dit en passant, était alors passé au travers... Nouvelle évaluation, donc, de 4 000 médicaments : pour 835 d'entre eux, le service médical rendu (SMR) est jugé insuffisant. Vous avez dû renoncer à une intention première de déremboursement, pour des raisons que nous a expliquées le président du Comité économique des produits de santé, que nous venons d'entendre. Puisqu'il semble très difficile de retirer un médicament qui est déjà sur le marché, même si le service médical rendu est insuffisant, n'eût-il pas été bon, pour l'avenir, d'éviter d'emblée de mettre sur le marché de tels médicaments ? Or, ce que l'on voit depuis 1999 ne rassure pas... Entre 150 et 200 médicaments sont déposés, bon an mal an, qui ne marquent aucun progrès sur le protocole thérapeutique existant. Et il aura fallu dix ans pour arriver au déremboursement des fameux 835 médicaments.
Il faut bien distinguer entre procédure de validation et procédure de réévaluation. La première porte un enjeu de santé publique, via l'évaluation du ratio bénéfice-risque. Après la directive européenne de 1975 sur l'évaluation du médicament, restaient, à la création de l'Agence, 4 500 dossiers en souffrance, alors qu'ils auraient dû être réglés avant 1990. La pression du comité économique et du ministère était donc très forte. La seconde procédure est d'une tout autre nature. Il s'agit de réévaluer l'engagement des finances publiques sur un médicament, procédure légitime, tant au regard de l'évolution des thérapeutiques que de la santé de nos finances sociales. Je suis partisan d'une réévaluation régulière. Ce qui ne veut pas dire, si la commission d'autorisation de mise sur le marché a bien fait son travail, qu'un médicament réévalué est totalement inutile. La question qui se pose est celle de la bonne utilisation des deniers publics. La lettre à la commission de transparence demandait que ce travail soit mené, qui devait conduire à une évolution du taux de remboursement, ou du prix. Cela a donné lieu à une série d'épisodes que relate le rapport.
Il se trouve qu'en 2000, j'ai été déchargé des fonctions de directeur-adjoint du cabinet du ministre, m'étant vu confier la charge de conseiller sur le projet de loi relatif aux droits des malades. Je n'ai donc pas suivi de près les discussions qui ont eu lieu autour de la réévaluation de 1999.

Vous étiez directeur du cabinet de M. Kouchner lorsqu'y a été reçue la note de 2001.
Je n'en ai pas eu, que je me souvienne, connaissance. Elle était adressée aux conseillers du cabinet.

Nous vérifierons. Il me semblait que le directeur de la sécurité sociale vous avait envoyé une note concernant le Mediator.
En décembre 2001. Au reste, la Direction de la sécurité sociale n'était pas placée sous l'autorité du ministre délégué à la santé. Il ne s'agissait pour nous que de rendre un avis, le plus souvent favorable au déremboursement.

J'en reviens aux médicaments à SMR5. Il n'est pas normal que soient mis chaque année sur le marché des médicaments de ce type. Sur la fameuse liste des soixante-dix-sept, on en compte vingt-cinq ! Non seulement ils ne correspondent à aucun progrès thérapeutique, mais ils ne sont pas, pour certains, sans effets indésirables. Il y a bien là un enjeu de santé publique.
La question se pose davantage de l'autorisation de mise sur le marché que du déremboursement. Une autorisation ne devrait être délivrée qu'aux médicaments qui améliorent le traitement de référence. Il existe certains domaines où cela est réellement le cas, comme l'oncologie. C'est sur cette voie qu'il faut avancer. La question est complexe, dans la mesure où elle est largement régie par des règles européennes et internationales. La France est de ce point de vue aux avant-postes, car l'appréciation se fait au regard du traitement de référence.

L'Europe centralise en effet de plus en plus de procédures. Nous n'avons pas la pleine maîtrise de l'autorisation de mise sur le marché. En revanche, nous avons la main sur la liste des médicaments remboursés. Il serait bon, devant la commission de transparence, de procéder à des essais comparatifs pour effectuer un classement.
Rien n'est exclu. La décision de prise en charge permet de poser des exigences - sauf pour les génériques, réputés rendre, par construction, le même service médical.

Comment expliquez-vous que beaucoup de médicaments soient mis sur le marché à des prix supérieurs à ceux qui existent déjà...

Votre prédécesseur nous a dit que les prix n'étaient pas supérieurs à ceux qui sont pratiqués ailleurs en Europe.
Qu'il existe une réglementation européenne pour la mise sur le marché ne nous interdit pas de la faire progresser. Voyez ce qui s'est passé avec les réactifs de laboratoire. La position française, portée au niveau du Parlement européen par Mme Veil, a imposé en janvier 1994 une révision du projet de directive, pour plus de sécurité. Preuve que l'on peut aller plus vite que quinze ans...

Comment verriez-vous évoluer le système des agences ? Faut-il rompre tout lien financier avec l'industrie pharmaceutique, au risque de les priver de ressources propres ?
Vous vantez les vertus des donneurs d'alerte, mais la volonté de protéger la santé publique est-elle chez chacun d'eux toute-puissante ? Ne craignez-vous pas de voir le système bloqué par des interventions infondées ?
Vous dites oui à une réforme de l'autorisation de mise sur le marché. J'ai souvenir que, lorsque nous avons conduit nos auditions sur le Vioxx, on nous disait que l'analyse qui y présidait était fondée sur un modèle pasteurien. Or, aujourd'hui, des médicaments apparaissent pour traiter les maladies chroniques, sous forme de traitements à long terme. N'y a-t-il pas contradiction avec ce modèle ? D'où la difficulté à mettre en place les études préalables...
Je ne sais pas répondre à cette dernière question, de nature scientifique, bien que j'en comprenne la légitimité.
En ce qui concerne le système de financement des agences de sécurité sanitaire, je puis vous dire qu'en 1993-1994, la subvention de l'Etat - subvention directe et mises à disposition de personnel confondues - était de l'ordre de 40 %, le reste étant assuré par des redevances. Ce qui importe à mon sens, c'est de rompre tout lien de l'Agence avec l'industrie pharmaceutique sur les dossiers individuels. L'idéal est à mon sens un équilibre entre la subvention publique et le produit d'une taxe sur le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique qui se justifie car il faut des ressources propres.
Un financement public à 100 % ne me paraît pas la solution optimale. La taxe sur le chiffre d'affaires est légitime, parce que l'Agence joue un rôle de surveillance permanente du marché. J'ajoute que ce financement équilibré, qui témoigne à la fois de l'engagement des pouvoirs publics tout en assurant à l'institution des ressources autonomes évite de mettre l'Agence dans une totale dépendance vis-à-vis des pouvoirs publics, qui autrement pourraient être tentés, s'ils l'estimaient un jour gênante, de la mettre à la diète sévère...
Qu'un dispositif d'alerte puisse susciter des manoeuvres, cela ne fait aucun doute. Nous avons martelé, quatre ou cinq ans durant, notre souci de la déontologie. A côté des pressions directes, il y a aussi celles, indirectes, des concurrents qui tentent d'obtenir l'interdiction. La manipulation est partout, elle peut se développer avec le contradictoire. Mais il y a, à mon sens, plus à gagner qu'à perdre en autorisant l'expression des contradictions. Il n'est pas si facile que cela de provoquer des alertes injustifiées.

Faut-il renforcer les droits des patients en matière de pharmacovigilance et leur donner la possibilité de conduire devant les tribunaux des actions collectives, comme c'est le cas aux Etats-Unis ?
Faut-il renforcer les pouvoirs de l'Etat en matière de contrôle économique du médicament ?
La participation des usagers et de leurs associations à la vigilance sanitaire, notamment pour les pathologies chroniques, est un élément majeur d'évolution du système. La directive du 15 décembre 2010 va dans ce sens. Il faut renforcer cette évolution. Je ne suis pas hostile à d'éventuelles actions collectives. C'est un moyen de répondre rapidement aux souffrances des victimes, mais l'organisation juridique n'est pas simple. En revanche, les indemnisations punitives, à l'américaine, provoquent du contentieux et me semblent contreproductives.
S'agissant du contrôle économique, les perspectives de l'assurance maladie sont telles que la pression économique sur le prix et le remboursement ne peut que croître à l'avenir...

Les agences comme l'Agence du médicament ou l'Afssaps ont été chargées de la gestion et de l'évaluation des risques à la suite de crises, comme celle du Sida ou de la vache folle. Leur indépendance conduit à une forme d'expropriation politique, alors que la protection de la santé publique est une mission incessible de l'Etat. Les ministres ne sont pas informés, se disent incompétents, sachant que les agences prennent leurs décisions au nom de l'Etat... M. Xavier Bertrand va jusqu'à proposer que le ministre n'ait plus la responsabilité du remboursement d'un médicament ! Dans quel sens faut-il aller ? Comment éviter que les autorités gouvernementales légitimes ne se trouvent, par trop, privées de pouvoir ?
La sécurité sanitaire est une mission incessible de l'Etat, dont les agences sont les bras armés. Elles doivent avoir une autonomie scientifique, d'élaboration et de production d'alerte. Toutefois, même lorsqu'elles sont investies d'un pouvoir de police, délégué par le Parlement, elles doivent, à mon sens, jouer auprès du ministre le rôle d'une direction d'administration centrale, pour évoquer les risques perçus. C'est ainsi que fonctionne la Food and Drug Administration (FDA) américaine.
Les réunions régulières avec les directeurs des agences pour analyser les risques, en discuter et partager l'information assurent l'information du ministre en direct, sans remettre en cause l'autonomie des établissements. Pour ma part, j'ai toujours estimé que, si une décision de l'Agence me paraissait contraire à ce que je pensais, je démissionnerais.

Encore faut-il que le principe du contradictoire puisse émerger au sein de l'Agence, et que celle-ci fasse preuve d'ouverture d'esprit, par exemple en matière de procréation médicalement assistée.
Nous sommes d'accord. Il faut veiller à la composition des comités, des structures qui alimentent le débat.

L'architecture du système d'évaluation et de contrôle du médicament, complexe, fait intervenir pas moins de cinq instances. Le ministre dit souhaiter que l'on réduise le nombre de commissions de l'Afssaps, et de leurs membres. Faut-il modifier l'architecture ? Fusionner la commission de la transparence et l'Afssaps ? Créer une seule entité pour le médicament ? N'y aurait-il pas alors un risque de gigantisme ? La pharmacovigilance doit-elle conserver une place à part ?
En matière de conflits d'intérêts, jouer la transparence suffit-il ? Comment garantir des décisions impartiales ? Ne faudrait-il pas ériger « un mur », comme le dit Martin Hirsch, entre les experts de l'Afssaps et l'industrie pharmaceutique ?
Les organisations se figent ; il faut les remettre régulièrement en question, et pas seulement lors des crises. Une fusion en une seule grande agence me parait toutefois contreproductive : on aboutirait à un ministère bis, et l'on perdrait en réactivité. La question peut se poser en revanche dans le domaine de l'environnement.
S'agissant de l'organisation interne, on gagne toujours à réduire le nombre des divers comités et groupes, mais en veillant à conserver des compétences scientifiques qui sont de plus en plus spécialisées. Une rationalisation faciliterait également la mise en place de dispositifs de contrôle déontologique.
La fusion de la commission d'AMM et de la commission de la transparence entraînerait une confusion des genres. Il faudrait plutôt que la commission de la transparence devienne une vraie commission médico-économique qui prenne en compte le prix du médicament, l'impact médical et économique ; ce ne peut pas être la même instance qui prend la décision de santé publique sur le rapport bénéfice-risque.
Quant à fusionner la commission de pharmacovigilance et la commission d'AMM, surtout pas : ce sont deux métiers différents.
Les alertes montent des services d'inspection, de l'AMM, des laboratoires. Couper la pharmacovigilance des structures dédiées au médicament ferait perdre en information et en réactivité.

Il faudrait renforcer l'autonomie de la commission de pharmacovigilance, afin qu'elle n'ait plus besoin de passer par la commission d'AMM pour proposer un retrait.
Il faut qu'elle ait une grande autonomie. La transparence, le contrôle des déclarations d'intérêts, des formations du personnel : tout cela a été mis en place par l'Agence entre 1993 et 1997. J'ai pu recruter un magistrat et créer une cellule de veille déontologique.
Je m'en félicite. Il faut contrôler la mise en oeuvre du droit. Ce type de cellule, qui exerce une sorte d'audit interne, est indispensable pour les agences, confrontées à la difficulté de gérer des centaines d'experts.
L'audit externe est tout aussi indispensable. J'avais proposé, dès ma nomination, que le service central de prévention de la corruption en soit chargé.

Ne serait-il pas utile de constituer des groupes de réflexion éthique au sein même des organismes, comme dans les hôpitaux ?
C'est une démarche légitime, mais qui ne remplace pas la démarche purement déontologique. Il faut une cellule de veille qui forme les experts et fasse pression sur les gestionnaires des procédures.

Sur l'échelle de Richter des crises sanitaires, à quel niveau situeriez-vous l'affaire du Mediator, par rapport à celle du sang contaminé ?
Je ne saurais comparer les drames. L'affaire du Mediator est une crise d'une intensité absolument exceptionnelle, compte tenu du nombre de personnes concernées, et parce qu'elle affecte la confiance envers tout le système de sécurité sanitaire.

Nous accueillons à présent M. Didier Houssin, directeur général de la santé.
Tout d'abord, j'indique que je n'ai pas de lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique.
Au fil de ses 3262 pages, le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) sur le Mediator, rendu public le 15 janvier 2011, parle de la Direction générale de la santé (DGS) à trente-trois reprises. Il rappelle que si le benfluorex a été interdit dans les préparations magistrales en 1995 par la DGS, l'autorisation de mise sur le marché de la même substance a été maintenue par l'Agence du médicament, sous forme de médicament pour diabétiques ; qu'un rapport de la Cour des comptes sur l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) de mars 2006 n'a pas reçu de réponse de la DGS sur la conduite de la pharmacovigilance par l'Agence ; que la participation de représentants de la DGS aux différentes commissions nationales d'expertise sur le médicament n'a pas permis de générer une alerte ou une réaction plus précoce à propos du Mediator.
Deux critiques s'en dégagent donc. Si la DGS a eu une bonne réaction en 1995, elle n'a pas su mettre fin au paradoxe du maintien de l'utilisation du Mediator dans les préparations pharmaceutiques. Par ailleurs, elle n'a pas donné l'alerte malgré la présence de ses représentants dans le système de protection.
J'ai été informé régulièrement sur la pharmacovigilance dans le cadre des réunions hebdomadaires de sécurité sanitaire que j'anime. Sur 311 réunions qui se sont tenues en six ans, le directeur général de l'Afssaps m'a informé à 73 reprises de questions de pharmacovigilance qui lui semblaient d'une particulière importance. C'est ainsi que le 28 octobre 2009, j'ai appris, en même temps, l'existence du Mediator et la démonstration récente d'un risque accru de valvulopathie liée à son utilisation. J'ai ensuite appris, le 2 décembre 2009, sa suspension effective par l'Afssaps, à la suite de l'avis de la commission d'autorisation de mise sur le marché (AMM) du 12 novembre 2009. Je tiens les comptes rendus de chacune de ces 311 réunions à votre disposition. De manière complémentaire, les représentants de la DGS au sein des commissions, notamment de pharmacovigilance, m'ont informé des conséquences à tirer concernant certains produits, s'agissant de décisions relevant de la DGS, par exemple à propos d'un vaccin contre le virus du papillome humain, de mucolytiques pour le nourrisson ou d'un médicament antidiabétique.
En matière de sécurité sanitaire du médicament, la DGS exerce un rôle de tutelle stratégique, dans le respect des missions de l'Afssaps, qui exerce sans contrôle hiérarchique ses pouvoirs de police sanitaire au nom de l'État. Dès le début des années 2000, la DGS a favorisé la modernisation de la pharmacovigilance, et promu la pharmaco-épidémiologie par diverses initiatives : la création, en août 2004, d'un groupement d'intérêt public sur l'évaluation épidémiologique ; le rapport demandé au professeur Bégaud sur l'évaluation des médicaments après leur mise sur le marché et la gestion des risques ; le financement par l'Afssaps d'études de pharmaco-épidémiologie à partir de 2005 ; la promotion de nombreuses études post-AMM ; la création en juillet 2005 d'un comité de liaison des études post-AMM ; enfin, le travail sur la coordination des vigilances dans le cadre du Comité d'animation du système d'agences (CASA). Surtout, des orientations ont été fixées à l'Afssaps en matière de veille, de surveillance, de réactivité aux risques dans le cadre de son contrat d'objectifs et de performance 2007-2010.
En matière de sécurité sanitaire, la DGS a pour rôle de veiller à la continuité de l'approvisionnement. L'Afssaps a ainsi publié, en 2009, une liste de médicaments dont la continuité de l'approvisionnement est indispensable, notamment en cas de pandémie grave. Une liste analogue a été établie concernant les dispositifs médicaux. Un plan de pharmacovigilance renforcée a été mis en place en 2009 concernant les produits utilisés dans le cadre de la pandémie grippale. Lors de phénomènes épidémiques graves, comme le méningocoque B en Seine-Maritime ou de menaces radiologiques, biologiques ou chimiques, la DGS a coordonné l'action de l'Afssaps et de l'établissement pour la préparation et la réponse aux urgences sanitaires.
L'affaire du Mediator a souligné la nécessité d'une amélioration dans la durée, dont le ministre a tracé les grandes lignes : organisation de l'expertise et conditions de sa crédibilité, organisation interne et financement de l'Afssaps, conditions de la vie du médicament, de son autorisation à son suivi.
L'Europe n'a pas tiré suffisamment les leçons de la crise du Vioxx. L'attention avait alors porté avant tout sur le renforcement de la surveillance lors de l'introduction de nouveaux médicaments, or le Mediator est un médicament ancien. La pharmacovigilance doit se rapprocher de l'AMM. C'est l'esprit de la nouvelle directive européenne sur les AMM. L'AMM n'est plus un aboutissement, mais le début de la vraie vie du médicament. Alors que le principe de précaution est parfois critiqué, le drame du Mediator souligne combien l'incertitude devrait profiter au patient. Restaurer la confiance, pour reprendre le titre de l'excellent rapport du Sénat en 2006, passera par un renforcement de l'approche de précaution.
Le 28 octobre 2009 à 9 heures, en réunion de sécurité sanitaire, lorsque le directeur général de l'Afssaps a indiqué que la commission de pharmacovigilance venait de l'alerter d'un risque accru de valvulopathie, et annoncé que la commission d'AMM allait se prononcer rapidement.

Avez-vous eu les moyens de réagir aux retraits de médicaments dans d'autres pays, sachant que le Mediator a été retiré en Espagne et en Italie en 2003-2004 ?
Je n'étais pas informé de cette suspension. Le rapport de l'Igas s'interroge sur la circulation de l'information entre l'échelon européen et les États membres. Après 2003, le Mediator n'était plus utilisé qu'en France ; cela explique que la vigilance européenne se soit éteinte.

Il est difficile de concevoir que les autorités compétentes ne soient pas au courant du retrait d'un médicament chez nos voisins ! Est-ce dû au cloisonnement des circuits d'information ?
J'ai fréquemment été alerté du retrait de produits à l'étranger, soit parce que l'information était sur la place publique, soit par l'Afssaps. Le Mediator avait pour particularité de n'être utilisé qu'en France. Après 2003, l'Europe n'avait plus guère de raison d'intervenir...
L'apport européen est important, car il est fort utile d'analyser les effets d'un médicament sur un territoire et une population étendus.

Le nombre de décès attribuables au Mediator varie selon les études entre 500 et 2 000. Avez-vous pu affiner les statistiques du nombre de décès et d'hospitalisations ? Pouvez-vous nous dire la réalité des chiffres ?
L'étude de la CNAM sur des patients hospitalisés pour valvulopathie, qui a démontré un lien avec la prise du Mediator, a dénombré quarante-six décès sur quatre ans et demi. Le médicament existe depuis trente ans : en faisant une règle de trois, Catherine Hill a donc estimé à environ 500 le nombre de décès imputables au médicament. Une autre étude, menée par Mahmoud Zureik et Agnès Fournier de l'Inserm, prend en compte la mortalité sur le long terme : ils estiment le nombre de décès possible entre 1 000 et 2 000. Certaines valvulopathies vont toutefois pouvoir être dépistées et traitées, notamment grâce au comité de suivi mis en place par le ministère, ce qui devrait éviter des décès.

Les chiffres de 500 comme de 2 000 décès ne sont donc que des estimations ? Comment appréhender l'information que nous recevons ? Combien de décès sont imputables au Mediator ?
L'étude de la Cnam en identifie quarante-six, sur une période de quatre ans. Reste à déterminer la part de responsabilité du Mediator dans ces morts. Le chiffre de 500 est en revanche une estimation statistique.

Le constat actuel est donc de quarante-six morts. Les autres chiffres sont des estimations auxquelles on parvient par des calculs différents.

Quels que soient les chiffres, tout mort est un mort de trop ! L'amplitude de la réaction découle sans doute des chiffres annoncés, mais il était nécessaire d'alerter la population sur le risque que présentait le Mediator.

La DGS a publié une liste de soixante-dix-sept médicaments sous surveillance, tout en indiquant que les patients ne doivent pas pour autant interrompre ou modifier leur traitement sans consulter leur médecin. Quelles sont les implications en termes de contrôle ? Quand donnerez-vous des informations supplémentaires sur ces médicaments ? Quelles dispositions prenez-vous vis-à-vis des médecins ?
La pharmacovigilance concerne l'ensemble des médicaments, mais certains font l'objet d'une surveillance renforcée : les médicaments nouveaux ; les médicaments pour lesquels la balance bénéfice-risque est discutable ; ceux pour lesquels on peut craindre un mésusage - comme dans le cas du Mediator.

Quelle attitude doit-on concrètement adopter quand on prend du Lévothyrox ou du Subutex ?
Ce n'est pas tant le Lévothyrox qui pose problème que certains génériques. Il ne faut surtout pas arrêter le traitement mais, en cas de doute, interroger son médecin. La transparence a des avantages mais aussi des inconvénients !

La décision d'AMM se fait sur un modèle pasteurien ; n'y a-t-il pas une inadéquation entre ce modèle et les pathologies chroniques pour lesquelles nombre de ces médicaments sont pris ?
La grande majorité des médicaments sont aujourd'hui à usage prolongé, pour des maladies chroniques. Je ne dirais pas pour autant que toute la philosophie de la chaîne du médicament est marquée par la théorie pasteurienne et le rythme de la maladie infectieuse. L'usage de l'insuline, par exemple, est ancien.
L'opinion doit comprendre que le médicament n'est pas un aliment : il contient un principe actif et a, de par sa nature même, des inconvénients. En matière d'effets indésirables, les statistiques sont essentielles. Comment savoir si une pathologie, qui peut être rarissime, est liée à la prise d'un médicament ou survenue spontanément ? C'est toute la difficulté de la pharmacovigilance.

Le rapport de la mission d'information du Sénat sur le Vioxx a-t-il été pris suffisamment au sérieux ? Nos propositions, qui ressemblent fort à celles que fait aujourd'hui l'Igas, n'ont guère été traduites dans les faits...

J'ai tenté d'assurer le service après-rapport en déposant nombre d'amendements, presque tous refusés par le gouvernement. En six ans, j'en ai fait adopter deux, dont un qui étend aux patients la possibilité de notifier les effets indésirables d'un médicament - et pour lequel nous attendons toujours le décret d'application.
Le rapport du Sénat de 2006 faisait vingt-cinq recommandations. Je vous ferai parvenir un document retraçant les suites qui leur ont été données. La notification par les patients figure dans la directive européenne du 15 décembre 2010, et a été mise en oeuvre par anticipation lors de la pandémie grippale.

A l'époque, je n'avais même pas reçu le soutien du gouvernement, qui s'en était remis à la sagesse du Sénat ! A quand le décret ?
Je vous répondrai par écrit.

En matière d'organisation institutionnelle, comment s'opère la coordination entre agences ? Quelle est le rôle du comité d'animation du système d'agences (Casa) ?
Chaque mercredi, j'anime une réunion de sécurité sanitaire centrée sur l'actualité, qui rassemble, outre le cabinet du ministre, les directeurs généraux de l'Afssaps, de l'Institut nationale de veille sanitaire (InVS), de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), de l' Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes), de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), de l'Autorité de sûreté nucléaire, de l' Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), un représentant de la direction de la sécurité civile, et souvent la directrice générale de l'alimentation. C'est le lieu du partage de l'information et de la coordination, sachant que de nombreux sujets, comme les accidents de radiothérapie ou les phénomènes épidémiques, relèvent de plusieurs agences.
Le Casa, autour du DGS, opère à un niveau plus stratégique : mutualisation de l'expérience, portage de projets en commun. Il se réunit environ tous les deux mois.

La canicule de 2003 a révélé l'étendue du mésusage des psychotropes, dont les Français sont de gros consommateurs. Trop de médecins font le choix de la facilité dans la prescription, notamment pour les personnes âgées. Ce sujet doit être une priorité.

L'excellent rapport Zarifian donnait l'alerte dès 1995, et faisait des propositions concernant le mésusage des psychotropes. Plus récemment, il y a eu le rapport de notre ancienne collègue députée Maryvonne Briot.
Ce sujet dépasse le cadre de la régulation du médicament : il s'agit de la prescription, du rôle du médecin, du pharmacien, de leur formation, de la relation entre patient et médecin... Sans doute la tendance à la prescription médicamenteuse est-elle trop accentuée en France. L'affaire du Mediator conduira peut-être à plus de mesure... Nous travaillons sur les conditions de prescription, notamment sur la base du rapport d'information de Catherine Lemorton.

Que pensez-vous du rapprochement que fait l'Igas entre l'affaire du Mediator et celle du sang contaminé ?
L'Afssaps décide du retrait d'un médicament sans que le politique en soit informé. Quelle est votre appréciation sur l'indépendance des agences vis-à-vis du pouvoir politique ?
Dans quelle mesure la DGS est-elle été informée des alertes, comme celle concernant le Mediator signalée à Marseille en 1999 ? M. Mattei nous a dit n'avoir été au courant de rien durant son passage au ministère, alors que le problème du Mediator avait été soulevé à l'étranger.
Le sang comme le Mediator sont des produits de santé, mais l'affaire du sang contaminé s'inscrivait dans un contexte peu réglementé, tandis que le médicament est aujourd'hui très encadré, avec une agence solide, et le Mediator est un produit ancien. C'est l'illustration de la théorie des catastrophes, avec toute une série de défaillances : positionnement « furtif » du médicament, anorexigène habillé en antidiabétique, occasions manquées, garde-fous qui n'ont pas fonctionné... L'analyse en sera instructive.
Je ne puis répondre. C'est à la justice de dire s'il y a eu habileté, ou plus...
La relation entre la DGS et l'Afssaps n'est pas hiérarchique. Le ministère infléchit bien entendu les orientations stratégiques de l'Agence, mais dans son domaine de spécialité, elle fait son travail d'évaluation et de gestion des risques. Ma relation avec le directeur général de l'Agence est excellente, mais il ne pouvait me parler que de ce dont il était lui-même informé ! La vraie question est de savoir à quel moment un signal est constitué, et quand les conditions de son émergence sont rassemblées. Il n'y a pas de rupture entre le pouvoir politique et les agences, qui sont un moyen pour l'État d'agir de façon spécialisée, avec des moyens dédiés. L'information circule.
Bien que ce soit rare, puisque les décisions prises sont habituellement fondées, le ministre, juridiquement, peut imposer sa volonté.
Il faut avoir à l'esprit que plus de 12 000 médicaments sont utilisés en France, dont 8 000 sont vendus en officine et 4 000 utilisés dans les hôpitaux.
Certains médicaments ne sont plus commercialisés...
Non, s'ajoutent en effet les dispositifs médicaux, très nombreux et divers, les cosmétiques et les logiciels. Aucun ministre ne peut savoir ce qui se passe avec chaque médicament.

Des alertes peuvent-elles être occultées pour des raisons de mode ? Je pense notamment aux implants mammaires, dans un contexte de développement de la chirurgie esthétique, et aux psychotropes.
Le système des médicaments est très cadré. Il est particulièrement sécurisé, notamment grâce à la chaîne pharmaceutique.
Certes l'affaire du Mediator vient me démentir, mais la sécurité des dispositifs médicaux m'inquiète bien plus.

Pourquoi ne pas être intervenu à propos de la directive européenne transposée la semaine dernière par le Sénat, qui autorise l'importation de dispositifs médicaux d'occasion après une simple certification par un organisme étranger situé dans un État membre ? Cette disposition m'inquiète beaucoup. Un amendement a été adopté à l'unanimité en commission, mais rejeté en séance publique. Le principe de subsidiarité s'applique pourtant en matière de santé publique.
Avec les dispositifs médicaux, nous devons faire face à une extrême diversité, en raison de l'existence de producteurs plus petits et de la difficulté accrue de conduire une évaluation des essais cliniques.
Les implants mammaires posent un défi d'autant plus redoutable que des fraudes ont eu lieu. En matière de médicaments, la France est à peu près épargnée par les médicaments falsifiés, mais le problème pointe à l'horizon.

Certaines sociétés qui fabriquent des sondes endocavitaires les ont retirées sans la moindre intervention de la pharmacovigilance. Et dans ce cas, ce ne sont pas des petites sociétés.
Il s'agit ici de matériovigilance. Dans le cas évoqué, il a été décidé de retirer les sondes, plutôt que de risquer des accidents mortels.
En liaison, je suppose, avec les médecins et les chirurgiens.

L'affaire du Mediator est très spécifique. Le Glifanan a été retiré après de nombreuses années d'utilisation...

avant de découvrir ses propriétés qui détruisaient le foie dans des délais de vingt-quatre ou quarante-huit heures. Dans le cas du Mediator, l'AMM ne correspondait pas aux véritables propriétés de ce médicament, dont nous savons tous aujourd'hui qu'il est un anorexigène.

Pas tous : le professeur Alexandre n'est pas d'accord. Cela figure dans le rapport.

Monsieur le directeur général, avez-vous lancé une recherche sur les « Mediator en puissance», ceux dont les indications de l'AMM ne coïncident pas avec les propriétés pharmacologiques du produit ?

Cela nous éviterait de créer en juin une nouvelle mission commune d'information...

J'ai apprécié vos trois idées de conclusion, notamment la nécessité de rapprocher AMM et pharmacovigilance. Vous avez raison, mais comment faire ?
La vigilance s'atténue dès qu'il s'agit de médicaments anciens. Il faudrait systématiquement les passer en revue.
Vous avez raison d'attirer l'attention sur les médicaments à double usage, comme les sulfamides hypoglycémiants, dont le positionnement est ambigu.
Ma réflexion sur le rapprochement à opérer entre pharmacovigilance et AMM tient notamment à la difficulté de comparer les signaux d'alerte et l'efficacité des produits. La directive européenne sur la pharmacovigilance va dans ce sens : la commission de pharmacovigilance au niveau européen a une capacité, sinon de retrait, du moins d'enclencher un processus conduisant à la suspension ou au retrait d'un médicament. Pour la France, le mieux est que la commission d'AMM travaille avec la pharmacovigilance, ce qui suppose d'adapter les structures administratives et scientifiques. Cela pose le problème des processus, il faudra éviter certains effets de silo, voire des antagonismes. Malgré mon grand respect pour Jean-François Girard, je ne partage pas sa crainte d'un conflit d'intérêts entre l'autorisation et la suspension, car en pratique, la décision n'appartiendra guère aux mêmes personnes.
Le mieux est d'internaliser les compétences de pharmaco-épidémiologie : il faut proscrire l'analyse distincte de l'intérêt pharmaceutique et des dangers potentiels, car le médicament n'a de sens que via l'approche simultanée des bénéfices et des risques.

Une aventure comme celle de 1995 pourrait-elle se reproduire ? M. Tabuteau pense qu'un texte de 1998 a mis fin à l'incohérence entre la surveillance des préparations pharmaceutiques et celle des préparations magistrales.
Ce doit être exact, mais je vais vérifier.

Vous n'avez pas cité le rapport du professeur Queneau sur la iatrogénie médicamenteuse, un sujet dont on ne parle guère, contrairement aux accidents de la route, et aux maladies nosocomiales. Certes, il est impossible de chiffrer le nombre de morts, mais le rapport commandé par M. Barrot et remis à un de ses successeurs comporte des propositions de bon sens.
S'agit-il à vos yeux d'un problème de santé publique ? Faut-il lui accorder une priorité ? Dans son livre consacré à la canicule, le professeur Abenhaïm, ancien directeur général de la santé, mentionne 18 000 décès. Un consensus paraît se dégager pour imputer 150 000 hospitalisations annuelles à la iatrogénie médicamenteuse. Ne faudrait-il pas que les hôpitaux adoptent à son sujet des dispositions analogues à celles relatives aux maladies nosocomiales ?
Je ne méconnais pas la difficulté à traiter de ce sujet au cours d'une formation financée par des laboratoires... Pensez-vous que ce sujet deviendra prioritaire ?
Vous évoquez l'une des principales causes d'accident grave à l'hôpital et en pratique de ville. Répétée récemment, l'enquête nationale sur les événements indésirables liés aux soins (Eneis) a mis en évidence ses trois principales sources : les iatrogénies médicamenteuses, les maladies nosocomiales et les complications chirurgicales. Le sujet que vous abordez est donc important, ce qui ne signifie pas que rien ne soit fait.
Des initiatives sont prises dans les établissements de santé, à commencer par l'action des pharmacies hospitalières. Toutefois, subsistent des défaillances de prescription, notamment d'incompatibilité entre produits. En ce domaine, les logiciels d'aide à la prescription ouvrent de grands espoirs, mais ils ne sont pas encore opérationnels. A cela s'ajoutent de mauvaises transmissions d'informations.

Vous assurez la coordination des plans de gestion des risques, avec des résultats qui n'ont rien de spectaculaire. Je parle surtout des études post-inscriptions. On dénombre aujourd'hui 228 plans de gestion des risques pré-AMM et 22 post-AMM, soit 250 au total, relèvent d'une procédure nationale centralisée, sans compter les procédures européennes. De son côté, l'Afssaps en ajoute 29.
Est-ce que ces plans de gestion permettent de réaliser des études conjointes post-AMM ? Paradoxalement, certaines études post-AMM conduites par la commission de transparence sont gérées par le Comité économique des produits de santé (CEPS), ce qui pose la question du rapprochement de ces structures, sans aller jusqu'à leur fusion. Parmi les 126 demandes d'étude que le CEPS a formulées depuis 2004, seules 19 % sont terminées, alors que 47 % n'ont pas encore reçu un début de commencement. Avez-vous connaissance de cette situation et quelles actions avez-vous entreprises ? A ce propos, le président du CEPS a déclaré avoir eu, un moment, un « projet de sanction » ! J'ignorais l'existence de cette notion. La police sanitaire est plus compréhensive à l'égard des laboratoires que la police avec les automobilistes, alors que la sécurité des patients est en cause. On met souvent sur le marché des médicaments dont on ne connaît pas les effets indésirables ni le rapport entre le bénéfice et les risques, et l'on est en droit d'avoir une surveillance effective par les plans de gestion des risques ou les études post-AMM. Si ces études sont demandées uniquement pour se couvrir, c'est une fausse sécurité qui n'est pas de nature à restaurer la confiance dans le médicament.
Je crois que vous avez mis en place des structures de coordination, mais je parle franchement : le résultat n'est pas bon.
Pour les nouveaux médicaments, les plans de gestion des risques sont mis en place dans une optique de sécurité sanitaire. L'initiative est souvent européenne, mais l'Afssaps peut intervenir de son propre chef. Vous avez tout à fait raison, et c'est ce que le ministre a dit récemment en déclarant qu'il est important que les laboratoires soient conscients que ces études ne doivent pas traîner et être conduites en temps nécessaire. Si les études peuvent prendre du temps, il faut aussi fixer des limites.
Celles effectuées post-inscription apprécient l'utilisation du produit, dans un esprit qui n'est pas nécessairement axé sur la sécurité sanitaire : il s'agit plutôt de légitimer le niveau de prise en charge par la solidarité nationale. Sur ce sujet, je reconnais qu'il faudrait peut-être aller plus rapidement et peser davantage sur les laboratoires.

Les retards justifient des sanctions financières, à l'égard de personnes qui ne sont pas insolvables.
Nous avons mis en place le comité de liaison, en 2005, pour éviter les doublons. Cependant, je retiens votre message, d'aller plus vite, et éventuellement de façon de plus ferme...

Il faut aussi sanctionner, lorsque c'est nécessaire, et ne pas s'en tenir à des projets de sanction : la disposition existe, elle a été intégrée à l'accord-cadre et il n'y a aucune raison de ne pas l'appliquer. Je vous demande d'intervenir auprès de M. Noël Renaudin, qui ne semble pas en avoir pris la pleine mesure...