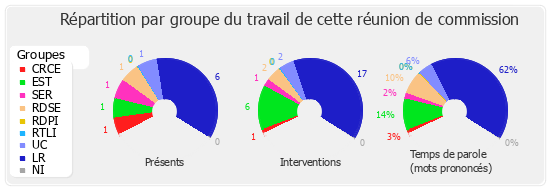Mission commune d'information sur la filière viande en France et en Europe
Réunion du 3 avril 2013 : 1ère réunion
Sommaire
- Audition m. philippe chotteau responsable du département « économie » de l'institut de l'élevage et de mme mélanie richard chef de projet sur la filière viande bovine de l'institut de l'élevage (voir le dossier)
- Audition de m. henri brichard vice-président de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles fnsea (voir le dossier)
- Audition de mm. guillaume roué président et didier delzescaux directeur de l'interprofession nationale porcine inaporc (voir le dossier)
- Audition de m. serge préveraud président de la fédération nationale ovine fno (voir le dossier)
La réunion
Audition M. Philippe Chotteau responsable du département « économie » de l'institut de l'élevage et de Mme Mélanie Richard chef de projet sur la filière viande bovine de l'institut de l'élevage
Audition M. Philippe Chotteau responsable du département « économie » de l'institut de l'élevage et de Mme Mélanie Richard chef de projet sur la filière viande bovine de l'institut de l'élevage

Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous commençons aujourd'hui nos travaux.

La filière viande en France traverse une grave crise de confiance, accentuée par les récentes affaires, notamment par la vente de viande de cheval dans des lasagnes étiquetées « pur boeuf » et au prix correspondant à cet étiquetage. Cela va-t-il détourner les consommateurs de la viande, et en particulier de la viande de boeuf ? Quelles mesures seraient susceptibles de redonner confiance du consommateur ?
Merci pour votre accueil. L'institut de l'élevage est une association régie par la loi de 1901, gérée par des représentants de la filière, qui s'occupe exclusivement des questions relatives aux ruminants. Dédiée à la recherche et au développement, elle compte un contrôleur d'État à son conseil d'administration car elle bénéficie des fonds publics provenant du compte d'affectation spéciale « développement agricole et rural » (Casdar), qui transitent par la direction générale de l'enseignement et de la recherche (DGER) du ministère de l'agriculture. Ses administrateurs sont des représentants des syndicats d'éleveurs : fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), fédération nationale bovine (FNB), fédération nationale ovine (FNO), fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), fédération nationale des éleveurs de chèvres (FNEC)... J'y suis responsable du département de l'économie : il s'agit de suivre l'économie des différentes filières, mais aussi de s'intéresser, d'un point de vue microéconomique, aux résultats des différentes exploitations.
La crise de confiance actuelle concerne la viande rouge, et non le porc ou la volaille. Ce n'est pas la première : chacun se rappelle la première crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) en 1996, ainsi que la deuxième en 2001. A chaque fois, la filière viande, bovine ou ovine, s'en est relevée au prix d'efforts considérables pour améliorer la traçabilité. C'est de cette époque que date l'identification individuelle des animaux, ainsi que celle du produit, en boucherie comme en grande surface. En France, nous avons même imposé l'identification du produit en restauration.
Bien sûr, l'actuelle crise laissera des traces. Elle est apparue, en vérité, dès le mois de janvier, sur les ondes de la BBC. Elle concerne les viandes transformées, qui dans la profession sont appelée, fort maladroitement, « minerai ». Ces viandes voyagent dans l'Europe entière, voire au-delà, et leur traçabilité est plus difficile à assurer. Il faut distinguer les différentes phases de transformation. La première transformation est l'abattage, la deuxième est le désossage et la transformation des carcasses en muscles ou en « minerai », la troisième et la quatrième consistent en la transformation en plats cuisinés, en saucisses, en produits qui peuvent mêler différentes viandes. C'est ce dernier secteur qui fait l'objet d'une crise de confiance.
Il dépend beaucoup des importations. La France a un cheptel de vaches allaitantes de 4,1 millions de têtes : c'est le plus grand d'Europe ; il représente un tiers du cheptel européen. Viennent ensuite l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Bulgarie... Notre cheptel de vaches laitières est également le deuxième d'Europe, avec 3,6 millions de têtes. Pourtant, nous sommes importateurs nets de viande : nous importons 400 000 tonnes équivalent carcasse (TEC), ce qui représente 23 % de notre consommation. Nous exportons 22 % de notre production. L'explication est simple : nous ne consommons pas les mêmes qualités de viande que ce que nous produisons. Notre production comporte 62 % de viande issue de vaches de réforme ou de génisses, 31 % de viande issue de jeunes bovins, abattus entre dix-huit et vingt-quatre mois, et 7 % de viande de boeuf. Nous consommons pour 80 % de la viande issue de vaches de réforme ou de génisses : nous en sommes le premier marché. Elle est, en principe, moins chère, et sert souvent de base à l'industrie de transformation. Nous exportons la moitié de la viande de taurillon que nous produisons : l'autre moitié constitue 13 % de notre consommation. Nous exportons essentiellement en Italie, en Grèce et en Allemagne. Les deux premiers pays ont été fragilisés depuis le début de la crise : la Grèce a connu des chutes de revenu de près d'un tiers. Pourtant, la consommation a tenu plutôt bien, même si nous avons senti l'impact de la crise.
Le scandale de la viande de cheval touche une partie de la consommation française : essentiellement les plats cuisinés à base de boeuf, et les steaks hachés surgelés. Le steak haché frais apparaît au consommateur, à tort ou à raison, comme plus sûr.
Il faut noter qu'il est produit en majorité à partir de viande française, et qu'il comporte une mention d'origine. Les produits transformés sont fabriqués à partir de viandes importées, dont ni l'industriel ni le distributeur ne sont obligés d'indiquer l'origine : c'est le segment le plus sensible. La confiance globale du consommateur est réduite, et cela l'encourage à s'orienter vers des viandes moins transformées. Cette évolution est déjà visible : le steak haché surgelé pâtit de la crise, alors que le steak haché frais se porte mieux.

Avez-vous déjà des statistiques précises sur l'évolution des ventes de chaque type de produit ?
Nous avons des statistiques, mais elles ne sont pas très récentes : elles vont jusqu'à fin février, donc avant la crise.
Nous disposons de deux indicateurs : les chiffres de l'abattage, ceux des importations et ceux des exportations combinés nous sont fournis par le service de la statistique et de la prospective (SSP) du ministère de l'agriculture. Mais ils ne permettent pas de distinguer entre les consommations des différentes qualités de viande. Le panel Kantar, notre deuxième source, mesure les achats des ménages - hors restauration. Or la restauration représente environ 30 % de la consommation de viande bovine, et il y a sans doute déjà un impact significatif sur ce marché. Sur les produits non transformés, le panel montre, dès le mois de février, un transfert du steak haché surgelé vers le steak haché frais, et plus globalement de la grande distribution vers les boucheries, qui représentent environ 15 % de la distribution de viande de boeuf en France. La boucherie se porte donc plutôt mieux du fait de la crise. Le panel ne distingue pas entre eux les produits transformés. Nous devons donc interroger les distributeurs, comme Findus ou Picard, qui affirment observer aussi un impact.
Ces enseignes ont procédé à des retraits de produits, ce qui affecte encore davantage la consommation.

Le fait que les consommateurs se reportent vers la boucherie est-il sans incidence sur leur pouvoir d'achat ? Les prix en boucherie sont supérieurs à ceux des grandes surfaces. Derrière la substitution d'une viande à une autre dans la chaîne de production, il y a la volonté de faire du profit à court terme, d'autant qu'avec la crise, les distributeurs font pression sur les prix pour maintenir leurs ventes. Qu'en pensez-vous ? Vous nous avez décrit un univers compliqué. Avant d'exporter, ne pourrions-nous privilégier notre marché intérieur ? Je comprends de surcroît que nous exportons la viande de meilleure qualité : ce constat ne me satisfait pas ! Il faut nous donner les moyens de rendre accessible au plus grand nombre de la viande de bonne qualité. Certes, j'imagine bien quel type de consommateur, en Grèce, importe nos produits, et je ne me fais pas de souci de ce côté-là. Mais les Français doivent pouvoir consommer de la viande dont le goût soit le meilleur possible.
Par le terme « qualité » nous entendions simplement les types de viande et non leurs qualités gustatives réelles ou supposées. La France exporte de la viande de jeune bovin, plus claire, car elle correspond moins à ses goûts qu'à ceux de ses voisins méditerranéens. Les bouchers français privilégient la viande issue de bêtes plus âgées, plus grasses.

Nous exportons nos produits de jeunes bovins alors que notre consommation est surtout composée de viandes issue de vaches de réforme, abattues en France ou importées. Il s'agit surtout d'un problème d'habitudes de consommation, ou de goûts... Il est vrai que les produits de réforme sont moins chers que le boeuf ou le veau.
Nous valorisons bien nos produits d'exportation : la viande de jeune bovin se vend à un bon prix chez nos voisins du sud, qui l'apprécient particulièrement. Actuellement, la viande de vache à lait est plus chère que celle de jeune bovin. Pourtant, la viande de vache laitière est moins demandée ; elle est fléchée vers la transformation, qui lui ajoute de la valeur, ou la restauration hors foyer, soumise à des contraintes de prix.

Dans ce tour de France et d'Europe des habitudes alimentaires que nous faisons, nous constatons que chacun essaie de faire un produit noble avec ce qu'il a. Certains, en France, vont jusqu'à utiliser des techniques industrielles d'attendrissement du steak! Avons-nous des indications sur la cadence et le tonnage des importations de viande de cheval et de viande ovine ?
D'après les statistiques douanières, les importations de viande de cheval sont marginales - même si nous sommes nettement importateurs. Nous importons environ 300 grammes d'équivalent carcasse par habitant et par an, ce qui représente environ 20 000 tonnes annuelles pour le pays. Nous produisons à peu près la moitié de notre consommation, et en importons l'autre moitié, soit environ 10 000 tonnes par an.

Qu'en est-il des importations de mouton britannique, soumis aux techniques de séparation mécanique ?
Ces techniques sont interdites partout en Europe. Il n'y a guère de traçabilité, cependant. La viande ovine consommée en France est importée à 60 %, mais nous ne savons pas d'où elle provient.
Nous savons si elle est importée avec ou sans os.
Les statistiques douanières dont nous disposons ne nous permettent pas d'en savoir plus. C'est un grand mélange, qui comporte les viandes désossées mécaniquement.
Nous avons importé en tout 112 000 tonnes en 2011.
Sur une consommation totale de 212 000 tonnes.
La viande désossée - susceptible d'avoir été séparée mécaniquement, donc - représente 25 000 tonnes.

Nous apprenons beaucoup en vous écoutant : cela illustre, si besoin était, le bien-fondé de cette mission. Qui représentez-vous ? Uniquement le syndicat FNSEA ? Comment sont organisées les autres filières ? Avez-vous une branche bio ? Les taurillons sont-ils élevés en batterie ou à l'herbe ?
Au conseil d'administration siègent les représentants des associations spécialisées que j'ai mentionnées : FNO, FNB, FNPL, FNEC - cette dernière regroupant plusieurs syndicats, parmi lesquels la confédération paysanne. Il y a aussi des représentants des coopératives d'insémination, des coopératives « bétail et viande », des coopératives laitières, du contrôle laitier, du contrôle de performance, ainsi que des représentants de l'État : DGER pour le Casdar, direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires (DGPAAT), et un contrôleur d'État puisque nous percevons des fonds publics.

Les autres éleveurs sont-ils organisés ? Sont-ils aussi aidés par le ministère ? Dans ma région, il y a « Bretagne viande bio »...
Il existe un institut technique pour chaque filière : volaille (Itavi), porc (Ifip), grandes cultures (Arvalis), fruits et légumes (Ctifl)... Ces instituts ont tous la même organisation, qui date d'un décret de 1972 pris à l'initiative d'Edgar Faure. Il y a des travaux sur le bio, mais ils portent davantage sur le lait que sur la viande, où la production bio n'est pas encore très développée. La plupart des taurillons sont presque tous finis au grain, ou à l'ensilage de maïs, même s'ils sont pour la plupart élevés à l'herbe.

En tant que consommateur, je souhaite n'être pas induit en erreur par la sémantique. Si le terme de « qualité » ne reflète pas le goût, je me sens trahi. Je n'ai rien contre le fait de manger du cheval, à condition de le savoir ! Et j'aimerais connaître la date d'abattage de l'animal dont j'achète la viande et, pour les bovins, savoir s'il est d'une race à viande ou non. S'il l'est, je supposerai qu'il a été élevé au grand air. Sinon, ou s'il s'agit de viande européenne, je penserai qu'il est fort probable qu'il ait été trait pendant treize ou quatorze ans avant d'être engraissé à la hâte avec je ne sais quelle farines. Comme il ne se sera pas déplacé sa viande sera tendre, mais son goût sera épouvantable.
Une telle transparence n'est pas inaccessible. Pourquoi ne pourrait-on pas connaître la date d'abattage et l'origine de la bête ? J'ai travaillé il y a quelques années sur l'élevage ovin. Nous importons de la viande de Nouvelle-Zélande, que nous consommons trois mois après abattage : comment est-ce possible ? Quels additifs permettent une telle conservation ?
En principe, pour tout ce qui est vendu en l'état, l'étiquette mentionne la ferme, la date d'abattage, indique si l'animal était d'une race à viande, mixte ou laitière, ainsi que sa nature : vache, génisse, taurillon... Pour les ovins il n'y a pas la distinction entre race à viande et race laitière, mais la date d'abattage figure pour les ventes en boucheries. En revanche, dans les grandes et moyennes surfaces (GMS) c'est vrai que nous importons quelque dix mille tonnes d'agneau réfrigéré sous vide de Nouvelle-Zélande, grâce à un procédé, appelé chilling, qui consiste à maintenir la viande à une température positive mais très proche de zéro, pour lequel l'étiquetage indique simplement « viande réfrigérée en provenance de Nouvelle-Zélande ». C'est un vrai problème.

Je doute que mon boucher soit capable de m'indiquer la date d'abattage de la viande qu'il me vend.
En principe, il le peut.
Le problème peut être inverse : une date d'abattage trop proche...
Trois mois, c'est trop, mais trois jours ce n'est pas assez. La vérité est entre les deux...

Vous avez mentionné l'interdiction de la séparation mécanique de la viande ovine. Est-ce aussi interdit pour la viande bovine en France ? Pourquoi trouve-t-on de la viande séparée mécaniquement dans le minerai qui entre dans la composition de plats cuisinés vendus en France ?
Si c'est le cas, il s'agit tout simplement de fraude : je vous invite à interroger les industriels sur ce point.

Est-ce l'offre sur le marché qui modifie la consommation, ou l'inverse ? Les opérateurs contribuent-ils à façonner le marché ?
Vous demandez en somme si le marché de la viande est un marché d'offre ou de demande. Pour la viande ovine, c'est un marché d'offre. Si la consommation a beaucoup baissé ces dernières années, c'est faute d'offre, française ou importée d'Irlande ou du Royaume-Uni - qui sont nos principaux fournisseurs d'agneau, loin devant la Nouvelle-Zélande.
La France a connu une chute de 6 % de sa production de viande bovine en 2012, qui a entraîné une forte hausse des prix : en deux ans, le prix de la viande de réforme a augmenté de 20 % - ce qui explique peut-être pourquoi certains cherchent d'autres voies... Là aussi, c'est la baisse de l'offre qui a fait chuter la consommation. La demande est très résiliente, comme on le voit bien dans les pays touchés par la crise, où l'impact de la crise est plus une descente en gamme qu'une baisse de volume. L'augmentation des prix serait heureuse pour les éleveurs, qui ont de grosses difficultés : leur revenu moyen est de quinze mille euros par travailleur familial à temps plein, avant impôts ! Or, dans le même temps, celui des producteurs en grandes cultures peut atteindre 70 000 euros en moyenne, pour un temps de travail parfois inférieur : cela crée des tensions, d'autant que le prix des céréales fait le coût de l'alimentation du bétail.

Ce que nous avons appris d'essentiel aujourd'hui, c'est que le minerai circule incognito, de manière indistincte. Quels sont les procédés de fabrication ? De quoi est-il composé ? Chair, nerfs, gras... ? Les chiffres que vous avez mentionnés pour nos exportations et importations montrent que nous devons réduire nos échanges, ne serait-ce que par souci environnemental : à quoi bon transporter toute cette viande dans un sens et dans l'autre ? Faire venir de la viande de Nouvelle-Zélande ne coûte que trente centimes par kilogramme. Dans ces conditions, comment pouvons-nous nous défendre ?

Quelle est votre position, et la position de la profession, sur les outils de première et de deuxième transformation en France ? Les collectivités sont soumises à des restructurations de ces outils, et les raisons de les financer n'apparaissent pas toujours clairement.
En France, les volumes traités dans les abattoirs ont baissé de 6 % en 2012, et devraient baisser de 3 % encore cette année. Les abattoirs sont donc dans une situation financière difficile : il s'agit d'une industrie lourde, aux marges étroites. Si l'outil n'est pas saturé, les problèmes arrivent vite, surtout pour les abattoirs de taille moyenne et grande. Les grands groupes souffrent actuellement, quelle que soit leur spécialisation. Il semble que les abattoirs de taille moyenne soient le plus remis en cause : la rentabilité d'un abattoir dépend en effet de la capacité à valoriser le cinquième quartier. Cela peut se faire avec la triperie, mais aussi par des produits non alimentaires, en utilisant le sang, les os, le cuir, le collagène... La stratégie du groupe Vion le démontre : Vion est devenu le premier opérateur européen d'abattage des porcs et des bovins. C'était un groupe d'équarrissage qui a racheté progressivement l'ensemble des abattoirs au Pays-Bas, en Allemagne du Nord, puis au Royaume-Uni. La force des abattoirs brésiliens est aussi dans leur capacité à bien valoriser le cinquième quartier.

Où en est la réflexion de la profession sur le modèle économique à retenir ? Il s'agit d'un problème de fond : faut-il un abattoir par département, au risque d'être dépassé par de nouvelles normes sur le bien-être animal ? Dans le sud de la France, les collectivités ont trouvé grand profit à fermer leurs abattoirs. Du coup, entre le Massif central et le bassin méditerranéen, il n'y a quasiment plus d'abattoirs : comment s'étonner alors que l'on transporte les animaux, qu'on les congèle, qu'on en fasse du minerai... ? Dans quelle enceinte pouvons-nous poser cette question ?

Pourtant, l'abattage de proximité profite à tous : un éleveur qui l'utilise double ses bénéfices.
Jusqu'à 10 000 tonnes, l'abattoir est petit, à partir de 30 000 tonnes il est important ; entre les deux, il est moyen.

Nous avons des progrès à faire sur la traçabilité. Le consommateur sait-il vraiment ce qu'il achète ? Certes, l'étiquetage est obligatoire, mais il est hasardeux, pas toujours très lisible.
L'abattage rituel, sans étourdissement préalable, fait l'objet d'une guerre des chiffres entre associations de protection des animaux, et industriels... Cela génère de la confusion, propice à tous les amalgames. Savez-vous quel est le pourcentage des animaux qui sont abattus en France sans étourdissement préalable ? Avez-vous de bonnes sources d'information ?
Nous n'avons ni sources, ni chiffres pour répondre à cette question. Je suppose que vous entendrez les fédérations d'abattoirs ; je ne sais pas s'ils mettront des chiffres à disposition, ou s'ils en font un secret industriel.
Cette question du mode d'abattage est mise en avant dans les médias depuis un an tout au plus. Du reste, il n'y a pas qu'un seul rite. Certains pays, comme la Malaisie, considèrent l'étourdissement préalable comme hallal. L'espoir est que tous les abattages rituels s'opèrent à terme avec étourdissement préalable.
Il s'agirait d'une forme de certification unique, qui n'est possible que s'il existe une norme internationale.

Les abattoirs sont toujours jumelés à des salles de découpe, ce qui n'était pas le cas autrefois, et ces ensembles sont obligés de faire à la grande distribution des livraisons de plus en plus abouties : les bouchers ne reçoivent plus de carcasses entières. Ces exigences obligent les abattoirs et les salles de découpe à se procurer des outils gigantesques, ce qui condamne l'éclosion des circuits courts. Qu'en pensez-vous ?
Bref, plus la grande distribution prend des parts de marché, plus on condamne les petits abattoirs et, donc, les circuits courts. Je m'étonne qu'il n'y ait pas de volonté plus nette de rectifier cette tendance.
De plus en plus, l'élaboration, la mise en barquette, la transformation des viandes bovine et ovine en haché ou en brochettes se font du côté des industriels...
La viande est expédiée muscle par muscle, et non plus carcasse par carcasse. Cela dit, cette tendance se développe relativement moins vite qu'on ne pouvait le penser. Intermarché, Leclerc ou Super U, s'étant aperçus que cette pratique rigidifiait leur offre, laissent leurs magasins s'approvisionner localement à l'inverse d'Auchan, de Carrefour ou de Casino dont la chaîne de distribution est plus centralisée. Comment combattre cette tendance ? Tout est question du rapport de forces entre producteurs et grande distribution.
La France, pour ce qui est de l'export, est plutôt positionnée sur la vente de viande par carcasse. Si cela constitue un atout, parce que les coûts de transformation sont limités, nous ne pouvons pas jouer, comme le font d'autres grands exportateurs, sur la complémentarité des marchés. Le Brésil, entre autres, sait exporter sur les marchés les pièces de viande que ces marchés demandent.
L'économie française est très internationalisée, ce qui nous interdit de songer à une renationalisation complète de l'offre et de la demande dans un avenir proche. Nous pouvons augmenter la part de taurillons produits et vendus en France, nous pouvons aussi accroître les exportations de vaches de réforme en les engraissant nous-mêmes, plutôt que laisser les Italiens de la plaine du Pô, les Espagnols de Catalogne et d'Aragon le faire. Reste que nous vivons dans une économie européenne et, bientôt, périméditerranéenne. Nous ne parviendrons pas à produire en quantité suffisante la qualité de viande que nous préférons consommer. La production couvre la moitié de nos besoins en viande de mouton et le cheptel se réduit d'année en année, malgré le bilan de santé de la PAC. La démonstration vaut pour les vaches de réforme : nous avons perdu 200 000 têtes en deux ans.
Les circuits courts, une idée dont on ne parlait pas il y a dix ans, représentent une idée très nouvelle mais restent une pratique mineure...
Les producteurs de viande ovine qui se sont engagés dans cette voie réalisent leurs ventes à 80 % dans les filières traditionnelles. Les circuits courts nécessitent des outils d'abattage adaptés de petite taille. Ces petits outils d'abattage, qui dépendent souvent des collectivités territoriales, doivent être modernisés...

Ils ont disparu... Et les pouvoirs publics excluent l'idée de les certifier.

Nous recevons à présent M. Henri Brichard, vice-président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, et ses conseillers, M. Antoine Suau et Mme Nadine Normand. Nous aimerions connaître le sentiment de la FNSEA sur l'économie et la compétitivité de la filière viande et la question de la confiance du consommateur.

La FNSEA est, de loin, la principale organisation syndicale du monde agricole français. Après le scandale de la viande de cheval substituée à la viande bovine. Nous nous interrogeons sur la restauration de la confiance du consommateur. Comment faire progresser les ventes de viande bovine ? Depuis les crises de la maladie de la vache folle, l'ESB, les viandes fraîches sont tracées de l'élevage à l'étal. Ne faut-il pas en faire de même pour les produits agroalimentaires à base de viande ?
La filière viande est en proie à un mal-être généralisé, et pas seulement pour des raisons économiques. Un ras-le-bol s'exprime face à des normes et des contraintes parfois contradictoires. La Commission européenne, dans le cadre de la PAC, veut soumettre l'agriculture, plus qu'autrefois, à la loi du marché. Dans le même temps, elle impose aux éleveurs de conserver l'herbe sur les exploitations quand ceux-ci ont économiquement intérêt à basculer vers une alimentation des bovins à base de maïs... La contrainte de la quantité de travail est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, surtout dans les régions où l'élevage côtoie les grandes cultures, un secteur qui fonctionne bien mieux.
Alors, comment sauver ce secteur ? La FNSEA a toujours soutenu que l'élevage, important en soi, apporte une valeur ajoutée supplémentaire à l'agriculture. Il constitue, entre autres, un débouché pour les céréales qui servent à l'alimentation des bêtes.
Les charges des éleveurs, en particulier les charges alimentaires, augmentent rapidement, parfois de 20 à 30 % en quelques mois, tandis que les prix de vente se tassent. D'où un effet de ciseau qui pèse exclusivement sur l'amont. Pour répartir équitablement cette hausse des charges tout au long de la chaîne, jusqu'au consommateur final, nous avons conclu, le 3 mai 2011, un accord entre producteurs, transformateurs et distributeurs afin d'ajuster, à la hausse comme à la baisse, les prix de vente en fonction des variations de charges. Après tout, quand le prix de l'énergie augmente, celui des billets d'avion aussi... La FNSEA espère qu'on y reviendra dans la future loi d'avenir de l'agriculture. Il faudra probablement passer aussi par une modification de la loi de modernisation de l'économie (LME) pour en arriver à des pratiques plus convenables. Les producteurs, parce qu'ils sont éclatés, font figure de maillon faible face à la grande distribution.
Le coût de la main-d'oeuvre pèse plutôt sur les abattoirs et les transformateurs. Le marché européen est unique, mais les règles sociales et fiscales, elles, sont différentes entre Etats membres de l'Union européenne. Ce qui conduit à des aberrations : un bovin français, abattu en Allemagne, plus compétitive sur ce segment, peut revenir sous forme de produits transformés dans nos supermarchés.
Il existe des écarts de plus en plus grands entre exploitations au niveau des poids des charges. Les plans de modernisation des bâtiments d'élevage ont fait leur effet dans le secteur bovin, les éleveurs doivent cependant continuer de faire des efforts pour produire plus et travailler mieux.
Les normes, surtout environnementales, ne sont pas à condamner en soi. Mais les producteurs ont du mal à les accepter lorsqu'elles ne sont pas adaptées à leur région, leur climat et leur sol. Prenons un exemple simple : une seule période d'épandage est fixée au niveau national en dépit de réalités agronomiques très différentes. Adapter les dates d'épandage aux territoires nous épargnerait d'augmenter nos capacités de stockage d'effluents, un effort financier supplémentaire demandé aux éleveurs alors qu'ils viennent juste d'amortir leurs investissements. Nous y économiserions aussi un peu de béton...
Les contraintes administratives jouent surtout pour le porc et la volaille. La complexité des dossiers à constituer et la longueur des délais pour voir aboutir les projets découragent l'investissement. Trois ans d'attente, c'est insupportable ; entre-temps, l'intérêt du projet peut avoir diminué.
La volatilité des cours des matières premières, qui est désormais structurelle appelle une autre réponse que celle des instruments de la PAC, trop légers. Le Parlement européen défend des filets de sécurité plus adaptés en volume et en prix, plus flexibles ; nous espérons qu'il aura gain de cause car un prix plancher de la viande de 1,50 euros quand le cours est de 2,50 euros pour les plus basses catégories ne suffit pas.
Nous avons avancé sur le dossier d'avenir de la gestion des risques lors de la dernière loi de finances avec la réforme de la déduction pour investissement (DPI), et de la déduction pour aléas (DPA). Grâce à ces outils fiscaux, nous irons vers une gestion pluriannuelle, ce qui est indispensable pour passer les mauvaises années. Il existe également des fonds de mutualisation dans la PAC ; nous avions beaucoup insisté sur ce point en 2008, en mettant en oeuvre l'article 68 du bilan de santé de la PAC. Réfléchissons à une assurance fourrage en prenant exemple sur l'Espagne et l'Italie : ces deux pays ont créé des pôles assurantiels regroupant compagnies privées et pouvoirs publics et cela fonctionne bien. Les pouvoirs publics devront intervenir, en dernier instance, pour la réassurance.
Beaucoup de progrès restent à faire dans l'organisation des producteurs : les producteurs bovins sont peu affiliés à des coopératives, ce qui est moins vrai pour les éleveurs porcins. Le taux de regroupement est de 40 %. Certains expliquent cette situation par la culture des agriculteurs ; cela dépend beaucoup des régions, en fait. Le problème est surtout celui du droit de la concurrence. Nous défendons l'extension des mesures du « paquet lait » aux autres secteurs. Cela sera difficile mais il faudra faire évoluer les agriculteurs, ils ont leur part de responsabilité lorsqu'ils arrivent en ordre dispersé face à une entreprise de transformation qui occupe 40 à 50 % du marché.
À chaque crise de l'ESB, nous avons observé un pic de sensibilité aux modes de production. Les consommateurs, en réalité, connaissent très mal notre métier : ils s'imaginent des exploitations de centaines de bovins quand la moyenne est, en France, de cinquante vaches. La charte des bonnes pratiques d'élevage vise à mieux les informer.
Les logos d'origine sont mal acceptés par l'Europe et les transformateurs ; nous les avons obtenus pour le porc et la volaille cette année à Bruxelles. Avec pour ligne de conduite, la transparence et le choix pour le consommateur, nous ne pouvons qu'être favorables aux logos d'origine sur les produits transformés. Il restera à vaincre les réticences de la Commission européenne et des pays du Nord qui ont davantage une culture de commerçants que de producteurs. En tout cas, nous défendons ce dossier au sein du Copa-Cogeca. Le signe d'identification de l'origine, en soi, n'induit pas de coûts supplémentaires, si ce n'est que, pour être valable, il suppose une certification. Or au-delà des périodes de crise, le consommateur se détermine surtout en fonction du prix des produits. Comment valoriser la transparence ? Nous voulons promouvoir l'origine France, mais la réussite de cette stratégie n'est pas garantie. Nous aussi, il nous arrive d'acheter des téléviseurs fabriqués n'importe où parce qu'ils sont les moins chers dans les rayons des supermarchés...

Nous avons les plus grandes difficultés à obtenir des chiffres sur les modes d'abattage, une information que de nombreux éleveurs voudraient voir figurer sur le produit. À votre connaissance, quel est le pourcentage de bovins et d'ovins abattus rituellement en France ? Nous savons que cette technique peut faire courir certains risques sanitaires...
Sincèrement, la FNSEA ne possède pas ces chiffres. Les instituts techniques et l'interprofession de l'abattage seront peut-être capables de vous les fournir.

Il faudrait indiquer également que la viande abattue en France n'est pas forcément de production française. La commune dont j'ai été maire abrite un abattoir qui produit 17 000 tonnes à partir de viandes foraines.

Le Sénat vient d'adopter sa première loi issue d'une proposition du groupe écologiste, concernant les lanceurs d'alerte, je m'en réjouis ! Les normes, surtout quand elles sont édictées depuis Bruxelles, méritent adaptation, mais comment ?
Le monde agricole, qui était solidaire dans le passé, est désormais divisé entre plusieurs mondes : les grandes cultures qui se portent bien d'un côté, l'élevage en grande souffrance de l'autre... Pour le rassembler, notre ministre a fait une proposition intéressante : la surprime aux cinquante premiers hectares dans le cadre de la future PAC. Qu'en pensez-vous ? Le plafonnement des aides de la PAC à 100 000 euros ne rendrait-elle pas la répartition de celles-ci plus équitable ?

Si ! Il est question de viande et d'élevage, de régulation européenne, de régulation nationale pour plus de solidarité.

Tant qu'à faire, vous auriez pu aussi parler du transport de la paille !

La crise récente a renforcé la position des éleveurs français car chacun sait la qualité de notre viande. Que représente la production française dans notre consommation ? Pour avoir été producteur, je sais que nous fournissions il y a quelques années de la viande bovine et de la viande porcine à l'Allemagne et que le rapport de forces s'est inversé, surtout pour le porc. La raison en est très simple : ce qui était la principale ressource de l'agriculteur, la viande, est devenue la ressource annexe avec le développement du biogaz issu de la méthanisation. M. Bailly pourrait décrire la même situation pour les ovins et la laine en Nouvelle-Zélande. Qu'en est-il pour le boeuf ?
Le monde agricole était et reste solidaire ; c'est un éleveur venant d'un département de grandes cultures, l'Aisne, qui vous l'affirme. La solidarité, c'est une valeur forte de la FNSEA. D'ailleurs, comme je l'ai expliqué, les écarts entre exploitations, qu'on ne perçoit pas au niveau macroéconomique, sont aussi importants que les différences entre secteurs. Certes, l'élevage se porte globalement plus mal. La solution passe d'abord, même si l'accompagnement est toujours bienvenu, par l'économie et les outils de la PAC. Dans la boîte à outils, il faut pouvoir compter sur le recouplage des aides - qui fait l'objet d'une véritable bataille à Bruxelles - la compensation du handicap ou encore les dispositifs d'aide à l'herbe. La surprime pour les cinquante premiers hectares n'est peut-être pas le plus pertinent ; l'institut de l'élevage a été le premier à travailler sur cette hypothèse et, depuis, en est revenu. Nous avons toujours combattu pour des aides plus flexibles, plus ciblées sur les secteurs en difficulté. Les céréaliers sont les premiers à demander cette évolution qui est rendue difficile par les règles de l'organisation mondiale du commerce (OMC), mais aussi par l'annualité budgétaire qui s'applique au budget européen. Travaillons sur la gestion des risques et le fonds de modernisation céréaliers-éleveurs (FMCE). Celui que nous avions lancé, à titre privé, repose sur le volontariat. Son efficacité suppose qu'il devienne obligatoire avec une contribution volontaire obligatoire (CVO).
Monsieur Revet, je ne suis pas en mesure de vous donner des chiffres précis sur notre autonomie alimentaire. En ovins, nous sommes très déficitaires, avec un taux de couverture de 40 %. Pour les bovins, nous sommes en dessous des 100 %.
La place de l'Allemagne sur le porc et la volaille s'explique par des coûts de main-d'oeuvre plus bas et notre difficulté à développer nos exploitations. Pour ce qui est de la viande bovine, nous envoyons nos animaux en Italie se faire engraisser.

A cause des normes initiales, qui sont moins contraignantes dans la plaine du Pô.
Naisseur et engraisseur sont aussi deux métiers différents ; d'où le choix du bassin allaitant de se tourner vers l'Italie. L'évolution de la PAC, avec la convergence des aides, aura un impact fort sur l'élevage. Reste à trouver l'équilibre entre le secteur naisseur et le secteur engraisseur.
Les échanges avec l'Allemagne venaient du fait que nous mangions, traditionnellement, les arrières, d'où l'envoi des avants vers l'Allemagne, qui a d'autres traditions culinaires.

Il existe un groupe de travail sur la PAC, ne nous égarons pas. Notre sujet ici est la filière bovine et la traçabilité de la viande.

Cela suppose que nous examinions aussi ce qui touche à la production et à ses conditions économiques, dans laquelle la PAC joue un rôle important.

En matière d'étiquetage et d'information du consommateur, les plats cuisinés sont dans le viseur des pouvoirs publics. Or, une quinzaine de produits entrent dans la composition de ces plats, non seulement la viande, mais tout ce qui l'accompagne. Je ne doute pas que nous soyons en mesure d'indiquer d'où vient le moindre navet, mais c'est un produit que les consommateurs achètent, pas un panneau d'affichage. Tout recenser rendrait l'information illisible. Un échange avec la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), ainsi qu'avec les associations de consommateurs, ne serait pas malvenu.

Nous entendrons demain les représentants de la fédération du commerce et de la distribution (FCD), et plus tard la DGCCRF et les associations de consommateurs.

Il est tout de même prodigieux de constater que quand le prix plancher de la viande est atteint, cela ne se répercute jamais sur le consommateur. La vocation d'un syndicat est de fédérer les énergies. Y a-t-il moyen d'aboutir à un mécanisme de régulation des prix tout au long de la chaîne ?
La réussite du FMCE dépend, via le mécanisme des CVO, de la puissance publique, puisque c'est elle qui étend les accords interprofessionnels. Cela étant, des contrats se mettent en place entre céréaliers et éleveurs, pour des échanges paille-fumier, par exemple - preuve que la solidarité existe.

Vous avez clairement évoqué la question des relations entre producteurs et distributeurs, et avez même évoqué la nécessité de réformer la LME. Nous vous remercions pour toutes ces pistes.

Nous aimerions entendre le point de vue de l'interprofession porcine sur la situation économique et la compétitivité de la filière, qui souffre depuis plusieurs années, ainsi que sur les questions touchant à la traçabilité de la viande et au respect de l'environnement.

Nous savons, en effet, la filière en difficulté. Quelles sont ses perspectives économiques ? Comment se portent les différents acteurs de la filière ? Quelles sont vos prévisions à court et moyen terme ? Quelles mesures de soutien vous paraîtraient opportunes ?
Je suis éleveur de porcs dans le Finistère, près de Landerneau, depuis 35 ans. Assisté de cinq collaborateurs, je produis, avec 600 truies, 18 000 porcs par an. Je préside également la coopérative Prestor, qui regroupe 450 éleveurs, représentant une production de plus de 2 millions de porcs par an, et est actionnaire du groupe GAD. L'interprofession porcine, que je préside depuis sa création, en 2002, regroupe tous les maillons de la filière, de la production à la grande distribution, présente dans notre conseil d'administration. Nous travaillons à la promotion de nos produits en France et à l'export - qui est pour nous crucial, et, en liaison avec l'Institut technique de la filière porcine, que nous finançons en grande partie. Nous travaillons également sur les questions de recherche et développement, les perspectives économiques de la filière, mais aussi sur la gestion des risques afin d'assurer la protection des cheptels. Nous sommes très attachées à offrir au consommateur les garanties qu'il attend, dont la traçabilité, qui passe par l'étiquetage. L'interprofession est jeune, composée autour d'une petite équipe d'ingénieurs. Inaporc a la particularité de gérer l'association ATM porc, qui a la responsabilité de l'équarrissage depuis la privatisation de ce secteur en 2009. C'est un marché de 150 millions d'euros, avec deux sociétés sur le territoire. Depuis le désengagement de l'État, nous avons réduit les coûts de l'équarrissage de 20 % - il faut dire que notre pouvoir de négociation est plus élevé que celui de France AgriMer, et que nous travaillons également à développer la concurrence, en recherchant des solutions alternatives.
La filière porcine est soumise à rude concurrence. Le porc est une viande populaire et qui doit le rester. C'est la première viande consommée en France et dans le monde. Elle n'en subit pas moins quelques tabous liés aux problématiques confessionnelles, ce qui n'est pas facile à gérer au quotidien, j'en veux pour preuve les appels d'offre des collectivités locales, qui peuvent être amenées à exclure le porc du menu des cantines, pour conserver un double choix à tous les enfants, viande ou poisson. Cela peut être choquant dans un État laïc : la question nutritionnelle ne devrait pas s'encombrer de considérations confessionnelles.
Voici quelques chiffres sur la filière porcine : 250 millions de porcs sont produits chaque année en Europe, soit 22 millions de tonnes. La France assure environ 10 % des volumes, soit 24 millions de porcs. A titre de comparaison, la Chine en produit 500 millions, les États-Unis 100 millions, l'Amérique du Sud 200 millions.
Les débouchés sont de deux types. Les parties nobles de l'animal vont dans les pays où le pouvoir d'achat est élevé - Europe, États-Unis, Japon, Corée du Sud. Les autres parties, têtes, oreilles, pieds et abats, vont sur les marchés à plus faible pouvoir d'achat, comme la Russie.
Nous sommes aujourd'hui autosuffisants en volume, avec 2 millions de tonnes produites par an pour autant de consommées. Mais nous exportons un tiers de notre tonnage, et importons par conséquent autant, notamment pour le jambon, depuis l'Espagne, l'Allemagne, le Danemark. Jusqu'il y a trois ans, nous étions exportateurs nets en valeurs ; aujourd'hui, nous sommes déficitaires, pour 500 millions d'euros.
La filière est confrontée à un défi redoutable. Il faut garantir au consommateur un prix abordable, mais en même temps, il faut couvrir les coûts de production. Or, dans ces coûts, l'alimentation compte pour 65 %.
De céréales, et de soja - 12 % aujourd'hui contre 25 % auparavant - généralement importé, ainsi que d'autres composants, comme le colza. Or, la volatilité du coût de ces matières premières n'est pas répercutée sur le consommateur. Quand le prix de revient au kilo monte à 1,80 euro, nous restons payés 1,62 ou 1,63 euro. D'où une lente érosion du revenu des éleveurs avec, paradoxalement, des résultats comptables variables. Chez moi, sachant que le stock est de 650 000 euros, une variation de 20 % représente 150 000 euros.
Au-delà de cette question du prix de revient, qui se pose dans tous les pays, notre problème de fond tient d'une part aux problématiques fiscales et sociales, d'autre part aux normes.
Se pose, tout d'abord, le problème du coût de la main d'oeuvre dans la transformation. Le plus gros abattoir de porcs européen est allemand, il s'agit de la société Tonnies : 14 millions de porcs sont abattus chaque année par cette l'entreprise, installée principalement dans les anciens Länder de l'Est, qui fait appel à une main d'oeuvre venue à 90 % des nouveaux Etats membres de l'Union européenne, voire d'Etats hors Union européenne, à un coût de 5 à 7 euros de l'heure, contre 20 euros chez nous. Or la main d'oeuvre représente 40 à 60 % du coût de l'abattage. En 1995, l'Allemagne produisait ainsi 30 millions de têtes, contre 25 millions en France. Aujourd'hui, elle produit 45 millions de porcs et en abat 60 millions, la différence venant des Danois et des Hollandais, qui font abattre en Allemagne.
Vous comprendrez notre souhait d'une harmonisation sociale à l'échelle européenne.
Nous souhaitons une harmonisation fiscale car les entreprises allemandes ont d'importantes facultés d'optimisation fiscale, pour bénéficier du régime favorable de TVA jusqu'à 800 000€ de chiffre d'affaires. Les entreprises encaissent donc un différentiel de 3 % entre TVA versée et encaissée. Cela représente, pour une exploitation comme la mienne, une différence de 60 000 à 70 000 euros, soit, sur dix ans de carrière, de 600 000 à 700 000 euros.
Les choix politiques ont, eux aussi, des incidences. Quand les Verts allemands ont, au cours des années 1998-2000, imposé la sortie du nucléaire, ils ont donné un avantage comparatif extraordinaire aux éleveurs allemands. La méthanisation est devenue une manne, transformant la viande de porc en un simple sous-produit du lisier. Il est vrai qu'il est impensable d'envisager une harmonisation énergétique totale et que la France présente sur ce point quelques avantages : quand nous achetons le kilowatt chez EDF à 6,5 centimes, les Allemands le paient 13 centimes.
Malgré cette perte de compétitivité et la réduction de la production, le marché reste saturé en France. Le prix de revient est donc la variable essentielle. Les réglementations nous échappent largement, car elles relèvent plutôt du niveau européen.
Des correctifs à la PAC, qui n'est guère équilibrée pour les éleveurs, seraient bienvenus. Ses premiers bénéficiaires sont les céréaliers. Il n'en serait pas moins utile qu'une partie de la dotation soit flottante, pour aller, selon les circonstances, à ceux qui en ont le plus besoin.
Cela est resté marginal, même si l'idée était bonne dans son principe.
Peut-être pourrait-on agir sur le deuxième pilier, via la conditionnalité environnementale et énergétique des aides. Les normes environnementales sont très strictes en France, et la production porcine est localisée à 70 % dans le grand ouest, où la question de la qualité de l'eau a été, ces quinze dernières années, centrale. Nous avons fait d'importants travaux de mise aux normes, investi sur le traitement des lisiers et malgré cela, l'étau réglementaire ne nous permet pas d'envisager des extensions d'élevage dans les zones en excédent structurel, tandis qu'il est presque impossible de créer des exploitations dans celles où il n'en existe pas, tant les comités de défense sont prompts à surgir de terre. Seul, on ne peut rien. Si les élus, au nom du développement économique de leur territoire, de l'impératif de maîtrise écologique aussi, de l'emploi - la filière en compte 80 000 - pouvaient nous appuyer, cela serait très utile.

Nous exportons, dites-vous, ce qui ne se consomme pas en France, mais restons importateurs de ce qui s'y consomme bien, comme le jambon. Ce qui signifie que si l'on produit plus, il faudra exporter davantage. N'est-il pas envisageable, pour faire face à la concurrence, d'afficher le particularisme de la production à la française. Chez moi, le porc noir de Bigorre est une véritable niche valorisable.
Les produits bien identifiés, comme le porc noir de Bigorre ont un marché, y compris à l'export. On les trouve sur les étals jusqu'à Pékin ou Séoul. L'image du luxe français est bonne. Mais il demeure sur un créneau marginal au regard de nos fondamentaux : le porc se doit d'être une viande populaire à un prix abordable. Aujourd'hui, le coût est de 1,60 euro à la sortie de l'élevage, de 3,20 euros à la sortie de l'abattoir, de 5 euros après transformation, et de 9 euros à la distribution. La France consomme 2 millions de tonnes. Une augmentation de 30 centimes représenterait 600 millions d'euros. Voilà de quoi combler ce que nous avons perdu ces dernières années, 230 millions pour les éleveurs, 120 millions pour les abattoirs, 100 millions pour les transformateurs, ce qui laisserait encore 150 millions à la distribution. Pour le consommateur, qui achète 35 kilos par an, cela représenterait un cout supplémentaire de 10 euros sur l'année, même pas deux paquets de cigarettes. Mais je sais bien que c'est là un pur jeu de chiffres, et que le marché ne fonctionne pas ainsi...

Notre mission fait suite à des événements récents, qui pourraient pénaliser toute la filière : le consommateur perçoit le monde de la viande comme un univers où les règles sont mal respectées, d'où un comportement de retrait. Comment corriger les choses pour renverser la vapeur ? Car les dégâts collatéraux sur l'emploi peuvent être énormes.
Nous produisons une viande peu chère, selon un système de production beaucoup plus standardisé que dans la filière bovine, avec peu de segmentation - et nous nous efforçons, au sein de l'interprofession, de ne pas opposer les segments. Le bio ne représente que 0,1 %, le label rouge 5 %, nous avons quelques indications géographiques protégées, fondées sur une certification de conformité du produit, montées à 50 % dans les années 1990, parce que les grandes surfaces étaient demandeuses, mais redescendues à mesure que s'éloignait la crise de l'ESB. Nous avons des programmes sur six races locales, qui vont du Cul noir Limousin au cochon de Bayeux. Parmi les races locales, les plus nombreuses sont les basques. Nous aidons le Noir de Bigorre, pour assurer la variété génétique. Mais ce sont des variétés très typées, grasses, faites pour la charcuterie, et les prix sont élevés. Notre démarche reste donc globale, marquée cependant par le souci de préserver la qualité.
La question de la traçabilité est revenue sur le devant de la scène, avec les récents scandales. Heureusement que nous n'avons pas trouvé de porc en renforcement du boeuf dans les lasagnes à l'origine du scandale, nous aurions assisté à des procès en cascade. Nous sommes donc très vigilants. Nous savons ce qu'est notre part de marché ; 95 % des porcs produits le sont par des adhérents de coopératives et de groupements de producteurs ; c'est une chance. Le marché est ainsi très encadré. Et nous mutualisons les services techniques ; nous embauchons les vétérinaires, les techniciens, les ingénieurs. Nous maîtrisons l'identification des animaux, via Uniporc pour 80 % et quelques interprofessions régionales, pour assurer la traçabilité. Nous avons donc une longueur d'avance.
Il n'en demeure pas moins quelques contradictions. Je pense, notamment, à l'étiquetage. Nous avons, sur le sujet, signé, en 2010, des accords volontaires. Volontaires car on ne peut exiger, sachant que 30 % de ce qui est consommé est importé, que tout soit étiqueté français. Les Allemands ont su, mieux que nous, développer le réflexe patriotique. Chez nous, le consommateur cherche plutôt le produit le moins cher, car c'est le seul message de la distribution. Il est vrai aussi que sur certains produits, comme le saucisson, qui est un mélange, l'industriel s'approvisionne où il peut ; il est donc difficile de donner pour ces produits une indication de provenance au sein de l'Union européenne. Mais pour ce qui est bien identifié, et notamment les produits bruts, il serait sage de mentionner le pays d'origine. L'Union européenne doit légiférer d'ici à décembre 2014, mais elle le fera sous la pression des pays fortement exportateurs, qui feront tout pour que l'on ne descende pas en deçà de la mention « Union européenne ». C'est ainsi que faute d'incitations fortes des pouvoirs publics, l'étiquetage tel que nous le préconisons reste volontaire. Il faut beaucoup de force de conviction pour le développer. Sachant que 60 % des produits sont aujourd'hui identifiés, nous travaillons à aller au-delà. Mais la grande distribution, qui écoule 85 % de notre production, ne relaie pas notre effort et en reste au seul message sur le prix, ce qui contribue à une certaine opacité sur les origines.

Je comprends mal que les gouvernements qui se sont succédés ne se soient pas attelés au problème de l'identification de l'origine des viandes par le consommateur, alors qu'en matière alimentaire, l'Europe ne cesse d'édicter les règlements les plus tatillons. La filière porcine a perdu en France 8 % de sa production. Et cela ne va pas mieux dans les filières ovine et bovine. Il est vrai qu'hors la Bretagne, il est difficile d'entreprendre de bâtir une porcherie sans se heurter aussitôt à certaines associations. Il faudrait pourtant faire prendre conscience que ce produit est nécessaire ! Chez moi, la seule solution serait de s'installer à côté d'une fromagerie, en faisant valoir l'argument du lactosérum.
Sur la PAC, j'ai posé la question à M. Le Foll : il m'a répondu qu'à son grand regret, il paraissait impossible de faire aboutir à court terme l'idée des primes flottantes. Quant à l'utilisation du second pilier pour soutenir économiquement les productions en difficultés, je crains que tout le monde veuille aller y chercher son bonheur...
Je m'interroge sur le soja utilisé dans l'alimentation des porcs : est-il exempt d'OGM ?
Les bovins sont répertoriés sous un numéro, mais jusqu'où descend l'étiquetage, pour les porcs ? Peut-on savoir où un jambon a été produit ?

Il est vrai que les Allemands n'hésitent pas à vanter leur production nationale. En France, en dépit des scandales récents, les citoyens sont convaincus que la production française est bien surveillée et de qualité. Ne pourrait-on en tirer profit ? Chacun sait que « tout est bon dans le cochon », même si nous exportons beaucoup, mais un label France n'aurait-il pas des effets positifs ? Les parlementaires que nous sommes ne pourraient-ils vous aider en promouvant un tel dispositif, assurant la traçabilité ?

Je n'oublie pas qu'un projet de loi relatif à la consommation est à venir. Le gouvernement affirme qu'il ne peut imposer un marquage national : j'aimerais savoir pourquoi. J'étais présent, samedi dernier, au lancement du plan méthanisation, dans une exploitation exemplaire, sans le gigantisme qui marque ses homologues allemandes. Je revendique aussi l'étiquetage de la viande « nourrie sans OGM », nous avons tout à y gagner. N'y a-t-il pas là autant de pistes d'avenir pour la filière ?

J'ai été très sensible à votre proposition de donner 30 centimes d'euros par kilo de plus à l'éleveur. Ne serait-il pas possible que 15 centimes aillent au consommateur et 15 autres au transformateur ? Le consommateur ne doit pas être abusé sur la provenance des viandes. J'en veux pour preuve la charcuterie Corse produite à partir de cochons venus du continent. C'est un peu comme peu l'agneau de Sisteron élevé à Dijon...

Lors d'une précédente rencontre, le président de la FNSEA nous disait avoir visité un abattoir allemand dont les 2 500 employés portaient des blouses de couleurs différentes et n'étaient pas payés de la même façon en fonction de leur pays d'origine. En tant que parlementaires français, que faire face à cette concurrence plus que déloyale ?
Nous n'avons pas de doctrine sur les OGM dans le contexte actuel où, faute d'avoir trouvé une solution à l'OMC, l'on négocie des accords de libre échange tous azimuts. Tout cela est loufoque ! Nous exportions 40 000 tonnes de poitrines de porcs vers la Corée avant que ce pays ne signe un accord avec le Chili, faisant chuter ce chiffre à 20 000 tonnes. Avec les accords de libre échange, c'est la loterie à la fois au plan commercial et en matière de normes. Des discussions sont en cours avec les Canadiens alors qu'ils continuent de donner de la farine animale aux cochons, de les nourrir aux OGM, des les soigner avec des antibiotiques facteurs de croissance, le tout sans aucune politique de prévention. Comme dans les abattoirs américains, ils ne prennent aucune précaution, se contentant de nettoyer les carcasses à l'eau de Javel... et nous allons devoir importer ces produits. Si l'on nous demande ne pas nourrir nos animaux avec des OGM, c'est à dire d'augmenter nos coûts de production sans avoir la certitude que le consommateur fera la différence, nous disparaitrons. Certes quelques distributeurs se sont engagés à ne proposer que des produits sans OGM, mais les autres laissent le choix au consommateur qui se fondera, sur le seul critère du prix, d'autant que le porc ne s'adresse pas aux plus fortunés.
Nous souhaitons mettre en place un étiquetage Viande porcine française (VPF) assorti d'un cahier des charges, sachant qu'aujourd'hui, lorsque vous achetez un jambon, le commerçant dispose des documents d'accompagnement permettant de remonter jusqu'à la fabrication des lots dans l'usine ; contrairement aux élevages bovins, notre cheptel est en effet organisé en troupeaux et non par individus.
A propos de la méthanisation, je rappelle que la taille moyenne des élevages au Danemark, aux Pays-Bas et dans le Nord de l'Allemagne est de 500 à 600 truies par élevage contre 200 en France. Nous sommes des artisans et entendons le rester. Nous n'avons qu'une seule doctrine : que les capitaux des élevages soient détenus par la famille. Le modèle français permet ainsi à chacun de s'exprimer en fonction de ses ambitions tout en conservant une taille humaine aux exploitations.
Enfin, il convient de terminer l'Europe sociale et fiscale.
Si la directive Bolkestein est cachée derrière un voile pudique, nous la voyons bien à l'oeuvre dans nos villages, avec des ouvriers venus d'autres Etats membres de l'Union européenne, qui dorment dans des camionnettes et travaillent le week-end !

Oui, elle a hélas été adoptée par le Conseil et par le Parlement. En tous cas, merci pour la qualité de nos échanges.

Nous avons le plaisir d'accueillir pour cette dernière audition de l'après-midi la fédération nationale ovine (FNO). De même que MM. Fortassin et Bailly ont sans doute eu l'occasion de vous recevoir lorsqu'ils rédigeaient leur rapport, j'avais moi-même eu beaucoup de plaisir à travailler avec votre fédération en 2008 lorsque nous dressions le bilan de santé de la PAC.

Etant fille d'éleveur de moutons, je suis moi aussi ravie de vous recevoir.
En 2013, le marché de la viande ovine avait été marqué par une très importante chute des prix, un regain d'importations britanniques ayant entraîné un surplus de 500 000 agneaux dans notre pays. Comment expliquez-vous les faiblesses de la filière ? Comment la France s'inscrit-elle dans la concurrence européenne et extra européenne en particulier néo-zélandaise ? Quelles mesures pourrions-nous prendre pour vous soutenir ?
Pour votre information, je suis éleveur de moutons dans le sud du département de la Vienne.
La diminution du cheptel ovin français a débuté il y a trente ans, lorsque, dans les années 80, notre filière fut la première à recevoir des aides accompagnées d'un alignement sur le prix mondial. Le nombre d'animaux a baissé de 50 à 60 %, notre autosuffisance est passée de 80 % à 45 % et la baisse des revenus les éleveurs les a conduits, sauf dans les zones de montage, à se diriger vers l'élevage bovin, le lait ou les céréales. Pour résister à la concurrence, nous avons mis en place des signes officiels de qualité qui nous assurent un avantage de 1 euro à 1,50 euro par kilo par rapport aux moutons anglais. Parmi ses faiblesses, la filière ovine a la particularité de nécessiter beaucoup de bras et d'être très technique alors que beaucoup d'épouses qui travaillaient auparavant avec leur mari ont trouvé un emploi à l'extérieur.
Est ensuite venue la période 2007-2008 au cours de laquelle nous avons demandé aux pouvoirs publics d'agir, faute de quoi, comme celle du cheval de trait, cette production pouvait disparaitre. Nous avons travaillé avec Michel Barnier comme avec les parlementaires de gauche et de droite et nous avons réussi. L'élevage ovin représentait 80 000 exploitants dont 50 000 ayant plus de 10 brebis et - coeur de la filière - 23 000 éleveurs, considérés comme professionnels, en percevant des aides. Si cette production est très présente dans les zones de montagne, elle existe en réalité dans tous les départements. Une volonté politique et syndicale forte ont permis un rééquilibrage au moment du bilan de santé de la PAC consistant à attribuer 125 millions d'aides supplémentaires au profit de ce secteur, soit 24 euros par brebis, au titre des mesures dites de l'article 68. Nous avons souhaité orienter ces aides en les réservant aux éleveurs dont la productivité est au minimum de 0,7 agneau par brebis et en conditionnant 3 des 24 euros à une contractualisation. La carence de l'élevage ovin, comme des autres productions, étant la gestion de l'offre, nous avons, non sans difficulté, demandé à chaque éleveur d'établir un plan prévisionnel de production. Grâce à la base de données mise en place par Emmanuel Coste, président de l'interprofession, nous pouvons ainsi anticiper les périodes de creux et de pointes de production afin, dans ce dernier cas, de mettre en place des opérations avec les grandes surfaces. Lorsque l'aide de 24 euros a été instaurée, tout le monde nous prédisait qu'elle serait récupérée par l'aval. Or, le prix des agneaux a augmenté au cours des trois années suivant la réforme. Je tire une fois de plus mon chapeau à Emmanuel Coste car nous sommes la seule filière parvenue à conclure un accord interprofessionnel, Interbev ovins qui regroupe 13 familles. Comme pour un bateau au large, il nous faut tous ramer ensemble pour faire avancer. L'accord interprofessionnel a créé un climat qui conduit chacun, y compris les grands groupes industriels comme Bigard ou la coopération, à mener avec nous un travail très intéressant.
La baisse des prix au mois de janvier 2013 s'explique par deux phénomènes : d'une part, confrontés à une très forte sécheresse les privant d'herbe, les Néozélandais ont vendu beaucoup d'agneaux - c'est un système très libéral - et d'autre part, comme à leur habitude, les consommateurs anglais en ont profité pour acheter l'agneau néozélandais à bas prix et exporter les leurs, notamment vers la France. L'été et l'automne très humides en Angleterre ne leur ayant pas permis de le faire entre septembre et décembre 2012, ces importations ont été reportées aux mois de janvier et février 2013. J'ai reçu le président du Beef and lamb néo-zélandais - à la fois syndicat et interprofession - il y a huit jours dans mon département. Alors que des actions étaient menées dans les grandes et moyennes surfaces (GMS), je lui ai expliqué que c'était ce que m'inspirait leur comportement car au final, les éleveurs néo-zélandais et anglais sont très malheureux et nous ne sommes non plus au mieux. Nous discutons avec les anglais à Bruxelles dans le cadre du COPA-COGECA. Nous leur demandons davantage de transparence dans la mesure où 55 % des agneaux que nous consommons sont importés. La question de la transparence a été réglé pour la production française. Elle doit l'être désormais au niveau européen. Les néo-zélandais sont moins concernés dans la meure où ils exportent pour Pâques et que cette année, en 48 heures les opérateurs n'avaient déjà plus d'agneaux français.
Les importations en cause dans l'affaire Spanghero venaient du même pays que ceux de la crise de l'ESB en 2000... Nous sommes - par la volonté des professionnels - le seul pays au monde où les agneaux sont identifiés par une boucle électronique alors que seul le cheptel reproducteur l'est en Angleterre. L'accord interprofessionnel prévoyant l'étiquetage « viande ovine française » (VOF) a été signé il y a 10 ans mais non mis en oeuvre. Dès la semaine prochaine, nous demanderons aux grandes et moyennes surfaces (GMS) d'accepter d'apposer ce logo qui désigne l'une des productions les plus saines au monde. Le ministre et son cabinet nous appuient. La crise actuelle peut en effet représenter un opportunité pour l'agneau français. Nous n'avons pas de difficultés pour le vendre mais l'on peut encore espérer une augmentation des prix d'un produit qui le mérite. A la différence du porc, consommé au quotidien, l'agneau ne représente que quatre actes d'achat par an, allant souvent de pair avec celui du foie gras ou d'une bonne bouteille de bon vin. C'est un produit que l'on achète au moment des fêtes et le vendredi ou le samedi pour les réunions de famille. Si nous avons réuni tous les ingrédients pour apporter les réponses qu'attendent les consommateurs, nous souffrons - comme les autres productions animales - de l'augmentation de 30 % du prix des matières premières.
L'élevage évolue. On voit aujourd'hui fleurir des ateliers ovins autour d'exploitations céréalières. Peut-être est-ce le signe d'une agriculture dans laquelle l'agronomie reprendrait le dessus. Dans le Bassin parisien, il y a très longtemps, la première fonction des brebis était de fournir du fumier avant le lait, la laine ou la viande. Bertrand Patenôtre, un ingénieur disposant d'une exploitation céréalière de 180 hectares près de Troyes, a constaté il y a quelques années que sa consommation d'intrants montait en flèche tandis que ses rendements baissaient. Il a choisi de se doter d'un cheptel de 700 brebis pour assurer la fertilisation naturelle du sol. Il raisonne sur son exploitation prise globalement et il n'est pas le seul.
Ces évolutions s'expliquent peut-être aussi par le fait que l'élevage ovin est moins lourd que celui des bovins. Dans le cadre de la PAC, les systèmes trop dépendants de l'extérieur devront sans doute être repensés. Nous travaillons beaucoup avec l'institut de l'élevage sur ces sujets, même si l'éclairage vient aujourd'hui davantage des éleveurs que de nos chercheurs.

Pourquoi avez-vous fixé la productivité à 0,7 agneau par brebis pour verser la prime à la brebis ?
Où en êtes-vous par rapport aux sigles de qualités, aux indications géographiques protégées, aux labels ou aux appellations d'origine contrôlée ? Même si l'on n'a pas abordé la question de la transformation, il arrive que les brebis fassent du fromage...
Quand le label VOF sera-t-il enfin utilisé ?
La laine représente-t-elle un complément de revenu important pour les éleveurs ?
20 % des agneaux bénéficient d'un signe officiel de qualité. Nous n'avons pas réussi à faire davantage. Est-ce une question de prix, de contraintes liées aux contrôles ? Quoiqu'il en soit, depuis les années 1980, les agneaux labellisés ont fait figure de locomotive pour l'ensemble de la production et nous espérons effectivement qu'ils seront plus nombreux. VOF devrait constituer un socle complété par des dénominations régionales : agneau du Limousin, Baronnet, agneau du Quercy etc. Lorsque 105 tonnes arrivent du Grande-Bretagne dont 58 tonnes pour faire des merguez achetées par Spanghero pour un prix au kilo inférieur de 2 euros à nos productions, les éleveurs français sont exaspérés.
La laine est exportée brute vers la Chine ou la Turquie, c'est donc dans ces pays que la valeur ajoutée se réalise. Mes brebis ont deux kilos de laine vendus chacun 50 à 60 centimes d'euros, ce qui ne paye même pas la tonte. Des débouchés apparaissent en revanche pour la laine de mouton comme matériau d'isolation naturelle.

Avez-vous engagé une démarche avec d'autres filières pour identifier, d'une façon générale, la viande française de qualité ?
Dans la filière bovine, l'indication viande bovine française (VBF) revêt un caractère obligatoire, imposé par la réglementation européenne dans la période de crise de l'ESB. Pour le porc et l'agneau en revanche, il s'agit de démarches volontaires. La semaine prochaine, nous discuterons de sa généralisation avec les opérateurs de la distribution car aujourd'hui le consommateur, perdu, ne regarde que les prix. Il est grand temps de remettre de l'ordre, dans l'intérêt même de nos concitoyens

Depuis, l'excellent rapport de 2008 de nos collègues Gérard Bailly et François Fortassin, vous avez travaillé sur VOF et sur les filières qualité de même que la traçabilité s'est amélioré grâce aux boucles électroniques. Ne serait-il pas très utile au consommateur de voir indiqués clairement l'origine des animaux et la date d'abattage ? Les propos qui nous ont été livré sur la soi disant viande fraîche de Nouvelle-Zélande abattue en réalité trois mois auparavant sont difficiles à entendre. Faut-il aller jusque là, sachant que les industriels n'aiment pas indiquer l'origine des éléments des plats préparés ? Quel est le pourcentage d'agneaux abattus en France sans étourdissement préalable, c'est-à-dire par des méthodes rituelles ? Est-il vrai que la viande halal vient de Nouvelle-Zélande alors que l'abattage sans étourdissement y est interdit ?
Actuellement les étiquettes sont illisibles ; donner des informations au consommateur est bien entendu un moyen de restaurer la confiance. Mais pour établir la traçabilité encore faut-il qu'elle existe depuis le départ. Or, l'Europe n'impose pas de connaître le pays dans lequel le mouton est né, a été élevé et a été abattu. Les entreprises françaises importent pourtant de la viande où ces informations ne sont pas affichées... Face au lobby des entreprises anglo-saxonnes, la France va devoir agir à Bruxelles. On ne peut avoir demandé tous ces efforts de traçabilité au budget de l'Etat et aux éleveurs sans qu'ils ne soient reconnus. Il y a là une cause de distorsion de concurrence. Un exemple : alors que depuis la crise de l'ESB, les cervelles d'agneau de plus de six mois sont interdites dans notre pays et que nous jetons donc les têtes à la poubelle, des camions viennent tous les jours de Barcelone ou d'Angleterre - pays où ces produits sont autorisés - pour livrer des cervelles.
Le législateur doit mettre un peu d'ordre dans la réglementation qui concerne tout de même la santé de nos concitoyens. Vous comprendrez donc que nous soyons remontés. Comme nous l'avons dit au congrès de la FNSEA, nous voulons être payés en retour de nos efforts.

Comment savoir alors si une cervelle achetée a plus ou moins de six mois ?
Il est impossible de le savoir.
Bien entendu. Nous sommes confrontés à une succession de petits problèmes de ce genre qui pèsent sur notre rentabilité.
Et dans nos campagnes, les gens n'arrivent plus toujours à comprendre l'Europe et le raisonnement d'un certain nombre de fonctionnaires.
Concernant l'abattage rituel, la consommation musulmane devient importante au-delà du pic très ponctuel des fêtes religieuses. S'ajoute la demande nouvelle d'exportation vers l'Afrique du Nord depuis le printemps arabe. Bien que je ne dispose pas ici de chiffres, je puis vous dire que les opérateurs s'efforcent de répondre aux attentes des clients juifs ou musulmans. Selon une étude du cabinet suisse Gira, dans les dix ans qui viennent, la hausse de la consommation mondiale sera la plus forte pour les volailles puis pour les ovins, les bovins et enfin seulement le porc en quatrième, ces deux dernières productions subissant l'incidence de la consommation musulmane. Nous recevons beaucoup de demandes d'ingénierie du Maroc et d'Algérie, pays où plusieurs centres d'insémination ont été installés par des Français. De plus, nous exportons des animaux vivants par avion à partir de Châteauroux. Il existe un réel potentiel.

Sur le segment du rituel êtes-vous aussi en concurrence avec la Nouvelle Zélande ?
Oui. Ce sont de très grands professionnels et leurs 34 millions de brebis font la force de ce pays. Ils sont capables de répondre à la demander internationale d'agneaux abattus rituellement.
Bien qu'ils n'abattent pas sans étourdissement, ils ont passés des accords permettant que leur viande soit reconnue comme rituelle.
Ils exportent déjà dans des pays musulmans près de chez eux. Je suis administrateur de l'un des plus grands abattoirs de France où nous avons travaillé pour répondre aux attentes de cette clientèle très intéressante. En revanche, nous n'avançons pas beaucoup sur la question des abattages clandestins pendant les fêtes religieuses. Des abattoirs ponctuels pourraient être mis en place. A cette période, les abattoirs traditionnels sont saturés. Pendant deux jours, nous travaillons en permanence pour abattre 10 à 12 000 agneaux contre 250 000 sur l'ensemble de l'année.

L'abattage clandestin a évolué. Il s'agit désormais d'abattoirs clandestins qui s'organisent pour tuer jusqu'à 100 à 200 moutons.
Lors d'une réunion près d'Avignon il y a deux ans, j'ai rencontré des maires furieux de retrouver des abats dans leurs bois. Davantage de réglementation ne serait pas une mauvaise chose.

Notre rapport était bien volontairement intitulé Revenons à nos moutons car la diminution des effectifs est assez dramatique. Si des choses sont allées dans le bon sens depuis 2008, nous avons encore perdu entre 200 et 250 000 têtes en 2012. Dans les massifs, ces sont des milliers et des milliers d'hectares qui sont désormais sans animaux. Avec 3 milliards de personnes de plus à nourrir dans les 40 ans qui viennent, nous ne pouvons pas laisser ces espaces en l'état.
La politique européenne devrait prendre davantage en compte l'entretien de l'espace, en primant de façon spécifique les « moutons tondeurs ». Arrivant de la Vienne, vous n'avez pas évoqué les loups mais ils finiront par arriver chez vous.
Je ne crois qu'à moitié aux ateliers ovins sur les exploitations céréalières car le mouton est un herbivore et que j'ai du mal à concevoir un élevage ovin hors sol. Quel est selon vous la taille du troupeau permettant de faire vivre une famille, sachant qu'une productivité de 0,7 me semble faible ?
Qu'en est-il des brebis de réforme ? Il ne faudrait pas que l'on triche en les appelant autrement. C'est là aussi une question de transparence.
Au moment où nous réformons la PAC, les aides actuelles vous donnent-elle satisfaction ? En tant que parlementaires, devrions-nous travailler à les modifier ou à les améliorer pour que notre élevage ovin progresse ?
Je vois que vous connaissez parfaitement le dossier ovin ! Dans vingt départements, le loup est un réel problème et la situation devient insupportable. La FNO a pu rencontrer les parlementaires des deux assemblées sur ce sujet, et leur expliquer que l'on devra un jour faire face à un drame si rien n'est fait. Nous ne demandons pas la disparition du loup, mais une régulation à la hauteur de l'enjeu et une vraie baisse de la prédation. Nous avons été reçus par les ministres de l'écologie et de l'agriculture, Mme Batho et M. Le Foll, qui nous ont semblé animés par la volonté d'agir sur cette question.

Le plan Loup ne devrait permettre de tuer que très peu de prédateurs. Si tout va bien, c'est au maximum la moitié de la progression des effectifs qui pourra être neutralisée, autant dire une quantité négligeable. J'ai posé il y a quelques semaines une question orale au ministre de l'agriculture à propos des mesures prises pour lutter contre les attaques du loup. La réponse qui m'a été faite est très insatisfaisante. Nos ministres ne sont cependant pas plus à blâmer sur cette question que ceux qui les ont précédés.
Le coût du plan Loup s'élève à 10 millions d'euros. Nous avons dit aux ministres qu'avec cet argent, on pourrait payer des instituteurs et des infirmiers à l'heure des difficultés budgétaires ! Il nous a été répondu que des avancées énormes avaient été accomplies. Pour ma part, je ne vois pas quels progrès ont été faits depuis l'arrivée du loup, avec la convention de Berne et les plans mis en oeuvre en France. Je ne pense pourtant pas que nos demandes soient disproportionnées, alors que des agriculteurs sont contraints de quitter les montagnes et que des emplois disparaissent à cause des prédateurs. Les éleveurs ont aujourd'hui un sentiment d'écoeurement. Certains d'entre eux ont déjà perdu cinq fois leur troupeau. Ces dommages ont bien sûr été payés par le contribuable : nous sommes donc un pays riche pour pouvoir nous permettre de telles dépenses !
Le ton va nécessairement monter sur ce sujet. Nous constatons une réelle incompréhension dans les régions concernées, où les professionnels nous pensent incapables d'agir et pensent à régler le problème eux-mêmes. Nous avons été poussés à entrer dans le plan Loup, dont nous ne voulions pas au départ. L'idée était de mettre en place un dispositif comparable à celui qui existe dans les Pyrénées, où la gestion de l'ours ne relève pas des professionnels eux-mêmes, mais d'une entité spécifique. Les choses seraient sans doute différentes si le loup était présent dans les Pyrénées ...
Sur la question de la place de l'élevage chez les céréaliers, l'évolution que je vous ai décrite n'est en effet pas généralisée. On voit cependant apparaître une vraie nouveauté : dans un certain nombre d'exploitations, les bêtes pâturent et ne restent pas en bergerie. Cette évolution peut être associée aux pratiques de l'assolement et des cultures intermédiaires pièges à nitrates (Cipans), et certaines recherches sont menées en ce sens. Cette évolution que nous voyons poindre ressemble à ce que faisaient autrefois nos grands-parents, avec bien sûr de nécessaires adaptations puisqu'un éleveur doit pouvoir vivre de ses produits. La crise nous fera peut-être évoluer vers ce type de pratiques.
S'agissant de la taille des exploitations dans la filière viande, un éleveur qui dispose de 500 à 600 brebis, soit 700 à 800 agneaux si sa gestion est bonne, a une activité rentable. Certains éleveurs ovins gagnent d'ailleurs très bien leur vie.

Pouvez-vous nous donner votre appréciation sur la question de la viande de brebis ?
Il est probablement possible d'apporter une meilleure valorisation à la viande de brebis. La question se pose de savoir si la « viande ovine française » recouvre à la fois l'agneau et la brebis.
La partie couplée de la PAC nous est indispensable, et nous demanderons même un supplément en espérant obtenir 15 % de plus que les 125 millions dont nous bénéficions à l'heure actuelle. Une augmentation de 3 à 4 euros par brebis pourrait nous permettre d'accélérer le travail sur la traçabilité et de promouvoir les signes officiels de qualité comme VOF. La PAC est un outil d'orientation exceptionnel ; de nombreuses avancées, par exemple sur la contractualisation et sur la productivité, ont pu être réalisées grâce à cet instrument.
La convergence nous convient, puisque nous avons les droits à paiement uniquement (DPU) les plus faibles. Le verdissement ne nous pose pas non plus de problèmes.
La gestion de l'herbe constitue en revanche un échec depuis vingt ans. Pour obtenir les primes herbagères agroenvironnementales (PHAE), des contrats de cinq ans peuvent être passés par lesquels l'engagement est pris, par exemple, de ne labourer que 20 % des terres. Cela signifie qu'en cas de problème, par exemple en cas de sécheresse, il est impossible d'utiliser certaines parcelles : c'est à mon avis complètement stupide. La gestion de l'herbe doit être économique. A force de restrictions, les parcelles d'herbe finissent par être utilisées pour la production de céréales, ce qui est contre-productif.

J'ai apprécié que vous abordiez la question de l'agronomie. A mon sens, l'évolution que vous nous avez décrite est très positive et doit se poursuivre. On voit ainsi se concrétiser les principes de l'agroécologie. Il est nécessaire de repenser les pratiques de l'agriculture et de l'élevage, de favoriser la polyculture et d'éviter les grandes spécialisations.
J'ai compris dans vos propos que cette évolution venait davantage des éleveurs que des chercheurs. Pouvez-vous nous apporter des précisions sur ce point ? Comment faire pour que les chercheurs soient à la hauteur des avancées initiées par les éleveurs ?
Dans une situation de crise, le rôle du chercheur est d'identifier des voies d'évolution, en agriculture comme dans d'autres domaines. Des révolutions sont aujourd'hui nécessaires, et notamment une révolution fourragère, une révolution génomique, et une révolution des outils de gestion des ateliers d'élevage.
La révolution apportée par la luzerne pourrait être du même ordre que celle permise par le maïs il y a trente ou quarante ans. La luzerne est un élément exceptionnel qui me permet d'assurer l'indépendance et la performance de mon exploitation de 900 brebis. C'est une source de protéines végétales que nous pouvons produire nous-mêmes au lieu d'acheter du soja américain. Au début du siècle, on avait 1,2 millions d'hectares de luzerne ; aujourd'hui, on n'en compte plus que 200 ou 300 0000. Des petits systèmes d'irrigations peuvent être mis en place pour assurer la culture de la luzerne ; c'est dans cette direction par exemple que la recherche doit travailler.
Une évolution génétique de nos troupeaux est aujourd'hui nécessaire. Les éleveurs néo-zélandais, qui possèdent de 3 000 à 6 000 brebis pour 1,3 agneau par brebis, n'assistent pas leurs bêtes au moment de l'agnelage : ils ont fait évoluer leurs troupeaux afin d'adapter le bassin des brebis. En France, nous sommes présents tout au long de l'agnelage, le jour comme la nuit, pour assister nos bêtes. C'est une façon de travailler qui devient invendable auprès des jeunes ! Il n'est pas question de travailler comme les éleveurs néo-zélandais, mais devons faire évoluer nos troupeaux par la génomique en mettant l'accent sur les qualités maternelles, et non plus seulement sur la conformation des agneaux pour l'abattoir.
Nous travaillons depuis quelques temps sur la question des coûts de production. Il est regrettable qu'un éleveur ne puisse pas savoir ce que son atelier de production lui rapporte - en dehors des aides qu'il reçoit, qui banalisent tous les résultats. Nous sommes en train de nous doter d'outils qui permettront aux éleveurs de poser un diagnostic sur la situation de leur exploitation et d'en améliorer la performance.
Il est enfin un dernier dossier que j'aimerais évoquer devant vous, celui de l'installation. Nous sommes la première production à avoir travaillé sur cette question. Les prix du foncier sont de plus en plus élevés depuis quelques années, le phénomène étant renforcé par les arrivées d'investisseurs étrangers : quand une exploitation est cédée, elle l'est bien sûr au plus offrant. Nous devons décider si nous voulons une France qui ressemble à un immense champ de blé si nous souhaitons conserver la diversité de nos paysages naturels. La transmission des exploitations dans un cadre familial se fait de plus en plus rare - 50 % des éleveurs travaillent aujourd'hui hors cadre familial - et le coût de l'investissement pour un jeune qui souhaite s'installer est devenu inabordable. Un jeune qui vient de s'installer à côté de chez moi a du débourser plus de 400 000 euros, simplement en matériel et en capital d'exploitation ; au moindre problème, il lui sera très difficile de s'en sortir. Il est donc nécessaire de donner des moyens à l'élevage ovin.
Pour répondre à ces enjeux, nous avons créé un fonds d'investissement, Labeliance, qui reprend un mécanisme issu de la pêche artisanale. Le dossier est actuellement examiné par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Il s'agit d'apporter des fonds propres à un jeune exploitant pour une dizaine d'années, en complément d'un emprunt. Cette solution n'est peut-être pas la panacée, mais il nous faut réfléchir à ces enjeux.
Le législateur a une réelle responsabilité sur cette question : des métiers sont menacés de disparition. Ce n'est pas avec les exploitations céréalières que la valeur ajoutée est principalement créée - et je vous dis cela sans animosité envers les producteurs céréaliers. En revanche, une exploitation ovine mobilise jusqu'à 7 emplois.

Nous vous remercions, M. Préveraud, pour cette intervention passionnée.