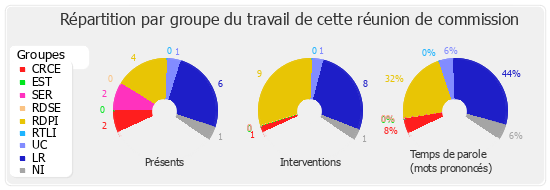Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation
Réunion du 9 octobre 2012 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion
La commission procède tout d'abord à l'audition conjointe de M. Georges Chodron de Courcel, directeur général délégué de BNP Paribas, Mme Jézabel Couppey-Soubeyran, conseiller scientifique du Conseil d'analyse économique, M. Martin Merlin, chef de l'unité « Politique des services financiers, relations avec le Conseil » à la direction générale du marché intérieur et des services de la Commission européenne, Mme Danièle Nouy, secrétaire générale de l'Autorité de contrôle prudentiel, MM. Thierry Philipponnat, secrétaire général de Finance Watch, et Hervé de Villeroché, chef du service du financement de l'économie à la direction générale du Trésor.

L'Union bancaire est une idée récente émise afin de briser le cercle vicieux entre risque souverain et risque bancaire. Il s'agit d'éviter que la défaillance d'un établissement bancaire n'entraîne la défaillance de son Etat - qui serait incapable de le recapitaliser seul - ou, à l'inverse, que les difficultés budgétaires d'un Etat ne jettent un doute sur la solidité de son secteur bancaire.
Fort du constat de ce lien préoccupant entre la santé du secteur bancaire et le crédit de l'Etat, le Conseil européen des 28-29 juin s'est saisi de cette question, à l'aide du rapport de Herman Van Rompuy sur l'avenir de l'Union économique et monétaire (UEM). Parmi les quatre piliers pour une UEM stable et prospère figurent un cadre financier intégré et un cadre budgétaire intégré. Le cadre financier intégré, c'est l'Union bancaire ; le cadre budgétaire intégré, ce sont les dispositions de gouvernance des finances publiques, notamment celles du TSCG.
Le rapport Van Rompuy précisait que l'Union bancaire reposait sur trois éléments : une supervision bancaire commune, un fonds de garantie des dépôts commun et un mécanisme européen de résolution des défaillances bancaires.
La mise en place de l'Union bancaire est très directement liée au Mécanisme européen de stabilité (MES) dont la mise en condition opérationnelle a été annoncée cette semaine. Lors du sommet des Etats membres de la zone euro, tenu le 29 juin 2012, la demande a été faite à la Commission européenne de présenter un mécanisme de surveillance unique. Elle précise que « lorsqu'un mécanisme de surveillance unique, auquel sera associée la Banque centrale européenne (BCE), aura été créé pour les banques de la zone euro, le MES pourrait, à la suite d'une décision ordinaire, avoir la possibilité de recapitaliser directement les banques ».
Nous voilà donc en présence d'un cadre original à l'initiative de la zone euro. Mais nous ne saurions oublier que l'Union bancaire, même si sa réalité principale prend place au sein de la zone euro, est un élément des institutions de l'Union européenne à 27 Etats. Nous voyons l'équilibre délicat qui va devoir s'instaurer et le caractère nécessairement un peu contradictoire de cette construction.
Pour mieux comprendre ces contradictions, j'ai le plaisir d'accueillir Danièle Nouy, secrétaire générale de l'Autorité de contrôle prudentiel, Jézabel Couppey-Soubeyran, conseiller scientifique du Conseil d'analyse économique, Martin Merlin, chef de l'unité « Politique des services financiers, relations avec le Conseil » à la direction générale du marché intérieur et des services de la Commission européenne, Thierry Philipponnat, secrétaire général de Finance Watch, Georges Chodron de Courcel, directeur général délégué de BNP Paribas et Hervé de Villeroché, chef du service du financement de l'économie à la direction générale du Trésor.
Je vais d'abord laisser la parole à la Commission, puisque l'Union bancaire est d'initiative européenne. J'ai cru comprendre, pour avoir rencontré récemment Michel Barnier, que l'Union bancaire a des conséquences très structurelles. Elle contribue à poser des problèmes au sein de la zone euro et de toute l'Union européenne. Elle conduit à une clarification des responsabilités. Vous nous direz si la BCE doit en être le pivot alors que l'Autorité bancaire européenne (ABE) a vocation à s'occuper de l'ensemble des institutions financières des Vingt-Sept Etats membres. Aidez-nous à y voir clair !
Je voudrais me concentrer sur le mécanisme de surveillance unique (MSU) actuellement en négociation au Conseil et au Parlement. Nous considérons que cette proposition constitue une contribution importante à la résolution de la crise de la zone euro. Nous estimons que la supervision nationale a montré ses limites et nous avons besoin d'une supervision supranationale pour rétablir la confiance dans la solidité du système bancaire de la zone euro. Nous devons la rétablir entre les banques, entre les banques et les investisseurs ou encore entre autorités nationales et entre Etats membres.
Depuis quelques années, on observe une défiance forte à l'égard des superviseurs nationaux et une tendance à la désintégration du marché financier européen. Pour contrer ce repli national, il nous paraît indispensable d'adapter la gouvernance du contrôle du système bancaire aux objectifs qui sont les nôtres, à savoir la consolidation de la zone euro.
Nous pensons que l'établissement d'un superviseur unique, au moins au sein de la zone euro, est nécessaire pour préparer les prochaines étapes de l'Union bancaire. Elle commence avec la supervision unique - c'est ainsi que l'a présenté le sommet de la zone euro du 29 juin - mais, évidemment, il faudra aller au-delà. Avec le MSU, nous espérons rétablir la confiance entre autorités nationales. Une fois cette étape achevée, il sera possible de finaliser l'Union bancaire avec, d'une part, la recapitalisation directe des banques par le MES, et, d'autre part, avec la mise en place d'arrangements communs dans le domaine de la résolution bancaire. Ce faisant, nous espérons contribuer à l'achèvement de l'UEM. Un autre pendant de cet effort consiste à aller vers davantage d'intégration dans le domaine budgétaire.
Je voudrais expliciter quelques éléments dans la proposition de la Commission. Tout d'abord, nous ne proposons pas de faire basculer la supervision des banques du niveau national vers le niveau européen. Nous entendons créer un système intégré dans lequel la BCE et les autorités nationales coopèreront afin d'assurer une meilleure supervision au sein de la zone euro. Ce n'est pas un basculement de souveraineté : il s'agit de permettre aux superviseurs nationaux, représentés au niveau de la BCE, d'exprimer leur souveraineté de façon différente, à la fois plus européenne et plus collégiale. Les modalités de cette articulation entre les tâches relevant de la BCE et du niveau national doivent encore être précisées. Cette notion de système intégré, dans lequel le centre et la périphérie coopèrent étroitement afin de bien superviser le système bancaire, nous semble tout à fait clef.
Dans ce cadre, il nous paraît également essentiel que la BCE ait la compétence exclusive pour superviser toutes les banques de la zone euro. Nous entendons éviter un système dual dans lequel la BCE aurait une compétence exclusive pour seulement quelques très grandes banques. Un tel système serait, selon nous, un facteur d'instabilité et, au surplus, il est très difficile de définir ex ante ce qui est systémique de ce qui ne l'est pas.
Nous avons décidé de confier la responsabilité de la supervision à la BCE. Il y avait d'autres possibilités telle que l'ABE, établie à Londres, qui a fait un excellent travail depuis le début de l'année 2011. Nous aurions pu envisager la création d'un nouvel organisme ad hoc. Nous avons retenu la BCE, car tel semblait le souhait des chefs d'Etats et de gouvernements, mais aussi car nous entendons nous reposer sur sa force, sa crédibilité et son expertise. C'est le modèle le plus efficace permettant de mettre rapidement sur pied le MSU dont nous avons besoin.
Nous reconnaissons toutefois que, en confiant cette responsabilité à la BCE, nous nous sommes donné un certain nombre de contraintes. En effet, le traité établit le fonctionnement de la BCE, et, en particulier, elle ne peut prendre des décisions juridiquement contraignantes qu'à l'intérieur de la zone euro et l'organe de décision principal de la BCE est le Conseil des gouverneurs. Il devra donc être à la fois responsable de la conduite de la supervision et de la politique monétaire.
La proposition essaye de trouver des solutions à ces deux contraintes. S'agissant du champ d'application géographique, nous souhaitons le champ le plus large possible. L'Union bancaire est indispensable pour la zone euro mais elle est aussi très nécessaire pour le Marché intérieur dans son ensemble. Les pays hors zone euro pourront s'intégrer au MSU. Toutefois, compte tenu du traité, il ne sera pas possible qu'ils disposent d'un droit de vote au Conseil des gouverneurs. Nous continuons de travailler à ce sujet.
Nous connaissons les conflits d'intérêts pouvant exister entre supervision et politique monétaire. Nous proposons donc la création d'un conseil de supervision qui devra assumer l'essentiel des tâches attribuées à la BCE dans le domaine de la supervision afin de dégager le plus possible le Conseil des gouverneurs de cette responsabilité. Pour autant, la responsabilité ultime des décisions devront être prises par le Conseil des gouverneurs tant qu'aucune modification du traité ne sera intervenue.
Dans les négociations en cours, la première priorité de la Commission est de tenir le calendrier fixé par les chefs d'Etats et de gouvernements en juin, à savoir l'adoption de cette proposition d'ici la fin de l'année. Nous pensons que c'est possible. Les sujets ne sont pas très compliqués, nous avons besoin de volonté politique, qui a déjà été démontrée par le sommet de la zone euro. Nous devons poursuivre sur cette route.
Il est vital que le système commence à opérer dès janvier 2013. Ce serait un très mauvais signal si nous étions encore, en mars 2013, en train de négocier ce texte, repoussant à une date plus tardive son entrée en vigueur. Il faut tenir le calendrier afin de démontrer que les autorités politiques sont déterminées à sortir la zone euro de sa crise.
Nous sommes conscients que la BCE s'organise avec les autorités nationales. Elle ne doit pas et ne peut pas tout faire à partir de Francfort. Il est possible que des banques de taille petite ou moyenne soient laissées à la responsabilité première des autorités nationales. Pour nous, il est toutefois très important que la responsabilité ultime reste dans les mains de la BCE.
Enfin, notre troisième priorité est la préservation du marché intérieur. Il est difficile d'organiser une supervision intégrée sous l'égide de la BCE pour les 27 Etats de l'Union européenne et nous le regrettons. Certains pays, de toutes façons, ne souhaitent pas y participer. En tout état de cause, il est primordial que cette supervision intégrée ne crée pas un fossé, au sein du marché intérieur, entre pays dans et hors de la zone euro. C'est pourquoi, il est très important de maintenir l'ABE, qui devra peut-être être renforcée. Elle doit absolument aboutir sur l'établissement d'un corps de règles unique qui s'appliqueront à tous les pays et à toutes les banques de l'Union européenne. Il est donc vital de conclure rapidement les négociations en cours que ce soit en matière prudentielle, de résolution ou de protection des déposants.

Nous le voyons, cette affaire est d'une simplicité quasiment biblique. Je passe la parole à Danièle Nouy, à qui je demanderai tout d'abord, de façon provocante, si la création d'un superviseur intégré annonce une réduction des moyens et des effectifs de l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP). Quelle sera l'articulation entre les services de l'ACP et ceux de la BCE ? Par ailleurs, quelle procédure sera mise en place pour les groupes transfrontaliers, ayant des activités dans et hors de la zone euro ?
Le projet d'Union bancaire a trois composantes : une surveillance bancaire unique, mais aussi un mécanisme commun de résolution des défaillances bancaires et une garantie commune des dépôts. Le système de supervision unique tel que proposé par la Commission européenne sera organisé, à l'image de l'Eurosystème, avec une décentralisation de la mise en oeuvre et une centralisation de la prise de décision. Certains principes de l'Union bancaire sont déjà connus : différenciation entre les Etats membres appartenant à la zone euro et ceux qui n'en font partie, système européen unique de surveillance, composé d'un échelon national et d'un échelon européen, et participation directe de l'échelon européen, qui sera variable en fonction de la situation et de la nature des banques concernées.
En termes de calendrier, l'objectif est de parvenir à un accord d'ici à la fin de l'année 2012 pour permettre rapidement aux fonds d'urgence de la zone euro de recapitaliser directement des établissements en difficulté. La BCE a mis en place pendant l'été un groupe de travail de haut niveau, auquel je participe avec la sous-gouverneure de la Banque de France. On constate, au sein de ce groupe, une bonne convergence des vues sur plusieurs principes. Tout d'abord, la BCE devra être dotée de l'entière responsabilité de la supervision bancaire pour la zone euro. Ensuite, le périmètre de la supervision européenne devra recouvrir l'ensemble des banques de la zone euro. Par ailleurs, la mise en oeuvre opérationnelle des activités de supervision devra se faire, autant que possible, de manière décentralisée par les superviseurs nationaux. En outre, le degré de centralisation ou de décentralisation de la mise en oeuvre de la supervision pourra être défini sur la base du caractère systémique de la banque concernée, de la nature des tâches de supervision ou, plus probablement, des deux. Enfin, les établissements seraient différenciés selon leur pertinence systémique.
S'agissant de la participation à l'Union bancaire, la Commission propose une supervision bancaire ouverte aux dix Etats membres n'appartenant pas à la zone euro, dans le cadre d'une coopération dite « étroite ». Il est vrai qu'une supervision unifiée, dans l'idéal, serait pertinente à l'échelle des Vingt-Sept, mais cela pose des problèmes d'ordre opérationnel et juridique.
S'agissant du périmètre de la supervision, l'ACP est favorable à la proposition de la Commission de couvrir l'ensemble des 6 000 banques de la zone euro. Je rappelle notamment que beaucoup de problèmes sont venus, ces dernières années, de banques non systémiques, comme Northern Rock ou Bankia.
S'agissant des responsabilités, la proposition de la Commission donne une compétence très large à la BCE, qui exercera l'essentiel des pouvoirs de supervision aujourd'hui aux mains des superviseurs nationaux. Comme nous le souhaitons, la BCE décidera et définira les modalités de la conduite opérationnelle de la supervision ; c'est donc elle qui organisera la décentralisation du mécanisme, avec un impact fort, en termes organisationnels, pour les superviseurs nationaux.
Certains pays, comme l'Allemagne, pensent qu'il faudrait privilégier, au moins à titre transitoire, un régime dual distinguant les banques les plus importantes soumises à la supervision de la BCE, et les autres, soumises à une supervision nationale. Nous pensons, quant à nous, qu'il convient plutôt de s'orienter, dans un premier temps, vers une instruction conjointe, par les superviseurs nationaux et par la BCE, des dossiers les plus importants, mais la décision finale devrait rester, en tout état de cause, dans les mains de la BCE.
Pour répondre à votre question sur les effectifs et les moyens de l'ACP, il est possible que ce mécanisme conduise, à terme, à une réduction. Dans un premier temps cependant, l'expertise et les équipes de l'ACP seraient encore nécessaires pour préparer le travail du gouverneur de la Banque de France qui siègera à la BCE, ainsi que pour l'instruction des dossiers.
L'objectif est de mettre en place ce système en début d'année prochaine. Selon nous, la première décision à prendre est de définir le degré de décentralisation ou de centralisation du mécanisme.
Les deux autres composantes de l'Union bancaire, la résolution et la garantie des dépôts, sont essentielles mais leur mise en place ne doit pas nécessairement être simultanée avec celle de la supervision unique. La supervision unique est la pierre fondamentale. C'est le superviseur unique qui prononcera la décision de non viabilité d'un établissement, conduisant à la transmission d'un dossier à une autorité de résolution, quel que soit son niveau. De même, c'est le superviseur unique qui activera la procédure de garantie des dépôts.
Par ailleurs, je tiens à souligner que le renforcement du contrôle démocratique fait partie du projet d'Union bancaire. La BCE et l'ABE rendront compte au Parlement européen et l'ACP restera, comme aujourd'hui, responsable devant le Parlement français. Je crois savoir que des possibilités d'auditions des superviseurs européens par les Parlements nationaux sont actuellement en discussion.
S'agissant des groupes transfrontaliers, la BCE sera le superviseur consolidé des groupes dont le siège est établi dans la zone euro et négociera à ce titre avec les autorités des pays d'accueil. Inversement, elle participera au collège des superviseurs lorsque le superviseur consolidé sera l'autorité d'un État membre hors de la zone euro.

J'ai pu constater, à Londres, que le Royaume-Uni ne manifeste pas le même enthousiasme sur l'Union bancaire. Il serait utile que vous confrontiez vos analyses...
Je m'adresse à présent à Georges Chodron de Courcelles en lui demandant de nous dire, au nom d'une banque française et européenne, quelle est son approche. Qu'attendez-vous de cette supervision européenne plus intégrée ? Qu'est-ce que vous redoutez, le cas échéant ?
La réforme de l'Union bancaire est très structurante pour l'avenir et doit être prise au sérieux. Elle fait partie intégrante de la convergence budgétaire et bancaire. Un de nos problèmes, c'est la crise de confiance tant envers les banques que les Etats. Il n'y a pas d'Union bancaire sans convergence budgétaire.
Cette Union bancaire doit être globale. Il est très important que la place de Londres soit régulée de la même manière que les autres places européennes, de sorte qu'il n'y ait pas d'arbitrage. La mise en place d'un superviseur unique est une excellente chose si nous voulons restaurer la confiance. Certains ont pu penser qu'il y a eu des conflits d'intérêts entre certains régulateurs locaux et les autorités politiques...

C'est assez vraisemblable ! Quand, lors des exercices de tests de résistance, l'Irlande ne visait pas les établissements dont le Gouvernement savait qu'ils seraient en difficulté, nous étions dans une situation de conflits d'intérêts avérée.
J'observe simplement que la BCE n'aura pas ce type de conflits d'intérêts. Danièle Nouy se rappellera que, dans certaines réunions, la situation des banques espagnoles avait été soulevée, mais on nous disait que le banquier central espagnol était très confiant... donc circulez !
Bien évidemment, il y a un petit conflit d'intérêt entre supervision et politique monétaire, mais il est beaucoup moins important que ceux constatés jusqu'à présent.
Ceci étant dit, le diable est dans les détails. Toutes les banques doivent être supervisées. Nous ne savons pas quelles sont les banques systémiques. Il faudra ensuite définir la transitivité avec les autorités nationales.
Il faut faire l'Union bancaire le plus vite possible. Le plus tôt sera le mieux afin d'aborder d'autres sujets tout aussi importants, à savoir, d'une part, les résolutions des banques en difficulté, et, d'autre part, la garantie des dépôts. Tant qu'on ne dispose pas d'une certaine sécurité, c'est-à-dire qu'un superviseur a bien vu que les banques sont en bon état, personne n'a envie de mutualiser les bons et les mauvais.
Je ne m'étends pas sur la résolution qui soulève de nombreux problèmes juridiques. S'agissant de la garantie des dépôts, quand on sera à peu près sûrs que les banques sont correctement supervisées, alors on pourra mettre en place un système européen de garantie des dépôts. Il se caractérise par deux étages de transitivité : la garantie des dépôts au niveau national et, ensuite, s'il y a un problème, le niveau européen prendra le relais.
Aujourd'hui, il y a une tentation que l'euro du Sud aille vers l'euro du Nord. Je suis assez bien placé pour le dire car nous sommes présents sur de nombreux marchés domestiques.

L'euro du Sud, dans votre esprit, a-t-il la même valeur que l'euro du Nord ?
Pour moi, il a la même valeur, mais nombre de gens hésitent. Par exemple, vous êtes déposants en Espagne. Vous êtes donc garantis par l'Etat espagnol : êtes-vous vraiment bien garantis ? La tentation est grande de venir en France ou en Belgique ou vous pensez que, peut-être, vos dépôts seront mieux garantis car la qualité du garant est meilleure. Il faut absolument éviter cela. Quand nous serons supervisés globalement par un seul organe, ce problème se posera beaucoup moins.
Aujourd'hui, la situation budgétaire des Etats, qui se réglera à moyen terme, se cumule avec la mauvaise condition des banques. Si nous n'arrivons pas à faire converger, assez vite, ces deux éléments, nous ferons face à de grandes difficultés. Nous sommes donc très pressés de façon à essayer d'inverser ce cercle vicieux.

Je me tourne vers Thierry Philipponnat, secrétaire général de Finance Watch. Dites-nous ce que fait votre organisme et les réflexions que vous inspirent les commentaires, politiquement très corrects, qui viennent d'être émis.
Finance Watch est une ONG, créée à l'appel de 200 élus européens, de tous horizons politiques. Ils ont fait valoir qu'ils avaient besoin d'un plaidoyer qui ne reflète pas seulement les intérêts particuliers des parties prenantes à l'industrie financière mais également une analyse plus axée sur l'intérêt général, afin, logique classique dans une démocratie, de se faire une opinion. Une fois que l'on a entendu les arguments des uns et des autres, on peut trancher en tant que législateur.
Finance Watch a aujourd'hui 71 membres : ONG, syndicats, instituts de recherche, associations de consommateurs, etc. Elle regroupe également des membres qualifiés, comme des universitaires, qui ont de « l'épaisseur » en matière de régulation économique et financière. Notre équipe est composée qu'une quinzaine de professionnels, qui viennent tous de l'univers de la finance, afin de faire des propositions qui dépassent un appel général à la réforme. Nous sommes dans le concret.
Nous avons fondamentalement trois activités : l'analyse des propositions de la Commission européenne, avec cet angle systématique de l'intérêt général ; le plaidoyer, c'est-à-dire faire connaître nos positions ; et le lobbying.
Le lobbying, s'il est fait de façon transparente, selon les normes et les procédures de l'Union européenne, me semble tout à fait légitime.
Par exemple, nous avons publié un rapport sur CRD IV mi-février. Nous avions six préconisations principales. Dans les quinze jours suivants, nous avons rencontré à peu près tous les groupes politiques au Parlement européen pour discuter de ces propositions. Cinq d'entre elles ont été transformé en amendements par des groupes d'horizon politique différent.

Vous activité est sous-tendue par l'intérêt général, l'intérêt académique ou bien soutenez-vous des intérêts économiques ?
Nous n'avons aucun intérêt économique particulier. Nous sommes financés par quatre fondations philanthropiques et une centaine de particuliers. Nous avons également reçu, après vote du Parlement européen et appel d'offres de la Commission européenne, une dotation budgétaire des institutions européennes.
Notre logique - et on peut débattre des contours de l'intérêt général - est de cerner, pour une réglementation particulière, quel est l'intérêt qui dépasse la somme des intérêts particuliers.

Si la Commission finance les lobbys qui viennent la rencontrer, c'est une façon d'objectiver les débats.
Je pense que la logique générale est celle d'un équilibre des débats.
Sur le sujet de l'Union bancaire, j'aimerais le mettre en perspective avec l'objectif recherché. Il est double. Tout d'abord, il s'agit de mettre fin au cercle vicieux entre risque souverain et risque bancaire. Ensuite, c'est de réduire la situation d'aléa moral des banques vis-à-vis de la société. L'aléa moral, c'est une asymétrie de positions où les gains et les pertes ne sont pas partagés pas le même bord.
L'impact de l'aléa moral est triple. Celui qui est le plus documenté, c'est l'impact sur le contribuable. Une question moins souvent discutée, mais très bien mise en exergue par le récent rapport Liikanen, c'est la distorsion de concurrence créée par l'aléa moral. En effet, les banques qui bénéficient d'un soutien explicite ou implicite de l'Etat profitent d'un avantage de financement. Il y a donc clairement une distorsion entre les plus grands et les plus petits établissements bancaires.
La façon la plus simple de le décrire, c'est : « pile je gagne, face, vous perdez ! ».
Par exemple, le Royaume-Uni a dû sauver ses banques à coup de dizaines de milliards de livres sterling. Les profits de ces banques allaient à des capitaux privés, mais les pertes ont été supportées par la société britannique. Les gains et les pertes n'étaient pas portés par la même entité. Il y a donc une incitation à prendre des risques que ce soit pour les banques ou pour leurs financeurs. Dans le monde réel, il faudrait bien évidemment nuancer ce propos. L'avantage de financement permet de faire payer au contribuable une rente dont il ne bénéficiera pas.
Dans le cadre de l'Union européenne, il y a deux textes législatifs sur la table : le MSU, d'une part, et la gestion de crise et la résolution bancaire, d'autre part. De notre point de vue, ils ne peuvent pas être séparés. Il est absolument impératif que les deux soient adoptés.
Avec le seul MSU, nous assisterions - si je peux me permettre une petite provocation - à un renforcement de l'aléa moral. En effet, nous aurons encore mieux garantis le système bancaire par la puissance publique. En revanche, le mécanisme de gestion de crise permet d'éviter ce travers. Il comporte notamment un dispositif extrêmement important qui consiste à faire supporter les pertes par les capitaux privés. C'est le système du « bail-in » : si vous apportez des capitaux, vous en supportez le risque. Si les deux textes sont mis en place parallèlement, alors nous aurons avancé.
Il faut également réfléchir à la structure du système bancaire : c'est le rapport Liikanen. Il y aura toujours un résidu d'aléa moral. La réforme de structure consiste à dire que ce résidu doit bénéficier à la partie des activités bancaires la plus utile à la société et aux citoyens.
Sur la question de la résolution bancaire, j'aimerais rappeler le système en vigueur aux Etats-Unis. L'autorité de résolution s'appelle le FDIC et a été mis en place par le fameux Glass-Steagall Act de 1933. L'Union bancaire, la gestion de crise et le rapport Liikanen sont des réflexions proches de celles du Glass-Steagall.
Le système de résolution bancaire aux Etats-Unis fonctionne remarquablement bien pour les petites et moyennes banques et moins bien pour les plus grosses. On peut émettre quelques doutes sur son efficacité pour les plus grandes banques. Là, on revient à une question de structure et de taille des banques par rapport à la faisabilité et à la réalité d'un mécanisme de gestion de crise.

Je passe la parole à Jézabel Couppey-Soubeyran, qui pourra nous apporter un éclairage macro-économique : cette proposition est-elle de nature à stimuler la croissance dans la zone euro ? Est-elle susceptible d'encourager le développement d'activités non régulées, comme le « shadow banking » ?
Il est nécessaire d'instaurer une Union bancaire, ou plus précisément un système européen de supervision. L'Europe s'est trop concentrée sur la stabilité monétaire et pas assez sur la stabilité financière. Or la crise a montré le danger d'une séparation entre la surveillance monétaire et la surveillance financière. Par exemple, au début des années 2000, la BCE, superviseur monétaire, a pu maintenir des taux d'intérêt très bas car elle avait les yeux rivés sur l'inflation, qui n'augmentait pas, sans prendre en considération les évolutions sur les marchés financiers. C'est pourquoi il est urgent d'abandonner la séparation entre les deux objectifs de stabilité monétaire d'une part et de stabilité financière d'autre part. Certes, des conflits peuvent exister, mais ils ne se manifestent qu'en période de crise, lorsque les banques centrales, de toute façon, sont contraintes d'intervenir comme prêteurs en dernier ressort.
Chaque objectif doit avoir son instrument. Il ne s'agit pas de remettre en cause le taux d'intérêt comme instrument de l'objectif de stabilité monétaire, mais l'objectif de stabilité financière doit avoir également son ou ses instruments propres. Au début des années 2000, il aurait fallu agir sur le front de la stabilité financière, mais un relèvement du taux d'intérêt aurait semblé incongru au vu du taux d'inflation et de la conjoncture économique.
Le problème se situe dans le niveau d'implication des banques centrales dans l'objectif de stabilité financière. La banque centrale n'est pas, par nature, un bon superviseur micro-prudentiel. Certes, il arrive qu'elle endosse ce rôle, notamment dans les pays en développement ou les pays du Sud de l'Europe, dont les moyens humains et budgétaires sont limités. Mais, lorsqu'elle exerce ce rôle de superviseur micro-prudentiel, la banque centrale a un champ, sauf exception, limité au seul secteur bancaire. Le dispositif reste donc sectoriel alors que les activités financières s'étendent au-delà du seul secteur bancaire.
Dès lors, la proposition de la Commission européenne consiste à confier à la banque centrale une mission qui, d'une part, n'est pas dans sa culture et que, d'autre part, elle ne peut exercer que de façon sectorielle, donc limitée. Elle le fait cependant, car la BCE est la seule institution européenne crédible en matière bancaire. On peut regretter, à cet égard, que l'on déconstruise ce que l'on avait commencé à mettre en place depuis 2010 à travers les autorités européennes, l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers. L'ABE n'a eu ni le temps ni les moyens de trouver sa place institutionnelle. Elle n'en a pas eu le temps, dans la mesure où elle aurait dû être instaurée dès la création de l'Eurosystème. Elle n'en a pas eu les moyens, dans la mesure où elle a fonctionné en 2011 avec un budget de seulement 20 millions d'euros, soit huit fois moins que le budget de l'ACP française, qui est, certes, multisectorielle.
Toutefois, je considère que la banque centrale doit s'impliquer dans la stabilité financière. D'une part, elle doit être proche du superviseur micro-prudentiel, avec qui elle doit entretenir des échanges d'information quotidiens. D'autre part et surtout, la banque centrale doit endosser le rôle de superviseur macro-prudentiel. A cet égard, on peut craindre qu'en confiant la supervision micro-prudentielle à la BCE, on ne retarde ou n'ajourne sa mission de surveillance macro-prudentielle qui aujourd'hui, malgré la création du Comité européen du risque systémique (CERS), est dépourvue de moyens et d'objectifs.

Pourriez-vous, pour la clarté du débat, préciser ce que vous entendez par surveillance macro-prudentielle et par surveillance micro-prudentielle ?
La supervision micro-prudentielle correspond à la surveillance sur base individuelle, établissement par établissement. La supervision macro-prudentielle, à l'inverse, s'intéresse au système bancaire et financier de façon globale, pour prévenir la survenance d'un risque systémique. Les instruments de cette surveillance macro-prudentielle sont encore en cours de définition, notamment dans le cadre de Bâle III, pour limiter les phénomènes d'emballement du crédit ou de bulles spéculatives.

La direction générale du Trésor peut-elle préciser quels sont les enjeux de ce texte et les positions en présence au niveau européen ? Pensez-vous que le pilier macro-prudentiel soit appelé à progresser aussi rapidement que le contrôle individuel des établissements ?
De façon générale, la France soutient fortement le projet d'Union bancaire. Cinq principaux enjeux peuvent être identifiés.
Le premier a trait au champ de la supervision : doit-elle concerner toutes les banques ou seulement certaines banques ? La France soutient la proposition de la Commission visant à y intégrer toutes les banques de la zone euro, à la fois pour préserver l'intégrité du marché et pour mieux encadrer le risque que peuvent faire porter les petits établissements. La majorité du Conseil est sur la même position, l'Allemagne étant moins enthousiaste, d'une part parce qu'elle souhaite, pour des raisons politiques, que certaines banques locales et régionales y échappent, d'autre part parce qu'elle considère qu'il convient d'avancer par étapes sur un projet aussi intégrateur.
Le deuxième enjeu est relatif à la répartition des compétences, au sein de la BCE, entre la politique monétaire et la supervision bancaire. La compétence doit-elle être exercée par le Conseil des gouverneurs ou par une instance spécialisée ? La France est favorable, sur ce point, à la proposition de la Commission européenne, qui prévoit la création d'une instance de gouvernance dédiée mais une responsabilité politique et juridique exercée par le Conseil des gouverneurs. L'Allemagne, quant à elle, souhaite une stricte séparation entre les deux instances.
Troisième enjeu : la supervision doit-elle se limiter aux Dix-Sept pays membres de la zone euro ? La France est d'accord pour que le mécanisme soit ouvert aux autres Etats membres qui souhaiteraient y participer. Le Royaume-Uni a fait savoir qu'il ne le souhaitait pas, mais d'autres regardent le dispositif avec intérêt. Dès lors, la gouvernance au sein de la BCE devra être adaptée, mais les Etats non membres de la zone euro ne pourront pas avoir voix délibérative au Conseil des gouverneurs.

Quelle est la procédure applicable pour l'adoption de cette proposition ?
Cette proposition comporte deux textes. Le premier, qui est un projet de règlement du Conseil, nécessite l'unanimité des Etats membres. Le second, qui est un projet de règlement du Parlement européen et du Conseil, est soumis à la procédure législative ordinaire de co-décision, avec majorité qualifiée au Conseil.
Quatrième enjeu : quelle sera la place de l'ABE dans ce système ? L'ABE doit rester la gardienne de l'uniformité des règles applicables au sein du marché intérieur à Vingt-sept. Mais l'arrivée de la BCE comme superviseur imposera d'en revoir la gouvernance, notamment pour respecter le point de vue du Royaume-Uni.
Enfin, le cinquième et dernier enjeu est l'articulation de cette proposition avec les deux autres piliers de l'Union bancaire, pour lesquels les questions restent, à l'heure actuelle, en suspens : quelle mutualisation de la ressource pour résoudre les crises bancaires ? Qui sera l'autorité de résolution ?

Jézabel Couppey-Soubeyran a récemment commis un ouvrage intitulé « L'économie est un jeu ». Et je crois que, dans la décennie écoulée, certaines banques ont effectivement considéré que le raisonnement était celui-ci. Nous savons où cela nous a conduit. La volonté de régulation est par conséquent une nécessité.
Nous avons beaucoup parlé de la supervision bancaire. Où en sont les deux autres piliers, à savoir la résolution et la garantie des dépôts ? On entend dire que les discussions sont au point mort. Or si ces trois piliers ne sont pas conjointement négociés et adoptés, on peut craindre que l'Union bancaire ne puisse pas trouver sa légitimation pleine et entière.
S'agissant plus spécifiquement du MSU, on peut se demander quel rôle jouerait les parlements nationaux car ce seront évidemment les Etats qui devront assumer les conséquences financières et politiques des décisions prises par la BCE.
En ce qui concerne le calendrier, si j'ai bien entendu la volonté de la Commission d'aboutir pour le 1er janvier 2013, on entend également des propos selon lesquels la supervision intégrée ne sera sans doute pas opérationnelle à cette date. Or sa constitution était considérée comme un élément essentiel pour que le MES puisse recapitaliser directement des banques en difficulté. Le MES pourra-t-il recapitaliser les banques si le projet d'Union bancaire n'est pas suffisamment avancé ?
Je voulais également me référer aux propos de Jean Pisani-Ferry qui affirme qu'une vraie Union bancaire impliquerait à la fois une supervision commune, une procédure de résolution et l'accès à une ressource budgétaire commune. Selon lui, les trois vont ensemble. Il conclut que si l'un de ces trois éléments était manquant ou mal conçu, cela fragiliserait l'ensemble. Par conséquent, l'Union bancaire serait aussi efficace que sa plus faible composante. Cette analyse est-elle pertinente ? Incite-t-elle à l'optimisme, dès lors que l'on constate que l'Allemagne s'oppose à ce que le MES recapitalise les banques espagnoles, souhaite que la supervision soit limité à quelques grosses banques et rejette le principe d'un régime commun de garantie des dépôts ?
Depuis le début de la crise de la zone euro, les banques se recentrent sur leur marché domestique et réduisent leur exposition aux autres pays de la zone euro. Le projet de la Commission européenne est-il de nature à rassurer les banques et à encourager les mouvements de capitaux entre Etats membres ? Autrement dit, le projet de la Commission est-il de nature à remédier à la « fragmentation financière » ?
Lorsque la BNP décide de faire émettre des obligations à sa filiale italienne BNL plutôt que de continuer à la financer par la maison mère en France, n'alimente-t-elle pas la fragmentation du marché unique ? Ne donne-t-elle pas le sentiment d'avoir déjà intégré une possible sortie de l'Italie de la zone euro ?
L'Allemagne s'oppose à ce que le MES puisse recapitaliser les banques espagnoles. Mais à quoi servirait une Union bancaire qui n'aurait pas pour effet de faire financer la recapitalisation des banques espagnoles par les contribuables du reste de l'Europe ?
Le fait de ne pas retenir l'ABE comme autorité supranationale de supervision n'est-il pas le signe de son manque de crédibilité ? A terme, l'ABE n'est-elle pas appelée à disparaître au profit de la BCE ?
Les Britanniques peuvent-ils faire échouer les négociations ? Quelles sont les incidences de l'unanimité sur la négociation ?
En ce qui concerne le calendrier et la faisabilité de l'Union bancaire dès le 1er janvier 2013, je crois que c'est tout à fait possible. Il faut bien sûr que les ressources nécessaires soient affectées à la BCE. Les personnes qui connaissent ce métier sont chez les superviseurs nationaux. Dès lors, la BCE pourra demander et obtenir assez rapidement qu'un certain nombre de superviseurs nationaux lui soient affectés. Le temps passant, elle pourra recruter d'autres personnes.
En fonction du degré plus ou moins systémique des établissements, leur supervision sera plus ou moins centralisée. En conséquence, au début, la part de l'instruction qui sera opérée par le superviseur national sera peut-être plus importante par rapport à celle réalisée par les services de la BCE. Leur rôle sera néanmoins crucial puisqu'ils feront une proposition de décision définitive aux organes de supervision européens. Au fur et à mesure de la transition, le dosage de la part respective des superviseurs nationaux et de la BCE va évoluer.
Avant la mise en place de l'ABE, j'ai présidé le Comité européen des superviseurs bancaires (CESB). Je voudrais rappeler que l'ABE ne fait pas de supervision : elle est en charge de la régulation. Elle rédige un règlement unique et elle prend, dans le cadre du manuel des superviseurs, des recommandations et des standards techniques qui disent comment appliquer la supervision. Mais je ne vois pas comment l'ABE pourrait faire des actes de supervision. D'ailleurs, la régulation à Vingt-Sept est déjà une chose particulièrement difficile. Si l'on veut aller vite, il faut bien évidemment construire autre chose.
L'ABE va garder toute sa place en vue d'élaborer et d'assurer l'application d'une régulation harmonisée. Le MSU va même aider l'ABE dans son rôle. Aujourd'hui, Vingt-Sept Etats négocient à l'ABE. Demain, il y aura plutôt onze personnes autour de la table, à savoir 10 + 1. La BCE va naturellement coordonner et rapprocher les positions des Etats membres de la zone euro.
La fragmentation financière est regrettable mais avec la crise financière, nous avons assisté à une renationalisation des opérations et des financements. Ce sera la tendance naturelle si l'on ne fait rien. Avec l'Union bancaire, on n'aura plus cette incitation à la fragmentation. C'est pourquoi, il faut aussi être capable d'attirer ceux qui ne sont pas dans l'eurozone.
Aujourd'hui, ce sont les marchés et le régulateur qui imposent la fragmentation et interdisent de financer des euros du Sud par des euros du Nord. A cet égard, la France est dans une position intermédiaire, l'Europe « du centre ». Tous les régulateurs locaux ont demandé aux établissements de ne pas financer les filiales établies à l'étranger tant que le risque est supporté par le contribuable national. Les transferts de fonds depuis le Sud de l'Europe vers le Nord sont massifs, comme le montrent les soldes Target, et s'expliquent par les craintes sur la solidité des Etats en cas de crise bancaire.
S'agissant de la négociation en cours, je me demande quelles conditions les Britanniques vont poser pour donner leur accord à ce projet.
Sur la résolution, il s'agit de fournir une procédure applicable lorsqu'une banque est en difficulté. En effet, les procédures de droit commun de la liquidation judiciaire ou de la sauvegarde sont impossibles, car leur simple annonce conduirait au retrait immédiat des dépôts, ce qui serait catastrophique. Il faut donc une autorité de résolution dotée de pouvoirs importants, capables d'imposer aux créanciers, de façon autoritaire, une participation financière.
Concernant notre filiale italienne, BNP Paribas a demandé à BNL d'être autosuffisante en termes de ressources, sans financement par la maison-mère française. Cela a conduit BNL à emprunter, à des taux certes plus élevés, mais cela permet d'éviter que BNP Paribas ne porte le risque, très improbable, d'une crise italienne.
L'Union européenne est en train de se doter d'un ensemble de règles dans les domaines prudentiel, avec CRD IV, de la résolution des crises bancaires et de la protection des déposants. Ces textes sont nécessaires pour les Vingt-Sept et constituent, dans le même temps, une base pour le renforcement de l'Union monétaire.
L'Union bancaire commence par la supervision commune parce qu'il est d'abord nécessaire de rétablir la confiance au sein des Dix-Sept avant de mettre en commun les ressources financières ou d'encadrer la résolution des défaillances. Une fois que la responsabilité de la supervision sera assumée au niveau européen, il conviendra de mettre en commun la responsabilité budgétaire corrélative.
S'agissant de la responsabilité politique de la BCE en tant que superviseur, nous avons proposé un format assez classique de responsabilité devant le Conseil et l'Eurogroupe, avec possibilité d'auditions et de rapports auprès du Parlement européen. Il est envisageable d'aller plus loin, notamment auprès des Parlements nationaux, au moins tant que les autorités de résolution resteront à un niveau national.
L'ABE n'a pas été choisie pour exercer la supervision bancaire, notamment parce qu'elle est soumise à d'importantes contraintes juridiques. Il s'agit d'une agence règlementaire, qui ne peut donc pas prendre de décision juridiquement contraignante qui soit fondée sur une large liberté d'appréciation, en application de la jurisprudence Meroni de la Cour de justice de l'Union européenne. Or, un superviseur doit jouir d'une certaine marge d'appréciation. Ce problème ne se pose pas pour la BCE, qui est une institution de l'Union européenne, établie par les traités. Un litige porté par le Royaume-Uni devant la Cour de justice, relatif aux missions de l'AEMF, nous montre que cette question de compétence est loin d'être anecdotique.
S'agissant de la position britannique, le Royaume-Uni sait que l'Union bancaire est également dans son intérêt, étant très affecté par la crise dans la zone euro. Les demandes britanniques portent essentiellement sur la gouvernance au sein de l'ABE ; il est en effet possible d'ajuster la proposition actuelle, en revoyant les modalités de vote à la majorité qualifiée au sein de l'ABE.

Jézabel Couppey-Soubeyran remet en cause, dans son propos, le rôle d'une banque centrale dans la supervision micro-prudentielle. Ce point de vue, que j'ai longtemps partagé, oublie cependant que la supervision individuelle des établissements fait partie du métier du banquier central, ne serait-ce qu'au titre du suivi et du contrôle des demandes de liquidité des banques. Je pense qu'il est sain qu'il y ait deux institutions, l'une pour édicter les règles, l'autre pour superviser.
Qu'en sera-t-il, cependant, de la supervision des secteurs non bancaires, en particulier celui de l'assurance ?
Par ailleurs, quel est le calendrier des autres piliers de l'Union bancaire, car la supervision commune est inutile si cela n'a aucune conséquence en termes de résolution des crises ?
Enfin, quelle sera l'articulation entre le superviseur national et le superviseur européen, dans la mesure où ce dernier dépendra nécessairement des travaux réalisés par le premier ?

Je m'interroge sur le bien-fondé et le caractère opérationnel de la différenciation introduite par Jézabel Couppey-Soubeyran entre le macro-prudentiel et le micro-prudentiel.
Si j'ai bien compris, il y aurait un conseil de supervision logé au sein de la BCE, mais ce serait le conseil des gouverneurs qui prendrait l'ensemble des décisions. Comment s'articulent ces deux conseils ?
En matière de garantie des dépôts, il existe aujourd'hui des mécanismes nationaux. On envisage un système européen. Qui garantit quoi ? Un fonds national sera-t-il amené à cotiser au fonds européen ?
La banque centrale a une information privilégiée sur la liquidité des banques qui se refinancent auprès d'elle. Pour autant, cela n'oblige pas à faire d'elle le micro-superviseur. L'important est qu'elle fasse partager cette information privilégiée au micro-superviseur, ce qui lui laisse ensuite la possibilité de s'impliquer dans la stabilité financière en prenant en charge la politique macro-prudentielle.
Vous vous interrogiez sur le sort de la surveillance des autres secteurs. Si l'on confie la micro-supervision à la BCE, on restera forcément dans un modèle sectoriel, c'est-à-dire spécialisé institution par institution. Il faudra donc trouver un autre superviseur pour les assurances, les entreprises d'investissement, les marchés de valeurs mobilières, etc.
Ce qui fonde la différence entre le macro et le micro-prudentiel, c'est que le risque systémique n'est pas la somme de simples risques individuels. Surveiller les risques au niveau micro-prudentiel ne suffit pas à prévenir le risque systémique et donc à s'assurer de la stabilité financière globale. La surveillance doit donc reposer sur les deux piliers. L'institution la mieux placée pour assurer l'aspect macro-prudentielle de la surveillance, c'est la banque centrale.
Je voudrais enfin revenir sur la légitimité démocratique qui a été évoquée sous l'angle de la responsabilité politique. Pour que la banque centrale jouisse de cette légitimité, il faut qu'elle rende des comptes. Elle doit donc pouvoir suivre un certain nombre de règles bien définies. C'est par exemple tout à fait possible s'agissant de la politique monétaire, même si, parfois, on peut regretter que la BCE ne communique pas suffisamment sur ses décisions.
En matière de politique micro-prudentielle, ce sera beaucoup plus difficile, car elle est plus discrétionnaire. Il est clair que la légitimité démocratique de la BCE pourra être mise à l'épreuve lorsqu'elle se verra confier cette politique de micro-supervision.
Tout à fait.
Il y a une logique à continuer à séparer la régulation de la supervision. L'édiction de règles relève d'abord du Conseil et du Parlement européen. Par exemple, CRD IV, qui transcrit Bâle III en droit européen, c'est d'abord un règlement européen. Sa mise en oeuvre plus fine relève de l'ABE et concerne l'ensemble du marché intérieur et des Vingt-Sept. Le maintien de l'ABE est donc légitime. La supervision, en revanche, est aujourd'hui exercée au niveau national et le sera demain, pour les Dix-Sept, au niveau de la BCE.
S'agissant de la garantie des dépôts, une directive européenne va harmoniser un certain nombre de caractéristiques techniques des fonds. Il n'y a pas de difficultés majeures de ce point de vue. Elle prévoit également que, à terme, les fonds de garantie soient préfinancés à hauteur de 1 % des dépôts, ce qui est un montant relativement important, de l'ordre d'une dizaine de milliards d'euros pour la France. Les fonds préfinancés pourront intervenir à la fois en garantie des dépôts et en résolution, de manière à la fois curative et préventive pour éviter une faillite désordonnée. Ils pourraient se prêter les uns aux autres, ce qui est le premier pas vers une mutualisation et un mécanisme plus européen.
Il ne faut pas oublier la question de la résolution. Si l'on se contente de la supervision sans les outils de résolution et, à terme, une autorité de résolution, seulement une moitié du chemin sera parcourue. Je ne crois pas que le Conseil veuille retarder l'adoption des outils de résolution. C'est une discussion déjà bien avancée. Ce qui prendra plus de temps, c'est de se mettre d'accord pour savoir jusqu'où va la mutualisation de la résolution des crises bancaires.
Dans beaucoup d'Etats membres, l'assurance n'est pas supervisée par la banque centrale. Elle n'est pas incluse dans le projet et elle n'est pas à l'ordre du jour.
Sur l'articulation entre le niveau central et les superviseurs nationaux, le Système européen des banques centrales est un bon exemple. Quand la Banque de France octroie un prêt dans le cadre d'une opération de politique monétaire, elle le fait au nom et pour le compte de l'Eurosystème. Les risques sont mutualisés, mais c'est bien la Banque de France qui octroie le crédit, analyse le collatéral et vérifie que cette opération se déroule selon les conditions fixées par l'Eurosystème.
Nous pensons qu'il faut garder une articulation entre l'échelon national qui, par sa proximité, comprendra mieux les risques, et l'échelon européen qui doit garder la pleine responsabilité des décisions. Si l'échelon national reste responsable de manière large, il n'y a plus d'échelon européen.
Je ne crois pas qu'il y ait d'incompatibilité à rapprocher - au contraire - le micro et le macro-prudentiel au sein de la banque centrale. C'est parce qu'elle comprend bien les enjeux macro et micro que les deux politiques peuvent s'articuler harmonieusement. Il faudra réfléchir à la gestion des conflits. En tout état de cause, la séparation stricte me paraît plus risquée qu'un rapprochement.

Nous n'avons pas tout traité. Mais, à la suite de cette table-ronde, nous sommes encore plus persuadés qu'il s'agit d'un sujet structurant en termes de responsabilité et de fonctionnement de l'Union européenne.
Puis, la commission procède à l'examen du rapport de M. François Marc, rapporteur, sur le projet de loi n° 21 (2012-2013) autorisant la ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) au sein de l'Union économique et monétaire.

Après le texte portant création du Mécanisme européen de stabilité, nous voici de nouveau saisis au fond d'un projet de loi autorisant la ratification d'un traité. Pour la deuxième fois en 2012, le Sénat a préféré confier l'examen d'un tel texte à notre commission des finances, considérant qu'il formait un tout avec le projet de loi organique et le projet de loi de programmation des finances publiques.
Depuis sa négociation et sa signature en mars 2012, le contexte a beaucoup évolué. Au départ, il s'agissait d'inscrire une règle contraignante dans notre Constitution après une année 2011 particulièrement difficile pour la zone euro marquée, entre autres, par un écart croissant des taux entre l'Allemagne et la France. La réforme du pacte de stabilité est entrée en vigueur à la fin du mois de novembre 2011, sans avoir donné lieu à de véritables débats politiques. Le nouveau président du conseil des gouverneurs de la BCE, Mario Draghi, proposa alors aux Etats membres un « contrat implicite » : une intervention de la Banque en échange d'un pacte budgétaire. Grosso modo, la présentation qu'en firent ensuite Mme Merkel et M. Sarkozy revenait à durcir le pacte de stabilité. Dorénavant, la sortie de crise reposait uniquement sur la discipline budgétaire, ce qui assombrissait les perspectives d'un retour à la croissance.
Et puis, avec l'élection de François Hollande, la donne politique et juridique a changé.

Une nouvelle donne politique, donc, parce qu'un pacte de croissance complétait le pacte budgétaire ; nous en avons longuement parlé lors du débat d'orientation des finances publiques. La demande du candidat Hollande étant satisfaite, il n'y avait plus d'obstacles à ratifier ce traité. M. Jean-Marc Ayrault, qui se déplacera demain au Sénat pour un débat sur les orientations de la politique européenne, vous le redira.
Parallèlement, les Etats confièrent à Herman Van Rompuy le soin d'ouvrir les travaux sur la manière de remédier aux dysfonctionnements de la zone euro. C'est dans ce cadre que la France promeut, pour reprendre l'expression du Président de la République, sa conception de « l'intégration solidaire ».
Une nouvelle donne juridique, aussi, depuis que la Commission européenne, dans sa communication du 20 juin, a donné une interprétation souple du fameux article 3 qui institue la « règle d'or ». D'après elle, le caractère des nouvelles règles budgétaires à inscrire dans le droit national doit être contraignant et permanent, mais pas forcément au plan juridique. En d'autres termes, elle a repris le principe « se conformer ou s'expliquer ». Autrement dit, si un Etat est capable d'avancer les raisons pour lesquelles il a contourné une règle, il peut bénéficier d'une appréciation positive ou favorable. D'après le Conseil constitutionnel, l'article 3 laisse même aux Etats le choix d'adopter une règle contraignante ou une règle non contraignante. En définitive, ce traité pourrait améliorer le pacte de stabilité.
Cela dit, le pacte budgétaire ne représente qu'une partie du traité, un traité qui est intergouvernemental et non communautaire. Aux termes de son article 2, le droit communautaire primera en cas de conflit avec une disposition du traité. Le texte prévoit également la coordination de politiques économiques et l'institution d'une Conférence des parlements nationaux dont les contours restent à préciser, mais qui pourrait s'inspirer du succès de la COSAC. Son entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2013 si douze Etats de la zone euro l'ont ratifié. Le calendrier sera certainement respecté, puisque douze Etats, dont huit de la zone euro, ont achevé leur procédure de ratification.
Comme nous venons de le voir, le traité aura une valeur juridique inférieure au pacte de stabilité.
Cependant son poids politique est tel qu'il pourrait conduire à modifier tant les procédures que les modalités d'application du pacte de stabilité. En particulier, il pourrait modifier la manière dont est apprécié le respect du critère de 3 % par les autorités communautaires, en mettant l'accent sur les efforts structurels des Etats plutôt que sur le niveau du déficit effectif. De même, les règles de majorité, dans le cas où la Commission voudrait être plus clémente, en raison de la conjoncture notamment, seront assouplies. A l'inverse, il n'est pas évident que le TSCG entraîne un durcissement des possibilités d'imposer des sanctions.
Quelle est la nature exacte de la règle qui figure dans le TSCG ? Constitue-t-elle un carcan ? Nous condamnera-t-elle à l'austérité ?
Elle paraît en tout cas économiquement plus pertinente que celle du volet « correctif » du pacte de stabilité. En effet, avec la règle du TSCG, les Etats doivent se fixer un objectif à moyen terme (OMT), défini en termes de solde structurel. Cet objectif ne peut pas correspondre à un déficit structurel supérieur à 0,5 point de PIB (1 point de PIB pour les Etats ayant une dette de moins de 60 points de PIB), alors que le pacte de stabilité prévoit que les Etats peuvent avoir un déficit structurel jusqu'à 1 point de PIB. Pour la France, cela ne change rien, puisque l'objectif qu'elle se fixe est déjà l'équilibre structurel.
Pour atteindre cet objectif, les Etats doivent définir une trajectoire de solde structurel, selon laquelle le déficit structurel doit être réduit de 0,5 point de PIB par an, soit 10 milliards d'euros dans le cas de la France.
La supériorité de cette règle sur celle du pacte de stabilité, qui fixe un objectif nominal de 3 %, est qu'elle est fixée en termes de déficit structurel et non de déficit effectif.
Avec la règle des 3 %, un Etat en situation de faible croissance doit, pour respecter son objectif de déficit, ajouter aux mesures structurelles des mesures supplémentaires pour compenser les effets de la moindre croissance du PIB.
La règle des 3 % oblige les Etats à faible croissance à prendre des mesures supplémentaires, ce qui pèse encore plus sur la croissance, ajoutant de la crise à la crise.
La règle du TSCG porte uniquement sur le solde structurel, indépendamment de l'évolution du solde conjoncturel. C'est pourquoi le Premier ministre a considéré, devant l'Assemblée Nationale, que le traité est « plus souple que le traité de Maastricht qui se focalise sur le seul déficit nominal ».
Politiquement, sans préjuger toutefois de ce que décidera le Conseil sur proposition de la Commission, le poids désormais accordé à la règle de solde structurel rendra difficile au Conseil de sanctionner un Etat qui ne respecterait pas le critère de 3 %, dès lors que cet Etat serait « en règle » avec le TSCG, affichant une ambition vertueuse de revenir à l'équilibre, dans le respect d'un OMT défini de manière argumentée.
Les protestations contre l'entrée en vigueur de la réforme du pacte de stabilité en novembre 2011 ont été beaucoup moins fortes que celles contre le TSCG. Pourtant l'application des règles du pacte de stabilité, et notamment l'objectif de revenir à un déficit nominal de moins de 3 % du PIB, nous oblige depuis 2011 à des efforts autrement plus importants que ce qui résulterait de la seule application du TSCG.
Ainsi, dans le PLF 2013, pour passer d'un déficit nominal de 4,5 % du PIB à 3 %, soit une réduction du déficit de trente milliards d'euros, il sera nécessaire de réduire le déficit structurel de 40 milliards d'euros. En 2011 et en 2012, il aura fallu réduire le déficit structurel de 30 milliards puis de 24 milliards d'euros. A titre de comparaison, l'effort que nous oblige à réaliser le TSCG n'est « que » de 10 milliards d'euros par an de 2014 à 2016, année du retour à l'équilibre structurel.
La question du solde structurel est au coeur du dispositif. Certains d'entre vous s'en sont déjà émus, et sur ce sujet les points de vue divergent. A l'Assemblée nationale, beaucoup, y compris le ministre du budget, ont relevé les incertitudes sur son mode de calcul. Elles sont réelles.
Sans entrer dans la technique, on peut dire que la détermination du solde structurel dépend de l'estimation que l'on retient pour le PIB potentiel de l'économie, et que les économistes peuvent avoir des estimations divergentes. On peut se demander s'il est pertinent de fonder une règle de finances publiques sur une notion aussi subjective.
Néanmoins, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve l'économie européenne, on ne peut plus se permettre de fonctionner uniquement avec une règle dont les effets sont procycliques et récessifs. Malgré ses défauts, la notion de solde structurel permet de tenir compte de la conjoncture et d'éviter d'ajouter la crise à la crise : c'est donc la notion à retenir.
Comment faire pour atténuer ses défauts ? Une première piste est l'harmonisation des méthodologies. Autre proposition : s'en remettre, pour l'appréciation du respect de la trajectoire, à un « juge » indépendant. Cela renvoie à la discussion du projet de loi organique, qui cherche à résoudre cette difficulté en créant un Haut conseil des finances publiques.
Pour conclure sur l'analyse de la règle, quelques mots sur sa présumée rigidité.
Le traité prévoit que la constatation d'un écart par rapport à la trajectoire doit entraîner le déclenchement d'un mécanisme de correction dit « automatique ». En fait, l'automaticité est relative, voire inexistante : le mécanisme proposé par le projet de loi de programmation des finances publiques autorise de s'écarter de la trajectoire pendant trois années consécutives. En outre, l'interprétation du traité par la Commission européenne indique explicitement que les autorités budgétaires pourront conserver une marge d'appréciation sur la pertinence de son déclenchement. Pour la Commission, tout réside dans le principe « se conformer ou s'expliquer » : si on s'écarte de la trajectoire, il faut s'en expliquer. Le traité prévoit aussi que les écarts par rapport à la trajectoire sont acceptables en cas de « circonstances exceptionnelles », mais leur définition est tellement floue qu'elle laissera une place à l'appréciation des organismes indépendants qui devront être mis en place.
Enfin, le traité ne comporte pas seulement la règle de déficit. Il comprend aussi, à l'article 4, une règle de dette qui figure déjà dans le pacte de stabilité. Cette règle importante oblige les Etats, à compter de 2017, à réduire l'écart entre leur niveau de dette et le seuil de 60 % du PIB d'un vingtième par an. Un Etat comme la France, dont le ratio de dette est d'environ 90 points de PIB, devrait réduire son ratio de 1,5 point de PIB par an.
La règle est souvent mal comprise. D'une part, il ne s'agit pas de réduire le stock de dette en milliards d'euros, mais le ratio dette/PIB. D'autre part, selon la façon dont évolue le stock de dette en milliards d'euros et le PIB, le ratio peut diminuer alors même que le montant de la dette continue d'augmenter. Si la France respecte la trajectoire qui figure dans le projet de loi de programmation 2012-2017, elle respectera la règle de dette avant même que celle-ci ait commencé à s'appliquer, en 2017. Ce point est rassurant sur la capacité de notre pays à s'inscrire dans cette nouvelle exigence.
Il faut néanmoins signaler une bizarrerie dans le TSCG : en recopiant la règle du pacte de stabilité, une erreur s'y est glissée. Si bien que, littéralement, ce n'est plus l'écart entre le niveau de dette et le seuil de 60 % qu'il faudrait réduire chaque année de 5 %, mais bien le stock de dette lui-même. Il s'agit évidemment d'une erreur de rédaction car, dans le cas contraire, la règle serait inapplicable et incohérente. En tout état de cause, dès lors que le traité renvoie à la règle figurant dans le pacte de stabilité, c'est bien la règle dans sa rédaction communautaire qui s'appliquera. Nous pouvons être rassurés sur ce point.
Sans verser dans la politique-fiction, je veux souligner qu'un rejet du traité présenterait des inconvénients majeurs. La France serait d'abord marginalisée puisque, contrairement à la Constitution européenne enterrée à la suite du « non » français, le traité entrerait en vigueur malgré elle et s'appliquerait aux Etats l'ayant ratifié. Autrement dit, le TSCG n'a pas besoin de la France pour fonctionner. La France perdrait en outre sa crédibilité : elle romprait unilatéralement le contrat implicite entre la BCE et les Etats, qui conditionne la politique monétaire accommodante de la BCE au respect des règles budgétaires par les Etats ; elle ne respecterait pas l'engagement pris lorsque ses partenaires se sont ralliés à l'idée de pacte pour la croissance au mois de juillet. Dans ces conditions, et alors que certains Etats membres se sont ralliés à la position de la France, comment penser que notre pays pourrait peser sur les débats économiques à venir ?
Les différents ministres n'ont pas tort lorsqu'ils estiment qu'un rejet du traité par la France entraînerait une augmentation auto-réalisatrice des taux auxquels elle se finance, et donc une spirale comparable à celle qu'ont connue l'Espagne et l'Italie.
Mais, dans une telle situation, la France serait encore plus démunie que l'Espagne et l'Italie : elle aurait des difficultés à convaincre ses partenaires de la faire bénéficier du soutien du MES, puisque le préambule des traités MES et TSCG lie le bénéfice du MES à la ratification du TSCG. Nous avons vu lors des débats sur le MES que ce lien n'était pas juridiquement contraignant. Mais politiquement, il faudrait convaincre une majorité d'Etats actionnaires du MES, représentant au moins 85 % du capital, de voter en faveur d'une aide à la France, ce qui serait sans doute complexe à réaliser.
Si elle devait bénéficier, sous une forme ou sous une autre, d'une aide de ses partenaires européens, à travers le MES ou la BCE, cette aide serait soumise à des conditions, selon des règles au moins comparables à celles du TSCG, et probablement plus rigoureuses.
En définitive, même si l'augmentation des taux ne se produisait pas, la France resterait soumise aux règles du pacte de stabilité et, si elle ne respectait pas le critère des 3 % de déficit, elle ne pourrait pas plaider les circonstances atténuantes en mettant en avant son respect des règles du TSCG, puisqu'elle l'aurait rejeté.
Voilà la situation. La préconisation de votre rapporteur général est d'inciter à l'adoption de ce traité, à la suite des arguments que j'ai tenté de vous exposer avec le plus de conviction possible. Le pacte de croissance ayant changé la donne et modifié le contexte, le TSCG constitue un assouplissement des règles en vigueur jusqu'à présent. La France a intérêt à l'adopter, si nous ne voulons pas retourner vers des règles plus procycliques. L'emploi du solde structurel permettra en effet de pratiquer des corrections budgétaires contracycliques plus facilement qu'auparavant ; le traité nous offre l'opportunité d'opérer plus facilement des corrections de trajectoire. Il est donc souhaitable que notre commission préconise en séance de la manière la plus large possible, et si possible à l'unanimité, un vote favorable.

Je voudrais souligner les efforts méritoires déployés par notre rapporteur général pour nous persuader de voter en faveur du texte qui fait l'objet de son rapport. Ces efforts sont d'autant plus méritoires qu'il y a quelques mois, avant ce qu'il a appelé, à juste titre, la « nouvelle donne » politique, les appréciations et le jugement qu'il portait sur le TSCG n'étaient pas tout à fait les mêmes. Il nous a livré une analyse Canada Dry d'un texte présenté comme nuancé et modéré, alors qu'il l'avait présenté pendant des mois et des mois comme un carcan et un gage d'austérité ! Nous ne pouvons que saluer la performance, et les qualités de souplesse de sens de l'adaptation dont elle témoigne.
En toute cordialité, je voudrais toutefois relever deux ou trois points. Vous ne nous ferez tout de même pas croire que grâce au pacte pour la croissance et l'emploi 120 milliards d'euros vont s'investir en France et avoir un impact sur la conjoncture économique de notre pays. Nous en avons déjà parlé, et vous savez bien que l'essentiel des crédits de ces fonds structurels sera affecté aux Etats qui en sont déjà bénéficiaires, comme par exemple la Roumanie et la Bulgarie, et n'aura donc pas d'effet sur la croissance française. Quelques milliards d'euros tout au plus peuvent, si le gouvernement français a des projets et les présente à temps, accélérer le rythme de l'activité dans notre pays. Je vous connais trop bien, Monsieur le rapporteur général, pour penser que vous n'avez pas la même lecture que moi !
Vous évoquez enfin, dans une approche pédagogique que je partage, le changement de référentiel, avec l'appel à la notion de solde structurel. C'est en effet l'innovation du TSCG. Elle appelle une instance neutre, susceptible de garantir le calcul de certaines grandeurs économiques.
Certains d'entre nous seront particulièrement attentifs, lors de l'examen du projet de loi organique qui découlera de ce débat, à ce qu'il s'agisse bien d'un dispositif cohérent, et à ce que le Haut conseil des finances publiques ne soit pas un ensemble vide, ni même un organe qui n'exercerait pas toutes les prérogatives qui doivent lui revenir.
En tout état de cause, nous devrons nous habituer à raisonner en termes complexes, ce qui n'est pas simple vis-à-vis de l'opinion publique. Par exemple, ce qu'on présente comme une économie dans les dépenses n'est en réalité, selon les chiffres mêmes du gouvernement, qu'un freinage dans une tendance acquise à l'accroissement !
Substituer à des données nominales des données structurelles est un facteur de complexité, qui suppose davantage de confiance envers l'Etat et les pouvoirs publics, et pas seulement dans l'enceinte parlementaire mais aussi et surtout dans le cadre de la zone euro : pour que la surveillance multilatérale prévue ait un sens, il faut que les notions soient les mêmes dans chaque Etat.
En conclusion, je ne résiste pas à la tentation de vous titiller un peu, Monsieur le rapporteur général, sur ce que vous nous dites au sujet de la France qui ne doit pas s'interdire a priori de se réclamer de la règle du TSCG, plus souple que celle prévue par le pacte de stabilité, en particulier si la croissance devait être nulle ou négative en 2013. Ceci est-il compatible avec les propos du ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici, qui nous affirmait que les 3 % seraient respectés absolument, et qu'il n'était pas même question de 3,1 % ou de 3,2 % ? Monsieur le rapporteur général, seriez-vous plus laxiste que le ministre que vous soutenez ?

Nous venons de vivre un grand moment ! Notre rapporteur s'adressait d'abord à ses collègues de la majorité...

Sur le fond, nous avons soutenu ce traité, nous le voterons. Mais en nous souvenant de toutes les attaques contre « Merkozy », nous avons tout de même quelques questions à vous poser. Où est la cohérence, si chère à M. le Premier ministre qui l'invoque à tout bout de champ ? Vous discourez sur la croissance, alors que vous ne prenez aucune mesure de réforme structurelle, ce qui nous amène tout droit à la décroissance !

Quelles que soient vos circonlocutions oratoires, si vous imposez réellement un point et demi de prélèvement supplémentaire par rapport au PIB, nous allons tout droit à la récession ! Alors, quand vous prétendez, avec le président de l'Assemblée et certains de vos collègues, qu'en 2014 tout ira mieux et que nous atteindrons les 3 %, alors qu'un institut prévoit dès aujourd'hui un déficit de 3,5 %, nous savons à quoi nous en tenir !
Le Haut Conseil justifie bien des accommodements. Que l'on parle de déficit structurel, de « nouveau PIB », de PIB réel ou virtuel, un fait demeure : la réalité économique n'est pas virtuelle ! Nous allons directement vers la récession. Nous allons voter un traité qui fera comprendre aux Français que la France doit devenir raisonnable, qu'elle doit mener une politique budgétaire équilibrée, pour faire en sorte que les générations futures ne soient pas accablées par une dette insupportable. J'avoue que je regrette la franchise de Mme Bricq et son honnêteté (protestations à gauche), lorsqu'elle promettait que les 100 milliards nécessaires pour parvenir aux 3 % seraient réalisés pour 50 % par des économies et pour 50 % par la fiscalité. Ce n'est pas du tout ce que vous dites, lorsque vous parlez d'un tiers pour la fiscalité des entreprises, un tiers pour la fiscalité des ménages et un tiers pour les économies, d'autant que personne ne sait si où vous allez les faire !

Nous sommes dans le virtuel, alors que la situation exige du courage. Nous assumerons nos responsabilités et nous voterons le traité, même s'il sera difficile d'adopter à l'unanimité votre rapport en zigzag.

Je n'en suis pas encore à « rendez-nous Mme Bricq ». Laissez-la exercer ses nouvelles fonctions : une expérience ministérielle est toujours utile ! Quoi qu'il en soit, je salue l'artiste, parce que l'exercice n'est pas simple !

Il y a quelques mois, c'était impossible d'accepter un tel traité, puis vous changez deux virgules et trois accents et vous nous expliquez que ce serait une catastrophe pour le pays si ce texte n'était pas voté ! Il y a six mois, vous ne pouviez en aucun cas le voter, parce qu'il ne mentionnait ni l'emploi ni la croissance ; François Hollande le jugeait inacceptable et s'était engagé à le renégocier. Puis, dès lors qu'il suffit que 12 Etats de la zone euro aient ratifié ce traité pour qu'il entre en vigueur, la capacité de François Hollande de le renégocier est égale au néant. Cela devient donc une promesse électorale non tenue, mais vous vous employez à convaincre, surtout dans votre propre camp, que ce dont vous ne vouliez hier à aucun prix doit être adopté aujourd'hui. Peut-être certaines règles doivent-elles être assouplies... En réalité, la situation financière de l'Europe, de la France, est telle que, quel que soit le gouvernement, il faut réduire le déficit et revenir le plus vite possible à l'équilibre. Toute l'Europe devra aller en ce sens. J'aurais préféré entendre le Président de la République dire franchement : « les conditions budgétaires étant ce qu'elles sont, nous n'avons pas réussi à faire prendre des mesures pour l'emploi et la croissance ». Les 120 milliards ? Même le Gouvernement en parle très peu !
Ce texte est plutôt bon, à l'origine. Vous vous êtes battus pour que ne soit pas inscrite dans la Constitution la règle d'or. Qu'est-ce que cela change par rapport au fait qu'il faut tendre vers l'équilibre, que le gouvernement soit de droite ou de gauche, et trouver des solutions ?
Naturellement, nous allons voter le traité. Allons-nous voter le rapport ? Nous aurions préféré entendre M. Marc reconnaître que le traité allait dans le bon sens, qu'il n'avait été possible de le modifier qu'à la marge mais qu'il était nécessaire de l'adopter. Il n'aurait sans doute pas été voté par tout le monde à gauche et à droite, mais les gens peuvent évoluer : moi-même, j'ai fait campagne contre le traité de Maastricht ! Franchement, convenez qu'en six mois, le texte n'a guère changé ! Nous voterons donc le traité négocié par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel.

Je voterai le texte en séance, mais je m'interroge beaucoup sur le rapport... Je regrette l'absence d'examen conjoint avec la loi organique dans laquelle sera fixée, par exemple, la composition du Haut conseil. Les deux sont intimement liés. Deuxième regret, le mécanisme retenu est une usine à gaz. Il aurait été pourtant simple d'inscrire la règle d'or dans la Constitution ! Le Conseil constitutionnel ne l'impose pas, certes, mais ne l'interdit pas. Et j'ai des doutes sur la légitimité du futur Haut conseil.
Notre rapporteur général estime que le message délivré par le gouvernement depuis mai dernier a permis de lever le doute des investisseurs sur la capacité de la France à rembourser sa dette publique. La trajectoire de réduction des déficits a été définie et appliquée bien avant ! Le précédent gouvernement a engagé la réduction du déficit budgétaire, avec l'objectif des 3 % puis d'un retour à l'équilibre. En quoi le message a-t-il changé ? Les investisseurs n'ont jamais eu de doutes à propos de la France ; à aucun moment nous n'avons connu d'envolées de taux d'emprunt comme l'Espagne ou l'Italie. J'attendrai les explications du rapporteur général avant de me prononcer sur le rapport.

M. Delattre parle de contorsions. J'en vois aussi de votre côté. Quel tango argentin sur le vote du rapport et le vote du traité. Vous êtes à la peine pour vous en expliquer...

Je ne vois pas ce qui vous empêche de voter le texte du rapporteur général. Les débats que nous aurons sur les perspectives européennes et sur le traité sont des débats structurants, et importants, ils engagent notre politique économique sur plusieurs années.
Nous réalisons ce que vous souhaitiez, nous entamons la réduction du déficit, sur l'origine duquel je ne m'étendrai pas. Il atteint aujourd'hui 2 000 milliards d'euros. Notre politique vise à le ramener à 4,5 % du PIB puis à 3 % ; il sera ensuite réduit de 0,75 % par an pendant quatre années. C'est une politique courageuse et difficile. Dans le même temps, nous cherchons des marges de manoeuvre, mais ce n'est pas chose facile. Monsieur le président, vous qualifiez le pacte de croissance de « petites sommes ». Beaucoup a changé depuis le sommet des 28 et 29 juin : pacte de croissance, taxe sur les transactions financières, union bancaire ; ce n'est pas rien ! J'ai entendu parler d'obligations de projet pour 3,5 milliards d'euros, de l'augmentation de capital de la BEI avec un effet de levier pour la France de 5 milliards, de la réaffectation des fonds structurels non utilisés. Certes, il ne s'agit pas d'une injection keynésienne au sens du New Deal. Mais celle-ci serait-elle possible en Europe aujourd'hui ?
Je ne vois pas en quoi une inscription de la règle d'or dans la Constitution aurait été plus simple. On n'écrit pas de chiffres dans la Constitution, ne serait-ce que parce qu'ils peuvent changer après quelques années !

Je vous rappelle que la France a signé des textes bien plus contraignants, le « six pack » ou le « deux pack » en cours de négociation. Ils sont au moins aussi compliqués.
Vous appelez de vos voeux des prévisions économiques confiées à une institution neutre, crédible. Cela figure dans le « deux pack ». Nous aurons un débat sur ces sujets, mais en attendant, je soutiens le rapporteur général.

Chacun connaît nos positions sur le sujet, et nous les défendrons en séance, mais je tenais à redire ici combien ce traité est néfaste pour la France ; c'est une erreur politique et économique. Plutôt que de s'entendre sur la meilleure solution, qui eût été le référendum, vous préférez rester dans votre entre soi et vous donnez des leçons de démocratie. Je trouve déplorables les propos que j'ai entendus ici, sachant l'état dans lequel les gouvernements de droite ont plongé la France. Ce traité, y compris dans sa version modifiée, est mauvais pour notre pays, il l'engage sur la voie de l'austérité qui n'amènera aux Françaises et aux Français que souffrances.
Le président Marini a salué les efforts méritoires du rapporteur général. Une fois n'est pas coutume, je le suis. Car j'ai connu François Marc tenant un tout autre discours que celui qu'il nous tient aujourd'hui. Les 120 milliards du pacte de croissance ne serviront ni la France, ni la croissance ! Cessons de leurrer les Français ! Le Président de la République ne tient pas les mêmes propos que le candidat de naguère et l'on est à tel point dans le double langage que notre rapporteur général lui-même a bien du mal à gérer les contradictions. Comment parler de croissance quand on sait qu'elle ne sera pas au rendez-vous, parce que l'on n'en met pas en place les instruments ?
Je voterai contre le traité, et contre les conclusions du rapporteur général.

L'Union européenne a franchi une première étape, nous a dit le rapporteur général. En effet : ayant pris acte du changement de gouvernement, elle a, ainsi qu'elle sait le faire, bâti du compromis pour sauver la face de son nouvel interlocuteur. De fait, le pacte de croissance est emballé dans de nouveaux articles sans aucune portée juridique. Le seul qui en ait une, c'est l'article 3, relatif au pacte budgétaire.
J'admire le talent de M. Marc, qui s'est lancé dans de longues explications, mais je m'inquiète de la façon dont sera mesuré le déficit structurel : nous pourrions donner le sentiment, dangereux, de changer le thermomètre. Les acteurs économiques ne nous en évalueront pas moins à l'aune de critères robustes. Les Européens nous regardent. Je sors d'un échange avec les membres CDU-CSU de la commission des finances du Bundestag : les Allemands attendent de nous des signaux clairs. Or, je constate que ce sont les recettes fiscales qui permettent de boucler le projet de loi de finances pour 2013. Où sont les économies structurantes ? J'aurais aimé que le rapporteur général soit aussi prolixe sur cet impératif qu'il l'a été dans sa présentation. Où sont les économies réelles ?

Oui, madame Keller, l'Union européenne a réalisé un compromis. Parce qu'il existait des positions différentes. Celle du Président de la République nouvellement élu n'était pas celle qui a prévalu sous le quinquennat précédent, où le gouvernement a dépensé sans compter...

Mais oui : 600 milliards de dette en cinq ans, ce n'est pas rien. Soyons justes : en 2011, il s'est enfin rendu compte que la situation n'était plus tenable, qu'il devait faire preuve de plus de sérieux dans la gestion des finances publiques, et il a commencé à réduire le déficit structurel. Parallèlement, le président Sarkozy a aligné ses positions économiques, voire sa vision du modèle social, sur l'Allemagne - à un point que l'on n'avait jamais vu. Des meetings communs Sarkozy-Merkel ont même été envisagés !
Il est vrai qu'il est plus juste de parler aujourd'hui d'un traité complété que renégocié, mais le fait est que l'alternance en France a créé au sein de l'Union européenne une nouvelle donne, habilement construite avec nos partenaire du Sud, je pense à l'Espagne et à l'Italie. Changement ténu ? La France a eu une part prépondérante dans l'initiative de croissance. Le dossier de la taxe sur les transactions financières lui aussi a progressé.

Oui, madame Keller, le compromis s'est effectivement noué autour de la progression et de la réorientation de la construction européenne. Ce traité, dont je n'ai jamais été un farouche détracteur, avait été initialement pris pour apaiser les marchés financiers ; pour calmer, également, une opinion allemande extraordinairement inquiète devant le tour que prenait l'Europe avec la Grèce et le MES. Par parenthèse, le gouvernement allemand a été le seul autour de la table à la BCE à s'opposer à la proposition de Mario Draghi d'acheter de la dette sur le marché secondaire. Depuis, il y a eu des avancées. Si l'alternance n'a pas bouleversé la donne européenne, elle a contribué à la faire évoluer.

La règle qu'institue ce texte est, d'après moi, de bon sens : les Etats, en régime permanent, doivent être à l'équilibre structurellement, tout en s'accordant, en cas de crise, la possibilité de déficits conjoncturels. J'approuve le rapport de M. Marc et voterai pour la ratification du TSCG.

Inutile de commenter l'habillage politique auquel recourt la majorité pour justifier ses revirements : il est particulièrement habile. Je préfère me réjouir de l'adoption de règles plus contraignantes s'imposant à des Etats dépensiers, dont le nôtre.
Ce qui me réjouit moins est la complexité du texte. Comment sera évalué le « PIB potentiel » qui se calcule sans tenir compte des « tensions sur les facteurs de production » ? Qu'est-ce donc qu'une « tension sur les facteurs de production » ? La définition de solde structurel prêtera toujours à discussion. On sera toujours tenté de recourir à des mesures conjoncturelles, hors solde structurel bien sûr... La solution était d'en rester au solde effectif pour réduire la dépense publique. Une politique d'économie n'est pas récessive pourvu qu'elle s'attaque sérieusement aux dépenses inefficaces, et nous savons qu'il y en a. Nous y aurions tous gagné.
Qui déterminera le PIB potentiel et le solde structurel ? Le Haut conseil des finances publiques, qui devra donner son avis sur l'hypothèse de croissance ? Ou laissera-t-on ce soin à la discrétion du Gouvernement ? Dans le dernier cas, j'émettrai de très vives réserves.

L'intervention portait tout à la fois sur le traité et la loi organique.

Le Conseil constitutionnel n'a pas jugé nécessaire de réviser la Constitution, mais il ne l'interdit pas non plus ! Nous, à droite, nous nous apprêtions à le faire. Cela avait le mérite de la clarté, de la transparence et de la sincérité. Tout le contraire de ce rapport plein d'hypocrisie qui s'adresse, non pas à nous, mais à la majorité. Ah ! Certaines contorsions sont douloureuses... Je préfère l'attitude de M. Foucaud, qui ne dévie pas de sa position.
Beaucoup plus grave que l'habillage politique, l'incertitude que vous faites peser sur le respect de la parole de la France. Vous utilisez spécieusement la notion de solde structurel ; 3 %, pour autant, c'est déjà du déficit. Permettez-moi de vous le rappeler ! Depuis quelques temps, curieusement, les grands élus de gauche discutent le chiffre, M. Yung vient de le faire à l'instant. Cela en dit long sur vos intentions.
Pour convaincre vos collègues, vous prétendrez avoir obtenu des avancées. Au vrai, tout ce que vous avez gagné, c'est du flou, afin de pouvoir demain contourner nos obligations. Si vous aviez réellement voulu le dissiper, vous auriez choisi, comme nous, l'option de la révision constitutionnelle.

Il est clair que le TSCG n'a pas été renégocié ! Quant au pacte de croissance, les redéploiements de crédits bénéficieront à d'autres pays qui ont des besoins financiers plus urgents. J'aurais préféré une inscription de la règle dans la Constitution, la meilleure garantie pour nos concitoyens contre une dérive des dépenses publiques.
On trouve peu d'économies dans le projet de loi de finances 2013 : il n'est que de voir le nombre de fonctionnaires : 23 % des actifs en France, 10 % en Allemagne ! Quel retour à la croissance espérer dans ces conditions ? Le FMI, dans ses perspectives publiées aujourd'hui, prévoit pour la France une croissance de 0,1 % du PIB. C'est inquiétant pour l'avenir !
Quels que soient les discours entendus, si le texte nous convient sur le fond, il faut le voter. On peut s'abstenir en commission sur le rapport parce que l'on ne partage pas la vision du rapporteur général, mais voter en séance la ratification du traité.

Vous saluez chez moi des talents cachés de contorsionniste... Pourtant ma ligne politique est claire, dans le droit fil de celle que défendait, ici-même notre ancienne rapporteure générale, Nicole Bricq. Elle a fait preuve d'une très grande prudence d'interprétation : elle fut une des premières à considérer, en février 2012, qu'il pourrait ne pas y avoir d'obligation pour la France à inscrire le traité dans la Constitution, analyse confirmée depuis par le Conseil constitutionnel.
Il ressort de plusieurs interventions que ma présentation a peut-être été rapide sur certains points, sur lesquels je vais revenir.
En ce qui concerne le contexte économique et la croissance, les résultats obtenus par le Président de la République et les 120 milliards d'euros du pacte de croissance ne constituent pas un simple « habillage » ! Au contraire, ils traduisent un changement d'état d'esprit, qu'il fallait provoquer, au sein de l'Union européenne. Lorsque Mario Draghi a avancé le 25 avril le terme de « pacte de croissance », il a montré qu'il partageait notre préoccupation sur ce sujet.
De même Herman Van Rompuy, dans son pré-rapport et ses propositions, a-t-il évoqué la croissance et parlé de mutualisation des dettes, termes non innocents, qui auraient encore, il y a peu, suscité l'hostilité des Allemands. La logique keynésienne reste donc bien présente dans l'esprit de certains des dirigeants européens. De ce point de vue les engagements ont été pris et la France a contribué à cette réorientation. Les débats tenus lors de l'élection présidentielle n'auront pas été vains !
En réponse à M. Marini, qui s'étonne que l'on puisse évoquer une hypothèse de croissance nulle ou négative en 2013, je rappelle qu'il ne s'agit que d'une hypothèse de travail. Je suis persuadé que nous tiendrons l'objectif de réduction du déficit à 3 %. A cet égard le projet de budget 2013 contient de nombreuses propositions concrètes. Mais notre rôle n'est-il pas aussi d'envisager des politiques correctrices ou d'ajustement dans le cas contraire ?
Nicole Bricq était-elle plus ambitieuse que moi sur la part respective des économies de dépenses et des surcroîts de recettes ? Elle se prononçait pour le 50-50. Nous tenons la même ligne. Lors de l'examen du texte de programmation budgétaire, j'ai ainsi souligné que cet effort de 100 milliards d'euros serait équitablement partagé à l'horizon 2017 : 50 en recettes, 50 en dépenses...

Dans l'immédiat, l'effet récessif d'une action sur les recettes étant moindre que celui d'une baisse des dépenses, il apparaissait légitime de commencer par une hausse des recettes, l'objectif de moyen terme étant de parvenir à un équilibre 50-50, à l'horizon de la programmation pluriannuelle. Nicole Bricq et moi-même tenons bien le même discours.
Albéric de Montgolfier m'interpelle à propos d'une formule qui le heurte, concernant les évolutions intervenues depuis mai dernier. Ma préoccupation était de constater que les marchés avaient bien réagi. Rappelez-vous, on disait alors que l'élection présidentielle aurait des effets dépressifs sur l'activité et des effets négatifs sur l'évolution du spread de taux d'intérêt... En réalité, les marchés ont été plutôt bienveillants à l'égard de la nouvelle équipe !
Nous aurons l'occasion de revenir bientôt sur les mesures structurelles. Nous verrons à ce moment où trouver les 50 milliards - ou 40 - dont nous parlons. Ce n'est pas l'objet du présent projet de loi de ratification du TSCG. Quant à l'inscription de la « règle d'or » dans la Constitution, la question a été tranchée par le Conseil constitutionnel. Je ne peux rien dire de plus. J'en viens à la question de M. Delahaye sur le rôle du Haut conseil des finances publiques. Ce conseil va...

vérifier si la trajectoire des finances publiques est respectée. Il aura sa propre appréciation du solde structurel, qui sera prise en considération par le Gouvernement. Le Haut conseil sera donc naturellement amené à faire connaître sa méthodologie - et d'ailleurs, à venir la détailler devant nous.
Le président Marini a parlé de belles plaidoiries. Je le remercie de reconnaître la bonne articulation des arguments que j'ai utilisés : il ne s'agit pas d'une navigation périlleuse entre des récifs. Je regrette de ne pouvoir satisfaire les attentes de notre collègue du groupe CRC. Je ne crois pas m'être éloigné de mes positions passées. Il s'agit de concilier la préoccupation européenne et l'ambition de croissance.
Pour finir, je vous invite à regarder l'évolution de la conjoncture de ces dernières semaines. Le FMI a formulé ce jour ou hier des appréciations qui donnent du sens à la notion de solde structurel et à la nécessité de mesures contra-cycliques qui permettent de s'affranchir d'un carcan trop rigoureux. Vous savez qui dirige le FMI actuellement : les propos que sa directrice générale tient aujourd'hui pourraient apparaître contradictoires avec sa position d'il y a quelques mois...
La situation est grave, la conjoncture se dégrade : la France se doit d'avoir une politique vertueuse. Tel est le cas et les marchés le reconnaissent.

Un petit rappel de procédure avant que nous passions au vote : ce texte est une loi ordinaire, pas une loi de finances, c'est donc le texte de la commission qui sera débattu en séance. Mais si le texte de la commission est rejeté, c'est le texte du Gouvernement qui sera examiné. Le rapporteur général n'ayant proposé aucun amendement, les deux textes sont identiques. Autrement dit, un vote négatif sur le rapport serait sans conséquence, il n'empêcherait pas tous ceux qui le veulent de voter le texte du Gouvernement en séance publique... Je tenais à souligner cette bizarrerie de procédure...
La commission adopte le projet de loi par 15 voix pour, après prise en compte des délégations de vote, 2 contre et 9 abstentions.