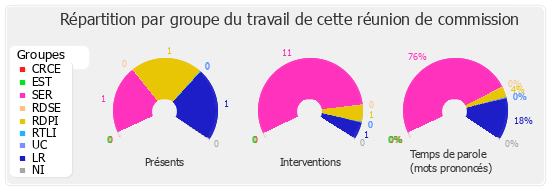Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
Réunion du 12 septembre 2013 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion

Nous poursuivons nos auditions sur le projet de loi organique et le projet de loi, adoptés par l'Assemblée nationale, relatifs à l'indépendance de l'audiovisuel public.
Le groupe NRJ est un groupe audiovisuel indépendant né en 1981, lors de la libéralisation de la bande FM.
Nous saluons les avancées qu'apportera ce texte en renforçant tant l'indépendance du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) que ses pouvoirs. Un CSA fort et indépendant est en effet le garant d'un paysage audiovisuel divers, fort et pérenne face à la concurrence de plus en plus agressive d'opérateurs télécom et Internet non régulés. Ses pouvoirs doivent être incontestables : nous nous réjouissons donc que le projet de loi sépare désormais, en son article 3, les pouvoirs d'enquête et d'instruction du CSA de ses pouvoirs de sanction.
Nous nous inquiétons toutefois de la fragilité juridique de l'article 6 octies du projet de loi, qui modifie l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986. Ces dispositions nous semblent en effet violer le Traité de fonctionnement de l'Union européenne et les directives communautaires en matière de télécommunications, ainsi que certains principes constitutionnels.
Aux termes de l'article 106 du Traité, tout droit d'origine étatique conférant un avantage concurrentiel à des entreprises constitue un droit spécial. S'agissant de l'affectation d'une ressource rare appartenant au domaine public de l'État, l'article 2 de la directive du 16 septembre 2002 interdit aux États membres de conférer de tels droits aux entreprises de secteur de l'audiovisuel.
Plus spécifiquement, l'article 4 de la directive « Concurrence » prévoit que « les États membres n'accordent pas de droits exclusifs ou spéciaux d'utilisation des radiofréquences pour la fourniture de services de communications électroniques » en indiquant que « l'attribution des radiofréquences pour des services de communications électroniques doit être fondée sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés ». Bref, toute disposition ayant pour objet de court-circuiter une procédure en vigueur suivie par toutes les autres entreprises souhaitant exercer la même activité est susceptible de constituer un droit spécial illégal engageant la responsabilité de l'État. Toute juridiction amenée à apprécier la validité des actes d'application de la disposition contraire devra en prononcer la nullité. Ces principes ont déjà été appliqués au secteur de l'audiovisuel.
L'octroi d'un droit spécial - qui s'apparente à un privilège, à un droit de préemption, voire à une assurance-vie, selon l'expression de M. de Tavernost - est rigoureusement prohibé par le droit européen.
L'amendement adopté par l'Assemblée nationale, qui reviendrait à octroyer potentiellement huit chaînes bonus, contrevient à la directive du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, comme à la position constante de la Commission européenne. Dans un communiqué de presse du 29 septembre 2011, intitulé « Antitrust », celle-ci considère que l'octroi de canaux de télévisions additionnels à trois opérateurs historiques, sans mise en concurrence, est contraire au droit de l'Union européenne, pénalise les opérateurs concurrents et prive les téléspectateurs d'une offre plus attractive. Elle rappelle que le dividende numérique doit favoriser l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché et être alloué suivant des procédures ouvertes, transparentes, objectives, non-discriminatoires et proportionnées. Octroyer des fréquences sans respecter ces critères, gelant de facto le paysage au profit d'acteurs historiques, reviendrait à accorder un droit spécial à l'entreprise concernée et donc à enfreindre le droit européen.
L'amendement adopté par l'Assemblée nationale qui autorise la modification des modes de financement et de diffusion en cours d'exploitation par simple agrément du CSA n'est pas conforme aux principes du droit de l'Union européenne. La transformation d'une chaîne payante en chaîne gratuite ne saurait être envisagée sans nouvel appel à candidatures.
L'obligation de transparence impose de demander à l'entreprise candidate de préciser si elle demande une autorisation pour une chaîne gratuite ou payante. Le CSA distingue clairement les services de télévision payants des services gratuits, et les dossiers de candidature sont examinés selon des critères totalement différents. En effet, le modèle économique d'une chaîne de télévision est étroitement lié à son mode de financement, qui influence sa grille et son plan d'affaires. Ainsi, une chaîne payante, qui s'adresse à des abonnés, sera moins soumise au marché publicitaire qu'une chaîne gratuite, ce qui peut être déterminant dans l'octroi de l'autorisation. Si la législation offrait la possibilité au CSA de modifier a posteriori et de manière discrétionnaire la nature du service, les critères selon lesquels une autorisation est accordée ne seraient plus transparents.
L'article 6 octies contreviendrait également à l'obligation de non-discrimination. La chaîne qui se verrait accorder une telle autorisation de diffuser en clair bénéficierait d'un avantage concurrentiel indu par rapport aux chaînes gratuites existantes. Grâce à sa diffusion sur un multiplex existant - R4, pour Paris Première - la chaîne payante qui deviendrait gratuite bénéficierait instantanément d'un taux de couverture du territoire de 95 %. Or, les six nouvelles chaînes gratuites devront, elles, attendre fin 2014, au mieux, avant d'atteindre un taux de 85 %. L'agrément aurait un impact considérable en termes de captation de l'audience et du marché publicitaire.
Le succès de la TNT tient aux acteurs qui y ont cru, qui ont investi. Depuis son lancement il y a huit ans, une chaîne gratuite a contribué à hauteur de 50 millions d'euros au déploiement et à l'initialisation de la TNT, contre une vingtaine de millions seulement pour une chaîne payante. Les chaînes gratuites d'origine se verraient indument concurrencées par les chaînes passant du payant au gratuit, qui pénètreraient le marché une fois les risques pris par les autres ! Ce manquement au principe d'égalité constituerait une punition injustifiée pour ceux qui ont investi des sommes considérables dans la TNT.
En conclusion, autoriser le CSA à donner un agrément au changement du mode de diffusion des chaînes payantes de la TNT, sans appel à candidatures, reviendrait à lui accorder le droit de prendre une décision administrative contraire au droit européen et au droit constitutionnel.
Selon le droit européen, seul l'octroi d'une nouvelle autorisation par un nouvel appel à candidatures peut permettre le passage d'une diffusion cryptée à une diffusion en clair. En matière de commande publique, le respect des principes d'égalité de traitement et de l'obligation de transparence interdit toute modification substantielle d'un contrat. Une modification du mode de financement, par exemple, doit s'analyser comme entraînant la passation d'un nouveau contrat, supposant dès lors la délivrance d'une nouvelle autorisation, ce qui implique le respect des règles de publicité et de mise en concurrence. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne étaye cette analyse.
La chaîne qui ne souhaite plus exploiter sa fréquence dans les conditions stipulées dans la convention qu'elle a sollicitée, n'a d'autre choix que d'y renoncer pour, ensuite, éventuellement effectuer une nouvelle demande afin d'obtenir une autorisation, dans la transparence et à égalité avec les autres candidats. C'est le seul moyen de passer d'une diffusion cryptée à une diffusion en clair en respectant les exigences du droit.
Encore une fois, le projet de loi apporte de vraies avancées face aux inquiétudes que fait naître la pénétration du marché audiovisuel par les opérateurs télécom et Internet. Nous ne voulons pas le voir invalidé. Vu son impact, une telle disposition mériterait d'être débattue dans le cadre de la grande loi audiovisuelle annoncée pour fin 2014.

Merci de vos voeux pour le succès de cette grande loi audiovisuelle ainsi que de vos conseils juridiques. Le Sénat s'attache toujours à sécuriser juridiquement les textes issus de l'Assemblée nationale.
Vous n'ignorez pas que certains soutiennent la position inverse de la vôtre. Il n'y a pas de vérité absolue, seul le juge constitutionnel peut trancher. D'autant que les positions sont réversibles : votre groupe juge parfois la souplesse du CSA salutaire, notamment en matière de radio... Dans un environnement mouvant, où les équilibres de marché et les techniques évoluent très vite, un CSA figé peut devenir un handicap. Attention à ne pas brandir des principes qui risquent ensuite de se retourner contre vous : les opérateurs du secteur ont besoin de souplesse pour pouvoir réagir aux évolutions techniques.
La procédure proposée par l'Assemblée nationale pour qu'une chaîne payante devienne gratuite n'est pas arbitraire : la décision du CSA devra s'appuyer sur des considérations objectives. Je déposerai d'ailleurs un amendement prévoyant la réalisation d'une étude d'impact préalable. Nous ferons d'autant plus confiance au CSA que nous garantirons son indépendance et professionnaliserons ses compétences. Vous pourrez défendre vos arguments devant lui. Je crois toutefois que NRJ a profité de la souplesse du CSA pour se développer, du moins dans le secteur de la radio : les radios acquises par votre groupe ont pu changer de catégorie sans appel à candidatures.
C'est l'article 42-3, alinéa 1 de la loi du 30 septembre 1986. En matière de radio, il s'agit d'un changement de catégorie administrative : le service demeure gratuit, il s'adresse toujours au même bassin de population, le mode de financement ne change pas.

En effet. Cela dit, comme les chaînes gratuites, la TNT payante s'adresse à l'ensemble du territoire.
Nous avons reçu nombre d'études juridiques, notamment de la part de Canal +. Les décisions devront absolument être prises en responsabilité, avec le souci de l'équilibre économique du secteur et de la préservation du pluralisme. C'est en responsabilisant le CSA que l'on garantira des décisions justes. Lui donner la possibilité de rendre des décisions rapides sera bénéfique à tout le secteur - vous compris. Cette mesure ne préjuge en rien de l'attribution de l'agrément à telle ou telle chaîne. Le Sénat prévoira l'encadrement nécessaire pour prévenir au maximum les risques de déstabilisation que vous avez exposés.
L'article permettant à une chaîne locale de se transformer en chaîne nationale à l'occasion de son passage en haute définition vous parait-il ambigu ?
Beaucoup de radios demandent que l'on revoie les seuils anti-concentration. Le seuil réglementaire est fixé à 150 millions d'auditeurs potentiels. Ça tombe bien, NRJ, le number one, serait à 149 millions !
Nous sommes à 125 millions.

Les chiffres sont contestés, tout comme la méthode de calcul ; en tout état de cause, vous frôlez la limite. Il faut encourager le CSA à mettre en place des méthodes de calcul incontestables.

Je précise que le seuil est calculé en retenant le bassin de réception, non l'audience cumulée. Faudrait-il plutôt retenir ce dernier critère, qui est employé pour la télévision ? Que pensez-vous de la situation de la radio numérique terrestre (RNT) ? Certains grands groupes sont accusés de chercher à freiner l'arrivée de concurrents. Enfin, les tarifs de diffusion de TéléDiffusion de France (TDF) sont jugés très élevés. Qu'en pensez-vous ?
L'amendement permettant aux chaines locales d'accéder au marché national n'appelle pas d'observation de notre part, dès lors que la procédure prévoit un appel à candidatures.
La question du seuil anti-concentration est une préoccupation majeure pour nous. Fin 2012, le CSA a lancé une concertation avec les acteurs. Le seuil est fixé par la loi, tandis que les modalités de calcul sont de la compétence du CSA, qui exerce cette mission de manière objective et transparente. Nous ne souhaitons donc pas qu'il en soit dessaisi, comme certains ont pu le demander. Le CSA demeure le meilleur des juges de paix.
Les seuils ont été mesurés en 2010 selon une première méthodologie en 2010 : NRJ était alors à 145 millions d'auditeurs potentiels. Le CSA s'est par la suite doté d'un outil de mesure plus performant, utilisé par l'Ofcom, le régulateur britannique, qui neutralise notamment l'effet du brouillage. En 2012, selon cette nouvelle méthode, la couverture de NRJ s'établissait à 121 millions.
Si le législateur souhaite conserver un mode de calcul assis sur le bassin de population, il faudrait, nous semble-t-il, indexer le seuil sur l'évolution naturelle de la population. En tout état de cause, nous souhaiterions que soit retenue la méthode la plus récente et la plus performante. Faut-il compter en part d'audience plutôt qu'en bassin de population ? Nous n'avons pas de religion en la matière, mais l'alignement sur la méthode utilisée pour la télévision aurait le mérite de la cohérence.
Le groupe NRJ compte en son sein le deuxième diffuseur, principal concurrent de TDF, l'opérateur historique captant tout de même 75 % du marché. Dans l'esprit des radios libres de 1981, NRJ a créé un petit diffuseur pour ne plus être dépendant du monopole d'État. C'est toujours la passion de notre métier, de la radio et de la télévision, qui nous guide ; nous y mettons tout notre coeur, toute notre âme, tous nos moyens.
Les prix de TDF varient selon que les sites sont réplicables ou non réplicables. Pour les sites non réplicables, comme la tour Eiffel, TDF applique des tarifs dissuasifs pour un opérateur alternatif : le petit diffuseur que nous sommes y perdrait de l'argent. L'ARCEP a été saisie de cette pratique anticoncurrentielle et un contentieux est actuellement en cours devant la cour d'appel de Paris.

J'en reviens à la TNT gratuite. L'arrivée de nouveaux concurrents peut déstabiliser le secteur, avez-vous dit en substance. Ces mêmes arguments étaient invoqués naguère pour contester les six nouveaux entrants - dont vous étiez ! Chacun défend avant tout ses intérêts propres, et ceux qui nous critiquaient hier nous soutiennent aujourd'hui...
Vous plaidez pour un appel à candidatures systématique. Dans les faits, la meilleure des garanties, c'est encore que le CSA prenne tous les paramètres en compte dans sa décision. Ce n'est pas parce qu'une chaîne n'a pas été candidate, à un moment donné, à la TNT gratuite qu'elle doit être condamnée à ne jamais pouvoir y accéder.
Un opérateur de la TNT payante peut se porter candidat pour la même chaîne en TNT gratuite sans renoncer à émettre en TNT payante. Si sa candidature est retenue, il pourra alors faire son choix entre les deux : le CSA l'admet.

Être candidat pour une chaîne gratuite tout en restant sur la TNT payante n'est pas un projet crédible ; il sera difficile de convaincre le CSA dans ces conditions. L'environnement, les technologies, l'écosystème changent, ce qui conduit à faire évoluer les projets. Le CSA doit pouvoir s'appuyer sur des études sérieuses - études d'impact, voire appels à contribution - sans pour autant entrer dans une procédure trop lourde.
Nous avons entendu vos préventions. Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?
Nous attendons les assises de la radio annoncées par la ministre.

En tant que président de la commission du Sénat pour le contrôle de l'application des lois, j'y suis sensible, car on ne peut laisser la loi sans application ! Il en va de la crédibilité du travail législatif.
La commission auditionne ensuite Mme Marie-Françoise Marais, présidente de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi), sur le projet de loi organique n° 815 et le projet de loi n° 816, adoptés par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatifs à l'indépendance de l'audiovisuel public.

Nous recevons la présidente de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) dans le cadre de la discussion des projets de loi sur l'indépendance de l'audiovisuel. Nous souhaitons en effet entendre les acteurs de ce secteur ; nous réfléchissons également aux propositions du rapport Lescure, parmi lesquelles figure le transfert des missions de l'Hadopi au CSA. La séparation absolue entre numérique et audiovisuel mérite en effet d'être interrogée. M. Schrameck nous citait un exemple montrant ce qu'une telle séparation peut avoir d'incongru : le CSA s'interrogeait ainsi sur l'autorisation de diffusion d'un clip alors que ce dernier avait déjà été vu un million de fois sur YouTube.
Comme la loi concerne le renforcement des compétences du CSA, nous devions vous entendre, madame, sur ces projets de loi ainsi que sur les pratiques que vous avez pu observer dans le cadre de votre mission.
Je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer devant la représentation nationale. Une spécificité de l'Hadopi tient à son mode de gouvernance caractérisé par une double présidence, en raison de l'autonomie de la commission de protection des droits. En seulement trois années, l'Hadopi est arrivée à maturité : en matière de protection des droits, la réponse graduée est montée en puissance ; l'encouragement de l'offre légale, en dépit d'outils limités, a bénéficié d'actions de sensibilisation au respect du droit d'auteur ; le protocole de sa mission d'observation a été révisé pour développer des connaissances spécifiques notamment en recherche informatique ; enfin, deux avis techniques qui font référence ont été rendus. L'Hadopi ne se limite pas à la réponse graduée, comme nous pourrons le souligner lors de la publication de notre rapport d'activité.
Le rapport Lescure est, de l'aveu même de son auteur et selon la ministre de la culture et de la communication, une première étape, un point de départ qui confirme la légitimité de nos missions et montre le travail de défrichage que nous avons engagé depuis trois ans. Les agents de l'Hadopi savent que les quatre années qui nous séparent de la loi ayant créé l'institution sont une éternité sur internet. Cela nous conduit à nous poser trois questions : quoi, comment, qui ?
Quoi, c'est-à-dire quel est le périmètre de l'action publique en ce domaine et plus largement concernant les modalités d'accès aux oeuvres ? Ne faudrait-il pas adopter une approche différente à cet égard ? Dans ce sens, nous avons commencé à modéliser un système de rémunération proportionnelle du partage, sous le pilotage d'Eric Walter. Les outils incitatifs juridiques et fiscaux méritent d'être modernisés.
Qui ? Il est légitime de se demander quel acteur public doit être chargé de ces missions rénovées. Comme l'a souligné la ministre, il convient de bâtir un équilibre global dans lequel la question institutionnelle va de pair avec les questions de fond. Admettons qu'il s'agisse de s'interroger sur un transfert, immédiat ou différé, de nos missions au CSA. Notre expérience nous amène à mettre en évidence une dissymétrie majeure entre la régulation de l'audiovisuel et celle d'internet : le périmètre, la cible, l'approche, le sujet et la méthode sont différents.
Ainsi, les contenus ne sont pas les mêmes : l'Hadopi est compétente non seulement sur le film et la musique, mais aussi pour la photographie, le logiciel, le jeu vidéo et le livre numérique, secteurs confrontés à des problématiques spécifiques et appelant un traitement différencié. Quant aux acteurs, l'audiovisuel est structuré autour d'un nombre limité d'acteurs identifiés et territorialisés, tandis que sur internet, tout citoyen peut être créateur ou diffuseur mais aussi, potentiellement, faire l'objet d'une sanction décidée par le juge. Nous refusons catégoriquement toute méthode intrusive, risquée et contraire à la nature du réseau, qui tient à sa neutralité. L'Hadopi a la responsabilité de faire respecter le droit d'auteur sur internet, et non pas de veiller à la qualité des contenus, au pluralisme politique ou à la bonne utilisation de la langue française. Internet n'est enfin pas soumis comme l'audiovisuel à un régime d'autorisation : au contraire, c'est la liberté qui est la règle et la contrainte l'exception.
Dès lors, mutualiser la régulation de ces deux secteurs peut présenter des complémentarités, des synergies, mais aussi des contradictions, des conflits d'intérêts, ou à tout le moins des difficultés. Ce n'est qu'après un examen approfondi de ces questions que la question institutionnelle pourra se poser. C'est lorsque le quoi et le comment auront trouvé des réponses modernisées que la question du qui se posera sous l'éclairage nécessaire.
Aujourd'hui, les enjeux de propriété intellectuelle et de protection des données personnelles se rapprochent. Une autorité dédiée au numérique telle que recommandée par le Commissariat général à la stratégie et à la prospective dans son étude « La dynamique d'internet » pourrait être envisagée. L'institution retenue devra avoir une expertise spécifique et une indépendance incontestable.
Les questions de gouvernance méritent elles aussi la plus grande attention : la gouvernance doit en effet répondre aux objectifs d'indépendance, de représentativité et d'expertise - notamment en matière de droit d'auteur - et d'impartialité vis-à-vis de tous les acteurs économiques de l'offre culturelle. Celle de l'Hadopi a été conçue dans ce but : son président est ainsi élu par le collège parmi les trois membres magistrats ou chargés de missions juridictionnelles. Un transfert au profit d'une institution n'offrant pas les mêmes garanties constituerait un recul. Or, sous la forte pression médiatique et face aux exigences renouvelées des internautes, toute suspicion doit être écartée.
La préservation de tous les emplois est une exigence qui ne saurait être ni une variable d'ajustement, ni un levier, ni un sujet de négociation. Ne pas reconnaître leur expertise serait un véritable gâchis. J'entends qu'ils pourraient se démobiliser ? En quarante ans de vie professionnelle je n'ai vu d'équipe si mobilisée ! Leur taux d'absentéisme est cinq fois inférieur au taux moyen constaté dans la fonction publique. Le risque de dispersion des compétences que ferait peser l'indétermination sur le sort de l'Hadopi pourrait être levé aisément si le gouvernement répondait aux sollicitations des représentants du personnel en annonçant ce que nous attendons depuis trois mois : la préservation de tous les emplois. La compétence d'agents dont on a hier vilipendé le travail ne peut servir de prétexte à un transfert précipité dont on ignore les contours : s'agirait-il de toutes les missions, comme l'envisage le rapporteur, ou la seule réponse graduée, comme a semblé l'affirmer la ministre - ce qui impliquerait que des emplois seraient détruits ?
J'entends que le piratage aurait massivement augmenté ? Il faut savoir distinguer les chiffres des fantasmes. L'évolution n'est ni massive ni irréversible. En trois ans, nous avons inversé dix ans de laisser-faire : ce n'est pas en quelques mois d'incertitude que l'évolution peut devenir irréversible. D'ailleurs, un transfert au CSA permettrait-il de l'endiguer ? Non. L'opinion ne retiendrait qu'une chose : l'Hadopi est supprimée. Or le dispositif de la réponse graduée repose largement sur sa notoriété. Le doute sur son avenir n'est d'ailleurs pas nouveau : elle est sous le coup d'un procès permanent en illégitimité, ce qui ne l'a jamais empêché de fonctionner.
J'entends que ce transfert serait source d'économies. Lesquelles ? Le premier poste de dépense est sa masse salariale : envisage-t-on de détruire des emplois ? Son loyer représente 2 % du budget annuel du CSA ; si ce dernier propose de nous héberger, nous étudierons volontiers sa proposition. Les grilles salariales n'ont pas été comparées, pas plus que les coûts de fonctionnement - qui pour l'Hadopi sont exceptionnellement bas ; le coût du transfert physique des installations n'a pas été évalué ; le cas des agents éventuellement en doublon n'a pas été étudié. Rappelons que le budget de l'Hadopi représente un millième de celui du ministère de la culture.
J'entends des appels en faveur d'une présence accrue dans les collèges et les lycées. C'est déjà le cas. En 2012 et 2013, nous avons sensibilisé les enseignants, documentalistes, chefs d'établissement, mais aussi les collégiens, les lycéens et les étudiants, qui se réjouissent d'avoir enfin un interlocuteur actif qui leur apporte des réponses précises.
J'entends enfin l'attachement de tous à l'indépendance. Celle-ci doit en effet être garantie par le contrôle démocratique. C'est pourquoi je me tiens à l'entière disposition du Parlement.
Les missions de l'Hadopi ne sont pas remises en cause, au contraire. Il revient aux pouvoirs publics de décider quels outils sont les plus à mêmes de servir ces deux objectifs, présents dans le même article de la Déclaration universelle des droits de l'homme : la défense de la propriété intellectuelle des créateurs et l'accès de chacun à la culture, qui constituent les deux faces d'une seule pièce.
L'Hadopi est la seule institution consacrée à la protection du droit d'auteur sur internet, ce qui suscite de l'intérêt à l'étranger - nul n'est prophète en son pays... Elle protège tous les droits d'auteur, et pas seulement la musique ou le film. Elle n'est pas en charge d'un secteur, mais de la création. Comme l'a indiqué le Conseil constitutionnel, « la compétence reconnue à l'Hadopi n'est pas limitée à une catégorie particulière de personnes, mais elle s'étend à la totalité de la population. » Quatre exigences de valeur constitutionnelle s'imposent à elle : la libre communication des pensées et des opinions, la propriété, la liberté d'entreprendre et enfin la protection de la vie privée et des données personnelles.
L'Hadopi telle qu'elle est répond à l'exigence de concilier tous ces objectifs. Son organisation garantit son indépendance, notamment à l'égard des ayants droit. Internet, cet espace de liberté, ne peut être soumis à un régime d'autorisation : tout ce qui n'est pas interdit y est autorisé. C'est pourquoi l'Hadopi n'a pas le pouvoir de sanction, et s'est prononcée très tôt en faveur de la plus grande prudence en matière de filtrage.
La situation n'en est pas pour autant satisfaisante. Il faut être plus ambitieux, comme le préconise Pierre Lescure. Il est nécessaire d'une part de compléter les outils existants concernant l'offre légale et les mesures techniques de protection (MTP), et d'autre part d'imaginer un dispositif de prévention de la contrefaçon commerciale impliquant tous les acteurs. Cette piste innovante est au centre de la mission que m'a confiée la ministre.
Toute institution en charge de ces missions rencontrerait, sans ces nouveaux outils, les mêmes limites - et les mêmes critiques - que celles que rencontre l'Hadopi.

Vos explications et votre plaidoyer ont été particulièrement complets. Vous défendez légitimement votre institution et vous répondez aux critiques qu'on lui adresse. Mais notre débat porte sur l'indépendance. Vos arguments en faveur de l'indépendance rejoignent ainsi ce que nous voulons pour le CSA. Ses membres seront en effet choisis en fonction de leur compétence et sans aucune considération politique, puisque le vote interviendra aux trois cinquièmes des suffrages des membres des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Au-delà du présent projet de loi, je considère d'ailleurs que les désignations d'autorités ou de personnalités indépendantes devraient toujours s'opérer de cette façon.
Que toutes les missions que vous décrivez et défendez nécessitent l'indépendance n'invalide pas leur transfert éventuel au CSA. Il ne s'agit pas de transposer les missions actuelles du CSA dans le champ d'internet ; il ne faut pas essayer d'effrayer le chaland en disant que les contenus d'internet seront surveillés ! Ce qui est envisagé, c'est le transfert des compétences actuelles de l'Hadopi, qui ne sont pas attentatoires aux libertés publiques, comme vous l'avez montré. Dans ce domaine, le décret a supprimé le seul élément, la coupure de l'accès à internet, qui semblait disproportionné au vu de ce qu'il est devenu aujourd'hui, aussi essentiel que l'air qu'on respire.
Au Sénat, nous nous sommes extirpés du débat manichéen qui a pu avoir lieu dans d'autres instances : je ne vois donc pas qui vise votre véhémence ; les seules réactions très dures que j'ai entendues à ce sujet s'opposaient à l'existence de votre mission et de votre institution. Je ne sais pas si vous nous avez communiqué une délibération de l'Hadopi ou si votre déclaration traduit une opinion personnelle. Si on est d'accord avec les conclusions du rapport Lescure, il faut certes se donner le temps d'arriver à un acte législatif global et à des solutions non législatives complémentaires.
En revanche, lorsque vous prétendez que tout va bien et que l'incertitude ne pèse pas sur le travail ni sur le moral, vous me surprenez. Tout ce que j'entends sur le sujet, sans le solliciter, démontrerait plutôt le contraire. Les autorités ont décidé de l'extinction de l'Hadopi et du transfert de ses missions. Comme cela ne se fait pas vite, cela pèse sur les personnels mais aussi sur l'autorité même de l'institution. Or tout est une question d'autorité dans ce domaine. Comme l'a dit la ministre, le plus vite sera le mieux. C'est la meilleure façon de ne pas laisser mourir ce que vous avez entrepris. Nous aurons plus tard d'autres débats sur l'acte II de l'exception culturelle et sur la globalité des équilibres nouveaux à rechercher dont parle M. Lescure. C'est en se fondant sur la réalité de votre mission, qui n'a pas été le flicage et la répression que d'aucuns ont décrits, qu'on se convainc qu'il faut procéder au transfert le plus vite possible, à partir du moment où cela a été arbitré.

Cette audition me donne une impression étrange. Si elle est l'occasion d'un exercice intéressant, qui est de faire le point sur l'action de l'Hadopi, elle donne lieu à un débat qui n'est pas lié au projet de loi dont vous êtes le rapporteur, mon cher collègue. En vous écoutant, je me suis demandé si je n'entendais pas plutôt un ministre exprimant la volonté du Gouvernement. Il existe un Parlement qui devra se prononcer sur les orientations qui ont été présentées. Nous sommes en train de débattre à la fois de l'indépendance du CSA et de ce qui doit advenir de l'Hadopi et de la défense du droit d'auteur, ce qui était l'objectif de la loi de 2009. Nous avions alors évité les guerres de tranchées : la première loi avait été adoptée à la quasi-unanimité au Sénat. Il n'y a pas ici des défenseurs du droit d'auteur qui veulent réserver la culture à ceux qui ont les moyens de se l'offrir, et des défenseurs de la culture pour tous qui veulent passer le droit d'auteur par-dessus bord. Nous avions concrétisé nos objectifs à travers l'Hadopi. Il y avait eu un débat sur la possibilité pour la justice de priver un internaute abusif d'accès à internet, certains y étant opposés, et d'autres, comme moi, craignant une moindre dissuasion si l'on émoussait cet instrument ultime. Mais tous étaient favorables à la pédagogie, à la réponse graduée, et à une sanction considérée comme un ultime argument.
Tant que l'Hadopi existe, il faut rappeler que la riposte graduée continue - l'on ne parle pas seulement de réponse... Nous partageons les mêmes objectifs, mais divergeons sur l'étage ultime. L'Hadopi a fait reculer le nombre des infractions. Répétons que nous ne cassons pas l'instrument sinon certains en déduiront qu'ils peuvent reprendre leurs vieilles habitudes. Ne serait-il pas plus raisonnable de considérer que l'Hadopi est destinée à durer ? Créée il y a 4 ans, elle s'est déjà adaptée à de nombreuses évolutions. Il est légitime de réfléchir à une modification des structures. Comme la ministre a indiqué qu'un autre texte interviendrait, utilisons ce temps pour déterminer le rôle que peut jouer l'Hadopi dans un autre dispositif. Ne refusons pas les évolutions, mais ne cassons pas l'instrument sans avoir déterminé comment atteindre l'objectif.

La question est la suivante : faut-il maintenir des structures séparées ou transférer les missions de l'Hadopi au CSA ? Comment ne pas se poser cette question dans une loi qui concerne le CSA, sa gouvernance, ses compétences ? L'opinion s'en est déjà saisie. On peut discuter du délai. Toutefois, j'ai le sentiment que bientôt il n'y aura plus de débat, tant la situation se détériore à un rythme inquiétant depuis le milieu de l'an passé. Ceux qui ont soutenu la création de l'Hadopi seront prompts à voir dans ce rapprochement un acte politique. À titre personnel, j'avais vu en cette instance un instrument en faveur de la protection du droit d'auteur et de la prévention. Il y a eu des résultats, mais la dégradation que l'on constate appelle une réponse.
Depuis le discours du Bourget, les agents de l'Hadopi connaissent l'intention du Président de la République de remplacer l'autorité. Avant cela, son prédécesseur avait indiqué sa volonté de passer à une Hadopi 3. Pourtant, depuis quatre ans, les agents, confrontés à une incertitude permanente, continuent à faire leur travail. Leur expertise est précieuse. Internet, c'est toute une culture : les Internet Protocol (IP) flottantes, dynamiques, les adresses Media Access Control (MAC), etc. Ils ont mis sur pied des missions qui ne sont pas mises en cause ; ils souhaitent que celles-ci se poursuivent.
La suppression d'une autorité administrative indépendante est-elle la seule solution ? Accepterions-nous au détour d'un débat ancré dans l'urgence la mort de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), comme le préconise un rapport parlementaire ? Sans doute pas ! Le CSA lui-même a évolué, héritier de la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL) et de la Haute autorité.
À côté de la greffe, il y a la fusion : créons une nouvelle autorité, comme on l'a fait en créant le Défenseur des droits. Ainsi l'ensemble des missions seraient préservées. Rien ne justifie une action dans l'urgence. Un simple transfert des missions n'apportera pas davantage de moyens au CSA pour les remplir que n'en a l'Hadopi. Nous sommes inquiets.

Vos interventions tranchent avec tout ce que j'avais entendu. J'en prends acte en me félicitant de l'utilité de nos auditions.