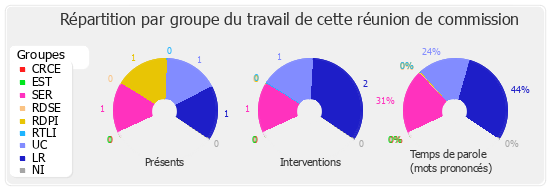Commission d'enquête menace terroriste après chute de l'Etat islamique
Réunion du 8 mars 2018 : 1ère réunion
Sommaire
- Audition de m. amin boutaghane chef de l'unité de coordination de la lutte anti-terroriste uclat au ministère de l'intérieur
- Audition de m. rémy heitz directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice (voir le dossier)
- Audition de mme myriam benraad professeure en science politique et chercheuse (voir le dossier)
La réunion
Cette audition s'est déroulée à huis clos. Le compte rendu ne sera pas publié.
Cette audition s'est déroulée à huis clos. Le compte rendu ne sera pas publié.

Notre commission d'enquête poursuit ses travaux avec l'audition de Mme Myriam Benraad, professeure en science politique à l'université de Leyde, aux Pays-Bas, et membre du Centre international de lutte contre le terrorisme à La Haye, ainsi que chercheuse associée à l'Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman, en association avec le CNRS et l'université d'Aix-Marseille.
Parmi vos domaines de recherche figurent les identités et communautés au Moyen-Orient, l'histoire et les recompositions sociopolitiques de l'Irak contemporain, ainsi que l'islam politique et les phénomènes de radicalisation dans les sociétés arabo-musulmanes.
Vous êtes l'auteure de plusieurs articles et ouvrages sur l'Irak, l'organisation État islamique et le djihadisme, dont, en janvier dernier, Jihad : des origines religieuses à l'idéologie. Idées reçues sur une notion controversée.
C'est en tant que politologue et chercheuse que notre commission d'enquête a souhaité vous entendre, afin que vous apportiez un éclairage intellectuel à ses travaux.
Nous vous avons adressé un questionnaire qui peut constituer le « fil conducteur » de votre intervention. Je vous propose de vous donner la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes, puis j'inviterai mes collègues, en commençant par notre rapporteure, Sylvie Goy-Chavent, à vous poser des questions.
Cette audition fera l'objet d'un compte rendu publié.
Enfin, je rappelle, pour la forme, qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du code pénal. Je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites : « Je le jure. ».
Vous avez la parole, Madame.
Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, Mme Myriam Benraad prête serment.
L'État islamique a perdu, en Irak et en Syrie, environ 95 % de son territoire. Le chapitre ouvert par la conquête triomphale de l'année 2014 se referme.
Le processus s'est accéléré avec la reprise de Ramadi, fin 2015, suivie de pertes territoriales massives en 2016 et 2017. Les acteurs locaux de part et d'autre de la frontière irako-syrienne doivent cependant, pour une très large part, leurs victoires à l'appui militaire de la coalition - ce qui pose, sur le long terme, la question de la reconstitution d'un appareil militaire viable pour consolider ces gains et éviter un retour des djihadistes.
Toutefois, la menace n'a pas disparu pour autant. Le discours est concentré sur l'État islamique, mais il existe d'autres factions djihadistes vers lesquelles certains combattants de celui-ci font désormais mouvement. Nous assistons ainsi, en Syrie, à une réaffirmation d'Al-Qaeda et de ses affiliés qui peuvent s'inscrivent dans une tendance djihadiste nationaliste, contre le régime de Bachar el-Assad, ou plus transnationale et tournée vers des attaques contre l'Occident. Il y a des effets d'oscillation, pour ces organisations, entre le terrain local et le djihad global, qui reste une menace de long terme. Le repli de l'État islamique ne signifie pas que la France est sortie des radars djihadistes ; au contraire, ces derniers rappellent régulièrement que notre pays reste un ennemi viscéral.
Sur le terrain, l'État islamique est revenu à la guérilla et à la clandestinité, lançant des opérations contre les armées et les institutions qui symbolisent le retour de l'État. Les civils sont moins visés. En Irak, des zones jusqu'à présent épargnées sont touchées, comme le Sud. Autour de Bassora, les djihadistes ont fait la preuve, avec des embuscades et des incidents armés, de leur capacité à se redéployer à la faveur des absences ou des dysfonctionnements de l'État, y compris dans des zones où ils n'étaient pas présents. Rappelons qu'en 2014, la prise de Mossoul par l'État islamique a été rendue possible par la défaillance de l'armée et de l'administration locale. En Syrie, nous sommes dans une situation de guerre civile, très confuse, ou un grand nombre de groupes de tendances différentes se réclament du djihad.
D'autres foyers de djihadisme ont émergé. En Libye, la perte de Syrte par l'État islamique en décembre 2016 a conduit à son redéploiement en plusieurs centaines de cellules disséminées sur l'ensemble du territoire. En Égypte, l'armée a déclenché une offensive contre les groupes actifs au Sinaï, même si la présence djihadiste dans cette région est une réalité depuis des décennies.
Toutes ces zones sont travaillées depuis longtemps par le djihadisme qui a attiré une partie de la jeunesse du fait de la défaillance de l'État et d'un environnement de désocialisation. Je procède ici à une analyse institutionnaliste de ce phénomène qui se nourrit du vide sidéral provoqué par le manque d'État et d'institutions. C'est la demande d'État des populations qui explique pourquoi elles ont pu, dans certains cas, jouer le jeu des djihadistes qui promettaient un retour de l'ordre et une restauration des fonctions régaliennes. C'est vrai en Irak comme en Libye.
La menace doit être analysée à la lumière des spécificités nationales, sur la base d'une connaissance approfondie des dynamiques locales : il est difficile de comparer l'Irak à la Syrie, où les situations sont très spécifiques.
Fait notable : le retour de l'Afghanistan dans le discours djihadiste. L'État islamique a publié, le 4 mars, une vidéo appelant les musulmans à la hijra, c'est-à-dire à la migration vers ce pays, appelé Khorasan - sa dénomination médiévale - dans la vidéo, pour le replacer au coeur de la menace transnationale. Bien que l'Afghanistan soit sorti du champ de visibilité des populations occidentales, rien n'a véritablement été résolu : il subsiste un paysage insurgé très morcelé, avec des factions qui se font la guerre. On assiste à un morcellement analogue en Syrie, où une myriade d'organisations font face aux acteurs dits loyalistes, appuyés par la coalition irano-russe. Dans la Ghouta orientale, il est difficile de nommer et de caractériser les acteurs. Les sociétés s'effondrent, les territoires se fragmentent et les populations civiles sont livrées à elles-mêmes.
Sans alarmisme excessif, la menace subsiste d'autant que les crises se poursuivent, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, voisine d'un Sahel en phase de déstabilisation avancée. Les facteurs structurels de la radicalisation djihadiste demeurent.
En Irak, comment arracher les combattants et leurs familles à l'idéologie panislamiste pour les ramener à la vie civile ? Faut-il une amnistie, voire une intégration dans l'appareil militaire et sécuritaire ? Voilà les questions à résoudre.
Il n'y a pas de profil type des militants partis faire le djihad - dont, je le rappelle, le départ est pour une large part antérieur à l'entrée en guerre de la France contre l'État islamique. Ce sont des individus très différents, happés par un discours susceptible de séduire un large public. C'est sur ce point qu'il faut lancer une action de long terme, en déconstruisant l'idéologie, en en montrant les limites, en la délégitimant en profondeur. Les déçus de l'expérience du « califat » sont désormais nombreux, mais le discours demeure séduisant et mobilisateur.
Les motivations de ceux qui sont partis sont très diverses. Elles peuvent être identitaires, avec une surdétermination de l'identité religieuse. Elles peuvent relever de l'utopie, de l'aventurisme ou d'une aspiration anti-système. Dans le contexte français, la rhétorique de l'État islamique s'est télescopée avec des questions qui travaillaient la société française depuis très longtemps ; elle a su faire écho aux griefs, aux frustrations et aux questionnements qui s'exprimaient depuis parfois des décennies. C'est Internet qui a facilité notamment la rencontre de ces maux anciens et du discours djihadiste. De jeunes Français ont vu dans le discours de l'État islamique une réponse à leurs aspirations en termes d'égalité et de justice sociale.
J'ai favorablement accueilli le nouveau plan contre la radicalisation présenté par le Gouvernement, en particulier les mesures en matière d'éducation. Le djihadisme est un phénomène générationnel, c'est pourquoi cette question est cruciale. Beaucoup de professeurs se sont adressés à moi depuis les attentats de 2015 parce qu'ils n'ont pas les outils pour répondre aux élèves radicalisés. Ils se demandent comment reconstruire du lien, du sens, comment faire sortir ces élèves de cette représentation biaisée du monde et de l'autre. J'irais même plus loin : il faudrait un cours ou une tranche de scolarité spécifiquement consacrés à cette question pour sensibiliser directement les jeunes. Les campagnes comme Stop-Djihadisme sont bienvenues, mais elles ne suffisent pas. Il faut sensibiliser les jeunes plus directement.
Je ne crois pas qu'il existe des loups solitaires dans le djihadisme. Au minimum, les combattants sont équipés d'une idéologie en libreservice, sur la Toile. Les prisons ont aussi été un haut lieu de rencontres et de radicalisations. Que faire des détenus radicalisés après la détention ? Les Pays-Bas, où je vis aujourd'hui, et le Danemark ont anticipé cette question de la réintégration. N'attendons pas la libération de ces détenus pour préparer l'après.

Je vous remercie. Les services de l'État ont expliqué à notre commission qu'ils n'entretenaient aucun contact avec le gouvernement syrien. Cela nous interdit d'obtenir des chiffres sur les djihadistes français détenus par le régime, ou éventuellement en liberté. Quid des rebelles de la Ghouta orientale ? Comptent-ils des Français dans leurs rangs ? À la lumière de vos recherches, quel est le lien entre djihadisme et salafisme ?
Les Kurdes de Syrie ont au moins une dizaine de djihadistes entre leurs mains. Les cas de Thomas Barnouin et d'Émilie König ont été très médiatisés. La politique des Kurdes vis-à-vis de leurs prisonniers est indissociable des dynamiques du conflit, alors qu'ils sont attaqués par la Turquie et que leurs relations avec les Américains sont de plus en plus sensibles. Pour ces raisons, il est difficile d'avoir des informations fiables. Nous en savons davantage sur les volontaires internationaux qui ont rejoint les Forces démocratiques syriennes ou les Unités de protection du peuple (YPG) kurdes.
Certains Français avaient rejoint, au début du conflit syrien, l'organisation Jabhat al-Nosra qui constituait alors le noyau dur d'Al-Qaïda en Syrie. Ils sont ensuite passés dans les rangs de l'État islamique et l'on peut supposer qu'ils ont rejoint, après la mise en difficulté de celui-ci, d'autres factions- ainsi Hay'at Tahrir al-Cham, sans doute un sous-produit d'Al-Qaïda bien que l'organisation préfère mettre l'accent sur son caractère nationaliste, syrien. D'autres, enfin, sont sortis de la zone syro-irakienne pour rejoindre des pays comme l'Afghanistan ou la Libye. Il y a une importante fluidité.
Les services de renseignement ont perdu la trace d'un certain nombre de djihadistes.
Ou ont été exfiltrés. Ou ont réussi à se redéployer. Entre 150 et 500 sont encore sur zone, d'après les estimations - qui ne sauraient être définitives.
On accorde en France une attention un peu excessive aux revenants, au détriment de ceux que j'appellerais les résidents. La France compte plusieurs milliers de radicalisés prêts à passer à l'acte car leurs convictions sont parfois plus solides que ceux qui sont effectivement partis sur zone et ont vécu le conflit dans leur chair. N'ayant pas fait l'expérience de la guerre, ces résidents restent activables à tout moment, si j'ose dire. Sans compter que les attentats qui ont suivi ceux de Charlie Hebdo étaient préparés à domicile.
Le salafisme désigne plusieurs tendances, dont certaines se combattent. Les quiétistes prônent un retour à un islam des origines, un islam purifié - le salaf est le pieux prédécesseur, le musulman mythifié qui sert de référence. Opposés à la violence, ils s'opposent aux djihadistes. Mais le salafisme, qu'il débouche ou non sur l'action violente, reste une rupture d'avec notre modèle de société, avec la communauté nationale, avec nos valeurs républicaines. Le passage à l'acte violent des personnes d'abord séduites par le salafisme est beaucoup plus probable que celui des personnes qui n'y ont pas succombé.
Le salafisme est une forme d'acculturation, même pour les jeunes qui ont grandi dans un milieu musulman traditionnel. Il suppose aussi une rupture d'avec la communauté familiale. Le témoignage des parents de djihadistes est souvent très éclairant : ces derniers rejettent la mosquée fréquentée par les parents, ils se réfèrent aux contenus radicaux diffusés sur Internet... Ceux qui ne sont pas tombés dans le salafisme en ont été empêchés par une tradition familiale forte. Chez les convertis, en revanche, la tentation salafiste est décuplée. On s'étonne toujours de trouver des Bretons décidant d'aller faire le djihad, mais cela s'explique par un désir de rupture qui ne se heurte à aucune barrière. Bref, le salafisme est un courant de rupture qui peut mobiliser des potentialités violentes.

Le djihadisme semble être un phénomène générationnel : on voit peu de combattants de plus de soixante ans partir en Syrie ou en Irak... Les fondements sociologiques dont vous parliez, telle la lutte des classes, peuvent pourtant parler à tous : comment expliquer que seuls les jeunes partent ?
Des personnes plus âgées ont aussi rejoint les groupes terroristes sur place, mais l'on en parle moins. Beaucoup de ceux qui ont rejoint l'État islamique ignoraient ce qu'ils trouveraient sur le terrain. Les jeunes, c'est vrai, ont davantage été tentés. Je l'explique essentiellement par la force de la propagande numérique et des réseaux sociaux, qui ont promu l'utopie, l'aventure, l'amusement, voire désigné le califat comme un eldorado ou un terrain de distraction. On parle souvent de sous-culture ; je le réfute : le « djihadisme 2.0. » s'est fondu dans la culture dominante, tout en élargissant ses perspectives par une communication multilingue. Jusqu'au début des années 2000 en effet, la propagande djihadiste n'était véhiculée qu'en arabe, et en arabe classique encore ; elle a ensuite été rendue accessible à tous et s'est déployée en détournant notamment les symboles de la culture jeune pour se rendre séduisante. Dès lors, elle n'était plus une sous-culture au sens propre du terme. Tout cela s'est greffé sur un environnement géopolitique particulier, celui des crises irakienne, syrienne et libyenne, qui ont beaucoup catalysé les flux de recrutement.

N'est-ce pas une base très cultivée qui a créé ce système de recrutement de jeunes ?
La propagande peut se mesurer qualitativement et quantitativement. Un certain nombre de responsables médiatiques du califat ont été touchés, mais ils restent très forts techniquement. Ce sont de véritables geeks ! La propagande joue à présent sur la nostalgie du califat, qu'aucun groupe djihadiste n'était jusqu'alors parvenu à recréer, et fleurit grâce à tout un réseau de partisans. C'est pourquoi l'attention mériterait d'être portée sur les résidents qui alimentent cette nostalgie et pourraient en faire le carburant d'un passage à l'acte violent.

Vous recommandez de ne pas se focaliser sur les revenants, mais la rencontre des revenants et des résidents ne peut-elle pas être explosive ?
La probabilité qu'ils se rencontrent est faible. Sauf en prison...
surveillée, certes. La prison reste le principal danger. Je ne suis ainsi pas convaincue qu'il faille les y rassembler, mais la perspective de placer les revenus du djihad parmi les détenus de droit commun ne m'enthousiasme pas non plus. Les acteurs du système carcéral disent observer des phénomènes de désembrigadement et obtenir des progrès par le contact et le dialogue. Cela ne dispense toutefois pas de faire de la prévention. Comment faire sortir de l'idéologie djihadiste ceux qui s'y sont enfermés ? Voilà l'enjeu. Mon dernier ouvrage procède par exemple à une analyse sémantique du mot « mécréant », que certains détenus utilisent largement, bien qu'ils ne l'aient manifestement pas compris - de même que le califat historique n'est pas ce qu'ils pensent. Je crois au dialogue avec les personnes compétentes pour montrer aux radicalisés que l'idéologie djihadiste est une aberration. Le personnel existe pour de telles actions, mais il est parfois menacé ou a peur d'intervenir.

Vous dites que l'attirance pour le salafisme est une forme de modernité. N'est-ce pas paradoxal ? L'islam, comme le christianisme, est en outre un ensemble très divers, sur lequel nous gagnerions à faire de la pédagogie. Vous évoquiez d'ailleurs les émissions du service public : que faire sur le terrain de l'information ? A-t-elle seulement un impact sur les djihadistes ? Peut-on améliorer l'information sur l'islam et la culture musulmane pour freiner l'embrigadement ?
Il y a globalement un problème de compréhension de certains termes par les jeunes qui sont happés par une phraséologie qui a peu à voir avec la tradition musulmane. Or ces mots influencent leurs rapports aux autres. Il y va de la cohésion nationale et de leur place dans la République. C'était le cas en particulier des jeunes qui ont assassiné le père Hamel, et c'est ce qui a motivé mon dernier livre. Le constat de leur mécompréhension de certains termes est effrayant, et le discours répandu selon lequel on ne peut rien faire contre la propagande numérique me scandalise particulièrement.
Le salafisme est en effet une expression très moderne, voire hypermoderne puisque c'est une réinvention de la tradition. Le port de la burqa, par exemple, n'a jamais été une tradition des sociétés musulmanes. C'est pourquoi l'État islamique a investi autant dans la zone grise que dessinent les sympathisants du djihad. Heureusement, les mosquées salafistes sont progressivement fermées.