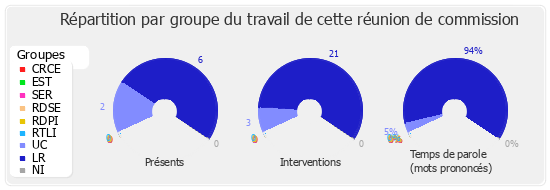Commission d'enquête état des forces de sécurité intérieure
Réunion du 16 mai 2018 à 14h20
Sommaire
- Table ronde d'organisations syndicales des surveillants pénitentiaires (voir le dossier)
- Audition de mm. michel delpuech préfet de police de paris thibaut sartre préfet secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police de paris frédéric dupuch directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne christian sainte directeur régional de la police judiciaire éric belleut directeur adjoint de l'ordre public et de la circulation philippe dalvavie conseiller technique chargé des affaires juridiques lucas demurger conseiller technique chargé de la prospective au cabinet du préfet denis safran conseiller technique professeur agrégé de médecine chargé des questions de santé en matière de sécurité intérieure (voir le dossier)
La réunion

Notre commission d'enquête poursuit ses travaux avec l'audition des représentants des syndicats des surveillants pénitentiaires.
Notre commission d'enquête s'efforce d'analyser les différents aspects de l'actuel sentiment de malaise qui semble régner au sein des forces de sécurité intérieure, d'en comprendre les causes et de proposer des pistes d'amélioration.
Les auditions des personnels de la police et de la gendarmerie nationale que nous avons menées nous ont permis de constater que, malgré les réformes récentes, certaines difficultés persistent au sujet de la répartition des missions entre les forces de l'ordre et les surveillants pénitentiaires. Ces difficultés concernent les transfèrements mais aussi le maintien de l'ordre au sein des établissements ou aux abords de ceux-ci. Il existe en outre actuellement un malaise propre au monde pénitentiaire, que vous pourrez également évoquer.
Cette audition est ouverte à la presse et sera diffusée en direct sur le site Internet du Sénat. Elle fera également l'objet d'un compte rendu publié. Je rappelle, pour la forme, qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du code pénal.
Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, prêtent serment
Je passe à présent la parole au rapporteur.

Les blocages de plusieurs centres pénitenciers au mois de janvier ont révélé l'existence d'un malaise profond parmi les personnels pénitentiaires. Pourriez-vous, brièvement, nous indiquer les principales causes de ce malaise ? Les mesures annoncées par le Gouvernement dans le cadre de l'accord signé avec les syndicats vous paraissent-elles à la hauteur des enjeux ? La création de cette commission d'enquête a été impulsée par la vague de suicides au sein de la police et de la gendarmerie nationales à l'automne dernier. L'administration pénitentiaire est-elle également confrontée à ce phénomène ? Quels sont les dispositifs de prise en charge des risques psycho-sociaux au sein de l'administration pénitentiaire ? Estimez-vous qu'il existe des insuffisances dans ce domaine ? L'administration pénitentiaire fait face à des difficultés importantes de recrutement, notamment s'agissant du corps des surveillants pénitentiaires. Comment améliorer, selon vous, l'attractivité de la profession ? Les forces de sécurité intérieure revendiquent, depuis des années, la suppression des tâches indues, parmi lesquelles la prise en charge des extractions judiciaires. Quelle est votre position sur le sujet ? Plus généralement, estimez-vous nécessaire, compte tenu du niveau d'insécurité de certaines prisons, de recevoir l'appui des forces de sécurité intérieure pour mener à bien vos missions ? La formation initiale et continue vous parait-elle adaptée dans l'administration pénitentiaire ? Quelles seraient pour vous les voies d'amélioration ?
Le malaise n'est pas nouveau. L'élément déclencheur a été une agression au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil dans le Nord, dans une maison centrale ultra-sécuritaire, par un détenu radicalisé, sur quatre collègues. La mobilisation a pris une ampleur régionale puis nationale. Les organisations syndicales se sont mobilisées autour de ce cas. Malheureusement il y a eu un effet de contagion avec des faits similaires à Mont-de-Marsan, et à Borgo où deux collègues ont reçu 31 coups de couteaux. Nous sommes en recherche de reconnaissance, ce qui passe par le statut : nous souhaitons la « parité-police » en ce qui concerne notamment la rémunération. Notre grille indiciaire, si on enlève la prime de sujétion de 26 %, est de 1 200 euros en début de carrière, après les huit mois (bientôt six !) de formation. Soit 1 450 euros net par mois avec la prime. Il y a les heures supplémentaires obligatoires, 40 ou 50 heures par mois : c'est seulement ainsi qu'on arrive à un salaire décent. C'est aussi une façon d'inciter les jeunes fonctionnaires. Un jeune de 20-22 ans qui vient de province avec 2 000 euros par mois pour travailler à Paris avec les dépenses que cela implique, va être en difficulté.
En 1958 déjà, les surveillants exprimaient des revendications : on leur a accordé la prime de sujétion mais on les a privés du droit de grève. Aujourd'hui les surveillants restent de simple « porte-clefs », or la population pénale n'est plus la même ! La méthode de gestion des tensions n'a pas changé. Le boulot ne donne pas envie !

Quand vous êtes victimes d'agression, comment cela est-il traité ? L'administration vous encourage-t-elle à porter plainte et vous assiste-t-elle ?
Quand nous sommes agressés, nous sommes considérés comme dépositaires de l'autorité publique. L'administration ne nous assiste pas. Il y peu de suivi de l'administration. On peut aussi parler de la sécurité. L'architecture, la gestion ne sont pas adaptées. Sur certaines maisons d'arrêt il y a 200 % de surpopulation avec des détenus de genre très différents mélangés. Les conditions de détention du détenu, ce sont celles du surveillant ! Selon les Gouvernement, les propositions d'évolution du parc immobilier changent de plusieurs dizaines de milliers de places. Il y a un vrai besoin.
Cela fait 25 ans que la pénitentiaire n'avait pas été aussi révoltée. Il y a un raz-le-bol sur la violence. Nous sommes confrontés depuis plus de trois ans au terrorisme sans y être préparés. En septembre 2016 un collègue a été lâchement attaqué à la maison d'Osny par un homme qui lui a perforé la gorge avec une lame. Aujourd'hui ça continue, les agressions se poursuivent malgré l'accord qui a été signé.

Sur les agressions, que proposez-vous ? Des nouvelles constructions ont été annoncés, mais pour le reste que préconisez-vous ?
Nous demandons qu'on remette de la sécurité dans les prisons. Dans les maisons d'arrêt surpeuplées, il faut occuper les détenus en permanence. Quand il y a trois détenus ou quatre au lieu d'un dans une cellule, c'est générateur d'agression. Les équipes locales d'appui et de contrôle prévues de longue date ne sont pas en place dans tous les établissements. Nous demandons que ce qui avait été prévu il y a deux ans soit appliqué.
L'ancien directeur de l'administration pénitentiaire avait demandé la création de 20 équipes locales d'appui et de contrôle dotées chacune de 7 ETP. Aujourd'hui seuls 6 ou 7 sont déployées, qui plus est prélevées sur les autres personnels. Elles n'ont pas de prérogatives judiciaires. Il y deux ans une instruction a permis aux surveillants d'intervenir sur les abords des établissements pénitentiaires avec un fusil à pompe pour appréhender les individus tentant de projeter des objets dans l'établissement et les maintenir en « garde à vue » le temps de contacter un OPJ pour qu'il prenne le relais. Mais dans les faits c'est impossible : pas de formation, pas de locaux spécifiques en dehors de l'établissement.
Nous nous considérons comme membres des forces de sécurité intérieure. L'élément déclencheur du mouvement de janvier 2018 est effectivement l'agression de Vendin-le-Vieil. Le fait que le détenu soit un condamné pour terrorisme a un peu occulté le caractère général du problème. C'est la goutte de sang de trop. En 1992, deux collègues avaient perdu la vie et il y avait eu un mouvement très dur. Ce qui nous motive ce n'est pas les revendications statutaires, c'est de pouvoir exercer les missions dans de bonnes conditions de sécurité. Depuis des dizaines d'années, quels que soient les gouvernements, personne ne s'intéresse à la question pénitentiaire. Il s'agit juste de mettre quelqu'un derrière quatre murs puis on se moque de ce qui se passe, de savoir si les personnels ont les moyens de faire face. Or la personne va ressortir et ce n'est pas pris en compte. Si la sécurité des surveillants n'est pas assurée, la mission de réinsertion ne risque pas de l'être.

Comment, à l'intérieur de la prison, sont gérés les détenus qui présentent des problèmes psychiatriques ? Avez-vous les moyens de gérer cela, ainsi que la réinsertion ?

Vous avez souligné l'évolution de la population carcérale, en particulier avec la radicalisation. Quelle est votre relation avec les détenus, quel est l'impact de ces relations sur les surveillants, en terme de risques psycho-sociaux ?
Concernant le suivi psychologique des personnes ayant commis des agressions sexuelles, je considère qu'il n'y a pas de moyens et de personnels suffisants pour réaliser un vrai suivi. Les détenus ont tous les moyens en détention pour visualiser des vidéos pornographiques. Ils ont le droit à un ordinateur qui permet de lire des vidéos. En théorie il y a un blocage mais dans la prison il y a beaucoup de théorie.

Est-ce que le fait de pouvoir consulter sur internet des vidéos pédophiles ou djihadistes est l'exception ou la règle ? On sait que les smartphones sont répandus...
Les brouilleurs nécessaires ne sont pas présents. Un test va être fait au deuxième semestre 2018 à la prison d'Osny mais cela va aussi brouiller le wifi, d'où un problème pour les personnels... Dans la prison du centre-ville de Melun, la 4G fonctionne parfaitement. Nous ne pouvons pas garantir qu'il n'y a pas de portables faute de pouvoir correctement fouiller.
Au nom d'une certaine paix sociale, certains établissements pénitentiaires permettent aux détenus d'acheter des CD avec des images et des films pornographiques.

Le législateur a permis à l'administration pénitentiaire de se doter d'IMSI-catchers. Yen a-t-il dans les établissements ?
On sait qu'il y a eu des tests, mais on ne sait pas où ni quand. 31 000 téléphones ont été saisis en 2015 dans les prisons françaises, 33 000 en 2016, 40 000 en 2017 : le phénomène n'est pas nouveau. Les téléphones installés légalement dans les établissements n'intéressent pas les détenus : on est censés, nous surveillants, les écouter... Le projet de Mme Belloubet d'installer un téléphone dans chaque cellule ne les intéressera pas plus car là aussi nous devrons les contrôler. Si nous pouvions exercer un tel contrôle, nous n'aurions pas eu comme ce matin l'évasion d'un détenu fiché S à Brest pendant une extraction médicale.
Il n'y a qu'un IMSI-catcher qui ait été acheté, mais il n'est pas utilisé car les techniciens ne sont pas formés ; en outre cela a des effets sur la santé des utilisateurs. Tout comme les brouilleurs : il ne s'agit jusqu'à présent que d'un brouillage temporaire et partiel pour ne pas exposer les personnes : c'est l'application du principe de précaution. En outre les brouilleurs ont aussi des effets sur les habitations des alentours.
Les articles 57-1 et 57-2 de la loi pénitentiaires empêchent les fouilles corporelles systématiques. Une mission parlementaire de l'Assemblée nationale est lancée depuis avril sur ce sujet. Il n'y a pas que les téléphones portables, il y a aussi la drogue, les armes blanches voire les armes lourdes qui entrent dans nos prisons. Récemment une arme a été retrouvée dans un sac de linge. Nous réclamons que dès qu'il y a contact avec l'extérieur, il puisse y avoir fouille. Nous n'avons évidemment aucun plaisir à fouiller un détenu à nu. Mais les moyens technologiques ne sont pas efficaces. Si nous ne pouvons pas fouiller les détenus, il faut que les familles passent par des portiques comme dans certains aéroports.
Aujourd'hui, on trouve plein de portables, qui sont utilisés à toutes sortes de fin. En Martinique, un détenu a même commandité un meurtre de la prison avec son portable.
Il faut certes plus de places de prison, mais depuis 20 ans on ne fait que créer des places de prison sans réfléchir. Je fais partie des surveillants du plan Chalandon, qui était censé résorber la surpopulation. Il faut réfléchir à quel type de places de prison nous voulons, mais à la façon dont on gère les différentes populations de la prison. Les Canadiens ont des prisons très « light » et des prisons très sécuritaires avec très peu de places pour les détenus les plus dangereux. On ne tend pas vers cela ! On a aboli la peine de mort en 1981 mais on n'a pas lancé de réflexion sur l'échelle des peines. Par ailleurs, il a été décidé pour des raisons économiques de pénaliser la démence mentale, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a énormément de problèmes psychiatriques en prison. Nous avons obtenu le développement des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA), mais cela ne suffit pas. La maison centrale de Château-Thierry a un savoir-faire qui mérite d'être exploité.
Nous avons également des centres médico-psychologiques régionaux (CMPR), mais le problème est le même : il est impossible d'affecter un détenu au sein de ces centres sans accord du détenu. Le législateur doit corriger cette erreur. Nous avons besoin de développer les CMPR tout comme les UHSA.
Plus généralement, nous revendiquons qu'une réforme pénale vienne donner un cadre juridique clair pour la prise en charge des détenus présentant des problèmes psychiatriques. Il faut sortir ces détenus des prisons pour les confier aux centres qui ont les compétences nécessaires pour les prendre en charge. Depuis des années, nous n'affrontons pas les problèmes.
Créer 35 ou 40 000 places supplémentaires dans les établissements pénitentiaires ne règlerait rien. Cela fait 20 ans que nous créons des places de prisons, mais sans jamais réfléchir au modèle d'incarcération.

En création nette, il n'y a pas eu tant de places de créées, car les prisons ouvertes n'ont parfois fait que compenser les pertes engendrées par des fermetures d'établissements.
Il nous manque bien sûr des places, des moyens, des effectifs, des outils législatifs et réglementaires, mais ce qui fait défaut, c'est surtout la cohérence de la politique carcérale. Notre système est fondé sur un enfermement non définitif et orienté vers la réinsertion. Pour cela, il nous faut des moyens et des effectifs, mais cela ne sera pas suffisant.
S'ajoute à ces difficultés un phénomène nouveau pour le monde carcéral : le terrorisme. Les projets se succèdent, au gré des différents drames, mais aucun ne va dans la bonne direction ; l'administration fait le contraire de ce que nous proposons.
Enfin, une des difficultés du système carcéral français est liée au fait que l'on gère à la fois des prévenus et des condamnés. Trouvez-vous normal qu'en France les prévenus aient moins de droits que les condamnés ?
Les conditions de travail découlent de tout ça : le manque de moyens et d'effectifs, l'insuffisance de réglementation, etc.
Il faut de l'autorité avant tout. Le détenu est théoriquement à disposition de l'administration pénitentiaire et doit répondre à certaines obligations, à l'égard de soi-même, à l'égard de ce qu'il doit à la société et à l'égard des victimes. Sur ces trois faisceaux, on ne travaille malheureusement que très peu.

Que se passe-t-il actuellement quand un détenu ne respecte pas les règles ?
Pas grand-chose malheureusement. Dans la plupart des établissements pénitentiaires, les infractions commises par les détenus ne sont pas traitées en temps utiles, car il y a une embolisation totale.
La loi pénitentiaire de 2009 ne prévoit aucune obligation pour les détenus de travailler ou d'avoir une activité. En revanche, l'administration pénitentiaire a elle l'obligation de propose une activité et un plan de réinsertion aux détenus. Ne serait-ce pas plutôt au détenu de s'investir dans son projet de réinsertion ?

J'attendais une réponse plus précise sur les agressions. Êtes-vous réellement incités à déposer plainte ou au contraire subissez-vous des pressions ?
Nos collègues hésitent souvent à déposer plainte, car ils craignent les représailles pour leurs familles. Il y a un manque d'accompagnement de l'administration pénitentiaire dans le dépôt de plainte et un manque de soutien psychologique. En l'absence d'accompagnement par les représentants syndicaux, cela ne se fait pas. Près de 10 % de nos collègues quittent l'administration pénitentiaire.
Un surveillant pénitentiaire a un uniforme, pas une armure.
En 2012, au centre pénitentiaire de Fresne, une jeune surveillante a été agressée. Sa hiérarchie l'a interrogée sur ce qu'elle avait fait au détenu. Elle s'est suicidée. L'administration met en cause les personnels dans l'exercice de leurs missions, au quotidien.
Une étude démontre que l'administration pénitentiaire présente le plus important taux de suicide parmi ses fonctionnaires.

J'ai été frappé, dans votre discours, par la manière dont vous opposez la théorie et la pratique. La défaillance du système semble être la norme. J'aurais trois questions à vous poser.
En premier lieu, le principal problème réside-t-il pour vous plutôt dans un manque de moyens ou d'effectifs ou dans des insuffisances juridiques ? Que proposez-vous concrètement pour améliorer les procédures ?
En deuxième lieu, que répond votre hiérarchie face à ces difficultés ?
Enfin, quelle est la réaction des juges d'application des peines lorsque vous évoquez les difficultés que vous soulevez ?

Pourriez-vous nous faire parvenir, par écrit, un inventaire des difficultés que vous soulevez et de vos propositions ?
Je souhaiterais répondre à Mme Raimond-Pavero. Comme ma l'a indiqué il y a quelques années un chef d'établissement, l'administration pénitentiaire est devenue aujourd'hui un service public, et le détenu un usager de service public. Nous n'avons clairement pas la même perception.
Trouver des solutions à ces difficultés, c'est à la fois un choix sociétal et un choix politique. Nous devons nous interroger sur l'utilité de la prison dans notre société, car aujourd'hui elle ne fait plus peur.

Je suis frappé par le fait que la cellule de prison puisse, comme on l'entend parfois, être considérée comme un lieu d'habitation. Cela implique qu'on ne puisse s'y livrer à certaines pratiques, et cela aura notamment impact pour le renseignement pénitentiaire.
Aucun texte législatif ne fait de la prison un lieu d'habitation. En revanche, il est prévu qu'un coffre soit mis à disposition de tout détenu pour qu'il puisse conserver ses effets personnels. La cellule n'est donc pas un lieu d'habitation, même s'il s'agit d'un débat récurrent.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous refusons la judiciarisation de nos missions et le statut d'OPJ, car cela nous ferait dépendre du parquet. Nous ne pouvons à la fois faire du réglementaire et du judiciaire.
Nos dispositifs disciplinaires sont d'ores et déjà embolisés. Que serait-ce si les procédures disciplinaires donnaient lieu à des procédures judiciaires ? Cela impliquerait en outre que les fouilles ne puissent pas être réalisées sans la présence de l'autorité judiciaire.
Pour répondre aux autres questions, il me semble qu'il faut bouger tous les paramètres et activer tous les leviers. Il faut s'interroger, je l'ai déjà dit, sur la place de la prison dans la société. Je regrette que la prison fonctionne en vase clos ; cela entretient beaucoup de spéculation sur son fonctionnement, qui n'est pas connu, et sur la pseudo-corruption de ses fonctionnaires.
Nous avons besoin de d'avantage de moyens, d'effectifs et de moyens techniques pour renforcer la sécurité dans les prisons.
Sur le rapport avec les juges de l'application des peines, nous exigeons que les surveillants assistent à la commission d'application des peines. Cela permettrait au juge de l'application des peines d'avoir un meilleur éclairage sur les situations. Certains établissements pénitentiaires, comme à Varenne, impliquent les surveillants dans ces commissions. Le retour des juges de l'application des peines est très positif ! Cela a par exemple permis de réorienter des décisions de permission de sortie.
Le rôle des surveillants pénitentiaires est essentiel. Or, il est devenu un porte-clés et un porte-douleur. Nous sommes devenus des bonnes à tout faire. Les profils doivent être plus spécialisés et les moyens adaptés au profil des détenus. Nous devons impulser une nouvelle logique.
Pourquoi ne pas créer une journée citoyenne pour que les citoyens puissent découvrir d'eux-mêmes les prisons ? C'est une idée défendue par notre syndicat.
Nous vous transmettrons nos propositions. La vraie problématique est la carence de l'autorité. Il suffit de voir que des détenus se lèvent à midi, refusent de prendre une douche, voire refusent même de se soigner.
Le syndicat FO revendique le statut d'OPJ pour les surveillants pénitentiaires. Cela pourrait constituer une réponse à la lenteur administrative dans le traitement des incidents. Nous effectuons d'ores et déjà des missions qui relèvent de la police judiciaire, comme les fouilles ou les perquisitions, sans avoir pour autant ni le statut d'APJ, ni celui d'OPJ.
En ce qui concerne les relations avec les juges de l'application des peines, la loi prévoit la possibilité que les surveillants pénitentiaires soient consultés. Nous souhaiterions que cette pratique soit généralisée.
L'armement des surveillants a été une révolution. Il ne faut pas avoir peur de parler de « police pénitentiaire ». C'est pourquoi nous revendiquons le statut de force de sécurité intérieure. Le personnel pénitentiaire doit pouvoir se protéger, non seulement dans le cadre des extractions, mais également au sein des établissements de détention. Nous souhaiterions par ailleurs être autorisés à porter des pistolets à impulsion électrique au sein des quartiers de détention les plus dangereux.

Vous avez indiqué que les prévenus ne bénéficient pas du même traitement que les détenus. Pourriez-vous préciser ce point ?
Par ailleurs, j'ai cru comprendre dans vos propos que vous vous sentiez en insécurité y compris en dehors du service. Quelles sont les réponses de l'administration pénitentiaire en la matière ?
Je souhaite rappeler que l'article 12 de la loi pénitentiaire confère un statut de force de sécurité intérieure aux agents de l'administration pénitentiaire.
Nous réalisons au quotidien des gestes qui peuvent s'apparenter à des actes relevant des prérogatives des APJ ou des OPJ. Le ministère de la justice doit travailler sur le statut des personnels pénitentiaires.
L'article 12 de la loi pénitentiaire ne fait pas référence à la sécurité publique, mais concerne uniquement les prérogatives des surveillants pénitentiaires dans le périmètre périphérique des établissements. Nous ne sommes pas mentionnés dans le code de la sécurité intérieure. La question n'est pas de savoir si nous sommes pour ou contre, mais je constate que nous n'appartenons pas aux forces de sécurité intérieure.

Nous sommes dans une situation paradoxale. Des débats ont lieu au Parlement sur la définition du périmètre d'intervention des surveillants pénitentiaires.
Il faut trancher le débat dans un sens ou dans l'autre. Cela aura une conséquence sur notre statut, en particulier sur le fait de nous conférer ou non des prérogatives judiciaires.
Pour répondre à la question de Mme Loisier, les prévenus sont placés dans des maisons d'arrêt au sein desquelles les conditions sont plus rudes qu'en détention. Prenez l'exemple des parloirs : les prévenus n'ont pas les mêmes droits que les détenus !
Plutôt que de se poser la question de la séparation entre prévenus et condamnés, nous devrions réfléchir au sens de la peine et de la prison.

Je voudrais tout d'abord saluer votre travail, qui demeure malheureusement peu reconnu.
Pourriez-vous nous préciser les taux de surpopulation carcérale et de manque d'effectifs ?
Les violences commises à notre encontre en dehors du service augmentent. Beaucoup de personnels ne portent pas plainte car leur identité est révélée à l'avocat de l'autre partie. Les agents se sentent menacés. À Reims, l'identité de plusieurs personnes a récemment été taguée sur les murs du centre pénitentiaire. Il faudrait un anonymat dans les procédures, comme les policiers.

Est-ce que cela aurait vraiment un sens ? Les détenus connaissent les gardiens.
Nous n'utilisons que rarement nos noms et prénoms. Les détenus m'appellent « gardien » ou « chef », les collègues m'appellent « collègue ».
Pour répondre à M. Sol, le taux moyen d'occupation des maisons d'arrêt est actuellement de 140 %. Toutefois, la création de nouvelles places de prison ne sera pas suffisante pour faire disparaître la surpopulation carcérale.
C'est un phénomène européen !
Dans certaines maisons d'arrêt, nous atteignons 280 % d'occupation !
Certains pays, comme le Canada ou la Suède, travaillent déjà, comme nous le proposons, sur le rôle social de la prison et sur le profilage des détenus, avec des résultats positifs. Le système canadien est sans aucun doute le plus abouti, même si nous sommes conscients qu'il ne pourrait être purement et simplement transposé en France, sans adaptation aux spécificités de notre population.
Une statistique est éclairante : huit détenus sur dix entrent en prison alors qu'ils sont déjà connus de l'administration pénitentiaire et ont donc déjà un parcours judiciaire. Le choc carcéral n'existe plus. Nous devons poser les bonnes questions. La question ne doit plus être de savoir su la prison est une bonne ou mauvaise réponse. Il s'agit d'une réponse parmi d'autres.

Je vous remercie.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
Audition de Mm. Michel delPuech préfet de police de paris thibaut sartre préfet secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police de paris frédéric dupuch directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne christian sainte directeur régional de la police judiciaire éric belleut directeur adjoint de l'ordre public et de la circulation philippe dalvavie conseiller technique chargé des affaires juridiques lucas demurger conseiller technique chargé de la prospective au cabinet du préfet denis safran conseiller technique professeur agrégé de médecine chargé des questions de santé en matière de sécurité intérieure
Audition de Mm. Michel delPuech préfet de police de paris thibaut sartre préfet secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police de paris frédéric dupuch directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne christian sainte directeur régional de la police judiciaire éric belleut directeur adjoint de l'ordre public et de la circulation philippe dalvavie conseiller technique chargé des affaires juridiques lucas demurger conseiller technique chargé de la prospective au cabinet du préfet denis safran conseiller technique professeur agrégé de médecine chargé des questions de santé en matière de sécurité intérieure

Notre commission d'enquête poursuit ses travaux avec l'audition de M. Michel Delpuech, préfet de police, accompagné par ses collaborateurs. Notre commission d'enquête s'efforce, d'abord, d'établir un diagnostic objectif sur l'existence ou non d'un « mal-être » au sein des forces de sécurité intérieure, ce mal-être ayant notamment pu se manifester par des expressions de colère débordant des canaux traditionnels, en particulier depuis la fin de l'année 2016. Elle s'efforce ensuite de comprendre les causes de ce phénomène, qu'elles soient matérielles ou morales, et d'examiner l'efficacité des mesures qui ont déjà été prises pour y porter remède au cours des dernières années. Enfin, il s'agit pour nous de proposer des pistes pour améliorer la situation.
Nous souhaiterions ainsi vous entendre d'abord brièvement sur ces différents sujets s'agissant des agents de la préfecture de police de Paris. J'inviterai ensuite le rapporteur et les autres membres de la commission d'enquête à vous poser des questions sur des points plus particuliers.
Cette audition est ouverte à la presse et sera diffusée en direct sur le site Internet du Sénat. Elle fera également l'objet d'un compte rendu publié. Je rappelle, pour la forme, qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du code pénal.
Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, MM. Michel Delpuech, Thibaut Sartre, Frédéric Dupuch, Christian Sainte, Éric Belleut, Philippe Dalvavie, Lucas Demurger et Denis Safran prêtent serment.

Comme l'a rappelé le président, notre commission d'enquête a été mise en place après la vague de suicides au sein de la police nationale et l'expression, hors champ syndical, d'une colère spontanée qui a surpris la représentation nationale et, peut-être, aussi la hiérarchie. Nous souhaitons donc identifier les causes de ce malaise et tenter d'esquisser des propositions et des solutions.
Quelles mesures sont mises en oeuvre pour prévenir les risques psychosociaux dans la police nationale ? La préfecture de police de Paris s'inscrit-elle dans la même politique que la direction générale de la police nationale, pour laquelle un premier plan de prévention des risques psychosociaux (PPRPS) avait été élaboré lorsque M. Bernard Cazeneuve était ministre de l'Intérieur ? Des mesures spécifiques ont-elles été prises par la préfecture de police ?
Nombre de personnes auditionnées à ce jour ont fait état d'un malaise particulier sur la « plaque parisienne », qui couvre beaucoup de secteurs réputés sensibles, avec de fortes tensions entre les forces de l'ordre et une fraction de la population, où le décalage est le plus grand entre effectifs théoriques et effectifs réels, où les personnels - parfois même les encadrants - sont les plus jeunes. Il ne semble pas que ce problème soit en voie de résolution, puisque même si les recrutements compenseront les déficits, la probabilité est forte que les promotions ainsi recrutées et formées quitteront rapidement la plaque parisienne pour aller en province. Comment pensez-vous réussir à faire en sorte que les effectifs réels correspondent aux effectifs théoriques et comprennent des personnels plus expérimentés ? Des mesures sont-elles à l'étude pour créer des éléments d'attractivité, notamment à travers la rémunération des fonctionnaires qui accepteront une affectation en région parisienne ?
L'accès au logement constitue une difficulté supplémentaire, qui nous a été décrite par des policiers eux-mêmes. Elle concerne notamment les personnels qui sortent d'école ou qui ont déjà une famille. Dans la gendarmerie, bien que les locaux soient souvent vétustes, ce problème ne se pose pas. Au cours de précédentes auditions, il nous a été indiqué que sur 2 500 demandes de logement, 1 500 étaient traitées de manière satisfaisante. Parmi les auteurs des 1 000 restantes, certains doivent se loger dans les pires conditions, ce qui crée un malaise chez les policiers entrants dans le métier et nuit à l'attractivité de la plaque parisienne. Des solutions sont-elles envisagées ? Y a-t-il des partenariats avec les collectivités territoriales ou des bailleurs ? Dans le système du bail social, éventuellement sur contingent réservataire, le locataire relève du droit commun, à la différence d'un logement de fonction. Sur les 25 000 logements du contingent réservataire, combien restent occupés par des policiers qui pourraient se loger ailleurs, voire par des retraités ?
J'en viens à ce qu'on appelle la « politique du chiffre ». La commission a entendu beaucoup de gradés de la police et de syndicalistes, qui avaient tous prêté serment, et elle n'arrive pas à savoir qui a raison : ceux qui affirment qu'une telle politique n'a jamais existé, ceux qui expliquent qu'elle a existé mais n'existe plus, ou ceux qui disent qu'elle perdure. Ce qui est certain, c'est que la base et le sommet n'en ont pas la même perception. Nous voulons donc savoir si la « politique du chiffre » existe et, le cas échéant, quelles en sont les modalités. Les objectifs quantitatifs sont-ils définis de manière parfois quelque peu absurde au regard de leur utilité réelle ou s'agit-il d'un fantasme imaginé par certains policiers ? Parce qu'il est légitime d'avoir une exigence de résultat, détermine-t-on des critères un peu plus qualitatifs que quantitatifs ?
On sent qu'il y a une crise morale beaucoup plus forte au sein de la police nationale que de la gendarmerie, alors que les conditions d'exercice, tant matérielles que juridiques, sont les mêmes. Les difficultés liées au sous-équipement ou à la vétusté des locaux sont identiques, les interrogations sur le sens de l'action en l'absence de réponse pénale adaptée sont partagées, ... Les raisons de la différence d'état d'esprit ne s'expliquent pas par le statut militaire des gendarmes : les compagnies républicaines de sécurité, qui ont un statut civil, ne connaissent pas cette crise. Au sein de la gendarmerie nationale, il y a un esprit de corps, un général considérant comme un camarade un gendarme auxiliaire ou un brigadier, alors que les trois corps de la police nationale développeraient plutôt un esprit de caste. Les commissaires et, moins encore, les préfets ne souffrent à aucun moment de leur formation ou de leur carrière aux côtés des policiers qu'ils doivent diriger ; ils ne partagent pas les mêmes conditions. Au fil des auditions et des déplacements sur le terrain, cette problématique, qui peut sembler secondaire, s'est révélée être un élément important du malaise des policiers.
Comment rapprocher les formations initiales et continues entre les trois corps afin, notamment, de former les commissaires dans des conditions plus proches de celles des agents qu'ils auront à commander ? Concernant le management, il a été déploré devant la commission d'enquête que les « meneurs d'hommes » d'autrefois aient disparu au profit des « gestionnaires », en raison de la formation qu'ils reçoivent, mais aussi des contraintes nouvelles qui leur sont imposées. Le « meneur d'hommes » devient le marginal ; le gestionnaire est la norme. J'aimerais connaître votre sentiment sur ce sujet.
Par ailleurs, pensez-vous que la formation technique initiale des policiers les prépare à ce qu'ils pourront trouver sur le terrain, c'est-à-dire parfois des scènes de terrorisme ou une violence qui peut leur être incompréhensible ? Les personnels sont-ils également accompagnés lorsqu'ils y sont confrontés ? La délinquance et la société étant évolutives, comme le montre le développement de l'enregistrement vidéo d'interventions policières au moyen de téléphones portables, la formation continue prend-elle en compte ces transformations ?
Ma question suivante porte sur la police de sécurité du quotidien (PSQ), qui ne concerne peut-être qu'à la marge la préfecture de police de Paris. Il a été considéré qu'une police déconcentrée, jouissant localement d'une plus grande autonomie, pouvait mieux répondre à la demande de terrain, qui est parfois, en province, prise en charge par la police municipale. Quel est votre avis sur cette déconcentration ?
Par ailleurs, tout le monde conviendra qu'il est très bien de renforcer les contacts entre la police nationale, les élus, les institutions et la population, mais si on sanctuarise ce « temps de contact » à effectifs et volumes horaires constants, cela ne se fera-t-il pas au détriment du temps d'intervention et d'investigation ? L'expérimentation de la police de proximité, sur laquelle j'avais travaillé, a montré que sans une augmentation des moyens, les renseignements supplémentaires collectés ne pouvaient pas être traités, faute de ressources ; le résultat était donc très décevant. Ne risque-t-on pas d'observer la même chose avec la police de sécurité du quotidien ?
Pour disposer de personnel, de temps de travail supplémentaire, on imagine qu'on pourrait économiser sur la procédure pénale et les tâches administratives, et renforcer le déploiement sur le terrain. On commence à connaître les projets du gouvernement en ce qui concerne la réforme du code de procédure pénale. Pensez-vous que ce qui est envisagé suffise pour gagner du temps de travail de policiers et redéployer ceux-ci sur le terrain ? Y a-t-il d'autres pistes pour alléger la procédure pénale, que ce soit au travers du code de procédure pénale ou par le recours à de nouveaux moyens techniques et logiciels ? Les policiers et les citoyens n'aspirent qu'au redéploiement des effectifs sur le terrain.
Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, Messieurs les Sénateurs, je voudrais d'abord dire l'honneur qui est le nôtre d'être devant la commission d'enquête. J'ai souhaité être entouré de collaborateurs : M. Thibaut Sartre, préfet, secrétaire général pour l'administration, qui a sous son autorité les grandes fonctions de soutien à la préfecture de police (budget, immobilier, ressources humaines, dont l'action sociale et le logement), M. Frédéric Dupuch, directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, qui couvre l'activité de sécurité publique de Paris et de la petite couronne, M. Christian Sainte, directeur de la police judiciaire, qui est également compétente sur Paris et la petite couronne, M. Éric Belleut, directeur adjoint de l'ordre public et de la circulation, l'ordre public étant - et je suis très attaché à cette spécificité parisienne - confié à une direction à temps plein pour préserver les autres services de cette activité et professionnaliser l'intervention, MM. Philippe Dalvavie et Lucas Demurger, conseillers chargés respectivement des affaires juridiques et de la prospective au sein de mon cabinet, qui m'ont aidé à préparer le dossier, et le professeur Denis Safran, bien connu pour sa proximité avec la police et notamment la brigade de recherche et d'intervention (BRI), aux côtés de laquelle il se trouvait lors des attentats au Bataclan.
Je voudrais rappeler brièvement ce que sont la préfecture de police de Paris et le préfet de police. Il peut y avoir des confusions ou des besoins de clarification autour de cette institution, bien que celle-ci soit assez connue.
Ainsi que vous l'indiquiez, la préfecture de police se trouve très fortement mobilisée sur plusieurs fronts, et tout particulièrement au cours de ces dernières années : la lutte contre la menace terroriste - la plus grande part, en nombre, des actes terroristes qui ont frappé notre pays depuis 2015 ont été commis sur la plaque parisienne -, la lutte contre la délinquance, qu'elle soit de haut vol ou qu'il s'agisse de violences et de trafics de drogue dans certains quartiers de la petite couronne, la gestion des conséquences des flux migratoires en matière de lutte contre l'immigration irrégulière, enfin, le maintien de l'ordre à Paris, qui a connu des épisodes extrêmement violents et éprouvants pour les effectifs au moment de la contestation de la loi dite « El Khomri » en 2016 ou, très récemment encore, lors de la manifestation du 1er mai 2018, lors de laquelle 1 200 « Black Blocks » étaient présents. Les fonctionnaires de la préfecture de police sont donc extrêmement sollicités.
La préfecture de police est une institution territoriale, non une direction générale du ministère de l'Intérieur, à la différence de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale. Elle regroupe l'ensemble des services placés sous l'autorité du préfet de police pour lui permettre d'exercer ses missions et ses compétences. Cela signifie par exemple que je ne suis pas responsable de programme (RPROG) au sens de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), mais simplement responsable de budget opérationnel de programme (RBOP), comme lorsque j'étais préfet à Bordeaux puis à Lyon. Pour prendre la mesure des compétences du préfet de police, le plus simple est de se représenter trois cercles : premièrement, Paris, deuxièmement, la petite couronne et les aéroports, et troisièmement, l'Île de France.
Sur le territoire de Paris, qui est le territoire historique, le préfet de police exerce toutes les missions régaliennes d'un préfet dans les domaines de la sécurité intérieure et de la sécurité civile, ainsi que les missions de secours et l'autorité de police générale assumées par le maire dans les autres communes de France.
En petite couronne, il y a un héritage historique et une évolution récente : la préfecture de police couvrait originellement le département de la Seine. Lorsque celui-ci a disparu et que les trois départements de la petite couronne ont été créés, un partage des tâches est intervenu avec ces trois préfets, autorités de droit commun, et le préfet de police de Paris a gardé la compétence de gestion des effectifs de la petite couronne - notamment ceux rattachés à la direction de la sécurité publique - au travers du secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP) de Paris, créé en 1971. Plus récemment, lorsque M. Nicolas Sarkozy, qui était alors président de la République, a porté le thème du Grand Paris, la volonté de prendre les devants sur le terrain de la sécurité intérieure s'est fait jour et le préfet de police s'est vu attribuer la compétence sur Paris et la petite couronne pour l'ordre public, la sécurité publique et la direction des forces de l'ordre, ce qui atteste d'une vision intégrée de la compétence du préfet et des services. La loi du 28 février 2017 a élargi la compétence du préfet en matière de sécurité et de police - mais non de flux migratoires - aux plateformes aéroportuaires. Cet héritage relatif à la petite couronne induit une particularité par rapport aux questions que la commission d'enquête se pose : nombre de dispositifs de suivi social sont compétents seulement pour Paris, les effectifs de la petite couronne relevant pour ces sujets des préfets de département. Je souhaite que ce point d'incohérence, que j'ai déjà soulevé, fasse l'objet d'une évolution : il faut que l'ensemble des policiers de la préfecture de police soit suivi, au plan de l'action sociale, par les services de la préfecture de police, qui ont une grande expérience et un savoir-faire en la matière.
Enfin, la région d'Île de France constitue une zone de défense et de sécurité (ZDS), qui est placée sous l'autorité du préfet de police. En tant que préfet de zone de défense et de sécurité, celui-ci a donc, d'une part, la responsabilité de la gestion de crise et de la résilience face aux épisodes de neige, d'inondation ou de catastrophes de toute sorte, d'autre part, de la gestion des moyens de la police nationale et partiellement de la gendarmerie nationale, notamment pour l'immobilier - le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) d'Île de France est dirigé par le préfet, secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police, sous l'autorité du préfet de police. Enfin, le préfet de police dispose des pouvoirs accrus à Paris par rapports à ses homologues en province en matière d'animation des politiques de sécurité intérieure, de circulation et d'ordre public lorsque les événements le justifient.
L'organisation de la préfecture de police repose sur plusieurs directions actives de police : la direction de la sécurité de proximité compte environ 20 000 fonctionnaires pour Paris et la petite couronne ; la direction de l'ordre public et de la circulation représente à peu près 4 500 fonctionnaires et intervient également en petite couronne, comme, par exemple, lors de grands événements sportifs au Stade de France. La direction de la police judiciaire regroupe 2 200 fonctionnaires et la direction du renseignement, dont je rappelle qu'elle couvre le spectre du renseignement territorial et celui de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) pour la prévention de la radicalisation, 800. Il y a également une direction de soutien technique et logistique. Les effectifs sous l'autorité du préfet de police s'élèvent donc à environ 30 000 fonctionnaires. Si l'on considère le périmètre couvert par le SGAMI Paris, s'y ajoutent 12 000 fonctionnaires supplémentaires.
Concernant la prévention des risques psychologiques et sociaux (RPS), je veux mettre en lumière le mode d'organisation que nous avons à la préfecture de police. Au sein de la direction des ressources humaines, une sous-direction de l'action sociale dispose de 25 assistantes sociales, de quatre médecins du travail et demi, de psychologues du travail, ainsi que d'une trentaine de médecins statutaires (ou médecins d'aptitude). L'idée est d'organiser une interface aussi efficace que possible entre ces professionnels et les unités dédiées à cette tâche au sein des directions actives, au plus proches des fonctionnaires.
Nous avons déploré l'an passé sept suicides, dont quatre à Paris et trois en petite couronne. Ce chiffre est en diminution sur la longue période. Chaque cas donne lieu à une enquête d'environnement, afin d'identifier la part de ce qui peut relever d'éléments personnels - souvent des questions sentimentales - et ce qui est lié au travail, même si le distinguo est toujours très difficile à établir. Ce qui est important, ce sont les efforts de détection et de prévention qui sont faits à la préfecture de police comme ailleurs, puisque nous nous inscrivons totalement dans les initiatives nationales. Ces efforts passent par un souci de repérage, d'attention accrue, par un meilleur dialogue entre médecines statutaire et de prévention, par un décloisonnement entre les métiers de psychologue et de médecin. Si vous le permettez, les deux directeurs vont dire un mot de leur organisation interne sur ces sujets.
Au sein de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP), nous avons un service d'accompagnement et de soutien (SAS), rattaché à la gestion des ressources humaines, qui reçoit les demandes propres des agents ou les signalements de collègues interpellés par une attitude ou l'évolution d'un comportement. Cela se traduit soit par des entretiens téléphoniques, soit par des entretiens en face à face ; nous en avons réalisé respectivement 1 400 et 132 en 2017. Une fois que l'on a ciblé la cause du mal-être (problème de logement, problème familial, problème d'affectation, problème relationnel avec des collègues, problème hiérarchique), nous essayons de résoudre en interne ce qui peut l'être, par exemple, le fonctionnement hiérarchique. Pour le reste, grâce au fonctionnement intégré en réseau que nous avons avec la préfecture de police, nous nous tournons vers le service compétent dépendant du préfet, secrétaire général pour l'administration, afin d'assurer un relai. Nous avons ainsi déjà résolu des situations de véritable urgence. Nous rencontrons actuellement le cas, comme cela se produit parfois en-dehors de Paris, d'agents surveillés par des malfaiteurs qui leur font savoir qu'ils connaissent leur adresse, leur véhicule, etc. Cette situation, qui génère bien évidemment chez les fonctionnaires concernés un certain malaise, est portée à notre connaissance et nous cherchons alors très rapidement un nouveau logement - aspect privé - et une nouvelle affectation - aspect administratif.
Au sein de la direction de l'ordre public et de la circulation, l'unité de prévention et de soutien comprend une dizaine de fonctionnaires, qui réalise des entretiens téléphoniques ou en face à face (une centaine en 2017), ainsi que des déplacements dans les services et sur le terrain. Pour les cas les plus complexes, elle se tourne vers la direction des ressources humaines et de la formation de la préfecture de police, afin d'obtenir l'aide de ses psychologues.
La direction régionale de la police judiciaire est une maison bien plus petite, organisée en groupes d'enquête hiérarchisés et fédérés autour d'un chef de groupe.
Il y a deux ans, cependant, un fonctionnaire de l'identité judiciaire s'est suicidé avec son arme de service, sur son lieu de travail, un dimanche matin. On s'interroge alors nécessairement pour savoir si on n'a pas négligé des signaux qui auraient pu être envoyés avant le passage à l'acte. Mais il s'agissait de problèmes personnels et ni les collègues, ni la hiérarchie n'avaient pu percevoir le danger.
Lorsqu'un problème se fait jour, nous organisons immédiatement la prise en charge par la sous-direction des affaires sociales et resserrons le dispositif de suivi. Se pose alors très rapidement la question du désarmement du fonctionnaire concerné. Le passage à l'acte est évidemment facilité par la mise à disposition d'une arme à feu et, dans ces conditions, l'examen médical et le suivi dans la durée, avec un psychologue, sont très importants.

Cependant, le désarmement est susceptible d'aggraver le sentiment de dévalorisation du fonctionnaire. De surcroît, si l'on veut vraiment trouver une arme, on peut le faire ailleurs.
On se pose la question du désarmement à chaque fois. Tous les cas ne relèvent pas de schémas présuicidaires : il peut aussi s'agir de quelqu'un qui traverse une difficulté, dont la consommation d'alcool devient anormale ou les horaires de travail, erratiques, qui adopte un comportement détaché vis-à-vis de son emploi... La question se pose alors de savoir s'il faut désarmer cette personne, au risque de la mener dans une impasse en lui donnant l'impression d'être dans un trou, ou au contraire lui maintenir la confiance en l'accompagnant. Le premier réflexe des chefs de service est de proposer immédiatement le désarmement. Il est alors important que nous ayons un entretien avec l'environnement du fonctionnaire concerné, avec le corps médical : au bout du compte, il appartient à l'autorité hiérarchique de se prononcer. Une telle décision est lourde de conséquences ; on ne désarme pas systématiquement.
Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, je vous ai entendu dire que nous nous émouvions naturellement devant la vague récente de suicides. J'aimerais remettre les choses en perspective, au moins en ce qui concerne la préfecture de police.
En 2017, la préfecture de police a déploré sept suicides de policiers, quatre pour Paris intra-muros et trois pour l'agglomération parisienne. Si l'on rapporte ce chiffre à l'effectif total, soit 30 000 fonctionnaires, la proportion est très faible, même si chaque suicide constitue un drame pour l'individu, sa famille et ses collègues. On peut relever que ce chiffre reste relativement constant au fil des années et on ne saurait parler, en ce qui concerne la zone de compétence de la préfecture de police, d'une quelconque « explosion ». Néanmoins, le nombre de suicides est toujours trop élevé et nous devons tout mettre en oeuvre pour prévenir ces actes.
Deux dispositifs principaux ont été mis en place. Le dispositif a posteriori consiste en une enquête environnementale, qui est menée systématiquement après un suicide pour en expliquer les raisons. Les causes sont toujours multifactorielles et relèvent majoritairement de situations personnelles ou familiales ou de problèmes d'endettement, entre autres.
Le dispositif a priori vise à prévenir le suicide dans toute la mesure du possible, sachant que malheureusement le « risque zéro » n'existe pas. À la préfecture de police, il est assez robuste. Il repose d'abord sur l'environnement immédiat : collègues et hiérarchie doivent être formés à détecter des signaux faibles tels qu'un changement de comportement, des difficultés, etc. Il repose ensuite sur des structures pluridisciplinaires constituées de médecins de prévention, médecins du travail qui examinent de manière de plus en plus fréquente les fonctionnaires de police, de médecins d'aptitude qui sont en étroite relation avec les médecins de prévention bien que leurs métiers soient différents, de psychologues du réseau psychologique et de psychologues du travail. À la préfecture de police, il y a un véritable fonctionnement en réseau, qui permet des consultations régulières de cette équipe pluridisciplinaires. Sept réunions médico-sociales se sont tenues, par exemple, en 2017, dans l'objectif d'appréhender l'ensemble des problématiques liées à des situations de souffrance au travail ou de souffrance tout à fait personnelle. Enfin, il y a les cellules de veille et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
J'insiste sur le fait que le point d'entrée pour la détection d'un risque psychosocial est bien la médecine de prévention : seul le médecin de prévention peut connaître tout l'historique des problèmes médicaux du patient, puisqu'il détient son dossier. Or dans le risque suicidaire, il n'y a pas seulement les problèmes psychologiques, mais il peut aussi y avoir des problèmes somatiques ou autres. Ceci doit être pris comme un tout. Le psychologue est une aide et, comme pour un médicament, on y a accès sur prescription.
Je précise que je souhaiterais que ce dispositif soit étendu aux fonctionnaires travaillant en petite couronne, et notamment au sein de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne.

Combien de personnels sur les 30 000 cités bénéficient de cette politique ? Quelle est la répartition entre Paris et la petite couronne ?
Il y a environ 4 000 agents dans le département de Seine-Saint-Denis et 3 000 respectivement dans les départements des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne, donc au total 10 000 en petite couronne et 20 000 à Paris.
J'en viens à la question de la gestion des effectifs sur la plaque parisienne. Le constat que vous faites et les questions qu'il génère ne nous surprennent pas. J'ai été secrétaire général pour l'administration de la police à Paris avant de devenir directeur de cabinet du préfet de police pendant un peu plus de quatre ans. J'y ai donc passé plus de 15 ans. Ce phénomène de l'arrivée de jeunes fonctionnaires sur la plaque parisienne et de turnover permanent, qui alimente les services de police en province, ne s'est guère corrigé depuis ce temps où je l'avais découvert. Ces difficultés s'expliquent en premier lieu par l'origine géographique des lauréats des concours, qui dans leur immense majorité ne sont pas parisiens, ni même franciliens. La plupart souhaitent retourner dans leur région d'origine. L'Île-de-France n'est pas représentée à la part de sa démographie dans les concours de catégorie B. En second lieu, il y a également un problème lié au coût de la vie en région parisienne et qui s'aggrave à mesure qu'on va vers son centre. C'est un élément pénalisant, qui peut pousser les fonctionnaires à rejoindre ou à se rapprocher du « berceau natal ».
En revanche, le fait que les sollicitations opérationnelles soient très fortes et très denses n'est pas nécessairement de nature à faire fuir les agents. Au contraire, l'acquisition de compétences sur un territoire aussi riche est bien vécue par les jeunes fonctionnaires. Par exemple, l'équipage de la police de proximité intervenu samedi est constitué de très jeunes fonctionnaires. Celui qui a neutralisé le terroriste a un an d'ancienneté, les deux autres sont également de jeunes gardiens. Le fait d'être dans cette situation n'est pas vécu comme quelque chose de pénalisant.
Une autre explication au problème du turnover est que les jeunes fonctionnaires que nous accueillons se voient confier des tâches auxquelles ils ne s'attendaient pas, telles que la circulation. Toutefois, ce n'est pas parce que des tâches ne plaisent pas qu'elles sont indues - je pense notamment à la protection des grandes institutions de la République.
Surtout, j'observe que tous les mécanismes compensatoires mis en place depuis plusieurs années se sont peu à peu érodés : la prime de fidélisation a été étendue à d'autres circonscriptions, qui n'ont rien à voir avec la plaque parisienne. La prime « coût de la vie » représente 1 700 euros brut annuels, ce qui n'est pas à la mesure du différentiel du coût de la vie. Quant à l'obligation statutaire, qui est de huit ans pour le concours national à vocation régionale Île de France et de cinq ans pour le concours à affectation nationale, on peut penser qu'elle n'a pas encore sa pleine portée.
La prime de fidélisation augmente par pallier annuel de 200 euros et peut atteindre 1 800 euros au bout de 10 ans. Elle concerne l'ensemble de l'Ile de France, où elle est versée sans distinction entre les circonscriptions. Il n'y a ainsi pas de différence entre les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis, par exemple. Progressivement, la prime a été accordée à des fonctionnaires se trouvant dans une dizaine de circonscriptions en province ; ce n'est donc plus un dispositif spécifique.
Le fait de recevoir des jeunes sortis d'école n'est pas nécessairement une chose négative. Ces fonctionnaires sont plutôt allants, récemment formés et ont envie de s'impliquer fortement dans le métier qu'ils exercent. En revanche, il y a deux conséquences inquiétantes. La première est celle d'un déficit d'encadrement. La seconde, c'est le manque d'officiers de police judiciaire (OPJ). Leur part s'élève aujourd'hui à 13 % des officiers du troisième corps de la plaque parisienne, alors que la moyenne nationale est de 23 % (mais celle-ci prend en compte les effectifs d'OPJ de la préfecture de police de Paris).

Ces chiffres sont nettement inférieurs à ceux de la gendarmerie. Peut-on imaginer des dispositifs non financiers incitatifs pour engager les policiers vers cette qualification ?
Il existe une voie d'avancement pour les OPJ mais ce n'est pas l'option que nous recommandons. En effet, un certain nombre de fonctionnaires ne demandent pas mieux que de devenir OPJ pour accroître leurs chances de quitter la plaque parisienne. La réflexion que nous menons porte sur la mise en place, dès la formation initiale des gardiens de la paix, pour une partie des promotions, d'une formation complémentaire permettant de faire en sorte qu'ils aient cette qualification dès l'arrivée dans les services. Ceci permettrait aussi de mettre en lumière l'investigation en tant que filière à part entière, alors qu'elle a du mal à recruter.
Nous partageons le regret que vous avez exprimé de voir des fonctionnaires particulièrement jeunes confrontés à des situations particulièrement difficiles. Cependant, le vrai sujet est la fuite de l'encadrement. Au sein de la DSPAP, le taux d'encadrement dans le corps des gardiens et gradés n'atteint pas 17 %, et ce taux varie fortement selon les services et les circonscriptions. C'est au centre de rétention administrative qu'il est le plus faible : il n'y est que de 4 %. Je conçois que cette affectation puisse être particulièrement peu engageante mais, constitutionnellement, la surveillance d'êtres humains doit être assurée par des êtres humains relevant du secteur public.
Par ailleurs, le dispositif de fidélisation, avec l'obligation de servir huit années, porte sur la région Île-de-France, non sur un site d'affectation en particulier. Or La Courneuve, ce n'est pas Versailles, et les agents ne sont pas tenus de rester huit ans à La Courneuve.
Dans mes fonctions, j'observe cet exode progressif des personnes formées. Pour devenir OPJ, il faut deux ans d'ancienneté, donc au bout de deux ans, les agents les plus brillants et les plus travailleurs passent le « bloc OPJ », entrent en formation et leur expérience à la préfecture de police de Paris constitue un atout supplémentaire pour obtenir une mutation. La DSPAP réalise 80 000 gardes à vue par an et ce chiffre progresse de 1 000 par an, alors que le nombre d'OPJ ne cesse de décroître : fin 2014, ils étaient 3 200 ; aujourd'hui, ils sont 2 700. Cela nous conduit à des réorganisations permanentes. On va être obligé d'effectuer de plus en plus de tâches avec de moins en moins de personnes ayant l'expérience pour le faire.
Dans une direction spécialisée telle que celle que je dirige, on a une perte en ligne d'effectifs, avec des départs qui s'accélèrent : le renouvellement générationnel est une réalité, mais il y a également beaucoup de départs vers la province et nombre d'enquêteurs spécialisés se tournent vers le renseignement, où ils trouvent la satisfaction de se renouveler professionnellement et de travailler en s'affranchissant, dans une certaine mesure, de la lourdeur de la procédure. Enfin, le manque d'attractivité se ressent aussi sur les ouvertures de postes : en 2013, pour la police judiciaire, 25 postes étaient ouverts pour les officiers ; cette année, il y a 76 postes vacants, dont tous ne suscitent pas de candidature.
En ce qui concerne le continuum de la hiérarchie, on se rend compte de l'existence d'un maillon faible : le manque d'encadrement par les officiers fragilise toute la chaîne hiérarchique. Ce phénomène est aussi, certainement, un facteur de dichotomie perceptible entre la hiérarchie supérieure et la base.
Enfin, comme cela a déjà été évoqué par M. le préfet de police, le nivellement par le bas des quelques avantages et compensations qui valaient pour les fonctionnaires affectés en région parisienne rend que le maintien à Paris pénalisant. Les conditions de vie étant déjà dégradées par rapport à la province, les contraintes financières deviennent alors rapidement un enjeu majeur pour les personnels.
Le sujet du logement suscite à juste titre des préoccupations, puisque c'est une question clef. La politique du logement spécifique aux fonctionnaires de la préfecture de police de Paris existe déjà depuis les années 1980. Sa particularité est de réserver sur des crédits d'État des logements à destination de ses fonctionnaires, avec un financement par le programme 176. Il s'agit de droits de présentation ; le bailleur qui a construit - que ce soit un bailleur social ou non - s'engage à réserver des logements à des fonctionnaires de police qu'on lui présente par l'intermédiaire du bureau du logement. Cela représente une ressource de 13 300 logements financés par l'État. Le parc a été mis en place par Pierre Joxe alors qu'il était ministre de l'intérieur et a toujours reçu le financement nécessaire à son maintien. L'idée est maintenant d'améliorer le positionnement en abandonnant certains sites et en en investissant d'autres, afin de rendre l'offre plus attractive.
Il y a aujourd'hui environ 13 500 logements, dont 90 % dans le parc social et 10 % dans le parc privé. Le système repose sur le principe de la réservation et des droits de présentation : nous présentons des candidats aux bailleurs sociaux ; le bail est signé par ces deux parties directement. Le fonctionnaire a alors la même relation avec son bailleur que n'importe quel autre locataire.
Lorsque le locataire résilie le bail, soit le droit de réservation nous revient et nous pouvons présenter un nouveau candidat, soit le droit de réservation est perdu. Cela dépend du type de réservation.
L'idée de départ était de s'engager sur un droit de réservation pour une durée de 15 à 20 ans. Si le locataire que nous avons présenté au bailleur part - parce qu'il change d'affectation, parce qu'il acquiert un logement, ... - nous récupérons un logement et le droit de réservation nous reste acquis. Au bout d'un certain temps, il devient caduc.
Chaque année, ce sont à peu près 13 millions d'euros qui sont affectés au droit de réservation. Nous proposons environ 1 500 à 1 600 logements par an. Le turnover est d'à peu près 15 % par an.
Nous avons reçu, l'an dernier, 2 700 demandes pour 1 600 logements. La situation des personnes concernées peut être très diverse ; certaines occupent déjà un logement de la préfecture de police et souhaitent changer de lieu de résidence. Le différentiel de 1 000 entre l'offre et la demande est évolutif : ce ne sont jamais les mêmes personnes qui le composent. Parmi les demandeurs, certains fonctionnaires ont refusé un logement que nous leur avions proposé parce qu'il ne leur convenait pas en termes de localisation ou de structure.
Aujourd'hui, nous avons un peu moins de 1 700 demandes en stock, dont 1 000 ont moins de six mois d'ancienneté. Il y a donc un stock frictionnel. Sur les 1 000 personnes ayant déposé une demande il y a moins de six mois, 425 se sont déjà vu proposer un logement, c'est-à-dire un « bon de visite ». Parmi les 600 demandes qui ont plus de 6 mois, toutes ont déjà donné lieu à un bon de visite au moins. Elles émanent souvent de fonctionnaires déjà logés dans le parc social : ce n'est pas une primo-demande. Concernant les besoins immédiats, nous mettons un accent particulier sur la situation des jeunes arrivant à la préfecture de police, qui sont le moins payés et n'ont généralement pas d'attaches familiales en Île-de-France - nous leur portons donc une attention toute particulière. L'an dernier, 400 gardiens de la paix sortis d'école ont formulé une demande auprès du bureau du logement de la préfecture de police, quelle que soit leur affectation (Paris ou petite couronne).
Je voudrais souligner le fait que sur 3 200 arrivées, nous n'avons reçu que 400 demandes : c'est peu.
Nous avons trouvé une solution pour l'ensemble des 400 demandeurs, soit en parc social, soit en résidence... Tous les fonctionnaires sortis d'école qui nous ont sollicités ont obtenu une solution de logement.
La question est de savoir pourquoi tous ne s'adressent pas au bureau du logement. La réponse se trouve dans nos développements et échanges précédents : le système du turnover n'incite pas certains à s'engager de manière durable dans un logement de type familial, qui privilégieront une logique de colocation tout en conservant le logement qu'ils occupent hors de l'Île-de-France.

Les fonctionnaires restent en Île-de-France entre cinq et huit ans tout de même.
Lorsque j'étais en poste à Béthune, qui fournit de nombreux fonctionnaires de police, « l'effet TGV » incitait beaucoup d'entre eux à adopter un mode de vie que nous désapprouvions : leur épouse ou future épouse étant dans le bassin minier du Pas-de-Calais, ils préféraient garder leur pavillon à Béthune, par exemple, et choisissaient des services de nuit, en « trois-trois », avec un logement précaire et à moindre coût dans la capitale ; ils rentraient dans leur département quand le service le leur permettait.

Il nous a été rapporté qu'il y aurait un décalage dans le versement des salaires après la sortie d'école. L'affectation au premier poste génère une augmentation de traitement, mais il se passe parfois jusqu'à six mois avant que celle-ci ne soit répercutée sur la feuille de paie du fonctionnaire après l'arrivée en poste en région parisienne, c'est à dire au moment où le policier a le plus besoin de cet argent pour son installation.
La paie est assurée au niveau régional. Je n'ai jamais été saisi par les organisations syndicales notamment de décalages aussi longs que ceux que vous évoquez, même s'il peut y avoir des délais d'un ou deux mois, mais je vais faire vérifier ce point.

Il me semble que certains policiers nous ont dit qu'ils avaient dû rembourser une partie de ce qu'ils avaient touché pendant leur formation.
La rémunération au cours de l'année qui suit la sortie de l'école, pendant laquelle les fonctionnaires sont stagiaires, est significativement supérieure à celle des élèves, notamment par le jeu des primes.

Je voudrais insister sur le fait que la police attire les jeunes. On s'aperçoit que ce sont surtout les filles qui passent et réussissent les concours. Or vous n'avez jamais abordé la situation de ce public féminin. Les jeunes filles sont-elles également touchées par ces problèmes d'épuisement professionnel ? S'adaptent-elles plus ou moins bien à l'environnement parisien ?
Le suicide est un phénomène très masculin. Nous n'avons pas évoqué le sujet des femmes à la préfecture de police parce qu'il n'y a pas de problème spécifique et qu'il n'est pas nouveau. Il y a maintenant plus d'un quart des gardiens de la paix qui sont des femmes et tout le monde s'en réjouit. Par le dynamisme et l'équilibre que ce taux de féminisation apporte dans les services, il y a eu un vrai changement très positif dans le mode de fonctionnement. Il y a quelques commissaires féminins dans des arrondissements un peu difficiles de la capitale et les élus y sont très contents. Ce n'est pas un sujet.

Les pompiers de Paris restent pour la population nationale, et notamment pour les jeunes, un corps très attractif. Comment expliquez-vous cela ? Avez-vous pour les sollicitations opérationnelles un travail de coordination avec eux ?
La brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) est placée sous mon autorité puisqu'en tant que préfet de police je coordonne les secours. La force du système parisien, c'est le fait qu'il soit complètement intégré, sous l'autorité d'un seul chef. Le statut des sapeurs-pompiers est un statut militaire, comme les marins-pompiers à Marseille, qui sont sous l'autorité du maire. Le financement de la BSPP relève du budget spécial de la préfecture de police, qui est voté par le conseil de Paris mais auquel contribuent, à parts égales, l'État, la Ville de Paris, les départements et les communes de la petite couronne. Les pompiers de Paris attirent beaucoup de jeunes mais très peu de jeunes femmes. Je pense qu'il y a là une progression à faire, mais on ne passe pas du jour au lendemain d'un paradigme à l'autre.

Le citoyen n'est pas hostile à la « politique du chiffre ». Mais il semblerait que celle-ci ait conduit au versement de primes réservées à la hiérarchie.
Par ailleurs, je me demande si ce serait une bonne chose que les policiers puissent entrer dans des lieux privés, tels que des supermarchés, avec leur arme de service.
Cette interrogation pose la question de l'utilisation de l'arme en-dehors des heures de service. Il y a des éléments en faveur de cette option, d'autres contre... Je ne suis pas certain que cela relève du domaine de la loi. Les fonctionnaires tiennent beaucoup à avoir l'usage de l'arme en-dehors du service mais on est renvoyé à la règle de l'endroit : le « maître de maison » doit garder la maîtrise.
Si un fonctionnaire de police souhaite assister à un spectacle avec son revolver et si le responsable du théâtre ne le veut pas, il ne peut pas entrer. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a eu un mouvement de panique dernièrement dans un cinéma, lorsqu'un fonctionnaire a, en enlevant sa veste, fait apparaître son revolver.
Personnellement, je ne m'aventurerais pas sur ce terrain.
Concernant la politique du chiffre, il y a deux écueils permanents : soit on instaure une dictature - avec tout ce qui en découle - et cela pervertit l'activité ; soit il n'y a aucun objectif ni élément d'appréciation et alors, lorsque l'on évalue l'encadrement, c'est « à la tête du client ». Donc le préfet de police délivre des lettres de mission aux directeurs, qui fixent des objectifs aux collaborateurs.

Demandez-vous un chiffre précis de contraventions, de gardes à vue, etc. ?
Trois fois non ! En revanche, j'aime savoir, par exemple, le nombre de gardes à vue réalisées par officier de police judiciaire (OPJ) et par an dans chaque circonscription. Si je m'aperçois que ce chiffre est de 50 dans une circonscription alors qu'il est de 260 dans une autre, je constate qu'il y a un problème de répartition de la ressource et je peux le régler. Il n'y a aucune incidence sur l'indemnité de responsabilité et de performance (IRP) des fonctionnaires concernés.
Je pense qu'il y a une confusion entre les chiffres-objectifs et les chiffres-bilan. Certes, on utilise des chiffres. Mais la caricature selon laquelle on dirait : « Vous devez faire tant de contraventions en stationnement, tant en feu rouge » ne fait pas partie du tout des stratégies même si je ne saurais jurer que personne, parmi les 20 000 fonctionnaires de la direction, ne l'a jamais dit. En revanche, nous mesurons le taux d'occupation de la voie publique et le nombre de patrouilles qu'on a dégagées, le délai entre la réception d'un appel téléphonique au 17 et l'arrivée de l'équipe sur place, le nombre de gardes à vue, de cambriolages et de vols avec violence, etc. Nous exploitons les chiffres au plan des bilans, pas en tant qu'éléments d'objectifs chiffrés à atteindre.
L'IRP est liée principalement aux fonctions de l'intéressé et indexée sur son niveau de responsabilité. Lorsqu'il y a une prime pour un résultat exceptionnel, elle est accordée collectivement, à un groupe, de manière indifférenciée entre le chef de groupe et les autres fonctionnaires.
L'une de vos questions, Monsieur le Rapporteur, portait sur « l'esprit police », l'esprit de corps, l'esprit de caste. Notre vision, c'est que la police est une maison et que son unité est un impératif - à Paris, cela est peut-être mieux vécu qu'ailleurs. Nous devons tout faire pour éviter une cassure entre les chefs et ceux qui sont, comme l'on dit familièrement, « au bas de l'échelle » : par exemple, les chefs de service ne sauraient rester derrière leur bureau ; il faut qu'ils soient chaque jour au contact des équipes au moment de l'appel, à l'accueil, etc.
Il est vrai qu'en raison du mode de recrutement, les origines des fonctionnaires sont très différentes. Beaucoup de gardiens arrivent par la voie des adjoints de sécurité (ADS), ce qui permet d'avoir des effectifs qui reflètent la diversité de la population française actuelle. Le niveau du concours des commissaires est élevé et nombre d'entre eux sont diplômés de Sciences-Po. Pour ceux-ci, la préfecture de police de Paris leur offre l'avantage d'être intégrés dans une structure importante, ce qui évite l'isolement et leur permet d'acquérir de l'expérience avant d'être nommés chefs de service.
Par ailleurs, nous avons mis en place une formation « transport » avec l'École nationale supérieure de police (ENSP), destinée à une cohorte regroupant des membres des trois corps, et cette première expérience a été unanimement jugée très positive, tant par la hiérarchie que par les participants. Enfin, nous avons entamé une réflexion autour du management. Nous sommes très allants pour développer cultiver un esprit de corps intégré, spécifique, me semble-t-il, à la préfecture de police.
En ce qui concerne la formation initiale, l'attaque survenue samedi 12 mai dernier à Paris a montré que les gardiens étaient bien préparés. J'aimerais signaler la situation de la filière investigation. Je pense qu'il faut, en permanence, adapter la formation initiale au type de police que l'on souhaite mettre en place. Les fonctionnaires doivent être préparés à la fois au pire, aux cas extrêmes, et, en même temps, à la police de sécurité du quotidien, de contact, de partenariat, à la fidélisation dans les quartiers, ... Nous devons bien expliquer que c'est l'un et l'autre, non l'un ou l'autre.
J'en viens à la police de sécurité du quotidien. Nous la mettons en place partout sur la plaque parisienne, c'est-à-dire Paris et la petite couronne, et non seulement dans les « quartiers de reconquête républicaine » (à Aulnay-sous-Bois et Sevran, à Champigny-sur-Marne et Chennevières, ainsi que l'an prochain à Asnières-Gennevilliers-Colombes et dans la zone de sécurité prioritaire des 10e et 18e arrondissements de Paris), qui ne sont pour nous que des pastilles sur lesquelles nous allons faire un effort supplémentaire. La police de sécurité du quotidien, c'est partout.
D'une part, il y a des stratégies locales de sécurité, des partenariats, la police mieux connectée, les téléphones intelligents « Neo », qui sont très appréciés des fonctionnaires parce qu'ils leur font gagner énormément de temps et d'efficacité. D'autre part, avec M. Frédéric Dupuch, nous avons engagé une réforme globale de l'organisation des circonscriptions pour mieux faire apparaître les missions. Il y a deux ensembles de grandes missions. Le premier a trait à la police de sécurité du quotidien, avec « Police Secours », qui doit être sanctuarisée pour être en capacité d'intervenir à tout instant et peut-être faire l'objet, sur certaines plages horaires, d'une mutualisation entre circonscriptions voisines (comme cela était le cas samedi dernier), avec des brigades territoriales de contact et avec les brigades anti-criminalité (BAC). Le second a trait au judiciaire et, compte tenu de nos difficultés, nous réfléchissons à des mutualisations intelligentes. En effet, on peut avoir intérêt à regrouper des activités au niveau pertinent, surtout lorsque cela est complètement neutre pour le public - peu importe, par exemple, l'endroit où se déroule une garde à vue ; en revanche, il faut que l'accueil des plaintes se fasse dans la proximité. Nous n'écartons pas l'idée d'une fermeture nocturne de certains commissariats si très peu de personnes y sont accueillies la nuit ; cela pourrait permettre de dégager des moyens pour déployer des brigades supplémentaires sur la voie publique.
Voici rapidement présentés nos projets pour la police de sécurité du quotidien. Nous commencerons la mise en place de nos circonscriptions rénovées par Nanterre, Saint-Denis, Créteil-Bonneuil et le 20e arrondissement de Paris. Nous développerons partout l'écoute, les capteurs, la présence sur les réseaux sociaux, les modes de patrouille adaptés (vélos tout-terrain et véhicules électriques).

Merci pour vos réponses. Existe-t-il un retard d'investissement sur les parcs automobile et immobilier ?
Par ailleurs, que pensez-vous de la réforme du code de procédure pénale et des outils destinés à faciliter les transcriptions ou les liaisons avec le parquet ? Qu'en est-il et que souhaiteriez-vous de plus ?
Concernant l'aspect procédural, il y a une grande attente de la part des enquêteurs. La montée en puissance du parquet a autorisé des enquêtes préliminaires dans le souci, je pense, de soulager un certain nombre de cabinets d'instruction. De fait, les enquêteurs s'adressent très naturellement au parquet pour solliciter des actes d'investigation et obtenir des outils qui leur paraissent utiles. En parallèle, les textes ont évolué, afin d'instaurer un contrôle, une vérification de ces outils par le juge des libertés et de la détention, saisi par le parquet lui-même. Cet alourdissement du formalisme de la procédure et de la protection des droits, en application de normes européennes qu'il ne s'agit pas du tout de remettre en cause, nécessite des adaptations.

En France, les modes accusatoire et inquisitoire coexistent, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays européens.
La procédure orale n'est pas dans notre culture ; nous avons un mode de procédure écrite, dans lequel tout ce qui est dit doit être retracé et retranscrit. La procédure est donc assez complexe. La moitié des procès-verbaux sont de pure forme, mais ils obèrent néanmoins le temps dédié à l'enquête et l'investigation. Cet alourdissement des procédures est l'un des facteurs de démobilisation des personnels.
Ceux-ci sont donc dans l'attente de dispositifs d'allègement, à la fois sur le fond et sur la forme : outils de bureautique, facilitation des échanges - des projets sont menés avec le ministère de l'intérieur et la chancellerie - et des transmissions de procédures, modification de règles de forme pour sortir de la nécessité de tout retranscrire par écrit et ainsi regagner du temps d'enquête à effectif constant voire en baisse.
Je ne peux pas, à ce jour, mesurer les effets que cela induira à terme, ni sur nos capacités d'investigation, ni sur la mobilisation des enquêteurs et le degré d'attractivité de la filière d'investigation que je défends.
À Paris, l'essentiel (90 à 95 %) des procédures judiciaires, en volume, est réalisé par la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne. Si l'on réduisait de deux heures la durée moyenne d'une garde à vue, nous gagnerions l'équivalent de 200 officiers de police judiciaire sur le territoire de la préfecture de police.
Au-delà du droit, une réflexion plus fondamentale sur les nouvelles technologies et le numérique pourra apporter bien des réponses en termes d'allègement : dématérialisation et outils technologiques constituent une partie de la solution, à droit constant. Nous sommes très allants sur la modernisation. Les tablettes numériques rencontrent un grand succès. Les caméras-piéton devraient équiper à l'avenir tous les équipages.
Nous en avons déjà 600 et 1 300 supplémentaires ont été commandées.
Tout le monde n'est pas encore équipé. Plutôt que de saupoudrer la dotation, nous la distribuons de manière groupée, circonscription par circonscription. Les fonctionnaires ont bien compris que la caméra était pour eux un outil de protection.
L'autre grand sujet est celui des besoins immobiliers. Le ministre de l'intérieur a annoncé un plan extrêmement important, qui comprend des projets sur la plaque parisienne et en Île-de-France, mais le temps de l'immobilier est long.
Comme observateur de la vie publique, je note que l'État a fait des sacrifices touchant au coeur des fonctions régaliennes - police, gendarmerie, administration pénitentiaire, justice - au cours des dernières années et qu'il y a maintenant un rattrapage à faire. Compte tenu du fait que le budget de l'État correspond principalement aux dépenses de personnel (titre 2 du projet de loi de finances), l'effort ne semble pas hors de portée et le président de la République a fait état de sa détermination sur ce sujet.

Pouvez-vous nous communiquer les chiffres relatifs au retard d'investissement à la fois sur l'immobilier et sur le parc automobile ?
Sur le parc de véhicules, la moyenne d'âge est légèrement inférieure à sept ans. Au-delà de la question de l'ancienneté, se pose le problème de l'entretien et de la disponibilité du parc. Grâce à des réorganisations internes à la préfecture de police, nous avons pu, au cours des six derniers mois, récupérer 150 véhicules supplémentaires.

Quel effort serait aujourd'hui nécessaire pour rattraper le retard d'investissement et parvenir à maintenir un niveau correct de décence, de dignité et d'efficacité pour les forces de l'ordre ?
Nous vous communiquerons les éléments chiffrés par écrit. Sur l'immobilier, nous pouvons vous donner l'évaluation des besoins à ce jour.

Le commissariat de Coulommiers relève-t-il de la préfecture de police ?
Il dépend du SGAMI Paris et on est venu m'en parler.

À quel rythme - annuel, semestriel, trimestriel - ont lieu les visites auprès de la médecine préventive ? Sont-elles faites à la demande ou programmées ?
Pouvez-vous, par ailleurs, préciser le taux de turnover, ce phénomène semblant occuper une place prépondérante ?
Concernant la médecine de prévention, le rythme dépend du régime d'emploi. En théorie, le médecin de prévention doit voir les fonctionnaires tous les trois ans ; pour ceux travaillant en régime de nuit, il me semble, de mémoire, que ce doit être tous les ans. On a remonté la pente en la matière : en 2017, les 4,5 médecins exerçant à Paris ont effectué 5 500 visites, contre 4 000 en 2016. À chaque fois qu'un fonctionnaire demande à rencontrer un médecin, ou si son service le souhaite, parce qu'il est signalé comme étant « en risque », il est vu.
Le turnover concerne environ 3 000 fonctionnaires par an, sur les 30 000 que compte la préfecture de police ; le taux est donc de 10 % par an. Il affecte toujours les mêmes couches. Dans les grandes brigades centrales et les services spécialisés, il y a un attachement.
Le « mouvement général de l'été », dont les syndicats vous ont peut-être parlé, permet de pourvoir les postes en province. C'est un grand exercice auquel chacun est attaché. Si on veut modifier le paradigme, il faut aussi modifier cet aspect-là. Le sujet est simple à exposer, il est plus compliqué à régler, et il suppose sans doute une concertation et une intelligence collectives.

Monsieur le préfet de police, Messieurs, merci beaucoup de vous être rendus disponibles. Merci aussi aux sénateurs et aux administrateurs.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
La réunion est close à 18 h 15.