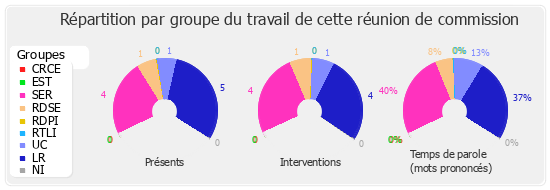Commission d'enquête Evaluation politiques publiques face aux pandémies
Réunion du 8 juillet 2020 à 18h45
La réunion

Mes chers collègues, nous entamons nos travaux avec l'audition de M. Jean Rottner, président de la région Grand Est.
Nous avons souhaité privilégier, dans un premier temps, une approche de la gestion de la crise sanitaire au plus proche des territoires. La région Grand Est a été marquée par les conséquences de la tenue, du 17 au 24 février derniers, d'un rassemblement religieux de plus de 2 000 personnes venues de toute la France et de pays limitrophes qui a joué un rôle de « superpropagateur du virus ».
Nous étions au premier stade de l'épidémie et cet événement a constitué un accélérateur avec des cas recensés, dès la semaine suivante, en Bourgogne-Franche-Comté, dans la Manche et à Paris, mais aussi en Corse ou en Guyane.
Revenir sur cet événement, intervenu relativement précocement dans la chronologie de l'épidémie en France, devrait nous permettre d'examiner les outils d'alerte et de veille qui étaient en place et la façon dont l'épidémie a été prise en charge par la suite. Nous souhaitons aujourd'hui recueillir le retour d'expérience du président de la région.
Qui a piloté la crise dans la région ? Tous les acteurs disponibles ont-ils été sollicités à hauteur de leurs capacités, qu'il s'agisse de la médecine de ville ou des cliniques privées, alors que nous avons tous en tête les images de l'hôpital de campagne déployé à partir du 20 mars par le service de santé des armées et des transferts de malades pour venir soulager les capacités hospitalières ? Comment les Ehpad, qui accueillent des personnes vulnérables, ont-ils été pris en considération ? Quels enseignements en tirer si une autre crise devait survenir ?
Je vais maintenant, conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, vous demander de prêter serment. Je rappelle que tout témoignage mensonger devant une commission d'enquête parlementaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, M. Jean Rottner prête serment.
Je vous laisse la parole pour une présentation d'une dizaine de minutes environ, avant de passer aux questions des rapporteurs, puis des autres membres de notre commission d'enquête.
C'est avec grand respect que je me tiens devant votre commission d'enquête qui réalise un travail indispensable pour avancer et faire face plus efficacement à toute nouvelle crise éventuelle.
Je répondrai à vos questions en tant que président de région, car c'est à ce titre que j'ai joué un rôle dans cette crise qui a affecté ma région, et particulièrement ma ville de Mulhouse, mais aussi avec mon expérience et ma sensibilité de médecin urgentiste et de président du conseil de surveillance du groupement hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace. C'est à ces différents titres que j'essaie de faire preuve de recul et d'une certaine forme d'humilité. Après coup, il est toujours très facile de juger, de se rappeler, de penser que, de croire qu'il eût été...
Dans mes souvenirs, cette crise débute lors d'une réunion à la mairie de Mulhouse au cours de laquelle nous voyons apparaître sur nos écrans une information de la presse locale mentionnant l'existence de deux clusters familiaux à Mulhouse. Nous nous tournons vers le préfet qui nous confirme alors qu'il ne s'agit bien que de clusters familiaux. Nous sommes dans les derniers jours du mois de février.
Les choses s'accélèrent très rapidement entre le 1er et le 3 mars : le 2 mars, un premier patient est admis en réanimation au centre hospitalier de Mulhouse. C'est d'abord le médecin réanimateur qui fait le rapprochement avec le rassemblement religieux et qui évoque la possibilité non pas d'un cluster familial, mais bien d'un vrai foyer épidémique - j'emploie souvent l'expression de « rouleau compresseur épidémique » pour décrire ce qui est arrivé à Mulhouse.
De fait, notre département a dû s'organiser très rapidement pour passer au plan blanc et transformer les hôpitaux de Mulhouse et de Colmar en établissements pratiquement spécialisés dans la prise en charge des malades du covid. La directrice de l'hôpital m'informait de manière très régulière de la situation. Devant l'explosion des appels au SAMU, j'ai décidé d'aller les renforcer pendant quelques heures, le 4 mars. Sur place, je me rends compte qu'il ne s'agit plus d'un cluster : avec une ligne renforcée de médecins et une double régulation, nous arrivons au chiffre impressionnant pour Mulhouse de 2 000 appels, contre 600 ou 700 dans les jours les plus denses, qui concernent tous le même sujet. Les médecins, particulièrement bien préparés, arrivent à faire des diagnostics et à orienter correctement les patients selon qu'ils devaient bénéficier de soins hospitaliers ou rester chez eux en faisant appel à la médecine de ville. La performance médicale a été confirmée par les médecins en place à l'hôpital : ceux qui s'y sont rendus en avaient vraiment besoin. Il n'y a pas eu de surchauffe en raison d'admissions de cas bénins.
Le 5 mars, je me suis fendu d'un SMS au chef de l'État pour l'avertir que la situation à Mulhouse et dans le Haut-Rhin s'apparentait davantage à une épidémie, avec des foyers apparaissant partout, qu'à ce que laissait entendre le discours national selon lequel les choses étaient maîtrisées.
La ville de Mulhouse est passée, dès le 3 mars, en cellule de crise. Des décisions de fermeture d'écoles et de lieux publics, en concertation avec le préfet de département et l'agence régionale de santé (ARS), ont commencé à être envisagées. Une première unité « covid » est ouverte à Mulhouse le 4 mars. Le jour suivant, plusieurs cas ayant une origine mulhousienne sont confirmés à travers l'hexagone. Je fais une tournée des lycées pour répondre aux inquiétudes des élèves, des professeurs, car plusieurs agents sont malades. Je me veux relativement rassurant.
Le 6 mars, les choses s'accélèrent tellement que le Premier ministre décide de faire passer notre département en stade 2 renforcé. Le 7 mars, à l'hôpital de Mulhouse, nous déclenchons le premier plan blanc. Nous nous engageons alors dans une forme de course-poursuite sanitaire. À l'échelle régionale, nous anticipons déjà une crise économique à venir au regard de la fermeture des commerces. Nous prenons donc contact avec le monde économique et envisageons de premières dispositions urgentes.
C'est à ce moment qu'apparaissent, chez nos amis transfrontaliers, de premiers signes d'inquiétude. L'Institut Robert-Koch publie une carte montrant le Grand Est en rouge et recommande aux ressortissants allemands de ne plus venir sur notre territoire. C'est une grosse surprise en Allemagne et chez nous. C'est la préfiguration de plusieurs dispositions comme la fermeture des frontières qui interviennent très vite. Ce sont aussi des mots, prononcés par nos amis allemands, politiques ou non, qui font un peu mal.
Nous ressentons la nécessité de prendre contact avec nos homologues allemands. Le 11 mars, je m'entretiens par téléphone avec trois présidents de Länder pour leur demander de ne pas aller trop vite. Le 12 mars, nous mettons en place une cellule transfrontalière, en concertation avec l'État, avec l'ARS et avec les départements. Depuis la loi « Alsace », le président de région et le préfet ont une forme d'expérimentation diplomatique transfrontalière de proximité. Cela a plutôt bien marché puisque nos amis allemands sont revenus vers nous assez rapidement. Aux alentours du 20 mars, ils nous annonçaient qu'ils étaient prêts à ouvrir leurs lits de réanimation et à venir en renfort, le cas échéant.
Entre le 11 et le 19 mars, juste avant le week-end des élections municipales, nous assistons à une forte augmentation des cas. Nous sommes même assez stupéfaits. En 24 heures, alors que nous souhaitions nous montrer encore un peu rassurants, nous avons dû faire face à plus de 200 admissions supplémentaires entre Colmar et Mulhouse, à 30 patients de plus en réanimation et à 20 décès. On se dit alors que quelque chose de terrible est en train de se passer. Ce sont d'ailleurs les mots que j'emploie dans la presse nationale, le dimanche des élections, pour souligner que nous étions complètement concentrés sur autre chose que les municipales depuis une dizaine de jours...
Les choses se sont enchaînées très vite. C'est à ce moment que sont apparus les défauts d'organisation : infirmières et médecins libéraux nous disent vouloir monter au front, mais souffrir d'un manque d'équipement ; de même, on constate une tension extrême sur tous les équipements hospitaliers de protection - des directeurs d'hôpitaux me disent que leur stock ne leur permettra de tenir que jusqu'au lendemain, voire au surlendemain, mais ignorer ce qu'il en sera ensuite... Nous étions confrontés à de vraies difficultés d'anticipation. Or mon expérience professionnelle m'a toujours démontré qu'il faut, en cas de crise, un back office particulièrement performant pour permettre à ceux qui sont à l'avant de ne pas se poser trop de questions.
Nous avons dû faire face à des difficultés humaines énormes qui laisseront des cicatrices. Le personnel soignant a dû faire face collectivement à la fois à ses propres peurs, à ses propres angoisses, et à sa propre méconnaissance de ce virus pour s'organiser. C'est ce que les hôpitaux mulhousiens ont fait, en pleine coordination - assez rapidement, je tiens à le souligner - avec les hôpitaux privés qui ont proposé de déprogrammer leurs opérations, ce qui nous a permis d'avoir du personnel de réanimation - médecins ou infirmières - supplémentaire, et qui ont ouvert des unités covid.
Cette solidarité entre établissements a joué à l'échelle de notre département, mais aussi à celle de la région : 24 heures sur 24, pendant six ou sept jours, nous avons entendu les hélicoptères au-dessus de nos têtes dans une noria constante vers les centres hospitaliers de proximité - Reims, Charleville, Thionville, Metz, Nancy, Troyes, Saint-Dizier... - qui ont servi de matelas d'amortissement pour les admissions en réanimation.
Le fait régional a pris toute sa signification avec des équipes qui se connaissaient, qui avaient pris l'habitude de travailler ensemble dans des réseaux de réanimation ou d'urgence à l'échelle régionale. Il est important de souligner cette solidarité alors qu'apparaissent de premières polémiques : la proximité médicale entre l'hôpital public et l'hôpital privé a été réelle chez nous, sur le terrain. Elle a dû être renforcée grâce aux moyens de l'État, à travers le dialogue que j'ai pu avoir avec les ministres ou avec l'ARS, ce qui a permis de mettre en place l'hôpital de campagne ou d'obtenir des évacuations militaires par A330.
Nous avons ouvert des salles de réanimation dans les salles d'opération, les salles de réveil étaient pleines, nous avons vraiment « poussé les murs ». En ce qui concerne la polémique selon laquelle on ne réanimait plus au-delà d'un certain âge, les statistiques, notamment celles de Paris, montrent que les admissions en réanimation liées à l'âge sont restées stables cette année, même avec la crise du covid. Les médecins ont toujours fait preuve du même état d'esprit qu'en période non épidémique, à savoir éviter toute perte de chance. Or ces transferts ont justement permis de limiter les pertes de chance pour les patients qui avaient besoin de soins de réanimation de longue durée, une fois stabilisés. En général, les patients étaient transférés au bout du septième jour. Nos amis transfrontaliers ont largement joué le jeu et ont été d'un grand secours : en temps normal, nous sommes coincés à 180 degrés par nos frontières ; là, nous avons pu oeuvrer à 360 degrés et transférer des patients jusqu'en Autriche.
Je voudrais revenir sur la question du matériel, et notamment sur les masques, qui a défrayé la chronique. L'initiative de Bruno Retailleau a permis aux collectivités de commander des masques. Je l'ai fait et j'en ai informé le Premier ministre. Ces masques étaient destinés aux médecins généralistes, aux infirmières qui étaient au front, aux personnels de secours, aux personnels des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), qui étaient un peu « à la ramasse », et même aux avocats commis d'office ou aux vétérinaires. Bref, à toute une panoplie de professionnels qui se trouvaient dans une situation compliquée, faute de masques.
Nous avons commandé 5 millions de masques, par le biais d'un mini-appel d'offres à sept importateurs. Nous en avons retenu trois, qui étaient connus des centres hospitaliers français. Nous avons eu la chance de passer notre commande quelques jours avant l'arrivée sur le marché des Américains. Une petite bataille avec l'État a eu lieu ensuite, sur laquelle nous pourrons revenir. Les masques ont été distribués avec le soutien des conseils départementaux, dans les structures d'accueil médico-sociales ou sociales.
Compte tenu du manque criant de matériel de protection, j'avais demandé à l'ensemble de mes services de sortir tous les masques qui étaient à notre disposition. Les lycées en possédaient 600 000. J'ai également fait appel à la générosité des entreprises, nombre d'entre elles possédant encore des stocks dits « Bachelot ». En 24 heures, nous avons récolté 1,3 million de masques, qui ont été distribués aux médecins généralistes, dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, les Vosges et en Moselle.
J'ai moi-même décroché mon téléphone pour organiser les choses dans le Haut-Rhin, par l'intermédiaire du syndicat des pharmaciens, de manière à ce que la répartition puisse s'organiser. Ayant encore des contacts dans ce domaine, j'ai pu ainsi simplifier la tâche. Ce système a d'ailleurs été repris par l'ARS, et l'Union régionale des professionnels de santé a proposé en quelques heures une application permettant de répartir harmonieusement les masques. L'intelligence, la rapidité, et la situation de crise nous ont permis d'inventer ensemble de nouveaux systèmes.
En cet instant, je souhaite apporter un témoignage humain. Dans le cadre des contacts que j'ai pu avoir avec les professionnels de santé, j'ai été frappé par l'intensité des événements qu'ils ont vécus. Ainsi, un chef de service m'a raconté, avec des sanglots dans la voix, qu'il n'avait pas eu le temps d'expliquer ce qui se passait aux infirmières, lesquelles étaient parfois complètement dépassées. Quand on voit une personne qui se porte bien, il est difficile de comprendre son décès deux heures plus tard.
Nous avons très vite mis en place, dans nos hôpitaux, une cellule de soutien psychologique à nos soignants. Une directrice s'est posé la question de savoir si elle devait créer une cellule psychologique de la cellule psychologique. Cela montre la force du tsunami qui nous a atteints, qui a atteint la population et inquiète encore aujourd'hui. Si j'ai pu m'élever contre le fait que notre territoire soit classé « rouge » trop longtemps, c'est parce que nous avons besoin de nous relever et de retrouver la confiance. Durant cette crise, nous nous sommes efforcés, en tant qu'hommes et femmes politiques, d'accompagner les uns et les autres.

En tant que président de région, vous avez évoqué ce que pouvaient être les difficultés rencontrées par les collectivités territoriales pour l'achat de matériel. À quels autres tatillonnages administratifs avez-vous dû faire face ? Comment avez-vous géré la graduation des besoins sur l'ensemble des départements de la région Grand Est ?
Par ailleurs, vous avez mentionné la prise en charge de patients par les hôpitaux d'autres départements moins touchés ou par des établissements privés. Qu'est-ce qui a justifié l'envoi de patients loin de leur domicile ? Pourquoi ne sont-ils pas restés dans le Grand Est ?
S'agissant du début de la vague épidémique, vous avez évoqué les nombreux appels au SAMU. Quelle place ont eu alors les tests ? Comment avez-vous vécu les conseils donnés le 6 mars à la population, qui les encourageaient à vivre normalement ?
Enfin, pour ce qui concerne la situation actuelle, vous avez évoqué les difficultés des personnels soignants et les conséquences psychologiques de cette épreuve. Assiste-t-on aujourd'hui à une reprise normale des activités dans les établissements hospitaliers ?
S'agissant des transferts, nos capacités de réanimation étaient dépassées. Les médecins, les centres hospitaliers et l'ARS ont organisé cette noria de transferts, justement pour qu'il n'y ait pas de pertes de chance. En quelques minutes, il fallait prendre la décision d'intuber. Ainsi, au service d'accueil des urgences à Mulhouse, il y avait parfois six patients à intuber en attente de trouver un lit. Par conséquent, les patients dont l'état était stable en réanimation devaient être transférés, d'abord à l'échelle régionale, ensuite à l'échelle interrégionale et enfin à l'échelle internationale.
Je le rappelle, un patient atteint du covid a une réanimation longue - de quatre à cinq semaines -, techniquement complexe et spécifique.
Nous avons commencé par des transferts de proximité. Ensuite, nous avons eu le support de l'armée, dans le cadre de l'opération Morphée. Puis a été implanté un hôpital de campagne, qui accueillait les patients déjà stabilisés. Parallèlement, nous avons eu recours au transport par TGV et hélicoptère, pour les lits disponibles en proximité. Si Mulhouse et Colmar ont été très fortement atteints dès le début, l'épidémie n'a sévi à Strasbourg qu'après quatre ou cinq jours d'écart, ce qui a permis à la ville d'anticiper et de s'organiser. Ainsi Strasbourg a-t-il servi d'amortisseur, comme plus tard Nancy, puis Reims. La Moselle a été touchée beaucoup plus fortement, contrairement à la Meurthe-et-Moselle. C'est une réalité qui a été peu évoquée.
Pour ce qui concerne les tests, seuls les gens à l'hôpital ont été testés. Telle était la doctrine. Le nombre de lignes de régulation a été doublé puis triplé, et quatre à cinq médecins répondaient 24 heures sur 24 aux appels. Les laboratoires n'étaient pas équipés pour faire les tests. Au départ, seuls trois laboratoires avaient la capacité de les réaliser. Ensuite, les laboratoires universitaires, puis les centres hospitaliers généraux, puis les laboratoires privés ont reçu l'autorisation de les mettre en oeuvre. Tout cela a été très progressif.
Après la décision de fermer les espaces publics et les écoles, j'appelais encore la population à se rendre dans les commerces de proximité. Je dois le dire, je me suis planté ! En effet, en quelques heures, la vague épidémique est arrivée. Avec trente patients supplémentaires en réanimation et vingt décès en l'espace de vingt-quatre heures, nous avons fait face à une aggravation massive du rythme. Cette accélération a eu lieu la semaine précédant les élections municipales.
Quant à la reprise, elle est en cours. Depuis le 1er juillet, le centre hospitalier de Mulhouse n'est plus en plan blanc. Mais les stigmates sont là : les équipes sont épuisées, et 800 des 6 000 employés ont été malades. La reprise est donc progressive ; elle doit se faire dans le cadre d'une sécurité sanitaire maximale. Ainsi, les blocs opératoires ayant servi de salles de réanimation doivent absolument être désinfectés. Tout cela prend du temps et coûte de l'argent. Aujourd'hui, malgré les aides de l'État, la facture est négative.
Je tiens toutefois à évoquer un point de satisfaction. Des établissements qui n'avaient pas pour habitude de travailler ensemble - je pense aux relations entre le public et le privé ou même entre Colmar et Mulhouse - continuent à dialoguer, ce que j'estime encourageant. On ne referme pas la porte de l'épisode covid, on s'efforce d'en tirer les leçons par des actes et des organisations différentes. Je me prépare à une nouvelle crise, ce qui devrait nous permettre de définir localement une programmation et une organisation de la santé et des soins, fondées sur la confiance entre collègues, entre établissements, et sur une meilleure coopération. Il faudra verser de l'eau et beaucoup d'engrais pour qu'on ne retrouve pas les vieilles habitudes.

Je vous remercie de votre témoignage éclairant et émouvant.
Ma première question concerne votre déclaration à France Bleu le 16 mars dernier, dans laquelle on perçoit la panique qui s'empare du Grand Est. Vous dites que la France ne mesure pas la gravité de la situation et que les Français doivent rester chez eux. Vous parlez de tension extrême, vous dites qu'on a surestimé la capacité des Français à faire les bons gestes pour se prémunir et vous reconnaissez que vous ne pensiez pas ainsi 48 heures plus tôt.
Dans cette perspective, j'aimerais savoir ce qui vous a permis, à un moment donné, de respirer. Quelle action ou conjonction d'actions vous a fait reprendre espoir ? Quelle est pour vous l'organisation idéale ? Que referiez-vous ? Que ne referiez-vous pas ?
Ensuite, vous avez évoqué une « petite bataille avec l'État » lors de la commande des masques. S'agit-il de ce qui est arrivé à la région Bourgogne-Franche-Comté, l'État ayant fait main basse sur les commandes des collectivités ?
Enfin, avant d'être président du conseil régional du Grand Est, vous en étiez vice-président, chargé de la compétitivité des territoires et du numérique. Je voudrais recueillir votre avis sur l'importance du numérique dans la gestion de cette crise. Je pense aux téléconsultations médicales, mais aussi à l'enseignement à distance.
Je vous remercie d'avoir évoqué la notion de « respiration », qui m'est chère. Quand on est médecin urgentiste de formation, on ne se désespère pas face à un arrêt cardiaque ! Arrêter une réanimation est toujours une décision grave.
La respiration a été possible grâce à la solidarité. Les soignants se sont serré les coudes, malgré les difficultés hospitalières. La solidarité citoyenne a été exceptionnelle, et la solidarité territoriale et internationale s'est également manifestée.
Je le dis honnêtement, quand le chef de l'État ou le président du Sénat m'ont appelé pour m'annoncer le renfort de l'État, ce fut une respiration. Les soignants souriaient largement en disant : « On nous a enfin entendus ! » Cela a permis de faire repartir la machine.
L'arrivée de l'hôpital militaire, l'A330, le renfort des collègues de la région, ont apporté des espaces de respiration, non pas à moi, mais aux soignants. Je suis allé leur donner un coup de main, mais on ne peut pas être et avoir été. En tant qu'élu à la tête d'un exécutif, j'ai un devoir d'alerte, d'action, et de réaction. J'avais la possibilité d'agir à côté de l'État. C'est cette souplesse qu'on peut regretter ou discuter.
Emmanuel Galiero, journaliste du Figaro, m'avait appelé pour connaître ma position sur un éventuel report des élections. Je lui avais répondu que le sujet n'était pas là.
En voyant les images des Buttes-Chaumont, des quais de Seine, on s'aperçoit que les Parisiens ignorent ce qui est en train de se passer dans leur pays, alors que leurs compatriotes meurent chaque jour. On a le sentiment que personne ne comprend ce qui est en train de se passer. Quand le Gouvernement prend la bonne décision de venir en soutien, c'est le premier espace de respiration pour l'ensemble des équipes hospitalières. Pour avoir fait régulièrement le tour des directeurs de centres hospitaliers universitaires (CHU) et des chefs de service, je peux vous dire que certains jours, ils n'en pouvaient plus. Ils avaient épuisé leurs stocks NRBC - nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques - et ne savaient plus comment protéger leurs collègues. Or, quand on est patron d'un service, on se sent éminemment responsable de ses collaborateurs : infirmières, aide-soignantes, agents d'entretien, hôtesses d'accueil, secrétaires...
Sur les relations avec l'État, je me suis prononcé, et j'ai eu des paroles assez sévères sur l'ARS, considérant que c'était avant tout une agence de gestion budgétaire, et pas d'organisation et de gestion de crise. Je maintiens ces propos. Je sais que l'ARS compte des gens extrêmement compétents, qui ont fait leur maximum. Mais l'anticipation nécessite aussi de voir comment les choses se passent sur le terrain : un hélicoptère EC-135 ne peut pas atterrir dans les mêmes conditions qu'un Caïman. Cela, un médecin urgentiste le sait. Mais s'il doit passer par une régulation nationale et obtenir l'accord d'un médecin dans le cadre d'une régulation zonale par l'ARS, au lieu que les choses se fassent de médecin à médecin, il a l'impression de recevoir de l'énergie négative, là où il devrait y avoir une énergie positive.
Sur cette fameuse bataille des masques, je peux vous donner des explications. Nous avons mis dix jours à nous organiser, et sélectionné trois importateurs, pour parer tout risque de défaillance. Nous avons commandé 5 millions de masques, et en avons finalement reçu 6,6 millions. Il se trouve que nous partagions un importateur avec l'État. Je respecte éminemment le rôle de l'ARS, tout comme les décisions administratives, que je ne conteste pas. Dans le premier avion, il y avait moins de masques que prévu. L'État en prend une part, j'en prends une autre, et Mme Dufay, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, s'aperçoit qu'il ne lui reste plus rien. Je lui propose de passer mon tour, mais - c'était un dimanche matin, je m'en souviens - mon téléphone sonne à sept heures moins le quart et mes équipes me disent qu'elles n'ont pas accès à l'avion, que celui-ci est entouré de militaires, et que le stock est réquisitionné. J'essaie de joindre le préfet de région, le préfet de département, je n'y arrive pas ; je finis par joindre la préfète, qui me fait part de la décision prise, compte tenu des incertitudes vis-à-vis de l'importateur, qui ne tenait pas toujours ses promesses en termes de nombre par cargaison. Dont acte. L'importateur avait deux avions, nous avons donc attendu deux ou trois jours de plus. Mais cette décision n'avait pas été prise le dimanche matin à sept heures moins le quart... On aurait pu nous le dire ! Ce genre de détail complique les relations entre les uns et les autres.
Oui, la téléconsultation a fait un bond. Si vous avez quelque influence sur l'assurance maladie, dites-lui que nous ne devons pas revenir en arrière ! Notre région a offert à tous ses lycéens, dans les établissements volontaires, un ordinateur, et nous connecterons tous les foyers de la région au très haut débit d'ici à 2023. Sur les données, c'est très compliqué. Grâce à l'intelligence artificielle, nous avons la capacité de détecter la réactivation d'une épidémie. Voilà des semaines que nous bataillons pour obtenir un outil adéquat, malgré les garanties d'anonymisation et de partage des informations. Pour progresser dans la connaissance et le suivi des épidémies dans notre pays, c'est indispensable.

Merci pour votre témoignage passionnant. Vous avez vécu une situation singulière. D'autres régions, comme l'Île-de-France, ont vécu une forte épidémie, mais vous, vous avez quasiment vécu une situation de médecine de catastrophe, n'ayant bénéficié d'aucun délai pour vous préparer.
Dans les tout premiers jours du mois de mars, vous nous avez décrit une mise en gestion avec l'ensemble des partenaires au niveau de votre région. Vous ne nous avez pas parlé des rapports avec l'État. Avez-vous reçu du ministère, à ce moment-là, des instructions claires ? Vous expliquez avoir accompli des tâches, comme la répartition des masques, qui ne faisaient pas partie de votre rôle. Le 2 mars, quand le foyer épidémique est apparu, et que l'alerte a été diffusée, les moyens des hôpitaux avaient-ils déjà été renforcés ? Au Sénat, près d'une semaine auparavant, nous avions interrogé les autorités nationales sur cette question.
Vous avez publié le 28 avril une tribune dans laquelle, parlant de la gestion d'une crise sanitaire, vous dites qu'il faut un pilote unique et qu'il y a eu trop de désordres, avec des rôles trop dispersés, la délimitation des tâches n'étant pas claire. Dans la gestion d'une telle crise, qui doit être le pilote unique, au niveau national et au niveau des territoires ?
J'aurai du mal à répondre à votre première question sur l'état des forces début mars, car cela ne relève pas vraiment de ma compétence. Il est vrai que les collectivités territoriales se sont arrogé des champs de compétence pour compenser la passivité des systèmes qui étaient à la peine. Pour ma part, j'ai toujours essayé de ne pas dépasser mes limites. Je n'ai pas effectué de gestion directe du matériel ou de l'organisation. Je sais que Mulhouse n'a pas souffert, par exemple, d'un manque de matériel, malgré de fortes tensions. À Colmar, le chef de pôle des urgences m'avait indiqué qu'il avait épuisé son stock NRBC et ne savait plus où trouver du matériel de protection pour ses équipes.
Je ne pense pas que les moyens des hôpitaux de ma région avaient été augmentés avant le mois de mars, pour se préparer à la crise. Nous avons attendu très longtemps des respirateurs supplémentaires, notamment.
Pour le président de région que j'étais, il a toujours été simple d'avoir un dialogue assez fluide avec le ministre de la santé, le Premier ministre, l'entourage du Président de la République, voire même le Président de la République lui-même.
Pour moi, il est indispensable d'avoir un pilote unique. Le préfet de région, le préfet de zone peuvent jouer ce rôle. Mais cette crise sanitaire a été entièrement gérée par le ministère de la santé. Comme président de région, je n'ai pas eu de rapports avec la direction générale de la santé, mais avec l'ARS, et les préfets. Le préfet de zone de défense, lui, a la possibilité de mobiliser l'armée, les moyens civils, les moyens sanitaires... En matière de coordination, il aurait été préférable d'avoir une coordination par le ministère de l'intérieur, sous la responsabilité du préfet zonal de défense. D'ailleurs, en cas de catastrophe, le patron des opérations de secours, c'est bien le préfet. Nous aurions dû respecter ce schéma pour éviter les conflits de compétences. Dans une telle crise, il faut des directives et une hiérarchie verticale.

Vous avez dit que les transferts s'étaient bien déroulés, et qu'ils étaient nécessaires pour libérer des places en réanimation. Mais les professionnels de santé ne se sont pas sentis écoutés et maîtres de leurs transferts. Les ordres de transfert venaient-ils du haut - de Paris - ou y a-t-il eu une vraie coordination et une vraie entente sur les patients à transférer ? On nous a dit que certains patients ont été transférés non par manque de place dans les hôpitaux mais par manque de matériel. En prévision d'une éventuelle autre crise, ne faudrait-il pas rassembler des stocks de matériel pour éviter ce type de transferts ? Sur la e-santé, la régionalisation des données serait une bonne chose. Comment la région peut-elle la favoriser ?
La plateforme e-Meuse, qui fait de la télémédecine, proposait de commencer à bâtir une forme de collecte de données au niveau régional et départemental, en fonction des projets. Là aussi, faisons confiance : la décentralisation, ce n'est pas seulement transférer des compétences de l'État aux régions. Nous avons la France en partage, sa gestion et son progrès, et les territoires doivent se sentir responsables, ne pas tout demander à l'État, et être une partie de la solution. Nous pouvons avancer en ce sens, en favorisant les projets transversaux qui concernent la santé, le soin et le bien-être. Nous avons 210 millions d'euros de budget consacrés à la santé et aux soins...
Les transferts ont été compliqués au début, puis sont devenus spontanés. Les transports sanitaires sont extrêmement onéreux : un transfert en A330 représente six équipages d'ambulanciers, d'infirmiers et de médecins, et prend du temps.
Un certain nombre de professionnels ont eu le sentiment que cela leur échappait : il faut savoir où et comment on fait atterrir un NH90 Caïman, comment on l'équipe, comment on le médicalise... Ils nous disent aussi que, tant qu'ils n'avaient pas obtenu le coup de tampon de l'ARS, les transferts n'étaient pas possibles, surtout depuis l'étranger.
L'action du SAMU zonal, dont les référents locaux étaient plutôt des anesthésistes-réanimateurs, a forcé la proximité, mais ceux qui ne sont pas au front tout le temps n'ont pas les mêmes notions que ceux qui travaillent en réanimation. Je pense qu'il faut avoir là de la souplesse et de l'agilité.
Je sais que, sur les deux centres hospitaliers les plus proches de mon lieu de vie, les transferts ont été faits essentiellement sur des critères médicaux. Éviter la perte de chance est véritablement ce qui a guidé les équipes médicales.

Dans le département de la Marne, les choses n'ont pas été aussi simples, notamment s'agissant des relations entre le public et le privé. La méconnaissance par l'ARS de toute une partie du secteur et le manque de volonté d'associer le privé ont conduit à des situations assez extravagantes. Pour ce qui concerne le médico-social, les départements n'ont reçu des instructions que le 26 mars... On voit bien que l'administration, en France, est assez lourde et met parfois plus de grains de sable que de gouttes d'huile dans les rouages.
Alors que nous réfléchissions sur la régionalisation de la santé, j'avais proposé que le conseil de surveillance des ARS soit présidé par le président de région ou son représentant. Pensez-vous que nous parviendrions à mieux cibler les décisions en période de crise s'il y avait une décentralisation plutôt qu'une déconcentration ?
Vous avez parfaitement raison sur les Ehpad : notre temps de réaction et notre retard ont été inqualifiables.
Sur les sujets médico-sociaux et sociaux, faisons confiance aux départements ! Il faut qu'il y ait un patron responsable. Les présidents de conseil départemental sont des personnes responsables. Ils sont en capacité d'anticiper, d'accompagner, de prendre des décisions adéquates, de décompter. Les problèmes de décompte ont duré pendant des jours. Je ne m'explique pas les différences de chiffres qu'il a pu y avoir d'un jour à l'autre.
Aujourd'hui, nous sommes en capacité de mettre en place des organisations locales qui nous permettent d'avoir des observatoires, des référencements, des données quasi automatiques. Les régions ont des compétences. Actuellement, elles sont freinées, faute d'autorisations ou en raison de problème de sécurisation ou de souveraineté des données.
C'est le président du conseil régional qui doit présider l'ARS, et personne d'autre. D'ailleurs, ce serait une erreur de confier cette compétence au président de région « ou à son représentant ». La santé est aujourd'hui l'une des premières préoccupations des Français. Le président de l'ARS doit être un élu du territoire, qui connaisse ce territoire, qui favorise la coopération, qui travaille avec les centres hospitaliers universitaires, lesquels ont un rôle majeur dans l'aménagement du territoire. Je pense à la magnifique convention entre le CHU de Reims et Troyes, qui permet d'avoir des praticiens hospitaliers à temps partagé. C'est ce genre de solutions, inventées sur les territoires par les acteurs du territoire, qui doivent être mises en avant.
Il ne s'agit pas de faire plaisir au président du conseil régional en lui permettant de diriger une structure supplémentaire. Il s'agit de répondre à une logique de création, d'équité, d'égalité et d'aménagement du territoire - celui-ci est désormais crucial -, alors que la colère est toujours présente, plus particulièrement sur les questions de santé.
Il y a quatre déterminants pour que les gens s'installent sur un territoire : le très haut débit, les mobilités, la formation et la santé. Les collectivités, particulièrement les régions, interviennent dans ces quatre domaines. En matière de santé, il faut clarifier les choses. Tout le monde s'en est rendu compte avec la crise.
Il faut une responsabilité départementale, avec une délégation territoriale de l'ARS, en lien avec le préfet du département, pour une gestion de proximité du médico-social, du social et de la psychiatrie. C'est très important : on passe aujourd'hui à côté de soins qui sont absolument essentiels. Il faut peut-être une coordination au niveau régional, au travers d'ARS qui seraient plus stratégiques. Osons, à l'instar de certains pays européens, poser la question de la place et de la responsabilité des collectivités locales.
Je suis prêt, à l'image de ce que l'on fait pour les lycées, à prendre la responsabilité à la fois du matériel et des bâtiments hospitaliers. Pour des raisons d'aménagement du territoire, je pourrais décider de ne pas fermer un hôpital et de prendre en charge son déficit de fonctionnement. Nous sommes actuellement dans une vision beaucoup trop budgétaire. Quand on ferme deux maternités sur un même secteur, c'est dramatique pour l'ensemble du territoire concerné, mais il faut aussi parfois accepter de fermer une maternité parce que la sécurité sanitaire n'est pas assurée. En tant qu'élus locaux, nous sommes habitués à prendre ce genre de décisions. Ce que je refuse dorénavant, c'est que l'on nous demande de panser les plaies ouvertes par des décisions administratives et de calmer la vindicte populaire qu'elles suscitent. C'est dans cet esprit de proximité qu'il faut agir aujourd'hui. Les territoires doivent travailler en lien avec les structures de santé, déconcentrées ou non.
Les élus locaux ne peuvent exercer un simple rôle de représentation à la tête du conseil de surveillance. Nous devons être à la tête d'un conseil d'administration, avec un pouvoir de décision et de management. Il faut que le directeur ne soit pas une courroie de transmission de l'ARS, mais qu'il ait lui aussi la possibilité d'agir et soit responsabilisé. Les médecins et les équipes médicales qui sont à la tête des hôpitaux doivent jouer un rôle majeur. Il faut rétablir cette confiance et que chacun puisse assumer pleinement son rôle.
La vindicte qui s'exprime parfois contre les ARS n'est pas gratuite. Le système doit être amélioré. Les ARS ont de vraies compétences, mais nous en avons aussi. Nos directeurs ont des compétences. Nos médecins ont des compétences. Il faut aujourd'hui que la verticalité laisse place à une vraie transversalité dans les actions pour répondre à l'attente de nos concitoyens.

Des soignants de l'hôpital de Colmar ont-ils dû travailler sans protections adéquates ou se bricoler des protections ?
Estimez-vous, à ce stade, que le nombre de lits de réanimation était insuffisant ? Faudrait-il prévoir, pour l'avenir, une certaine proportion de lits de réanimation dans les hôpitaux, partout sur le territoire ? Visiblement, cette proportion était moins importante en France qu'en Allemagne...
Diriez-vous que le problème des masques est désormais réglé ? De nouveaux problèmes pourraient-ils se poser en cas de deuxième vague ou de nouvelle pandémie ?
Les 800 employés des hôpitaux de Mulhouse et Colmar qui ont été malades souffrent-ils de séquelles ? Ne pensez-vous pas que l'on devrait intégrer au cursus de formation des soignants un module sur la manière de faire face à une pandémie, notamment virale ?
Enfin, vous nous avez dit qu'il faudrait un pilote, mais n'estimez-vous pas qu'il serait peut-être nécessaire que vous travailliez en lien direct avec l'État ? On a l'impression que vous n'avez pas véritablement eu la possibilité de tirer la sonnette d'alarme pendant plusieurs jours.
Pour ce qui est du matériel, oui, il y a indéniablement eu du bricolage, mais de manière exceptionnelle. Le système D a existé. Le monde entrepreneurial a soutenu certains hôpitaux. Nous avons tous, sur ce plan, une très grande marge de progrès.
Aujourd'hui, je pense que la situation, en termes de masques, de tests, de réactifs, est stabilisée. Grâce à nos entrepreneurs, nous avons mis des masques en production. Nous avons même désormais un surplus de masques... Nous avons aussi créé, à cette occasion, la première société d'économie mixte locale médicale, avec la Banque des territoires et le Crédit Mutuel. Nous nous sommes dit que nous allions utiliser nos propres réseaux, à l'image de ce qui a existé pour les masques, pour commander des tests sérologiques PCR, des masques PCR et des écouvillons, qui nous manquaient. Finalement, nous n'avons pas eu à utiliser les fonds que nous avions prévu d'engager. L'outil existe toujours et est prêt à être réactivé en cas de problème. Nous avons su faire preuve d'imagination pour inventer un outil assez agile et très rapide.
Bien sûr, il manque certainement des lits de réanimation au quotidien en France. Il s'agit là d'un choix de société, qui aura des incidences sur les dépenses d'assurance maladie et sur le budget de la santé. Nous sommes face à un nouveau pacte social en France. La santé en fait largement partie. Aujourd'hui, acceptons-nous l'existence d'un déficit chronique et des d'établissements qui ne sont pas à l'équilibre ? C'est une décision qu'il faudra discuter, qui dépasse peut-être le seul Ségur de la santé et qui doit être acceptée par la population en général. Cela ne veut pas dire qu'il faut surconsommer du soin, au contraire. Un nouveau pacte social, c'est à la fois plus d'exigence et plus de justice. Aujourd'hui, le tiers payant permet à n'importe quel Français de ne pas connaître le coût de ses médicaments. Certains citoyens qui en ont la capacité pourraient peut-être participer en partie à cette prise en charge.
Le choix de créer des lits de réanimation supplémentaires doit être fait collectivement. Nous devrions peut-être aussi le faire en tant que représentants de la Nation.
La différence avec l'Allemagne ne tient pas seulement au nombre de lits de réanimation. Elle réside aussi dans une stratégie différente, et peut-être dans un lien plus fort et mieux organisé autour du patient entre la médecine libérale et la médecine hospitalière, doublé de lits de soins intensifs et de réanimation - les lits de soins intensifs sont moins équipés, mais convertibles assez rapidement en lits de réanimation. Contrairement à nous, les Allemands ont très rapidement mis au point un test PCR et ont testé massivement. Ils n'ont pas non plus subi le même rouleau compresseur viral que nous avons connu, en région puis dans tout le pays.
Aujourd'hui, la formation aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques existe très souvent dans le cursus des médecins et du personnel soignant. En l'espèce, nous avons été dépassés à la fois par l'ampleur du risque viral, par une impréparation de nos équipes à travailler ensemble et par la difficulté de mobiliser les moyens matériels.
Faut-il des stocks ? Ceux-ci coûtent cher... Si l'on fait ce choix, qui les entretient ? Où les localise-t-on ? Il existait quelques stocks de masques en France, mais on a vu combien il était difficile de les utiliser.
Comment une organisation régionale, permettant de réagir très rapidement, peut-elle éventuellement se mettre en place ? Cela pose à nouveau la question du chef de file, du patron. L'armée peut entretenir, en région, un centre d'intervention en hôpital militaire. Le Sénat vient d'ailleurs de publier un excellent rapport sur le service de santé des armées. On voit bien que ses moyens ont largement diminué et qu'il faut les soutenir. Il a fait la preuve de son efficacité et de son savoir-faire sur le terrain opérationnel qui est celui de la métropole. Heureusement qu'il était là...
Pour ce qui concerne la formation, avec la crise sanitaire, bon nombre d'étudiants infirmiers et aides-soignants ont bénéficié d'une fabuleuse master class... Notre région fait partie de celles qui les ont gratifiés financièrement, ce qui était normal.
Mais oui, il faut aujourd'hui changer de paradigme et peut-être s'engager clairement dans un transfert de compétences médicales vers le personnel infirmier, au-delà des pratiques avancées. En période de crise, les infirmiers doivent potentiellement être beaucoup plus présents. Or, aujourd'hui, une infirmière en pratique avancée gagne 50 euros de plus par mois : cela n'encourage pas vraiment les vocations.

Vous avez évoqué votre situation géographique et souligné le fait que vous êtes dans une zone frontalière. Le Gouvernement français a-t-il pris aussi contact avec les Allemands pour appuyer vos démarches ? Aviez-vous l'habitude de faire des évacuations sanitaires vers l'Allemagne avant cette crise ?
J'avais des échanges quasi quotidiens avec Amélie de Montchalin, qui travaillait aussi avec Jean-Yves Le Drian sur les relations avec le gouvernement de Mme Merkel. Nous devions aussi gérer les problèmes découlant de la fermeture des frontières, pour les frontaliers comme pour les marchandises. Cela n'a pas été simple, surtout lorsqu'un ministre d'un Land voisin a déclaré que chaque Français repoussé sauvait la vie à un Allemand ! Bref, il y a eu une très bonne coordination entre la préfète, moi-même, Amélie de Montchalin et Jean-Yves Le Drian sur ces sujets. Les contacts transfrontaliers entre médecins ont aussi joué pour accélérer les choses. Il a fallu mettre en avant la confiance, au-delà de la peur primaire et populaire qui régnait.
Oui, nous sommes en zone frontalière. J'aimerais que Paris regarde ces zones avec les yeux de l'amour, en se disant que nous sommes les marins de la terre en Europe, et que nous pouvons être une chance pour la France, en étant non une zone d'exception, mais d'expérimentation. Chez nous, la santé fait partie des irritants du quotidien. Si l'on fait un infarctus au bord de la frontière, et qu'on est transporté dans un hôpital français situé à trois quarts d'heure de route, alors que, de l'autre côté de la frontière, un centre hospitalier peut vous accueillir à dix minutes de chez vous, ce n'est pas normal dans un espace européen de coopération. Nous avons quatre frontières, et des accords commencent à peine à se mettre en place. Les accords d'Aix-la-Chapelle aideront à soigner ces irritants du quotidien, mais une des leçons de la crise est bien que nous devons faire en sorte qu'il soit facilement possible de se faire soigner de part et d'autre de la frontière, d'autant qu'il y a des centres d'excellence des deux côtés.

Mon département, l'Oise, a été le premier atteint, et a payé un lourd tribut, même s'il a été un peu moins touché que le Grand Est. Merci pour vos réflexions sur l'optimisation du système de santé, et sur les ARS. Vous nous avez parlé d'un SMS au chef de l'État le 4 mars au soir, et avez évoqué les difficultés dans les réquisitions de masques. Certaines demandes précises que vous avez faites ont-elles été prises en considération immédiatement, et suivies de décisions?
L'Oise avait quinze jours d'avance sur nous, en effet, et je sais que nos médecins ont beaucoup échangé pour connaître la situation. J'avais envoyé un SMS de soutien à l'ancien sous-préfet de Mulhouse, Louis Lefranc, qui est préfet de ce département, pour lui souhaiter un bon rétablissement, car il avait été infecté. Pour ma part, j'essaie toujours de rester à ma place, même si j'ai parfois fait jouer mes réseaux pour débloquer certaines situations.
Le rassemblement religieux représentait environ 2 000 personnes, avec quelque 300 enfants, scolarisés dans 75 écoles, je crois. La question, pour le préfet - et il l'a partagée avec les élus - était de décider s'il fallait fermer les écoles, ou non. Il y a eu des allers-retours avec le ministère de l'intérieur et celui de la santé, et l'hésitation a duré jusqu'au 6 mars, je crois, date à laquelle le Premier ministre a tranché, ce qui était bienvenu, et a renforcé l'action du préfet. La maire de Mulhouse a même décidé d'aller plus loin en fermant un certain nombre d'établissements publics. Pour ma part, je n'ai pas revendiqué de fermetures ; j'ai simplement donné l'alerte. Les signaux que j'ai fait remonter ont été entendus, comme l'a montré la décision, prise le 16 mars, d'envoyer des renforts de l'armée à Toulouse. Il est vrai que j'ai eu des échanges avec le Président du Sénat, avec le cabinet du Président de la République, avec le Premier ministre et avec Olivier Véran.

Quel est votre regard, a posteriori, sur les initiatives spectaculaires qui ont concerné votre région ? Je pense, par exemple, à la question des transferts, par TGV, de malades vers d'autres régions. Le rapport rendu par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France juge sévèrement cette initiative et la considère comme de la pure communication. De même, l'hôpital de campagne était-il utile et indispensable ?
Vous avez indiqué que la coordination avec les établissements privés avait été bonne dans votre région, ce qui va à l'encontre de ce qu'on entendait dans les médias. Vous insistez sur la nécessité d'un pilote unique. J'essaie de dénombrer le nombre d'interlocuteurs de l'État avec lesquels vous avez dû échanger : on comprend tout de suite le problème ! Ce sont sans doute les préfets de zone qui sont les bons interlocuteurs. Pourquoi est-ce plutôt le ministère de la santé qui a joué ce rôle ? Au cours des dernières semaines, qu'est-ce qui a changé ? Nous sommes ici pour essayer de tirer les leçons pour demain...
Sur les TGV, je trouve le rapport sévère, et même injuste. Il est toujours très facile de critiquer a posteriori... L'hôpital de campagne, les TGV, l'A330, la noria d'hélicoptères, l'ouverture de lits frontaliers : tout cela a constitué autant de vraies bouffées d'oxygène.
Sur la coopération entre le privé et le public, les responsables de l'ARS et les préfets pourront sans doute mieux vous répondre que moi. De mon point de vue, sur mon territoire, elle s'est bien passée, même si ce n'était pas évident, compte tenu des antécédents et des rivalités. Du côté de Strasbourg, il y a eu un temps de latence. Mais, sous la pression de la réalité, et grâce à la responsabilité de chacun, les choses se sont faites, ce qui n'a peut-être pas été le cas sur d'autres territoires moins exposés. Je ne connais pas les chiffres, mais je vous apporte simplement mon témoignage d'élu local mulhousien, alsacien, connaissant la situation et échangeant avec les CHU, qui ont souvent joué un rôle d'amortisseur. Face aux circonstances, le devoir d'agir a toujours conduit à mettre en place une forme d'organisation.
Des changements ? Vive la décentralisation et la confiance ! Vive la possibilité d'expérimenter ! L'État doit faire confiance aux territoires. En l'occurrence, il y avait à la fois un débat scientifique et un débat idéologique sur la répartition des rôles. Et les médecins, pour sympathiques qu'ils soient, ne sont pas toujours faciles à gérer : on a vu s'exprimer à la télévision de grandes rivalités. Il y a eu beaucoup de lourdeurs. Par exemple, il a fallu attendre pendant des semaines la validation de tests sérologiques réalisés chez nous, dans notre institut de virologie. Une telle lenteur n'est pas concevable dans un pays moderne, agile ! Résultat, la colère est là. Il faut plus de souplesse, ce qui ne revient pas à ce que chacun puisse faire n'importe quoi dans son coin : il faut respecter le principe d'égalité républicaine, même si je préfère la notion d'équité.
Bref, cette crise a révélé une certaine lourdeur française, qui doit être corrigée. Je pense aussi à un deuxième mammouth, celui de l'éducation nationale, dont le fonctionnement est similaire. Comme élu local, je suis passionné de mon territoire et de ma région. Je me suis efforcé de communiquer sans entrer dans la polémique, au moment où je devais dire les choses, parce qu'il fallait de l'huile dans les rouages. Si l'état d'esprit change, la santé ne pourra qu'en bénéficier.

Je suis sénateur des Français établis hors de France. Il n'y a qu'une vingtaine de mois que je suis rentré en France, et je ne maîtrise pas l'intégralité de la machinerie administrative que vous avez décrite. Toutefois, j'ai été très surpris que ce soit le ministère de la santé et non celui de l'intérieur qui soit le chef de file. Une question est revenue souvent, même si elle a été évincée des plateaux de télévision. J'ai entendu dire que la lutte entre privé et public existait bien dans le Grand Est. J'aimerais avoir une réponse claire. Il y a eu de nombreuses prouesses en matière d'évacuations, en TGV, en avion, en hélicoptère. Ces évacuations résultaient-elles du fait qu'il ne restait plus aucun lit covid-19 dans la région, ni dans le privé, ni dans le public ? J'ai entendu dire qu'il restait environ 70 lits disponibles dans le privé, dans la région Grand Est, au moment où des malades ont été évacués vers Bordeaux et d'autres régions... Pourquoi n'arrivons-nous pas à avoir une réponse précise à cette question ?
Je ne cherche pas à éviter la question, mais je ne dispose tout simplement pas des informations. Cela ne relève pas de ma compétence : il n'entrait pas dans mon rôle de disposer de ces informations. Cette question relève de la stratégie de l'organisation hospitalière, dont la région ne s'est pas occupée. Comme élu local dans mon département, j'ai une connaissance fine et quotidienne de la réalité, mais je ne suis pas en mesure de vous répondre sur la disponibilité en lits de réanimation dans les autres structures des autres départements de ma région, car je n'ai jamais eu accès à ces données.

À Lyon, le système a été complètement différent, puisque ce sont les Hospices civils de Lyon qui ont pris la tête, et il y a eu trois pôles, avec un hôpital public et deux hôpitaux privés dans chaque zone. Malgré la pression, nous avons immédiatement mis en place une architecture conjuguant hôpital et secteur privé.
Je suis maire de Bron depuis dix-sept ans, et j'ai tous types d'hôpitaux dans ma commune. Mais vous n'avez pas évoqué l'action de Santé publique France. À Lyon, sur la gestion des masques, l'ARS a renvoyé la balle à Santé publique France, dont les colis n'arrivaient pas à Lyon... Or, la doctrine de Santé publique France est d'anticiper, comprendre et agir. Avez-vous eu de bons échanges avec cette instance ?
J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit sur l'égalité et l'équité, parce que nous avons des normes égalitaires qui ne sont pas très équitables... En temps de crise, il faut aussi des signaux, par forcément financiers : je pense notamment à des signaux humains, qui font voir à la population et aux professionnels qu'on est là, que les élus sont là. Je vous trouve bien humble, lorsque vous dites que vous restez scrupuleusement à votre place. Ne faut-il pas que les élus aient un rôle beaucoup plus central dans la gestion des crises, et notamment dans la gouvernance de l'hôpital ? En ne siégeant qu'au comité de surveillance, on ne peut pas agir dans ce type de situations. Les associations d'élus pourraient se mettre autour de la table pour faire des propositions à l'État afin de devenir des acteurs à part entière, avec l'État, qui est, lui, morcelé entre les ARS, les préfectures et Santé publique France, qui se renvoient la balle. Les élus ont une place de proximité, connaissent le terrain et peuvent pousser des coups de gueule justifiés.
Nous nous sommes interrogés, à Lyon, sur les taux de mortalité. Vos données font-elles apparaître des taux sur la mortalité en réanimation, notamment pour les malades qui ont été transférés ?
Santé publique France, beaucoup d'élus et de responsables ne savaient pas ce que c'était. C'est un interlocuteur qui doit jouer un rôle, mais nous ne l'avons pas vu directement. Humble ? En temps de crise, il fallait être extrêmement précis, voire chirurgical, sur les actions que nous menions, afin de ne pas ajouter au chaos. Cela nous imposait de rester dans notre rôle de collectivité territoriale. Or nous n'avons pas de compétence franche en matière de santé, mis à part un peu de formation.
Je revendique, en matière de gestion, une place extrêmement forte pour les collectivités, et plus particulièrement pour le conseil régional et le conseil départemental. Le rôle des maires, à la tête du conseil de surveillance, doit être un vrai rôle d'administration, avec un pouvoir, des perspectives et des prérogatives - et une forme de responsabilisation, aussi. J'ai travaillé à la question avec Olivier Véran, dans le cadre du Ségur de la santé. Régions de France m'a désigné pour réaliser une synthèse de propositions permettant, au niveau des régions, de prendre pied dans une forme de décentralisation liée à la santé. La volonté est là, donc. Mais nous étions en crise, dans une organisation que nous connaissons et où il fallait parfois entrer par la porte, parfois par la fenêtre, notamment pour obtenir les données. Par exemple, j'ai demandé à l'ARS de faire un travail de corrélation et de compilation des données, afin qu'on puisse anticiper un développement de la maladie à l'échelle régionale, et l'on m'a répondu que je sortais de mon rôle.
Il faut donc changer de paradigme. Nous devons sortir d'une vision administrative du monde : l'élu peut non seulement demander des comptes, mais aussi participer à la prise de décision en temps de crise car, sur le terrain, il joue un rôle essentiel d'accompagnement. Les collectivités doivent donc se voir définir un rôle en matière de santé, et l'assumer : en période de crise, il faut prendre ses responsabilités, comme on l'a bien vu pour la réouverture des écoles. Les élus aussi doivent changer de paradigme, et ne pas avoir peur des questions de santé, qui font partie du pacte social et renvoient à des choix collectifs sur le budget, les choix et les implantations des structures de soins.
Chez nous, le taux de mortalité est celui qu'ont connu tous ceux qui ont fait de la réanimation. L'ARS et les équipes médicales et hospitalières vous renseigneront mieux que je ne saurais le faire.

N'avez-vous pas le sentiment que l'arrivée massive, sur les chaînes de télévision, d'épidémiologistes et de virologues a participé à l'angoisse de nos concitoyens ?
Je connais et j'apprécie le milieu médical. Je connais aussi ses faiblesses, grandes et petites. Je sais la compétition qui y règne. Sur la chloroquine, la question n'est pas de savoir si l'on est pour ou contre, mais de voir quels sont les résultats des essais cliniques ! La médecine, c'est l'expertise, l'expérience, l'humilité aussi, bref c'est la science. Hors de cela, point de salut.

Merci.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
La réunion est close à 20 h 35.