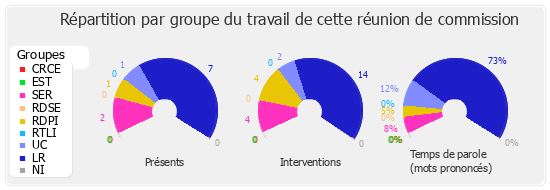Commission d'enquête Évaluation politiques publiques face aux pandémies
Réunion du 28 juillet 2020 à 14h30
Sommaire
La réunion
Table ronde de praticiens

Nous poursuivons nos travaux en examinant la gestion de la crise sanitaire du point de vue d'acteurs de terrain dans différents territoires, avec l'audition conjointe de MM. Alain Mercat, chef du service de médecine intensive-réanimation du CHU d'Angers, Albert Birynczyk, président du syndicat national des urgentistes de l'hospitalisation privée, Bernard Llagonne, chirurgien à la clinique d'Épernay, Serge Smadja, secrétaire général de SOS Médecins France et Marc Noizet, chef du pôle urgences et du SAMU à l'hôpital Muller de Mulhouse.
Notre objectif est de déterminer si la réponse apportée à la crise sanitaire a bien été adaptée à la situation de territoires très différents, dont certains ont été fortement touchés par l'épidémie et d'autres beaucoup moins. Nous nous interrogeons notamment sur le point de savoir si chacun des acteurs a bien été mobilisé à la hauteur de ses capacités, qu'il s'agisse des cliniques privées ou de la médecine de ville, mais aussi sur les conséquences du déclenchement du plan Blanc et de la déprogrammation massive des interventions sur la prise en charge d'autres pathologies.
Je demanderai à ceux de nos intervenants qui souhaitent prendre la parole à titre liminaire de présenter brièvement leur principal message, afin de laisser le maximum de temps aux échanges. Je demanderai à chacun d'être concis dans ses prises de parole et, en ce qui concerne les sénateurs, d'indiquer précisément à qui leur question s'adresse.
Messieurs, je rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Vous êtes appelés à prêter serment. J'invite chacun d'entre vous à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire : « Je le jure. »
Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, MM. Alain Mercat, Albert Birynczyk, Bernard Llagonne, Serge Smadja, et Marc Noizet prêtent serment.

Nous poursuivons nos travaux en examinant la gestion de la crise sanitaire du point de vue d'acteurs de terrain dans différents territoires, avec l'audition conjointe de MM. Alain Mercat, chef du service de médecine intensive-réanimation du CHU d'Angers, Albert Birynczyk, président du syndicat national des urgentistes de l'hospitalisation privée, Bernard Llagonne, chirurgien à la clinique d'Épernay, Serge Smadja, secrétaire général de SOS Médecins France et Marc Noizet, chef du pôle urgences et du SAMU à l'hôpital Muller de Mulhouse.
Notre objectif est de déterminer si la réponse apportée à la crise sanitaire a bien été adaptée à la situation de territoires très différents, dont certains ont été fortement touchés par l'épidémie et d'autres beaucoup moins. Nous nous interrogeons notamment sur le point de savoir si chacun des acteurs a bien été mobilisé à la hauteur de ses capacités, qu'il s'agisse des cliniques privées ou de la médecine de ville, mais aussi sur les conséquences du déclenchement du plan Blanc et de la déprogrammation massive des interventions sur la prise en charge d'autres pathologies.
Je demanderai à ceux de nos intervenants qui souhaitent prendre la parole à titre liminaire de présenter brièvement leur principal message, afin de laisser le maximum de temps aux échanges. Je demanderai à chacun d'être concis dans ses prises de parole et, en ce qui concerne les sénateurs, d'indiquer précisément à qui leur question s'adresse.
Messieurs, je rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Vous êtes appelés à prêter serment. J'invite chacun d'entre vous à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire : « Je le jure. »
Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, MM. Alain Mercat, Albert Birynczyk, Bernard Llagonne, Serge Smadja, et Marc Noizet prêtent serment.
Outre mes fonctions de chef de service et de président de la commission médicale d'établissement (CME) au CHU d'Angers, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire m'a chargé, au début de la crise, de coordonner l'offre de soins de réanimation sur l'ensemble de la région, laquelle a été modérément touchée par cette crise.
En préambule, je dois vous informer que j'ai des liens d'intérêts avec des sociétés qui commercialisent essentiellement des appareils d'assistance respiratoire. Il s'agit d'une activité d'expertise rémunérée et du financement de travaux de recherche sans lien direct avec le covid-19.
Sur le fond, je dois dire que l'activation du plan Blanc a été l'occasion d'un bouleversement du mode de fonctionnement des CHU et que les centres hospitaliers en général ont fait preuve de réactivité, ce qui a été une très bonne surprise. Souvent vues comme lourdes, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, les structures hospitalières, dont les CHU, ont su, en quarante-huit heures, se libérer de la contrainte budgétaire et adapter leur offre de soins aux besoins de la population. L'ensemble des personnels a fait preuve d'un sens des responsabilités et de l'intérêt public absolument exemplaire.
Au début, cette crise a été appréhendée comme relevant des structures hospitalières, et non comme un défi pour l'ensemble du système de santé, ce qui m'apparaît être un point faible de la réponse qui lui a été apportée.
Outre mes fonctions de chef de service et de président de la commission médicale d'établissement (CME) au CHU d'Angers, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire m'a chargé, au début de la crise, de coordonner l'offre de soins de réanimation sur l'ensemble de la région, laquelle a été modérément touchée par cette crise.
En préambule, je dois vous informer que j'ai des liens d'intérêts avec des sociétés qui commercialisent essentiellement des appareils d'assistance respiratoire. Il s'agit d'une activité d'expertise rémunérée et du financement de travaux de recherche sans lien direct avec le covid-19.
Sur le fond, je dois dire que l'activation du plan Blanc a été l'occasion d'un bouleversement du mode de fonctionnement des CHU et que les centres hospitaliers en général ont fait preuve de réactivité, ce qui a été une très bonne surprise. Souvent vues comme lourdes, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, les structures hospitalières, dont les CHU, ont su, en quarante-huit heures, se libérer de la contrainte budgétaire et adapter leur offre de soins aux besoins de la population. L'ensemble des personnels a fait preuve d'un sens des responsabilités et de l'intérêt public absolument exemplaire.
Au début, cette crise a été appréhendée comme relevant des structures hospitalières, et non comme un défi pour l'ensemble du système de santé, ce qui m'apparaît être un point faible de la réponse qui lui a été apportée.
Je vous remercie tout d'abord de nous donner l'occasion de témoigner devant votre commission d'enquête.
L'ensemble des établissements privés de France et de leurs personnels se sont très fortement mobilisés contre l'épidémie de covid-19. Nous avons participé à la gestion hospitalière de cette crise en complémentarité avec le système public. Les organisations que nous avons mises en place étaient conformes au guide de préparation et de gestion des situations sanitaires exceptionnelles.
L'application du plan Blanc en deux phases a entraîné la déprogrammation des activités chirurgicales et médicales non urgentes dès le 13 mars, ce qui a permis de libérer des lits, d'éviter la saturation et d'organiser nos établissements en zones covid et non-covid. L'organisation de circuits spécifiques au sein des services des urgences, avec une séparation entre des unités covid, des unités non-covid et des unités tampons pour les patients en attente de confirmation du diagnostic, a permis une prise en charge médicale sécurisée et une orientation adaptée des patients. On peut considérer que l'ensemble des services des urgences des établissements privés a opté pour cette organisation, même dans les zones à faible activité virale.
Durant cette crise, la grande majorité des admissions dans nos services des urgences provenaient de la régulation par le centre 15, mais de nombreux patients étaient adressés par nos confrères de ville ou se présentaient de leur propre initiative. Nous avons constaté une réduction drastique de la fréquentation, de l'ordre de 50 % à 70 % en fonction des territoires, principalement durant la période de confinement. On peut expliquer cette baisse par le renoncement aux soins de patients qui avaient peur de contracter le virus en milieu hospitalier et par la diminution générale des activités que nous avons constatée en France - circulation automobile, activités sportives... Nous avons connu à peu près la même baisse d'activité que les établissements publics. Les patients qui se présentaient avaient une raison tout à fait valable de le faire - ils étaient parfois dans une situation plus grave qu'en temps normal en raison des retards de prise en charge dont je viens de parler.
En conclusion, je le répète, l'hospitalisation privée a bien participé à la prise en charge de la crise du covid. Nous n'avons pas eu le sentiment d'être complètement mis à l'écart. Néanmoins, du fait des procédures spécifiques liées aux situations sanitaires exceptionnelles, les patients étaient orientés en priorité vers des établissements de niveau 1 ou 2 et certains établissements ont peut-être eu l'impression d'avoir servi de soupape au système.
Je vous remercie tout d'abord de nous donner l'occasion de témoigner devant votre commission d'enquête.
L'ensemble des établissements privés de France et de leurs personnels se sont très fortement mobilisés contre l'épidémie de covid-19. Nous avons participé à la gestion hospitalière de cette crise en complémentarité avec le système public. Les organisations que nous avons mises en place étaient conformes au guide de préparation et de gestion des situations sanitaires exceptionnelles.
L'application du plan Blanc en deux phases a entraîné la déprogrammation des activités chirurgicales et médicales non urgentes dès le 13 mars, ce qui a permis de libérer des lits, d'éviter la saturation et d'organiser nos établissements en zones covid et non-covid. L'organisation de circuits spécifiques au sein des services des urgences, avec une séparation entre des unités covid, des unités non-covid et des unités tampons pour les patients en attente de confirmation du diagnostic, a permis une prise en charge médicale sécurisée et une orientation adaptée des patients. On peut considérer que l'ensemble des services des urgences des établissements privés a opté pour cette organisation, même dans les zones à faible activité virale.
Durant cette crise, la grande majorité des admissions dans nos services des urgences provenaient de la régulation par le centre 15, mais de nombreux patients étaient adressés par nos confrères de ville ou se présentaient de leur propre initiative. Nous avons constaté une réduction drastique de la fréquentation, de l'ordre de 50 % à 70 % en fonction des territoires, principalement durant la période de confinement. On peut expliquer cette baisse par le renoncement aux soins de patients qui avaient peur de contracter le virus en milieu hospitalier et par la diminution générale des activités que nous avons constatée en France - circulation automobile, activités sportives... Nous avons connu à peu près la même baisse d'activité que les établissements publics. Les patients qui se présentaient avaient une raison tout à fait valable de le faire - ils étaient parfois dans une situation plus grave qu'en temps normal en raison des retards de prise en charge dont je viens de parler.
En conclusion, je le répète, l'hospitalisation privée a bien participé à la prise en charge de la crise du covid. Nous n'avons pas eu le sentiment d'être complètement mis à l'écart. Néanmoins, du fait des procédures spécifiques liées aux situations sanitaires exceptionnelles, les patients étaient orientés en priorité vers des établissements de niveau 1 ou 2 et certains établissements ont peut-être eu l'impression d'avoir servi de soupape au système.
Chirurgien orthopédiste libéral depuis 31 ans, j'exerce dans une clinique de moyenne importance située dans un territoire d'environ 100 000 habitants. Toutes les cliniques de ce type sont en grande difficulté financière. Nous ne sommes pas labélisés « urgences » et nous n'avons pas de service de réanimation, mais nous faisons beaucoup de chirurgie - nous avons cinq salles d'opération - et nous disposons d'une salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI) qui permet d'installer huit postes de respirateur adaptés. Même si notre clinique n'a pas de service de réanimation, nous assurons 55 % de l'activité chirurgicale de notre territoire.
Je suis président de la commission médicale d'établissement et nous sommes en train de constituer une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS). Je suis par ailleurs vice-président du Bloc, syndicat qui représente les chirurgiens, les anesthésistes et les obstétriciens, président du syndicat des orthopédistes et vice-président de l'union régionale des professionnels de santé libéraux du Grand-Est.
Afin que nous soyons d'accord sur les termes que nous employons, je préciserai que, pour moi, un hôpital est public et une clinique est privée à but lucratif - ce terme est peut-être dépassé, mais il est consacré. Je mets à part les établissements de santé privés d'intérêt collectif (Espic), qui se rapprochent davantage d'un hôpital du fait de leur mode de financement.
Pour nous, la crise a commencé dès février, d'autant que deux de nos médecins anesthésistes sont italiens, l'un étant originaire de Bergame. Le 2 mars, nous avons tenu une réunion de la CPTS en phase de constitution, qui a rassemblé 104 personnes ; un médecin généraliste présent a eu le covid, mais aucun autre participant à cette réunion n'a contracté le virus. Au sein de l'URPS, nous avons eu des réunions régulières sur le covid dès le mois de février. Le Conseil national de l'Ordre des médecins nous a adressé une alerte le 3 mars.
Le 16 mars, nous avons arrêté toute activité chirurgicale au bloc opératoire, ce qui a été un séisme pour un établissement comme le nôtre qui ne fait quasiment que de la chirurgie. Du coup, nous nous sommes retrouvés avec des stocks colossaux de masques, d'équipements de protection individuels et de solution hydroalcoolique, alors que tout le monde criait à la pénurie. Nous avions aussi du personnel dévoué, ainsi que des lits et des chambres libres. Bref, tout pour recevoir des patients ! Mais personne ne nous a été adressé les deux premières semaines.
Nous avons donc été choqués, pendant cette crise, par le manque de coopération entre les hôpitaux et les cliniques, ces dernières n'ayant pas été sollicitées durant les deux premières semaines. Ce choc a été accentué lorsque nous avons appris les transferts de patients organisés à grand renfort de moyens de transport et de médiatisation, à un moment où des lits étaient vacants dans les cliniques... Nous avons également été mis à l'écart lors de la reprise d'activité, puisque celle-ci a été organisée dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire (GHT), dont nous sommes exclus.
Nous avons aussi été choqués par certaines « petites phrases », dont celle-ci, de la part d'un directeur de CHU : « Il est injuste que les cliniques poursuivent une activité chirurgicale programmée, alors que l'hôpital public n'est plus en mesure de le faire. C'est une forme de concurrence déloyale. »
En conclusion, les cliniques et les praticiens qui y exercent ont le sentiment que les hôpitaux ont souhaité mener seuls la guerre contre le covid.
Chirurgien orthopédiste libéral depuis 31 ans, j'exerce dans une clinique de moyenne importance située dans un territoire d'environ 100 000 habitants. Toutes les cliniques de ce type sont en grande difficulté financière. Nous ne sommes pas labélisés « urgences » et nous n'avons pas de service de réanimation, mais nous faisons beaucoup de chirurgie - nous avons cinq salles d'opération - et nous disposons d'une salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI) qui permet d'installer huit postes de respirateur adaptés. Même si notre clinique n'a pas de service de réanimation, nous assurons 55 % de l'activité chirurgicale de notre territoire.
Je suis président de la commission médicale d'établissement et nous sommes en train de constituer une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS). Je suis par ailleurs vice-président du Bloc, syndicat qui représente les chirurgiens, les anesthésistes et les obstétriciens, président du syndicat des orthopédistes et vice-président de l'union régionale des professionnels de santé libéraux du Grand-Est.
Afin que nous soyons d'accord sur les termes que nous employons, je préciserai que, pour moi, un hôpital est public et une clinique est privée à but lucratif - ce terme est peut-être dépassé, mais il est consacré. Je mets à part les établissements de santé privés d'intérêt collectif (Espic), qui se rapprochent davantage d'un hôpital du fait de leur mode de financement.
Pour nous, la crise a commencé dès février, d'autant que deux de nos médecins anesthésistes sont italiens, l'un étant originaire de Bergame. Le 2 mars, nous avons tenu une réunion de la CPTS en phase de constitution, qui a rassemblé 104 personnes ; un médecin généraliste présent a eu le covid, mais aucun autre participant à cette réunion n'a contracté le virus. Au sein de l'URPS, nous avons eu des réunions régulières sur le covid dès le mois de février. Le Conseil national de l'Ordre des médecins nous a adressé une alerte le 3 mars.
Le 16 mars, nous avons arrêté toute activité chirurgicale au bloc opératoire, ce qui a été un séisme pour un établissement comme le nôtre qui ne fait quasiment que de la chirurgie. Du coup, nous nous sommes retrouvés avec des stocks colossaux de masques, d'équipements de protection individuels et de solution hydroalcoolique, alors que tout le monde criait à la pénurie. Nous avions aussi du personnel dévoué, ainsi que des lits et des chambres libres. Bref, tout pour recevoir des patients ! Mais personne ne nous a été adressé les deux premières semaines.
Nous avons donc été choqués, pendant cette crise, par le manque de coopération entre les hôpitaux et les cliniques, ces dernières n'ayant pas été sollicitées durant les deux premières semaines. Ce choc a été accentué lorsque nous avons appris les transferts de patients organisés à grand renfort de moyens de transport et de médiatisation, à un moment où des lits étaient vacants dans les cliniques... Nous avons également été mis à l'écart lors de la reprise d'activité, puisque celle-ci a été organisée dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire (GHT), dont nous sommes exclus.
Nous avons aussi été choqués par certaines « petites phrases », dont celle-ci, de la part d'un directeur de CHU : « Il est injuste que les cliniques poursuivent une activité chirurgicale programmée, alors que l'hôpital public n'est plus en mesure de le faire. C'est une forme de concurrence déloyale. »
En conclusion, les cliniques et les praticiens qui y exercent ont le sentiment que les hôpitaux ont souhaité mener seuls la guerre contre le covid.
Je commencerai par présenter rapidement quelques chiffres concernant SOS Médecins : nous regroupons 1 300 médecins répartis en 63 associations et nous recevons environ 6,3 millions d'appels par an, qui donnent lieu à un peu moins de 4 millions d'actes. Nous sommes un service libéral, mais nous assurons en pratique beaucoup de missions de service public : permanence des soins, conventions avec les SAMU, interventions dans les prisons et les commissariats, notamment en cas de garde à vue... Nous avons aussi mis en place un centre assez original de prise en charge des femmes victimes de violences. Nous collaborons également avec de nombreux acteurs privés du système de santé ou du secteur médico-social. Autre exemple de mission de service public que nous assumons, nos chiffres d'activité font partie des indicateurs utilisés par Santé publique France pour surveiller la circulation du virus.
Nous organisons la réponse à la demande de soins de plusieurs manières : la régulation, la visite à domicile, la tenue de points fixes de consultation et la téléconsultation. Depuis le début de l'épidémie, notre réseau a pris en charge un peu moins de 70 000 patients covid, dont le premier cas constaté en France - c'était à Bordeaux. Au pic de l'épidémie, notre réseau voyait environ 2 500 patients covid par jour. Nous avons donc été présents dans la prise en charge des patients durant toute cette crise.
Quels sont les principaux messages que je souhaite véhiculer ?
SOS Médecins, c'est avant tout des visites à domicile, même si nous pratiquons également la téléconsultation depuis le début de cette crise. Nous avons cherché à évoluer pour nous adapter à la situation, mais la visite à domicile est un aspect indispensable de notre prise en charge. Ne l'oublions pas, sinon il n'y aura plus personne pour l'effectuer, d'autant qu'elle est peu pratiquée par nos confrères. Si on ne la revalorise pas, cela va poser des problèmes. La téléconsultation a été très utile, mais dans beaucoup de situations il a fallu aller au domicile pour se rendre compte de l'état clinique des patients. Tout ne pouvait pas être réglé en téléconsultation.
Second message, mettre en place un accès unique aux soins pour le patient est une erreur. Nos concitoyens doivent pouvoir bénéficier de plusieurs accès aux soins. Les patients doivent continuer à appeler les structures qu'ils ont l'habitude de solliciter. Il me paraît absolument indispensable que les professionnels de santé, hospitaliers, libéraux ou privés, se coordonnent. C'est d'ailleurs comme cela que nous travaillons avec la plupart des SAMU, avec qui nous avons de bonnes relations. Toutefois, cela mérite d'être amélioré. À titre d'exemple, nous avons signé depuis 2005, dans toutes les structures en France, des conventions de collaboration avec les SAMU. Il y est précisé que nous sommes interconnectés. Cette interconnexion est téléphonique. Quinze ans après, il n'y a pas beaucoup d'endroits où l'interconnexion informatique existe. Il est pourtant urgent de la mettre en place. Ce serait plus utile que de créer un nouveau numéro ou une nouvelle strate pour prétendument simplifier un dispositif. On l'a bien vu : l'accès unique est plus un danger pour nous qu'autre chose.
Je commencerai par présenter rapidement quelques chiffres concernant SOS Médecins : nous regroupons 1 300 médecins répartis en 63 associations et nous recevons environ 6,3 millions d'appels par an, qui donnent lieu à un peu moins de 4 millions d'actes. Nous sommes un service libéral, mais nous assurons en pratique beaucoup de missions de service public : permanence des soins, conventions avec les SAMU, interventions dans les prisons et les commissariats, notamment en cas de garde à vue... Nous avons aussi mis en place un centre assez original de prise en charge des femmes victimes de violences. Nous collaborons également avec de nombreux acteurs privés du système de santé ou du secteur médico-social. Autre exemple de mission de service public que nous assumons, nos chiffres d'activité font partie des indicateurs utilisés par Santé publique France pour surveiller la circulation du virus.
Nous organisons la réponse à la demande de soins de plusieurs manières : la régulation, la visite à domicile, la tenue de points fixes de consultation et la téléconsultation. Depuis le début de l'épidémie, notre réseau a pris en charge un peu moins de 70 000 patients covid, dont le premier cas constaté en France - c'était à Bordeaux. Au pic de l'épidémie, notre réseau voyait environ 2 500 patients covid par jour. Nous avons donc été présents dans la prise en charge des patients durant toute cette crise.
Quels sont les principaux messages que je souhaite véhiculer ?
SOS Médecins, c'est avant tout des visites à domicile, même si nous pratiquons également la téléconsultation depuis le début de cette crise. Nous avons cherché à évoluer pour nous adapter à la situation, mais la visite à domicile est un aspect indispensable de notre prise en charge. Ne l'oublions pas, sinon il n'y aura plus personne pour l'effectuer, d'autant qu'elle est peu pratiquée par nos confrères. Si on ne la revalorise pas, cela va poser des problèmes. La téléconsultation a été très utile, mais dans beaucoup de situations il a fallu aller au domicile pour se rendre compte de l'état clinique des patients. Tout ne pouvait pas être réglé en téléconsultation.
Second message, mettre en place un accès unique aux soins pour le patient est une erreur. Nos concitoyens doivent pouvoir bénéficier de plusieurs accès aux soins. Les patients doivent continuer à appeler les structures qu'ils ont l'habitude de solliciter. Il me paraît absolument indispensable que les professionnels de santé, hospitaliers, libéraux ou privés, se coordonnent. C'est d'ailleurs comme cela que nous travaillons avec la plupart des SAMU, avec qui nous avons de bonnes relations. Toutefois, cela mérite d'être amélioré. À titre d'exemple, nous avons signé depuis 2005, dans toutes les structures en France, des conventions de collaboration avec les SAMU. Il y est précisé que nous sommes interconnectés. Cette interconnexion est téléphonique. Quinze ans après, il n'y a pas beaucoup d'endroits où l'interconnexion informatique existe. Il est pourtant urgent de la mettre en place. Ce serait plus utile que de créer un nouveau numéro ou une nouvelle strate pour prétendument simplifier un dispositif. On l'a bien vu : l'accès unique est plus un danger pour nous qu'autre chose.
Je tiens à vous remercier de cette invitation et de l'occasion que vous donnez aux acteurs de terrain, confrontés en première ligne à la violence de cette crise, de venir témoigner devant vous.
Je suis le chef du service des urgences et du SAMU 68 à l'hôpital de Mulhouse. J'assume par ailleurs des missions de coordonnateur du Réseau et Observatoire des urgences Grand-Est, qui travaille quotidiennement pour les cinquante-deux services des urgences de la région, en lien avec l'ARS, pour en améliorer le fonctionnement global.
Mon établissement comprend 1 250 lits MCO (médecine, chirurgie, obstétrique), dont 36 lits de réanimation. Il couvre un bassin de population de 400 000 habitants, ce qui en fait le deuxième centre hospitalier général en termes de taille et d'activité. Le SAMU 68 gère à peu près 200 000 dossiers médicaux de régulation par an. Nous accueillons près de 120 000 patients sur les différents sites des urgences de l'établissement.
Si, dès la fin de février, comme tous les établissements de France, nous nous apprêtions à accueillir des cas suspects de covid - situation aggravée par notre proximité avec l'Italie -, c'est le 1er mars que nous avons été confrontés brutalement à la réalité de cette crise, qui nous a submergés en quelques jours avec une cinétique excessivement violente, ne nous laissant, pendant près de six semaines, aucune capacité à anticiper. Je souhaite donc ici témoigner du contraste des situations entre les différents territoires nationaux, car mon département a vécu quelque chose d'exceptionnel.
La précocité de la crise par rapport au reste du territoire national et la suractivité que nous avons constatée ont été la conséquence directe d'un rassemblement cultuel qui s'est tenu dans l'agglomération de Mulhouse du 17 au 23 février. Ce rassemblement de 2 000 à 3 000 personnes a donné lieu à un foyer épidémique majeur et à une dispersion non contrôlée, à une période où on ne parlait que de « petite grippe » et où les gestes barrières et l'isolement n'étaient encore que des concepts.
Premier point, le Haut-Rhin a été un département sinistré de manière hors norme comparativement au reste du territoire. Mon établissement a accueilli plus de 2 000 patients covid, dont plus de 365 en réanimation. L'activité du centre 15 a été multipliée par quatre et nous avons transféré 330 patients de réanimation lourde dans d'autres départements pour permettre le maintien de nos capacités d'accueil et de prise en charge. Ces 330 patients représentent la moitié des patients transférés pour toute la France.
Deuxième point, nous avons vécu un décalage important dans la compréhension nationale de la gravité de la situation à laquelle nous étions confrontés. Cela a donné lieu à des recommandations qui étaient inapplicables sur notre territoire et à un retard dans l'envoi de renforts humains et de moyens pourtant nécessaires - je pense en particulier aux équipements de protection individuels. Début mars et pendant plus de quinze jours, nous nous sommes sentis réellement isolés.
Troisième point, nous avons été confrontés à une difficulté de pilotage de gestion de la crise au niveau régional, notamment en ce qui concerne la coordination de la disponibilité des lits de réanimation et les transferts inter-établissements, en raison, d'une part, d'outils numériques inadaptés, et, d'autre part, d'un manque d'expertise dans la gestion de crise de nos tutelles régionales.
Quatrième point, nous avons été confrontés à une difficulté dans les choix stratégiques, thérapeutiques et d'orientation liée à une méconnaissance de la maladie, à une gestion de crise avec des moyens saturés et contraints, à une incidence plus importante des formes graves chez les patients âgés et polypathologiques et à la sollicitation à un niveau hors norme de nos unités de réanimation.
Cinquième point, nous avons assisté à une collaboration inédite public-privé -preuve que tous les territoires n'ont pas vécu la même situation - et ville-hôpital, avec une flexibilité organisationnelle et des innovations qui nous ont permis d'éviter la saturation des structures hospitalières, qu'elles soient publiques ou privées. En très peu de temps, public et privé ont travaillé ensemble, y compris grâce à l'échange de professionnels. Nous avons par exemple accueilli des anesthésistes du privé dans nos services de réanimation.
Cette crise était probablement difficilement prévisible. Notre système de santé s'est transformé dans sa globalité et s'est adapté pour y faire face. Le retour d'expérience est nécessaire pour mutualiser nos apprentissages régionaux. Il est important de désenclaver nos fonctionnements, qui ont toujours tendance à s'organiser en silos. Si l'hôpital public, dans certains endroits, a défendu son propre périmètre, ce n'était pas pour ne pas travailler avec le privé, mais par méconnaissance et par crainte de l'inconnu. Il importe donc d'améliorer la coordination et la communication entre les acteurs.
Je tiens à vous remercier de cette invitation et de l'occasion que vous donnez aux acteurs de terrain, confrontés en première ligne à la violence de cette crise, de venir témoigner devant vous.
Je suis le chef du service des urgences et du SAMU 68 à l'hôpital de Mulhouse. J'assume par ailleurs des missions de coordonnateur du Réseau et Observatoire des urgences Grand-Est, qui travaille quotidiennement pour les cinquante-deux services des urgences de la région, en lien avec l'ARS, pour en améliorer le fonctionnement global.
Mon établissement comprend 1 250 lits MCO (médecine, chirurgie, obstétrique), dont 36 lits de réanimation. Il couvre un bassin de population de 400 000 habitants, ce qui en fait le deuxième centre hospitalier général en termes de taille et d'activité. Le SAMU 68 gère à peu près 200 000 dossiers médicaux de régulation par an. Nous accueillons près de 120 000 patients sur les différents sites des urgences de l'établissement.
Si, dès la fin de février, comme tous les établissements de France, nous nous apprêtions à accueillir des cas suspects de covid - situation aggravée par notre proximité avec l'Italie -, c'est le 1er mars que nous avons été confrontés brutalement à la réalité de cette crise, qui nous a submergés en quelques jours avec une cinétique excessivement violente, ne nous laissant, pendant près de six semaines, aucune capacité à anticiper. Je souhaite donc ici témoigner du contraste des situations entre les différents territoires nationaux, car mon département a vécu quelque chose d'exceptionnel.
La précocité de la crise par rapport au reste du territoire national et la suractivité que nous avons constatée ont été la conséquence directe d'un rassemblement cultuel qui s'est tenu dans l'agglomération de Mulhouse du 17 au 23 février. Ce rassemblement de 2 000 à 3 000 personnes a donné lieu à un foyer épidémique majeur et à une dispersion non contrôlée, à une période où on ne parlait que de « petite grippe » et où les gestes barrières et l'isolement n'étaient encore que des concepts.
Premier point, le Haut-Rhin a été un département sinistré de manière hors norme comparativement au reste du territoire. Mon établissement a accueilli plus de 2 000 patients covid, dont plus de 365 en réanimation. L'activité du centre 15 a été multipliée par quatre et nous avons transféré 330 patients de réanimation lourde dans d'autres départements pour permettre le maintien de nos capacités d'accueil et de prise en charge. Ces 330 patients représentent la moitié des patients transférés pour toute la France.
Deuxième point, nous avons vécu un décalage important dans la compréhension nationale de la gravité de la situation à laquelle nous étions confrontés. Cela a donné lieu à des recommandations qui étaient inapplicables sur notre territoire et à un retard dans l'envoi de renforts humains et de moyens pourtant nécessaires - je pense en particulier aux équipements de protection individuels. Début mars et pendant plus de quinze jours, nous nous sommes sentis réellement isolés.
Troisième point, nous avons été confrontés à une difficulté de pilotage de gestion de la crise au niveau régional, notamment en ce qui concerne la coordination de la disponibilité des lits de réanimation et les transferts inter-établissements, en raison, d'une part, d'outils numériques inadaptés, et, d'autre part, d'un manque d'expertise dans la gestion de crise de nos tutelles régionales.
Quatrième point, nous avons été confrontés à une difficulté dans les choix stratégiques, thérapeutiques et d'orientation liée à une méconnaissance de la maladie, à une gestion de crise avec des moyens saturés et contraints, à une incidence plus importante des formes graves chez les patients âgés et polypathologiques et à la sollicitation à un niveau hors norme de nos unités de réanimation.
Cinquième point, nous avons assisté à une collaboration inédite public-privé -preuve que tous les territoires n'ont pas vécu la même situation - et ville-hôpital, avec une flexibilité organisationnelle et des innovations qui nous ont permis d'éviter la saturation des structures hospitalières, qu'elles soient publiques ou privées. En très peu de temps, public et privé ont travaillé ensemble, y compris grâce à l'échange de professionnels. Nous avons par exemple accueilli des anesthésistes du privé dans nos services de réanimation.
Cette crise était probablement difficilement prévisible. Notre système de santé s'est transformé dans sa globalité et s'est adapté pour y faire face. Le retour d'expérience est nécessaire pour mutualiser nos apprentissages régionaux. Il est important de désenclaver nos fonctionnements, qui ont toujours tendance à s'organiser en silos. Si l'hôpital public, dans certains endroits, a défendu son propre périmètre, ce n'était pas pour ne pas travailler avec le privé, mais par méconnaissance et par crainte de l'inconnu. Il importe donc d'améliorer la coordination et la communication entre les acteurs.

On enregistre effectivement de grandes disparités selon les territoires. Le Grand-Est a connu un tsunami. Dans d'autres régions, la situation a été plus calme. Les relations avec les ARS ont aussi été très différentes d'un territoire à l'autre. Le professeur Mercat a évoqué la région des Pays de la Loire. Nous n'avons pas eu de vague, mais les liens avec l'ARS et le préfet ont été fluides, ce qui n'a pas été le cas partout.
Le plan Blanc s'est appliqué de manière uniforme sur le territoire, avec des nécessités évidentes dans les endroits où les lits manquaient. Il a fallu fermer des lits dans certains territoires sans qu'ils soient « utilisés ». Mais dans d'autres, il semblerait que les relations entre le public et le privé, par exemple au CHU d'Angers, aient été assez fluides, avec des transferts de patients.
Le plan Blanc a occasionné un certain nombre de non-interventions. La Ligue nationale contre le cancer parle d'un nombre de diagnostics de cancer moitié moindre. La commission des affaires sociales du Sénat a entendu également les représentants des malades cardiaques : là aussi, il y aurait un retard considérable dans la prise en charge. Dans vos établissements, les interventions ont-elles repris au rythme antérieur ? Il semblerait que ce soit compliqué parce que le personnel mis sous tension a besoin de récupérer, mais aussi parce que certains hôpitaux manquent encore d'équipements de protection. Est-ce le cas dans les établissements que vous représentez ? L'actuel frémissement constaté sur le front du covid entretient-il la crainte des patients d'aller à l'hôpital, soit en consultation, soit pour une intervention ? La clinique est-elle impliquée dans votre communauté professionnelle territoriale de santé ?

On enregistre effectivement de grandes disparités selon les territoires. Le Grand-Est a connu un tsunami. Dans d'autres régions, la situation a été plus calme. Les relations avec les ARS ont aussi été très différentes d'un territoire à l'autre. Le professeur Mercat a évoqué la région des Pays de la Loire. Nous n'avons pas eu de vague, mais les liens avec l'ARS et le préfet ont été fluides, ce qui n'a pas été le cas partout.
Le plan Blanc s'est appliqué de manière uniforme sur le territoire, avec des nécessités évidentes dans les endroits où les lits manquaient. Il a fallu fermer des lits dans certains territoires sans qu'ils soient « utilisés ». Mais dans d'autres, il semblerait que les relations entre le public et le privé, par exemple au CHU d'Angers, aient été assez fluides, avec des transferts de patients.
Le plan Blanc a occasionné un certain nombre de non-interventions. La Ligue nationale contre le cancer parle d'un nombre de diagnostics de cancer moitié moindre. La commission des affaires sociales du Sénat a entendu également les représentants des malades cardiaques : là aussi, il y aurait un retard considérable dans la prise en charge. Dans vos établissements, les interventions ont-elles repris au rythme antérieur ? Il semblerait que ce soit compliqué parce que le personnel mis sous tension a besoin de récupérer, mais aussi parce que certains hôpitaux manquent encore d'équipements de protection. Est-ce le cas dans les établissements que vous représentez ? L'actuel frémissement constaté sur le front du covid entretient-il la crainte des patients d'aller à l'hôpital, soit en consultation, soit pour une intervention ? La clinique est-elle impliquée dans votre communauté professionnelle territoriale de santé ?

Ce n'est pas fréquent ! Cette crise a fait la preuve que la CPTS, lorsque sa création est à l'initiative du terrain, est un bon outil. Comment les praticiens libéraux ont-ils été associés sur votre territoire ?
Le fait d'interdire aux patients de solliciter leur médecin traitant a amené un basculement vers le 15, qui n'était pas forcément équipé en termes de personnel. Comment SOS Médecins a-t-il pu pallier la surcharge du 15 ?

Ce n'est pas fréquent ! Cette crise a fait la preuve que la CPTS, lorsque sa création est à l'initiative du terrain, est un bon outil. Comment les praticiens libéraux ont-ils été associés sur votre territoire ?
Le fait d'interdire aux patients de solliciter leur médecin traitant a amené un basculement vers le 15, qui n'était pas forcément équipé en termes de personnel. Comment SOS Médecins a-t-il pu pallier la surcharge du 15 ?
Votre remarque sur le plan Blanc est pertinente. Il s'agit d'un outil dont l'activation change complètement les modes de gestion de l'hôpital. On constitue un petit groupe pour prendre toutes les décisions. Est-il pertinent de dire sur l'ensemble du territoire, au même moment, partout, pour le public et le privé, « déprogrammez tout, il faut libérer des lits » ?
Je plaide en faveur d'une autonomie des territoires, coordonnés par les ARS, avec une gestion assurée au plus près du terrain, c'est-à-dire confiée aux établissements pivots supports de GHT, et donc essentiellement aux CHU. On a probablement déprogrammé quinze jours trop tôt.
Il y a en France approximativement 7,5 lits de réanimation pour 100 000 habitants, mais ce chiffre masque une grande hétérogénéité. Nous avons eu de la chance, puisque le covid s'est attaqué à deux des régions les plus richement dotées en lits de réanimation : le Grand-Est et l'Île-de-France. Les deux régions les plus défavorisées à cet égard sont la Bretagne et les Pays de la Loire, avec moins 5 lits pour 100 000 habitants. L'amplitude de la réponse va dépendre de l'offre de soins existante et de la cinétique de l'évolution de l'épidémie.
Effectivement, chez nous, la relation avec le privé et les cliniques a été excellente. J'ai sollicité l'ARS pour que l'on demande aux cliniques d'ouvrir des lits de réanimation pour des patients non covid. On m'a répondu « bien sûr ! », et tout a été fait en vingt-quatre heures. Par ailleurs, on a établi des conventions très simples autorisant nos chirurgiens à aller opérer dans les cliniques. Tout s'est véritablement joué à l'échelon local. Sur ces questions-là, je ne crois guère à une consigne nationale !
Nous savions déjà - c'est une des rares choses apprises de la crise du H1N1 en 2009 - que les régions seraient touchées à des moments différents, même si nous n'imaginions pas le phénomène incroyable qu'a connu le Grand-Est. Nous nous attendions donc à devoir adapter la réponse à la fois dans l'espace et dans le temps. Mieux vaut organiser la coordination avec la médecine libérale en amont, plutôt qu'au moment où la crise survient.
Votre remarque sur le plan Blanc est pertinente. Il s'agit d'un outil dont l'activation change complètement les modes de gestion de l'hôpital. On constitue un petit groupe pour prendre toutes les décisions. Est-il pertinent de dire sur l'ensemble du territoire, au même moment, partout, pour le public et le privé, « déprogrammez tout, il faut libérer des lits » ?
Je plaide en faveur d'une autonomie des territoires, coordonnés par les ARS, avec une gestion assurée au plus près du terrain, c'est-à-dire confiée aux établissements pivots supports de GHT, et donc essentiellement aux CHU. On a probablement déprogrammé quinze jours trop tôt.
Il y a en France approximativement 7,5 lits de réanimation pour 100 000 habitants, mais ce chiffre masque une grande hétérogénéité. Nous avons eu de la chance, puisque le covid s'est attaqué à deux des régions les plus richement dotées en lits de réanimation : le Grand-Est et l'Île-de-France. Les deux régions les plus défavorisées à cet égard sont la Bretagne et les Pays de la Loire, avec moins 5 lits pour 100 000 habitants. L'amplitude de la réponse va dépendre de l'offre de soins existante et de la cinétique de l'évolution de l'épidémie.
Effectivement, chez nous, la relation avec le privé et les cliniques a été excellente. J'ai sollicité l'ARS pour que l'on demande aux cliniques d'ouvrir des lits de réanimation pour des patients non covid. On m'a répondu « bien sûr ! », et tout a été fait en vingt-quatre heures. Par ailleurs, on a établi des conventions très simples autorisant nos chirurgiens à aller opérer dans les cliniques. Tout s'est véritablement joué à l'échelon local. Sur ces questions-là, je ne crois guère à une consigne nationale !
Nous savions déjà - c'est une des rares choses apprises de la crise du H1N1 en 2009 - que les régions seraient touchées à des moments différents, même si nous n'imaginions pas le phénomène incroyable qu'a connu le Grand-Est. Nous nous attendions donc à devoir adapter la réponse à la fois dans l'espace et dans le temps. Mieux vaut organiser la coordination avec la médecine libérale en amont, plutôt qu'au moment où la crise survient.
Les CPTS sont en cours de constitution et je découvre ce qu'est l'administration française !
J'ai été à l'initiative d'une communauté professionnelle territoriale de santé avec des collègues généralistes il y a plus de deux ans, bien avant que les CPTS n'existent, tout simplement parce que travailler ensemble nous semblait une évidence, d'autant que de nombreux jeunes médecins sont arrivés dans ma région. Arrivent les CPTS, et là, ça se gâte : on tombe sur des structures technocratiques qui compliquent tout !
Nous en sommes au projet de santé, il y en a encore pour des mois et des mois de travail. On vient de recevoir la facture pour l'externalisation de ce projet : c'est très cher, et c'est autant de moins pour les soins !
Pour revenir à la crise du covid et à ma CPTS, nous étions donc unis dès le premier jour : 104 personnes participaient à la première réunion. Nous avons immédiatement créé un groupe WhatsApp, grâce auquel 140 personnes étaient en lien permanent, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Nous comptions notamment, dans notre groupe, un réanimateur de la clinique de Reims, des pneumologues, etc. Tout cela nous a grandement aidés. La CPTS n'est pas encore officielle, mais c'en est déjà l'embryon, et je suis très heureux que nous ayons eu cette idée en amont !
Les CPTS sont en cours de constitution et je découvre ce qu'est l'administration française !
J'ai été à l'initiative d'une communauté professionnelle territoriale de santé avec des collègues généralistes il y a plus de deux ans, bien avant que les CPTS n'existent, tout simplement parce que travailler ensemble nous semblait une évidence, d'autant que de nombreux jeunes médecins sont arrivés dans ma région. Arrivent les CPTS, et là, ça se gâte : on tombe sur des structures technocratiques qui compliquent tout !
Nous en sommes au projet de santé, il y en a encore pour des mois et des mois de travail. On vient de recevoir la facture pour l'externalisation de ce projet : c'est très cher, et c'est autant de moins pour les soins !
Pour revenir à la crise du covid et à ma CPTS, nous étions donc unis dès le premier jour : 104 personnes participaient à la première réunion. Nous avons immédiatement créé un groupe WhatsApp, grâce auquel 140 personnes étaient en lien permanent, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Nous comptions notamment, dans notre groupe, un réanimateur de la clinique de Reims, des pneumologues, etc. Tout cela nous a grandement aidés. La CPTS n'est pas encore officielle, mais c'en est déjà l'embryon, et je suis très heureux que nous ayons eu cette idée en amont !
L'idée initiale avait été conçue entre médecins. C'était une erreur, car il faut évidemment y adjoindre les infirmières, notamment libérales, qui sont ravies d'échanger avec les médecins. On découvre beaucoup de difficultés, notamment à la sortie d'hospitalisation après chirurgie.
L'idée initiale avait été conçue entre médecins. C'était une erreur, car il faut évidemment y adjoindre les infirmières, notamment libérales, qui sont ravies d'échanger avec les médecins. On découvre beaucoup de difficultés, notamment à la sortie d'hospitalisation après chirurgie.

Pour information, la configuration des CPTS existait déjà dans la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Elles ont été modifiées et améliorées dans la loi « Touraine ».

Pour information, la configuration des CPTS existait déjà dans la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Elles ont été modifiées et améliorées dans la loi « Touraine ».
Il y a eu effectivement une collaboration avec le 15. Nos centres d'appels ont constitué une sorte de petite soupape. Néanmoins, les consignes étaient très claires : tout patient suspect de covid devait être transféré au 15, qui décidait de la prise en charge. Les consignes suivantes ont été le « tout ambulatoire », et le 15 nous transférait énormément d'appels. Il est donc important de bien coordonner la réponse aux soins par des acteurs qui se connaissent et qui travaillent ensemble. Dans beaucoup de structures en France, de nombreux médecins de SOS Médecins sont régulateurs libéraux au 15.
Il y a eu effectivement une collaboration avec le 15. Nos centres d'appels ont constitué une sorte de petite soupape. Néanmoins, les consignes étaient très claires : tout patient suspect de covid devait être transféré au 15, qui décidait de la prise en charge. Les consignes suivantes ont été le « tout ambulatoire », et le 15 nous transférait énormément d'appels. Il est donc important de bien coordonner la réponse aux soins par des acteurs qui se connaissent et qui travaillent ensemble. Dans beaucoup de structures en France, de nombreux médecins de SOS Médecins sont régulateurs libéraux au 15.
Il y a effectivement eu au cours de cette crise une forte chute des admissions aux urgences. La prise en charge des patients a été faite avec le 15, qui faisait office de régulateur en fonction des différents établissements. Je peux donner le retour d'expérience de mes confrères d'Île-de-France. C'est un territoire de population dense, avec un grand nombre de services des urgences privés et publics. Mes collègues regrettent le manque de coordination sur un plan local, départemental. Il existe très peu d'outils pour faire collaborer les uns et les autres au plus près du territoire. Il y a les réseaux territoriaux des urgences, qui existent également dans le Grand-Est. L'idée est que nous puissions tous nous réunir - médecins coordonnateurs des établissements publics et privés, régulation du centre 15, sapeurs-pompiers, SOS Médecins et éventuellement les CPTS - pour construire un projet territorial commun. J'insiste sur le caractère décentralisé de la mesure. Le délégué départemental de l'ARS pourrait faire office de régulateur neutre de l'offre de soins. Cette instance nous permettrait non seulement de nous coordonner, de créer des liens, de pouvoir nous entraider - je pense à la pénurie de médecins urgentistes -, mais aussi et surtout de désamorcer des situations parfois conflictuelles : problèmes ou refus d'admission, etc.
En Île-de-France d'autres structures, comme le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires (Codamups), n'ont quasiment pas joué de rôle pour l'organisation des acteurs face à la crise. C'est dommage. Nous aurions pu nous rencontrer dans ces instances et avoir plus d'échanges sur un territoire donné.
Il y a effectivement eu au cours de cette crise une forte chute des admissions aux urgences. La prise en charge des patients a été faite avec le 15, qui faisait office de régulateur en fonction des différents établissements. Je peux donner le retour d'expérience de mes confrères d'Île-de-France. C'est un territoire de population dense, avec un grand nombre de services des urgences privés et publics. Mes collègues regrettent le manque de coordination sur un plan local, départemental. Il existe très peu d'outils pour faire collaborer les uns et les autres au plus près du territoire. Il y a les réseaux territoriaux des urgences, qui existent également dans le Grand-Est. L'idée est que nous puissions tous nous réunir - médecins coordonnateurs des établissements publics et privés, régulation du centre 15, sapeurs-pompiers, SOS Médecins et éventuellement les CPTS - pour construire un projet territorial commun. J'insiste sur le caractère décentralisé de la mesure. Le délégué départemental de l'ARS pourrait faire office de régulateur neutre de l'offre de soins. Cette instance nous permettrait non seulement de nous coordonner, de créer des liens, de pouvoir nous entraider - je pense à la pénurie de médecins urgentistes -, mais aussi et surtout de désamorcer des situations parfois conflictuelles : problèmes ou refus d'admission, etc.
En Île-de-France d'autres structures, comme le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires (Codamups), n'ont quasiment pas joué de rôle pour l'organisation des acteurs face à la crise. C'est dommage. Nous aurions pu nous rencontrer dans ces instances et avoir plus d'échanges sur un territoire donné.
Dans les services des urgences privés, elle s'est faite de manière très progressive. Nous avions eu l'impression, au moment du déconfinement, que l'état des patients était plus grave. Mais ce n'était qu'une impression. Actuellement, nous avons retrouvé le même niveau d'activité que d'habitude. Si deuxième vague il y a à l'automne, nos services des urgences ayant repris leur activité habituelle, nous craignons une sursaturation.
Dans les services des urgences privés, elle s'est faite de manière très progressive. Nous avions eu l'impression, au moment du déconfinement, que l'état des patients était plus grave. Mais ce n'était qu'une impression. Actuellement, nous avons retrouvé le même niveau d'activité que d'habitude. Si deuxième vague il y a à l'automne, nos services des urgences ayant repris leur activité habituelle, nous craignons une sursaturation.
Les centres 15 ont été très rapidement identifiés comme étant le point de passage obligatoire. Cela peut être discutable ; ce qui ne l'est pas, c'est qu'il fallait un avis médical, c'est-à-dire un médecin régulateur pour prendre en considération la demande et orienter le patient dans son parcours de soin. Il y a eu certes de nombreuses recommandations successives, mais le but était d'adapter le système à une pathologie nouvelle. Quoi qu'il en soit, les centres 15 ont été saturés, notamment le mien. L'activité a été multipliée par quatre et le personnel par cinq. J'ai eu jusqu'à quatre salles de régulation différentes, dont une gérait l'aide médicale urgente et les autres uniquement la partie covid, à grand renfort de médecins libéraux. Je salue au passage ce partenariat, qui s'est mis en place très rapidement grâce à l'appui du conseil départemental de l'Ordre des médecins.
Il s'agissait d'une expérience intéressante, menée également en lien avec nos collègues de SOS Médecins à Mulhouse, qui ont vu très rapidement leur plateforme d'appel saturée. Nous avons basculé ces appels vers le centre 15 afin de ne solliciter SOS Médecins que pour les patients nécessitant véritablement le recours à un médecin. Les agents de terrain ont réussi à s'articuler les uns avec les autres. Au niveau du centre d'appel, la problématique est plutôt de parvenir à faire la distinction entre ce qui est de l'ordre de l'aide médicale urgente et ce qui ne l'est pas. À cette fin, nous avons mis en place un serveur vocal interactif.
De la même façon, les médecins généralistes se sont organisés pour créer des systèmes d'effecteurs médicaux en dehors de la permanence des soins. Nous avons mis en place un dispositif permettant de solliciter un médecin sur une plateforme électronique pour visiter un patient. Il s'agissait ainsi d'éviter un déplacement non nécessaire vers une structure hospitalière. Les médecins généralistes ont également mis en oeuvre des structures de consultation à l'entrée des hôpitaux pour essayer d'éviter le passage aux urgences.
S'agissant de la reprise, on a constaté une période d'accalmie, juste après la décroissance du nombre de patients covid, qui a duré quatre à cinq semaines, avec un taux d'activité s'établissant à 40 %. Chose notable, les patients venaient pour des problèmes graves et des pathologies nécessitant un recours hospitalier. Nous avons eu des taux d'hospitalisation allant jusqu'à 50 %, contre 20 % en temps normal. C'est une des leçons à retenir : il y a eu des retards de soins, notamment pour les pathologies carcinologiques. Certains patients ont dû attendre trois mois pour la finalisation de leur bilan et la réalisation des biopsies. Ils ont donc subi une forme de perte de chance par retard de démarrage du traitement. L'arrêt des activités programmées et chirurgicales était sans doute à moduler.
Les centres 15 ont été très rapidement identifiés comme étant le point de passage obligatoire. Cela peut être discutable ; ce qui ne l'est pas, c'est qu'il fallait un avis médical, c'est-à-dire un médecin régulateur pour prendre en considération la demande et orienter le patient dans son parcours de soin. Il y a eu certes de nombreuses recommandations successives, mais le but était d'adapter le système à une pathologie nouvelle. Quoi qu'il en soit, les centres 15 ont été saturés, notamment le mien. L'activité a été multipliée par quatre et le personnel par cinq. J'ai eu jusqu'à quatre salles de régulation différentes, dont une gérait l'aide médicale urgente et les autres uniquement la partie covid, à grand renfort de médecins libéraux. Je salue au passage ce partenariat, qui s'est mis en place très rapidement grâce à l'appui du conseil départemental de l'Ordre des médecins.
Il s'agissait d'une expérience intéressante, menée également en lien avec nos collègues de SOS Médecins à Mulhouse, qui ont vu très rapidement leur plateforme d'appel saturée. Nous avons basculé ces appels vers le centre 15 afin de ne solliciter SOS Médecins que pour les patients nécessitant véritablement le recours à un médecin. Les agents de terrain ont réussi à s'articuler les uns avec les autres. Au niveau du centre d'appel, la problématique est plutôt de parvenir à faire la distinction entre ce qui est de l'ordre de l'aide médicale urgente et ce qui ne l'est pas. À cette fin, nous avons mis en place un serveur vocal interactif.
De la même façon, les médecins généralistes se sont organisés pour créer des systèmes d'effecteurs médicaux en dehors de la permanence des soins. Nous avons mis en place un dispositif permettant de solliciter un médecin sur une plateforme électronique pour visiter un patient. Il s'agissait ainsi d'éviter un déplacement non nécessaire vers une structure hospitalière. Les médecins généralistes ont également mis en oeuvre des structures de consultation à l'entrée des hôpitaux pour essayer d'éviter le passage aux urgences.
S'agissant de la reprise, on a constaté une période d'accalmie, juste après la décroissance du nombre de patients covid, qui a duré quatre à cinq semaines, avec un taux d'activité s'établissant à 40 %. Chose notable, les patients venaient pour des problèmes graves et des pathologies nécessitant un recours hospitalier. Nous avons eu des taux d'hospitalisation allant jusqu'à 50 %, contre 20 % en temps normal. C'est une des leçons à retenir : il y a eu des retards de soins, notamment pour les pathologies carcinologiques. Certains patients ont dû attendre trois mois pour la finalisation de leur bilan et la réalisation des biopsies. Ils ont donc subi une forme de perte de chance par retard de démarrage du traitement. L'arrêt des activités programmées et chirurgicales était sans doute à moduler.
La perte de chance est très difficile à évaluer aujourd'hui. La ville de New York a publié des chiffres documentés, qui font état d'une surmortalité non liée au covid. Certes, il s'agit des États-Unis, où tout est très dépendant du niveau social et de la couleur de peau. Mais, en France, on constate aussi un taux anormalement élevé de patients consultant aux urgences et nécessitant une hospitalisation. Quelle est, dans ce retard de prise en charge, la part imputable à l'organisation du système de santé et celle imputable à l'attitude individuelle de personnes qui ont eu peur d'aller à l'hôpital et de croiser des malades du covid ? Il y a eu un important problème de communication de l'ensemble des structures de soins, qui n'ont pas su rassurer et expliquer aux patients, notamment ceux issus de milieux défavorisés, qu'ils ne couraient pas un risque anormal de contracter l'infection.
La perte de chance est très difficile à évaluer aujourd'hui. La ville de New York a publié des chiffres documentés, qui font état d'une surmortalité non liée au covid. Certes, il s'agit des États-Unis, où tout est très dépendant du niveau social et de la couleur de peau. Mais, en France, on constate aussi un taux anormalement élevé de patients consultant aux urgences et nécessitant une hospitalisation. Quelle est, dans ce retard de prise en charge, la part imputable à l'organisation du système de santé et celle imputable à l'attitude individuelle de personnes qui ont eu peur d'aller à l'hôpital et de croiser des malades du covid ? Il y a eu un important problème de communication de l'ensemble des structures de soins, qui n'ont pas su rassurer et expliquer aux patients, notamment ceux issus de milieux défavorisés, qu'ils ne couraient pas un risque anormal de contracter l'infection.
Empêtré dans ma CPTS et ses problèmes administratifs, j'ai oublié de répondre aux questions sur les retards de prise en charge et la reprise de la chirurgie. On a découvert beaucoup de choses en cancérologie, mais aussi en matière de chirurgie vasculaire. Un patient qui a un orteil noir, si on lui a dit de rester chez lui pour ne pas encombrer les centres 15, c'est une amputation au bout de quinze jours ! Quant à la chirurgie orthopédique, je n'ai jamais vu, en trente et un ans d'exercice, une telle dégradation des coxarthroses. Or il est très difficile, passé un certain âge, de remonter la pente...
Oui, on a vu des choses très bizarres sur le terrain, qu'on n'avait jamais constatées auparavant. Quant à la reprise des activités, elle n'a été que très progressive, conformément à la demande de l'ARS. On commence maintenant à atteindre un taux d'activité d'environ 80 %. C'est lié aux règles instituées dans les blocs opératoires, avec un recours aux péridurales et aux anesthésiants locaux plutôt qu'aux anesthésies générales. On a aussi beaucoup de temps morts, qui font que l'on n'arrive pas à 100 % d'activité.
Empêtré dans ma CPTS et ses problèmes administratifs, j'ai oublié de répondre aux questions sur les retards de prise en charge et la reprise de la chirurgie. On a découvert beaucoup de choses en cancérologie, mais aussi en matière de chirurgie vasculaire. Un patient qui a un orteil noir, si on lui a dit de rester chez lui pour ne pas encombrer les centres 15, c'est une amputation au bout de quinze jours ! Quant à la chirurgie orthopédique, je n'ai jamais vu, en trente et un ans d'exercice, une telle dégradation des coxarthroses. Or il est très difficile, passé un certain âge, de remonter la pente...
Oui, on a vu des choses très bizarres sur le terrain, qu'on n'avait jamais constatées auparavant. Quant à la reprise des activités, elle n'a été que très progressive, conformément à la demande de l'ARS. On commence maintenant à atteindre un taux d'activité d'environ 80 %. C'est lié aux règles instituées dans les blocs opératoires, avec un recours aux péridurales et aux anesthésiants locaux plutôt qu'aux anesthésies générales. On a aussi beaucoup de temps morts, qui font que l'on n'arrive pas à 100 % d'activité.

J'aurai trois questions.
La première s'adresse au professeur Mercat : quel est concrètement l'impact de la contrainte budgétaire ? Vous avez souligné que votre hôpital avait réussi une adaptation spectaculaire, notamment parce que vous vous êtes délestés de la contrainte budgétaire. Comment s'est concrétisée chez vous l'absence de cette contrainte budgétaire ? Quand est-elle revenue ? Qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire de ce fait ?
Ma deuxième question s'adresse au docteur Noizet. J'ai lu vos déclarations antérieures sur la confrontation à la mort et sur les difficultés morales vécues par les soignants. Je reviens sur la collaboration public-privé que vous avez évoquée. Nous avons bien compris, au gré des auditions, que cette collaboration n'a pas été partout la même. Est-ce l'urgence, la force du drame qui expliquent la bonne collaboration chez vous, ou est-elle liée aux personnes ? La consigne nationale est-elle déviée ? Nous avons besoin de comprendre pourquoi cela n'a pas fonctionné partout de la même manière.
Ma troisième question s'adresse au docteur Smadja et concerne SOS Médecins. J'ai lu, dans un article de presse du 15 juillet, que l'on dénombrait une centaine de suspicions de cas de covid-19 par jour il y a un mois, contre 600 pour la seule journée de mardi dernier. Êtes-vous fonctionnels et opérationnels en termes de tests, de matériel et de suivi ? Sommes-nous prêts pour une nouvelle vague ? Comment se passe pour vous cette hausse sur le terrain ?

J'aurai trois questions.
La première s'adresse au professeur Mercat : quel est concrètement l'impact de la contrainte budgétaire ? Vous avez souligné que votre hôpital avait réussi une adaptation spectaculaire, notamment parce que vous vous êtes délestés de la contrainte budgétaire. Comment s'est concrétisée chez vous l'absence de cette contrainte budgétaire ? Quand est-elle revenue ? Qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire de ce fait ?
Ma deuxième question s'adresse au docteur Noizet. J'ai lu vos déclarations antérieures sur la confrontation à la mort et sur les difficultés morales vécues par les soignants. Je reviens sur la collaboration public-privé que vous avez évoquée. Nous avons bien compris, au gré des auditions, que cette collaboration n'a pas été partout la même. Est-ce l'urgence, la force du drame qui expliquent la bonne collaboration chez vous, ou est-elle liée aux personnes ? La consigne nationale est-elle déviée ? Nous avons besoin de comprendre pourquoi cela n'a pas fonctionné partout de la même manière.
Ma troisième question s'adresse au docteur Smadja et concerne SOS Médecins. J'ai lu, dans un article de presse du 15 juillet, que l'on dénombrait une centaine de suspicions de cas de covid-19 par jour il y a un mois, contre 600 pour la seule journée de mardi dernier. Êtes-vous fonctionnels et opérationnels en termes de tests, de matériel et de suivi ? Sommes-nous prêts pour une nouvelle vague ? Comment se passe pour vous cette hausse sur le terrain ?
Vous m'interrogez sur la contrainte budgétaire. Comme vous le savez, depuis des années maintenant, l'hôpital public est financé par le système dit de la T2A, la tarification à l'activité. Pour avoir des rentrées financières importantes, il faut une activité importante, c'est-à-dire un taux d'occupation élevé et surtout des séjours courts. À chaque nouveau projet de filière ou d'offre de soins, il faut faire de la prospective et se demander quel sera l'impact sur le budget de l'hôpital. C'est assez lourd et très mal vécu de longue date par l'ensemble de la communauté médicale, notamment par les collègues dont l'activité n'est pas rentable. Ce qui rapporte avec la T2A, c'est la chirurgie, la réanimation, les pathologies très lourdes et la cardiologie interventionnelle.
Et tout d'un coup, avec le plan Blanc, cette règle ne vaut plus. On ferme le service d'orthopédie et on le transforme trois jours plus tard en un service d'accueil de patients covid. Pour quelqu'un comme moi qui fréquente l'hôpital public et les CHU depuis trente ans, c'est une chose incroyable ! En sortant de la réunion, on s'est dit : on a fait ça ? Eh bien oui, on l'a fait ! Et il a fallu en informer nos collègues chirurgiens orthopédiques, qui sont allés aider dans les centres de prélèvement parce qu'ils étaient motivés et qu'ils voulaient participer.
La contrainte budgétaire n'est pas revenue pour l'instant. Nous sommes dans une situation intermédiaire, on attend les conclusions plus fermes du Ségur de la santé sur le financement de l'hôpital public et on croise les doigts !
Vous m'interrogez sur la contrainte budgétaire. Comme vous le savez, depuis des années maintenant, l'hôpital public est financé par le système dit de la T2A, la tarification à l'activité. Pour avoir des rentrées financières importantes, il faut une activité importante, c'est-à-dire un taux d'occupation élevé et surtout des séjours courts. À chaque nouveau projet de filière ou d'offre de soins, il faut faire de la prospective et se demander quel sera l'impact sur le budget de l'hôpital. C'est assez lourd et très mal vécu de longue date par l'ensemble de la communauté médicale, notamment par les collègues dont l'activité n'est pas rentable. Ce qui rapporte avec la T2A, c'est la chirurgie, la réanimation, les pathologies très lourdes et la cardiologie interventionnelle.
Et tout d'un coup, avec le plan Blanc, cette règle ne vaut plus. On ferme le service d'orthopédie et on le transforme trois jours plus tard en un service d'accueil de patients covid. Pour quelqu'un comme moi qui fréquente l'hôpital public et les CHU depuis trente ans, c'est une chose incroyable ! En sortant de la réunion, on s'est dit : on a fait ça ? Eh bien oui, on l'a fait ! Et il a fallu en informer nos collègues chirurgiens orthopédiques, qui sont allés aider dans les centres de prélèvement parce qu'ils étaient motivés et qu'ils voulaient participer.
La contrainte budgétaire n'est pas revenue pour l'instant. Nous sommes dans une situation intermédiaire, on attend les conclusions plus fermes du Ségur de la santé sur le financement de l'hôpital public et on croise les doigts !
Concernant la collaboration public-privé, début mars, durant la première semaine, devant la difficulté d'orienter les patients dans le département, j'ai provoqué une réunion téléphonique avec mes collègues responsables des services des urgences, dont un service des urgences privé à Mulhouse. Nous avons conjointement décidé de concentrer les patients covid dans les deux principaux hôpitaux publics que sont ceux de Colmar et de Mulhouse et de déconcentrer le reste de l'activité vers les autres services des urgences du département, de manière à éviter la dispersion du virus.
Certes, très rapidement, cette organisation a été rendue complètement inopérante et il a fallu revoir les choses. Mais nous avions déjà trouvé entre professionnels des arrangements entre public et privé, uniquement pour le volet urgences.
Nos hôpitaux publics et privés n'avaient pas encore, à ce moment-là, mis en place de partenariat fonctionnel pour répondre à la gestion de crise. Ce n'est que la semaine d'après, le 13 mars, que l'ARS a organisé une réunion entre l'hôpital public et les établissements privés de la ville pour trouver un mode de partenariat fonctionnel, mis en place en moins de quarante-huit heures, avec des prêts de matériels et des professionnels allant d'un site à l'autre pour renforcer les équipes. Des unités de la clinique ont aussi été transformées pour accueillir des patients covid au fur et à mesure des besoins. La clinique a également réussi à transformer son unité de surveillance continue pour y accueillir des lits de réanimation quand, au plus haut de la vague, nous n'avions plus de solution.
Pour répondre plus précisément à votre question, je ne pense pas que ce soit une question de personnes. Effectivement, les intervenants se connaissent, mais ils travaillent dans une forme de lutte concurrentielle. Certains praticiens de la clinique sont d'anciens praticiens hospitaliers : il existe aussi parfois une forme de concurrence humaine, voire de rancoeur. Toujours est-il que, devant la nécessité de réussir, personne n'a tergiversé. Il s'agit peut-être d'une attitude citoyenne ou peut-être est-ce inscrit dans notre génome de soignants. Bref, face à une crise, nous savons changer nos modes d'organisation pour le bien du patient.
Chez nous, le déclenchement a été l'impulsion de l'ARS, dont je salue l'action. À partir de là, tout a roulé tout seul. Avait-on besoin de quelque chose qui était chez l'autre ? Un coup de téléphone, et c'était possible !
Je ne vous cache pas que le retour à la normale s'est fait assez rapidement dès le moment où les unités se sont vidées de leurs patients covid. Je pense néanmoins qu'il en restera quelque chose : la capacité à le faire, et la preuve que public et privé savent faire face ensemble à une problématique précise.
Concernant la collaboration public-privé, début mars, durant la première semaine, devant la difficulté d'orienter les patients dans le département, j'ai provoqué une réunion téléphonique avec mes collègues responsables des services des urgences, dont un service des urgences privé à Mulhouse. Nous avons conjointement décidé de concentrer les patients covid dans les deux principaux hôpitaux publics que sont ceux de Colmar et de Mulhouse et de déconcentrer le reste de l'activité vers les autres services des urgences du département, de manière à éviter la dispersion du virus.
Certes, très rapidement, cette organisation a été rendue complètement inopérante et il a fallu revoir les choses. Mais nous avions déjà trouvé entre professionnels des arrangements entre public et privé, uniquement pour le volet urgences.
Nos hôpitaux publics et privés n'avaient pas encore, à ce moment-là, mis en place de partenariat fonctionnel pour répondre à la gestion de crise. Ce n'est que la semaine d'après, le 13 mars, que l'ARS a organisé une réunion entre l'hôpital public et les établissements privés de la ville pour trouver un mode de partenariat fonctionnel, mis en place en moins de quarante-huit heures, avec des prêts de matériels et des professionnels allant d'un site à l'autre pour renforcer les équipes. Des unités de la clinique ont aussi été transformées pour accueillir des patients covid au fur et à mesure des besoins. La clinique a également réussi à transformer son unité de surveillance continue pour y accueillir des lits de réanimation quand, au plus haut de la vague, nous n'avions plus de solution.
Pour répondre plus précisément à votre question, je ne pense pas que ce soit une question de personnes. Effectivement, les intervenants se connaissent, mais ils travaillent dans une forme de lutte concurrentielle. Certains praticiens de la clinique sont d'anciens praticiens hospitaliers : il existe aussi parfois une forme de concurrence humaine, voire de rancoeur. Toujours est-il que, devant la nécessité de réussir, personne n'a tergiversé. Il s'agit peut-être d'une attitude citoyenne ou peut-être est-ce inscrit dans notre génome de soignants. Bref, face à une crise, nous savons changer nos modes d'organisation pour le bien du patient.
Chez nous, le déclenchement a été l'impulsion de l'ARS, dont je salue l'action. À partir de là, tout a roulé tout seul. Avait-on besoin de quelque chose qui était chez l'autre ? Un coup de téléphone, et c'était possible !
Je ne vous cache pas que le retour à la normale s'est fait assez rapidement dès le moment où les unités se sont vidées de leurs patients covid. Je pense néanmoins qu'il en restera quelque chose : la capacité à le faire, et la preuve que public et privé savent faire face ensemble à une problématique précise.
Je confirme les propos de Marc Noizet. Nous avons un lien d'intérêt : il a été chef de service de l'hôpital d'Épernay pendant quelques années alors que je travaille dans la clinique. Nous nous connaissons donc un peu et nous réglions déjà avant le covid, d'homme à homme, un certain nombre de difficultés liées aux urgences. J'ai été en contact direct avec l'un des chirurgiens de la clinique du Diaconat-Roosevelt de Mulhouse, il confirme exactement ce que vient de dire Marc Noizet : oui, quand on est confronté à une crise, il faut y aller, car on est avant tout médecin ! Tout cela s'est fait très normalement entre médecins, on exerce tous le même métier, quand même !
Je confirme les propos de Marc Noizet. Nous avons un lien d'intérêt : il a été chef de service de l'hôpital d'Épernay pendant quelques années alors que je travaille dans la clinique. Nous nous connaissons donc un peu et nous réglions déjà avant le covid, d'homme à homme, un certain nombre de difficultés liées aux urgences. J'ai été en contact direct avec l'un des chirurgiens de la clinique du Diaconat-Roosevelt de Mulhouse, il confirme exactement ce que vient de dire Marc Noizet : oui, quand on est confronté à une crise, il faut y aller, car on est avant tout médecin ! Tout cela s'est fait très normalement entre médecins, on exerce tous le même métier, quand même !

Je rappelle que la T2A a été installée après le budget global, qui avait entraîné pour les hôpitaux des pertes de marché élevées. C'est grâce à la T2A qu'ils ont récupéré des parts de marché importantes. Plus que la T2A, c'est probablement l'Ondam hospitalier qui a joué un rôle négatif pour l'ensemble des budgets hospitaliers. Quand il est fixé à 2,4 % alors qu'il faudrait qu'il soit établi à 4 %, ça ne peut pas fonctionner !

Je rappelle que la T2A a été installée après le budget global, qui avait entraîné pour les hôpitaux des pertes de marché élevées. C'est grâce à la T2A qu'ils ont récupéré des parts de marché importantes. Plus que la T2A, c'est probablement l'Ondam hospitalier qui a joué un rôle négatif pour l'ensemble des budgets hospitaliers. Quand il est fixé à 2,4 % alors qu'il faudrait qu'il soit établi à 4 %, ça ne peut pas fonctionner !
Il existe en effet plusieurs indicateurs permettant d'apprécier la circulation du virus. Un frémissement se faisant sentir actuellement, on surveille le nombre de nouveaux cas, le taux de positivité des tests, l'incidence des cas, etc. La concordance de tous ces indicateurs fait la qualité de la surveillance. Les suspicions de cas de covid-19 détectées dans notre réseau constituent un indicateur précoce. Cette surveillance syndromique, c'est-à-dire les retours de diagnostic que l'on envoie tous les jours, à six heures du matin, à Santé publique France, pour les patients qui présentent un certain tableau clinique - toux, fièvre, etc. -, s'est avérée particulièrement utile lorsque l'on manquait de tests.
Désormais, on a la capacité de faire des tests, même si les délais peuvent être plus ou moins longs pour obtenir les résultats, voire pour trouver un laboratoire. Les laboratoires manquent de personnel pour faire des prélèvements. Les préleveurs des laboratoires n'ont reçu, par décret, l'autorisation de faire des tests PCR que depuis peu. Ce week-end, la possibilité de faire des prélèvements avec des écouvillons a été élargie aux pompiers, aux secouristes, etc. Il y avait donc auparavant un engorgement pour la réalisation de tests, mais il est aujourd'hui possible de les pratiquer. Ils permettent d'apporter une confirmation des données de la surveillance clinique et de valider la qualité des indicateurs. Au moment du pic de l'épidémie, on avait environ 2 500 suspicions de covid-19 par jour, contre moins de 200 après le confinement, et 500 depuis début juillet. Cette hausse est corroborée par celle du « R0 » ou du nombre de nouveaux cas. Même si la situation n'est pas comparable à celle que nous avons connue fin mars, début avril, ces données doivent nous inviter à la prudence.
Il existe en effet plusieurs indicateurs permettant d'apprécier la circulation du virus. Un frémissement se faisant sentir actuellement, on surveille le nombre de nouveaux cas, le taux de positivité des tests, l'incidence des cas, etc. La concordance de tous ces indicateurs fait la qualité de la surveillance. Les suspicions de cas de covid-19 détectées dans notre réseau constituent un indicateur précoce. Cette surveillance syndromique, c'est-à-dire les retours de diagnostic que l'on envoie tous les jours, à six heures du matin, à Santé publique France, pour les patients qui présentent un certain tableau clinique - toux, fièvre, etc. -, s'est avérée particulièrement utile lorsque l'on manquait de tests.
Désormais, on a la capacité de faire des tests, même si les délais peuvent être plus ou moins longs pour obtenir les résultats, voire pour trouver un laboratoire. Les laboratoires manquent de personnel pour faire des prélèvements. Les préleveurs des laboratoires n'ont reçu, par décret, l'autorisation de faire des tests PCR que depuis peu. Ce week-end, la possibilité de faire des prélèvements avec des écouvillons a été élargie aux pompiers, aux secouristes, etc. Il y avait donc auparavant un engorgement pour la réalisation de tests, mais il est aujourd'hui possible de les pratiquer. Ils permettent d'apporter une confirmation des données de la surveillance clinique et de valider la qualité des indicateurs. Au moment du pic de l'épidémie, on avait environ 2 500 suspicions de covid-19 par jour, contre moins de 200 après le confinement, et 500 depuis début juillet. Cette hausse est corroborée par celle du « R0 » ou du nombre de nouveaux cas. Même si la situation n'est pas comparable à celle que nous avons connue fin mars, début avril, ces données doivent nous inviter à la prudence.

Vous avez dit que la pandémie avait été appréhendée comme une crise hospitalière et non comme une crise globale. Que voulez-vous dire ? Quels leviers faudrait-il activer si une nouvelle crise survenait ?
Le CHU d'Angers participe à l'étude Discovery. La recherche a-t-elle pu se faire dans de bonnes conditions ? Avez-vous eu du mal à trouver des patients volontaires ? Quels ont été les apports de cette étude ?
Enfin, quelle est la pertinence du transfert de malades en TGV ? Pourquoi ne pas avoir eu recours aux ambulances ou aux pompiers ?

Vous avez dit que la pandémie avait été appréhendée comme une crise hospitalière et non comme une crise globale. Que voulez-vous dire ? Quels leviers faudrait-il activer si une nouvelle crise survenait ?
Le CHU d'Angers participe à l'étude Discovery. La recherche a-t-elle pu se faire dans de bonnes conditions ? Avez-vous eu du mal à trouver des patients volontaires ? Quels ont été les apports de cette étude ?
Enfin, quelle est la pertinence du transfert de malades en TGV ? Pourquoi ne pas avoir eu recours aux ambulances ou aux pompiers ?

Vous avez dit que le Haut-Rhin était sinistré. Vous avez noté un décalage entre des recommandations inapplicables et la réalité du terrain et évoqué des problèmes de gestion. Pourriez-vous préciser quelles difficultés vous avez rencontrées ? Vous avez aussi soulevé les difficultés liées au numérique : s'agit-il de problèmes de compatibilité entre les différents systèmes, de problèmes de réseaux ? Aviez-vous mis en place le dossier partagé avant l'épidémie ?

Vous avez dit que le Haut-Rhin était sinistré. Vous avez noté un décalage entre des recommandations inapplicables et la réalité du terrain et évoqué des problèmes de gestion. Pourriez-vous préciser quelles difficultés vous avez rencontrées ? Vous avez aussi soulevé les difficultés liées au numérique : s'agit-il de problèmes de compatibilité entre les différents systèmes, de problèmes de réseaux ? Aviez-vous mis en place le dossier partagé avant l'épidémie ?

On a manqué de masques, de tests, de gel hydroalcoolique, etc. La coordination a été plus ou moins efficace selon les régions. Notre commission fera un bilan et publiera un rapport qui, j'en suis sûr, fascinera le Gouvernement... Mais notre système de santé est-il désormais mieux préparé en cas de nouvelle vague ?
On ne nous parle jamais de traitement depuis le début de nos travaux. J'ai bien compris qu'il n'y avait pas de traitement spécifique pour la covid-19, mais j'imagine que l'on ne donne pas uniquement du paracétamol aux patients... Si un jour j'étais malade et que j'apprenne cela, je ne suis pas sûr que mon état mental et moral s'améliorerait ! Je comprends bien que l'on ne traite que les symptômes et non pas la cause, mais, malgré tout, j'imagine que l'on a une meilleure connaissance de la maladie et que les traitements évoluent. Pourquoi ne pas en informer les gens ? On donne le sentiment à la population qu'elle ne sera pas mieux soignée en cas de deuxième vague. Si tel est le cas, il nous revient alors, responsables politiques et médecins, d'alerter le Gouvernement sur le risque de lever toutes les restrictions. Il semble en effet dangereux, dans ces conditions, de rouvrir à partir de septembre les salons, les foires, etc. La Belgique ou la Catalogne reconfinent, mais on semble faire comme si nous étions sortis de la crise. Sommes-nous donc mieux préparés qu'il y a six mois ?

On a manqué de masques, de tests, de gel hydroalcoolique, etc. La coordination a été plus ou moins efficace selon les régions. Notre commission fera un bilan et publiera un rapport qui, j'en suis sûr, fascinera le Gouvernement... Mais notre système de santé est-il désormais mieux préparé en cas de nouvelle vague ?
On ne nous parle jamais de traitement depuis le début de nos travaux. J'ai bien compris qu'il n'y avait pas de traitement spécifique pour la covid-19, mais j'imagine que l'on ne donne pas uniquement du paracétamol aux patients... Si un jour j'étais malade et que j'apprenne cela, je ne suis pas sûr que mon état mental et moral s'améliorerait ! Je comprends bien que l'on ne traite que les symptômes et non pas la cause, mais, malgré tout, j'imagine que l'on a une meilleure connaissance de la maladie et que les traitements évoluent. Pourquoi ne pas en informer les gens ? On donne le sentiment à la population qu'elle ne sera pas mieux soignée en cas de deuxième vague. Si tel est le cas, il nous revient alors, responsables politiques et médecins, d'alerter le Gouvernement sur le risque de lever toutes les restrictions. Il semble en effet dangereux, dans ces conditions, de rouvrir à partir de septembre les salons, les foires, etc. La Belgique ou la Catalogne reconfinent, mais on semble faire comme si nous étions sortis de la crise. Sommes-nous donc mieux préparés qu'il y a six mois ?
Oui ! J'évoquerai la réanimation des patients les plus graves. Il y a eu des progrès thérapeutiques. Comme vous le savez, de très nombreux essais ont été menés. Une controverse très vive a eu lieu autour de l'hydroxychloroquine, dont, pour l'instant, la communauté internationale n'est pas convaincue de l'efficacité. En revanche, une étude anglaise intitulée Recovery, dont le compte rendu a été publié la semaine dernière dans The New England Journal of medicine, montre qu'une courte cure de corticostéroïdes, avec un médicament qui ne coûte presque rien, la déxaméthasone, permet de réduire la mortalité des patients qui ont besoin d'une oxygénothérapie ou qui doivent être placés sous ventilation artificielle.
On a aussi fait des progrès dans l'identification des signes précoces de gravité : une des particularités des patients atteints de la covid-19, qui est un syndrome de détresse respiratoire aiguë, est qu'ils présentent une hypoxémie heureuse, c'est-à-dire des taux d'oxygène dans le sang très bas sans sensation d'essoufflement important. C'était trompeur pour nous, au début.
En matière d'offre de soins, il y a aussi eu des progrès : l'augmentation de l'offre de soins de réanimation développée lors de la première phase est désormais en réserve. Je coordonne l'offre de soins pour les Pays de la Loire : en Mayenne, département de 300 000 habitants, la situation est tendue, avec l'apparition de plusieurs clusters et une circulation du virus inquiétante - essentiellement parmi une population jeune, notamment des travailleurs immigrés qui travaillent dans les abattoirs, vivent dans des foyers et sont peu enclins à développer des formes graves. L'hôpital de Laval comptait, avant la crise, 8 lits de réanimation, soit moins de 3 lits pour 100 000 habitants, contre 7,5 en moyenne en France. Désormais, cet hôpital peut compter, en plus de son service de réanimation qui a été étendu, car l'unité de surveillance continue a été transformée en unité de réanimation, sur 15 lits d'une unité désaffectée, qui devait être transformée en service de cardiologie. Ces lits sont susceptibles d'être transformés en vingt-quatre heures en lits de réanimation. Le système est donc mieux préparé que lors de la première phase.
En ce qui concerne l'articulation entre l'hôpital et le système de santé, la doctrine était que les personnes, en cas de toux, devaient appeler le 15, chargé d'orienter les personnes suspectées d'être atteintes de la covid vers les hôpitaux de première ligne, qui étaient des hôpitaux publics. On a tout misé là-dessus, en sous-estimant l'ampleur de la crise. Il aurait probablement fallu activer plus tôt l'ensemble du système de santé, notamment les médecins généralistes, mais il aurait fallu alors pouvoir leur fournir des masques : on voit comment la disponibilité des moyens a eu un impact sur les décisions.
De même, le 26 février, dans la région Pays de la Loire, seul le laboratoire de virologie du CHU de Nantes avait l'agrément pour réaliser des tests PCR en vue de détecter les cas de covid. J'ai envoyé un courriel à M. Salomon, qui m'a répondu aussitôt qu'il activait d'autres centres. Le système était le suivant : la direction générale de la santé indiquait au centre national de référence (CNR) des coronavirus de l'Institut Pasteur les laboratoires prioritaires pour faire des diagnostics. Le CNR prenait ensuite contact avec ces laboratoires, leur communiquait la technique à utiliser, validait la mise en oeuvre de la technique par le biais de prélèvements tests et homologuait finalement les laboratoires. Cette stratégie a restreint le nombre de laboratoires agréés, et donc notre capacité de diagnostic. On l'a adaptée à une disponibilité des moyens de diagnostic assez limitée au départ, et ce n'est qu'ensuite qu'il est apparu qu'il fallait diffuser la technique à l'ensemble des laboratoires. En Mayenne, un laboratoire vétérinaire a ainsi reçu l'agrément et participe actuellement à la campagne de dépistage.
On a clairement considéré, pendant les premières semaines, que la crise constituait un défi pour l'hôpital, alors qu'elle constituait un défi pour l'ensemble du système de santé. On a probablement perdu du temps. On s'en est vite aperçu au sein de la cellule de crise du CHU d'Angers. On a contacté alors les médecins libéraux, et on a organisé treize centres Covid 49 - 49, comme le numéro du département. Il pouvait s'agir de maisons de santé pluridisciplinaires, de salles polyvalentes mises à disposition par les maires, etc. L'hôpital a fourni les gels hydroalcooliques fabriqués par la faculté de pharmacie, les masques, des étudiants en médecine pour assurer l'accueil du public, notre cellule d'hygiène a organisé les parcours pour éviter que les gens ne se croisent, puis on a laissé les médecins généralistes s'organiser pour assurer des permanences. Quand le SAMU recevait un appel d'une personne qui présentait des symptômes sans avoir développé une forme grave, il le redirigeait vers le centre le plus proche, où il était pris en charge par un médecin. Ce système a très bien fonctionné et nous sommes prêts à le réactiver.
J'en viens à la recherche. Il y a eu un très grand dynamisme en la matière, essentiellement du fait des CHU. L'essai Discovery a été mené par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), qui est un organisme de très haut niveau scientifique ; mais ce n'est pas l'Inserm qui soigne les malades, ce sont les hôpitaux ! La conduite de cet essai a été très difficile, et sa dimension européenne n'a pas simplifié les choses... Toutefois, les initiatives ont fleuri au sein des hôpitaux. Nous disposions d'un stock d'hydroxychloroquine et nous avons lancé un essai randomisé sur 250 malades. L'analyse de ce test est en cours et devrait être publiée dans les prochaines semaines. Les cliniciens et les chercheurs sont demandeurs d'une procédure simplifiée, rapide, adaptée au temps de crise, afin de pouvoir mener rapidement des travaux de recherche. Mais on note déjà des avancées. Il faut ainsi souligner le travail de la direction générale de la santé pour accélérer le processus d'évaluation des projets de recherche par les comités de protection des personnes.
Des transferts de patients ont été organisés. L'un des premiers a été un transfert de patients du Grand-Est vers les Pays de la Loire. L'idée est née au sein du groupe WhatsApp des réanimateurs du Grand Ouest. Nous constations que nous étions prêts, il ne manquait plus que les malades. Le chef du service de réanimation de l'hôpital de Mulhouse m'a expliqué qu'ils étaient submergés. Nous avons donc proposé d'accueillir des patients. Tout est allé ensuite assez vite. Lors d'une conférence téléphonique, j'ai fait cette proposition à l'ensemble de mes collègues réanimateurs des Pays de la Loire. Chacun était d'accord. J'ai soumis l'idée à ma directrice générale, qui est déléguée régionale de la Fédération hospitalière de France. Elle a contacté tous les directeurs des établissements concernés. Le 21 mars, j'ai proposé le dispositif au directeur général de l'ARS. Le 26 mars, le premier TGV en provenance de Strasbourg et de Mulhouse est arrivé : six patients ont été accueillis à Angers, quatre au Mans, six à Nantes et quatre à La Roche-sur-Yon. Les SAMU ont géré le transfert de manière remarquable. Les préfets ont veillé à garantir des conditions de sécurité optimales. L'opération a été une réussite ; les six patients soignés à Angers sont repartis chez eux.
Il semblait préférable d'organiser des transferts de patients plutôt que de médecins ou de moyens, car on ne pouvait pas prendre le risque de nous démunir et de réduire l'offre de santé sur notre territoire. C'est pourquoi nous avons formulé cette offre, qui a été transmise par le directeur général de l'ARS des Pays de la Loire, M. Coiplet, à la cellule de crise nationale. Celle-ci l'a ensuite communiquée à l'ARS du Grand-Est, et les transferts ont été organisés en cinq jours. Début avril, nous avons reçu 47 patients d'Île-de-France, avec des transferts par hélicoptère ou par avion ; il faut reconnaître que cela fut un petit peu plus compliqué et désordonné, même si aucun patient n'en a pâti - il est vrai que les collègues réanimateurs sélectionnaient des patients dans un état stable, capables de supporter les transferts. Les spécialistes du SAMU savent sécuriser un transfert, y compris prolongé - c'est leur métier -, et c'est une chance que n'ont pas tous les pays européens.
Oui ! J'évoquerai la réanimation des patients les plus graves. Il y a eu des progrès thérapeutiques. Comme vous le savez, de très nombreux essais ont été menés. Une controverse très vive a eu lieu autour de l'hydroxychloroquine, dont, pour l'instant, la communauté internationale n'est pas convaincue de l'efficacité. En revanche, une étude anglaise intitulée Recovery, dont le compte rendu a été publié la semaine dernière dans The New England Journal of medicine, montre qu'une courte cure de corticostéroïdes, avec un médicament qui ne coûte presque rien, la déxaméthasone, permet de réduire la mortalité des patients qui ont besoin d'une oxygénothérapie ou qui doivent être placés sous ventilation artificielle.
On a aussi fait des progrès dans l'identification des signes précoces de gravité : une des particularités des patients atteints de la covid-19, qui est un syndrome de détresse respiratoire aiguë, est qu'ils présentent une hypoxémie heureuse, c'est-à-dire des taux d'oxygène dans le sang très bas sans sensation d'essoufflement important. C'était trompeur pour nous, au début.
En matière d'offre de soins, il y a aussi eu des progrès : l'augmentation de l'offre de soins de réanimation développée lors de la première phase est désormais en réserve. Je coordonne l'offre de soins pour les Pays de la Loire : en Mayenne, département de 300 000 habitants, la situation est tendue, avec l'apparition de plusieurs clusters et une circulation du virus inquiétante - essentiellement parmi une population jeune, notamment des travailleurs immigrés qui travaillent dans les abattoirs, vivent dans des foyers et sont peu enclins à développer des formes graves. L'hôpital de Laval comptait, avant la crise, 8 lits de réanimation, soit moins de 3 lits pour 100 000 habitants, contre 7,5 en moyenne en France. Désormais, cet hôpital peut compter, en plus de son service de réanimation qui a été étendu, car l'unité de surveillance continue a été transformée en unité de réanimation, sur 15 lits d'une unité désaffectée, qui devait être transformée en service de cardiologie. Ces lits sont susceptibles d'être transformés en vingt-quatre heures en lits de réanimation. Le système est donc mieux préparé que lors de la première phase.
En ce qui concerne l'articulation entre l'hôpital et le système de santé, la doctrine était que les personnes, en cas de toux, devaient appeler le 15, chargé d'orienter les personnes suspectées d'être atteintes de la covid vers les hôpitaux de première ligne, qui étaient des hôpitaux publics. On a tout misé là-dessus, en sous-estimant l'ampleur de la crise. Il aurait probablement fallu activer plus tôt l'ensemble du système de santé, notamment les médecins généralistes, mais il aurait fallu alors pouvoir leur fournir des masques : on voit comment la disponibilité des moyens a eu un impact sur les décisions.
De même, le 26 février, dans la région Pays de la Loire, seul le laboratoire de virologie du CHU de Nantes avait l'agrément pour réaliser des tests PCR en vue de détecter les cas de covid. J'ai envoyé un courriel à M. Salomon, qui m'a répondu aussitôt qu'il activait d'autres centres. Le système était le suivant : la direction générale de la santé indiquait au centre national de référence (CNR) des coronavirus de l'Institut Pasteur les laboratoires prioritaires pour faire des diagnostics. Le CNR prenait ensuite contact avec ces laboratoires, leur communiquait la technique à utiliser, validait la mise en oeuvre de la technique par le biais de prélèvements tests et homologuait finalement les laboratoires. Cette stratégie a restreint le nombre de laboratoires agréés, et donc notre capacité de diagnostic. On l'a adaptée à une disponibilité des moyens de diagnostic assez limitée au départ, et ce n'est qu'ensuite qu'il est apparu qu'il fallait diffuser la technique à l'ensemble des laboratoires. En Mayenne, un laboratoire vétérinaire a ainsi reçu l'agrément et participe actuellement à la campagne de dépistage.
On a clairement considéré, pendant les premières semaines, que la crise constituait un défi pour l'hôpital, alors qu'elle constituait un défi pour l'ensemble du système de santé. On a probablement perdu du temps. On s'en est vite aperçu au sein de la cellule de crise du CHU d'Angers. On a contacté alors les médecins libéraux, et on a organisé treize centres Covid 49 - 49, comme le numéro du département. Il pouvait s'agir de maisons de santé pluridisciplinaires, de salles polyvalentes mises à disposition par les maires, etc. L'hôpital a fourni les gels hydroalcooliques fabriqués par la faculté de pharmacie, les masques, des étudiants en médecine pour assurer l'accueil du public, notre cellule d'hygiène a organisé les parcours pour éviter que les gens ne se croisent, puis on a laissé les médecins généralistes s'organiser pour assurer des permanences. Quand le SAMU recevait un appel d'une personne qui présentait des symptômes sans avoir développé une forme grave, il le redirigeait vers le centre le plus proche, où il était pris en charge par un médecin. Ce système a très bien fonctionné et nous sommes prêts à le réactiver.
J'en viens à la recherche. Il y a eu un très grand dynamisme en la matière, essentiellement du fait des CHU. L'essai Discovery a été mené par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), qui est un organisme de très haut niveau scientifique ; mais ce n'est pas l'Inserm qui soigne les malades, ce sont les hôpitaux ! La conduite de cet essai a été très difficile, et sa dimension européenne n'a pas simplifié les choses... Toutefois, les initiatives ont fleuri au sein des hôpitaux. Nous disposions d'un stock d'hydroxychloroquine et nous avons lancé un essai randomisé sur 250 malades. L'analyse de ce test est en cours et devrait être publiée dans les prochaines semaines. Les cliniciens et les chercheurs sont demandeurs d'une procédure simplifiée, rapide, adaptée au temps de crise, afin de pouvoir mener rapidement des travaux de recherche. Mais on note déjà des avancées. Il faut ainsi souligner le travail de la direction générale de la santé pour accélérer le processus d'évaluation des projets de recherche par les comités de protection des personnes.
Des transferts de patients ont été organisés. L'un des premiers a été un transfert de patients du Grand-Est vers les Pays de la Loire. L'idée est née au sein du groupe WhatsApp des réanimateurs du Grand Ouest. Nous constations que nous étions prêts, il ne manquait plus que les malades. Le chef du service de réanimation de l'hôpital de Mulhouse m'a expliqué qu'ils étaient submergés. Nous avons donc proposé d'accueillir des patients. Tout est allé ensuite assez vite. Lors d'une conférence téléphonique, j'ai fait cette proposition à l'ensemble de mes collègues réanimateurs des Pays de la Loire. Chacun était d'accord. J'ai soumis l'idée à ma directrice générale, qui est déléguée régionale de la Fédération hospitalière de France. Elle a contacté tous les directeurs des établissements concernés. Le 21 mars, j'ai proposé le dispositif au directeur général de l'ARS. Le 26 mars, le premier TGV en provenance de Strasbourg et de Mulhouse est arrivé : six patients ont été accueillis à Angers, quatre au Mans, six à Nantes et quatre à La Roche-sur-Yon. Les SAMU ont géré le transfert de manière remarquable. Les préfets ont veillé à garantir des conditions de sécurité optimales. L'opération a été une réussite ; les six patients soignés à Angers sont repartis chez eux.
Il semblait préférable d'organiser des transferts de patients plutôt que de médecins ou de moyens, car on ne pouvait pas prendre le risque de nous démunir et de réduire l'offre de santé sur notre territoire. C'est pourquoi nous avons formulé cette offre, qui a été transmise par le directeur général de l'ARS des Pays de la Loire, M. Coiplet, à la cellule de crise nationale. Celle-ci l'a ensuite communiquée à l'ARS du Grand-Est, et les transferts ont été organisés en cinq jours. Début avril, nous avons reçu 47 patients d'Île-de-France, avec des transferts par hélicoptère ou par avion ; il faut reconnaître que cela fut un petit peu plus compliqué et désordonné, même si aucun patient n'en a pâti - il est vrai que les collègues réanimateurs sélectionnaient des patients dans un état stable, capables de supporter les transferts. Les spécialistes du SAMU savent sécuriser un transfert, y compris prolongé - c'est leur métier -, et c'est une chance que n'ont pas tous les pays européens.

Les pompiers nous ont dit qu'ils auraient pu assurer ces transferts et qu'ils s'étonnaient du recours aux TGV...

Les pompiers nous ont dit qu'ils auraient pu assurer ces transferts et qu'ils s'étonnaient du recours aux TGV...
Je laisse mon collègue vous répondre sur ce point, car la querelle entre les « blancs » et les « rouges » ne date pas d'hier...
Je laisse mon collègue vous répondre sur ce point, car la querelle entre les « blancs » et les « rouges » ne date pas d'hier...
Cette polémique entre les services de la sécurité civile et les SAMU dure en effet depuis très longtemps. Le rapport de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers dénonce certains points. Je n'ai pas été témoin de tout ce qui s'est passé sur l'ensemble du territoire national, mais je sais que ce que nous avons vécu était hors norme : pendant quatorze jours, dans le département du Haut-Rhin, nous avons transféré quotidiennement entre 12 et 20 patients en réanimation. Sans doute était-il possible de faire autrement, mais, en tous cas, au moment où nous avons été confrontés à cette situation, il n'y avait pas d'autre solution que de transférer des malades, à moins d'accepter d'en laisser mourir d'autres. Nous avions déjà mis en oeuvre le partenariat entre le public et le privé et doublé le nombre de nos lits de réanimation. À partir du 25 mars, trente lits de l'établissement militaire de réanimation ont été installés à proximité immédiate de l'hôpital de Mulhouse. Nous avions aussi des renforts de professionnels médicaux et paramédicaux, qui venaient de toutes les régions, notamment de la Nouvelle-Aquitaine, mais ces transferts étaient nécessaires en raison du grand nombre de patients en état très grave. Les patients transférés n'étaient pas de nouveaux patients, mais des malades qui avaient été pris en charge depuis quelques jours, dont l'état était stabilisé et auxquels un transfert ne faisait pas courir de risque.
Je ne sais pas si recourir au TGV était une bonne solution. Une étude est en cours au niveau national, pilotée par un organisme indépendant : elle nous montrera si la mortalité des patients concernés a été plus importante. En tous cas, à première vue, la mortalité semble ne pas avoir été supérieure.
Nous avons eu un partenariat très étroit avec les sapeurs-pompiers dans le Haut-Rhin, grâce à des échanges et à des relations humaines nouées de longue date, et nous avons pu utiliser leurs moyens à bon escient. La mission des sapeurs-pompiers n'est pas de réaliser des transferts secondaires : cette tâche nécessite des moyens médicalisés importants, notamment des équipements de réanimation, qu'ils n'ont pas. Leur mission première est le secours aux personnes dans des conditions d'urgence, en aucun cas le transport de patients d'un établissement à un autre, en dehors de circonstances exceptionnelles. Grâce au transfert de 330 patients hors du département, nous avons pu accueillir autant de nouveaux malades.
Sans doute pourrions-nous organiser les choses différemment, peut-être pourrait-on disposer, comme à Laval, d'un service susceptible d'être transformé rapidement en service de réanimation, mais, vu l'ampleur du phénomène, les transferts étaient nécessaires. Cette expérience a été bénéfique. Nous pouvons améliorer la coordination entre les territoires, entre les régions et au niveau national, et il conviendrait aussi de standardiser les procédures. Les patients étaient pris en charge, dans les TGV, par des équipes extérieures au département, ce qui maintenait notre capacité opérationnelle à continuer à traiter les autres patients.
Cette polémique entre les services de la sécurité civile et les SAMU dure en effet depuis très longtemps. Le rapport de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers dénonce certains points. Je n'ai pas été témoin de tout ce qui s'est passé sur l'ensemble du territoire national, mais je sais que ce que nous avons vécu était hors norme : pendant quatorze jours, dans le département du Haut-Rhin, nous avons transféré quotidiennement entre 12 et 20 patients en réanimation. Sans doute était-il possible de faire autrement, mais, en tous cas, au moment où nous avons été confrontés à cette situation, il n'y avait pas d'autre solution que de transférer des malades, à moins d'accepter d'en laisser mourir d'autres. Nous avions déjà mis en oeuvre le partenariat entre le public et le privé et doublé le nombre de nos lits de réanimation. À partir du 25 mars, trente lits de l'établissement militaire de réanimation ont été installés à proximité immédiate de l'hôpital de Mulhouse. Nous avions aussi des renforts de professionnels médicaux et paramédicaux, qui venaient de toutes les régions, notamment de la Nouvelle-Aquitaine, mais ces transferts étaient nécessaires en raison du grand nombre de patients en état très grave. Les patients transférés n'étaient pas de nouveaux patients, mais des malades qui avaient été pris en charge depuis quelques jours, dont l'état était stabilisé et auxquels un transfert ne faisait pas courir de risque.
Je ne sais pas si recourir au TGV était une bonne solution. Une étude est en cours au niveau national, pilotée par un organisme indépendant : elle nous montrera si la mortalité des patients concernés a été plus importante. En tous cas, à première vue, la mortalité semble ne pas avoir été supérieure.
Nous avons eu un partenariat très étroit avec les sapeurs-pompiers dans le Haut-Rhin, grâce à des échanges et à des relations humaines nouées de longue date, et nous avons pu utiliser leurs moyens à bon escient. La mission des sapeurs-pompiers n'est pas de réaliser des transferts secondaires : cette tâche nécessite des moyens médicalisés importants, notamment des équipements de réanimation, qu'ils n'ont pas. Leur mission première est le secours aux personnes dans des conditions d'urgence, en aucun cas le transport de patients d'un établissement à un autre, en dehors de circonstances exceptionnelles. Grâce au transfert de 330 patients hors du département, nous avons pu accueillir autant de nouveaux malades.
Sans doute pourrions-nous organiser les choses différemment, peut-être pourrait-on disposer, comme à Laval, d'un service susceptible d'être transformé rapidement en service de réanimation, mais, vu l'ampleur du phénomène, les transferts étaient nécessaires. Cette expérience a été bénéfique. Nous pouvons améliorer la coordination entre les territoires, entre les régions et au niveau national, et il conviendrait aussi de standardiser les procédures. Les patients étaient pris en charge, dans les TGV, par des équipes extérieures au département, ce qui maintenait notre capacité opérationnelle à continuer à traiter les autres patients.
Si j'entends bien, il n'y a pas eu de difficultés à Mulhouse entre les pompiers et le SAMU, entre les cliniques et les hôpitaux. J'ai l'impression de ne pas connaître ce monde-là... Il y a quand même un certain nombre de problèmes ! Ils ont peut-être trouvé une solution à Mulhouse du fait de l'étendue des difficultés rencontrées, qui ont fait que chacun a pris ses responsabilités. Toutefois, dans ma clinique, quand mes infirmières, qui attendaient des malades avec tous les équipements nécessaires, entendaient parler de transferts par train ou par avion, il n'était pas facile de maintenir la cohésion des équipes ! Si je connais mal les rapports entre les SAMU et les pompiers, je sais que tout n'est pas rose entre les cliniques et les hôpitaux, comme en est convenu le président de la Fédération de l'hospitalisation privée au début. En décembre, nous avions connu la crise des urgences, qui était révélatrice d'un certain nombre de problèmes. Les cliniques et les hôpitaux travaillent chacun dans leur coin. On a peut-être appris à mieux traiter la covid, mais les problèmes de fond demeurent !
Si j'entends bien, il n'y a pas eu de difficultés à Mulhouse entre les pompiers et le SAMU, entre les cliniques et les hôpitaux. J'ai l'impression de ne pas connaître ce monde-là... Il y a quand même un certain nombre de problèmes ! Ils ont peut-être trouvé une solution à Mulhouse du fait de l'étendue des difficultés rencontrées, qui ont fait que chacun a pris ses responsabilités. Toutefois, dans ma clinique, quand mes infirmières, qui attendaient des malades avec tous les équipements nécessaires, entendaient parler de transferts par train ou par avion, il n'était pas facile de maintenir la cohésion des équipes ! Si je connais mal les rapports entre les SAMU et les pompiers, je sais que tout n'est pas rose entre les cliniques et les hôpitaux, comme en est convenu le président de la Fédération de l'hospitalisation privée au début. En décembre, nous avions connu la crise des urgences, qui était révélatrice d'un certain nombre de problèmes. Les cliniques et les hôpitaux travaillent chacun dans leur coin. On a peut-être appris à mieux traiter la covid, mais les problèmes de fond demeurent !
J'ai parlé en effet, dans mon propos liminaire, d'un décalage de compréhension et de perception entre ce que nous vivions et une vision nationale qui appréhendait le territoire d'une manière globale, sans tenir compte de la gravité de ce qui se passait localement. Début mars, nous évoquions la gravité des difficultés que nous rencontrions dans nos échanges quotidiens par téléphone ou visioconférence avec l'ARS et la préfecture. Je ne doute pas que le directeur de l'ARS ou le préfet aient fait remonter ces informations. Pourtant, nul n'a pris la mesure de l'ampleur des problèmes locaux et des besoins de réorganisation du système ; nos ressources pour faire face à la crise étaient saturées. Si nous avions bénéficié du renfort de ressources extérieures, l'organisation aurait pu être différente.
Illustration de ce décalage de perception, les recommandations nationales étaient déjà inapplicables chez nous. Chaque jour, le directeur général de la santé parlait, dans son point de presse quotidien, de la réalisation de tests, promettant que tout patient symptomatique bénéficierait d'un test ; mais nous n'avions déjà plus les moyens de tester ces patients, faute d'un nombre de tests suffisant, tandis que notre dispositif de prélèvement était déjà saturé : en Alsace, seul le laboratoire du CHU de Strasbourg pouvait traiter les tests et nous ne pouvions en réaliser davantage. La population ne comprenait pas. De même, on demandait aux gens d'appeler le 15 pour tout symptôme. Le 6 mars, j'ai demandé à ce que l'on sollicite le centre 15 pour des cas nécessitant une prise en charge, et non uniquement comme centre de renseignement. Il y avait donc un décalage entre les discours publics nationaux et la réalité que nous vivions.
Dans mon établissement, le stock de masques chirurgicaux s'élève à 30 000 par mois. Or, début mars, nous en consommions 30 000 en deux jours ! L'État avait mobilisé l'ensemble des stocks du territoire, mais il a fallu attendre assez longtemps pour recevoir une première aide - je n'ai plus la date en tête. La première livraison a été de 32 000 masques : nous devions tenir une semaine avec, et nous devions aussi fournir les professionnels de santé du territoire... Cela illustre l'incompréhension, le décalage entre l'ampleur de nos besoins et une vision nationale très lointaine, soucieuse que la règle soit la même sur tout le territoire.
Vous m'avez aussi interrogé sur les outils numériques. La gestion de crise est aussi une gestion de l'information et de la communication. Il convient donc de pouvoir disposer de chiffres exploitables ou susceptibles d'être aisément centralisés ; or nos systèmes d'information produisaient une multitude de chiffres divers, mais sans aucune coordination. Les différentes administrations envoyaient nombre de fichiers Excel sur la distribution des moyens de protection, l'état des stocks, les besoins, les activités, les lits de réanimation, etc. Les fichiers se multipliaient dans tous les sens, alors qu'il aurait été facile d'utiliser des outils numériques intégrés, simples à mettre en place, pour peu que l'on veuille bien homogénéiser les standards de communication.
La gestion des lits de réanimation a été révélatrice à cet égard. Dans le Grand-Est, l'enjeu a été la gestion des malades graves. Nous disposions, comme toutes les régions, du répertoire opérationnel des ressources, qui est une sorte de catalogue de l'offre de soins, permettant d'indiquer la disponibilité des lits. Cet outil est insuffisamment connu ou utilisé, ce qui renvoie à une problématique d'appropriation tant par les utilisateurs que par les instances régionales qui le pilotent ; de ce fait, il était inopérant et, au début de la crise, chaque établissement devait passer de multiples coups de téléphone aux autres établissements pour trouver des lits disponibles. Que de temps perdu ! Très vite toutefois, grâce à la mise en place d'un petit outil développé par des ingénieurs de Polytechnique, nous avons pu partager cette information presque en temps réel. Cela a changé notre vie ! Il est étonnant qu'en 2020 on ne puisse pas transférer des informations importantes en période de crise autrement que via des fichiers Excel...
J'ai parlé en effet, dans mon propos liminaire, d'un décalage de compréhension et de perception entre ce que nous vivions et une vision nationale qui appréhendait le territoire d'une manière globale, sans tenir compte de la gravité de ce qui se passait localement. Début mars, nous évoquions la gravité des difficultés que nous rencontrions dans nos échanges quotidiens par téléphone ou visioconférence avec l'ARS et la préfecture. Je ne doute pas que le directeur de l'ARS ou le préfet aient fait remonter ces informations. Pourtant, nul n'a pris la mesure de l'ampleur des problèmes locaux et des besoins de réorganisation du système ; nos ressources pour faire face à la crise étaient saturées. Si nous avions bénéficié du renfort de ressources extérieures, l'organisation aurait pu être différente.
Illustration de ce décalage de perception, les recommandations nationales étaient déjà inapplicables chez nous. Chaque jour, le directeur général de la santé parlait, dans son point de presse quotidien, de la réalisation de tests, promettant que tout patient symptomatique bénéficierait d'un test ; mais nous n'avions déjà plus les moyens de tester ces patients, faute d'un nombre de tests suffisant, tandis que notre dispositif de prélèvement était déjà saturé : en Alsace, seul le laboratoire du CHU de Strasbourg pouvait traiter les tests et nous ne pouvions en réaliser davantage. La population ne comprenait pas. De même, on demandait aux gens d'appeler le 15 pour tout symptôme. Le 6 mars, j'ai demandé à ce que l'on sollicite le centre 15 pour des cas nécessitant une prise en charge, et non uniquement comme centre de renseignement. Il y avait donc un décalage entre les discours publics nationaux et la réalité que nous vivions.
Dans mon établissement, le stock de masques chirurgicaux s'élève à 30 000 par mois. Or, début mars, nous en consommions 30 000 en deux jours ! L'État avait mobilisé l'ensemble des stocks du territoire, mais il a fallu attendre assez longtemps pour recevoir une première aide - je n'ai plus la date en tête. La première livraison a été de 32 000 masques : nous devions tenir une semaine avec, et nous devions aussi fournir les professionnels de santé du territoire... Cela illustre l'incompréhension, le décalage entre l'ampleur de nos besoins et une vision nationale très lointaine, soucieuse que la règle soit la même sur tout le territoire.
Vous m'avez aussi interrogé sur les outils numériques. La gestion de crise est aussi une gestion de l'information et de la communication. Il convient donc de pouvoir disposer de chiffres exploitables ou susceptibles d'être aisément centralisés ; or nos systèmes d'information produisaient une multitude de chiffres divers, mais sans aucune coordination. Les différentes administrations envoyaient nombre de fichiers Excel sur la distribution des moyens de protection, l'état des stocks, les besoins, les activités, les lits de réanimation, etc. Les fichiers se multipliaient dans tous les sens, alors qu'il aurait été facile d'utiliser des outils numériques intégrés, simples à mettre en place, pour peu que l'on veuille bien homogénéiser les standards de communication.
La gestion des lits de réanimation a été révélatrice à cet égard. Dans le Grand-Est, l'enjeu a été la gestion des malades graves. Nous disposions, comme toutes les régions, du répertoire opérationnel des ressources, qui est une sorte de catalogue de l'offre de soins, permettant d'indiquer la disponibilité des lits. Cet outil est insuffisamment connu ou utilisé, ce qui renvoie à une problématique d'appropriation tant par les utilisateurs que par les instances régionales qui le pilotent ; de ce fait, il était inopérant et, au début de la crise, chaque établissement devait passer de multiples coups de téléphone aux autres établissements pour trouver des lits disponibles. Que de temps perdu ! Très vite toutefois, grâce à la mise en place d'un petit outil développé par des ingénieurs de Polytechnique, nous avons pu partager cette information presque en temps réel. Cela a changé notre vie ! Il est étonnant qu'en 2020 on ne puisse pas transférer des informations importantes en période de crise autrement que via des fichiers Excel...

Dans la Marne, où est située la clinique du Pr Llagonne, il était en effet étonnant de voir les TGV sanitaires passer, alors que les cabinets des médecins généralistes ou les cliniques étaient vides, tandis que les hôpitaux ou le centre 15 étaient saturés. La réserve sanitaire avait été mobilisée, mais les médecins et les soignants étaient au chômage, en pleine crise...
C'est la première fois que le Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires (Codamups) est mentionné depuis le début de nos auditions. Il n'a, semble-t-il, pas été mobilisé. On entend peu parler aussi de Santé publique France (SPF). Quel est son rôle ?
Avez-vous des consignes en cas de survenue d'une nouvelle vague ? Une nouvelle organisation est-elle prévue ? On reçoit de belles statistiques tous les jours de la part de SPF, mais j'ai l'impression que l'on n'a pas tiré les leçons de la mauvaise organisation observée dans certains territoires.

Dans la Marne, où est située la clinique du Pr Llagonne, il était en effet étonnant de voir les TGV sanitaires passer, alors que les cabinets des médecins généralistes ou les cliniques étaient vides, tandis que les hôpitaux ou le centre 15 étaient saturés. La réserve sanitaire avait été mobilisée, mais les médecins et les soignants étaient au chômage, en pleine crise...
C'est la première fois que le Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires (Codamups) est mentionné depuis le début de nos auditions. Il n'a, semble-t-il, pas été mobilisé. On entend peu parler aussi de Santé publique France (SPF). Quel est son rôle ?
Avez-vous des consignes en cas de survenue d'une nouvelle vague ? Une nouvelle organisation est-elle prévue ? On reçoit de belles statistiques tous les jours de la part de SPF, mais j'ai l'impression que l'on n'a pas tiré les leçons de la mauvaise organisation observée dans certains territoires.

Monsieur Llagonne, des lits sont restés vacants dans votre clinique pendant une quinzaine de jours. Celle-ci se trouve-t-elle à proximité d'un hôpital en situation de surcharge ou d'un Ehpad qui manquait de moyens pour gérer les cas de covid ? Que s'est-il passé ensuite ? Aviez-vous la capacité d'abriter une cellule covid ?
On n'a pas observé, apparemment, de surmortalité parmi les 330 patients qui ont été transférés depuis Mulhouse. Mais, avec le recul, quels sont les éléments à prendre en compte pour apprécier si les transferts n'ont pas causé de préjudice aux patients ?

Monsieur Llagonne, des lits sont restés vacants dans votre clinique pendant une quinzaine de jours. Celle-ci se trouve-t-elle à proximité d'un hôpital en situation de surcharge ou d'un Ehpad qui manquait de moyens pour gérer les cas de covid ? Que s'est-il passé ensuite ? Aviez-vous la capacité d'abriter une cellule covid ?
On n'a pas observé, apparemment, de surmortalité parmi les 330 patients qui ont été transférés depuis Mulhouse. Mais, avec le recul, quels sont les éléments à prendre en compte pour apprécier si les transferts n'ont pas causé de préjudice aux patients ?

Quelles préconisations formuleriez-vous pour améliorer les procédures, l'informatique, la chaîne de commandement, le rôle de l'État, etc. ? Ce dernier, dans son ensemble, a parfois montré des carences et des défaillances, comme les témoignages l'indiquent. Avez-vous eu des réunions de travail avec les services de l'État, notamment l'ARS, pour évoquer ces retours d'expérience afin de pouvoir réagir différemment en cas de nouvelle vague à l'automne ? Plus on intervient vite, plus on peut ralentir la propagation de l'épidémie. Serions-nous aujourd'hui plus efficaces ?
Je ne veux pas faire des équipements individuels de protection un sujet de polémique, mais, en l'espace de cinq mois, l'État a dit tout et son contraire à leur sujet : les masques, initialement, ne servaient prétendument à rien ; ils sont désormais obligatoires. Les préfets ne demandent plus le retrait des arrêtés municipaux des maires concernant le port du masque dans les espaces publics extérieurs. Les Français ne comprennent pas ! Si l'État fait obligation aux Français de se protéger pour des raisons de santé publique, ne serait-il pas normal d'envisager une prise en charge des équipements par l'assurance maladie et les organismes complémentaires ? Le Président de la République semble rejeter cette hypothèse. On note aussi des tensions sur les stocks d'équipements de protection. C'est le cas pour les masques. Les infirmiers manquent de gants et les prix de ces derniers flambent. Une prise en charge par l'assurance maladie ne permettrait-elle pas d'endiguer ce phénomène et d'imposer un prix unique ?

Quelles préconisations formuleriez-vous pour améliorer les procédures, l'informatique, la chaîne de commandement, le rôle de l'État, etc. ? Ce dernier, dans son ensemble, a parfois montré des carences et des défaillances, comme les témoignages l'indiquent. Avez-vous eu des réunions de travail avec les services de l'État, notamment l'ARS, pour évoquer ces retours d'expérience afin de pouvoir réagir différemment en cas de nouvelle vague à l'automne ? Plus on intervient vite, plus on peut ralentir la propagation de l'épidémie. Serions-nous aujourd'hui plus efficaces ?
Je ne veux pas faire des équipements individuels de protection un sujet de polémique, mais, en l'espace de cinq mois, l'État a dit tout et son contraire à leur sujet : les masques, initialement, ne servaient prétendument à rien ; ils sont désormais obligatoires. Les préfets ne demandent plus le retrait des arrêtés municipaux des maires concernant le port du masque dans les espaces publics extérieurs. Les Français ne comprennent pas ! Si l'État fait obligation aux Français de se protéger pour des raisons de santé publique, ne serait-il pas normal d'envisager une prise en charge des équipements par l'assurance maladie et les organismes complémentaires ? Le Président de la République semble rejeter cette hypothèse. On note aussi des tensions sur les stocks d'équipements de protection. C'est le cas pour les masques. Les infirmiers manquent de gants et les prix de ces derniers flambent. Une prise en charge par l'assurance maladie ne permettrait-elle pas d'endiguer ce phénomène et d'imposer un prix unique ?
Le système de santé réagirait-il différemment en cas de seconde vague ? La réponse est oui, sans le moindre doute.
Vous avez évoqué le triptyque tester-isoler-traiter : lors de la première vague, les moyens de tests étaient fortement limités. Depuis lors, les capacités de test se sont largement développées. J'ai animé hier une cellule de crise consacrée à la situation en Mayenne : le laboratoire de virologie de mon CHU, par exemple, pratique chaque jour entre 500 et 600 tests de dépistage, ce qui montre bien que nous avons maintenant les moyens de mettre en place une stratégie fondée sur un dépistage de masse.
Une remarque sur le dépistage de masse : il est difficile de convaincre tout le monde de se faire dépister, sachant que cette démarche relève de la liberté individuelle de chacun ; en particulier, les populations les plus déshéritées, les plus désocialisées, sont très réticentes.
Nous disposons en outre de beaucoup plus de masques qu'au moment de la première vague. Je suis d'accord pour dire que le discours du Gouvernement a beaucoup fluctué à cet égard, mais il fallait tenir compte de l'absence de masques.
S'agissant du système de santé lui-même et des hôpitaux, les stratégies d'augmentation de l'offre de soins, pour ce qui est des soins critiques en réanimation, mais aussi en unité conventionnelle, ont été éprouvées. Le vrai souci, en cas de seconde vague, sera de traiter conjointement tous les patients qui nécessitent des soins non liés à la covid. Cela passera par une collaboration optimisée entre le public et le privé. Je ne vois pas d'autre solution.
S'agissant de ce que vous avez appelé la chaîne de commandement, dans les Pays de la Loire, les hôpitaux supports de GHT ont joué leur rôle et coordonné l'offre de soins. En particulier, il nous a été demandé de nous coordonner avec les cliniques, ce qui a été fait, parce que nous nous entendons bien et qu'il fallait apporter une réponse globale sur le territoire.
Il me semble que la déclinaison doit se faire à l'échelon des territoires autour des hôpitaux supports de GHT, particulièrement du CHU, avec un accompagnement et une coordination de l'ARS.
Il a été question tout à l'heure de la réserve sanitaire. Pour notre part, nous ne l'avons pas mobilisée ; nous avons mis en place un système un peu équivalent consistant à mobiliser nos étudiants en médecine dans les services de réanimation ou dans les Ehpad.
En cas de seconde vague, je le répète, il faudra impérativement préserver l'offre de soins pour les autres patients. Le retard qui a été pris dans l'offre de soins chirurgicaux, par exemple, n'est pas encore comblé, l'activité n'étant pas encore revenue à la normale. Pour le combler, il faudra faire un peu plus encore.
Le système de santé réagirait-il différemment en cas de seconde vague ? La réponse est oui, sans le moindre doute.
Vous avez évoqué le triptyque tester-isoler-traiter : lors de la première vague, les moyens de tests étaient fortement limités. Depuis lors, les capacités de test se sont largement développées. J'ai animé hier une cellule de crise consacrée à la situation en Mayenne : le laboratoire de virologie de mon CHU, par exemple, pratique chaque jour entre 500 et 600 tests de dépistage, ce qui montre bien que nous avons maintenant les moyens de mettre en place une stratégie fondée sur un dépistage de masse.
Une remarque sur le dépistage de masse : il est difficile de convaincre tout le monde de se faire dépister, sachant que cette démarche relève de la liberté individuelle de chacun ; en particulier, les populations les plus déshéritées, les plus désocialisées, sont très réticentes.
Nous disposons en outre de beaucoup plus de masques qu'au moment de la première vague. Je suis d'accord pour dire que le discours du Gouvernement a beaucoup fluctué à cet égard, mais il fallait tenir compte de l'absence de masques.
S'agissant du système de santé lui-même et des hôpitaux, les stratégies d'augmentation de l'offre de soins, pour ce qui est des soins critiques en réanimation, mais aussi en unité conventionnelle, ont été éprouvées. Le vrai souci, en cas de seconde vague, sera de traiter conjointement tous les patients qui nécessitent des soins non liés à la covid. Cela passera par une collaboration optimisée entre le public et le privé. Je ne vois pas d'autre solution.
S'agissant de ce que vous avez appelé la chaîne de commandement, dans les Pays de la Loire, les hôpitaux supports de GHT ont joué leur rôle et coordonné l'offre de soins. En particulier, il nous a été demandé de nous coordonner avec les cliniques, ce qui a été fait, parce que nous nous entendons bien et qu'il fallait apporter une réponse globale sur le territoire.
Il me semble que la déclinaison doit se faire à l'échelon des territoires autour des hôpitaux supports de GHT, particulièrement du CHU, avec un accompagnement et une coordination de l'ARS.
Il a été question tout à l'heure de la réserve sanitaire. Pour notre part, nous ne l'avons pas mobilisée ; nous avons mis en place un système un peu équivalent consistant à mobiliser nos étudiants en médecine dans les services de réanimation ou dans les Ehpad.
En cas de seconde vague, je le répète, il faudra impérativement préserver l'offre de soins pour les autres patients. Le retard qui a été pris dans l'offre de soins chirurgicaux, par exemple, n'est pas encore comblé, l'activité n'étant pas encore revenue à la normale. Pour le combler, il faudra faire un peu plus encore.
Je partage les propos du professeur Mercat. Maintenant que le port du masque a été rendu obligatoire dans les lieux publics - ce qui est pour moi très important - et que nous avons la possibilité de pratiquer des tests, d'isoler les personnes contaminées et, éventuellement, de confiner de manière sélective, si nécessaire, l'intensité des pics épidémiques pourra être atténuée. Cela nous épargnera toutes les difficultés que nous avons rencontrées lors de la première vague, en particulier dans les régions les plus touchées. Nous avons donc l'espoir que les choses se passent plutôt bien.
Il reste tout de même une inquiétude relative aux services des urgences. En automne et en hiver, ils connaissent habituellement un surcroît d'activité, et il est à craindre qu'une seconde vague de covid n'entraîne des difficultés d'organisation : comment sera gérée la prise en charge de ces patients ? C'est pourquoi la collaboration entre les établissements au sein des territoires sera cruciale : la centralisation des patients covid continuera-t-elle d'être assurée par un établissement pivot ?
Différents outils sont à notre disposition. Je parlais tout à l'heure des réseaux territoriaux des urgences, qui, dans certains endroits, fonctionnent plutôt bien.
Je le répète, il faudra structurer davantage les collaborations entre le public et le privé à l'échelle d'un département, d'un territoire, et nous devrons être associés à l'ensemble des mesures prises.
Je partage les propos du professeur Mercat. Maintenant que le port du masque a été rendu obligatoire dans les lieux publics - ce qui est pour moi très important - et que nous avons la possibilité de pratiquer des tests, d'isoler les personnes contaminées et, éventuellement, de confiner de manière sélective, si nécessaire, l'intensité des pics épidémiques pourra être atténuée. Cela nous épargnera toutes les difficultés que nous avons rencontrées lors de la première vague, en particulier dans les régions les plus touchées. Nous avons donc l'espoir que les choses se passent plutôt bien.
Il reste tout de même une inquiétude relative aux services des urgences. En automne et en hiver, ils connaissent habituellement un surcroît d'activité, et il est à craindre qu'une seconde vague de covid n'entraîne des difficultés d'organisation : comment sera gérée la prise en charge de ces patients ? C'est pourquoi la collaboration entre les établissements au sein des territoires sera cruciale : la centralisation des patients covid continuera-t-elle d'être assurée par un établissement pivot ?
Différents outils sont à notre disposition. Je parlais tout à l'heure des réseaux territoriaux des urgences, qui, dans certains endroits, fonctionnent plutôt bien.
Je le répète, il faudra structurer davantage les collaborations entre le public et le privé à l'échelle d'un département, d'un territoire, et nous devrons être associés à l'ensemble des mesures prises.
La clinique d'Épernay est située à un kilomètre de l'hôpital, soit trois minutes en voiture, et ni l'une ni l'autre ne disposent de service de réanimation. Notre activité est essentiellement chirurgicale - elle s'est arrêtée le 16 mars -, tandis que l'hôpital compte un important pôle gériatrique.
Nous disposons de 107 lits, répartis entre 80 chambres. Nous avons transformé toutes nos chambres en chambres individuelles pour accueillir 55 patients covid, lesquels nécessitent forcément des soins plus lourds qu'en chirurgie.
Par ailleurs, nous disposions d'un stock de masques chirurgicaux et de blouses.
À ce problème de collaboration, qui est une évidence pour tout le monde, il faudra apporter une réponse territoriale. C'est une évidence. Tout le monde en parle : le Président de la République, le Premier ministre. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est quand on veut faire du GHT le référent territorial, car cela revient à faire de l'« hospitalocentrisme », c'est-à-dire à tout ramener à l'hôpital public. Dès lors que l'on définit un hôpital public de référence, et donc que l'on crée une forme de hiérarchie, comment voulez-vous que s'amorce une bonne collaboration ? Cela ne me semble pas très logique.
Face à un CHU, il existe toujours une grosse clinique. Si l'on ne parvient pas à établir une collaboration locale d'égal à égal, laquelle pourra se décliner ensuite à l'échelle des plus petits territoires, on n'avancera pas. En cas de nouvelle crise, il est à craindre qu'on ne retombe dans les mêmes travers. Et si nous sommes débordés, comme c'était le cas à Mulhouse, nous mettrons tout notre coeur à l'ouvrage, parce que c'est notre métier, mais j'ai bien peur que nous n'ayons du mal à traiter les urgences hors covid, comme c'est le cas depuis maintenant vingt ans.
La clinique d'Épernay est située à un kilomètre de l'hôpital, soit trois minutes en voiture, et ni l'une ni l'autre ne disposent de service de réanimation. Notre activité est essentiellement chirurgicale - elle s'est arrêtée le 16 mars -, tandis que l'hôpital compte un important pôle gériatrique.
Nous disposons de 107 lits, répartis entre 80 chambres. Nous avons transformé toutes nos chambres en chambres individuelles pour accueillir 55 patients covid, lesquels nécessitent forcément des soins plus lourds qu'en chirurgie.
Par ailleurs, nous disposions d'un stock de masques chirurgicaux et de blouses.
À ce problème de collaboration, qui est une évidence pour tout le monde, il faudra apporter une réponse territoriale. C'est une évidence. Tout le monde en parle : le Président de la République, le Premier ministre. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est quand on veut faire du GHT le référent territorial, car cela revient à faire de l'« hospitalocentrisme », c'est-à-dire à tout ramener à l'hôpital public. Dès lors que l'on définit un hôpital public de référence, et donc que l'on crée une forme de hiérarchie, comment voulez-vous que s'amorce une bonne collaboration ? Cela ne me semble pas très logique.
Face à un CHU, il existe toujours une grosse clinique. Si l'on ne parvient pas à établir une collaboration locale d'égal à égal, laquelle pourra se décliner ensuite à l'échelle des plus petits territoires, on n'avancera pas. En cas de nouvelle crise, il est à craindre qu'on ne retombe dans les mêmes travers. Et si nous sommes débordés, comme c'était le cas à Mulhouse, nous mettrons tout notre coeur à l'ouvrage, parce que c'est notre métier, mais j'ai bien peur que nous n'ayons du mal à traiter les urgences hors covid, comme c'est le cas depuis maintenant vingt ans.
Sommes-nous maintenant mieux armés ? En tout cas, nous avons tiré les enseignements de la première crise et appris qu'il fallait utiliser les réseaux existants. Une réponse trop centralisée n'a pas été un gage d'optimisation. Autrement dit, l'armada des 55 000 médecins généralistes a été sollicitée sans doute trop tardivement. En cas de seconde vague, on peut espérer que ce réseau de médecine ambulatoire sera d'emblée utilisé, d'autant que les praticiens sont désormais mieux équipés.
À ce propos, j'indique que, au moment de la crise, nous avons dû faire appel à la solidarité nationale et aux dons. Ainsi, diverses sociétés nous ont fournis en masques, mais la gestion s'est faite au jour le jour. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Il a été dit que, faute de traitement, il faudrait peut-être reconfiner. J'espère que l'on n'en arrivera jamais là. Dans l'optique d'une meilleure optimisation du réseau libéral, peut-être faut-il notamment envisager de développer des tests salivaires, qui permettent d'obtenir un résultat plus rapidement, même si l'on dit qu'ils ne sont pas fiables. Dans l'hypothèse d'une seconde vague de covid concomitante à d'autres épidémies, notamment celle de grippe, il serait important de pouvoir distinguer entre ces différentes pathologies, et cela passerait sans doute par la réalisation de tests rapides dans les cabinets des médecins de ville.
Sommes-nous maintenant mieux armés ? En tout cas, nous avons tiré les enseignements de la première crise et appris qu'il fallait utiliser les réseaux existants. Une réponse trop centralisée n'a pas été un gage d'optimisation. Autrement dit, l'armada des 55 000 médecins généralistes a été sollicitée sans doute trop tardivement. En cas de seconde vague, on peut espérer que ce réseau de médecine ambulatoire sera d'emblée utilisé, d'autant que les praticiens sont désormais mieux équipés.
À ce propos, j'indique que, au moment de la crise, nous avons dû faire appel à la solidarité nationale et aux dons. Ainsi, diverses sociétés nous ont fournis en masques, mais la gestion s'est faite au jour le jour. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Il a été dit que, faute de traitement, il faudrait peut-être reconfiner. J'espère que l'on n'en arrivera jamais là. Dans l'optique d'une meilleure optimisation du réseau libéral, peut-être faut-il notamment envisager de développer des tests salivaires, qui permettent d'obtenir un résultat plus rapidement, même si l'on dit qu'ils ne sont pas fiables. Dans l'hypothèse d'une seconde vague de covid concomitante à d'autres épidémies, notamment celle de grippe, il serait important de pouvoir distinguer entre ces différentes pathologies, et cela passerait sans doute par la réalisation de tests rapides dans les cabinets des médecins de ville.
Est-on prêt à faire face à une seconde vague ? Je ne vais pas reprendre tous les arguments qui ont déjà été avancés, mais, le cas échéant, la situation serait bien évidemment différente de celle que l'on a pu connaître au début du mois de mars. D'une part, nous disposons de moyens de protection et de tests, lesquels permettent d'identifier et d'isoler les patients infectés ; d'autre part, la population a désormais connaissance des gestes barrières.
Par ailleurs, nous avons beaucoup appris, et il sera plus simple de « remettre le pied à l'étrier ». Les tâtonnements dans la collaboration public-privé et sur le positionnement des médecins libéraux ne seraient plus d'actualité.
Les consignes sont-elles différentes ? Clairement, non. Nous connaissons mieux cette maladie, qui a donné lieu à de nombreuses publications, lesquelles nous permettent de mieux appréhender un certain nombre de sujets, y compris sur des points thérapeutiques de supports ventilatoires. Au début, nous privilégiions l'intubation, la sédation et la ventilation assistée en réanimation, alors qu'aujourd'hui un certain nombre de travaux montrent qu'observer une phase intermédiaire reposant sur l'usage de supports ventilatoires non invasifs aurait été possible sans risque d'aérosolisation. Toujours est-il qu'il n'existe pas de référentiel à ce jour.
De même, il n'existe aucune doctrine écrite relative à l'organisation de notre système de santé dans le cas d'une telle pandémie, comme il en existe une en matière de tueries de masse et d'attentats, ce qui nous a permis d'évoluer dans notre approche. Cela viendra ultérieurement. Les retours d'expérience sont en cours dans les services, mais cela prendra du temps, surtout en cette période estivale. Nous disposerons sans doute des conclusions de ces retours à l'automne, ce qui nous permettra d'être un peu plus performants dans notre organisation dans le cas d'une seconde vague.
D'après ce que j'ai pu entendre autour de cette table, le fait que l'on ait imposé une règle uniforme sur l'ensemble du territoire a été difficile à comprendre et cela a rendu son application par tous difficile. Si, demain, le plan Blanc devait être déclenché dans tous les établissements, ce serait difficilement accepté, contrairement à ce que l'on a observé au moment de la première vague.
Sommes-nous prêts ? Je n'en suis pas sûr. En tous cas, nous sommes mieux armés face à une possible seconde vague.
La question des transferts est complexe. Le SAMU que je dirige s'est doté d'une cellule de coordination des transferts, en lien avec les services départementaux de réanimation, dont le rôle était d'identifier les malades pouvant bénéficier d'un transfert, et ce afin de libérer des places pour de nouveaux patients. Avec les réanimateurs et les anesthésistes, nous avons, d'un commun accord, défini un certain nombre de critères de transférabilité. Les patients qui ont été transférés étaient ceux pour lesquels les risques de complications étaient minimes. C'est la raison pour laquelle on n'a enregistré aucun décès au cours de ces transferts, le taux de mortalité de ces patients restant comparable à celui observé dans les services de réanimation pour les patients non déplacés. Ces transferts, au nombre de 330 au total, ont été effectués par des équipes dont c'est le métier. Chaque jour, des patients qui devaient être transférés ne l'étaient finalement pas, car on estimait que leur état était trop instable et qu'ils ne répondaient plus aux critères requis.
Je ne suis pas certain qu'il existe des indicateurs pouvant attester d'un éventuel préjudice pour ces patients ou d'une hausse du taux de morbidité à la suite de ces transferts. J'espère que le travail d'étude en cours nous éclairera sur ce point.
Est-on prêt à faire face à une seconde vague ? Je ne vais pas reprendre tous les arguments qui ont déjà été avancés, mais, le cas échéant, la situation serait bien évidemment différente de celle que l'on a pu connaître au début du mois de mars. D'une part, nous disposons de moyens de protection et de tests, lesquels permettent d'identifier et d'isoler les patients infectés ; d'autre part, la population a désormais connaissance des gestes barrières.
Par ailleurs, nous avons beaucoup appris, et il sera plus simple de « remettre le pied à l'étrier ». Les tâtonnements dans la collaboration public-privé et sur le positionnement des médecins libéraux ne seraient plus d'actualité.
Les consignes sont-elles différentes ? Clairement, non. Nous connaissons mieux cette maladie, qui a donné lieu à de nombreuses publications, lesquelles nous permettent de mieux appréhender un certain nombre de sujets, y compris sur des points thérapeutiques de supports ventilatoires. Au début, nous privilégiions l'intubation, la sédation et la ventilation assistée en réanimation, alors qu'aujourd'hui un certain nombre de travaux montrent qu'observer une phase intermédiaire reposant sur l'usage de supports ventilatoires non invasifs aurait été possible sans risque d'aérosolisation. Toujours est-il qu'il n'existe pas de référentiel à ce jour.
De même, il n'existe aucune doctrine écrite relative à l'organisation de notre système de santé dans le cas d'une telle pandémie, comme il en existe une en matière de tueries de masse et d'attentats, ce qui nous a permis d'évoluer dans notre approche. Cela viendra ultérieurement. Les retours d'expérience sont en cours dans les services, mais cela prendra du temps, surtout en cette période estivale. Nous disposerons sans doute des conclusions de ces retours à l'automne, ce qui nous permettra d'être un peu plus performants dans notre organisation dans le cas d'une seconde vague.
D'après ce que j'ai pu entendre autour de cette table, le fait que l'on ait imposé une règle uniforme sur l'ensemble du territoire a été difficile à comprendre et cela a rendu son application par tous difficile. Si, demain, le plan Blanc devait être déclenché dans tous les établissements, ce serait difficilement accepté, contrairement à ce que l'on a observé au moment de la première vague.
Sommes-nous prêts ? Je n'en suis pas sûr. En tous cas, nous sommes mieux armés face à une possible seconde vague.
La question des transferts est complexe. Le SAMU que je dirige s'est doté d'une cellule de coordination des transferts, en lien avec les services départementaux de réanimation, dont le rôle était d'identifier les malades pouvant bénéficier d'un transfert, et ce afin de libérer des places pour de nouveaux patients. Avec les réanimateurs et les anesthésistes, nous avons, d'un commun accord, défini un certain nombre de critères de transférabilité. Les patients qui ont été transférés étaient ceux pour lesquels les risques de complications étaient minimes. C'est la raison pour laquelle on n'a enregistré aucun décès au cours de ces transferts, le taux de mortalité de ces patients restant comparable à celui observé dans les services de réanimation pour les patients non déplacés. Ces transferts, au nombre de 330 au total, ont été effectués par des équipes dont c'est le métier. Chaque jour, des patients qui devaient être transférés ne l'étaient finalement pas, car on estimait que leur état était trop instable et qu'ils ne répondaient plus aux critères requis.
Je ne suis pas certain qu'il existe des indicateurs pouvant attester d'un éventuel préjudice pour ces patients ou d'une hausse du taux de morbidité à la suite de ces transferts. J'espère que le travail d'étude en cours nous éclairera sur ce point.

J'ai deux questions.
Le professeur Mercat a indiqué que nous avions fait des progrès en matière de prise en charge des patients, progrès qui, si je comprends bien les propos tenus à l'instant par le docteur Noizet, n'ont pas encore été théorisés. Dès lors, comment seront-ils théorisés et généralisés à l'ensemble du territoire, pour que tout le monde puisse en tirer profit en cas de nouvelle crise ?
Professeur Mercat, vous dites que cette crise a été gérée, dans un premier temps, selon une logique de prise en charge par le seul système hospitalier. Or on s'est rendu compte que c'est l'ensemble du système de santé qui devait être mobilisé : je pense notamment aux médecins généralistes libéraux et aux infirmières libérales, qui étaient en première ligne pour prendre en charge les patients non hospitalisés dont on soupçonnait qu'ils pouvaient être atteints de la covid - à l'époque, les tests n'étaient pas disponibles. La difficulté, pour ces professionnels, était qu'ils ne disposaient que de peu d'équipements de protection individuels. Dans chaque territoire, nous étions contraints de recourir au système D pour nous en procurer.
Notre manière de gérer cette crise, en nous appuyant prioritairement sur l'hôpital, s'explique-t-elle par le fait que notre système de santé est plutôt « hospitalocentré » ou bien par un manque d'équipements de protection individuels, qui ne nous aurait pas permis d'intégrer dans la prise en charge les professionnels libéraux ? Autrement dit, la carence en équipements de protection individuels a-t-elle influencé notre doctrine de gestion de la crise ?

J'ai deux questions.
Le professeur Mercat a indiqué que nous avions fait des progrès en matière de prise en charge des patients, progrès qui, si je comprends bien les propos tenus à l'instant par le docteur Noizet, n'ont pas encore été théorisés. Dès lors, comment seront-ils théorisés et généralisés à l'ensemble du territoire, pour que tout le monde puisse en tirer profit en cas de nouvelle crise ?
Professeur Mercat, vous dites que cette crise a été gérée, dans un premier temps, selon une logique de prise en charge par le seul système hospitalier. Or on s'est rendu compte que c'est l'ensemble du système de santé qui devait être mobilisé : je pense notamment aux médecins généralistes libéraux et aux infirmières libérales, qui étaient en première ligne pour prendre en charge les patients non hospitalisés dont on soupçonnait qu'ils pouvaient être atteints de la covid - à l'époque, les tests n'étaient pas disponibles. La difficulté, pour ces professionnels, était qu'ils ne disposaient que de peu d'équipements de protection individuels. Dans chaque territoire, nous étions contraints de recourir au système D pour nous en procurer.
Notre manière de gérer cette crise, en nous appuyant prioritairement sur l'hôpital, s'explique-t-elle par le fait que notre système de santé est plutôt « hospitalocentré » ou bien par un manque d'équipements de protection individuels, qui ne nous aurait pas permis d'intégrer dans la prise en charge les professionnels libéraux ? Autrement dit, la carence en équipements de protection individuels a-t-elle influencé notre doctrine de gestion de la crise ?

À vous écouter, dans certains territoires, le dialogue entre les différents professionnels de santé a été difficile, tandis que, dans d'autres, les choses se sont beaucoup mieux passées. Dès lors que la gravité de la situation l'imposait, les professionnels de santé, qu'ils exercent en hôpital public, en hôpital privé ou en cabinet de ville se sont parlé, ont mis en place des protocoles, se sont mobilisés, affranchis de toute contrainte budgétaire et, pour certains, de toute rigidité administrative. Très vite, ils ont apporté des réponses pour faire face à la situation.
Ce qui m'étonne, c'est qu'il ait fallu attendre que les malades affluent dans les services et que ceux-ci soient engorgés pour que ces réponses soient mises en place, alors que, depuis plusieurs semaines, nous avions l'exemple de l'Italie, pays frontalier tout à fait comparable au nôtre, où les événements ont pris un tour dramatique. Partagez-vous mon sentiment ? C'est en tout cas ce que l'on peut en conclure d'après les faits tels qu'ils ont été relatés par les médias. Mais peut-être votre approche est-elle différente.
En outre, comment expliquez-vous cette espèce d'aboulie, cette incapacité à réagir préventivement face à la catastrophe annoncée ?

À vous écouter, dans certains territoires, le dialogue entre les différents professionnels de santé a été difficile, tandis que, dans d'autres, les choses se sont beaucoup mieux passées. Dès lors que la gravité de la situation l'imposait, les professionnels de santé, qu'ils exercent en hôpital public, en hôpital privé ou en cabinet de ville se sont parlé, ont mis en place des protocoles, se sont mobilisés, affranchis de toute contrainte budgétaire et, pour certains, de toute rigidité administrative. Très vite, ils ont apporté des réponses pour faire face à la situation.
Ce qui m'étonne, c'est qu'il ait fallu attendre que les malades affluent dans les services et que ceux-ci soient engorgés pour que ces réponses soient mises en place, alors que, depuis plusieurs semaines, nous avions l'exemple de l'Italie, pays frontalier tout à fait comparable au nôtre, où les événements ont pris un tour dramatique. Partagez-vous mon sentiment ? C'est en tout cas ce que l'on peut en conclure d'après les faits tels qu'ils ont été relatés par les médias. Mais peut-être votre approche est-elle différente.
En outre, comment expliquez-vous cette espèce d'aboulie, cette incapacité à réagir préventivement face à la catastrophe annoncée ?
Cette crise de la covid a donné lieu à une communication extrêmement large, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais également dans les revues scientifiques - vous avez eu connaissance des différentes controverses -, au sein des sociétés savantes. La diffusion des informations concernant les bonnes pratiques en matière de soins ne constitue pas un problème. Celles-ci doivent donner lieu à la rédaction de procédures standardisées qui seront déclinées par territoire, par établissement. Ces procédures présentent un intérêt particulier notamment quand il faut mobiliser des médecins ou des infirmières qui ont peu l'habitude de ces situations et de ces patients.
Dans les Pays de la Loire, dès le début de la crise, nous avons mis en place une hotline ouverte vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Tous les réanimateurs, notamment les anesthésistes réanimateurs affectés à un établissement où ils étaient venus rendre service, pouvaient poser des questions à un expert.
Les progrès en matière de soins sont très modestes. Tout au plus sait-on qu'il est possible d'administrer des corticostéroïdes aux patients sous ventilation.
Vous évoquiez le caractère « hospitalocentré » de la réponse initiale et l'incidence qu'aurait pu avoir l'absence d'équipements de protection individuels. Pendant quelques semaines, nous avons eu tendance à ne considérer que les patients les plus gravement atteints, qui nécessitaient d'être placés en réanimation, en oubliant quelque peu les patients moins gravement touchés, pour lesquels il aurait fallu prendre des mesures afin d'éviter toute contagion. Cependant, faute, à l'époque, de moyens de prélèvement massifs, c'était extrêmement compliqué.
Les infirmières libérales, par exemple, ont joué un rôle extrêmement important, notamment en milieu rural, pendant la période de confinement, pour assurer une présence auprès des personnes isolées. Elles ont d'ailleurs signalé, tous comme les personnes livrant des repas à domicile ou les travailleurs sociaux, de nombreux cas de patients présentant des symptômes.
Concernant l'Italie, nous avons surtout été frappés par le fait que les hôpitaux ont été débordés. En Lombardie, on comptait 7,5 lits de réanimation pour 100 000 habitants -chiffre identique à celui de la France -, mais 20 pendant la crise, avec quelquefois des créations ex nihilo dans des conditions compliquées. Si vous relisez les articles de presse publiés au tout début de la crise, peu d'entre eux étaient consacrés au système de santé italien ou aux mesures d'isolement, qui ont été prises très tardivement dans ce pays. Et ce n'est qu'avec l'apparition des premiers cas dans le Grand-Est que l'on a réalisé que se reproduisait la situation italienne.
Effectivement, au départ, cette crise a représenté un défi pour le système hospitalier et on a perdu un peu de temps. Nous disposons désormais d'autres moyens, mais nous sommes également soumis à d'autres contraintes. J'y insiste : en cas de seconde vague, il faudra veiller à soigner correctement les patients non covid. Certains malades dont l'opération a été déprogrammée en février n'ont pas encore été opérés.
En cas de seconde vague, je suis convaincu que la réponse serait assez significativement différente.
Cette crise de la covid a donné lieu à une communication extrêmement large, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais également dans les revues scientifiques - vous avez eu connaissance des différentes controverses -, au sein des sociétés savantes. La diffusion des informations concernant les bonnes pratiques en matière de soins ne constitue pas un problème. Celles-ci doivent donner lieu à la rédaction de procédures standardisées qui seront déclinées par territoire, par établissement. Ces procédures présentent un intérêt particulier notamment quand il faut mobiliser des médecins ou des infirmières qui ont peu l'habitude de ces situations et de ces patients.
Dans les Pays de la Loire, dès le début de la crise, nous avons mis en place une hotline ouverte vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Tous les réanimateurs, notamment les anesthésistes réanimateurs affectés à un établissement où ils étaient venus rendre service, pouvaient poser des questions à un expert.
Les progrès en matière de soins sont très modestes. Tout au plus sait-on qu'il est possible d'administrer des corticostéroïdes aux patients sous ventilation.
Vous évoquiez le caractère « hospitalocentré » de la réponse initiale et l'incidence qu'aurait pu avoir l'absence d'équipements de protection individuels. Pendant quelques semaines, nous avons eu tendance à ne considérer que les patients les plus gravement atteints, qui nécessitaient d'être placés en réanimation, en oubliant quelque peu les patients moins gravement touchés, pour lesquels il aurait fallu prendre des mesures afin d'éviter toute contagion. Cependant, faute, à l'époque, de moyens de prélèvement massifs, c'était extrêmement compliqué.
Les infirmières libérales, par exemple, ont joué un rôle extrêmement important, notamment en milieu rural, pendant la période de confinement, pour assurer une présence auprès des personnes isolées. Elles ont d'ailleurs signalé, tous comme les personnes livrant des repas à domicile ou les travailleurs sociaux, de nombreux cas de patients présentant des symptômes.
Concernant l'Italie, nous avons surtout été frappés par le fait que les hôpitaux ont été débordés. En Lombardie, on comptait 7,5 lits de réanimation pour 100 000 habitants -chiffre identique à celui de la France -, mais 20 pendant la crise, avec quelquefois des créations ex nihilo dans des conditions compliquées. Si vous relisez les articles de presse publiés au tout début de la crise, peu d'entre eux étaient consacrés au système de santé italien ou aux mesures d'isolement, qui ont été prises très tardivement dans ce pays. Et ce n'est qu'avec l'apparition des premiers cas dans le Grand-Est que l'on a réalisé que se reproduisait la situation italienne.
Effectivement, au départ, cette crise a représenté un défi pour le système hospitalier et on a perdu un peu de temps. Nous disposons désormais d'autres moyens, mais nous sommes également soumis à d'autres contraintes. J'y insiste : en cas de seconde vague, il faudra veiller à soigner correctement les patients non covid. Certains malades dont l'opération a été déprogrammée en février n'ont pas encore été opérés.
En cas de seconde vague, je suis convaincu que la réponse serait assez significativement différente.
Comme je l'ai dit, dans mon établissement exercent deux anesthésistes italiens, qui nous avaient alertés sur la situation dans leur pays. Auparavant, nous avions eu l'expérience chinoise.
Pour autant, le 3 mars, lors de la réunion de ma communauté professionnelle territoriale de santé, personne ne portait de masque ! Un cas de covid a été signalé quelques semaines plus tard. Oui, je n'ai pas été vigilant du tout. Heureusement, on a pu dresser la liste de tous les participants à cette réunion.
Je vous rappelle quand même que, à Paris, depuis vingt ou trente ans, tous les Chinois portent un masque, contrairement aux « Gaulois ». On est en train de découvrir les choses.
Comme je l'ai dit, dans mon établissement exercent deux anesthésistes italiens, qui nous avaient alertés sur la situation dans leur pays. Auparavant, nous avions eu l'expérience chinoise.
Pour autant, le 3 mars, lors de la réunion de ma communauté professionnelle territoriale de santé, personne ne portait de masque ! Un cas de covid a été signalé quelques semaines plus tard. Oui, je n'ai pas été vigilant du tout. Heureusement, on a pu dresser la liste de tous les participants à cette réunion.
Je vous rappelle quand même que, à Paris, depuis vingt ou trente ans, tous les Chinois portent un masque, contrairement aux « Gaulois ». On est en train de découvrir les choses.
Oui, la gestion a été « hospitalocentrée » dans la mesure où cette maladie ne présente pas de signes de gravité dans 95 % à 98 % des cas.
Oui, la gestion a été « hospitalocentrée » dans la mesure où cette maladie ne présente pas de signes de gravité dans 95 % à 98 % des cas.

Je vous remercie, messieurs, de ces propos fort instructifs. Bon courage pour la suite, parce qu'il y en aura obligatoirement une. Mais pas nécessairement une seconde vague.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
La réunion est close à 17 heures.

Je vous remercie, messieurs, de ces propos fort instructifs. Bon courage pour la suite, parce qu'il y en aura obligatoirement une. Mais pas nécessairement une seconde vague.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
La réunion est close à 17 heures.