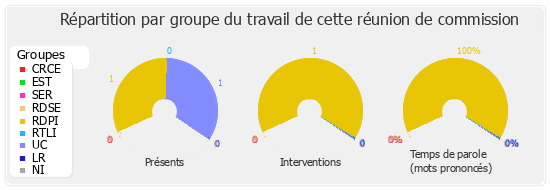Mission d'information Fonds marins
Réunion du 19 avril 2022 à 17h00
Sommaire
La réunion

M. le rapporteur, Teva Rohfritsch, qui se trouve actuellement en Polynésie, participe à cette audition en visioconférence, de même que nos collègues Muriel Jourda et Micheline Jacques.
Je remercie MM. Marc Boissé, président, et Laurent Beguery, responsable du département Services en mer d'Alseamar, de participer à notre mission, qui a démarré ses travaux en janvier dernier et qui les poursuivra jusqu'à l'été prochain. Le sujet qui nous occupe est au coeur de l'actualité et revêt une grande importance. Messieurs, nous sommes très heureux de vous entendre afin que vous nous présentiez la société Alseamar.
Merci de nous recevoir, en notre qualité de représentants d'Alseamar, pour évoquer cette belle aventure qu'est la maîtrise des grands fonds marins. Notre société, filiale du groupe de technologies innovantes Alcen, emploie une centaine de personnes. Nous intervenons dans le domaine de la mer, en surface et jusqu'à 11 000 mètres de profondeur. Nos cinq activités sont toutes orientées vers le domaine marin. La fabrication de matériaux de flottabilité pour l'industrie pétrolière off shore, la conception et la réalisation de systèmes antennaires de radiocommunication pour sous-marins militaires, ainsi que le développement de la robotique sous-marine, sont nos trois activités de produit. Nous effectuons également deux activités de service : le maintien en condition opérationnelle d'engins sous-marins pour la Marine nationale et le service rendu par nos drones sous-marins à nos clients, français et, surtout, étrangers.
Le monde sous-marin est notre domaine et notre activité quotidienne depuis plus de quinze ans. Ses contraintes étant très particulières, elles guident la conception et la réalisation de nos engins - nous les réalisons nous-mêmes -, ainsi que le service effectué. Nous sommes connectés avec le marché de la défense navale - je suis un ancien officier de marine -, le marché des sciences - Laurent Beguery est issu du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) - et celui du pétrole off shore. Nous travaillons de façon très étroite avec la Direction générale de l'armement (DGA), notamment sur le planeur sous-marin, avec des laboratoires scientifiques, tels que le Laboratoire d'océanographie de Villefranche (LOV), l'Institut méditerranéen d'océanographie - The Mediterranean Institute of Oceanography (MIO) -, l'Institut de géophysique de Paris, l'École nationale supérieure de techniques avancées (Ensta), etc. Nous sommes très présents, en dépit de notre petite taille, sur les marchés internationaux, vers lesquels nous exportons près de la moitié de notre chiffre d'affaires. S'agissant du planeur, nous avons notamment réalisé des contrats en Colombie avec Ecopetrol, en mer des Caraïbes, en Angola, en Norvège, aux États-Unis et dans le golfe du Mexique.
Je souhaiterais vous exposer brièvement la place de nos robots autonomes sous-marins - Autonomous Underwater Vehicle (AUV) -, de nos robots téléopérés - Remotely Operated Underwater Vehicle (ROV) - et de nos planeurs sous-marins. Les deux premiers sont assez connus, mais encore peu conçus en France. Deux fabricants de planeurs se trouvent aux États-Unis et un troisième chez nous.
Les ROV sont en permanence reliés par un câble à un bâtiment à la surface. Leur zone d'intervention est de ce fait très limitée. Ils sont néanmoins intéressants pour leur forte puissance et leurs possibilités d'inspection.
Les AUV sont propulsés de manière classique par une hélice. Ils sont également reliés en permanence, de façon acoustique, à un bâtiment de surface. Ils patrouillent sur le fond des océans et effectuent des missions importantes en matière de défense, notamment de « guerre des mines ». Leur zone d'intervention est aussi limitée en raison d'une endurance réduite, de vingt-quatre à soixante-douze heures, c'est-à-dire de deux à trois jours.
Les planeurs ont une véritable vocation océanographique : ils n'ont pas besoin de navire de surface et sont totalement autonomes. Ils sont faits pour les grands espaces et travaillent essentiellement dans la colonne d'eau entre la surface et les 1 000 mètres de profondeur maximale. Le planeur peut naviguer en dents de scie, éventuellement horizontalement, et il échange ses données avec le pilote à terre, qui est l'un des ingénieurs de la société. Il indique sa position géographique, l'état de son fonctionnement interne et les données qu'il a collectées en mer. Un tel engin peut parcourir 2 000 kilomètres en 110 jours de façon tout à fait autonome.

Cette capacité d'autonomie énergétique lui permet-elle de traverser 2 000 kilomètres sans être alimenté ?

Le planeur que vous avez inventé descend à 1 000 mètres. Les Américains ont-ils mis au point une technologie différente ?
Les planeurs américains commercialisés descendent comme nous à 1 000 mètres. À cet égard, nous avons développé deux prototypes : l'un est capable de descendre à 3 000 mètres, l'autre à 6 000 mètres. S'agissant de la technologie nécessaire à mettre en place pour parvenir à ces profondeurs, nous n'avons donc aucune crainte.
Ces engins sont très autonomes durant les 110 jours de mer. Ils se rechargent ensuite durant vingt-quatre heures avant d'être remis à l'eau. Cela est possible en raison de la parfaite maîtrise de toute la partie mécanique, électronique et informatique embarquée. De plus, notre savoir-faire unique nous incite à économiser le moindre milliwatt d'énergie.
Les planeurs ont été inventés dans les années 1990, mais c'est vers 2005 que l'on a commencé à les utiliser en Europe et en Amérique, principalement pour l'océanographie physique : à ce titre, l'exemple emblématique, c'est le planeur chargé d'allers-retours réguliers entre la Corse et la métropole pour mesurer la température et la conductivité de l'eau. Il offre une vue en coupe de la mer, permettant de distinguer les différentes masses d'eau toute l'année durant.
Très rapidement, de nouveaux capteurs ont été mis au point, notamment afin de mesurer la biologie de l'océan pour l'ensemble de la chaîne trophique. Ainsi, des capteurs de fluorescence permettent de voir le phytoplancton ; une caméra, développée à Villefranche-sur-Mer, permet de voir le zooplancton ; et l'ADN environnemental, champ d'études en plein développement auquel nous contribuons via divers partenariats, offre un inventaire exhaustif des populations animales et végétales présentes dans l'eau.
En parallèle, nous consacrons d'importants travaux à l'acoustique sous-marine. Outre les baleines et les dauphins, le benthos tout entier fait du bruit, qu'il s'agisse des crevettes, des coquilles Saint-Jacques ou encore des oursins. L'acoustique sous-marine est produite en grande partie par les mollusques ; de plus, beaucoup de poissons font du bruit en Méditerranée, principalement le corb et le mérou, qui sont deux espèces protégées.
Nous participons au programme européen Life, destiné à surveiller, dans le pélagos, les populations de rorquals communs, que l'on peut entendre à vingt-cinq kilomètres de distance environ - leur présence est donc assez facile à détecter -, et de cachalots. Les planeurs permettent de déterminer très précisément où les animaux se trouvent.
Les gliders permettent également de mesurer les impacts environnementaux. Les différents sons que les humains produisent dans l'océan - circulation des bateaux, battage des pieux, etc. - ont des effets sur l'environnement. En s'éloignant et en se rapprochant, on peut déterminer la portée à partir de laquelle ces sons deviennent une nuisance pour les animaux marins.
Nous étudions aussi les rejets de panaches. Ainsi, nous avons consacré une étude à l'usine d'aluminium Alteo, à Gardanne, dont les rejets aboutissent au canyon de Cassidaigne, dans le parc marin des Calanques. Avant 2016, il s'agissait de ce que l'on appelait les boues rouges ; désormais, ce sont des eaux de production industrielle basique. Au titre des eaux usées, nous avons également réalisé des études pour les communes d'Antibes et de Vallauris, afin de mieux connaître la dispersion de leurs eaux usées en mer.
Le sol et le sous-sol constituent un dernier objet d'étude, et non des moindres. Les capteurs associés permettent de mesurer très précisément ce qui se passe au fond de la mer : pour le compte de l'Institut de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer), nous menons une enquête sur le volcan apparu à Mayotte en 2018. Ce phénomène a entraîné l'apport de 6 kilomètres cubes de matière et un important dégazage de méthane et de CO2 sur le site dit « du fer à cheval ». Les mesures quotidiennes effectuées à ce titre durent depuis maintenant sept mois.
En résumé, notre véhicule, équipé de capteurs, est mis au service d'une stratégie d'échantillonnage destinée à l'étude des milieux. Il permet ainsi de répondre à diverses questions relevant pour l'essentiel de l'océanographie physique, de la biologie, des impacts environnementaux et des ressources minérales profondes.

D'autres opérateurs sont-ils chargés de l'exploitation de vos gliders ?
Non seulement nous vendons des planeurs, par exemple à des instituts de recherche, mais nous les exploitons : Alseamar dispose d'un certain nombre de chercheurs qui analysent les données collectées.
Notre stratégie varie en fonction des marchés. Souvent, le monde scientifique préfère traiter les données lui-même, ce qui n'est pas le cas du monde du pétrole, qui veut une donnée interprétée. Le monde de la défense, lui, se situe à mi-chemin.
Vous l'avez compris, ce planeur est un véhicule un peu particulier : il ne s'agit ni d'un robot autonome sous-marin (AUV) ni d'un véhicule sous-marin téléopéré (ROV). Ses capacités sont extraordinairement larges : il intervient aussi bien près des côtes que très loin en mer, car il dispose d'une grande autonomie. Les grands fonds marins font évidemment partie du spectre de ses applications.

Comment votre entreprise s'inscrit-elle dans la stratégie nationale définie ? Avez-vous participé à son élaboration et qu'en pensez-vous à ce stade ?
Nous avons été auditionnés à la fin de l'année dernière par le Secrétariat général de la mer (SGMer), que nous remercions encore de son écoute. Pour l'heure, notre implication s'arrête là.
J'insiste sur le fait qu'il s'agit selon nous d'une excellente initiative, car les grands fonds marins restent inconnus à ce jour. Nous n'avons pas de difficulté technique pour faire descendre nos engins à de telles profondeurs : reste à trouver les financements.

Avez-vous été associés au projet de démonstrateur, destiné à l'exploitation ?
Non, mais nous pourrions l'être, notamment pour mesurer l'impact de ce démonstrateur sur l'environnement marin dans son ensemble.

Avez-vous bénéficié de soutiens financiers pour le développement de vos différents prototypes ?
Les prototypes permettant de descendre à 3 000 et à 6 000 mètres ont été financés via le projet européen Bridges (Bringing together research and industry for the development of glider environmental services), qui regroupe dix-huit partenaires.
À présent, il faut passer du prototype, relevant de la recherche et développement, au véhicule de série. Or l'on ne peut pas engager de tels projets sans une vision de long terme. Cette étape, décisive, c'est celle de l'industrialisation.
En tout, notre société compte 100 personnes : nous relevons donc de facto des petites et moyennes entreprises (PME). Mais, en France comme à l'échelle de l'Union européenne, nous sommes considérés comme une entreprise de taille intermédiaire (ETI), au motif que nous faisons partie d'un groupe. Dès lors, nous ne pouvons pas bénéficier de financements à cet égard.
Après avoir dépensé 3 millions d'euros au titre de la recherche et développement, nous devrions donc mobiliser 3 millions d'euros supplémentaires pour franchir le seuil conduisant au marché, ce qui est beaucoup plus difficile. Nous recherchons désespérément des financements pour ces deux prototypes, achevés en 2019.
Bref, la question est moins technique que financière. L'opérateur financier qui nous accompagne doit disposer, à tout le moins, d'une vision à cinq ans.

Je suppose que vous nous confirmez le bon fonctionnement des prototypes ?
Tout à fait ; mais, par définition, un prototype n'est pas nécessairement reproductible. À cet égard, l'étape de l'industrialisation est fondamentale : on ne peut pas tout faire à la fois.

Vous nous dites, en quelque sorte, que c'est bien le passage du prototype au modèle industriel qui requiert des financements, car une fois cette phase atteinte, il ne fait guère de doute que l'intérêt pour la connaissance des grands fonds marins garantisse des débouchés ?
Vous posez ici la question du marché, une fois que l'outil sera mis à disposition des acteurs.
Actuellement, le monde du pétrole off shore ne descend pas à plus de 3 000 mètres, la défense non plus, et seule la science, en réalité, s'intéresse à ce qui se passe plus profond, mais cela ne crée pas un marché suffisant pour mobiliser les financements nécessaires au développement des outils. Reste le marché de l'exploitation minière des grands fonds, qui n'existe pas encore. Il y aura alors, dans le futur, de grands acteurs disposant des moyens de financer les outils. Nous n'en sommes pas là : le marché n'est encore qu'une potentialité et l'outil n'en est qu'à l'étape du prototype.

La ministre de la défense a dit son ambition de doter la Marine nationale d'outils pour la surveillance en particulier des liaisons intercontinentales. Elle a précisé que des décisions interviendraient dès cette année : en avez-vous été saisi ? Avez-vous des contacts, voire des commandes en la matière ?
Nous entretenons des contacts très réguliers avec le ministère de la défense, en particulier avec la Direction générale de l'armement (DGA), mais nous n'avons pas reçu de commande publique à ce stade.

L'articulation entre les volets militaire et civil vous paraît-elle possible et cohérente ?
Certainement. Les véhicules auront une technologie commune, mais des applications différentes.

L'effort réalisé pour la défense aura donc une utilité pour le domaine civil ?
J'en suis convaincu. En réalité, le porteur sera identique pour les applications civiles et militaires. C'est l'équipement embarqué qui différera.

Un problème technique nous empêche temporairement d'entendre nos collègues connectés en visioconférence. Notre rapporteur m'a transmis une question sur le positionnement des entreprises françaises dans la concurrence internationale : le Canada et le Japon auraient des entreprises plus importantes et une stratégie plus agressive dans le domaine ; est-ce à dire que, faute en particulier d'un champion national, nous prendrions du retard ?
Je partage cette idée que nous manquons d'un opérateur plus puissant, qui aurait un effet d'entraînement sur les autres entreprises françaises du secteur. De tels champions existent effectivement au Japon, au Canada, mais aussi en Norvège : il est dommage que nous n'en ayons pas en France, même si nous sommes habitués à travailler dans cet environnement.

Le Groupement des industries de construction et activités navales (Gican) vous paraît-il l'outil adéquat pour avancer dans cette direction ? Selon vous, quel type d'opérateur français pourrait-il prendre cette place de locomotive nationale pour le secteur ?
Le Gican est très important, mais il ne saurait jouer le rôle d'opérateur à proprement parler. L'opérateur susceptible de jouer le rôle de locomotive pourrait être par exemple, mais sans exclusive, un groupe pétrolier, parce qu'on y a l'habitude de travailler dans les profondeurs marines, à 1 000 ou 2 000 mètres de fond.

Le réseau des entreprises, tel qu'il existe en France, vous paraît-il une bonne base à développer ? Ou bien faut-il d'emblée placer notre ambition à l'échelle d'une coopération européenne ?
Je crois que nous n'avons pas de retard technique ; nous sommes prêts à explorer les grands fonds marins, mais nous manquons de financements pour développer les outils. Il serait utile qu'un grand groupe s'empare de cette mission, car il nous entraînerait dans son sillage. Ensuite, il me semble tout à fait nécessaire de travailler en coopération, et je crois que les entreprises françaises sont complémentaires plutôt que concurrentes. Nous pourrions tout à fait nous répartir les différentes missions susceptibles d'être définies, entre la surveillance des fonds, la cartographie, l'exploration, l'exploitation et l'évaluation des conséquences de l'exploitation des fonds marins : il y a de la place pour les différentes entreprises françaises qui peuvent se répartir les tâches.
Pour cartographier la zone économique exclusive, les techniques sont complémentaires entre les gliders, qui peuvent prendre des échantillons par exemple tous les vingt kilomètres, et nos véhicules, qui iraient ensuite dans les zones identifiées comme plus intéressantes, pour préciser la composition des sols. En réalité, nous sommes très complémentaires.

Diriez-vous que les interlocuteurs d'une stratégie nationale sont bien identifiés ?
Oui, nous nous connaissons tous et nous travaillons régulièrement avec les organismes que vous avez déjà auditionnés.

Vous évoquez les besoins financiers pour l'industrialisation : les 300 millions d'euros fléchés sur les grands fonds marins par le Plan France 2030 vous paraissent-ils suffisants ?
C'est difficile à dire, au-delà du fait que ce fléchage est une bonne nouvelle...

Vous n'en avez pas été saisis, pas plus que vous n'avez eu de commande publique en la matière.

Quels vous semblent être les progrès techniques nécessaires pour aller plus loin dans l'exploitation des fonds marins ? Sommes-nous, en France, bien placés pour réaliser ces progrès ?
Je crois que nous sommes prêts techniquement, mais qu'il nous manque des financements pour l'action elle-même.
Nous avons été contactés par l'Ifremer, qui souhaitait disposer d'une mesure plus continue, sans être tributaire des campagnes annuelles ou semestrielles. Nous avons donc discuté avec Jean-Marc Daniel des mesures à réaliser, qui sont particulières puisqu'elles concernent deux gaz dissous dans l'eau, le dioxyde de carbone et le méthane.
La méthode employée est assez récente, avec des capteurs difficiles à trouver, mais que nous connaissons bien, puisque nous les employons depuis plusieurs années, qu'il s'agisse de chercher du pétrole pour nos clients industriels ou d'étudier le stockage du carbone. Il faut aussi un capteur de courant, non pas pour mesurer les courants, mais pour étudier les panaches - encore un savoir-faire unique d'Alseamar. Bref, nous nous sommes vite entendus sur notre aptitude à réaliser cette surveillance. Un premier contrat a été conclu pour trois mois, et un second court jusqu'à la fin juillet. Nous aurons alors des données sur dix mois, et la prochaine campagne de surveillance par bateau commencera.
Ce financement sera-t-il pérennisé ? J'ignore auprès de quel ministère l'Ifremer trouve les fonds nécessaires. Faute de visibilité, nous ne pouvons pas vraiment nous investir pleinement à Mayotte. Nous y avons un petit local, et nous y avons recruté une personne qui s'occupe des gliders pendant la mission. Si nous avions une vision de long terme, nous pourrions par exemple travailler avec le parc naturel marin de Mayotte, ou conclure d'autres partenariats sur place.
La seconde mission consiste en la surveillance profonde - jusqu'à 3 500 mètres -du volcan de Mayotte. Les paramètres n'en sont pas encore connus, mais on peut imaginer qu'ils seront les mêmes que ceux qu'on utilise aujourd'hui, avec sans doute aussi la mesure du pH. Là encore, nous allons collecter des données, puis recommencer après deux ou trois ans : quid dans l'intervalle ?

Le Comité interministériel de la mer (CIMer) a fixé comme priorité d'accroître ces observations ; cela peut vous ouvrir des perspectives. Allez-vous, dès lors, envisager une implantation outre-mer ?
Une entreprise qui aurait une vision à moyen terme serait à même de répondre à cette question...
La réponse est oui, évidemment. Cela fait partie de nos plans. En effet, les engins que nous utilisons dans plusieurs pays du monde partent tous de France. Ce trajet pourrait être évité si nous disposions de plusieurs emplacements où les stationner en permanence.

La technique et la prospective sont liées. L'avenir n'est-il pas dans une convergence des technologies utilisées dans les planeurs et dans les AUV ? On peut imaginer des engins planant et disposant d'une hélice. Votre entreprise se positionne-t-elle sur les marchés européens et internationaux ?
Vous évoquez la convergence technologique. Ce qui nous semble important, c'est de clarifier les outils utilisés : un AUV et un glider sont deux engins différents. Le projet Bridges a permis la conception d'un engin allant à 6 000 mètres de profondeur, qui dispose d'une petite hélice : quand on descend si profond, ce n'est pas forcément pour remonter tout de suite ! Peut-on dire pour autant que cela transforme l'engin en AUV ? Pas vraiment. L'idée est de réaliser un échantillonnage discret, en prélevant une partie représentative des fonds marins, ce qui est bien le domaine d'action d'un glider.
Dans le cadre de France 2030, les AUV et les gliders se verront dotés des mêmes capteurs. Un glider pourra alors partir muni de sondeurs latéraux, pour avoir une image des fonds, et faire quelques acquisitions, alors que d'autres véhicules, dotés de la même technologie, auront des sondeurs plus gros, qui peuvent voir plus loin, avec l'idée de cartographier 50 ou 100 kilomètres carrés, ce qui n'est plus le domaine d'action d'un glider.
Alseamar est une entreprise internationale : nous travaillons avec des sociétés américaines, par exemple en Colombie avec Ecopetrol, ou dans les Caraïbes, ou encore à Chypre. Nos engins ne pèsent que 60 kilogrammes - ils tiennent sur la table -, et il est facile de les transporter ; nous travaillons donc dans le monde entier. Nous répondons à des appels d'offres européens.
Nous l'avons fait dernièrement pour mesurer l'impact d'un travail minier sous-marin. L'idée, alors, n'est pas de faire un démonstrateur en minant réellement, mais de simuler le minage et de mesurer un panache de turbidité et une déflexion d'oxygène. Au fond de la mer, ces panaches peuvent s'étendre sur plusieurs centaines de kilomètres. Il faut un véhicule très endurant pour parcourir tout le panache et mesurer l'impact qu'aurait une activité minière sous-marine.
Nos activités sont donc résolument mondiales. Le marché français ne suffirait pas à amortir le coût de nos innovations.

Nos deux Pôles mer permettent-ils de faire progresser la mise en réseau et la collaboration entre les entreprises, notamment au plan technologique ?
Nous faisons partie du Pôle mer Méditerranée, puisque nous sommes implantés entre Toulon et Aix-en-Provence. Ce sont des espaces très intéressants pour se retrouver et discuter sur des thèmes communs - par exemple, comment déposer un projet européen ? Les deux Pôles mer organisent des déplacements et des missions de découverte à l'étranger, qui sont autant d'occasions de coopérer et de mieux se connaître.

Merci à tous. Je me réjouis que notre pays compte ainsi des entreprises de très haute technologie, qui permettent de faire avancer les ambitions collectives. Nous espérons que vous pourrez continuer à mieux faire connaître les grands fonds marins.
La réunion est close à 18 h 00.