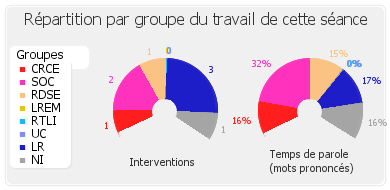Séance en hémicycle du 16 octobre 2013 à 21h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à dix-neuf heures, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Charles Guené.

La séance est reprise.

L’ordre du jour appelle le débat sur la place des femmes dans l’art et la culture (rapport d’information n° 74 [2012-2013], organisé à la demande de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
La parole est à Mme la présidente et rapporteur de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, que j’ai l’honneur de présider, a fait de la place des femmes dans le secteur de la culture le thème principal de ses travaux au cours de la session 2012-2013. Entre les mois de janvier et de mai dernier, douze auditions nous ont permis d’entendre le point de vue de dix-sept professionnelles de la culture représentant tout le champ de l’expression et de la programmation artistiques.
Ces travaux ont conduit à la publication, le 27 juin dernier, d’un rapport assorti de dix-neuf recommandations, que la délégation a adoptées à l’unanimité des présents. Nous sommes réunis ce soir pour en débattre ensemble, ce qui est, pour mes collègues et moi-même, une source particulière de satisfaction.
Le rapport de la délégation a mis en évidence un déséquilibre patent entre les hommes et les femmes, au détriment des femmes, dans le secteur culturel et dans la programmation des œuvres artistiques proposée au public en France. Force du « plafond de verre », faible visibilité des créatrices et puissance des stéréotypes masculins et féminins dans les médias figurent parmi les causes du déséquilibre relevé par nos travaux.
Ces constats peuvent sembler quelque peu contre-intuitifs, car le domaine de la culture est traditionnellement considéré comme accueillant pour les femmes, mais le rapport souligne bien l’« invisibilité » des femmes dans les lieux de création et les diverses manifestations artistiques.
De manière générale, on compte très peu de femmes parmi les artistes mis à l’honneur lors des grands prix, festivals, rétrospectives et autres manifestations culturelles destinées à valoriser l’excellence dans tel ou tel domaine.
En 2011, alors que ne figuraient parmi les 542 acquisitions annuelles des Fonds régionaux d’art contemporain – les FRAC – que 132 œuvres réalisées par des femmes, soit 24 %, la part des œuvres d’artistes femmes dans les acquisitions du Fonds national d’art contemporain était, elle, de 21 %.
Le prix moyen des créations des artistes femmes est inférieur de 27 % à celui des œuvres des artistes masculins, selon le premier état des lieux publié au mois de mars dernier par l’Observatoire de l’égalité hommes-femmes dans la culture et la communication.
Par ailleurs, seuls cinq centres chorégraphiques nationaux sur dix-neuf sont actuellement dirigés par des femmes : la proportion de 25 % n’a pas évolué depuis le rapport de Reine Prat remis en 2009.
Quant à l’accès des femmes aux postes stratégiques de l’administration culturelle, il existe encore en France d’importantes marges de progression : la part de femmes dans les postes de direction du ministère de la culture et des établissements publics qui en dépendent est d’environ 25 %.
De même, les femmes dirigent généralement les établissements les moins subventionnés, qu’il s’agisse des centres nationaux de création musicale, des opéras, des centres dramatiques ou des scènes nationales. Ce n’est certes pas parce qu’une femme dirige une structure que celle-ci reçoit moins de subventions, mais les statistiques montrent clairement que les femmes sont généralement nommées à la tête des structures les moins subventionnées.
Cela étant – je m’éloigne un instant du thème de l’invisibilité des créatrices –, les auditions auxquelles a procédé la délégation ont permis de mettre en évidence la banalisation de comportements sexistes dans les écoles d’art, au point que l’une des personnes reçues a dénoncé le fait que « l’éventail des comportements sexistes est large, allant de l’insulte sexiste ou homophobe jusqu’au harcèlement sexuel », ce qu’elle a d’ailleurs qualifié de « véritable fléau qui sévit dans l’enseignement artistique. »
Les données contenues dans le rapport sur la faible visibilité des femmes dans le secteur de la culture viennent d’être confirmées par une plaquette publiée par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la SACD, qui concerne la saison 2013-2014. On y dénombre seulement 25 % de spectacles de théâtre mis en scène par des femmes, 15 % de femmes solistes instrumentistes, 20 % de textes dus à des femmes auteures dans la programmation théâtrale et seulement 3 % de femmes chefs d’orchestre.
Ce dernier pourcentage est d’ailleurs emblématique de la force des préjugés qui limitent les carrières féminines : jouer d’un instrument, oui, mais diriger un orchestre, vous n’y pensez pas !
Le titre de cette plaquette – Où sont les femmes ? – interpelle à juste titre. En effet, tout se passe comme si la tradition des « grands maîtres » revenait à limiter le contact entre les femmes artistes et le public.
Pour en revenir aux femmes chefs d’orchestre, force est de constater qu’il reste un long chemin à parcourir si l’on en juge par des propos récents du directeur du Conservatoire de Paris, relayés par un quotidien en ligne, soulignant l’incompatibilité entre maternité et profession de chef d’orchestre.
Le tableau que la délégation a présenté n’est donc pas plus favorable aux femmes que ceux qu’ont dressés les deux rapports de la mission Égalités du ministère de la culture, en 2006 et 2009, sur l’égal accès des femmes et des hommes, dans le domaine des arts du spectacle, aux postes de responsabilité, aux lieux de décision, aux moyens de production, aux réseaux de diffusion et à la visibilité médiatique. Il semblerait que, en sept ans, rien n’ait été fait pour progresser.
Je rappellerai ce soir que les statistiques mises au jour par ces rapports étaient accablantes, car elles avaient alors révélé que les hommes dirigeaient 89 % des institutions musicales et 92 % des théâtres consacrés à la création dramatique, tandis que la programmation favorisait les hommes à hauteur de 97 % pour les compositeurs, de 94 % pour les chefs d’orchestre, de 85 % pour les auteurs des textes dramatiques à l’affiche des théâtres du secteur public et de 78 % pour les metteurs en scène de théâtre.
Dans le même esprit, on s’était alors aperçu que le coût moyen d’un spectacle pouvait varier du simple au double, dans la même institution, selon qu’il était mis en scène par une femme ou par un homme.
Ces travaux avaient également souligné des inégalités majeures dans les domaines suivants : celui de la musique, où, en 2009, les femmes représentaient 44 % des musiciens interprètes, 30 % des musiciens d’orchestres permanents et seulement 20 % des solistes, et, de manière beaucoup plus surprenante encore, celui de la chorégraphie, secteur pourtant traditionnellement accueillant pour les femmes, où la proportion de directrices de centres chorégraphiques nationaux est passée, entre 2006 et 2009, de 43 % à 26 %.
Ce déséquilibre entre les hommes et les femmes ne semble pas propre à la France, puisque le Parlement européen a adopté, au mois de mars 2009, une résolution sur l’égalité de traitement et d’accès entre les hommes et les femmes dans les arts du spectacle. Cette résolution constatait que de telles inégalités laissaient « des compétences et des talents inexploités et [étaient] préjudiciables à la dynamique artistique ».
Le Parlement européen appelait donc les États membres non seulement « à lever toute entrave à l’accès des femmes à la tête des institutions et des organisations culturelles les plus renommées », mais aussi à « garantir, chaque fois que cela était possible, l’anonymat des candidatures [en maintenant] l’usage de l’audition derrière un paravent pour le recrutement des musiciens d’orchestre » afin de permettre à des candidatures féminines de prospérer. Cette dernière recommandation, vous le comprendrez, mes chers collègues, se passe de commentaire...
Il y a donc bien eu une prise de conscience ; le diagnostic d’un déséquilibre très injuste, au détriment des femmes, dans tous les secteurs de la vie culturelle et artistique a été posé.
Alors, que faire pour améliorer les choses ?
J’en viens, madame la ministre, monsieur le président, mes chers collègues, aux recommandations de la délégation. Je me bornerai ce soir à évoquer devant vous celles qui me semblent les plus importantes.
Certaines de ces recommandations s’attachent à la source du problème, qui réside dans la force des stéréotypes masculins et féminins responsables de la pérennité de représentations féminines traditionnelles défavorables, dans la culture comme ailleurs, à la promotion des femmes. Des progrès restent à faire, à cet égard, dans les médias. La délégation appelle donc à une vigilance particulière dans l’élaboration des contenus – productions et programmes – et à la désignation, dans l’organigramme de toute structure et, plus particulièrement, des chaînes de télévision publiques, des personnes ou services chargés de cette mission de vigilance.
De manière générale, la délégation a estimé utile d’intégrer la sensibilisation aux stéréotypes masculins et féminins à la formation des élèves des conservatoires, des écoles d’art et des écoles de journalisme.
Avec le problème de la pérennité des stéréotypes traditionnels, qui contribuent à décourager l’essor de trop nombreuses femmes, nous sommes confrontés, nous en avons toutes et tous conscience, à un phénomène qui dépasse très largement le thème de la culture et des milieux artistiques qui nous rassemble ce soir.
Les caricatures, les clichés et les préjugés sexistes, qui sont autant de freins aux carrières féminines, ne se limitent pas au domaine artistique. Nous touchons là une question de société très vaste, qui intéresse évidemment le contenu des programmes de télévision, la publicité, mais aussi les manuels scolaires, la littérature et la presse enfantine et de jeunesse. Si vous me le permettez, je veux lancer ce soir une alerte au sujet des jeux vidéo et en ligne, dans lesquels les représentations des femmes sont souvent consternantes, voire choquantes, au point que le viol y est parfois banalisé.
Désamorcer ces préjugés sera un travail de longue haleine auquel la délégation aux droits des femmes ne restera pas indifférente, car il s’agit d’une question déterminante pour l’équilibre de notre société et pour l’harmonie des relations entre les hommes et les femmes.
Une autre série de recommandations vise à favoriser les candidatures féminines et à lever les freins aux nominations de femmes à des postes de direction : fixation d’un objectif de nomination d’au moins un tiers de femmes dans toutes les administrations culturelles, afin d’assurer un vivier de recrutement pour l’avenir ; encouragement des short lists paritaires et des co-candidatures pour les nominations aux postes de direction ; désignation de jurys paritaires pour tout recrutement dans le domaine artistique et culturel et sensibilisation des jurys et autres comités de sélection à la nécessité de ne pas juger les candidates différemment des candidats – trop souvent, on constate un niveau d’exigence plus élevé pour les candidates que pour les candidats, même de la part de jurys paritaires.
Certaines recommandations ont pour objet d’améliorer la visibilité des œuvres des créatrices qui, dans notre société, ont tant de mal à accéder au public. Il s’agirait de réfléchir à la création d’un « incubateur » de création, dédié aux femmes artistes, qui pourrait servir de source d’inspiration aux programmateurs de toutes les disciplines.
Pour ce qui concerne les médias, la délégation préconise de respecter une proportion d’un tiers d’œuvres, articles, émissions, etc. réalisés par des femmes. Dans cet esprit, la création d’un « prix » au féminin, qui serait attribué chaque année, par exemple, à une chaîne de télévision ou à un organe de presse qui se serait illustré par la place donnée à la création féminine, pourrait, selon la délégation, contribuer à faire bouger les lignes, si je puis employer cette expression.
Par ailleurs, il serait intéressant d’encourager les commissions de soutien du Centre national du cinéma et de l’image animée à sélectionner un certain pourcentage de films de femmes, par exemple un tiers.
Cela étant, il faut aussi poursuivre systématiquement la publication de brochures et de statistiques. L’état des lieux élaboré par le ministère de la culture et de la communication, au mois de mars dernier, dans le cadre de l’Observatoire de l’égalité hommes-femmes dans la culture et la communication, a permis de faire une nouvelle fois le point. Faute de la publication régulière de tels bilans, les décideurs ont trop souvent tendance à croire l’objectif atteint au premier frémissement statistique favorable !
D’autres recommandations, enfin, concernent le harcèlement sexuel dont le rapport dénonce l’ampleur dans les écoles d’art : lancement d’une réflexion nationale sur la question, associant tous les professionnels du secteur ; généralisation de l’information des étudiants et étudiantes de tout le secteur artistique sur la question et élaboration d’une charte déontologique distribuée à tous dès leur inscription ; organisation de la procédure disciplinaire s’appuyant sur la compétence de la section disciplinaire d’un autre établissement que celui dont relèvent l’auteur et la victime présumés et sur une composition strictement paritaire de cette section.
À cet égard, je me félicite tout particulièrement que, dans le cadre de la discussion du projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes, le Sénat ait adopté un amendement tendant à délocaliser les jurys en matière disciplinaire, en cas de poursuite pour faits de harcèlement sexuel. Je pense qu’une telle initiative honore notre assemblée.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, Virginia Woolf l’a écrit : la littérature « est appauvrie, au-delà de tout ce que nous pouvons en juger, par toutes ces portes qui se sont refermées sur les femmes ». Le même regret s’applique incontestablement à la création artistique. La discrimination dont sont victimes les femmes dans tous les domaines de la culture ne concerne pas seulement l’égalité entre les hommes et les femmes. Elle conduit aussi à priver le public de la richesse créatrice portée par des artistes ainsi évincées. C’est pourquoi, comme le souligne le titre du rapport de la délégation, il ne s’agit plus maintenant d’établir une nouvelle évaluation d’une situation hélas bien connue : le temps est venu de passer aux actes ! §

Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, la place des femmes dans l’art et la culture n’est pas dissociable de celle des femmes et des hommes dans la société.
Rappelons que l’an dernier, dans cette enceinte même, l’un de nos collègues, un peu énervé par un débat, disait de l’une de nos collègues, vice-présidente d’une commission : « Qui c’est cette nana ? »
Rappelons que voilà encore quelques jours, un député UMP a pu « caqueter » alors que notre collègue Véronique Massonneau s’exprimait sur la réforme des retraites : nous nous réjouissons que ce dernier dérapage ait été sanctionné rapidement par une ponction significative sur l’indemnité parlementaire du fautif.
Je ne résiste pas non plus au plaisir de signaler les propos tenus par l’un de nos augustes collègues lorsqu’il est en difficulté avec une femme : « Je vais appeler son président, ou son mari » !
Sous couvert d’un paternalisme plus ou moins assumé, sous couvert de culture méridionale ou nordiste, sous couvert aussi du « noviciat », très relatif des femmes, le sexisme a encore la vie dure et il ne faut rien laisser passer, ni dans cet hémicycle ni au-dehors.
On pourrait imaginer que la situation soit plus favorable dans le monde de l’art ou de la culture. L’exception créatrice et le génie de l’invention seraient-ils mieux protégés du sexisme et du préjugé que le reste du monde ? Rien n’est moins sûr et notre rapporteur l’a démontré ce soir avec talent : dans le monde de la culture et de l’art aussi, le sexisme est au rendez-vous !
Les excellents travaux de Reine Prat et le rapport de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes montrent que la situation est même parfois pire dans le domaine de l’art. Les chiffres de 2006 – hélas, trois fois hélas ! – n’ont pas évolué, les exclusions sont inchangées et les femmes restent absentes des postes stratégiques, même si elles sont les plus pratiquantes en matière d’art et de culture. Nous nous réjouissons, bien sûr, que le ministre de la culture et de la communication soit une femme, très féministe à ce que nous avons compris. C’est bien, mais c’est loin d’être suffisant !
De nos jours, les publics de toutes les écoles sont mixtes, les pratiques artistiques se sont diffusées, même si des inégalités sociales demeurent, ce que je déplore, les voies d’accès aux métiers et carrières artistiques sont toutes féminisées – dans certaines écoles, les femmes sont plus nombreuses que les hommes –, mais le pouvoir reste désespérément masculin, un peu comme dans le monde de l’école, où l’on ne trouve que des femmes à l’école maternelle, alors que, dans l’enseignement supérieur, la quasi-totalité des professeurs sont des hommes. Il en va de même dans le domaine de l’art et de la culture.
Face à ce constat, nous ne pouvons que souscrire au diagnostic établi dans le rapport de la délégation et affirmer, de nouveau, qu’il faut lutter contre les stéréotypes véhiculés dans nombre de contenus culturels, dont les jeux vidéo – nous partageons votre analyse sur ce point, madame la présidente ! –, et ce n’est pas simple, car la liberté de créer et la lutte contre le sexisme tendent parfois à s’opposer.
Par ailleurs, il faut lutter ardemment contre l’invisibilité des créatrices : leur éviction très fréquente d’un certain nombre de manifestations culturelles et leur sous-représentation sont encore des problèmes majeurs. Il faut donc mener une politique volontariste et encourager des productions féminines ou fortement féminisées.
Enfin, la question a déjà été évoquée et Mme la ministre s’attèle à son règlement, la « surmasculinité » critique des postes de direction dans les institutions et industries culturelles et dans la presse est un problème général qu’il convient de prendre à bras-le-corps, également pour aider notre démocratie !
Le vivier existe : les femmes ont acquis des formations, des diplômes, elles ont du talent, tout le monde en convient. Pourtant, lorsqu’il s’agit d’accéder aux postes de responsabilité, rien ne va plus ! « Vais-je être capable ? Vais-je réussir à concilier tout ? En ai-je vraiment envie ? » : ces questions que toute femme se pose en s’engageant dans la vie associative, culturelle ou artistique, quel homme se les pose vraiment ? Cette sorte d’hypermodestie, cette vogue du doute permanent, ce questionnement sur le sens de la prise de responsabilité ne semblent pas étouffer outre mesure la plupart de nos amis de sexe masculin. C’est un comportement socialement construit, qui ne doit rien au biologique ; c’est une forme de domination, involontaire ou volontaire, qu’un certain nombre d’hommes exercent dans la société, y compris dans le monde artistique et culturel.
Sans aller jusqu’à citer Gramsci – mais nous sommes en petit comité ! –, vous le savez comme moi, la culture joue un rôle majeur dans la prise de conscience des inégalités de toute sorte dans la société.
Il est temps de redonner aux femmes leur juste place dans l’art et la culture. Les trois vagues du féminisme en France ont bien sûr joué un rôle clé dans cette évolution : mieux les connaître permettrait peut-être d’aider à briser un certain nombre de préjugés.
À l’heure de la mixité de l’école maternelle jusqu’à la maison de retraite, il est temps d’encourager les femmes créatrices. Les récentes réformes de la loi sur l’école vont dans le bon sens, Mme le rapporteur l’a signalé.
Il faut promouvoir coûte que coûte des mesures qui, justement, ne coûtent rien : pour reprendre un exemple qui me tient à cœur, il serait si simple de donner à des rues ou à des places des noms d’artistes femmes – cela a été fait à Angers et je tiens à le saluer. Il faut également soutenir les propositions de Philippe Belaval qui visent à ne plus admettre que des femmes au Panthéon pendant l’actuel quinquennat, en particulier des résistantes, comme Germaine Tillion et Lucie Aubrac – elles furent des femmes de culture, l’une étant ethnologue et l’autre enseignante –, mais aussi des artistes. Par ailleurs, ces cérémonies doivent être des temps de partage démocratique et non pas des grands-messes laïques réservées à quelques happy few des quartiers mondains !
De plus, il faut placer au premier plan les arts visuels et le soutien aux photographes. La photographie est un art particulièrement accessible et démocratique et le métier s’est révolutionné : il faut également accorder une meilleure place aux femmes photographes.
En outre, les organisateurs de manifestations culturelles doivent être encouragés, au besoin par des mesures pécuniaires, à assurer une meilleure parité dans le choix des pièces artistiques présentées, tout comme il serait souhaitable que les conservateurs de musée ne se penchent pas uniquement le 8 mars sur les aspects féminins de leurs collections ou lors d’un grand événement, même s’il est très réussi : la culture doit se vivre tous les jours, et l’art mixte aussi !
Enfin, si l’on peut se féliciter de l’organisation de nouvelles expositions portant un regard iconoclaste, comme l’actuelle exposition sur le nu masculin au musée d’Orsay, il serait hautement urgent d’examiner ce qui se passe dans les FRAC en matière d’acquisitions et d’exposition des œuvres acquises : on achète des œuvres de femmes, mais elles sont trois fois plus nombreuses dans les remises que les œuvres d’hommes. Allez m’expliquer pourquoi ! Si les collections d’antan – jadis, il y a très longtemps – relevaient d’une époque où les femmes étaient très peu présentes et se trouvaient dans la situation de mineures reléguées aux tâches domestiques, aujourd’hui toutes nos collections sont mixtes : il faut donc que nos expositions le soient également !
Madame la rapporteur, madame la ministre, c’est en ayant chaussé ces « lunettes de l’égalité » que nous aborderons avec détermination l’examen du rapport pour avis consacré au budget des arts visuels.
Il me reste quelques secondes que je voudrais utiliser à citer certains noms qui n’ont jamais dû être entendus dans cet hémicycle : Louise Abbema, Chantal Akerman, Laure Albin Guillot, Geneviève Asse, Barbara, Anna-Eva Bergman, Sarah Bernhardt, Rosa Bonheur, Louise Bourgeois, Jeanne Bucher, Marcelle Cahn, Claude Cahun, Sophie Calle, Hélène Cixous, Germaine Dulac, Françoise d’Eaubonne, Alice Guy, Juliette, Marie Laurencin, Julie Manet, Annette Messager, Berthe Morisot, Musidora, Orlan, Rachilde, Carole Roussopoulos, nous avons besoin de vous !
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

M. Jacques Legendre . Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il fallait bien que les hommes participent à ce débat. Vous ne me le reprocherez pas !
Sourires.

Il existe encore aujourd’hui un décalage important entre la présence des femmes et celle des hommes dans le monde de l’art et de la culture. C’est une évidence. Fallait-il le rappeler ? Oui, car il est parfois utile de rappeler les évidences, voire de les dénoncer !
Plusieurs rapports et études relatifs à ce sujet montrent que le problème se situe sur deux plans : d’une part, l’accès à des postes de direction, d’autre part, l’accès aux programmations dans les domaines artistiques. Mme Gauthier-Morin, dont le rapport dresse un état des lieux, a relevé plusieurs chiffres qui, en effet, nous interpellent.
Si 60 % des élèves des écoles d’art sont des étudiantes, les femmes n’occupent que 18 % des postes à responsabilité au sein de l’administration culturelle. Fort heureusement, dans ma ville, le directeur de l’école d’art est une directrice !
Dans le secteur de la création, la programmation féminine est de 10 % environ dans le domaine de la musique, de 20 à 30 % dans ceux du théâtre et de la danse. De plus, 25 % des films français sont produits par des femmes.
Quant aux écarts de rémunération, ils seraient, selon les données du ministère, de 8 % dans les établissements publics, de 15 % dans le secteur audiovisuel et de 20 % dans les entreprises culturelles privées.
On assiste donc au même phénomène que dans d’autres secteurs professionnels : la présence des femmes augmente, les jeunes filles sont de plus en plus nombreuses à se former dans les disciplines artistiques et culturelles, mais elles se heurtent encore au fameux « plafond de verre ».
Ce constat établi, il s’agit de se mettre d’accord sur les voies à emprunter pour que la situation évolue, et tel est bien notre objectif commun.
Le Gouvernement a décidé la mise en place d’une discrimination positive, qui va de l’établissement de ce qu’il nomme des « short lists » – un terme anglais que je n’apprécie guère ! – à des remplacements de postes de direction. À mon avis, c’est ce dernier point qui risque de s’avérer un peu plus compliqué.
Lors du récent examen du projet de loi relatif à l’indépendance de l’audiovisuel public, madame la ministre, nous avons marqué notre surprise de vous voir communiquer avec tant d’ardeur sur l’indépendance des responsables de ce secteur, alors que vous-même étiez intervenue pour que le mandat de plusieurs responsables de théâtres et centres dramatiques ne soit pas reconduit.
N’auriez-vous pas un peu joué sur les mots en disant qu’il s’agissait non de révocation mais de non-renouvellement de mandat ? Les intéressés n’ont probablement pas goûté la nuance !
Vous avez justifié vos interventions par la volonté de féminiser les postes de direction dans le monde de l’art et de la culture.
Les membres de mon groupe sont prêts à applaudir la nécessaire féminisation du monde de l’art et de la culture, les chiffres nous alertant sur la nécessité d’agir. Toutefois, ce débat suffit-il à justifier l’éloignement de personnes aux qualités attestées et qui n’ont nullement démérité ? Nous découvrons là un problème déjà connu ailleurs, y compris dans le monde politique, et qui ne se règle pas toujours de façon satisfaisante par le recours aux quotas.
Preuve en est que le milieu artistique – pourtant ouvert d’esprit, ou que l’on croit ouvert d’esprit – n’a pas accepté vos arguments : nombreux sont les artistes qui ont manifesté leur désaccord avec cette politique, regrettant ce parti pris de féminisation systématique, ainsi, d’ailleurs, que de rajeunissement, pour ne pas parler de « jeunisme », aboutissant à écarter certaines personnalités sans justification incontestable.
Il me semble que le maintien dans le poste peut se comprendre quand les fonctions ont été exercées avec talent. Et je comprends aussi que, compte tenu des déséquilibres que nous avons constatés, il soit préférable de nommer une femme quand un poste se libère.
Je pense également que l’excès est l’ennemi du bien. Nous ne sommes plus, fort heureusement, au temps de Camille Claudel ! Le choix d’instituer une discrimination positive aussi systématique me semble peu respectueux, aussi bien de la profession que des femmes elles-mêmes, à qui l’on risque de reprocher d’avoir gravi les échelons grâce à des quotas !
Par ailleurs, selon moi, le secteur des arts et de la culture est certainement l’un des plus à même de refuser les préjugés et les discriminations. Il faut lui faire confiance pour évoluer, même s’il faut parfois le mettre devant la réalité de chiffres qui ne sont pas acceptables.
N’oublions pas non plus qu’il existe une sorte d’autocensure des jeunes femmes. Comme dans d’autres professions, elles ne veulent pas – ou ne peuvent pas toujours – investir les postes à responsabilité, plus contraignants pour la vie familiale. Je ne dresse ainsi qu’un constat et je n’en fais pas un argument. Les femmes peuvent craindre de ne pas trouver leur place ou de devoir se battre pour gravir les échelons.
Je pense que c’est sur ce plan qu’il faut agir : susciter la demande de responsabilités, informer davantage les jeunes femmes, leur faciliter, par la mise en œuvre d’une meilleure politique familiale, l’accès à des postes de direction et sensibiliser davantage la profession, comme a pu le faire avec beaucoup de force la SACD au festival d’Avignon en 2011 comme cette année.
Les chiffres cités dans les récents rapports, ainsi que dans la brochure élaborée par la SACD, ont véritablement créé un électrochoc bienvenu dans la profession. Il résulte des auditions que vous avez menées, madame le rapporteur, que les responsables d’institutions culturelles, les directeurs de lieux ou organisateurs d’expositions se sont interrogés sur la composition de leurs équipes ou sur leurs choix.
Le diagnostic ne relève généralement pas d’intentions nuisibles ou de comportements problématiques. C'est la raison pour laquelle les inégalités entre les hommes et les femmes sont si difficiles à faire disparaître. Je vous le dis très amicalement, je ne pense pas que certains termes de votre rapport tels que les « abus de pouvoir » des hommes reflètent totalement la situation. Cette expression, quelque peu polémique, risque de ne pas faire avancer le débat comme nous le souhaitons et de ne pas susciter le consensus.
Je partage, en revanche, l’idée de dialogue et de mobilisation pour mettre en mouvement l’ensemble des parties prenantes.
Par ailleurs, vous avez également identifié dans votre rapport comme chantier de travail la lutte contre les « stéréotypes » véhiculés dans les contenus culturels. Vous avez noté, par exemple, l’omniprésence de l’image dans la presse féminine de « femmes jeunes, minces et de peau blanche » et une incitation massive au « conformisme de genre ».
Vous dénoncez également les stéréotypes dans les œuvres du spectacle vivant et faites remarquer que dans les pièces classiques les personnages de femmes sont « épouses, filles, mères ou servantes, leur rapport au monde étant toujours médiatisé par leur lien avec un homme », ce qui nécessiterait de privilégier les pièces contemporaines.
Il faut pardonner aux classiques de n’avoir peut-être pas eu à l’esprit les nécessités qui nous imposent maintenant d’évoluer. Cela ne signifie pas pour autant qu’il faut se détourner des pièces classiques, mais il faut veiller à ne pas retrouver les mêmes stéréotypes dans les pièces contemporaines. Ce ne serait pas acceptable pour notre société !

Le présent débat me semble donc un peu caricatural. S’il faut évidemment veiller au respect de la femme dans toute représentation féminine – telle est la réelle question –, je recommande néanmoins la prudence lorsque je vois que, une fois de plus, la lutte contre les stéréotypes aboutit à vouloir confier à l’école la mission d’éduquer nos enfants à la théorie du genre…
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, ce débat me laisse dubitatif. Si je partage entièrement les préoccupations et, parfois, les propositions qui sont émises, les messages qu’il véhicule me semblent malheureusement trop souvent idéologiques. Peut-être certains ont-ils été exprimés sur un ton un peu vif, notamment ceux de Mme Bouchoux. Quoi qu’il en soit, au lieu de faire avancer les choses, ils risquent, au contraire, de susciter des polémiques, qui ne sont pas souhaitables.
En conclusion, je désire que notre société, telle qu’elle est, soit représentée le mieux possible dans le monde de la culture. Il reste du chemin à parcourir. Je souhaite qu’il soit fait. Parlons entre nous ! Dialoguons ! §

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce débat fait suite au rapport d’information sur le thème « La place des femmes dans l’art et la culture » de notre collègue Brigitte Gonthier-Maurin, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Cette dernière s’est saisie opportunément d’un sujet qui, trop longtemps minoré, mérite d’être étudié en tant que tel afin de favoriser une prise de conscience manifestement difficile. Évidemment, c’est la place des femmes dans l’ensemble de notre société qui doit être examinée et faire l’objet de la plus grande attention ainsi que de politiques fortes, car les inégalités entre les hommes et les femmes restent importantes, quel que soit le secteur professionnel.
Présentes dans la quasi-totalité des secteurs professionnels, ces inégalités sont, dans certains milieux, plus exacerbées encore que dans d’autres. C’est malheureusement le cas du secteur culturel, que l’on aurait pu croire « avancé » sur les questions de représentation et de places accordées aux femmes. Il se révèle être, au contraire, l’un des lieux privilégiés de l’inégalité des sexes.
Le rapport précité nous enseigne opportunément non seulement que la culture est le véhicule de stéréotypes sexistes par le biais des œuvres créées et via les médias, mais aussi que la place des femmes créatrices y est minorée, pour ne pas dire niée dans certains domaines. Il constate, enfin, que le « plafond de verre » s’y applique comme ailleurs, avec une sous-représentation manifeste des femmes aux postes clés des industries culturelles.
Il ne s’agit pas seulement d’une inégalité professionnelle caractérisée ; il s’agit bel et bien d’une amputation grave de notre imaginaire collectif ! Comment accepter qu’une moitié de l’humanité soit ainsi entravée dans sa capacité créatrice ? L’enjeu culturel est évident, au sens plein du terme, pour toute la société.
Ces constats accablants ont amené la délégation aux droits des femmes à proposer dix-neuf recommandations ciblées sur le monde culturel. Je ne les reprendrai pas, elles viennent en partie d’être exposées par Mme le rapporteur.
Notre groupe les soutient pleinement, afin de corriger ce déséquilibre entre les hommes et les femmes qui, comme toujours, se fait au détriment des femmes. Il est d’autant plus important de mettre ces préconisations en œuvre que la révélation de ce problème dans le monde culturel est finalement assez récente et n’a été évoquée qu’à partir de 2006, avec le rapport de Reine Prat.
Sans doute cette prise de conscience tardive est-elle l’une des raisons de la force de ces inégalités, puisque l’on ne peut traiter efficacement ce qui n’est pas clairement diagnostiqué.
En tout cas, force est de constater aujourd’hui que, depuis 2006, la situation ne s’est absolument pas améliorée. Ainsi, entre 2006 et 2009, les deux rapports de la mission Égalités du ministère de la culture sur l’accès des femmes et des hommes aux postes de responsabilité, aux lieux de décision, aux réseaux de diffusion dans le domaine des arts du spectacle n’ont pas relevé d’évolution positive : les femmes restent sous-représentées, et ce dans des proportions dramatiques que Mme la rapporteur a rappelées.
Les femmes dirigent seulement 11 % des institutions musicales et 8 % des théâtres de création dramatique. Elles ne représentent qu’une part très faible des compositeurs programmés, des chefs d’orchestre, des auteurs de textes dramatiques des théâtres publics. Je ne reprendrai pas tous les chiffres évoqués, mais ils sont éloquents sur la gravité du problème et l’ampleur du chemin à parcourir.
Nous disposons désormais de plusieurs rapports et constats de divers acteurs, qui ont tous participé à cette progressive prise de conscience collective : ont été ainsi étudiées en 2009, la question de l’image des femmes par Michel Reiser et Brigitte Grésy et, en 2011, la place des femmes dans le spectacle vivant et aux postes à responsabilité. Enfin, la publication, au mois de juin 2012 pour le festival d’Avignon, par la SACD de la brochure intitulée Théâtre, musique, danse : où sont les femmes ? et dénonçant les structures et établissements où les femmes sont sous-représentées, a semblé commencer à produire des effets positifs. Nous disposons donc d’une connaissance désormais objective de la situation, complétée par le rapport présenté aujourd’hui.
Comme le souligne ce document, le temps de la prise de conscience est révolu et l’immobilisme ne peut plus perdurer. Il faut donc désormais agir. Et il faut que les deux ministères concernés – le ministère de la culture et de la communication et le ministère des droits des femmes – mettent en œuvre des mesures correctrices et incitatives, comme le rapport le prône. C’est sur ce point, madame la ministre, que nous souhaitons connaître vos intentions.
Pour conclure, je voudrais attirer votre attention sur un sujet qui, s’il n’est pas directement abordé aujourd’hui, est entièrement lié au débat qui nous préoccupe, puisqu’il est spécifique aux femmes et au monde de la culture : je veux parler de la question de l’intermittence, dont nous avons eu également à débattre au sein de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.
La nécessité de réformer le régime de l’intermittence est souvent abordée, mais malheureusement trop peu dans le sens d’une meilleure appréhension des problèmes rencontrés par les femmes concernées. En effet, les annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage prévoient d’indemniser deux tiers d’hommes contre seulement un tiers de femmes.
Quant à la réforme du statut des futures mères intermittentes, qui s’en soucie ? Celles qui, pour porter leur combat, se sont nommées les « matermittentes », sont trop souvent oubliées.
À la suite de la réforme de 2003, le congé de maternité n’ouvrait plus droit ni à l’assurance-chômage ni aux cotisations retraite.
En 2004, heureusement – et c’est le seul point sur lequel le combat contre la réforme de 2003 a fini par aboutir –, ce recul des droits a été corrigé. Les périodes de congé de maternité ouvrent désormais de nouveau droit à l’assurance chômage comme aux cotisations retraite.
Cependant, le taux d’indemnisation reste extrêmement bas au retour de ce congé de maternité.
En effet, si les mois de congé de maternité ouvrent bien ces droits, puisque cinq heures journalières sont comptabilisées, ils sont pris en compte à niveau zéro, si bien que l’indemnisation est calculée sur le reste des cachets annuels, peu nombreux, et que son montant reste très faible.
De surcroît, les « trous » de carrière des intermittentes dépassent souvent les seules seize semaines légales de congé de maternité du fait même de la spécificité de l’activité professionnelle.
Les modes de calcul ouvrant droit à une indemnisation au titre du congé de maternité sont tellement complexes, voire impossibles, à mettre en œuvre que certaines « matermittentes » ne touchent pas d’indemnisation durant leur congé de maternité.
Effectivement, afin d’acquérir ce droit, il est nécessaire d’avoir réalisé deux cents heures au cours des trois derniers mois précédant le congé de maternité, soit entre le sixième et le huitième mois de grossesse ou pendant les trois mois précédant la conception de l’enfant.
Le volume d’heures exigé est donc extrêmement important puisqu’il faut normalement avoir effectué 507 heures sur dix mois ou dix mois et demi. Il est d’autant plus difficile à atteindre que certaines professions ne permettent pas une pratique jusqu’au huitième mois. Comment imaginer une danseuse continuant d’exercer au-delà de quelques mois de grossesse ou même une actrice, dont la capacité à incarner certains rôles sera limitée ?
Le mode de calcul des indemnités de ces intermittentes pose donc un véritable problème. En 2010, cette question a fait l’objet d’une plainte pour discrimination, à nos yeux parfaitement fondée, auprès de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité. Nous soutenons cette démarche et demandons que cette situation soit prise en compte.
Telles sont, mes chers collègues, les remarques que je voulais, au nom du groupe CRC, ajouter aux constats et recommandations du rapport présenté par Brigitte Gonthier-Maurin et que, je le rappelle, nous soutenons pleinement. §

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le 23 septembre dernier, pour la première fois, une femme a été élue à la présidence du Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, le SYNDEAC. Il s’agit de Madeleine Louarn, la directrice du théâtre de l’Entresort de Morlaix, ville chère à Marylise Lebranchu, et actuellement dans la tourmente, tout comme le département dans lequel elle est située.
Plus d’un demi-siècle après Jeanne Laurent, une autre finistérienne, va donc se poursuivre au féminin l’œuvre de décentralisation culturelle ! On ne peut que s’en féliciter ! Et pour que le bonheur soit plus complet, je rappelle que sur quatre présidents délégués au SYNDEAC, trois sont des femmes.
Une fois n’est pas coutume, dans le domaine de l’art et de la culture, véritable « bastion sexiste », comme l’indiquait un grand quotidien du soir, voilà quelques semaines. Car, contrairement à beaucoup d’idées reçues, la situation des femmes y est bien peu réjouissante : les inégalités sont frappantes !
À cet égard, je reprendrai vos propres mots, madame la ministre : « Le constat est sévère : dans les institutions culturelles, même si une prise de conscience commence à se faire jour et que les femmes artistes en particulier multiplient les interventions, la situation leur reste défavorable, qu’il s’agisse des nominations, de leur place dans les programmations artistiques, ou encore de l’accès aux moyens de production et de diffusion ».
Depuis quelques mois, la question de l’inégalité entre les hommes et les femmes en général – et je remercie Mme Najat Vallaud-Belkacem d’avoir présenté dernièrement un projet de loi sur ce sujet que le Sénat a adopté en première lecture – mais aussi dans le monde de la culture a fait l’objet d’une attention grandissante de la part des médias et de l’opinion publique.
Des collectifs donnent régulièrement l’alerte, qu’il s’agisse du Collectif H/F, présent dans une dizaine de régions – récemment en Bretagne –, ou du groupe La Barbe, qui multiplie les actions. Ce dernier a ainsi dévoilé le peu de place fait aux réalisatrices dans la sélection officielle du Festival de Cannes ou s’est encore invité, au mois de juin 2012, sur la scène du théâtre de l’Odéon lors de la présentation de la saison 2012-2013 pour dénoncer la programmation des quatorze spectacles à venir, quatorze textes écrits par des hommes, quatorze spectacles mis en scène par des hommes. Plutôt choquant, convenez-en !
La place des femmes dans l’art et la culture a été analysée de façon remarquable par la délégation aux droits des femmes dans le rapport de notre collègue Brigitte Gonthier-Maurin. Ce document indique que, sept ans après – je dis bien « sept ans » ! – le premier rapport de Reine Prat sur le sujet, la discrimination envers les femmes est la même.
Je ne vais pas citer tous les chiffres que les orateurs précédents ont déjà donnés. Je souhaiterais néanmoins rappeler que 85 % des textes que nous entendons ont été écrits par des hommes, 78 % des spectacles que nous voyons sont mis en scène par des hommes, 57 % des spectacles sont chorégraphiés par des hommes, alors que les spectateurs sont majoritairement des spectatrices. Ces œuvres, comme nous l’a dit une directrice artistique d’un festival féminin itinérant, sont en réalité « amputées d’une vision de l’autre pôle de l’humanité ».
Poids des maux, choc des taux : telle est la situation navrante !
De plus, derrière les chiffres se cache un discours sous-entendu, souvent pointé du doigt par le Collectif H/F : les femmes seraient-elles dépourvues d’autorité, ou encore de talent ?
Pourquoi sont-elles alors si peu nombreuses à accéder à la direction des institutions culturelles ? Pourquoi n’occupent-elles que 18, 4 % des postes à responsabilité de l’administration culturelle ? Pourquoi cet effet de glaciation ? Pourquoi l’arrivée de femmes aux affaires jetterait-elle un grand trouble, pour reprendre les mots d’Ariane Mnouchkine dans un article du journal Le Monde du 19 juillet dernier ? « Elles ne sont pas prêtes. Elles ne sont jamais assez prêtes. On risque de nommer des incompétentes ». Telles sont les remarques qui peuvent être entendues et qui sont relevées par la fondatrice du théâtre du Soleil qui poursuit : « Oui. C’est vrai. C’est même ça, l’égalité. Depuis des siècles, d’innombrables fois, on a nommé à d’innombrables postes, d’innombrables hommes incompétents. »
Sourires.

Or, comme le souligne la SACD, « il ne saurait y avoir une exception culturelle privant ou désavantageant les femmes dans l’octroi de responsabilités ! »
Pour mettre fin à cette situation honteuse, vous avez annoncé, madame la ministre, que la transparence prévaudrait désormais dans les procédures de nomination. Les oppositions grincheuses n’ont pas tardé. Dès cet été, la question des nominations à la tête de centres dramatiques nationaux a provoqué de nombreuses réactions, parfois douteuses. Mais tout cela s’est bien terminé grâce à la nomination d’Irina Brook à la tête du Théâtre national de Nice.
Auparavant et de façon heureuse, vous aviez réuni pour la première fois, au début du mois de mars, un comité ministériel pour l’égalité des femmes et des hommes dans le domaine de la culture et des médias. Lors de cette rencontre, ce comité a lancé des initiatives fortes visant à lutter contre les discriminations dont sont victimes les femmes et à renforcer leur présence dans le secteur du spectacle vivant.
De plus, une lettre a été envoyée à 270 dirigeants d’institutions culturelles, dans le domaine du spectacle vivant, les enjoignant à renforcer la place des femmes dans leurs choix de programmation ou dans l’accès aux moyens de production. Vous avez demandé que figurent dorénavant dans les lettres de mission de tous les dirigeants de nos institutions nationales et établissements culturels des consignes précises, afin que la présence des femmes aux postes de direction comme dans les programmations soit confortée.
On sait bien que les différents modes d’expression artistique et culturelle véhiculent des représentations sexistes et des stéréotypes ancrés dans l’inconscient collectif, stéréotypes qui se perpétuent ! Et le domaine du spectacle vivant n’est pas épargné !
En effet, le théâtre classique – c’est moins le cas dans le théâtre contemporain – identifie les femmes par rapport à l’homme, les plaçant dans une situation de dépendance. Elles n’existent pas ou peu par elles-mêmes, ne rayonnent pas seules, servent souvent de faire-valoir !
Or n’oublions pas que ces représentations sont faites, comme je le disais, par des hommes, pour des hommes et sont proposées dans une grande majorité à des femmes. Comment celles-ci les reçoivent-elles ? Pourquoi n’existe-t-il pas de femmes « normales » dans les spectacles ? Voilà des questions qu’il convient de se poser.
Selon Myriam Marzouki, que nous avons auditionnée, il faut arriver à représenter des personnages où les femmes soient identifiées dans leur rapport au travail, à la politique, à la vie familiale.
Il faut en finir avec cette vision d’un autre siècle selon laquelle les femmes étaient plus souvent célébrées comme des muses, des modèles ou des sources d’inspiration que comme des créatrices ; leur formation artistique était empêchée. Il faut en finir avec l’idée selon laquelle « la femme de génie n’existe pas, et quand elle existe, c’est un homme », comme le disait Octave Uzanne en 1905.
La situation du spectacle vivant « n’est plus en résonnance avec la société » affirme Laurence Equilbey, que nous avons accueillie lors d’une table ronde organisée au Sénat le 25 juillet dernier par la délégation aux droits des femmes.
Le constat est donc implacable : les femmes artistes sont nettement sous-représentées en France. Or l’art ne peut pas et ne doit pas être phallocentré ! L’art ne doit pas être à part, un domaine soumis, comme aurait dit le sociologue Pierre Bourdieu, à la « domination masculine ».
Comme l’a très justement indiqué la ministre des droits des femmes, « dans la culture comme partout ailleurs dans la société française, toutes les conditions doivent être réunies […] pour que les femmes et les hommes disposent des mêmes chances d’accéder aux responsabilités dans leur domaine d’activité. »
Rien ne justifie que le secteur de la création soit exclu de cette exigence républicaine. Rien ne justifie que l’égalité professionnelle s’arrête au seuil des théâtres ou des salles de musique.
Sur l’initiative du ministère des droits des femmes, cette semaine est celle de l’égalité professionnelle. Cet événement permettra d’encourager les initiatives positives qui ont déjà été prises par certaines entreprises et d’aider celles qui manquent encore de moyens pour mettre en œuvre l’égalité.
Le Gouvernement associe les paroles et les actes. J’en veux pour preuve la signature d’une charte pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans le secteur du cinéma le 10 octobre dernier, dans votre ministère, madame la ministre.
Élaborée par Le Deuxième Regard, une toute récente association de professionnels du cinéma qui fait de la lutte contre les stéréotypes et de la place des femmes le cœur de son action, cette charte s’adresse à tous les acteurs de l’industrie cinématographique, à tous les médias, ainsi qu’à tous les acteurs institutionnels et responsables politiques.
Cette charte a été cosignée par vous-même, madame la ministre, Najat Vallaud-Belkacem, Véronique Cayla, présidente d’Arte France et marraine de l’association Le Deuxième Regard, et Frédérique Bredin, présidente du Centre national du cinéma et de l’image animée, le CNC.
Il était urgent qu’un tel instrument soit adopté dans le domaine du cinéma, car, comme l’a indiqué le 4 avril 2013 au Sénat Mme Bérénice Vincent, présidente de l’association Le Deuxième Regard et responsable de son pôle Création, « notre cinéphilie est majoritairement masculine : la part des réalisatrices n’est que de 25 % en France, de 12 % en Europe, et de 5 % aux États-Unis ».
On note la faible présence de réalisatrices dans les festivals de cinéma ainsi que dans les jurys de sélection chargés d’attribuer des aides financières pour la réalisation de films. Qui sont majoritairement dans la lumière ? Les hommes. Qui restent les décideurs ? Des hommes !
Pour témoigner du taux élevé de paternalisme sur les lieux de tournage, Agnès Varda raconte de façon éloquente : « Si le réalisateur est un homme, quand il demande quelque chose, on lui dit : “ Oui, monsieur ” ; à moi, on dit : “ Oui Agnès ” ! » Touchante attention... §
Notons ces jours-ci, sur Ciné +Émotion, la très heureuse initiative intitulée « Le bal des réalisatrices », qui met à l’honneur quatorze femmes cinéastes.
Du 24 septembre au 29 octobre 2013, cette chaîne est allée à la rencontre de cinéastes débutantes, confirmées, ou « nouvelle vague ». Le programme de cet hommage rendu aux femmes réalisatrices célèbres comprend dix-sept films, parmi lesquels deux longs métrages plébiscités par le public et la critique, la même année Polisse de Maïwenn et La guerre est déclarée de Valérie Donzelli, ainsi que le documentaire Cinéast(e)s réalisé par Julie Gayet, qui met au jour le rôle actif joué par les femmes pour le développement du cinéma.
Je referme cette parenthèse cinématographique.
La question de la visibilité des femmes dans le secteur culturel soulève un autre problème fondamental : celui de leur précarisation, que j’illustrerai en évoquant le Fonds de professionnalisation et de solidarité, mis en place en 2007.
Ce fonds, je le précise, permet d’accompagner les intermittents du spectacle, artistes et techniciens fragilisés, afin de sécuriser au mieux leur parcours professionnel.
Après quelques années de fonctionnement, on peut noter que 51 % des bénéficiaires de ce fonds sont des femmes qui, souvent, vivent seules avec un ou plusieurs enfants et ont généralement des revenus annuels inférieurs à 15 000 euros. En comparaison, les femmes ne représentent que 33 % des professionnels intérimaires du spectacle. On constate donc une surreprésentation des femmes parmi les professionnels du spectacle qui ont recours à ce type de fonds et qui se trouvent dans une situation de fragilité.
La question de la visibilité des femmes doit aussi être mise en lien avec la question, très importante, de la vie de mère et de la maternité. Des artistes femmes avouent, et j’ai pu le constater lors d’auditions, qu’elles n’auraient jamais pu mener à bien leur carrière si elles avaient eu des enfants.
Force est de constater, et c’est terrifiant, que la maternité pourrait être un frein évident à la carrière artistique. C’est pourquoi nous avons adopté, sur ma proposition, un amendement relatif aux « matermittentes » lors de l’examen de la loi-cadre pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
Les intermittentes du spectacle en situation de grossesse se trouvent en butte, malgré la circulaire du 16 avril 2013, à une réglementation inadaptée à la spécificité de leur organisation professionnelle, qui les pénalise lourdement.
Les sénateurs ont ainsi adopté le principe d’un rapport précis de la Caisse primaire d’assurance maladie, la CPAM, dans les six mois qui feront suite à l’adoption du texte, afin d’établir clairement le nombre de femmes demandant un congé maternité, le nombre de refus de dossiers et leurs motifs, rapport incluant les délais d’instruction de leur dossier. Les témoignages de « matermittentes » essuyant un refus de prise en charge après la naissance de leur enfant sont en effet récurrents.
Ce rapport sera une première base donnant un peu plus de lisibilité à ces situations d’injustice avec, à terme, l’espoir de la mise en place d’un « minimum maternité » qui serait assuré à ces femmes.
Nous aurons l’occasion, je suppose, d’aborder à nouveau ces questions lors de l’examen du futur projet de loi d’orientation relatif à la création artistique.
Pour conclure, je dirai qu’il faut véritablement se mobiliser pour trouver des solutions permettant d’accompagner les femmes vers la visibilité. Aujourd’hui, il y a une véritable volonté politique, que je salue, de la part du Gouvernement.
Il est nécessaire de faire cesser le scandale de l’inégalité de traitement entre les femmes et les hommes dans le secteur de l’art et de la culture.
Comme l’a très justement rappelé le Mouvement H/F dans son manifeste pour l’égalité femmes/hommes dans l’art et la culture, « n’est-il pas inadmissible que les mécanismes de domination masculine se retrouvent dans un secteur de l’activité humaine qui se targue de missions d’émancipation, d’ouverture, de critique, voire de subversion ? »
Le temps du diagnostic, de la prise de conscience, du changement de mentalité, doit être derrière nous, celui des actes et des réalisations, devant nous.
Il faut que disparaisse en France cette anomalie démocratique de la sous-représentation des femmes dans le monde de l’art et de la culture.
Cette visibilité n’est pas étrangère aux symboles. Ainsi, l’idée de « panthéoniser » certaines grandes femmes de la nation me semble une ambition reconnaissante. Lorsque nous avions visité le Panthéon, madame la présidente Gonthier-Maurin, j’avais d’ailleurs posé une question sur la présence des femmes au sein de cet édifice.
Je viens de lire dans Ouest-France un article, que je vous invite à lire, intitulé « Et si les peintres de cavernes étaient des femmes ? » Des études scientifiques ont en effet prouvé que les peintures préhistoriques retrouvées dans ces grottes étaient l’œuvre de femmes.
Mon tropisme finistérien étant intarissable, surtout en ces moments si difficiles pour mon département, je reprendrai les mots de la réalisatrice Marie Hélia, qui vient de réaliser un documentaire scénarisé, Les chevalières de la table ronde, dans lequel témoignent douze militantes finistériennes de diverses générations – la plus âgée doit avoir 85 ans –, engagées depuis toujours dans la lutte pour les droits des femmes : « Ces militantes sont révoltées de constater les inégalités de salaires entre les deux sexes, les femmes considérées de plus en plus comme des objets, la violence qui leur est faite. Il faut faire attention aux comportements machistes. » Elle ajoute : « Un film de femme ? Oui ! Pour la première fois, je revendique ce label. De toute façon, il m’a souvent été appliqué avec ou sans mon consentement, et cette fois-ci, je le revendique. »
Selon cette réalisatrice, dont le documentaire sortira le 23 octobre prochain, « les femmes doivent encore et toujours se défendre ». Car aujourd’hui comme hier, un homme sur deux est une femme ! §

Sophie Calle, Nathalie Dessay, Hélène Grimaud, Maguy Marin, Laurence Equilbey, Agnès Varda, Coline Serreau : plasticienne, chanteuse lyrique, musicienne, chorégraphe, chef d’orchestre, réalisatrice ou metteuse en scène, voilà, monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, quelques exemples contemporains de femmes dont notre pays a su faire émerger le talent, aujourd’hui mondialement reconnu.
Sur la scène internationale, le prix Nobel de littérature vient d’être décerné à la Canadienne Alice Munro, quatrième femme à recevoir cette distinction en dix ans.
Dès lors, on pourrait croire que tout va bien, ou à peu près, pour les créatrices et autres actrices du monde de la culture, en France ou ailleurs. Or il n’en est rien, et la situation est particulièrement dramatique dans notre pays, comme le montre dans son excellent rapport notre collègue Brigitte Gonthier-Maurin, dont les dix-neuf recommandations ont été unanimement adoptées, le 27 juin dernier, par notre délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Si j’ai pu émettre quelques réserves quant à la façon dont les travaux de notre délégation sont parfois présentés, le travail de fond et de grande qualité qu’elle réalise mérite d’être reconnu. Il contribue à dénoncer et à résorber les inégalités, même là où elles sont les plus inattendues.
Ainsi, le domaine de l’art et de la culture pouvait paraître, à première vue, plus égalitaire que d’autres. Mais cela est totalement faux, comme le démontre très bien ce rapport. En effet, 75 % à 98 % des postes de direction d’établissements culturels sont aujourd’hui occupés par des hommes, qu’ils soient confiés à des directeurs administratifs ou à des artistes. Plus inquiétant encore, ces chiffres n’ont pas évolué depuis 2006, date du premier rapport sur ce sujet remis au ministre de la culture par Reine Prat.
Toutefois, il me semble que la prise de conscience de ces inégalités est en train de progresser, ce qui conduit à un indispensable rééquilibrage.
Madame la ministre, vous venez par exemple de nommer Irina Brook à la tête du Théâtre national de Nice. Je m’en réjouis, et j’espère que d’autres nominations permettront prochainement de faire reconnaître le talent et l’excellent travail réalisé par des femmes dans tous les domaines culturels.
Concernant les arts visuels, un secteur décrit comme particulièrement discriminatoire dans le rapport, je constate que, parmi les artistes sélectionnés pour la Biennale d’art contemporain, rendez-vous majeur qui se tient actuellement à Lyon, on compte de nombreuses femmes, dont plusieurs jeunes plasticiennes françaises.
Certes, cela reste encore et toujours insuffisant. Alors que les femmes représentent actuellement 60 % des étudiants dans les écoles d’art, il est anormal qu’elles occupent une place si réduite sur le marché de l’art à leur sortie : leurs productions représentent moins de 30 % des acquisitions des fonds régionaux d’art contemporain, les FRAC, et 25 % de celles du Musée national d’art moderne.
Il est particulièrement accablant de constater que ce fonctionnement biaisé du marché du travail vaut pour l’ensemble des secteurs culturels. De nombreuses femmes, dont le talent et les compétences ne sont pourtant plus à démontrer, nous ont fait part des difficultés qu’elles rencontrent pour être recrutées par de grandes institutions culturelles françaises. De fait, elles sont obligées de créer leurs propres ensembles, leurs propres troupes, à l’instar du chœur de chambre Accentus de Laurence Equilbey.
Cet état de fait est grave. Cela prouve que les mentalités et les pratiques dans le monde culturel ne sont pas plus évoluées qu’ailleurs et qu’un barrage quasiment systématique, conscient ou non, est fait aux femmes qui souhaitent occuper des postes de responsabilité et le méritent. Le fameux « plafond de verre » est sans doute encore plus infranchissable dans ce secteur que dans d’autres.
Au cours des auditions, il a été souligné que la situation serait moins dégradée dans d’autres pays ; cela me semble à la fois très inquiétant et indigne de notre République où l’égalité est censée tenir une place particulière.
En outre, un autre passage du rapport de notre collègue Brigitte Gonthier-Maurin est extrêmement alarmant. Il s’agit de celui qui est relatif aux écoles d’art, dans lesquelles des comportements et propos sexistes ainsi que des cas de harcèlement sexuel seraient généralisés, banalisés, voire tolérés. Je pense que le Gouvernement et les collectivités locales doivent entreprendre d’urgence une action très ferme face à de tels comportements, qui ne sauraient être acceptés. Surtout, la Justice doit s’en mêler.
Quelles sont les solutions face à la situation très fortement inégalitaire dont les femmes sont victimes dans le secteur de l’art et de la culture ?
Le rapport émet dix-neuf préconisations. Toutes ne permettront pas d’atteindre le but recherché, celui d’une égalité réelle, mais c’est un travail de fond nécessaire et qui petit à petit permettra d’y aboutir.
Je suis en parfait accord avec cette phrase figurant en page 45 du rapport : « Les seules obligations quantitatives et la politique de “quotas” ne suffisent pas, car elles ne permettent pas une évolution des mentalités et une prise de conscience responsable de la nécessité de faire évoluer les choses. »
Pour moi, tout est dit dans cette phrase. C’est pourquoi je suis un peu plus en désaccord avec la perspective esquissée par la seizième recommandation, qui viserait à créer un « lieu ressource » exclusivement dédié à la création féminine dans toutes les disciplines. Nous en avons discuté, et cela reviendrait, hélas, à isoler et stigmatiser peut-être encore davantage les créatrices.
L’objectif à atteindre, c’est de créer les conditions d’une réelle égalité femmes-hommes, dans la culture comme dans les autres domaines. Cette égalité doit se traduire concrètement, à la fois dans le recrutement, la rémunération et l’avancement. Pour cela, ce sont surtout les mentalités qui doivent évoluer en profondeur. Nous avons un vivier de créatrices et d’administratrices culturelles talentueuses et compétentes ; notre société doit leur permettre d’être reconnues à leur juste valeur, à égalité avec leurs homologues masculins.
Il me semble que l’une des clefs pour y parvenir réside dans l’éducation, la formation et l’orientation. La prévention et la condamnation sévère des pratiques discriminatoires et des comportements sexistes ou des actes de harcèlement sont également essentielles.
En ce qui concerne la lutte contre les stéréotypes et leur reproduction, je souscris entièrement à cette phrase, qui figure à la page 26 du rapport : « Pour la délégation, la lutte contre les stéréotypes doit surtout prendre la forme d’une politique de prévention et de sensibilisation, menée en particulier auprès des jeunes générations. »
Attention donc aux solutions extrêmes qui peuvent être prônées « au nom de l’égalité ». S’il est nécessaire de favoriser, dans la production contemporaine, les œuvres de compositrices, de réalisatrices et de metteuses en scène, il ne me semble nullement acceptable de « censurer » des œuvres anciennes sous prétexte qu’elles véhiculent des stéréotypes ou sont écrites par des hommes. Doit-on jeter Molière, Verdi, Wagner et bien d’autres ?
Ce qu’il faut, là encore, c’est éduquer les publics, resituer les œuvres dans leur contexte historique et politique, et non pas condamner, voire réécrire a posteriori certaines œuvres qui ont été réalisées à une époque où, en effet, l’égalité entre les femmes et les hommes était un non-sujet.
Dans le secteur culturel comme dans d’autres, mener une politique « aveugle » de quotas sert peu.
Ce sont, je le répète, les conditions de l’égalité réelle des chances que nous devons créer en renforçant l’éducation et la prévention, et en luttant contre les discriminations.
C’est pourquoi, madame la ministre, j’espère et je crois en votre collaboration réelle avec le ministère de l’éducation nationale.
Applaudissements.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénatrices et sénateurs, le titre de votre rapport d’information rédigé au nom de la délégation aux droits des femmes, « La place des femmes dans l’art et la culture : le temps est venu de passer aux actes », me plaît beaucoup. Ce titre pourrait être une forme de devise de l’action que je mène depuis plus d’un an à la tête du ministère de la culture. Passer aux actes, c’est exactement ce que je souhaite faire, et ce que j’ai commencé à faire.
Je suis donc heureuse d’être invitée ce soir par la délégation aux droits des femmes pour vous parler de cette action.
Cette question de l’égalité femmes-hommes est en effet devenue un sujet à part entière au sein du ministère de la culture et de la communication, que nous nous efforçons de traiter de manière transversale. Je salue d’ailleurs la présence dans cet hémicycle de Nicole Pot, en charge de ces questions au ministère.
Après le Comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité femmes-hommes, présidé par le Premier ministre en novembre dernier, j’ai mis en œuvre ma feuille de route.
J’ai donc installé dès le mois de mars un comité pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication, qui rassemble une quarantaine d’acteurs du monde de la culture et des médias. J’ai été très satisfaite de voir la participation unanime de tous ceux, femmes et hommes, à qui nous avons demandé de participer à ce comité.
Il fallait d’abord « rendre visible l’invisible », c’est-à-dire la discrimination, comme vous le suggérez dans votre rapport. Faire connaître la réalité de la situation, c’est déjà un moyen pour lutter contre ces inégalités. C’est aussi un moyen de combattre l’ignorance ou, pire, l’indifférence.
Je me suis donc appuyée sur l’observatoire de l’égalité dans la culture et la communication, une étude qui rassemble des informations très parlantes sur les nominations, les rémunérations et les programmations, mais aussi sur l’accès aux moyens de production dans tous les champs de la culture, un sujet évoqué par Myriam Marzouki lors de son audition devant votre délégation.
Publiée le 1er mars dernier, cette étude sera actualisée et complétée au début de l’année 2014, notamment par des données sur le secteur du cinéma. Elle a bien entendu vocation à être mise à jour et enrichie régulièrement.
Cela me permet de répondre à l’une des remarques, très juste, de Corinne Bouchoux, qui rappelait qu’il y avait des études, mais qu’elles étaient insuffisamment suivies.
Je veux mettre en place des évaluations pour savoir quels sont les effets des actions que nous avons mises en œuvre.
Il fallait ensuite engager une politique incitative, car c’est aussi de cette manière que s’opère le changement.
Trois chantiers m’occupent particulièrement, qui recoupent d’ailleurs très largement les chantiers prioritaires identifiés par la délégation aux droits des femmes : combattre les stéréotypes, donner toute leur place aux créatrices et promouvoir la place des femmes dans les postes de direction. Voici où nous en sommes.
Les médias sont au cœur de l’enjeu de la lutte contre les stéréotypes. L’image est en effet au cœur de la représentation que l’on donne de la société et des autres, et donc au cœur des processus d’identification auxquels sont confrontés, dès le plus jeune âge, les petites filles et les petits garçons.
L’image a aussi une influence très forte sur la formation des idées et la construction des consciences.
Nous devons donc veiller à ce que ces représentations véhiculées par les médias soient le reflet de la société, et non de ses blocages, et qu’elles contribuent à faire évoluer dans le bon sens la représentation des femmes.
Comme j’ai eu l’occasion de le dire le 8 juillet dernier à l’occasion du colloque France Télévisions « En avant toutes » consacré à la place et à la représentation des femmes à la télévision, le rôle du service public audiovisuel est déterminant pour combattre les discriminations et les stéréotypes. Le service public doit être exemplaire en la matière.
Le CSA sera désormais chargé d’exercer une vigilance toute particulière sur le sujet de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, en veillant notamment à promouvoir une meilleure image des femmes dans l’audiovisuel. Cela passe, en particulier, par la lutte contre les stéréotypes sexistes et les images dégradantes dans les programmes mis à la disposition du public. À cet égard, je me réjouis que le nouveau président du CSA ait décidé, avec le collège, de créer un groupe de travail sur les droits des femmes, présidé par Sylvie Pierre-Brossolette. Je sais que c’est un sujet qui vous tient à cœur.
La lutte contre les stéréotypes passe aussi par la formation, et donc par nos écoles : nous devons convaincre nos jeunes qu’il n’y a pas de métiers ou de filières qui seraient réservés par essence aux femmes – ou aux hommes ! –, ou interdites aux femmes, et qu’il n’y a pas non plus, à l’intérieur de chacune de ces filières ou de ces métiers, des niveaux au-delà desquels l’ambition des femmes devrait buter sur l’écueil de la maternité. Nous devons travailler à améliorer les orientations et les formations pour permettre à chacune et à chacun de se saisir de toutes les chances que lui offre son talent.
C’est vrai dans tous les domaines, mais c’est particulièrement vrai dans la culture, où l’on observe d’énormes inégalités dans la division du travail. Le secteur de la culture a beau être composé de milieux progressistes, qui veulent donner une image du monde et souhaitent souvent contribuer à son évolution, on retrouve malheureusement au sein de l’organisation hiérarchique et sociale qui prévaut dans les milieux culturels les mêmes mécanismes de discrimination à l’encontre des femmes qu’ailleurs – il arrive même parfois qu’ils soient pires qu’ailleurs.
Faut-il expliquer cela au nom d’une conception quelque peu datée du « génie créateur », une sorte de pouvoir démiurgique qui devrait demeurer l’apanage des hommes ? Ou serait-ce finalement, pour paraphraser Nietzsche, qui lui-même s’appuyait sur les Anciens, une autre expression du libri aut liberi – des livres ou des enfants –, comme si l’on ne pouvait pas tout à la fois exercer un pouvoir créateur d’artiste et avoir des enfants, le fait de donner naissance parallèlement à deux univers étant absolument insupportable ?
Nous devons donc travailler pour faire pièce à ces représentations, qui conduisent à cette grande inégalité et à cette division du travail dans les milieux culturels qui ne doit plus avoir cours.
Je voudrais à ce titre saluer le remarquable travail d’Universcience, qui anime auprès du jeune public des ateliers pour les sensibiliser à la question des stéréotypes et des préjugés sur la place de la femme dans les sciences et dans la société plus largement, et qui travaille à la représentation des femmes dans les expositions.
Je souhaite également que les écoles de l’enseignement supérieur dans le champ de compétence de mon ministère se saisissent de ces enjeux et puissent sensibiliser les élèves à ces questions. Cela ne se fait pas tout seul : là encore, les directrices d’école sont souvent des directeurs, et nous devons encore travailler pour faire évoluer le niveau d’encadrement féminin dans le champ de l’enseignement supérieur culturel.
J’ai aussi été sensible à la question du harcèlement à caractère sexuel dans les écoles d’art, que vous avez soulevée dans votre rapport. Pour celles qui dépendent du ministère de la culture, je demanderai qu’un état des lieux soit effectué. Jusqu’à présent, sauf quelques cas très spécifiques, je n’avais pas eu de remontées particulières d’informations, mais vous pouvez compter sur moi pour porter une attention toute particulière à ce sujet, madame la sénatrice.
La représentation des femmes passe aussi, bien sûr, par la dimension symbolique. Nous sommes dans le champ culturel et je me félicite, moi aussi, des grandes lignes des conclusions du rapport remis par Philippe Bélaval au Président de la République sur la nécessité de faire entrer des femmes au Panthéon afin de reconnaître à leur juste valeur leurs parcours exceptionnels de combattante, de citoyenne ou d’héroïne de la Résistance.
Toutefois, il est vrai aussi que certaines femmes artistes ont énormément apporté à notre pays. Je pense notamment à Marguerite Yourcenar, première femme à l’Académie française, à Marguerite Duras, à Simone de Beauvoir, ou encore à Joséphine Baker, une femme intelligente, courageuse, engagée dans la Résistance, mais dont la carrière de danseuse ne manquerait pas de provoquer un petit émoi si elle devait être honorée – voilà encore une autre forme de discrimination…
Quoi qu’il en soit, les exemples de femmes brillantes qui auraient toute leur place au Panthéon ne manquent pas.
Depuis six mois, nous avons défini les leviers qui nous permettront de faire évoluer la situation. J’ai concentré mon action et celle de mon ministère sur plusieurs aspects.
Tout d’abord, les contrats liant le ministère aux différentes institutions définiront désormais des clauses de promotion de l'égalité – en termes de nominations, de rémunérations, mais également de place des femmes dans les programmations, et ce dans le respect de la liberté de programmation. Ce sera la même chose pour les médias publics, lors du renouvellement des contrats d’objectifs et de moyens.
Dans le cadre d’une « saison égalité », un courrier a été envoyé aux dirigeants des 270 institutions culturelles dans le secteur du spectacle vivant, pour les inciter à inverser la tendance en donnant une plus juste place à toutes les femmes artistes dans la programmation comme dans la répartition des moyens de production. Une nouvelle fois, tout cela se fait dans le respect de la liberté de programmation des établissements – qui doit être un principe intangible.
Concernant la promotion des femmes dans les postes de direction, j’ai mené une politique de nominations dynamique.
Je remercie Maryvonne Blondin d’en avoir rappelé les principes.
Françoise Laborde a évoqué la nomination d’Irina Brook à la tête du Centre national dramatique de Nice. Toutefois, ce n’est pas la seule femme que j’ai nommée.
Je suis partie du même constat que vous : 90% des dirigeants sont des hommes. Face à ce qu'il convient d'appeler un blocage institutionnel, j'ai voulu impulser un mouvement, que je poursuivrai, pour favoriser le renouvellement à la tête de nos institutions.
Pour répondre au sénateur Jacques Legendre, concernant cette politique de nominations, je n’ai pas fait sortir les hommes pour nommer des femmes. Il y avait des règles concernant notamment le nombre de mandats successifs que pouvaient occuper des dirigeants d’établissement.
À leur arrivée en fin de mandat, j’ai clairement annoncé que le moment était venu de faire appliquer les règles, car les règles doivent être les mêmes pour tout le monde et sur tout le territoire de la République. Après tout, on nous demande à nous, élus, d’avoir des limitations en ce qui concerne le cumul des mandats. Cela peut aussi s’appliquer aux établissements publics, en tout cas à ceux du ministère de la culture.
Ces décisions ne remettent pas en cause le talent artistique de ceux qui étaient à la tête des établissements. En l’occurrence, seules leurs fonctions de direction d’établissement étaient concernées, et non pas leur capacité à produire ou à créer.
Au contraire, ceux qui ne sont plus directeur d’établissement seront accompagnés, en termes de subventions, pour le retour en compagnie.
J’ai souhaité que ces nominations soient l’occasion d’un renouvellement. Celui-ci doit se faire en incitant à une meilleure présence des femmes à la tête des établissements.
J’ai donc d’abord, dès le début de l’année, envoyé aux préfets et aux DRAC une circulaire demandant que l'on tende vers la parité dans la composition des jurys de sélection des candidats aux postes de dirigeants des institutions dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques, et que les listes restreintes de candidats établies par ces jurys soient également paritaires, ou en tout cas tendent vers la parité – il y a, en général quatre candidats sur ces listes restreintes.
Les résultats ont été extrêmement positifs et parlants : le simple fait d'avoir institué des commissions de sélection elles-mêmes paritaires – et que cela se sache – a permis de susciter plus de 50 % de candidatures féminines, contre moins de 20 % auparavant.
Nous évoquons des blocages psychologiques, la timidité ou la sous-évaluation de soi-même qu’ont les femmes, mais des mécanismes institutionnels permettent de lever ces blocages.
Ainsi, nous avons pu nommer Irina Brook au Théâtre national de Nice.
Plus généralement, depuis mon arrivée au ministère de la culture, j’ai eu à nommer neuf dirigeants de Centres dramatiques nationaux.
Sur ces neuf nominations, quatre femmes ont été nommées. Je nommerai bientôt une dixième personne : il y aura alors cinq hommes et cinq femmes.
La parité est atteinte sans que je n’aie jamais in fine fait prévaloir le critère du sexe. C’est simplement sur la qualité des projets présentés, sur la détermination et la volonté des candidates que j’ai pris mes décisions. D’ailleurs, elles ont souvent affirmé que la présence de femmes – à parité – dans les commissions et la volonté affirmée de reconnaître une plus juste place aux femmes leur avait donné cette confiance dont on leur reproche de ne pas faire suffisamment preuve.
Ces résultats sont encourageants.
De même, j’ai nommé six femmes directrice régionale des affaires culturelles. Cela permet de rééquilibrer progressivement la place des femmes parmi les dirigeants des services déconcentrés de l’État, pour ce qui concerne le ministère de la culture.
Par ailleurs, Sophie Makariou vient d’être nommée à la direction du Musée Guimet et Frédérique Bredin, à la tête du CNC.
Évidemment, cette politique a suscité des critiques, voire des polémiques. Mais c’est peut-être l’hommage du vice à la vertu – même si je ne veux pas m’arroger des valeurs comme celle-là.
Néanmoins, c’est le signe que les choses changent. Comme le disait Ariane Mnouchkine dans sa tribune dans Le Monde cet été, c’est le signe que lorsque les femmes arrivent quelque part, cela dérange.
Mme Maryvonne Blondin opine.
Tout d’un coup, lorsqu’on leur annonce qu’ils vont simplement être mis en juste concurrence avec des femmes talentueuses et compétentes, cela dérange les situations acquises.
C’est le changement qui est en marche.
C’est le moment des actes qui est venu.
Par ailleurs, j’ai souhaité que mon administration soit exemplaire. J’ai évoqué les nominations aux postes de DRAC – parce que l’égalité entre les femmes et les hommes doit commencer par le ministère et ses opérateurs.
Je souhaite que nous allions au-delà des objectifs de la loi Sauvadet.
En outre, j’ai pour ambition d'atteindre, le plus vite possible, la parité dans les conseils d'administration des opérateurs du ministère et les commissions consultatives dont je fixe la composition.
À cette fin, je m'engage devant vous à ce que, lors des renouvellements des personnalités qualifiées dans les conseils d’administration et dans les commissions consultatives du ministère, les nominations prennent pleinement en compte cet objectif d'arriver rapidement à la parité.
Pour cela, nous constituons des viviers exhaustifs dans tous les corps concernés par les postes de direction, en repérant les talents dans tous les domaines et en organisant, le cas échéant, des formations adaptées – qui peuvent d’ailleurs bénéficier aussi bien aux hommes qu’aux femmes.
Ces mesures répondent à un grand nombre de vos recommandations. Je voudrais revenir sur l'une d'elles en particulier : celle qui porte sur la signature d'une « charte pour l'égalité », qui engagerait les signataires à exercer une vigilance sur les stéréotypes, à favoriser la production des femmes et à veiller à une représentativité équilibrée des femmes dans les organigrammes.
Sachez qu'une Charte pour l'égalité hommes-femmes dans le secteur du cinéma vient d'être signée, le 10 octobre, au ministère de la culture et de la communication, avec la ministre des droits des femmes, en présence des deux premières signataires de la Charte : Frédérique Bredin, présidente du CNC, et Véronique Cayla, présidente d'Arte et marraine de l'association Le Deuxième Regard, à l'initiative de cette Charte.
Notre politique commence à porter ses fruits. Quelque chose est en train de bouger dans le paysage culturel français.
Je remercie Pierre Laurent de l’avoir rappelé : dans les prochains mois, va se poser la question des femmes dans les annexes VIII et X concernant l’indemnisation du chômage pour les intermittents du spectacle.
La question des « matermittentes » – c’est un assez joli mot pour une réalité souvent dure pour ces femmes – doit être spécifiquement prise en compte. J’y veillerai particulièrement. C’est un enjeu prioritaire, qui doit faire l’objet d’un traitement à part entière.
Enfin, il est aujourd’hui inadmissible que la France réserve encore à certaines femmes le sort que l'histoire a réservé à celles qui ont écrit certaines des plus belles pages de notre littérature ou de notre histoire.
On se souvient toujours d’Elsa Triolet en l’associant à Louis Aragon – ils formaient évidemment un très beau couple, littéraire et personnel. Mais elle était également un écrivain d’immense talent récompensé par le prix Goncourt. C’était une femme de conviction ; elle s’est battue pour la lecture publique. Je suis heureuse d’avoir inauguré très récemment, dans ma circonscription, en Moselle, une bibliothèque médiathèque théâtre nommée la Maison d’Elsa.
Dans ses Fragments autobiographiques, Elsa Triolet consignait ces mots : « Les femmes, c'est l'avenir du monde. Leur force n'est pas découverte, mais est-ce que l'électricité a toujours été connue ? Elle remuera encore des montagnes, cette force. »
Pour conclure, les femmes c’est la culture et l’électricité. C’est une force qui remue les montagnes. Ne permettons pas qu’elle demeure invisible. Il y va de l’avenir du monde. §

Nous en avons terminé avec le débat sur la place des femmes dans l’art et la culture.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 17 octobre 2013 :
À neuf heures trente :
1. Débat sur la protection des données personnelles.
À quinze heures :
2. Questions d’actualité au Gouvernement.
À seize heures quinze et le soir :
3. Débat sur le marché du médicament et des produits de santé.
4. Conclusions des commissions mixtes paritaires sur le projet de loi et le projet de loi organique relatifs à l’indépendance de l’audiovisuel public ;
Rapports de M. David Assouline, rapporteur pour le Sénat (nos 74 et 72, 2013-2014) ;
Textes des commissions mixtes paritaires (nos 75 et 73, 2013-2014).
5. Conclusions des commissions mixtes paritaires sur le projet de loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et sur le projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer ;
Rapport de Mme Catherine Tasca, rapporteur pour le Sénat (n° 57, 2013-2014) ;
Textes des commissions mixtes paritaires (nos 59 et 58, 2013-2014).
6. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens ;
Rapport de M. Hugues Portelli, rapporteur pour le Sénat (n° 63, 2013-2014) ;
Texte de la commission mixte paritaire (n° 64, 2013-2014).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures quinze.