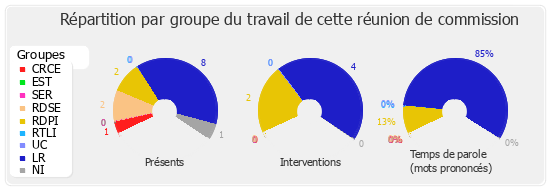Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation
Réunion du 26 février 2014 : 2ème réunion
Sommaire
- Désignation d'un rapporteur (voir le dossier)
- Mise en oeuvre de la nouvelle doctrine de l'état actionnaire
- Audition de m. david azéma commissaire aux participations de l'état directeur général de l'agence des participations de l'état (voir le dossier)
- Mécanisme de résolution unique : nouvelle étape de l'union bancaire
La réunion
Au cours d'une première réunion, la commission nomme tout d'abord M. François Marc rapporteur sur la proposition de loi n° 385 (2013-2014) de M. Christian Eckert, relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence.

En raison de la proximité de cette proposition de loi et de celle de notre collègue Hervé Maurey visant à renforcer la protection des épargnants, titulaires ou bénéficiaires de contrats d'assurance-vie et d'avoirs bancaires, dont François Marc est également le rapporteur, je vous propose que l'examen du texte d'Hervé Maurey puisse être joint à celui du texte de Christian Eckert, déjà inscrit à l'ordre du jour du Sénat. Le 9 avril, notre rapporteur présenterait un rapport unique et nous élaborerions le texte à soumettre à l'examen en séance, prévu le 16 avril.
Il en est ainsi décidé.
Puis la commission procède à l'audition de M. David Azema, commissaire aux participations de l'État, directeur général de l'Agence des participations de l'État, sur la mise en oeuvre de la nouvelle doctrine de l'État actionnaire.

Certains ici se souviennent de la naissance, à la direction générale du Trésor, de l'Agence des participations de l'État (APE), qui visait à professionnaliser la fonction d'actionnaire au sein de l'État. Je me souviens avoir signé, avec Jean Arthuis et Claude Belot, un rapport sur les ambigüités de l'État actionnaire, thème de toujours qui rebondit à travers les vicissitudes politiques.
Nous entendons ce matin David Azéma, qui nous expliquera la nouvelle doctrine de l'État actionnaire. Comment l'État actionnaire s'incarne-t-il, comment prépare-t-il son travail, comment donne-t-il une impulsion stratégique aux entreprises françaises concernées ? Sur ces questions de la doctrine, il y a eu, en moins d'un an, deux communications en conseil des ministres, la dernière en date du 15 janvier, émanant de Pierre Moscovici et Arnaud Montebourg.
L'Agence des participations de l'État (APE) est en charge de la gestion des participations de l'État, qui peuvent être majoritaires ou minoritaires, mais la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ne fait pas partie de son périmètre, en vertu d'une tradition qui n'est sans doute pas très rationnelle mais demeure constante dans la technostructure étatique.
Si j'évoque une nouvelle doctrine, c'est au regard de l'alternance politique. Sans doute le dossier Peugeot peut-il être l'occasion d'une illustration, puisque ce sera la première prise de participation industrielle significative de l'État depuis plusieurs années. Cette démarche est-elle comparable à celle qui avait guidé la puissance publique dans le dossier Alstom, en 2004, lorsque l'État était intervenu pour crédibiliser l'entreprise, et en était, quelque temps après, sorti avec une plus-value ? Ou s'agit-il d'une toute autre démarche ?
Le Parlement a voté, à la fin de l'année dernière, une habilitation à procéder par ordonnance à une rationalisation du droit applicable à l'État actionnaire. Vous savez combien nous sommes traditionnellement méfiants à l'encontre de cette procédure, par laquelle nous nous voyons dépossédés de nos prérogatives de législateur. Quels éléments sont-ils susceptibles d'être touchés par ce projet d'ordonnance ?
Afin de lever toute ambiguïté, j'ajoute une question sur les commentaires récents que l'on a pu lire dans la presse au sujet de vos projets personnels. Pouvez-vous nous rappeler la teneur de la clarification à laquelle vous avez procédé ?
Je suis un agent public, mais pas un haut fonctionnaire, puisque j'ai quitté la fonction publique il y a plusieurs années. Je me destinais à exercer mes fonctions exclusivement dans l'entreprise, que celle-ci soit privée ou publique. J'ai été, à ma grande surprise, sollicité pour exercer les fonctions que j'occupe aujourd'hui. Quittant l'entreprise Kéolis que j'avais rejointe huit semaines seulement auparavant, je les ai acceptées, en signant un contrat de droit public à durée déterminée. Ma vocation future est de retourner, si possible, dans le monde de l'entreprise. La presse ayant écrit que je serais candidat à des fonctions au sein d'une entreprise privée, j'ai fait une déclaration très courte et très pesée à l'agence Reuters, dans laquelle j'indique qu'il n'y a pas eu de sollicitation ferme de la part de cette entreprise à mon égard. En l'absence de poste, je ne suis pas candidat et n'ai donc pas déposé de dossier devant la commission de déontologie. Le reste relève de spéculations.
Cette clarification posée, je vous exposerai brièvement ce que sont les éléments de doctrine sur lesquels vous m'avez interrogé, et les mettrai en perspective, pour montrer qu'ils sont en continuité avec l'ambition qui a présidé à la création de l'APE, il y a dix ans.
Lorsque je suis entré en fonction, le 1er septembre 2012, un rapport de l'Inspection générale des finances venait d'être publié en juillet, qui dressait un bilan du fonctionnement de l'Agence qui, sans mettre en cause ni ses finalités ni son fonctionnement, soulignait certaines faiblesses. Nous nous sommes alors livrés à une tâche de réflexion pour améliorer le fonctionnement de l'État actionnaire, et avons cherché à y répondre en trois étapes.
Il s'agissait, tout d'abord, de clarifier le pourquoi de notre mission. Nous nous sommes rendu compte que la doctrine de l'État actionnaire était plus implicite qu'explicite. Nous gérions « en bon père de famille », un portefeuille hérité du passé, sans être très au clair sur nos orientations. D'où la réflexion à laquelle nous nous sommes attelés, et qui a donné lieu aux deux communications en conseil des ministres que vous avez évoquées.
Nous nous sommes demandé, ensuite, si les textes encadrant notre action étaient adaptés. Il est apparu que ces textes résultent d'une longue et lente stratification de dispositions difficiles à utiliser en pratique et qui consomment beaucoup de temps pour des résultats minimes. Nous avons donc entrepris de procéder à un toilettage.
Nous nous sommes, enfin, attelés à revoir notre mode d'organisation, nos principes de fonctionnement, nos règles de management, pour plus d'efficacité dans le suivi et le dialogue stratégique avec les entreprises.
En quoi consiste notre doctrine ? Nous assumons clairement, tout d'abord, qu'il est légitime pour l'État d'intervenir en fonds propres dans les entreprises, selon un niveau de participation et un horizon temporel qui peuvent être variables. Une telle démarche est parfaitement légitime et ne relève pas, pour nous, d'une erreur historique qu'il s'agirait de corriger en vendant tout le plus vite possible.
Quels motifs peuvent justifier que l'on mobilise une part du patrimoine public pour l'investir dans des entreprises ? Nous avons retenu quatre grands principes.
Le premier veut que l'État s'ancre au sein des entreprises structurellement stratégiques. Deux domaines répondent, pour nous, à cette définition, étant entendu que ces choix pourront toujours être revisités par le futur comité stratégique de l'État actionnaire : l'industrie nucléaire, d'une part, autour de ses deux acteurs principaux que sont EDF, l'opérateur, qui exploite 58 tranches nucléaires en France et doit en lancer deux nouvelles en Grande Bretagne, et Areva, industriel majeur de la filière ; les industries de défense, d'autre part, dans lesquelles la part du capital détenu par l'État est variable : il est présent dans Airbus Group, Thalès, Safran, DCNS, Nexter, toutes les grandes entreprises de défense à l'exception de Dassault Aviation - dont je rappelle cependant que 46 % du capital est détenu par Airbus Group avec lequel l'État est entré dans un pacte d'actionnaires à ce sujet, suite à l'achat, par l'Etat, d'une action de Dassault Aviation.
Le deuxième principe, produit de l'évolution historique de l'actionnariat public, veut que l'État soit présent dans les entreprises qui fournissent au pays des services essentiels - c'est volontairement que je n'use pas du terme de services publics, juridiquement plus restrictif. Il peut arriver que ces entreprises soient issues du secteur public, voire de l'État lui-même, comme Orange et La Poste. Il est légitime que l'État y soit actionnaire, et d'autant plus qu'il s'agit de secteurs peu ouverts à la concurrence, donc où existent peu d'offres alternatives. Le niveau de participation est ainsi variable, allant de 100 % d'actionnariat public pour La Poste à moins de 30 % pour Orange et 36 % pour GDF Suez, le niveau de participation s'appréciant au cas par cas.
Le troisième principe, le plus novateur, vise à accompagner le développement et la consolidation d'entreprises dans les secteurs et filières déterminants pour la croissance. La participation de l'État peut s'y décliner au niveau de l'APE, mais aussi via Bpifrance participations, qui entre au capital des entreprises, avec un horizon de détention limité, pour accompagner une phase de croissance internationale ou une phase de consolidation avec d'autres acteurs du secteur. Je pense, par exemple, aux entreprises de biotechnologie. Cette logique, qui était au coeur de la création du Fonds stratégique d'investissement, peut aussi exister au niveau de l'État. C'est elle qui a guidé l'opération PSA. L'entreprise était en phase de reconfiguration de son actionnariat qui, jusqu'à présent familial, va devenir ouvert, avec l'entrée d'un partenaire étranger. L'État s'associe à l'opération pour assurer l'ancrage de l'entreprise en France. Vous avez évoqué le précédent d'Alstom, mais pour PSA, l'horizon de sortie ne peut être aujourd'hui déterminé : l'État reverra sa présence quand il sera absolument convaincu que le futur stratégique de l'entreprise est assuré, que son développement est garanti, que son succès est sur les rails. J'ajoute que d'un point de vue strictement patrimonial - mais vous avez compris que ce n'est pas le seul angle d'examen de l'APE - c'est une diversification de portefeuille intéressante, dans un secteur où nous sommes peu présents. Ce n'est donc pas un mauvais calcul.
Le quatrième principe, enfin, le plus spectaculaire, bien que le moins important en termes d'occurences, tend à assurer le sauvetage d'entreprises après approbation de la Commission européenne, comme ce fut le cas pour Dexia, dès lors qu'une défaillance comporterait un risque systémique. C'est, certes, un moyen d'action hors norme, mais dont l'État ne saurait se priver dès lors qu'il est conforme aux traités communautaires.
J'ai évoqué l'entrée au capital de PSA, qui répond au troisième principe, mais l'État est également présent dans Renault, à hauteur de 15 %. Vous me direz que l'entreprise se porte de mieux en mieux ; mais elle n'est pas au bout, stratégiquement, de ses différentes étapes de développement. Les formes de l'alliance avec Nissan ne sont pas totalement abouties. Nous demeurons donc au capital, tant que cette hypothèque n'est pas levée. Même chose pour Air France, que la présence de l'État stabilise, lui évitant d'être prise pour cible d'une OPA et lui permettant de traverser sereinement cette période difficile. On se donne beaucoup de mal pour constituer des noyaux durs : l'État joue aussi ce rôle de stabilisation du capital.
Cela étant, la prise de participations n'épuise pas l'ensemble des relations que peut avoir l'État avec les entreprises : l'État actionnaire ne porte pas l'ensemble des politiques publiques. L'État est présent en fonds propres mais les administrateurs, même s'ils sont nommés par lui, sont administrateurs de l'entreprise. C'est le commissaire du Gouvernement qui vient porter les autres éléments de la parole publique. Cette distinction est importante, elle évite toute accusation de schizophrénie de la part de nos interlocuteurs au sein des conseils d'administration. L'État actionnaire apporte les fonds et noue le dialogue stratégique, mais la fonction de régulation doit être portée par d'autres. Car le régulateur peut prendre des décisions qui ne favorisent pas nécessairement les actionnaires, dont l'État. Dura lex, sed lex. L'État actionnaire invite évidemment l'entreprise à ne pas se soustraire à ses obligations, mais la régulation est autre chose.

Merci d'avoir souligné combien il est indispensable d'incarner l'État actionnaire, qui doit s'organiser comme un actionnaire. C'est sur le fondement de ce principe qu'a été créée, du temps que Francis Mer était ministre des finances, l'Agence des participations de l'État, qui s'est peu à peu dotée de procédures, notamment pour désigner ses administrateurs, qui sont vos yeux et vos oreilles au sein des organes stratégiques des entreprises où l'État possède une participation.

Merci de cette clarification sur des dossiers qui ont occupé, ces derniers mois, le devant de la scène. Pour PSA, nous avons bien compris l'esprit et la logique de l'intervention. Reste que le fait que DongFeng soit le seul investisseur privé n'est pas sans risques. Des conditions ont-elles été posées par cet investisseur ? La participation de l'État doit-elle être validée par la Commission européenne au titre des aides d'État ? Le recours de l'ADAM, l'Association des actionnaires minoritaires, pourrait-il créer une menace sur l'opération ? Vous nous dites que l'État a vocation à rester au capital tant que le succès n'est pas assuré, et que cela vaut aussi pour Renault. Comment gérer cette participation dans deux constructeurs automobile nécessairement en concurrence ? Les administrateurs seront-ils clairement distincts ?
Nicolas Dufourcq, directeur général de la BPI, nous disait, la semaine dernière, que l'opération Peugeot aurait très bien pu être réalisée par cette entité, mais que ce n'était pas la volonté de l'État chinois. Comment tracez-vous la frontière entre les doctrines d'intervention de l'APE et de la BPI ? L'opération aurait-elle dû être menée, à votre sens, par la BPI ?
Autre sujet de préoccupation, qui ne date pas d'hier, la rémunération des dirigeants d'entreprise. Comment expliquer que l'État actionnaire ait accepté dans un premier temps l'augmentation de celle des membres du comité de direction de Dexia ? Quel bilan faites-vous des règles relatives à la limitation à 450 000 euros par an de la rémunération des dirigeants, en vigueur depuis 2012 ? Avez-vous obtenu des progrès en la matière dans les entreprises où l'État n'est pas majoritaire ?
Arnaud Montebourg a évoqué la création d'une compagnie nationale des mines de France, dotée de 400 millions d'euros d'ici cinq à sept ans. Quel serait le modèle économique de cette compagnie ? Le montant de l'investissement annoncé n'est-il pas faible compte tenu de l'intensité capitalistique de cette activité ? Pourquoi Areva et Eramet n'ont-ils pas souhaité rejoindre le projet ?

L'État a cédé, en début d'année, 1,1 % d'Airbus. Cette cession était-elle déjà prévue l'an dernier dans le cadre de la reconfiguration de l'actionnariat et si tel est le cas, pourquoi intervient-elle maintenant ?
Vous avez indiqué les quatre grands principes présidant à la prise de participation de l'État. Mais quid des cessions ? Comment la nouvelle doctrine se traduit-elle en pratique ? Quel bilan pour 2013 et quelles perspectives pour 2014 pour le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État », tant en recettes qu'en dépenses ? Le comité stratégique de l'État actionnaire est-il en place et si tel est le cas, qu'en attendez-vous concrètement ?

Notre commission a demandé à la Cour des comptes de conduire une enquête sur le recours aux consultants extérieurs - banques d'affaires, avocats, experts - par l'État. Cela peut concerner l'APE. C'est une information que je voulais vous délivrer.
Comment pratiquerez-vous le « say on pay », soit la pratique consistant à demander un vote en assemblée générale sur les rémunérations des cadres dirigeants ?
La SNCM (Société Nationale Corse Méditerranée) est une petite société mais très coûteuse. N'est-ce pas de l'acharnement thérapeutique ?
Il s'agit d'une participation croisée entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations, l'État détenant 25 %, et Transdev, filiale de Véolia et de la Caisse des dépôts, 66 %, cette dernière indiquant qu'elle va investir davantage dans Transdev. Du point de vue de l'Etat actionnaire, comment peut-on faire la part entre ce qui est porté par l'Etat et par la Caisse des dépôts ? Cette dualité n'est pas nouvelle, mais comment rétablir la cohérence dans le partage ?
Jean-Claude Frécon m'a interrogé, à juste titre, sur les cessions. L'État n'est pas assez riche pour imaginer investir sans désinvestir. Cela suppose des arbitrages entre ses positions, notre portefeuille ne devant pas croître en valeur. N'oublions pas non plus que la LOLF, la loi organique relative aux lois de finances, prévoit l'affectation d'une partie des cessions au désendettement. Le Gouvernement ne va pas nous abonder en fonds budgétaire pour que nous investissions en fonds propres. L'entrée au capital d'une entreprise suppose donc bien d'avoir dégagé des ressources par cession de participations dans d'autres entreprises.
Ceci rejoint la question du niveau de participation au regard des objectifs stratégiques. Nous devons viser un rendement stratégique optimal de chaque euro public investi. Par exemple, notre objectif stratégique chez Airbus Group est que nul ne puisse mener une opération de prise de contrôle hostile du groupe, ce qui est assuré par une clause statutaire qui interdit une participation au capital supérieure à 15 %. Or, les statuts peuvent être modifiés par une assemblée générale, ce qui nous oblige donc à veiller à ce que la majorité qualifiée permettant cette modification ne puisse pas être atteinte. Il faut pour cela constituer un bloc défensif et concertant avec les Allemands, à 11 %, et les Espagnols, à 4 %, qui, ajoutés aux 11 % détenus par la France, permettent de tenir la ligne. Dès lors, pourquoi conserver 1 % de plus du capital, qui représente pas loin de 500 millions d'euros ? L'année dernière, nous n'avions pas nécessairement identifié que nous pourrions descendre notre participation à 11 % et nous nous étions fixés une cible à 12,12 %. Il se trouve de surcroît que le fait d'avoir cédé par étapes nous a permis de bénéficier du relèvement du cours lié à la restructuration de la gouvernance et, bien sûr, les résultats industriels d'Airbus Group. Nous avons arbitré une exposition « excessive » dans l'entreprise, pour récupérer des ressources qui pourront être réutilisées soit pour le désendettement de l'Etat, par exemple pour refinancer des programmes d'investissement d'avenir portés par le Commissariat général à l'investissement, soit pour réinvestir dans le capital d'autres entreprises, telle que PSA.
Nous observons les entreprises, nous nous forgeons une opinion sur le bon niveau de participation et nous adressons des recommandations, mais c'est le Gouvernement qui décide.
Dans l'opérations PSA, nous ne sommes pas les seuls, avec DongFeng, à accompagner l'augmentation du capital. Il fut il est vrai un temps envisagé, courant 2013, une augmentation de capital intégralement souscrite par DongFeng et l'État français. Les résultats de l'entreprise, l'arrivée de Carlos Tavares, l'existence d'un projet industriel commun entre DongFeng et Peugeot, la situation globale du marché ont permis, fin 2013, de rouvrir une hypothèse d'opération de marché, avec émission de droits préférentiels de souscription (DPS) pour les actionnaires. C'est le dispositif que nous avons retenu in fine. L'augmentation de capital réservée est de 1 milliard d'euros, partagée entre DongFeng et l'APE, à l'issue de quoi, des DPS seront distribués aux actionnaires, qui pourront soit souscrire de nouvelles actions, soit les céder à d'autres qui pourront souscrire à leur place. Les banquiers conseils des différents acteurs sont confiants dans la réussite de cette opération.
Les deux actionnaires entrants auront souscrit pour 500 millions d'euros dans l'opération réservée et se sont engagés à exercer leur DPS, ce qui porte l'engagement de chacun à 800 millions d'euros. La famille s'est engagée à exercer un nombre de DPS suffisant pour se recaler à 14 % du capital, au même niveau que les deux autres actionnaires stratégiques. Les engagements - les montants que je cite sont approximatifs - sécurisent ainsi 1,8 milliard d'euros sur les 3 milliards d'euros à lever ; le restant, 1,2 milliard d'euros, sera souscrit par une pluralité d'investisseurs. C'est un élément qui nous a permis de considérer que nous n'agissions pas sous le régime des aides d'Etat : c'est une opération normale d'un investisseur avisé. Nous avons porté notre analyse à la Commission européenne, qui considère que l'opération ne justifie pas une notification au titre des aides d'État.
Y a-t-il eu demande de contreparties ? Ce n'est pas le propre de l'opération en capital. Les ministères concernés sont, évidemment, aux premières loges des opérations industrielles et de restructuration au sein du groupe, et veillent à la préservation des intérêts nationaux. Cela s'est fait, se fait, se fera, comme je m'en suis expliqué tout à l'heure, indépendamment de la présence au capital. En tant qu'Etat investisseur, nous ne faisons qu'apporter du capital et nos co-investisseurs ne l'auraient pas compris autrement. Nos demandes étaient d'ailleurs les mêmes que leurs : une représentation au conseil, l'établissement d'un certain nombre de principes dans la gouvernance et puis c'est tout.
Il n'y aura pas un concert de contrôle, mais trois actionnaires de poids qui s'équilibrent. Ils peuvent d'ailleurs n'être pas toujours d'accord, et je pressens, au demeurant, une divergence de vues possible sur la rémunération des dirigeants, car les positions et doctrines de l'État français peuvent entrer en conflit avec celles d'autres investisseurs... Nous ne nous sommes pas engagés à rechercher un consensus entre les trois actionnaires stratégiques.
Je n'ai pas connaissance d'un recours et d'ailleurs, il n'existe pas d'acte, aujourd'hui, qui pourrait donner lieu à l'engagement d'un contentieux.
Notre présence concomitante dans PSA et Renault ? Mais c'est le cas de bien des investisseurs que d'être présents dans des entreprises concurrentes. Nous avons aussi, concomitamment, 84 % d'EDF et 36 % de GDF Suez, qui se vivent comme deux grands concurrents. La RATP et la SNCF, de même, sont deux établissements publics détenus à 100 % par la puissance publique. Nous nous sommes bien sûr donné des règles pour nous garder de tout mélange des genres : jamais un même administrateur dans deux entités concurrentes, jamais d'informations communiquées de l'un à l'autre. En revanche, outre que c'est une bonne chose pour l'État que d'avoir une compréhension de l'intérieur de certains secteurs, nous devons tirer bénéfice de notre présence dans plusieurs entreprises d'un même secteur pour faire remonter certaines préoccupations - je pense notamment à la politique de l'énergie.
Vous m'interrogez sur le partage des tâches entre l'APE et Bpifrance. Il y a un continuum dans notre action : nous ne sommes pas en rivalité ou en concurrence mais bien complémentaires. Nous possédons 50 % de Bpifrance, au conseil d'administration de laquelle je siège. Nous nous partageons les rôles au service de la politique actionnariale de l'État. Pour PSA - dossier complexe dans sa dynamique de négociation -, nos interlocuteurs chinois n'étaient pas entrés dans le détail de l'actionnariat public français, mais il nous a semblé qu'il serait préférable de négocier au niveau de l'APE, compte tenu de la conception chinoise des affaires, qui a coutume de remonter au niveau gouvernemental...
Si nous faisions entrer la Caisse des dépôts dans le périmètre de l'APE, Bpifrance serait à 100 % à l'État. La Caisse des dépôts est certes une entité publique, avec les mêmes considérations d'intérêt général que nous, mais nous restons bien distincts, y compris en termes de tutelle puisque seule la direction générale du Trésor est représentée à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts. Pour nous, la Caisse des dépôts est un organisme tiers, avec sa propre gouvernance. Reste que, du point de vue des autorités boursières étrangères, la Caisse des dépôts, c'est l'État. On l'a constaté sur le dossier EADS. D'où notre préoccupation de toujours veiller à consolider nos participations, pour ne pas franchir, dans des entreprises étrangères, les seuils d'offre publique obligatoires. C'est un impératif car notre lecture, héritée du XIXe siècle, n'est pas forcément celle de nos interlocuteurs étrangers.
J'en viens à la question de la rémunération - celle des dirigeants mandataires sociaux, sachant que les non mandataires ont un contrat de travail qui ne peut être défait par injonction gouvernementale. Dans les entreprises dont nous contrôlons le capital, le décret qui plafonne la rémunération, tous éléments confondus, à 450 000 euros, a été appliqué par anticipation au 1er octobre 2012 à tous les dirigeants mandataires sociaux. Dans les entreprises où notre participation est minoritaire, nous ne sommes souvent pas en mesure, ni dans les conseils d'administration, ni en assemblée générale, d'imposer nos vues. Nous avons néanmoins essayé de formaliser des principes à l'occasion du vote sur le « say on pay », cette disposition du code AFEP-MEDEF de gouvernement d'entreprise, dont les dispositions ont été reprises par 99 % des entreprises présentes dans le portefeuille de l'État, qui présenteront les rémunérations 2013 de leurs mandataires à leur assemblée générale, laquelle émettra un vote indicatif. Ce vote reste certes sans conséquences juridiques, mais la bonne pratique veut que, si les actionnaires manifestent leur désapprobation, le conseil d'administration doit se réunir pour en tirer les conséquences.
L'État a communiqué, en amont, sa position aux entreprises. Les niveaux de rémunération atteints par le passé méritent d'être reconsidérés et un effort de réduction de l'ordre de 30 %, par rapport à 2012 serait bienvenu. Il devrait, de même, être mis fin aux actions de performance et aux stock-options, ainsi qu'aux retraites chapeau, et les indemnités de rupture nouvellement décidées ne devraient pas être supérieures à douze mois de rémunération. Cette position déterminera notre vote sur le « say on pay » 2013.
Je ne suis pas en mesure, à ce jour, de fournir un bilan complet du compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État ». En tout état de cause, nous sommes convenus de produire notre rapport sur l'État actionnaire non plus en octobre mais dès juillet, pour éviter un décalage excessif dans le temps.
Le comité stratégique de l'État actionnaire est en cours de constitution - les ministres étudient diverses propositions. Il sera composé d'agents publics, de fonctionnaires et de représentants de la société civile. Ce sera, pour l'APE, l'équivalent d'un conseil d'administration, dans sa fonction non d'administration mais de réflexion et de débat. Il est bon d'échanger de bonne foi avec un aréopage de personnes compétentes pour orienter la décision.

Je vous remercie pour la clarté et la précision de vos propos. Comme Dominique de Legge et Jean-Claude Frécon, j'ai bien conscience que l'État doit être présent dans nos industries de défense. Sur les ventes d'armes, nous avons trois grands concurrents, les États-Unis, la Grande Bretagne et la Russie. Qu'elle est leur attitude à l'égard de leurs entreprises de défense ?

Vous avez cité l'adage Dura lex, sed lex, mais puisqu'il est question de l'accompagnement de l'État, je saisis l'occasion pour observer qu'il n'est guère notable pour l'entreprise Duralex, à Orléans, à qui l'on met plutôt des bâtons dans les roues...
Je m'interroge sur le projet de compagnie nationale des mines : la réflexion semble laisser de côté le nickel de Nouvelle-Calédonie. Il y a de quoi être surpris.

Vous arbitrez au sein d'une enveloppe globale, avez-vous indiqué. Pouvez-vous nous rappeler à quel montant elle est évaluée - à comparer avec celui de notre endettement ?
Je m'interroge sur ce qu'il faut entendre par État stratège, étant de tempérament libéral. Dans le dossier Alstom, l'État a sans nul doute été stratège. Sous le mandat de Nicolas Sarkozy, il a injecté 800 millions d'euros dans une entreprise menacée par des prises de position étrangères, investissement valorisé à plus de 2 milliards d'euros l'année suivante.
L'État doit être actionnaire dans nos entreprises de défense, soit. Mais il l'est encore pour 99 % dans Giat Industries, quand sa participation dans Safran ou Thalès ne dépasse pas 30 %. On a du mal à comprendre ces différences.
Comme pourrait le faire Charles Revet, je m'étonne que l'État soit encore actionnaire à 100 % de nos grands ports. Ne serait-il pas logique de les concéder aux chambres de commerce locales ?

Dans le bilan consolidé de l'État actionnaire, document dont le Parlement gagnerait à mieux tirer profit, les 14 % de PSA seront-ils inclus ?

La France s'écroule, l'État n'a plus les moyens d'assurer la sécurité, la justice, l'éducation, la solidarité, et l'on continue pourtant de raisonner comme il y a un siècle. L'État ne peut être actionnaire dans tout ! Pour la défense et le nucléaire, il y a un véritable enjeu stratégique ; mais doit-il être présent dans Renault, doit-il rester présent à 100 % de la RATP et de la SNCF ? J'ai l'impression que l'on raisonne comme au lendemain de la Seconde guerre mondiale. Je ne suis pas de l'école libérale, mais j'estime qu'il faut faire des choix. Au reste, les qualités de gestionnaires de l'État sont loin d'être au niveau de celles des actionnaires privés, parce que ses contraintes ne sont pas les mêmes.
J'ai connu, en Ile-de-France, une RATP et SNCF sous l'autorité absolue de l'État. On gère différemment aujourd'hui, dans un vrai dialogue. L'État ferait mieux de se concentrer sur ce qui touche à notre indépendance nationale. C'est un débat qui n'est d'ailleurs pas nouveau et existait déjà du temps du général de Gaulle. L'État ne peut se mêler de tout. On ne peut pas raisonner comme au temps des nationalisations de 1945. Se désengager de certains secteurs non prioritaires nous rendrait des marges de manoeuvre dans des domaines clé.

Comme Roger Karoutchi, je m'interroge. Vos préoccupations de bonne gestion ne sont pas celles des holdings anglosaxonnes, ni des konzern allemandes, dont la stratégie est à la fois financière et industrielle. Elle ne se rapproche pas non plus de la stratégie japonaise des années 1950-1960, qui consistait à prendre en main la totalité d'un secteur, comme l'électricité ou la photographie, pour le porter.
Nous savons que notre industrie souffre de faiblesses considérables et d'un manque de stratégie vieux de quarante ans. Le bicéphalisme entre APE et Caisse des dépôts et consignations n'arrange pas les choses. L'État est un actionnaire puissant d'EADS, qui possède 40 % de Dassault Aviation, mais le Rafale est en compétition avec l'Eurofighter. Où est la stratégie ? Il faut choisir de grands axes. Or, on a l'impression d'une extraordinaire dispersion.

Je ne partage pas le sentiment de Roger Karoutchi. Je n'oublie pas le discours de Nicolas Sarkozy, qui à Annecy, en 2008, insistait sur la nécessité de protéger les entreprises françaises, y compris au sein de l'Europe, et annonçait un plan anti OPA ainsi que la création d'un fonds public d'intervention de 175 milliards d'euros. Ce fut l'objet de discussions en Europe, les Allemands y étant opposés, d'autres favorables. François Baroin n'a-t-il pas dévoilé récemment qu'il avait été envisagé, du temps où il était ministre de l'économie, une nationalisation partielle du site de Florange ? Le sujet est actuel, il est loin d'être dépassé. Il y a eu, en France, des nationalisations punitives et des nationalisations colbertistes. Les prises de participations peuvent donner des réussites, on l'a vu avec Alstom.
La question est celle de la souveraineté industrielle, financière et politique d'un pays à l'intérieur de l'Union européenne. On est au-delà du débat sur l'État colbertiste ou prédateur. Le sujet est actuel, le résultat des élections européennes le montrera. Entre la nationalisation totale et le marché juste et parfait, on se rendra compte qu'un certain nombre de citoyens, libéraux ou pas, ont du mal à se retrouver.
Sur les grandes orientations, sur la défense ou le nucléaire, on a le plus grand mal, en Europe, à distinguer une ligne. Comment l'APE parvient-elle à s'orienter ? Voir le débat sur le nucléaire. Tout le monde est contre à la veille des élections, et une fois que c'est fini, on considère que l'on ne peut plus s'en passer.

J'ai souvenir d'un excellent ouvrage intitulé Adieu Colbert, où l'auteur, qui n'est autre que Yann Gaillard, posait cette question des stratégies souveraines.

L'État actionnaire est-il exemplaire ? Le législateur a voulu une féminisation des conseils d'administration des sociétés privées. L'APE respecte-t-elle ce principe lorsqu'elle désigne des administrateurs ? Ces derniers veillent-ils, dans leurs fonctions, à la question des écarts de rémunération entre personnels masculins et féminins ?
Sur la question des transports en Ile-de-France, il faudrait parler aussi de Réseau ferré de France (RFF) et de la société du Grand Paris (SGP) - dont la capitalisation à hauteur 4 milliards n'a pas eu lieu... Je voudrais comprendre les processus de décision. Vos préconisations sont-elles entendues ou les choix restent-ils purement ministériels ? Où est le plan stratégique en Île-de-France, quand quatre sociétés d'État y sont en concurrence ? Nous sommes une véritable exception en Europe ; nous restons le seul État européen où demeure - en Île-de-France - un monopole des transports publics.
Comment a été prise la décision de vendre une part significative d'Aéroports de Paris (ADP) ? Les collectivités territoriales concernées ont-elles été consultées ? Quid de la liaison Roissy-Charles de Gaulle-Paris ? Avez-vous émis des préconisations ? Approuvez-vous les décisions du gestionnaire ?
Quelles sont vos satisfactions et vos insatisfactions de gestionnaire d'État ? Comment jugez-vous vos participations dans les entreprises ? J'ai le sentiment que le processus de décision vous échappe.
Notre doctrine n'est pas colbertiste, consistant à créer des entreprises à 100 % publiques pour satisfaire les besoins du pays. Il ne s'agit pas non plus de nationaliser l'économie nationale. Nos positions sont proches de celles qu'on retenues la plupart des pays, à l'exception notable des États-Unis, du Japon et, sans doute, de la Grande Bretagne. L'État a intérêt à utiliser les interventions en fonds propres pour protéger les fleurons de son industrie contre les interventions hostiles mais aussi pour favoriser l'émergence de filières jugées stratégiques. Nous nous interdisons, cependant, à la différence de beaucoup de fonds souverains étrangers, d'investir en direct à l'étranger ; si les entreprises auxquelles nous participons le font, leur tête n'en reste pas moins en France - j'excepte Airbus Group, société plurinationale dont il a fallu choisir le siège dans un pays « neutre ».
Nous avons fait le travail de benchmarking. Partout, de l'Arabie saoudite à la Chine, se mènent des politiques d'intervention très stratégiques, partiellement par l'État, partiellement en bourse, et l'on met même en concurrence des entreprises publiques - la Chine a quatre entreprises de transport aérien sous capital public, six pour l'automobile. On y allie l'intervention publique en capital à un mode de gestion normal. C'est assez différent de ce que furent longtemps nos pratiques, dont on trouve la traduction institutionnelle dans les EPIC, directement sous tutelle de l'État. Par un abus de langage, et parce que ces EPIC cherchent de plus en plus à se gérer comme des entreprises, on assimile, dans notre portefeuille, des choux et des carottes - car il y a une vraie différence de nature entre un EPIC et une société anonyme à laquelle l'État participe aux côtés d'autres investisseurs. En 1967, déjà, le rapport Nora invitait à distinguer entre sociétés commerciales et EPIC.
Certes, notre portefeuille est hérité du passé, mais notre doctrine est héritière de la création de l'APE, en 2004. Cette doctrine peut être efficace, sachant qu'il faut la mettre en oeuvre en « investisseur avisé », pour reprendre les termes de la Commission européenne, et être capable d'arbitrer, pour se remettre à jour, car les priorités stratégiques d'hier ne sont pas forcément celles d'aujourd'hui. N'oublions pas, non plus, que nous ne sommes pas un centre de coûts mais de revenus : l'« usine APE » produit 4 milliards d'euros de dividendes par an, ce n'est pas rien. Est-il toujours urgent d'opérer des cessions sur des produits qui rapportent 4 % par an pour éviter de la dette qui coûte nettement moins ? S'il peut être utile de céder de beaux actifs pour faire face aux exigences du moment, il serait dommage de vendre l'intégralité des « bijoux de famille », alors que le vrai sujet, pour parler en entrepreneur, ce sont les dépenses d'exploitation et le solde d'exploitation.
Si le débat persiste quant à l'application in concreto de ces principes, nous estimons que la doctrine est durable, au-delà des alternances. A la différence des Américains, qui ne conçoivent pas que le nucléaire puisse être contrôlé par l'État, ou des Britanniques qui estiment qu'une action chez BAE suffit au Gouvernement pour atteindre ses objectifs stratégiques, les Français considèrent que la participation de l'État au nucléaire est légitime. Nous pouvons nous retrouver sur cette façon dont nos concitoyens appréhendent le sujet. Reste la question du niveau de participation. Pour Aéroports de Paris, nous avons agi conformément à notre doctrine : détenir 60 % plutôt que 51 % ne change rien quant à la maîtrise de la gouvernance ; les 9 % supplémentaires ne sont que patrimoniaux. Une part de la participation était détenue par Bpifrance ; nous sommes convenus de joindre nos pas, après avis de la Commission des participations et des transferts.
Sur les mines, l'annonce du ministre est d'intention politique. Le ministère du redressement productif, qui a la tutelle des mines, a jugé que la France ne disposait pas d'un acteur minier susceptible de valoriser nos compétences d'exploration. En matière minière, c'est l'exploitation et non l'exploration qui est gourmande en capitaux. Il s'agit bien de créer un véhicule minier français sur l'exploration en faisant levier sur les compétences, la réputation et la capacité du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). La position d'Areva-Mines et d'Eramet n'est pas tranchée, nous en sommes encore à un stade préliminaire. Le montant annoncé est-il suffisant ? Avec 400 millions d'euros, nous pouvons entretenir des équipes d'exploration de manière tout à fait raisonnable pendant plusieurs années jusqu'à ce que, après plusieurs essais infructueux, vous puissiez régénérer les capacités de financement de votre entreprise.
La valeur de notre enveloppe ? Une partie de notre portefeuille, côté en bourse, est facile à estimer, le reste l'est moins. L'an dernier, nous étions autour de 100 milliards d'euros, dont 60 côtés en bourse, qui valent aujourd'hui autour de 80 milliards d'euros, bien que nous ayons cédé 3,3 milliards d'euros d'actifs. C'est une enveloppe qui n'est pas négligeable.
L'endettement consolidé est significativement supérieur - EDF et GDF Suez, où les investissements sont lourds, le sont particulièrement - mais la valeur des entreprises est très au-dessus. Nous ne pouvons produire de comptes consolidés, car nous n'en avons pas : c'est qu'il n'existe pas un groupe « État ». C'est heureux, car les conséquences seraient difficiles à gérer en droit de la concurrence...

C'est l'hypocrisie européenne... En réalité, ce groupe existe bel et bien, mais on ne veut pas le révéler, pour des raisons formelles.
Nous sommes un conglomérat financier. Un bilan consolidé entre des entreprises aussi différentes que la RATP et Airbus Group n'a pas de sens. Et, pour tout dire, les comptes consolidés que l'on produit soigneusement tous les ans ne signifient rien !
Dans notre portefeuille, vingt entreprises pèsent pour plus de 80 % de la valeur. Il faut regarder entreprise par entreprise pour juger de la qualité du portefeuille. Mélanger EDF, entreprise très intensive en capital, et La Poste, intensive en main d'oeuvre qui, au surplus, en sont à des stades très différents de développement et de maturité, donne une moyenne qui ne signifie rien. Il faut donc lire nos état financiers - qui sont exacts - avec prudence. En la matière, la consolidation du portefeuille de l'Etat ne dit pas grand-chose.
La politique des transports en Île-de-France n'est pas de la responsabilité de l'APE... En tant qu'actionnaires, nous la subissons.
De même, Kéolis ou la RATP subiront les conséquences de la politique du Grand Londres, avec le retour en régie publique de ce qui était parti chez Crossrail. C'est une politique définie en partie par le STIF (Syndicats des transports d'Île-de-France) et en partie par l'État.
Quant à la société du Grand Paris, elle ne fait pas partie de notre périmètre d'intervention.

Ce n'est, du reste pas une société, mais un établissement public à caractère industriel et commercial.
Sur la féminisation, vous trouverez des chiffres dans notre rapport. La dynamique est conforme aux orientations définies par le Gouvernement. Le comité de la responsabilité sociale fait le point chaque année. Nous nous sommes dotés, pour la nomination d'administrateurs, d'un vivier sélectionné par un cabinet retenu sur appel d'offres, grâce auquel nous venons d'identifier une excellente administratrice pour Thalès.
L'ordonnance vise à éviter les scories d'un régime de tutelle venu se superposer au droit des sociétés. Un exemple : une fois que le comité des rémunération et le conseil d'administration se sont prononcés, à quoi bon demander une approbation ministérielle sur les rémunérations approuvées ? Nous devons éviter les redondances.
Nous souhaitons ainsi élargir notre capacité de nomination dans les conseils d'administration, en reconnaissant, comme la plupart des États étrangers, qu'il est important d'avoir des administrateurs qui pèsent au sein des conseils par leur expérience et leur capacité intellectuelle. Un choix intuitu personae plutôt que purement ès qualités, de fonctionnaires appelés à la mobilité, peut parfois se révéler utile. La Caisse des dépôts et consignations en a déjà la faculté. Il s'agit de passer d'une approche excessivement juridique à une approche pragmatique et de comprendre que l'on existe en considération des gens que l'on a nommés et que ce sont eux qui font véritablement la décision.
Sur les opérations de cession, enfin, le mille-feuilles des textes est tel qu'il est difficile de s'y retrouver, et nous devons avoir recours à des cabinets d'avocats pour savoir, par exemple, quelle doit être la bonne procédure pour céder 3 % des thermes d'Aix-les-Bains... Il faut y remettre de l'ordre.
Si notre participation est à une telle hauteur chez Giat, c'est que c'est une structure qui ne fait que porter des passifs environnementaux. On ne voit pas qui pourrait s'y substituer. La société qui compte est Nexter, que Giat possède à 100 %. Compte tenu de la doctrine, il est tout à fait possible que la participation de l'État diminue un jour dès lors, par exemple, qu'il existerait un projet stratégique pour constituer un acteur plus puissant. Il n'y a pas de tabou quant au niveau de détention dans les industries d'armement. L'enjeu est de s'assurer un noyau compris entre 15 % et 30 %, voire moins si on est « pacté » avec d'autres qui nous permettent de tenir ce noyau, afin d'éviter les agressions et les prises de contrôle non souhaitées. En matière d'armement, l'actionnariat est une chose, la commande publique en est une autre. L'État dispose de plusieurs moyens pour s'assurer du devenir stratégique des entreprises de ce secteur.
Certes. Et il arrive parfois que nous contribuions à ce que des recettes exceptionnelles l'alimentent...
Au moment de la cession de la SNCM, l'État, c'est le fruit de l'Histoire, gardait une participation minoritaire. L'entreprise est dans une situation financière difficile, que pourraient aggraver encore les procédures communautaires en cours. Il existe un plan de redressement, qui doit encore être soumis aux parties. Sur ce sujet d'importance, qui engage la desserte de la Corse et l'emploi dans la région de Marseille, le Gouvernement est vigilant et suit au jour le jour le développement de l'entreprise.

Réponse prudente, mais inévitable dans une période préélectorale...
Il me reste à vous remercier pour votre contribution, dont je salue la vivacité et la précision.
Puis, la commission procède à l'examen du rapport de M. François Marc et l'élaboration du texte de la commission sur la proposition de résolution européenne n° 389 (2013-2014) de M. Richard Yung, présentée au nom de la commission des affaires européennes, en application de l'article 73 quater du Règlement, sur le Mécanisme de résolution unique : nouvelle étape de l'union bancaire.

Je serai bref, car je souscris à cette proposition de résolution européenne. À la suite de l'audition conjointe d'hier, à laquelle je n'ai malheureusement pas pu assister, nous en examinons le texte tel qu'adopté jeudi dernier à l'unanimité par la commission des affaires européennes, à l'initiative de notre excellent collègue Richard Yung.
Cette proposition permet au Sénat de prendre position dans un débat dont les enjeux politiques, économiques et budgétaires sont majeurs.
Quelques éléments de contexte relatifs à l'union bancaire, tout d'abord. L'année 2014 est marquée par la mise en place du superviseur unique européen, en parallèle de la négociation sur le mécanisme de résolution unique. A l'automne 2013, le Parlement européen et le Conseil ont adopté deux textes qui ont transféré à la Banque centrale européenne (BCE) la responsabilité de la supervision de l'ensemble des établissements de crédit de la zone euro : c'est le mécanisme de surveillance unique (MSU), premier pilier de l'union bancaire.
La BCE sera directement en charge de la supervision des 128 établissements les plus importants, soit ceux qui présentent un bilan supérieur à 30 milliards d'euros, ou qui représentent plus de 20 % du PIB de leur pays d'origine, ou encore qui ont requis une aide financière du Fonds européen de stabilité financière (FESF) ou du Mécanisme européen de stabilité (MES). Ainsi, la supervision de la plupart des banques françaises ne sera plus, à l'avenir, assurée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui conservera néanmoins la charge de la surveillance quotidienne des établissements.
Pour lancer sa nouvelle mission sur des bases saines et connaître - mais aussi faire connaître - la réalité de la situation des banques de la zone euro, une revue générale de la qualité des actifs bancaires pour ces 128 établissements a été engagée ; cet exercice se conclura par des tests de résistance.
La présidente du conseil de supervision de la BCE, Danièle Nouy, a d'ores et déjà annoncé, le 7 février, que certains établissements devraient ne pas sortir indemnes de cet exercice : « Nous devons accepter le fait que certaines banques n'ont pas d'avenir. Nous devons en laisser quelques unes disparaître de manière ordonnée, et ne pas forcément essayer de les fusionner avec d'autres institutions. »

La proposition de résolution européenne de notre collègue Richard Yung appelle l'attention sur cet exercice et souligne, à juste titre, qu'il ne sera gage de crédibilité pour la zone euro que si une réponse forte et coordonnée est apportée à la publication des résultats et aux difficultés qui se feraient jour. En ce sens, il est important que la résolution demande, aux alinéas 16 et 17, que soit finalisé l'instrument de recapitalisation directe par le MES des établissements en difficulté. Le principe de cet outil a été maintes fois affirmé par les conseils européens et les conseils Ecofin successifs, et il est nécessaire, pour amortir le résultat de cet exercice, en attendant la mise en place complète du mécanisme de résolution unique. Le sous-directeur du Trésor, Corso Bavagnoli, a, me semble-t-il, indiqué que l'objectif était de parvenir à un accord sur cet instrument d'ici au mois de mars.
Le mécanisme de résolution unique (MRU), deuxième volet de l'union bancaire, doit comprendre une procédure décisionnelle efficace et garantir une responsabilité politique des décisions prises.
La mise en place d'un MRU est le corollaire nécessaire de celle du superviseur unique, afin d'assurer l'articulation entre l'identification des difficultés d'un établissement par le superviseur d'une part, et le lancement d'une procédure de restructuration, d'autre part.
La Commission a présenté une proposition de règlement pour le MRU en juillet 2013, avant même que le MSU ait été formellement adopté. Le Conseil est parvenu à un accord sur cette proposition le 19 décembre dernier. Les négociations sont actuellement en cours entre le Conseil, la Commission et le Parlement européen.
Le MRU transpose, pour la zone euro, le mécanisme de résolution qui a été harmonisé pour tous les États membres de l'Union par la directive sur le redressement et la résolution des banques dite « BRRD ». Il n'innove donc pas dans la palette des outils de résolution dont disposera l'autorité de résolution : plans de redressement des établissements a priori, établissements-relais, transferts d'actifs, cession ou fermeture d'activités, conversion de certaines créances en capital, etc. L'outil le plus décisif sera, à coup sûr, le renflouement interne, c'est-à-dire la recapitalisation par les créanciers, dont les conséquences sur le refinancement des banques devront être précisément évaluées, sachant que ces créances, plus risquées, seront pour elles plus onéreuses.
La procédure de prise de décision reste un point très débattu : qui aura la faculté d'« appuyer sur le bouton » de la résolution et d'engager le démantèlement d'une banque, avec les conséquences économiques et sociales que cela implique ? La Commission souhaiterait être cette autorité, mais on peut craindre qu'elle ne fasse primer des considérations techniques ou juridiques, alors que le Conseil pourrait trouver un équilibre entre l'appréciation de la viabilité d'un établissement et les considérations politiques, européennes et nationales. Comme l'a dit, je crois, Richard Yung hier : il n'est pas anormal que, tant que les États font fonction de filet de sécurité, ils conservent un pouvoir de décision sur la résolution.
Le système de décision proposé par le compromis du Conseil du 19 décembre 2013, faisant appel à quatre instances, toutes collégiales de surcroît - conseil de résolution unique en session plénière, conseil de résolution unique en session exécutive, Commission, Conseil - est complexe et propice aux blocages institutionnels : lorsque des difficultés sont déclarées, les marchés n'attendent pas pour mettre à mort un établissement. Il est donc nécessaire de prévoir une simplification du processus de décision, voire une procédure d'urgence. C'est l'objet des alinéas 30 et 31 de la proposition de résolution.
Le financement de la résolution doit passer par un fonds de résolution solide et rapidement mutualisé et par un filet de sécurité financier efficace.
C'est l'un des principaux objectifs d'une procédure de résolution que de trouver un financement pour absorber les pertes, afin d'éviter que les difficultés de l'établissement ne se transmettent à ses contreparties non remboursées, créant une crise potentiellement systémique.
Ce financement devra, à l'avenir, être essentiellement privé : d'abord les actionnaires, puis les créanciers, enfin un fonds de résolution alimenté par les banques.
Le premier enjeu réside dans les modalités de constitution de ce fonds, qui doit atteindre, en dix ans, 55 milliards d'euros. Il ne s'agit pas, à travers les règles de calcul, de protéger nos banques nationales par rapport aux banques des autres États membres, mais de faire en sorte que les contributions soient adaptées aux caractéristiques du bilan des établissements et tiennent notamment compte du risque de leurs activités. C'est pourquoi la proposition de résolution demande, à juste titre, l'application du critère des actifs pondérés par les risques, à côté de celui de la taille des établissements. Il s'agit de trouver un bon compromis entre logique de solidarité, inhérente à l'Union bancaire, et dimension assurantielle, responsabilisant les parties prenantes.
Le second enjeu réside dans la vitesse à laquelle les compartiments nationaux, alimentés par les secteurs bancaires nationaux, seront mutualisés dans un fonds unique européen. Si un délai semble justifié pour éviter que la totalité des contributions au fonds dans les premières années soit absorbée par le financement d'une ou plusieurs procédures de résolution dans quelques États membres au secteur bancaire fragile, il n'en demeure pas moins que le rythme de mutualisation de 10 % par an que projette le Conseil réduit considérablement le principe de solidarité : ne pourraient au départ être utilisées que des ressources très limitées - seulement 550 millions d'euros pour toute la zone euro la première année.
C'est pourquoi nous pouvons, je crois, être favorable à la solution de compromis consistant à réduire à cinq ans le délai de mutualisation des compartiments nationaux. C'est le sens de l'alinéa 41 de la proposition de résolution. Au terme de ces cinq ans, le montant-cible du fonds - 55 milliards d'euros - n'aura pas encore été atteint, mais les contributions annuelles des banques seront versées directement au fonds unique, sans transiter par des compartiments nationaux.
Enfin, pour assurer la crédibilité du mécanisme, il est nécessaire de mettre en place une forme de garantie publique en dernier ressort. Le Conseil souhaite que ce filet de sécurité permette de faciliter le recours du fonds de résolution à l'emprunt : ce pourrait être une garantie du MES, ou une garantie conjointe des États participants sur les émissions du fonds de résolution.
En attendant et pour la durée de la période de mutualisation, un filet de sécurité doit être en place : il ne peut s'agir que du MES, doté d'une capacité de recapitalisation directe des établissements.
Ainsi, le risque bancaire ne pourrait plus créer de risque souverain puisqu'à aucun moment la défaillance d'un établissement ne pourrait peser directement sur le budget d'un État membre. Cela ne signifie pas que le soutien public national soit complètement exclu : des garanties publiques, notamment lorsque la banque en difficulté peut être redressée, pourraient continuer d'être accordées. Mais les recapitalisations publiques de banques vouées sans cela à disparaître, telles nous les avons connues, ne devraient plus être possibles.
Je ne propose pas d'amendement à cette proposition de résolution européenne qui traite, de façon précise, l'ensemble des enjeux-clés du mécanisme et va même au-delà en rappelant certains aspects souvent occultés, comme l'exigence d'une régulation des infrastructures de marché et les conséquences du renflouement interne. Sur l'ensemble des questions, elle apporte des réponses qui vont dans le sens d'un dispositif crédible, ambitieux et équilibré.

Je suis tenté de vous suivre dans cette analyse. Une question, cependant, sur l'alinéa 27 de la résolution, qui juge que les modalités de calcul des contributions ainsi que les principes d'administration et d'investissement du Fonds de résolution ne doivent pas relever d'actes délégués. Cela signifie-t-il que ces dispositions doivent figurer dans l'accord intergouvernemental ?

Prévoir que ces fonds, qui atteindront pour le moins 55 milliards d'euros, soient gérés selon des règles fixées par des actes délégués, c'est aller loin dans les pouvoirs accordés à la Commission. Il nous semblerait normal que ce soit le comité exécutif du fonds de résolution, où sont présents les États membres, qui assure cette gestion.

Les parlements nationaux ont bien du mal à suivre et contrôler ces politiques ; nous l'avons touché du doigt à Bruxelles. Nous devons inventer des moyens plus précis de contrôle. Le ministre pourrait venir devant notre commission pour expliquer où en sont les négociations.

Le 17 avril, nous entendrons Pierre Moscovici sur le programme de stabilité. Nous pourrions en effet en profiter pour l'interroger sur ce sujet.
La proposition de résolution européenne a alors été adoptée sans modification.