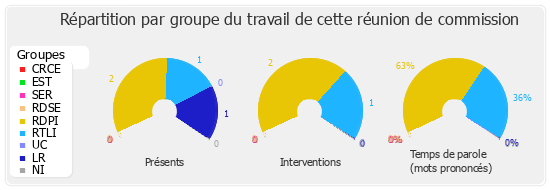Délégation sénatoriale à l'Outre-mer
Réunion du 18 juin 2015 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion

Mes chers collègues, après les tables rondes de jeudi dernier sur la question de la biodiversité dans les outre-mer à l'épreuve du changement climatique, organisées par notre groupe de travail commun avec la commission du développement durable, nous nous retrouvons aujourd'hui sur le thème du foncier.
Concernant nos travaux en cours et à venir, je vous rappelle que, jeudi prochain, se tiendra salle Clemenceau la première édition de nos conférences économiques, celle relative aux entreprises et dynamiques sectorielles du Pacifique. Cette journée, dont l'ouverture sera effectuée par le Président du Sénat à 9h15, sera extrêmement dense : 42 intervenants ont en effet répondu à nos sollicitations alors même que notre délégation ne peut prendre en charge aucun billet d'avion. La mobilisation exemplaire des acteurs économiques locaux révèle tout l'intérêt qu'ils portent à cette initiative de notre délégation dont l'objectif est de contribuer à une meilleure connaissance et à une plus forte visibilité dans l'Hexagone des contraintes et potentiels des territoires du Pacifique.
J'en profite pour saluer la présence parmi nous de notre collègue polynésien Nuihau Laurey, élu début mai.
Concernant l'activité événementielle de la délégation, je vous propose qu'une nouvelle manifestation soit organisée le 30 septembre prochain sur le thème du développement du tourisme dans les outre-mer : il s'agit d'un secteur d'activité clé pour l'ensemble de nos outre-mer et la tenue, à cette période, du salon Top Resa nous permettrait de faire témoigner de nombreux acteurs locaux. Quelques semaines avant la tenue de la Conférence des parties à Paris sur le climat, nous pourrions mettre l'accent sur les enjeux du changement climatique pour ce secteur d'activité et sur les potentiels de nos outre-mer en matière de tourisme durable. Cette manifestation serait organisée en partenariat avec la FEDOM.
Mais revenons à notre étude triennale sur le foncier dans les outre-mer dont les rapporteurs, Thani Mohamed Soilihi, à l'origine du choix de cette thématique et désigné comme rapporteur coordonnateur, et nos collègues Joël Guerriau, Serge Larcher et Georges Patient, rapporteurs du premier volet de la trilogie qui est centré sur la gestion du domaine de l'État.
Pour instruire ce premier volet, il leur a fallu récolter l'information, une information toujours éparse et difficile d'accès comme pour tous les sujets concernant les outre-mer.
Outre les nombreux questionnaires adressés aux services déconcentrés et aux juridictions dans l'ensemble des outre-mer, 8 auditions plénières ont été organisées au Sénat au cours desquelles 16 personnes ont pu témoigner. Au nombre de ces auditions figure la visioconférence organisée avec la préfecture de La Réunion.
Les rapporteurs et moi-même nous sommes par ailleurs rendus sur le terrain, en Guyane, à la Martinique et à Saint-Martin du 13 au 19 avril : 30 auditions ont eu lieu sur le terrain qui ont permis d'entendre près de 70 témoignages. On peut donc affirmer que les analyses et conclusions de nos rapporteurs sont particulièrement étayées ! Avec des photos prises au cours du déplacement illustrant leur présentation, ils vous feront partager leurs impressions.
Mais avant de leur donner la parole, je vous propose de désigner les rapporteurs qui viendront rejoindre notre collègue Thani Mohamed Soilihi, en charge de la coordination des travaux sur les 3 volets de l'étude sur le foncier, pour instruire le deuxième tome centré sur la problématique du titre de propriété, de l'indivision et de la combinaison des régimes juridiques coutumiers avec notre droit civil. Ces questions sont tout particulièrement prégnantes à Mayotte et dans les collectivités du Pacifique.
J'ai reçu les candidatures du président Jean-Jacques Hyest, fin privatiste et connaisseur de nos outre-mer, de Robert Laufoaulu qui avait d'ailleurs proposé le foncier comme sujet d'étude lors de la programmation des travaux de la délégation, ainsi que celle de Joël Guerriau.
Avant de désigner nos rapporteurs, je veux rappeler quelques principes garants du bon fonctionnement de notre délégation depuis sa création :
- la constitution de binômes de rapporteurs doit permettre de ménager un regard croisé de l'outre-mer et de l'hexagone ainsi qu'une répartition politique équilibrée des dossiers ;
- la désignation de rapporteurs différents pour chaque nouveau dossier doit permettre une implication directe du plus grand nombre de membres de la délégation. Je sais que les travaux de la délégation retiennent l'intérêt de plus en plus de collègues - nous ne pouvons d'ailleurs que nous en féliciter ! - mais il faut savoir partager et accepter la rotation. Je rappelle à cet égard, concernant la thématique du foncier, que la désignation d'un rapporteur coordonnateur décidée le 9 décembre, qui peut à première vue paraître en contradiction avec cet impératif de rotation, a été dictée par la complexité du sujet et la nécessité d'éviter les chevauchements entre les trois volets de l'étude : la gestion du domaine de l'État ; le titre de propriété confronté à l'indivision et aux conflits de régimes juridiques ; les conflits d'usage du foncier au coeur de la définition des politiques publiques.
Par ailleurs, et afin que la délégation dispose de tous les éléments d'appréciation, je dois invoquer la contrainte budgétaire : la thématique du deuxième volet de l'étude devrait conduire les rapporteurs à se déplacer à Mayotte et dans les collectivités du Pacifique. Il me semblerait donc raisonnable cette fois de nous en tenir à deux rapporteurs.
Après un échange entre MM. Guerriau, Patient, Magras et Hyest, M. Guerriau a accepté de retirer sa candidature. La délégation a confirmé M. Thani Mohamed Soilihi comme rapporteur coordonnateur et nommé rapporteurs MM. Jean-Jacques Hyest et Robert Laufoaulu sur le deuxième volet de son étude triennale sur le foncier.

Mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui sur le thème du foncier pour examiner le premier volet de notre étude triennale, centré sur la gestion du domaine de l'État, dont les rapporteurs sont Thani Mohamed Soilihi, à l'origine du choix de cette thématique et désigné comme coordonnateur, et nos collègues Joël Guerriau, Serge Larcher et Georges Patient.
Pour instruire ce premier volet, il leur a fallu récolter l'information, une information toujours éparse et difficile d'accès comme pour tous les sujets concernant les outre-mer. Outre les nombreux questionnaires adressés aux services déconcentrés et aux juridictions dans l'ensemble des outre-mer, huit auditions plénières ont été organisées au Sénat au cours desquelles seize personnes ont pu témoigner. Au nombre de ces auditions figure la visioconférence organisée avec la préfecture de La Réunion.
Les rapporteurs et moi-même nous sommes par ailleurs rendus sur le terrain, en Guyane, à la Martinique et à Saint-Martin du 13 au 19 avril : 30 auditions ont eu lieu sur le terrain qui ont permis d'entendre près de 70 témoignages. On peut donc affirmer que les analyses et conclusions de nos rapporteurs sont particulièrement étayées !

Monsieur le président, mes chers collègues, commencer par l'étude de la gestion du domaine s'imposait : d'une part, parce qu'elle recouvre des espaces à la fois très vastes et très stratégiques pour les outre-mer, d'autre part, parce que la légitimité comme l'efficacité de l'action de l'État sont contestées localement.
L'épineuse question des régularisations dans la zone des cinquante pas géométriques (ZPG) attend toujours sa solution définitive. Les occupations sans droit ni titre des espaces naturels et des immeubles désaffectés prospèrent inlassablement. La mobilisation du foncier d'État pour le logement, les grands équipements et l'agriculture tarde à produire des effets. Le point d'équilibre entre le développement économique et la protection de l'environnement, les deux objectifs souvent conflictuels auxquels la gestion du domaine de l'État doit tendre, n'est pas encore atteint et reste d'ailleurs difficile à définir.
Tous ces problèmes sont connus, mais demeurent sans solution. Ils n'ont jamais été analysés simultanément sur l'ensemble des collectivités ultramarines afin d'en discerner les causes profondes communes et de sérier les facteurs de différenciation propres à chaque territoire. C'est l'ambition de notre rapport de livrer la première radiographie transversale de la gestion domaniale dans les outre-mer et d'analyser ses failles et ses lacunes.
Le domaine ultramarin de l'État se laisse très difficilement appréhender car il présente une mosaïque de biens très divers, soumis à des régimes juridiques exorbitants du droit commun. Il manque encore un inventaire exhaustif des propriétés de l'État dans les outre-mer. Un principe général se dégage néanmoins : l'État conserve un patrimoine foncier considérable dans les départements d'outre-mer, alors qu'il en a transféré la plus grande partie dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution. Le degré d'autonomie d'une collectivité ultramarine peut se lire directement dans la description des biens restant propriété de l'État.
Dans les départements d'outre-mer, aucune politique d'aménagement ou d'urbanisme, de développement économique ou environnementale ne peut se faire sans l'État, considéré non seulement comme la puissance publique régulatrice, mais surtout en tant que propriétaire foncier majeur.
Le domaine de l'État dans les départements d'outre-mer est sans commune mesure avec le patrimoine des autres personnes publiques ou privées. Selon les territoires, la répartition de la propriété foncière varie beaucoup, mais pour prendre des points de repère, le domaine de l'État représente environ 13,5 % de la superficie de la Martinique et 37,5 % de celle de La Réunion. Il couvre jusqu'à 95,2 % de celle de la Guyane, alors que les collectivités territoriales n'y possèdent que 0,3 % de la surface foncière et les personnes privées guère plus de 1,3 %.
L'hypertrophie du domaine de l'État résulte de l'incorporation de deux zones cruciales : d'une part, les forêts qui couvrent l'intérieur des terres, d'autre part, la bande littorale, où se concentrent la population, les activités économiques et les équipements structurants.
En effet, dans les départements d'outre-mer, le domaine public maritime s'étend au-delà du rivage pour englober une bande littorale s'enfonçant vers l'intérieur des terres. En fonction des fluctuations du trait de côte et des remblais successifs, cette bande censée mesurer 81,20 mètres peut s'élargir jusqu'à 600 mètres. La composition du domaine de l'État outre-mer garde fortement l'empreinte de la colonisation, dont la zone des cinquante pas géométriques constitue un vestige archaïque que la départementalisation n'a pas aboli.
En revanche, le domaine public maritime, très associé à la capacité de l'État à maîtriser un territoire, a été transféré aux collectivités d'outre-mer par les différentes lois organiques qui leur confèrent un statut autonome. C'est le cas en Nouvelle-Calédonie au profit des trois provinces, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. De même, la Polynésie française est propriétaire du domaine public maritime.
Cependant, même dans les collectivités les plus autonomes, l'État conserve des propriétés abritant les services publics tels que palais de justice, bases militaires, ports autonomes ou encore les aéroports internationaux de Nouméa-La Tontouta et de Tahiti-Faa'a. Certaines font l'objet de demandes de revendication.
À l'hétérogénéité dans la composition matérielle du domaine s'ajoute l'éclatement extrême du droit domanial ultramarin. Les normes applicables sont éparpillées dans un grand nombre de textes différents : code général de la propriété des personnes publiques, code du domaine de l'État et sa version applicable à Mayotte, code forestier, code de l'environnement, code de l'urbanisme et lois non codifiées. Les dérogations sont devenues la règle au point de rendre les normes applicables particulièrement obscures et fluctuantes. Les grands principes du droit commun se retrouvent outre-mer criblés de mesures exorbitantes, de dispositifs d'exception et de solutions inédites dans l'Hexagone. Tant et si bien qu'aucune collectivité ultramarine n'est véritablement régie par le même droit domanial.
Le cas de Mayotte est le plus impressionnant : ni les baux emphytéotiques administratifs, ni les droits réels, ni les superpositions d'affectation, ni les mutations domaniales ne s'y appliquent ; le calcul des redevances domaniales n'est pas le même ; même chose pour la définition du régime des eaux et du domaine public fluvial. Il a fallu attendre 2010 pour découvrir la base légale applicable à Mayotte des contraventions de grande voirie, qui sanctionnent l'occupation sans droit ni titre du domaine public. Après une enquête archéologique serrée, le Conseil d'État est parvenu à conjuguer deux décrets sur Madagascar de 1902 et 1926 et trois arrêtés du gouverneur en 1911, 1914 et 1927, dont la cour administrative d'appel de Bordeaux avait pourtant jugé qu'ils étaient abrogés par l'ordonnance de 1992 codifiant le code du domaine de l'État applicable à Mayotte !
Morcèlement, éparpillement, complexité interne redoutable, toutes ces caractéristiques ne facilitent pas la compréhension, la maîtrise et la transposition de solutions pertinentes, y compris au sein des services de l'État.
Disons-le clairement, le droit du domaine de l'État outre-mer est totalement illisible, ce qui pose de graves problèmes d'accès au droit et de sécurité juridique. On peut comprendre le désarroi et l'attentisme de la population face à ce maquis inextricable.
Nous avons examiné les fondements de cette myriade de dérogations et d'exceptions pour en évaluer la pertinence. Notre conclusion est nette : elles sont moins la conséquence d'une juste appréciation des spécificités des territoires que le produit d'une pure sédimentation historique ; elles ne sont pas l'effet d'une volonté claire et constante, mais le reflet de l'indifférence d'une gestion au fil de l'eau et à la trajectoire incertaine.
Pour assumer la complexité juridique de la gestion domaniale, l'État a fait le choix de s'appuyer sur une multitude d'opérateurs, sans les doter des moyens nécessaires à leur action, sans s'assurer de l'efficacité de leur coordination et sans leur fixer de cap.
Une réévaluation des moyens humains mis à la disposition des services locaux du domaine en outre-mer paraît indispensable, ainsi qu'un audit de leurs systèmes d'information en vue de leur refonte et leur mise en cohérence.
La multiplicité des opérateurs intervenant sur des parcelles de statuts très divers, le fractionnement des procédures et l'exercice conjoint de compétences sur certains éléments du domaine rendent la coordination à la fois essentielle et complexe à mettre en place.
Or, sur plusieurs exemples, nous avons pu noter de sérieuses divergences d'approche et de méthode, des frictions et des tensions, entre les services déconcentrés et entre les établissements publics. Le cas du chevauchement conflictuel de l'ONF et du parc national de La Réunion en offre un exemple topique. Il faut y porter réponse sous peine de paralysie de l'action de l'État avec toutes les répercussions en chaîne que cela entraîne pour les collectivités territoriales et les particuliers.
Au fond, le domaine de l'État outre-mer reste dans l'angle mort de la politique immobilière nationale. De l'aveuglement naît le désintérêt, et bientôt le délaissement. C'est là que se trouve la racine du mal et c'est ce qui explique la prolifération des statuts fonciers dérogatoires, la fluctuation des normes sans horizon de long terme, le renvoi des difficultés à des facteurs extérieurs à l'administration et la compression des moyens humains et financiers.
Sans stratégie, il est impossible de repenser la gouvernance et les modes de gestion, d'affecter des moyens adéquats, de procéder à une libération encadrée et rationalisée du foncier. L'État ne semble pas savoir lui-même dans quel but il continue de garder tant de biens fonciers dans les outre-mer, au risque de maintenir une forme de tutelle sur les collectivités territoriales.
Nous souhaitons que soit élaboré un document d'orientation et de programmation à long terme de la politique domaniale dans les outre-mer qui devra ensuite être décliné dans des stratégies régionales compatibles avec les SAR. Cette feuille de route trouvera naturellement sa traduction dans les lettres de mission adressées aux préfets dans le souci d'assurer une double cohérence, territoriale et temporelle, à l'action de l'État. À défaut, persistera la tentation d'un immobilisme de fond, ponctué par à-coups d'interventions épisodiques et décousues.
Après ce panorama brossé à grands traits, je vais laisser mes collègues approfondir les points essentiels de notre rapport et présenter nos recommandations. Serge Larcher traitera la zone des cinquante pas géométriques, Joël Guerriau présentera les difficultés touchant le domaine privé de l'État et Georges Patient évoquera le cas particulier mais essentiel des forêts.

Monsieur le président, mes chers collègues, la géographie et l'histoire ont conjugué leurs effets pour faire diverger la situation de la zone des cinquante pas géométriques dans les différentes collectivités ultramarines. Nous évoquons les différents cas de figure dans notre rapport, mais je vais me concentrer sur le cas des Antilles, car le règlement définitif des occupations, attendu depuis des décennies n'y est toujours pas atteint.
Les agences des cinquante pas géométriques ont été instituées en Martinique et en Guadeloupe à titre temporaire. La durée de vie des deux agences et le périmètre de leurs missions ont été régulièrement modifiés depuis leur création en 1996. Depuis le Grenelle II en 2010, la régularisation des occupations sans titre historiques était censée devenir leur coeur de métier, mais elles conservent encore aujourd'hui la mission de concevoir et de mettre en oeuvre des programmes d'équipement. Elles se sont emparées de cette compétence d'aménagement, parce qu'il existait un vide, mais aussi pour se pérenniser.
La dernière prolongation des agences date d'octobre 2013, à la suite de la proposition de loi que j'avais déposée. Dans mon esprit, cette prolongation s'apparentait à une mesure d'urgence afin de disposer d'un délai supplémentaire, jusqu'au 1er janvier 2016, pour réfléchir à l'avenir de la gestion de la zone des cinquante pas géométriques. Je regrette que ce temps n'ait pas été mis à profit pour définir une feuille de route claire. Alors que les agences présentent un bilan en demi-teinte, l'État semble incapable d'envisager des alternatives satisfaisantes.
Les agences ont certes traité l'essentiel des demandes de régularisation déposées. Cependant, une faible proportion des demandes aboutit à des cessions effectives : 8,9% seulement des dossiers déposés en Guadeloupe, 13,4% à la Martinique. Aussi, les agences restent en charge d'un stock de dossiers très important. On estime le potentiel de régularisation restant en Martinique à 44 % des constructions illicites sur les espaces urbanisés de la zone.
En matière d'aménagement, le bilan est très contrasté d'un territoire à l'autre. L'agence de Martinique a réalisé des études d'aménagement sur plus de 70% de son périmètre d'intervention et programmé une vingtaine d'opérations portant sur 2 250 logements pour 27 millions d'euros d'investissements. En déplacement en Martinique, vos rapporteurs ont pu visiter des sites où l'agence a mené des opérations très réussies sur les communes des Anses d'Arlet et du François. Ils ont pu apprécier la grande qualité de l'ingénierie technique et de l'expertise juridique et financière qu'ont développées ses équipes. En revanche, l'agence de Guadeloupe n'a pu conduire d'études que sur 54 % de son périmètre. Elle n'a lancé que quatorze opérations de moindre ampleur portant sur 300 logements pour 11 millions d'euros d'investissements.
Cependant, au-delà des bilans quantitatifs, l'action des agences suscite de nombreuses interrogations qui font douter qu'elles puissent constituer une solution pérenne.
En premier lieu, l'enchevêtrement des opérations de régularisation et d'aménagement ne peut que retarder l'apurement définitif de la bande littorale. Actuellement, l'aménagement précède la cession, ce qui génère un processus sans fin. En effet, l'aménagement dure plusieurs années, entre trois et cinq ans en moyenne. Il suffit alors, avant la date de disparition programmée des agences, d'engager de nouveaux chantiers pour que le dispositif soit mécaniquement prorogé.
Or, l'implication des agences dans l'aménagement résulte d'une lecture très extensive des textes. L'aménagement n'est pas inscrit parmi leurs compétences légales, au-delà des travaux d'équipement en voie d'accès, adduction d'eau et assainissement. Elles n'ont pas le statut d'aménageur avec les leviers financiers qui y sont associés. Il n'est pas rare d'observer cette tendance à étendre progressivement ses prérogatives chez des établissements très autonomes, surtout lorsqu'ils ont une vocation transitoire et cherchent un moyen de se pérenniser.
Outre la question du périmètre de la mission des agences, la pratique des régularisations trahit parfois l'intention du législateur. Un certain nombre des occupants sans titre ne remplissent aucun des critères d'urgence sociale qui inspirent et justifient fondamentalement le processus. Au vu des villas cossues et des résidences opulentes qui ont été régularisés et que nous avons vues sur place, les conditions concrètes de cession sont parfois très contestables.
On trouve des cas de sous-évaluation manifeste des prix par le service du domaine : autour de vingt euros le mètre carré pour des villas jouissant d'un emplacement idyllique dans une crique du littoral atlantique, alors qu'elles pourraient être cédées le quintuple sur le marché immobilier. Rappelons que les occupants défavorisés bénéficient d'une aide exceptionnelle prévue par le législateur. Des prix de cession bas profitent surtout à ceux qui ne sont pas éligibles à cette aide. France Domaine surestime la décote due au manque d'équipement et d'accès à la zone.
C'est d'autant plus incompréhensible que l'agence des cinquante pas entreprend de son côté les travaux de voirie et de raccordement aux réseaux. Et même davantage, puisqu'elle prévoit la réalisation d'écoquartiers avec des matériaux respectueux de l'environnement. Ce sont certes de beaux projets valorisants pour l'agence. Mais ces travaux sont en partie financés sur des fonds publics et bénéficient de l'ingénierie d'agents d'un établissement public d'État. Comment ne pas y lire une prime à l'impunité ?
Ces situations montrent toute l'ambiguïté de l'aménagement, dont on sent que les agences essaient de faire leur priorité pour montrer leur utilité. La démarche n'est pas toujours aussi vertueuse que sur l'Anse Dufour, où le projet a permis de consolider le soutien de la population et de faire de la plage un site touristique très couru. Dans les autres cas, l'aménagement ne fait que valider la privatisation et le bétonnage du rivage.
Au-delà de la gestion administrative, la question des cinquante pas est par essence politique ; elle ne peut pas être résolue par l'État sans qu'il laisse les collectivités territoriales prendre des responsabilités plus importantes. Il est désormais grand temps de refermer la phase postcoloniale du traitement de la zone des cinquante pas géométriques et de renverser la logique à laquelle elle obéissait. On ne peut plus considérer comme normale l'appropriation de la bande côtière par l'État et comme dérogatoire les interventions des collectivités.
Le principe directeur doit devenir l'autonomisation foncière des collectivités en leur garantissant la maîtrise des espaces urbanisés de la zone des cinquante pas.
Cependant, le transfert de propriété ne peut s'envisager dans tous les outre-mer de la même façon. Il doit tout d'abord répondre à une demande explicite des collectivités territoriales. Il n'est pas question d'envisager que l'État, embarrassé de la gestion des régularisations, s'en décharge unilatéralement sur les collectivités. De ce point de vue, Mayotte - qui connaît autant que Saint-Martin une sous-administration préjudiciable - n'est sans doute pas aussi avancé dans sa réflexion que les Antilles.
Le triple souci de simplicité, de cohérence et de hauteur de vues pousse à recommander un transfert au niveau régional. La compétence de la région ou de la collectivité unique en matière de stratégie de développement économique et d'aménagement du territoire, inscrite notamment dans le schéma d'aménagement régional (SAR), conforte cette position.
Une fois son principe acté, le transfert devra être réglé dans un cadre conventionnel négocié entre l'État et les collectivités qui fixera les modalités opérationnelles et financières de la gestion du domaine pour l'avenir. Le contre-exemple du transfert inachevé et contesté du domaine à la collectivité de Saint-Martin ne doit pas être renouvelé. Une évaluation précise des charges doit permettre leur compensation effective.
Dans la mesure où le transfert aux collectivités des espaces urbanisés de la zone des cinquante pas géométriques n'a pas été préparé au cours des années écoulées, le réalisme porte à recommander une ultime prolongation des agences au maximum pour trois ans. C'est ce que propose l'article 8 du projet de loi relatif à la modernisation de l'outre-mer que le Gouvernement a déposé au Sénat et que nous examinerons la semaine prochaine en séance publique.
Cependant, cette prorogation devra être accompagnée de la fixation d'une date ferme à laquelle devront être achevées les négociations de transfert avec l'État. Si les agences sont prorogées jusqu'au 1er janvier 2018, alors il serait raisonnable qu'au 1er janvier 2017 les négociations soient achevées pour rendre le transfert effectif avant le 31 décembre de la même année.
Cette feuille de route doit être complétée par une réorientation des missions des agences vers la préparation opérationnelle et matérielle du transfert. Il conviendra de les recentrer pendant la phase transitoire sur la régularisation et le titrement, afin de transmettre la zone des cinquante pas géométriques, expurgée au maximum des sources de contentieux, dans des conditions optimales pour les collectivités territoriales.
En ce qui concerne les équipements et l'aménagement, les agences devraient, pendant la phase transitoire, uniquement achever les opérations en cours. Une priorité devait être donnée à ceux des travaux d'aménagement qui permettent d'ouvrir de nouvelles possibilités de cession-régularisation en sécurisant les zones concernées contre les aléas naturels. À cet effet, autant que faire se peut, il faut tirer parti du fonds « Barnier » prévu par le code de l'environnement.
Après la disparition des agences, les compétences de portage foncier ont vocation à être confiées aux établissements publics fonciers locaux et les compétences d'aménagement aux communes et établissements publics de coopération intercommunale via des sociétés d'économie mixte. Ainsi le paysage foncier antillais se rapprochera-t-il du régime de droit commun, en mettant fin à des exceptions exorbitantes qui ne servent pas le développement des territoires ultramarins.
Après le transfert, l'État n'a pas vocation à sortir complètement du jeu. Il serait intéressant de maintenir les commissions consultatives des cinquante pas créées par décret en août 2014. Leur mission est de donner un avis sur les demandes de cession de parcelles du domaine. Si elles sont effectivement mises en place - ce que nous n'avons pas constatées sur le terrain -, elles pourraient jouer un rôle d'interface et d'échange avec l'État. Mais leur composition devrait être revue pour donner la majorité des voix aux représentants des collectivités territoriales.
Dès à présent, il faut mener une action préventive contre la spéculation foncière alimentée par les cessions - régularisations. À cette fin, les modalités d'estimation du prix des cessions sur la zone des cinquante pas géométriques doivent être revues, quitte à accroître le montant de l'aide exceptionnelle pour les ménages les plus modestes, afin de garantir la neutralité de la révision à leur égard. Nous proposons également d'introduire un mécanisme de taxation exceptionnelle de la plus-value immobilière en cas de revente de biens régularisés.
La régularisation des occupations historiques n'a de sens que si l'on empêche les nouvelles implantations sauvages. À défaut, le stock de dossiers se remplira de nouveau et le mouvement de privatisation du littoral se poursuivra indéfiniment, ce qui finirait par amputer les territoires, non seulement de la beauté de leurs paysages, mais aussi d'un atout stratégique, pour le développement du tourisme en particulier.
Une action résolue de protection des espaces naturels, après leur délimitation rigoureuse, est donc plus que jamais nécessaire. Les leviers existent et sont à la disposition des services de l'État qui doivent être remobilisés.
Il faut amplifier le recours aux procédures de contravention de grande voirie et les poursuivre jusqu'à leur exécution effective. Un travail avec le parquet doit être mené pour assurer la fluidité de la chaîne judiciaire. Les procédures contentieuses pourront être améliorées en sollicitant systématiquement des astreintes journalières et en s'assurant de leur liquidation effective.
Par souci de rapidité et d'efficacité, il conviendrait de se concentrer sur la possibilité de saisir et de détruire les matériaux servant à des constructions illégales sur le domaine public maritime.
Les sanctions fondamentales sur le domaine public maritime restent la libération et la remise en état des terrains : la mise en oeuvre de ces condamnations est un élément clef pour restaurer la crédibilité entamée de l'État et pour retrouver une capacité de dissuasion préventive. Ce serait encore la meilleure arme contre les occupations illégales. Il ne faut pas hésiter à aller jusqu'à la destruction d'immeubles ou d'installations symboliques. Un ciblage des résidences secondaires permettrait de maximiser l'impact en minimisant le risque.
C'est uniquement lorsque la chaîne de surveillance et de répression, jusqu'aux services judiciaires, sera remise en ordre de marche que pourra, dans un second temps, être envisagée une élévation des niveaux de sanction et d'amende, si nécessaire. L'on sait, en effet, au moins depuis Montesquieu, que l'impunité fait plus de dégât que la légèreté des peines.

Monsieur le président, mes chers collègues, notre collègue Serge Larcher vient d'évoquer la question de la bande des cinquante pas géométriques qui appartient au domaine public. Les difficultés qui grèvent la gestion du domaine privé de l'État ne sont pas moins grandes ; je reviendrai dans mon intervention sur deux d'entre elles : les occupations sans droit ni titre et les mécanismes de cession du domaine privé à des fins agricoles.
Les cas de squats d'immeubles, de défrichement illégal et d'occupations de terrains du domaine privé se multiplient de façon incontrôlée en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin notamment.
Lorsque nous les avons rencontrés à Cayenne, le préfet de Guyane comme le conseil général les ont qualifiés de « véritable fléau ». Tout immeuble désaffecté ou inoccupé est susceptible d'être rapidement capté, ce qui contribue à bloquer le marché foncier et certains programmes d'équipement ou de promotion immobilière. Les rumeurs se propagent très vite et, en vingt-quatre heures, des squats peuvent s'installer dans un bâtiment laissé vide, comme une caserne désaffectée. L'endiguement d'un squat à un endroit ne fait que déplacer le problème ailleurs. Les installations se produisent même sur des terrains classés zones à risque, comme des collines de l'île de Cayenne inscrite dans un programme de prévention des risques (PPR) de mouvement de terrain. On peut imaginer ce qui se passerait en cas de catastrophe naturelle... Nous ne pouvons pas rester sans réagir.
La protection du domaine public ne paraît pas nécessiter de modifications législatives ou réglementaires, mais l'application effective des sanctions. En revanche l'État pâtit de l'absence de dispositifs juridiques adaptés pour lutter contre les occupations de son domaine privé.
La presse s'est fait en 2015 l'écho d'affaires retentissantes de squats dont étaient victimes des particuliers, qui parvenaient très difficilement à retrouver la possession de leur bien. On peut comprendre dès lors l'impuissance relative de l'État. D'une part, il ne peut utiliser sur son domaine privé de prérogatives particulières de puissance publique, sous peine de voie de fait caractérisée. D'autre part, le domaine privé de l'État n'est, par définition, pas protégé contre les violations de domicile, qui est l'incrimination prévue par le code pénal pour protéger les particuliers. Cet article ne vise pas à garantir d'une manière générale la propriété immobilière contre une usurpation, mais à protéger le domicile comme lieu de vie privé.
L'enjeu essentiel pour l'État est de procéder à l'expulsion. Or, le recours à la procédure d'expulsion par référé « mesures utiles » est impossible sur le domaine privé. N'est pas ouverte non plus à l'État la procédure d'expulsion accélérée « anti-squatteurs » prévue par la loi de 2007 instituant le droit au logement opposable, qui ne bénéficie qu'aux particuliers, propriétaire ou locataire.
Il ne reste donc à l'État que la voie de droit commun du droit civil prévue par la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. Dans ce cadre, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice et après signification d'un commandement de quitter les lieux. Une procédure longue et incertaine ne peut manquer de s'en suivre.
Les délais pourraient être drastiquement raccourcis si la procédure de flagrant délit était empruntée pour permettre aux forces de l'ordre d'intervenir sur le fondement de l'incrimination des articles du code pénal relatifs à la destruction, la dégradation et la détérioration du bien d'autrui. Or, le flagrant délit n'est pas utilisé.
Il semble que les services de l'État commettent ici une erreur de droit, qui les enferment dans une pratique plus restrictive que ce qu'imposent les textes. Il nous a été affirmé à de nombreuses reprises, y compris par des préfets, que, au bout de quarante-huit heures, il n'était plus possible d'agir contre les squats et les occupations du domaine privé car expirait alors le délai de flagrance.
Deux erreurs sont commises. En premier lieu, l'idée qu'il existe un délai maximal fixe pour engager une enquête de flagrance repose sur des bases très fragiles. L'article 53 du code de procédure pénale qui définit le flagrant délit ne prévoit aucun délai précis, fixe et uniforme, mais rapporte la flagrance à ce qui « se commet actuellement ou vient de se commettre », ainsi qu'à la découverte de traces et d'indices « dans un temps très voisin de l'action. » Il n'existe pas non plus de règles jurisprudentielles qui établiraient un délai ferme de quarante-huit heures. Tout dépend en réalité du cas d'espèce. Il semble que la règle des quarante-huit heures provienne d'une interprétation extensive et rigide d'arrêts de la Cour de cassation validant une enquête de flagrance engagée quarante-huit heures après la commission d'un viol, en estimant que ce délai était raisonnable pour laisser la victime porter plainte. La confusion est née de cette extrapolation.
En second lieu, même si l'on trouvait un fondement juridique à ce délai de quarante-huit heures, il serait inopérant dès lors que le délit est continu. C'est même l'interprétation donnée par la Chancellerie dans le cas de la violation d'un domicile privé : tant que la personne se maintient dans les lieux, les services de police et de gendarmerie peuvent diligenter une enquête dans le cadre de la flagrance.
En résumé, le cas de la violation de domicile est clair, avec une enquête de flagrance qui peut être diligentée à tout moment et une procédure administrative d'expulsion accélérée. La transposition de cet état du droit aux occupations illégales des immeubles privés de l'État est moins évidente. C'est ce qui explique une forme de paralysie de l'État et cela crée un effet d'aubaine : il est finalement plus sûr pour des squatteurs de s'attaquer aux propriétés de l'État ! C'est pourquoi il faudrait rapprocher le traitement de l'occupation du domaine privé de celui de la violation de domicile.
Nous proposons d'envisager la création d'un délit spécial d'occupation du domaine privé de l'État calqué sur l'article 226-4 du code pénal1(*), ce qui permettrait de disposer à coup sûr d'un délit continu. Cela rapprocherait aussi les protections du domaine privé et du domaine public, sur lequel les occupations sans titre sont toujours des infractions continues aux termes du code général de la propriété des personnes publiques. Il faut faire bouger les lignes.
Il pourrait paraître excessif de protéger ainsi l'intégralité du domaine privé, en particulier les bois et forêts qui bénéficient déjà des protections spécifiques du régime forestier. Mais il faudrait au moins englober les occupations du bâti, en particulier les anciens biens du domaine public affectés à un service public et déclassés dans le domaine privé. À défaut, la désaffectation et le déclassement de bâtiments comme des casernes pour permettre des opérations immobilières, y compris au bénéfice des collectivités territoriales, continuera de donner lieu à des occupations sauvages incontrôlables.
Aux mêmes fins et pour les mêmes biens, il conviendrait également d'étudier la possibilité d'ouvrir une voie d'expulsion administrative simplifiée sur le modèle de la loi DALO de 2007 pour s'exonérer de la procédure civile, qui est trop lourde et trop lente, donc inefficace.
Si l'État peine à protéger son domaine privé des squatteurs, il ne parvient pas non plus à le mobiliser pour de la mise en valeur agricole.
En Guyane, les demandes de cession gratuite de terrains du domaine privé pour la mise en valeur agricole, autorisées par le législateur, sont peu nombreuses : quinze en moyenne par an. Elles s'adressent à des occupants sans titre d'emprises domaniales se livrant à une activité exclusivement agricole. Le dispositif demeure largement méconnu si l'on en juge par l'énorme flux de demandes de cession onéreuse, qui pourrait être partiellement réorienté vers le mécanisme à titre gratuit.
À défaut de pouvoir obtenir immédiatement la cession d'un terrain domanial, les agriculteurs peuvent bénéficier de titres d'occupation. Cette attribution foncière leur ouvre la faculté de pouvoir acquérir in fine ces terrains à titre gratuit, sous conditions. Les concessions aux agriculteurs passent par des baux emphytéotiques ou des conventions d'occupation temporaire, sous réserve d'une mise en valeur agricole, attestée par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Les baux emphytéotiques sont conclus pour trente ans, sans limite de surface mais, en pratique, ne sont pas baillés plus de trois cents hectares par agriculteur. Les concessions sont accordées pour cinq ans et limitées à cinq hectares. D'après les données de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Guyane, 65 % des demandes reçoivent un avis favorable en commission d'attribution foncière, soit 914 sur 1390 dossiers entre 2000 et 2014. La mise à disposition est gratuite.
La conjonction de ces dispositifs de cession et de concession n'est pas assez efficace puisque la surface agricole utile (SAU) ne représente toujours que 0,3 % de la superficie de la Guyane et ne croît que faiblement. Sur 75 000 hectares remis, tous mécanismes confondus, 17 000 hectares seulement ont été mis en valeur ! Une conjonction de plusieurs facteurs ou raisons peut expliquer cet échec grave.
En premier lieu, la longueur des procédures est excessive : après sept à huit mois d'instruction du dossier, il faut attendre la réunion de la commission d'attribution, tous les trois ou quatre mois environ. Après un avis favorable, il reste à effectuer le bornage, puis à attendre la rédaction de l'acte par les services du domaine. Il n'est pas rare que les procédures durent entre deux et cinq ans.
En second lieu, il faut tenir compte du coût qui pèse sur l'agriculteur. Le bornage peut être pris en charge par le conseil général sur des fonds européens, au prix de délais supplémentaires. En revanche, les parcelles remises sont couvertes de forêt brute et il faut donc que l'agriculteur déforeste lui-même. Le coût de la déforestation est d'environ 5 000 € par hectare et les dotations européennes pour l'installation des jeunes agriculteurs sont à peine suffisantes. Avant même d'avoir commencé à cultiver, la trésorerie de l'exploitation est déjà asséchée par la déforestation. On ne peut pas dès lors s'étonner de la faible capacité d'impulsion économique des concessions accordées aux agriculteurs.
De plus, un agriculteur ne peut, au mieux, que valoriser 50 % de la surface qui lui est accordée, à cause de la faible productivité de terres qui sont trop humides et trop vallonnées. La valorisation de base dans le logiciel de gestion est d'un euro l'hectare.
Le contrôle de la réalité de la mise en valeur agricole, contrepartie du bail, n'est pas non plus correctement effectué, si bien qu'en moyenne la valorisation des terres est encore plus faible. Le défaut de mise en valeur entraîne en principe la caducité de la concession, mais l'État n'assume pas jusqu'à présent toutes ses responsabilités en la matière. Le préfet de Guyane nous a indiqué que « depuis dix ans, l'évaluation de la surface agricole utile montre un faible taux de valorisation des terres attribuées en commission d'attribution foncière, sans que, dans la pratique, il y ait retour à France Domaine des terres non mises en valeur. »
Par ailleurs, la chambre d'agriculture souffre de graves difficultés financières qui l'empêchent de jouer à plein son rôle de moteur et d'accompagnateur. Elle ne perçoit en effet pas assez de ressources propres au titre de la contribution additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Les réglementations sociales ne paraissent pas adaptées au cas de la Guyane. Par exemple, du fait de son climat équatorial humide et chaud, les travaux d'agriculture sont automatiquement considérés comme pénibles au sens du droit du travail. Cela pénalise les exploitants en renchérissant le coût de la main d'oeuvre. Enfin, les réglementations environnementales européennes pèsent de tout leur poids. Elles sont beaucoup plus strictes que leurs homologues au Brésil et au Suriname, sans prendre en compte les spécificités de l'agriculture et surtout de l'élevage en zone équatoriale.
Les maladies parasitaires qui affectent les animaux sont nombreuses et seuls sont autorisés certains produits de prévention et de traitement qui doivent être importés à des prix exorbitants pour de jeunes agriculteurs désireux de s'installer. De même, après déforestation, il faut replanter rapidement une herbe particulière à titre préventif ; son achat au Brésil coûte 300 € les vingt kilogrammes pour traiter trois hectares, mais les agriculteurs doivent l'importer d'Europe à 1 200 € pour la même quantité.
Si l'État veut rester crédible dans son action de mobilisation de son foncier pour l'agriculture, il doit également créer et entretenir un environnement réglementaire et commercial propice à la production et tenant compte des spécificités locales.

La Guyane est la terre d'exception parmi les exceptions ! Mon intervention prolonge celle de Joël Guerriau sur le domaine privé pour évoquer les forêts, un cas particulier mais capital.
Notre rapport préconise en effet une refonte d'ampleur du système des forêts qui recouvrent 96 % du territoire guyanais. Le but est de desserrer l'étau domanial pour des collectivités privées de réserves foncières si bien qu'elles doivent demander un terrain à l'État pour réaliser le moindre équipement collectif.
Le premier axe consiste à repousser vers l'intérieur des terres le domaine forestier permanent en élargissant la bande littorale qui n'est pas soumise au régime forestier et qui peut donc faire l'objet de transactions beaucoup plus aisément. Pour maximiser les effets, il faut donner plus d'ampleur à ce mouvement au nord-ouest de la Guyane, qui est soumis à une intense pression démographique. En vingt ans, Saint-Laurent-du-Maroni est passé de 6 000 à 50 000 habitants et dépassera dans les prochaines années la population de Cayenne.
Nous souhaitons aller plus loin en transférant le foncier ainsi libéré à la future collectivité unique, qui en a fait la demande. Il reviendra à la collectivité unique de Guyane de rétrocéder les terrains aux communes, aux acteurs économiques et aux particuliers en fonction de leurs demandes et des orientations du SAR. Elle pourra transposer les procédures existantes dans les commissions d'attribution foncière et continuer d'y associer l'État dans un rôle de conseil.
Transférer le foncier à la nouvelle collectivité unique lui permettrait d'être dotée dès sa création d'une réserve foncière. Elle disposerait ainsi d'un levier d'action au service de l'exercice de ses compétences très amples et de la réalisation de la planification stratégique inscrite dans le SAR. Les quelques centaines de milliers d'hectares qui pourraient être cédés restent d'un ordre de grandeur très raisonnable par rapport aux 8,5 millions de kilomètres carrés de la Guyane.
Cette réserve foncière d'amorçage pourrait servir de laboratoire pour démontrer la capacité de la collectivité unique à gérer efficacement le foncier. Ce transfert pourrait être accompagné d'une évaluation conjointe de l'État et de la collectivité unique, qui permettra à la collectivité de développer ses capacités d'expertise propres et à l'État de piloter les libérations ultérieures de foncier. Sur les fonds européens dont la collectivité unique est gestionnaire, il pourrait être parallèlement envisagé de créer un opérateur foncier régional pour utiliser et mobiliser le foncier transféré.
En complément, nous proposons de rapprocher la Guyane des autres départements d'outre-mer qui bénéficient du régime des forêts départemento-domaniales. Ce régime très particulier, qui donne la nue-propriété à la collectivité et accorde des droits d'usage permanents à l'État n'a pas été étendu à la Guyane en 1947. Les forêts qui appartenaient à la colonie ont été incorporées au domaine de l'État. Cette asymétrie avec les autres départements d'outre-mer, je dirais cette injustice historique, doit être gommée. Il faut donc envisager, après transfert à la collectivité unique de terrains proches du littoral, la transformation du reste du domaine forestier permanent en forêt collectivo-domaniale avec nue-propriété à la collectivité unique et usufruit, ce qui revient à une forme de droit d'usage, à l'État. De cette façon, hormis la zone du parc amazonien, la collectivité de Guyane exercerait des droits sur l'ensemble de la forêt guyanaise. L'Office national des forêts continuerait d'y assurer la gestion et pourrait développer une politique d'emplois aidés sur le modèle qui prévaut à La Réunion.
Par ailleurs, nous émettons plusieurs recommandations pour accroître les ressources financières revenant aux communes : il faut favoriser la constitution de forêts communales et garantir le paiement par l'État de la taxe sur le foncier non bâti au titre de ses forêts exploitées en outre-mer.
Aucune forêt de collectivité n'est gérée par l'Office national des forêts en Guyane, qui est le seul département français à connaître une telle situation. Cet état de fait pose d'autant plus de questions que : d'une part, dans l'Hexagone, les deux tiers des forêts publiques environ sont des forêts communales, d'autre part, l'exploitation du bois et des produits de la forêt, y compris indirectement pour alimenter des usines de biomasse, constitue une filière d'avenir pour la Guyane.
Il n'existe pourtant aucun obstacle juridique : le code forestier permet la création de forêts communales sous régime forestier sur demande de la commune et après arrêté préfectoral.
Cependant, aucun projet ne s'est concrétisé. Des discussions avec les communes de Régina et de Saint-Laurent-du-Maroni ont eu lieu sans aboutir. Les initiatives autour de Saül et Maripasoula peinent aussi à émerger. Le point d'achoppement réside dans la participation financière des communes à la gestion de la forêt. En effet, dans le droit commun, la répartition des responsabilités est telle que, d'un côté, la commune propriétaire d'une forêt fixe les orientations stratégiques de la gestion, décide du programme des coupes de bois et de leurs modes de vente, accorde les concessions et encaisse les produits de sa forêt ; de l'autre côté, l'Office national des forêts assure la surveillance et l'aménagement forestier, fixe les conditions techniques d'occupation et d'exploitation, propose le programme annuel des travaux. En contrepartie, l'Office national des forêts reçoit un versement compensateur de l'État et des frais de garde de la part de la commune.
Ces frais à hauteur de deux euros l'hectare ne peuvent être assumés par les communes, en particulier en Guyane, car elles sont victimes d'un effet de ciseau entre des ressources propres très faibles et des charges très lourdes dues à l'immensité de leur territoire et aux besoins d'équipement d'une population en forte croissance. Le dispositif national de frais de garde n'est pas adapté à l'outre-mer, et encore moins à la Guyane, alors que c'est précisément le territoire qui pourrait tirer le meilleur parti d'une exploitation plus intense de sa forêt.
Nous recommandons en conséquence une exonération des frais de garde normalement dus à l'Office national des forêts pour l'outre-mer, au moins à titre temporaire pour enclencher la dynamique de création de forêts communales, le temps que les ressources tirées des ventes de bois et des concessions profitent aux communes. Ce ne serait que le juste pendant de l'exonération temporaire dont bénéficie l'Office national des forêts jusqu'en 2018. En effet, aux termes de l'article 1395 H du code général des impôts, dans les cinq départements d'outre-mer, les forêts d'État sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) perçue auprès du gestionnaire-exploitant au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale. Cette exonération temporaire s'élève à 80 % pour les années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % pour les impositions établies au titre de 2016, 2017 et 2018.
L'existence d'une exonération temporaire prouve a contrario que l'État doit s'acquitter de la TFNB auprès des communes au titre des forêts de son domaine privé. Toutefois, l'administration conteste le principe même de cette fiscalisation pour le cas particulier de la Guyane.
Or, l'analyse des services de l'État, tant au niveau central qu'au niveau déconcentré est extrêmement contestable. Certes l'article 1394 du code général des impôts prévoit une exonération totale de la TFNB pour les propriétés de l'État, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus. L'administration fiscale invoque alors l'improductivité générale de la forêt guyanaise pour lui étendre l'exonération.
Cette position ne paraît pas défendable pour des raisons matérielles et juridiques. D'abord, il est erroné de considérer la forêt guyanaise comme improductive de revenus puisqu'elle fait l'objet d'une exploitation et de concessions. Cependant, la jurisprudence administrative avait ouvert des voies d'exonération en considérant que le critère d'improductivité s'appréciait au regard du propriétaire et non du gestionnaire. Le Conseil d'État a considéré que si une forêt produit des revenus pour l'Office national des forêts mais pas pour l'État, alors elle est exonérée de TFNB. Ceci est désormais inopérant car la loi de finances rectificative pour 2008 a complété les articles 1394 et 1400 du code général des impôts pour exclure expressément du bénéfice de l'exonération les bois et forêts appartenant à l'État et gérés par l'Office national des forêts. Le code général des impôts assujettit clairement les forêts appartenant à l'État soumises au régime forestier à la taxe foncière, l'Office national des forêts étant désigné expressément comme redevable.
Reste à réaliser l'évaluation cadastrale des forêts soumises à la TFNB. Il est certain que l'instruction ministérielle de 1908, qui définit les règles de calcul, n'avait pas complètement prévu le cas d'une forêt d'essences aussi variées que celle de la Guyane. En outre, ce n'est pas tout le domaine forestier qui est soumis à une exploitation forestière mais seulement une fraction, le front d'exploitation se déplaçant d'année en année. Néanmoins, les comptes de l'Office national des forêts sont suffisamment détaillés pour permettre de calculer les rendements et les frais déductibles. L'évaluation de la valeur locative cadastrale paraît donc constituer une tâche complexe mais certainement pas impossible.
La dernière ligne de défense de l'administration fiscale est d'invoquer les coûts extrêmement élevés de l'évaluation cadastrale pour un produit qui serait nul. On peut comprendre la motivation de l'article 333 J de l'annexe 2 du code général des impôts, selon lequel en matière d'évaluation de la valeur locative des propriétés non bâties assujetties à l'impôt foncier « dans le département de la Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées ». Cependant, l'administration fiscale ne peut s'appuyer sur cette disposition pour justifier de ne pas réaliser l'évaluation cadastrale des parcelles concédées ou exploitées. C'est même tout l'inverse, puisque l'article 333 J précité impose a contrario précisément ce travail d'évaluation cadastrale de toutes les parcelles de forêts concédées ou exploitées en Guyane.
Nous ne demandons donc que la simple et stricte application du droit existant : en Guyane, l'Office national des forêts est redevable pour l'État de la TFNB sur les parties du domaine forestier qu'il exploite ; la détermination de la valeur locative cadastrale des parcelles exploitées doit être menée à bien pour calculer le montant dû aux communes.
Sans doute, la première phase d'évaluation cadastrale nécessitera-t-elle un effort pour établir des modalités de calcul adaptées aux spécificités de la forêt guyanaise, mais pour les années suivantes, il suffira de reprendre cette base. L'exonération temporaire que j'ai évoquée précédemment perdure jusqu'en 2018. Ce délai peut être mis à profit pour réaliser l'évaluation cadastrale et pour préparer l'Office national des forêts à assumer la charge financière supplémentaire qui en résultera.
Enfin, il nous semble nécessaire de redéfinir le positionnement des parcs nationaux. Les trois parcs nationaux de Guadeloupe, de La Réunion et de Guyane, ne sont pas toujours parvenus à tisser des liens de confiance avec l'Office national des forêts, les communes et la population. Les conflits tendent à s'envenimer, au préjudice de tous.
La politique des parcs nationaux répond encore trop à une logique verticale imposée par un État toujours suspicieux de la capacité des collectivités territoriales à servir l'intérêt général. Entre les communes et les parcs nationaux, des tensions sont apparues au moment de signer les chartes de parcs qui régissent la zone de libre adhésion. Les collectivités ont besoin d'être rassurées sur les intentions à long terme des parcs nationaux, qui ne doivent pas être instrumentalisés par l'État pour garder la mainmise sur le foncier ultramarin. Elles craignent d'être soumises à toujours plus de restrictions dans leur politique d'aménagement et de développement, au-delà même de la zone coeur qui leur échappe déjà.
De même, les habitants considèrent que certaines de leurs activités traditionnelles, comme la chasse au tangue à La Réunion, sont menacées par les parcs nationaux qui ne peuvent adopter une position maximaliste d'interdiction totale sans concertation avec la population. La garantie du maintien d'activités traditionnelles dans les zones gérées par les parcs nationaux est une condition nécessaire de l'adhésion de la population à la conservation de la biodiversité.
Contre la tentation de la mise sous cloche, au nom d'un intérêt patrimonial national, il convient de préserver les capacités d'action des communes dont le territoire est compris dans les parcs nationaux. De ce point de vue, le développement de nouvelles mines en Guyane et de nouvelles carrières à La Réunion ne doit pas être freiné, dès lors qu'ils ne compromettent pas la vocation même des parcs.

Je remercie nos collègues pour la qualité et la profondeur de leurs investigations. Voilà une base solide sur laquelle pourra s'appuyer le deuxième volet de notre étude triennale qui sera consacrée à la propriété foncière privée marquée par l'indivision généralisée et une superposition des régimes civil et coutumier. Je vous rappelle que Thani Mohamed Soilihi poursuit sa fonction de coordonnateur et que nous avons désigné MM. Jean-Jacques Hyest et Robert Laufoaulu comme rapporteurs sur ce deuxième volet.
Mes chers collègues, après les tables rondes de jeudi dernier sur la question de la biodiversité dans les outre-mer à l'épreuve du changement climatique, organisées par notre groupe de travail commun avec la commission du développement durable, nous nous retrouvons aujourd'hui sur le thème du foncier.
Concernant nos travaux en cours et à venir, je vous rappelle que, jeudi prochain, se tiendra salle Clemenceau la première édition de nos conférences économiques, celle relative aux entreprises et dynamiques sectorielles du Pacifique. Cette journée, dont l'ouverture sera effectuée par le président du Sénat à 9 h 15, sera extrêmement dense : 42 intervenants ont en effet répondu à nos sollicitations alors même que notre délégation ne peut prendre en charge aucun billet d'avion. La mobilisation exemplaire des acteurs économiques locaux révèle tout l'intérêt qu'ils portent à cette initiative de notre délégation dont l'objectif est de contribuer à une meilleure connaissance et à une plus forte visibilité dans l'Hexagone des contraintes et potentiels des territoires du Pacifique.
J'en profite pour saluer la présence parmi nous de notre collègue polynésien Nuihau Laurey, élu début mai.
Concernant l'activité événementielle de la délégation, une nouvelle manifestation pourrait être organisée le 30 septembre prochain sur le thème du développement du tourisme dans les outre-mer : il s'agit d'un secteur d'activité clé pour l'ensemble de nos outre-mer et la tenue, à cette période, du salon Top Resa nous permettrait de faire témoigner de nombreux acteurs locaux. Quelques semaines avant la tenue de la Conférence des parties à Paris sur le climat, nous pourrions mettre l'accent sur les enjeux du changement climatique pour ce secteur d'activité et sur les potentiels de nos outre-mer en matière de tourisme durable. Cette manifestation pourrait être organisée en partenariat avec la FEDOM.
Mais revenons à notre étude triennale sur le foncier dans les outre-mer dont les rapporteurs, Thani Mohamed Soilihi, à l'origine du choix de cette thématique et désigné comme rapporteur coordonnateur, et nos collègues Joël Guerriau, Serge Larcher et Georges Patient, rapporteurs du premier volet de la trilogie qui est centré sur la gestion du domaine de l'État.
Pour instruire ce premier volet, il leur a fallu récolter l'information, une information toujours éparse et difficile d'accès comme pour tous les sujets concernant les outre-mer.
Outre les nombreux questionnaires adressés aux services déconcentrés et aux juridictions dans l'ensemble des outre-mer, huit auditions plénières ont été organisées au Sénat au cours desquelles seize personnes ont pu témoigner. Au nombre de ces auditions figure la visioconférence organisée avec la préfecture de La Réunion.
Les rapporteurs et moi-même nous sommes par ailleurs rendus sur le terrain, en Guyane, à la Martinique et à Saint-Martin du 13 au 19 avril : 30 auditions ont eu lieu sur le terrain qui ont permis d'entendre près de 70 témoignages.
On peut donc affirmer que les analyses et conclusions de nos rapporteurs sont particulièrement étayées ! Avec des photos prises au cours du déplacement illustrant leur présentation, ils vous feront partager leurs impressions.
Mais avant de leur donner la parole, je vous propose de désigner les rapporteurs qui viendront rejoindre notre collègue Thani Mohamed Soilihi, en charge de la coordination des travaux sur les trois volets de l'étude sur le foncier, pour instruire le deuxième tome centré sur la problématique du titre de propriété, de l'indivision et de la combinaison des régimes juridiques coutumiers avec notre droit civil. Ces questions sont tout particulièrement prégnantes à Mayotte et dans les collectivités du Pacifique.
J'ai reçu les candidatures du président Jean-Jacques Hyest, fin privatiste et connaisseur de nos outre-mer, de Robert Laufoaulu qui avait d'ailleurs proposé le foncier comme sujet d'étude lors de la programmation des travaux de la délégation, ainsi que celle de Joël Guerriau. Y a-t-il d'autres candidatures ?
Avant de désigner nos rapporteurs, je veux rappeler quelques principes garants du bon fonctionnement de notre délégation depuis sa création :
- la constitution de binômes de rapporteurs doit permettre de ménager un regard croisé de l'outre-mer et de l'Hexagone ainsi qu'une répartition politique équilibrée des dossiers ;
- la désignation de rapporteurs différents pour chaque nouveau dossier doit permettre une implication directe du plus grand nombre de membres de la délégation. Je sais que les travaux de la délégation retiennent l'intérêt de plus en plus de collègues - nous ne pouvons d'ailleurs que nous en féliciter ! - mais il faut savoir partager et accepter la rotation. Je rappelle à cet égard, concernant la thématique du foncier, que la désignation d'un rapporteur coordonnateur décidée le 9 décembre, qui peut à première vue paraître en contradiction avec cet impératif de rotation, a été dictée par la complexité du sujet et la nécessité d'éviter les chevauchements entre les trois volets de l'étude (1 : la gestion du domaine de l'État ; 2 : le titre de propriété confronté à l'indivision et aux conflits de régimes juridiques ; 3 : les conflits d'usage du foncier au coeur de la définition des politiques publiques).
Par ailleurs, et afin que la délégation dispose de tous les éléments d'appréciation, je dois invoquer la contrainte budgétaire : la thématique du deuxième volet de l'étude devrait conduire les rapporteurs à se déplacer à Mayotte et dans les collectivités du Pacifique. Il me semblerait donc raisonnable cette fois de nous en tenir à deux rapporteurs, ce qui me conduit à me tourner vers les candidats déclarés au nombre de trois.
* 1 « L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »