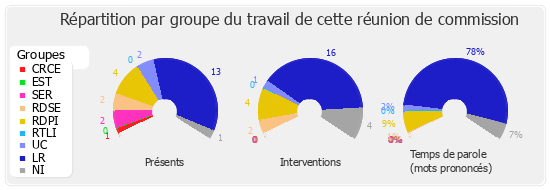Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation
Réunion du 2 novembre 2016 à 16h00
Sommaire
- Loi de finances pour 2017
- Projet d'instauration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - communication (voir le dossier)
- Mission « économie » et compte de concours financier ccf « prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » - examen du rapport spécial (voir le dossier)
La réunion
La réunion est ouverte à 16 heures.
La commission entend une communication de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, sur le projet d'instauration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.

Poursuivons nos travaux préparatoires à l'examen de l'article 38 du projet de loi de finances pour 2017, qui figure au sein des articles non rattachés de deuxième partie et qui prévoit l'instauration d'un prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.
Nous avons procédé à trois séries d'auditions ; le rapporteur général a souhaité nous présenter l'état de ses analyses et de sa réflexion sur ce projet de réforme du mode de collecte de l'impôt sur le revenu.

Un débat intéressant sur les taxis et les VTC débute dans dix minutes dans l'hémicycle. Les réunions de commission organisées en même temps nous contraignent à nous partager.

Si nous ne devions pas nous réunir pendant les séances publiques, nous ne pourrions pas examiner toutes les missions en commission qu'en travaillant tôt le matin avant la séance publique, et aux interruptions du déjeuner et du dîner.

Les auditions en commission ont été extrêmement intéressantes. Nous avons également recueilli de nombreuses contributions écrites ; l'espace participatif que nous avons ouvert a reçu près de 4 000 contributions. Après la présentation du projet par le directeur général des finances publiques, il est temps de vous faire part de mes premières conclusions.
Si le Gouvernement le présente comme un enjeu de modernisation, le prélèvement à la source est une idée ancienne qui remonte aux années 1930, très peu de temps après l'instauration de l'impôt général sur le revenu en 1914. Un décret-loi de 1939, supprimé en 1948, l'avait créé. Une nouvelle proposition fut faite en 1953, avec un système de versement d'acomptes, mais la réforme fut emportée par la chute du gouvernement. Quinze ans plus tard, Michel Debré initia une réflexion sur l'imposition des revenus, comportant le prélèvement à la source, qui échoua en mai 1968. Les syndicats nous l'ont rappelé : les accords de Grenelle indiquaient explicitement qu'il ne serait jamais proposé d'assujettir les salariés au régime de la retenue à la source.

La question fut de nouveau débattue au début des années 1970 lors de l'examen du budget pour 1974, par voie d'amendement instaurant un dispositif de retenue à la source. Ce projet fut supprimé par le Sénat, qui avait mis en évidence les faiblesses du dispositif, notamment les problèmes de confidentialité inhérents à la transmission de données fiscales, les lourdeurs pour les contribuables devant régulariser ex post, ou encore l'effet anesthésiant du prélèvement à la source, qui rend les augmentations d'impôts moins visibles.
Qu'en est-il de la réforme qui nous est proposée aujourd'hui ? Les obstacles qui avaient expliqué son rejet lors des tentatives précédentes peuvent-ils être levés ? S'agit-il vraiment, comme le Gouvernement le clame, d'une réforme de modernisation et de simplification, attendue par les Français et qui rapprocherait le mode de recouvrement de l'impôt sur le revenu de la France de celui de la quasi-totalité des pays de l'OCDE ?
Le dispositif proposé comprend vingt pages de modifications du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres codes ; il est accompagné d'une évaluation préalable, très complète, de 413 pages, enrichie à la demande du Parlement. Il s'agit, à compter du 1er janvier 2018, de mettre en place une contribution aux charges publiques contemporaine de la perception des revenus. Ce prélèvement ne concernerait qu'une partie des revenus, en l'espèce les traitements, salaires et pensions, le collecteur étant le payeur, c'est-à-dire l'employeur privé, l'administration publique ou la caisse de retraite ; le reversement aurait lieu le mois ou le trimestre suivant en fonction de la taille du collecteur ; les revenus des travailleurs indépendants, revenus fonciers, pensions alimentaires, rentes viagères, certains revenus de source étrangère, ne seront pas prélevés à la source, mais payés sous forme d'acomptes directement versés à l'administration fiscale.
Le taux de la retenue à la source et le montant de l'acompte seraient calculés selon une formule complexe fondée sur les revenus de l'année n-2 et n-1 - ce n'est pas si contemporain. Concrètement, en janvier 2018 s'appliquera le taux calculé à partir des revenus de 2016 déclarés au printemps 2017, le taux étant rafraîchi, pour reprendre les termes du Gouvernement, en septembre, sur la base des déclarations de revenus au titre de l'année 2017.
Le taux du prélèvement sera transmis par l'administration fiscale à l'employeur en utilisant autant que possible - la formule mérite d'être précisée - les outils existant déjà pour la déclaration sociale nominative (DSN). Ces mêmes outils serviront pour le reversement au Trésor public.
Il y aura toujours une déclaration d'impôt par foyer afin de régulariser le solde de l'impôt sur le revenu. Ainsi, pour les revenus de 2018, la régularisation interviendra à l'été 2019, pour la restitution de l'administration fiscale en cas de trop perçu, ou entre septembre et décembre 2019, pour le versement du solde restant dû. Le prélèvement à la source entraînera bien plus de régularisations qu'actuellement.
Ce projet pose un grand nombre de difficultés, qui ne sont pas seulement des imperfections techniques mais aussi des difficultés de fond qui ne concernent pas, comme on tente de nous le faire croire, une minorité de contribuables.
En premier lieu, le projet place l'employeur au centre de la relation entre le contribuable et l'administration fiscale, ce qui crée un grand nombre d'effets indésirables.
Tout d'abord, il crée de nouvelles charges, non compensées, pour les entreprises, adaptation de leur système de paie, gestion quotidienne du prélèvement, temps passé à répondre aux questions de leurs salariés, nouvelles responsabilités juridiques. On pourrait me rétorquer que les entreprises prélèvent déjà la CSG, mais celle-ci n'a pas un taux individualisé !
Toutes les entreprises, notamment les plus petites d'entre elles, ne seront pas prêtes à passer à la DSN qui doit être généralisée au 1er juillet 2017. Le Gouvernement, par la voix du directeur général des finances publiques, reconnaît travailler sur des versions allégées pour pallier ces difficultés. Enfin, les administrations publiques ne sont pas concernées par le passage à la DSN. Personne n'est capable de nous dire par quel moyen s'effectueront les prélèvements et les reversements pour les agents publics. Les armées, déjà confrontées au logiciel Louvois, pourraient être dans l'incapacité d'effectuer le prélèvement à la source, et cela est vraisemblablement le cas pour d'autres administrations publiques.
Ensuite, l'introduction d'un tiers, l'employeur, pose la question du respect de la confidentialité des données fiscales. L'employeur aura accès au taux de prélèvement, qui donne des indications sur la situation fiscale du salarié. Un couple pourra certes opter pour un taux individualisé, s'il ne veut pas révéler sa situation, mais celui-ci sera calculé et proposé par l'administration. Le contribuable pourra également demander que son taux ne soit pas transmis à son employeur, mais dans ce cas, le collecteur devra appliquer un taux proportionnel sur la base d'une grille de taux par défaut, bien sûr dissuasive : celle d'un célibataire sans enfant. Tout est fait pour éviter le recours à ce taux. En outre, il incombera à celui qui demande à bénéficier du taux neutre d'acquitter au fur et à mesure de la perception de ses salaires, le montant de retenue à la source dont ces derniers auraient fait l'objet, s'il existe un différentiel. Le recours à un taux neutre fera forcément naître la présomption que le salarié concerné dispose d'autres revenus qu'il cherche à occulter.
Enfin, la retenue à la source aura des incidences sur la relation entre l'employeur et le salarié, voire entre les salariés eux-mêmes. L'une des personnes auditionnées a cité l'exemple d'une personne qui gagnerait davantage qu'une autre, pour un salaire net inférieur. De nouvelles revendications pourraient naître. La connaissance du taux de prélèvement de chaque salarié pourra avoir des effets sur les négociations salariales individuelles. De plus, toute évolution de l'impôt se traduisant immédiatement sur la feuille de paye, les salariés seront conduits à négocier plus directement des augmentations de salaires.
Il faut souligner le caractère imparfait de la contemporanéité du prélèvement. Le paiement à n+1 constitue en effet une bizarrerie. Si le principal objectif de la réforme est de rapprocher le prélèvement de la perception des revenus, l'adaptation de l'impôt sera très imparfaite. Le nouveau système sera moins souple que l'actuel et le décalage d'un an ne sera pas résorbé : le taux de prélèvement sera historique, puisqu'établi sur le fondement des revenus de l'année n-2 puis, à compter de septembre, rafraîchi des revenus de l'année n-1. La contemporanéité portera exclusivement sur l'assiette.
Pour le calcul du taux, les réductions et crédits d'impôt ne seront pas pris en compte - une véritable atteinte au pouvoir d'achat. Leur bénéfice sera conservé mais la restitution n'aura lieu qu'en août de l'année n+1. Prenons l'exemple d'un couple faisant appel à une garde d'enfants, qui déduit à ce titre 7 500 euros sur 8 500 euros d'impôt : il ne paie que 1 000 euros. Dans le nouveau système, ce couple se verra chaque mois prélevé selon un taux qui ne tient pas compte de la réduction ; ce n'est qu'en août de l'année n+1 que la restitution aura lieu.
Pour certains contribuables, qui ont un emploi une partie de l'année ou qui débutent une activité en cours d'année après avoir été rattachés au foyer fiscal de leurs parents, le prélèvement à la source s'appliquera d'emblée, alors même que leurs revenus sur l'année pourraient ne pas être imposables. Ce n'est également qu'en août de l'année suivante qu'ils seront remboursés.
Quant aux évènements de la vie, ils ne sont pas tous pris en compte. En cas de mariage, Pacs, décès, divorce, l'administration calculera un nouveau taux de prélèvement ou d'acompte. Cependant, pour une naissance, le taux du prélèvement ne sera pas automatiquement ajusté. Il devra l'être sous la seule responsabilité du contribuable et selon un mécanisme particulièrement complexe à mettre en oeuvre. Or, l'application du quotient familial doit permettre de tenir compte des naissances en cours d'année.
Le système proposé est également particulièrement rigide pour moduler les versements en cours d'année. La modulation à la hausse sera encouragée, mais à la baisse, elle sera strictement encadrée et exposera les contribuables concernés à des sanctions significatives en cas d'erreur. De même, dans le cadre du prélèvement à la source, les recours gracieux, pour obtenir un délai de paiement, ne seraient plus possibles, puisque, comme dirait La Palice, les contribuables auront déjà payé. Concrètement, les difficultés de trésorerie ne seront pas prises en compte, qu'il s'agisse d'une maladie ou de l'accueil d'un proche dépendant.
Enfin, l'année de transition n'est pas traitée de manière satisfaisante. Les revenus non exceptionnels doivent être annulés par un crédit d'impôt ad hoc. Si le projet est voté, les impôts de 2017 auront pour base les revenus de 2016, tandis que les impôts de 2018 auront pour base les revenus de 2018. Afin d'éviter les optimisations, le projet recense les revenus exceptionnels de 2017 dont il est justifié qu'ils restent imposés, tels que les prestations de retraite servies sous forme de capital, les aides pour la reprise d'une activité professionnelle, les sommes perçues au titre de la participation ou de l'intéressement. Cependant sont exclus « les gratifications surérogatoires, quelle que soit la dénomination retenue par l'employeur » et « tout autre revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement ». Ces formulations, très floues, pourront laisser place à des interprétations. Imaginez des salariés recevant des primes : est-ce de l'exceptionnel ou du récurrent ? L'administration fiscale devra étudier chaque contrat de travail... Imaginez les difficultés ! La tâche est tellement complexe que le projet porte le droit de reprise de l'administration fiscale de trois à quatre ans. On aurait pu, plus simplement, calculer une moyenne.
La liste de ces difficultés n'est pas exhaustive. Je vous renvoie à mon rapport écrit et aux contributions que j'ai reçues. Le Gouvernement a fait le choix d'un système inutilement complexe pour répondre à un objectif qui aurait pu être atteint par d'autres moyens. Nous avions demandé une étude des réformes alternatives dans le rapport. Aucune argumentation convaincante n'a été fournie contre elles.
Tout d'abord, la mise en place d'une retenue à la source collectée par les employeurs par la plupart des pays de l'OCDE ne signifie pas qu'il s'agisse de la seule solution pour rendre l'impôt contemporain. C'est l'argument principal qui nous est opposé. Mais aucun pays ne cumule un impôt familialisé avec de nombreuses dépenses fiscales et des systèmes d'imposition très divers selon les catégories. Un impôt familialisé est très difficilement compatible avec un système de prélèvement à la source, par définition individualisé. L'administration a répondu à l'absence de prélèvement à la source par des outils extrêmement performants tels que la télédéclaration, la mensualisation et les modes de paiement modernes.
Dans nombre de pays ayant déjà institué un mécanisme de prélèvement à la source, comme les États-Unis, l'Australie et le Canada, celui-ci ne concerne que les salaires. À l'étranger, l'instauration d'un prélèvement à la source n'a en rien constitué une simplification. Cela n'a jamais été l'objectif du prélèvement à la source. Instauré dans les années vingt en Allemagne et trente en Italie, il avait pour but d'améliorer le recouvrement. Le Conseil des prélèvements obligatoires, en 2012, mettait en évidence que le système de gestion de la retenue à la source en Allemagne présentait une simplicité de gestion « très limitée ».
Si la France compte parmi les seuls pays de l'OCDE - avec la Suisse - à ne pas avoir établi un prélèvement à la source, c'est parce qu'elle a développé des outils très perfectionnés pour la collecte de l'impôt. L'administration fiscale a très largement fiabilisé son taux de recouvrement de l'impôt sur le revenu, qui atteint en 2015 plus de 98 %. C'est l'un des plus élevés au monde. Il n'y a donc rien à attendre, de ce point de vue, du prélèvement à la source.
Le Conseil des prélèvements obligatoires a logiquement conclu que plusieurs arguments forts autrefois ont aujourd'hui perdu de leur poids, et que la retenue à la source n'entraînerait ni une simplification des tâches des contribuables, ni une amélioration du recouvrement, ni des économies de gestion significatives dans l'administration. Le directeur général des finances publiques a même reconnu que la mesure provoquerait un pic d'activité, et qu'elle ferait économiser au maximum 1 200 postes, à terme.
Il existe divers outils à la disposition des contribuables facilitant la gestion de leur trésorerie, qu'il s'agisse de délais de paiement ou de la modulation des acomptes ou des prélèvements.
Pourquoi changer un système qui fonctionne ? Cela ne signifie pas qu'il ne faut rien faire, notamment pour supprimer le défaut majeur de notre système : le décalage d'une année entre la perception et l'imposition du revenu. Nous avons des réponses. Je préconise un prélèvement mensualisé et contemporain sous forme d'acomptes sur douze mois, supprimant le décalage d'un an pour mieux coller à la réalité des revenus. Le lien direct et exclusif avec l'administration fiscale, qui fonctionne aujourd'hui, serait conservé, sans l'introduction de tiers.
Pour les contribuables dont le revenu demeure stable d'une année sur l'autre, la réforme améliorerait le lissage du paiement de l'impôt au cours de l'année. Elle procurerait un gain de trésorerie estimé à près de 17 % de la mensualité, équivalent à celui prévu dans le projet gouvernemental. De plus, elle prendrait en compte les réductions et crédits d'impôt historiques dans le calcul des acomptes. Dans mon exemple précédent, celui d'une famille qui jouit de réductions d'impôts pour garde d'enfant, l'acompte mensuel en tiendrait compte. Le prélèvement à la source sera bien moins populaire quand les contribuables auront compris qu'il leur reviendra de débourser l'avance de trésorerie.
Dans l'hypothèse où un contribuable serait confronté à une baisse importante de ses revenus en cours d'année - ce qui concerne une infime minorité de contribuables, puisque sur les 17 millions de foyers titulaires de traitements, salaires et pensions effectivement imposés, seuls 2,4 % ont vu leurs revenus diminuer de plus de 30 % entre 2014 et 2015 - la mensualisation contemporaine donnerait la possibilité de demander la baisse du montant des mensualités dès le mois suivant, puisque l'impôt serait dû au titre des revenus courants et non des revenus de l'année précédente. Le système de modulation serait ainsi infiniment plus souple.
L'instauration du prélèvement mensualisé et contemporain pourrait s'accompagner d'un ensemble de mesures complémentaires pour faciliter le paiement de l'impôt, en particulier en cas de baisse soudaine et prononcée des revenus, pour les travailleurs indépendants ou ceux qui arrêtent une activité professionnelle. La réforme ne créerait pas d'inégalités entre contribuables puisque tous seraient soumis à un seul système, celui des acomptes.
Enfin, et c'est une difficulté commune aux deux régimes, il conviendrait de traiter l'année de transition. Je propose plutôt qu'une définition floue des revenus non exceptionnels, un dispositif fondé sur la moyenne des revenus sur plusieurs années.
Le système que je propose est plus simple, moins coûteux pour les entreprises, beaucoup moins fécond en régularisations, et plus respectueux de la confidentialité du fait de la relation directe entre le contribuable et l'administration fiscale.
En conclusion, la réforme telle qu'elle est présentée par le Gouvernement crée beaucoup plus de difficultés qu'elle n'en résout. Engagement du candidat François Hollande en 2012, l'instauration du prélèvement à la source est présentée en toute fin de mandat, alors même qu'elle ne sera manifestement pas prête au 1er janvier 2018 - les administrations ne le peuvent pas. Il s'agit seulement de tenir une promesse, sauf à considérer que le prélèvement à la source dissimule un autre agenda fiscal - réduction de certaines niches fiscales et surtout fusion entre la CSG et l'impôt sur le revenu. Je ne veux pas y croire. Ne changeons pas ce qui fonctionne et gardons-nous des usines à gaz.

Le prélèvement à la source représente une belle avancée. Il ne s'agit pas de « faire comme tous les autres pays » mais d'instaurer une mesure de simplification et de supprimer le décalage d'un an entre la perception du revenu et son imposition, qui crée une vraie injustice car l'imposition ne correspond plus à ce que l'on perçoit. Le rapporteur général évoque les 2,4 % de foyers subissant une baisse de 30 % de leurs revenus, mais beaucoup peuvent en perdre 10 % à 20 %. Nous voulons nous préoccuper de ceux qui subissent des accidents de la vie, perdent leur emploi ou déménagent et n'ont pas les moyens de payer leurs impôts.
La confidentialité de l'impôt n'est absolument pas mise en cause. L'entreprise ne dispose que du taux d'imposition de ses salariés. J'étais initialement de ceux qui auraient préféré que les banques, seules à connaître tous les revenus de leurs clients, soient chargées de la collecte. Le choix s'est porté sur les entreprises, dont acte. Je ne crois pas que celles-ci en subiront les conséquences, puisque l'administration fiscale sera chargée de régler les problèmes.
Le prélèvement par un tiers ne présente aucune difficulté. La familialisation, elle, est source de complexité.

Mais le Gouvernement n'a pas voulu la remettre en cause. La complexité engendrée ne pèse que sur l'administration fiscale, étant entendu qu'un foyer sur deux ne paie pas l'impôt sur le revenu.

Environ 90 % des foyers fiscaux qui paient l'impôt sur le revenu sont des salariés sans situation particulière.
L'instauration du prélèvement à la source n'est pas uniquement la traduction d'une promesse électorale, quoiqu'il soit bon de tenir ses promesses. En outre, il n'est pas possible de tout mettre en place dès la première année d'un quinquennat qui, par définition, en compte cinq.
Les difficultés pour les niches fiscales sont réelles, je le reconnais. Quant à la familialisation, nous sommes tous d'accord pour ne pas y toucher.

Nous assumons l'évolution du quotient familial, mesure de justice. En revanche, nous ne sommes plus favorables aujourd'hui à la fusion entre l'impôt sur le revenu et la CSG - il est donc inutile d'exciter les peurs à ce sujet. Les Français pensent que le niveau d'imposition est élevé, à tort ou à raison, car les mêmes qui ne veulent pas payer souhaitent des services publics améliorés. Quoi qu'il en soit, reconnaissons, à droite comme à gauche, que nous avons perdu la bataille explicative de ce qu'est l'impôt. La fiscalité locale pèse davantage pour les Français que l'impôt sur le revenu, malgré les 19 milliards d'euros d'augmentation décidés au cours du quinquennat précédent, et les 19,5 milliards d'euros au cours de ce quinquennat, soit 38 milliards d'euros en deux quinquennats. La fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG serait une erreur sociale et fiscale.
Nous pensons que le prélèvement à la source offre plus de justice sociale et fiscale, un paiement contemporain sans problème de confidentialité. Le choix de préférer un prélèvement sur dix mois, et non douze, a été fait pour ne pas perturber le compte en banque de nos concitoyens. Cette belle avancée doit être mise en place le plus vite possible, car elle est souhaitée par nos concitoyens et va vers plus d'équité.

Je salue le travail du rapporteur général et la qualité des auditions, éclairantes. Que diable le Gouvernement est-il allé faire dans cette galère ? Il aurait mieux valu y réfléchir en 2012. Le coût n'a pas été mesuré. Didier Guillaume évoque une mesure de justice, mais les gens paieront la même somme.
Tous les interlocuteurs ont démontré la difficulté de l'exercice. Le système ne sera jamais prêt pour le 1er janvier 2018 et crée des difficultés pour les entreprises et les collectivités territoriales, alors qu'une autre solution, bien plus simple, existe. Pourquoi ne pas proposer de s'engager dans cette direction-là ? Peut-être le prélèvement à la source cachait-il la fusion de la CSG avec l'impôt sur le revenu. Nous n'aurons jamais le fin mot de l'affaire. Mais puisque les socialistes y renoncent, pourquoi ne pas renoncer également au prélèvement à la source ? Didier Guillaume dit que les Français y sont favorables. Oui, car ils pensent que ce sera une mesure d'une extrême simplicité. Quand ils découvriront la réalité, ils déchanteront.
Les avancées proposées par le rapporteur général sont suffisantes.

Nous sommes bien cartésiens : nous souhaitons toujours présenter un dispositif d'emblée parfait. Le rapport d'évaluation compte 413 pages parce que notre fiscalité est complexe et qu'il faut l'expliciter pour chacune des situations.
Les organisations syndicales sont toujours contre les nouvelles mesures. Elles étaient déjà contre la télédéclaration. Mais, en conclusion de leur audition, elles ont bien indiqué vouloir réussir la réforme.
Pour les personnes recevant des salaires, des pensions ou des retraites, qui représentent la très grande majorité des contribuables, tout est simple. Elles n'auront, grâce à la déclaration préremplie, rien d'autre à faire qu'une télédéclaration.
Les collectivités territoriales transmettent déjà les éléments concernant les fonctionnaires, sans DSN, les éléments permettant d'élaborer la déclaration préremplie. On évoque le coût pour les entreprises ou les collectivités territoriales, mais dans le Tarn, 800 fonctionnaires sur 2 000 demandent à bénéficier une aide, sans coût excessif.
J'en viens aux taux rafraîchis. Les personnes dont les revenus baissent ont la possibilité de modifier leurs paiements, mais elles sont très peu nombreuses à le faire. Dans le nouveau système, dès lors que le salaire diminuera, la baisse sera immédiate, même si le taux n'est pas celui de l'année n.
La mensualisation à douze mois et non dix conduit à un prélèvement identique, même en cas de baisse, sauf à signaler une modification : c'est aussi complexe que le prélèvement à la source.
Pour certains contribuables, le nouveau système sera plus compliqué. Mais pour la très grande majorité des contribuables, ce sera une amélioration.

Plus on avance dans ce dossier, plus on cherche la belle avancée. L'extension du droit de reprise de l'administration fiscale, de trois à quatre ans, est extrêmement grave. C'est le recul d'un droit fondamental des contribuables. La possibilité de recours gracieux plaide également pour un lien exclusif entre contribuable et administration fiscale. En effet, elle ne peut concerner que ce qui n'est pas payé. C'est un véritable problème. La solution du rapporteur général est la bonne. Simple, elle résout les difficultés qu'il a soulevées.
Pourquoi le Gouvernement s'entête-t-il ? Il remet l'entrée en vigueur du dispositif à plus tard, en sachant très bien qu'il n'aura pas à s'en charger. Si l'administration fiscale a besoin de quatre ans et non de trois pour traiter les dossiers, c'est bien que le prélèvement à la source n'est pas simple.

J'ai suivi les auditions avec un grand intérêt. Le rapporteur général présente une variante intéressante. Est-elle pour autant à retenir ? Didier Guillaume et Thierry Carcenac ont développé les arguments démontrant que la réforme est réalisable. Le directeur général des finances publiques a répondu aux questions.
Je suis en revanche préoccupé par l'état d'esprit dans lequel cette réforme est abordée. Le représentant du Medef l'a jugée inutile, selon une position de principe. Celle de Force ouvrière a déclaré que ce n'était pas ce que son syndicat voulait. On a entendu dire, ces dernières semaines, que l'État serait gagnant et les contribuables perdants, le quotient familial menacé, la hausse des impôts inévitable, le risque de cavalerie budgétaire accru, le consentement à l'impôt nié... Ce contexte politisé, insatisfaisant, empêche d'étudier objectivement la réforme à engager. Le paiement mensualisé contemporain est intéressant, mais pourquoi s'arrêter à mi-chemin quand on peut instaurer le prélèvement à la source ?

Une mesure de simplification ? Avec recul et objectivité, je réponds non. Le nombre de cas de régularisation sera accru. La contemporanéité ? Mon système l'offre aussi. L'année de transition est complexe dans les deux cas. Quant à la familialisation, la jurisprudence stricte du Conseil constitutionnel laisse peu de marge de manoeuvre.
Didier Guillaume souligne que l'entreprise connaîtra le taux d'imposition de ses salariés. Si l'un d'entre eux se voit appliquer un taux trois fois plus élevé que les autres, à salaire égal, c'est bien qu'il perçoit d'autres revenus. Pourquoi l'administration a-t-elle dû créer un « taux neutre » ? C'est qu'il y a un problème !
Certains disent que le prélèvement à la source ne changera pas grand-chose pour la plupart des contribuables. Tout de même : 9,6 millions de foyers fiscaux - ce n'est pas négligeable - ont bénéficié de réductions ou de crédits d'impôts. Ils assureront tous la trésorerie de l'administration fiscale.
Dans leur rapport sur la fiscalité des ménages d'avril 2014, Dominique Lefebvre et François Auvigne estimaient à deux à trois ans le délai incompressible de mise en place de la retenue à la source.
Thierry Carcenac, le système fiscal est si complexe qu'il en est incompatible avec le prélèvement à la source. Une personne divorcée pourra être concernée à la fois par le prélèvement à la source, sur son salaire, et par l'acompte sur la pension alimentaire. C'est particulièrement compliqué.
Dans mon système, le contribuable aura la possibilité de moduler son revenu à la baisse. Il lui suffira de se rendre sur le portail de la DGFiP.
L'extension du délai du droit de reprise de l'administration fiscale ne concerne que l'année de transition. Par définition, les recours gracieux sur l'impôt sur le revenu disparaîtront. Ils se feront vraisemblablement davantage sur les impôts locaux.
François Marc, je n'ai pas repris certaines formulations que vous avez citées mais pourquoi introduire un tiers payeur, ce qui crée des problèmes de confidentialité ? Pourquoi avoir créé une réforme aussi complexe à mettre en oeuvre ?
La commission donne acte à M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, de sa communication et en autorise la publication sous la forme d'un rapport d'information.
La commission procède à l'examen du rapport de MM. Jacques Chiron et Bernard Lalande, rapporteurs spéciaux, sur la mission « Économie » et sur le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ».

La mission « Économie » est un ensemble hétéroclite de dispositifs en faveur des entreprises, et notamment des PME dans les secteurs de l'artisanat, du commerce et de l'industrie. Ils prennent la forme de subventions, de prêts, de garanties ou encore d'exonérations fiscales. Cette mission comprend aussi les crédits des administrations, autorités administratives indépendantes et opérateurs chargés de la mise en oeuvre de ces politiques.
Sans tenir compte des importants changements de périmètre qui interviennent cette année, les crédits de la mission « Économie » demeurent stables en 2017, s'élevant à 1,9 milliard d'euros - soit une hausse de 0,4 %.
Le programme 134 « Développement des entreprises et du tourisme », qui comprend la moitié de ces crédits, affiche une baisse de 1,1 % inégalement répartie. Les dépenses de personnel augmentent de 1,8 %, ce qui, compte tenu de leur rigidité, représente un effort réel : 22 équivalents temps plein (ETP) sont supprimés en 2017, pour un plafond d'emplois de 5 079 équivalents temps plein travaillé (ETPT). La stabilité des dépenses de fonctionnement, au contraire, est plutôt le signe d'un effort insuffisant, alors qu'il existe encore des marges de manoeuvre, en particulier en matière d'immobilier ou de fournitures. Les subventions aux opérateurs diminuent de 2,9 %, une baisse essentiellement supportée par Business France - j'y reviendrai. Mais l'essentiel de l'effort budgétaire de ce programme réside dans la réduction continue des crédits d'intervention en faveur des entreprises, qui affichent une baisse de 6,4 % (16,2 millions d'euros). Cette réduction est en elle-même nécessaire, tant les dispositifs concernés sont multiples, peu lisibles et gérés en silo par des intermédiaires peu évalués. Reste que la logique du rabot finira par trouver ses limites, et qu'il faudra bien mener un jour remettre les choses à plat - cet effort de rationalisation est au demeurant déjà engagé.
Ainsi du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (Fisac) dont la dotation baisse encore de 9 % en 2017 pour s'établir à 16,5 millions d'euros, en cohérence avec la réforme de 2014 organisant le passage d'une logique de guichet à une logique d'appel à projets. Mais cette réforme n'a pas rendu la programmation budgétaire plus fiable pour autant. Voici deux exemples. L'année dernière, nous avions demandé, avec la présidente Michèle André, le déblocage de 12,5 millions en faveur des stations-service de proximité, pour traiter le stock de dossiers en attente : le Gouvernement avait refusé... pour finalement débloquer cette somme en mai 2016. Deuxième exemple : la mobilisation d'un million d'euros du Fisac pour la revitalisation des centres-villes, annoncée il y a dix jours par la secrétaire d'État chargée du commerce et de l'artisanat, Martine Pinville.
Le programme 220, qui porte les crédits de l'Insee, s'élève à 454 millions d'euros en 2017. La hausse de 3,8 % tient surtout à la rallonge de 11 millions d'euros compensant la baisse de recettes liée à la prochaine entrée en vigueur de la gratuité des données publiques. Pour le reste, l'Insee mène un effort notable de maîtrise de ses dépenses, soumis cependant aux incertitudes qui entourent le déménagement au Centre statistique de Metz. Seuls 315 agents étaient présents à la mi-2016, sur les 400 attendus pour 2017 - objectif déjà revu à la baisse. Un certain nombre de ces agents ont été recrutés pour l'occasion en externe, ou sont issus d'autres administrations...
Les crédits du programme 305 sont stables, à 427 millions d'euros. Après une forte baisse ces dernières années, la subvention à la Banque de France (250 millions d'euros) ne varie plus : visiblement, les économies liées à l'allègement des procédures de surendettement ont atteint leurs limites, du moins à court terme. Il convient désormais de dégager des économies structurelles dans les coûts fixes.
On note aussi une hausse des dépenses de personnel des services économiques de la direction générale du Trésor, en dépit de la rationalisation de son réseau international. Réaliser des économies en regroupant certains postes à l'étranger sans compromettre les capacités de la France est un exercice difficile. Nous avons néanmoins pu constater, lors de notre visite au consulat français de San Francisco en avril 2015, l'efficacité du travail et la bonne coopération entre les agents de la direction générale du Trésor, de Business France et de Bpifrance.
Ces deux dernières entités sont, dans le domaine de l'action internationale, les deux grands succès de ces dernières années, qui posent les bases d'un véritable État stratège à l'exportation.
La création de Business France en 2015 a rassemblé en un seul opérateur l'action de l'État en matière de soutien à l'exportation et d'attraction des investissements étrangers. Sur le fond, c'est une nette réussite : l'objectif de 10 000 PME et ETI accompagnées à l'exportation devrait être tenu dès cette année, avec près de quatorze mois d'avance. Nous avons régulièrement entendu saluer l'action de l'organisme au cours de notre déplacement aux États-Unis : si quelque chose a changé, c'est qu'aujourd'hui nous vendons nos produits plutôt que nos entreprises...
Sur le plan budgétaire, la fusion d'Ubifrance et de l'Agence française des investissements internationaux (Afii) a également permis des gains de productivité, même si des économies sont encore possibles. Surtout, Business France a développé une véritable offre commerciale avec l'objectif d'en tirer plus de la moitié de ses ressources. Les premiers stades de l'accompagnement des PME sont gratuits - avec un ticket modérateur - car ils relèvent d'une mission de service public. En revanche, les prestations récurrentes et personnalisées sont facturées à hauteur de 50 % des coûts pour les phases de personnalisation et d'amorçage, et jusqu'à 100 % avec marge pour les grands groupes. Dès 2015, ces recettes commerciales ont atteint 90,7 millions d'euros, au lieu des 80 millions prévus, soit 46 % des ressources de l'opérateur. Cette politique d'autonomie financière explique la baisse de 3,2 % de la dotation budgétaire de l'agence, fixée à 98,1 millions d'euros pour 2017.
La faible présence de Business France dans les territoires - une présence pourtant indispensable pour identifier les entreprises ayant un potentiel de développement international - est néanmoins problématique. Bernard Lalande et moi-même proposons, sur le modèle britannique, le rattachement à Business France d'une partie des 400 conseillers en développement international des chambres de commerce et d'industrie (CCI). Ces derniers, formés, complèteraient leur expertise locale par une expertise sectorielle, par exemple dans les domaines du luxe, de l'agro-alimentaire, de la high tech, etc. Sur le plan budgétaire, cela se traduirait par une affectation d'une fraction de la taxe pour frais de chambre à CCI France, qui reverserait ensuite cette somme à Business France - soit environ 30 millions d'euros sur les 865 millions que rapportera cette taxe affectée en 2017. Aujourd'hui, les 400 collaborateurs des CCI représentent un coût de quelque 60 millions d'euros, pour un résultat qui ne donne pas beaucoup de satisfaction. La solution que nous préconisons ne plaira pas à tout le monde, mais elle aurait le mérite de l'efficacité.
Second problème, l'État stratège à l'exportation a besoin d'une identité forte et claire, notamment vis-à-vis de nos partenaires étrangers ; or les logos French Tech se multiplient à raison d'un par métropole... N'aurait-il pas été plus simple de faire cause commune, et de conserver un seul label French Tech national ?

Pour soutenir l'économie de notre pays, mieux vaut s'appuyer sur quelques instruments forts que sur une multitude de petites aides attribuées sans vision d'ensemble. Ces instruments, il en existe déjà plusieurs.
Parmi les 77 dépenses fiscales rattachées à la mission, les plus récentes forment un ensemble cohérent et complémentaire ; elles forment un cercle vertueux qui laisse aux gouvernants la maîtrise des choix politiques et stratégiques, et des instruments fiscaux pour les mettre en oeuvre. Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), qui représente 15,8 milliards d'euros, a permis aux entreprises de rétablir leurs marges, de s'adapter à la concurrence, de renforcer leurs fonds propres ou tout simplement de se maintenir. Il ne faut pas se tromper sur le sens du rapport de France Stratégie présenté en septembre 2016 : il est logique que les entreprises cherchent d'abord à stabiliser leur situation financière, puis qu'elles établissent un plan stratégique de développement, avant de procéder à des recrutements. Les marges rétablies ont maintenu l'emploi et même contribué à la création nette d'emplois dès 2013-2014. Nous sommes convaincus de la nécessité de renforcer ce dispositif en direction des PME et ETI.
Deuxième instrument, le suramortissement exceptionnel de 40 % a relancé l'investissement productif. Son coût budgétaire a doublé par rapport aux prévisions initiales pour atteindre un milliard d'euros, et toutes les études récentes sur l'investissement des entreprises confirment la reprise, avec un effet positif sur l'emploi.
Plusieurs dispositifs sectoriels en faveur de filières d'avenir complètent l'ensemble, dont l'amortissement accéléré des imprimantes 3D, mesure qui n'est pas aussi anecdotique qu'elle en a l'air : Jacques Chiron et moi-même l'avions proposée lors de la dernière du projet de loi de finances pour 2016, et le Gouvernement l'a reprise dans le cadre du collectif budgétaire de fin d'année.
Le plan « France Très haut débit » est une autre preuve que l'État, lorsqu'il s'en donne les moyens, est capable de conduire une politique ambitieuse. Portée par le programme 343, la participation de l'État au déploiement de la fibre optique se monte à 3 milliards d'euros, sur les 20 milliards prévus à horizon 2022. Le fait remarquable est que pour 2017, les autorisations d'engagement s'élèvent à 409 millions d'euros, au lieu des 150 millions d'euros initialement prévus, ce qui reflète l'accélération du déploiement qui est en cours. Les conventions signées avec les opérateurs pour la couverture des zones les moins denses ont dépassé les attentes, et l'objectif intermédiaire de 50 % de la population couverte fin 2017 pourrait être tenu avec un an d'avance. Une autre partie de la hausse s'explique par le financement d'un programme de couverture des « zones blanches » en matière de téléphonie mobile.
Autre outil à disposition de l'État stratège, le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » porte les crédits du Fonds pour le développement économique et social (FDES). Réactivé en 2014 et doté de 100 millions d'euros cette année, ce fonds accorde des prêts à des entreprises en difficulté. Toutefois, au vu du faible taux d'utilisation de ses capacités - 56 % en 2015, et toujours 0 % depuis le début de l'année - la question de sa pérennité se pose : soit le FDES finance des industries et des emplois viables à long terme mais fragilisés à court terme, et alors un acteur comme Bpifrance semble plus indiqué pour prendre le relais ; soit il finance des projets non viables, et il pourrait être supprimé.
Créée en 2013, Bpifrance est, avec Business France, l'une des pièces maîtresses du nouvel État stratège que nous appelons de nos voeux. La banque publique, qui peut soit accorder des crédits, soit contribuer aux fonds propres des entreprises, reprendra également la gestion des garanties publiques à l'exportation, auparavant assurées par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface), et qui font maintenant l'objet d'une dotation de 72,6 millions d'euros inscrite au programme 134.
Lors de nos travaux précédents, et notamment lors de notre déplacement à San Francisco en avril 2016, nous nous sommes particulièrement intéressés au financement des jeunes start-up innovantes. Grâce à ses interventions - toujours minoritaires - Bpifrance a contribué à « débloquer » le marché français du capital-risque. Sur ce marché, longtemps plafonnés à 800 millions d'euros par an, les financements de Bpifrance ont exercé un effet de levier qui a permis aux investissements en capital-risque en France de dépasser le milliard d'euros au premier semestre 2016. Paris est ainsi devenue la deuxième place européenne, talonnant Londres et devançant Berlin.
Quelques réserves cependant. D'abord, et nous insistons sur ce point, l'effet de levier menace toujours de se transformer en effet d'éviction. L'initié connaît par nature mieux le marché que celui qui a besoin de financements ; de là une certaine aversion au risque chez Bpifrance. Or les fonds privés pourraient refuser de s'engager si Bpifrance n'est pas autour de la table... Le capital-risque n'est pas un simple accompagnement, il exige une ouverture d'esprit, une réelle acceptation du risque. Il conviendrait, dans ce domaine, de disposer d'indicateurs pour mesurer non pas le « taux de survie » des entreprises, c'est-à-dire les risques, mais plutôt les perspectives dans cette économie naissante.
À cet égard, pourquoi l'Agence des participations de l'État (APE) ne disposerait-elle pas d'un portefeuille en capital-risque ? Alimenté par une fraction des autres dividendes de l'État actionnaire, ce fonds donnerait à l'APE la latitude nécessaire pour s'ouvrir davantage aux PME et ETI - alors qu'elle les considère aujourd'hui comme accessoires par rapport aux grands groupes. La croissance du capital-risque en France est réelle, mais encore très insuffisante lorsque les montants à lever dépassent 100 millions d'euros. Est-il normal que Blablacar ait dû s'adresser à des fonds américains pour lever 200 millions d'euros l'année dernière ?
Plus fondamentalement, Bpifrance est bien une institution publique, et non une banque ou un fonds d'investissement comme les autres. Son rôle est de mettre en oeuvre les orientations fixées par le Gouvernement et le Parlement.
Voilà ce que nous entendons par « État stratège ». Non pas un retour à une administration centrale rigide, aux plans quinquennaux et aux monopoles - il est facile d'ironiser sur cela -, mais un instrument rendant à l'État les moyens concrets de jouer son rôle, y compris de façon discrétionnaire, dans les situations où le secteur privé est défaillant ou soumis à un horizon de court terme. En fait, il s'agit tout simplement de permettre à l'État de prendre des décisions vraiment politiques : est-ce aux grands groupes internationaux, et notamment aux grandes entreprises du secteur du numérique, de faire la fiscalité des États ? Pourquoi l'État ne favoriserait-il pas l'acquisition ou l'émergence d'un géant du numérique ?
Voici, en attendant un travail plus approfondi, les quelques principes qui ont guidé notre réflexion et pourraient guider l'État stratège du XXIe siècle. Tout d'abord, l'agilité : l'État doit être réactif dans la fixation des priorités, et faire confiance aux acteurs comme Bpifrance, Business France ou encore l'APE. Ces acteurs doivent être organisés en réseau, le Gouvernement et le Parlement conservant la maîtrise du destin économique du pays.
Ensuite, la vision : de toute évidence, les priorités de demain seront la transition écologique et la révolution numérique, et il convient de ne négliger aucune source d'innovation.
Enfin, l'ouverture : l'État stratège n'a pas vocation à protéger les intérêts acquis à l'intérieur des frontières, mais à soutenir avec zèle l'internationalisation des entreprises françaises, de la TPE au grand groupe.
Naturellement, de telles perspectives ne se traduisent pas immédiatement en amendements de crédits. Le contrôle n'excluant pas la confiance, nous vous proposons d'adopter sans modification les crédits de la mission « Économie » et du compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ».

Je remercie les rapporteurs pour leur travail. Toutefois, le budget de l'Insee fournit, à mes yeux, trois exemples de ce qu'il ne faut pas faire. D'abord, la gratuité des données publiques : on dit qu'elle coûterait 11 millions d'euros. Qui payait jusqu'à présent, à qui a-t-on fait ce cadeau ? Ensuite, le déménagement à Metz de certains services de l'Insee, décidé en 2008 : à ce jour, seuls 315 agents ont été transférés sur les 625 attendus, et près de 200 recrutements extérieurs ont dû être effectués à Metz... En attendant, on continue de payer les locaux des deux sites. Tout cela coûte plusieurs millions d'euros ! Pourquoi ne pas imposer le déménagement à ces agents - agents publics et à ce titre soumis à certaines obligations - comme cela se fait dans le privé ? Enfin, pour le recensement, les communes fixaient auparavant elles-mêmes le niveau de rémunération des agents recenseurs, que l'Insee leur remboursait. C'était un système souple, remis en cause par la fixation de critères nationaux dans un décret de décembre 2015... qui a entraîné une augmentation annuelle de la dotation de trois millions d'euros. Je ne peux donc pas approuver la hausse du budget de l'Insee.

Merci aux rapporteurs qui ont mis en évidence l'apport positif de Bpifrance, assemblage de structures préexistantes, certes, mais qui renforce la cohérence des politiques menées. Je partage leur souhait d'une vision stratégique, avec néanmoins de fortes réserves quant à l'idée de confier la gestion du capital-risque à l'APE : l'audace n'est pas dans sa culture.
Le programme 134 s'intitule « Développement des entreprises et du tourisme », mais les crédits alloués au tourisme sont si réduits que les rapporteurs ne les ont pas même évoqués... L'action 21, « Développement du tourisme », représente 2,3 millions d'euros en autorisations d'engagement et 4,2 millions d'euros en crédits de paiement ; l'action 22, « Économie sociale et solidaire », respectivement 4,5 millions et 4,3 millions d'euros. Ce sont des montants anecdotiques. Surtout, les crédits du tourisme sont éclatés entre la mission « Économie », le budget du ministère chargé de l'égalité des territoires et celui du ministère des affaires étrangères et du développement international. Chacun reconnaît le travail accompli dans ce domaine par le précédent ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius, mais la vision d'ensemble fait défaut sur un secteur qui représente tout de même 7 % de notre PIB.
Les dépenses fiscales sont elles aussi atomisées : on trouve pêle-mêle les chèques vacances, la fourniture de logements dans les hôtels ou sur les terrains de camping classés. Alors que l'on évoque un redéploiement du dispositif « Censi-Bouvard » sur les locations de meublés non professionnelles, je mets au défi quiconque de me dire le montant total des dépenses fiscales consacrées aux résidences de tourisme pour 2014 ou 2015.
En conclusion, je plaide pour un regroupement des crédits du tourisme dans un programme unique, conformément d'ailleurs aux principes de la loi organique relative aux lois de finances (Lolf).

Je félicite moi aussi nos rapporteurs. Les louanges adressées à Bpifrance en matière d'aide à l'investissement ne sont cependant pas partagées par les chefs d'entreprise du numérique : certains d'entre eux se voient refuser des prêts par leur banquier habituel par manque de garanties, en dépit de l'aide apportée par l'organisme censé provoquer un effet de levier. Un hebdomadaire satirique a récemment révélé l'explosion des salaires de ses cadres - entre 20 et 40 %. Attendons le rapport de la Cour des Comptes, prévu pour la mi-novembre. Le tableau est moins rose qu'il n'y paraît.
J'ai toujours été favorable aux dispositifs de suramortissement, mais il était stupide d'en créer un en 2015 pour un an seulement. À ce compte, on n'avantage que ceux qui ont déjà investi ! Alors, on prolonge la mesure d'année en année... Mais les chefs d'entreprise ont besoin de visibilité sur plusieurs années. Visiblement, il n'y en a pas beaucoup à Bercy... Nos rapporteurs estiment que l'impact du dispositif est déjà visible : je demande à voir combien d'emplois ont été créés... Pourquoi ne pas abaisser le suramortissement à 20 % tout en l'allongeant sur trois ou quatre ans ?
L'augmentation de la dotation de l'Arcep est liée à la présidence par l'Agence de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Orece). On parle aujourd'hui de transformer l'Orece en service de la Commission européenne : ce serait une pure folie ! Ses avis pondèrent souvent ceux de la Commission, et sont complémentaires - en témoigne son récent avis sur l'application du principe de neutralité d'Internet. En absorbant l'Orece, en en faisant une nouvelle agence, la Commission européenne risque de mettre à mal la coopération entre régulateurs nationaux, comme lorsqu'Europol est devenue une agence communautaire. Il faudra être vigilant.

Ce rapport est intéressant mais contestable. Tout d'abord, mobiliser un million d'euros pour la revitalisation des centres-villes, comme l'a annoncé la secrétaire d'État chargée du commerce et de l'artisanat, est ridicule. Imaginez l'effet que cela produit... Il conviendrait d'abord de supprimer les réglementations contraignantes. Je cite souvent l'exemple des trois écrans de cinéma en centre-ville, qui réclament deux à trois ans de démarches ; les moyennes surfaces sont elles aussi soumises à un parcours d'obstacles pour obtenir différentes autorisations. Commençons par créer un environnement favorable aux implantations. Quant au Fisac, j'ai connu l'époque où son budget se chiffrait en centaines de millions, au lieu d'une quinzaine aujourd'hui... Aider les petites stations-service de proximité, c'est très bien, mais cela ne correspond pas à la vocation d'origine du fonds.
Bpifrance est une initiative intéressante, mais les « canards boiteux » qu'elle est obligée de soutenir entravent son action. Elle a sans doute un rôle d'impulsion, mais les banques privées, elles, prêtent mille milliards d'euros par an aux entreprises ! C'est sur cela qu'il faudrait agir. Il y a notamment un problème avec le financement de l'innovation : lorsqu'un dirigeant de start-up va voir son banquier, celui-ci lui demande de fournir ses trois derniers bilans... qui généralement n'existent pas ! Il y a là des règles, internes aux banques et législatives, qui doivent évoluer.
Je suis tout à fait favorable au développement du capital-risque. Pourquoi ne pas orienter la réduction d'impôt sur la fortune (ISF) pour l'investissement dans les PME vers le capital-risque, et vers les entreprises exportatrices ? Le problème est connu : l'Allemagne compte 5 000 PME et PMI tournées vers l'exportation, la France 900.
Je serai plus critique quant à la notion d'État stratège. Voyez Areva, et les dix milliards d'euros que tout cela a coûté au contribuable. Voyez ces entreprises du CAC 40 qui aujourd'hui battent pavillon étranger. Et que n'a-t-on pas entendu sur General Electric ! Pourquoi un tel acharnement du leader mondial à racheter Alstom ? Parce que l'entreprise américaine - cela n'a pas été dit à l'époque - visait en réalité notre savoir-faire en matière de turbines. Avec quatre d'entre elles, on peut produire autant d'électricité que le réacteur EPR de Flamanville. Dans le deal négocié par le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, l'État devait apporter deux milliards d'euros. On n'en a plus jamais entendu parler... Voilà le problème avec l'État stratège : je suis favorable à la régulation, mais cela ne signifie pas qu'il faille intervenir en dépit du bon sens. Tout est à revoir.
Au risque de me répéter, le CICE n'entre que pour un quart dans l'amélioration de 2 % des marges des entreprises ; le reste est attribuable à la baisse du coût de l'énergie, aux fluctuations de la parité entre le dollar et l'euro, et au quantitative easing par lequel la Banque centrale européenne (BCE) donne aux banques 60 à 80 milliards d'euros par an de liquidités pour investir dans l'économie. La crise serait bien plus grave si nous n'avions pas le quantitative easing.
Bref, le concept d'État stratège me laisse dubitatif, et il faut regarder tout cela de près. On peut concevoir que l'État mène une politique économique, par la régulation, mais je ne suis pas favorable à l'intervention directe. On peut ajouter que les dirigeants d'une partie de nos grandes entreprises continuent à être nommés en conseil des ministres : ce n'est pas un très bon signe.

Je félicite les rapporteurs pour la qualité et la tonalité positive de leur travail. Business France a commencé ses activités le 1er janvier 2015 ; les exportations sont un sujet dont l'Allemagne s'est emparée bien avant nous. Les PME faisaient parfois des coups, mais sans aller au-delà ; c'est pourquoi je me félicite que 10 000 PME et ETI aient d'ores et déjà été accompagnées. Joël Bourdin et moi-même avions, dans un rapport d'information sur les exportations agroalimentaires, mis en évidence la dispersion des énergies et des organismes chargés du soutien à l'exportation dans ce secteur.
Le rattachement des conseillers des chambres de commerce et d'industrie à Business France que vous préconisez a été amorcé dans certaines régions, en particulier en Bretagne, à la plus grande satisfaction des entreprises agroalimentaires. Celles-ci, trouvant une aide à l'échelon régional, pouvaient se passer des services d'Ubifrance. Y a-t-il une complémentarité entre l'action de Business France et ces initiatives régionales ?

Je félicite les rapporteurs, dont le travail nous ouvre des perspectives. Quelques remarques cependant. Je ne suis pas sûr d'être favorable au développement du réseau international de la direction générale du Trésor : la rationalisation en cours découle précisément de la séparation entre les missions économiques régaliennes, relevant du Trésor, et l'aide aux entreprises, confiée à Business France.
Il est difficile d'apprécier le travail de Business France, qui coûte quelque 100 millions d'euros par an à l'État. Vous affirmez que la moitié de ses dépenses sont couvertes par des recettes propres, mais ce n'est pas ce que j'ai entendu dans les différents postes de Business France, où par ailleurs l'opérateur et les chambres de commerces à l'étranger se livrent une véritable guerre. En théorie, Business France amène les PME de France vers l'étranger, où les CCI locales les aident à prospérer. La réalité est plus diverse, et le ministère a du mal à régulariser ce paysage. En Allemagne, tout le dispositif repose sur les chambres de commerce à l'étranger ; chez nous, il repose sur une trentaine d'organismes différents... Cela tient en partie à la structure très différente du tissu des PME en Allemagne et en France.
Business France demande environ un millier d'euros aux entreprises pour une participation à un salon, et prend en charge le reste. Mais cela ne suffit pas : tout l'enjeu est créer une relation suivie. Enfin, quels sont les indicateurs de succès ? Il convient d'y regarder de plus près.
Quant à l'opérateur Atout France - 36 millions d'euros par an, rattachés au budget du ministère des affaires étrangères et du développement international -, on ne sait pas où tout cela va, ni à quoi cela sert. Or, comme Michel Bouvard l'a rappelé, nous avons besoin de soutenir le tourisme.

Je félicite les rapporteurs dont la mission aux États-Unis a manifestement été fructueuse. Les propos de Michel Bouvard sur le budget du tourisme, auxquels je m'associe entièrement, pourraient tout aussi bien s'appliquer au logement : ces politiques sont éclatées entre différentes missions, et il est impossible de s'y retrouver. En revanche, je ne partage pas le point de vue d'André Gattolin sur le suramortissement : j'ai pu constater la réussite dans mon département.
Par ailleurs, il me semble abusif d'associer le déploiement du réseau de téléphonie mobile au label du « très haut débit », quand les opérateurs installent encore de la 3G, voire de la 2G obsolète. Mieux vaudrait installer directement la 4G ou la 5G dans les zones les plus reculées, où la fibre optique n'arrivera jamais. C'est ce que préconise le plan Juncker II.

Vous le savez, j'ai un intérêt tout particulier pour les autorités administratives indépendantes (AAI). Vous jugez modeste l'augmentation du budget de l'Autorité de la concurrence ; or 4,2 %, ce sont tout de même 914 000 euros, après une augmentation de 2 millions d'euros l'an dernier, alors même que son périmètre d'intervention a été réduit, par exemple avec la création de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer). Je suis par ailleurs choquée de constater que l'Arcep n'a pas régularisé ses dépenses immobilières et persiste à louer des locaux à des montants très exagérés, au-delà des seuils fixés par France Domaine. Il convient de suivre attentivement le dossier de l'immobilier des AAI, pour lequel vous rappelez qu'il existe des marges de manoeuvre.
S'agissant du déploiement du très haut débit sur le territoire, il s'agit évidemment, comme vous l'écrivez, d'une nécessité - mais est-ce pour autant une réalité ? La communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon-Sud, que je préside, s'est engagée avec dans un plan « Gironde numérique 2017-2022 » de résorption des zones blanches. Je sais ce que cela nous coûte - il a fallu s'engager sur trente ans - et je ne vois venir aucun résultat avant 2022. Comment peut-on écrire que l'objectif de 50 % de la population couverte en 2017 sera tenu avec une année d'avance ? Peut-être est-ce le cas en Île-de-France...

Les promesses non tenues sur la téléphonie mobile, on les renouvelle sur le très haut débit... Prenons garde, la crédibilité de la politique commence sur des dossiers comme celui-ci, auxquels les Français sont particulièrement attentifs.

Votre éclairage est très intéressant, tout particulièrement sur le plan « France Très haut débit ». Les opérateurs, qui doivent réaliser 6 à 7 milliards d'euros d'investissement dans les zones d'initiative privée, ne couvrent que les secteurs les plus rentables, et délaissent le reste. Dans mon département, le Tarn, ce que l'on appelle le « haut débit » n'est que de l'ADSL légèrement amélioré, pas de la fibre optique. Comment distinguer, dans les 50 % de la population considérés comme couverts, la part du véritable très haut débit et celle du débit légèrement amélioré ? Lorsque vous écrivez que 47,4 % des locaux sont couverts, s'agit-il des locaux professionnels ou seulement des logements ?
Vous soulignez la montée en charge du plan « France Très haut débit ». Mais parmi les 83 départements qui doivent présenter un schéma départemental d'aménagement numérique, seuls 50 ont obtenu un accord préalable et 20 une décision de financement. Il conviendrait d'accélérer l'instruction des dossiers.
Enfin, je rappelle couverture des zones blanches de téléphonie mobile avait été engagée par le plan Jospin... en 1999. Vingt ans après, les attentes sont toujours aussi fortes et les collectivités territoriales sont parfois amenées à financer elles-mêmes un pylône. Cela mériterait une approche différente.
D'une manière générale, les délégations de service public peuvent être utiles, mais encore faut-il trouver des opérateurs candidats... Le très haut débit est un enjeu essentiel, qui mériterait d'aller encore un peu plus loin.

En réponse à Vincent Delahaye, la gratuité des données publiques coûte à l'Insee 11 millions d'euros, que lui payaient les collectivités territoriales et les acteurs privés. Quant aux nouveaux agents de l'Institut à Metz, ce sont pour une part des fonctionnaires d'autres administrations qui ont demandé à y être transférés. On ne peut en revanche obliger un fonctionnaire à déménager : c'est le statut de la fonction publique.
Contrairement à André Gattolin, nous avons le sentiment que Business France a établi une véritable proximité avec les entreprises. En réponse à Yannick Botrel, le problème de l'éclatement des acteurs dans le secteur agroalimentaire a été résolu en 2016, avec le transfert à Business France des missions de la Sopexa (Société de promotion des produits agricoles) en la matière, pour davantage de cohérence.

Nous sommes en plein accord avec Michel Bouvard sur la nécessité de regrouper les crédits relatifs au tourisme, afin d'en avoir une vision d'ensemble.

Si l'expression d' « État stratège » vous choque, nous pouvons envisager d'en changer. Reste que l'État doit avoir une influence sur l'économie de son pays, dans le contexte de la mondialisation, et utiliser des outils comme Bpifrance, Business France, ou des dispositifs fiscaux comme le CICE ou le suramortissement de 40 %. Sinon, c'est ouvrir la voie à une libéralisation débridée, à la domination de grands groupes internationaux. Voyez les géants du numérique : ils ne paient pas d'impôts en France, et certains d'entre eux sont déjà en train d'imposer la manière dont on distribue des colis ou le courrier dans le monde entier... Va-t-on ensuite nous demander de renationaliser ? Il vaut mieux se poser les bonnes questions en amont : ayons une politique stratégique agile, par exemple avec des outils fiscaux qui ont une influence immédiate sur l'investissement.
Nous plaidons, je l'ai dit, pour que le FDES soit intégré à Bpifrance. Un canard boiteux, ce sont tout de même des emplois et une activité économique. Sans compter qu'une entreprise qui ne vaut pas un euro peut valoir des fortunes quelques années plus tard...

On peut critiquer le saupoudrage des dispositifs portés par la mission « Économie », mais à nous de balayer devant notre porte : après tout, c'est nous qui faisons la loi, et qui les laissons s'accumuler après année, parce que chacun demande le sien.
Bpifrance a été créée en 2013, Business France en 2015. Malgré leur jeune âge, ces organismes ont déjà des résultats. Bpifrance, qui doit récupérer certaines missions de la Coface, est un outil qui s'adresse véritablement aux PME et aux ETI : nous en avions grand besoin. Notre politique a trop longtemps été centrée sur les grands groupes, alors que la richesse d'un pays, ce sont aussi ses PME et ETI.
D'après les chiffres fournis par la mission « France très haut débit », le taux de couverture est aujourd'hui de 63 % de la population dans les zones d'initiative privée, contre 28 % dans les zones d'initiative publique. Certes, des zones blanches perdurent, comme en Saintonge, mais à l'échelle nationale nous sommes en avance sur la planification, et l'on peut espérer que les objectifs seront atteints avant 2022. Il est vrai que les crédits et priorités se sont parfois superposés, entre téléphonie mobile et très haut débit fixe...
Si nous voulons réduire notre déficit commercial, nous devons avoir une stratégie à l'exportation. Notre proposition au sujet de Business France et de CCI vise à mobiliser les correspondants sur tout le territoire. Encore faut-il que les collectivités jouent le jeu, et ne multiplient pas les logos pour se concurrencer entre elles...

Nous tiendrons compte des remarques entendues, notamment de la part de Michel Bouvard et Marie-Hélène Des Esgaulx, dans la rédaction définitive de notre rapport.

L'une des raisons de notre abstention est que, malgré la progression de certains indicateurs, les choses évoluent très lentement en matière de couverture du territoire par le très haut débit. Les chiffres fournis par la mission « France très haut débit » ne doivent pas être pris pour argent comptant.
À l'issue de ce débat, la commission décide de proposer au Sénat l'adoption, sans modification, des crédits de la mission « Économie » et du compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ».
La commission examine le rapport de M. Jacques Genest, rapporteur spécial, sur le compte d'affectation spéciale « Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale » (Facé).

Président du syndicat des énergies de l'Ardèche, je pourrais vous parler très longuement du Facé, l'ancien Fonds d'amortissement des charges d'électrification devenu le compte d'affectation spéciale « Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale » ; je m'en tiendrai à quelques observations sur le budget 2017.
Les recettes du Facé sont assises sur une contribution des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité, Enedis principalement. Le taux de cette contribution, dont le produit attendu est de 377 millions d'euros en 2017, soit un montant stable depuis 2012, est recalculé régulièrement, afin de couvrir exactement les crédits prévus sur l'exercice. Ainsi, les taux en vigueur ont été fixés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie le 6 septembre dernier. Il reste cinq fois plus élevé en zone urbaine qu'en zone rurale, faisant du Facé un dispositif remarquable de péréquation, qui doit demeurer.
En revanche, la répartition de ces aides entre les différentes enveloppes est modifiée pour renforcer les moyens alloués à la sécurisation des réseaux. Le projet de loi de finances pour 2017 augmente les moyens dévolus aux travaux de sécurisation des fils nus, qui excèdent désormais ceux consacrés aux extensions et aux enfouissements, ainsi que les crédits dédiés aux travaux réalisés après des intempéries. Cette augmentation s'opérant à enveloppe constante, ce sont les enveloppes dédiées aux travaux d'extension et de renforcement des réseaux qui diminuent. Je déplore la baisse importante, de 20 %, des crédits dédiés à l'enfouissement. Ces travaux n'ont pas pour seule finalité d'améliorer l'esthétique des paysages mais participent au renforcement et à la sécurisation des réseaux, notamment à la montagne, et à la résorption des coupures d'alimentation liées aux intempéries et aux départs mal alimentés. De même, la baisse des crédits dédiés à l'extension des réseaux, qui accompagne le développement démographique et économique des territoires ruraux, est regrettable.
Il est dommage que les crédits des sous-programmes du Facé ne soient pas fongibles en cours d'année, quitte à plafonner les transferts à 20 % du montant disponible afin d'éviter tout déséquilibre. C'est l'une des propositions que je ferai au terme de ma mission de contrôle en cours.
Les destinataires des aides du Facé sont des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité (Aodé) : des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, en particulier des syndicats d'électrification ou d'énergie, dans la mesure où ces collectivités sont les maîtres d'ouvrage de travaux d'électrification rurale. Je me félicite que le regroupement départemental des syndicats soit quasiment achevé.
Les crédits du programme 794 font l'objet d'une sous-consommation chronique en raison du faible nombre de projets présentés par les Aodé. Pourtant, les moyens alloués pour 2017 sont reconduits à l'identique alors qu'ils auraient pu être utilement alloués au financement des travaux d'électrification retracés dans le programme 793. Je vous propose donc un amendement n° 1 qui transfère 4 millions d'euros du programme 794 au programme 793, soit le montant des crédits non consommés au titre du programme 794 en 2015.
Après les dysfonctionnements importants rencontrés en 2014 dans la gestion des aides du Facé, liés au départ des agents d'EDF mis à disposition, les années 2015 et 2016 ont vu une normalisation du rythme d'instruction et de mise en paiement des dossiers présentés par les Aodé. La question du maintien des agents mis à disposition et de l'exécution en régie du Facé se pose ; le ministère souhaite lancer en 2017 une réflexion sur l'optimisation des moyens de fonctionnement accordés à la mission.
Le suivi de la performance des dépenses du CAS est amélioré en 2017, à la suite des critiques émises par la Cour des comptes. Dorénavant, les indicateurs relatifs aux coûts des travaux de renforcement et de sécurisation des réseaux prendront en compte les coûts effectivement constatés, à partir des données issues des états d'achèvement des travaux renseignés par les Aodé. Nous disposerons ainsi d'une vision plus fidèle de l'évolution du coût des travaux et donc de leur efficience.
Sous réserve de l'adoption de mon amendement, je vous propose d'adopter les crédits du CAS « Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale » (Facé), bel instrument de solidarité entre les territoires.

Une question me vient à l'esprit : à quand un Facé pour le très haut débit ?

Le problème a été résolu en 1936 pour l'électricité, ils étaient plus intelligents que nous ! On aurait pu faire la même chose pour le très haut débit. En commission des finances, j'ai été le seul à voter un amendement sur ce sujet !

Le principe du Facé, c'est que l'argent de l'électricité va à l'électricité. Aujourd'hui, au contraire, on prend aux opérateurs de télécommunications pour donner à la télévision... Je le regrette, mieux vaudrait que cet argent aille à la résorption de la fracture numérique.

Il y a donc des péréquations intelligentes ! À 15 kilomètres de Paris, seules 10 % des communes de première couronne, censées être couvertes par SFR fin 2017, le sont à ce jour... Tout est à l'arrêt depuis le rachat de SFR par Numericable, et je ne sais que répondre à mes administrés...

Le département de la Loire est relativement avancé dans sa couverture en très haut débit, avec de nombreuses infrastructures. Le rapport spécial de nos rapporteurs sur la mission « Économie » souligne les progrès réalisés dans toute la France depuis deux ans, grâce à l'investissement de l'État. Mais le manque d'appétence des fournisseurs d'accès constitue un goulet d'étranglement. Certains territoires sont fibrés sans fournisseurs d'accès !

Nous ne sommes pas seuls à nous occuper de cette question, d'autres commissions sont aussi très investies sur ce sujet.

Pour le très haut débit, il n'y a pas d'autre solution qu'une péréquation entre les territoires.
L'amendement n° 1 est adopté.
À l'issue de ce débat, la commission décide de proposer au Sénat l'adoption des crédits du compte d'affectation spéciale « Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale » (Facé), ainsi modifiés.
La commission examine le rapport de Mme Michèle André, rapporteure spéciale, sur la mission « Pouvoirs publics ».

Conformément au principe d'autonomie financière des pouvoirs publics, qui découle de la séparation des pouvoirs, la mission « Pouvoirs publics » regroupe les crédits alloués aux différents pouvoirs publics constitutionnels, c'est-à-dire à la Présidence de la République, à l'Assemblée nationale et au Sénat - ainsi qu'aux chaînes parlementaires -, au Conseil constitutionnel et à la Cour de justice de la République.
L'année électorale 2017 sera très riche. Pourtant, en dépit des coûts inhérents à l'élection présidentielle et au renouvellement général de l'Assemblée nationale et d'une moitié du Sénat, les institutions relevant de la mission « Pouvoirs publics » continuent à participer pleinement à l'effort de redressement des comptes publics. Pour l'exercice 2017, les crédits inscrits au sein de la mission « Pouvoirs publics » s'élèvent à près de 991 millions d'euros, en augmentation de 0,3 %, après plusieurs années de baisse significative. Cette évolution recouvre une stabilisation des dotations de l'État à la Présidence de la République, aux assemblées parlementaires et à la Cour de justice de la République, ainsi qu'une diminution des crédits accordés aux chaînes parlementaires ; seul le Conseil constitutionnel voit sa dotation augmenter de 4 millions d'euros, en raison notamment de l'organisation de l'élection présidentielle.
La dotation demandée par la Présidence de la République est maintenue à 100 millions d'euros, niveau atteint dès 2015 conformément aux engagements du chef de l'État. Elle demeure à un niveau inférieur à celui prévu par la loi de finances pour 2008, alors même que, depuis lors, de nombreuses dépenses auparavant supportées par le ministère de la défense, comme les pensions des gendarmes affectés au palais de l'Élysée, ont été transférées à la Présidence de la République. En 2017, les crédits de la Présidence auront reculé de plus de 12 millions d'euros par rapport à 2011.
Cette baisse de la dotation est le fruit des efforts réalisés sur les dépenses de la Présidence de la République, qui permettent d'éviter une augmentation des crédits demandés en 2017, alors qu'une année électorale a généralement de fortes implications sur l'agenda présidentiel comme sur l'organisation des services.
Les dotations versées à l'Assemblée nationale et au Sénat sont de nouveau gelées pour l'an prochain. Elles s'élèveront au total à environ 841,5 millions d'euros. La stabilisation en euros courants des dotations des deux Chambres est due à des efforts en dépenses, afin notamment d'absorber la hausse tendancielle de leurs charges.
La dotation de l'État à l'Assemblée nationale demeure à son niveau de 2016, soit 517,9 millions d'euros, en dépit d'une hausse de près de 9 % des charges assumées par la première chambre. En effet, le surcoût total du renouvellement général de l'Assemblée est estimé à 37,8 millions d'euros - somme intégrant les indemnités versées aux collaborateurs de députés en fin de mandat. À cela s'ajoute un programme important de travaux durant la suspension des travaux parlementaires : 12,8 millions d'euros pour la réfection de l'étanchéité de la cour d'honneur, le confortement de l'emmarchement situé sous la colonnade du Palais-Bourbon et la rénovation des locaux de la vice-présidence. L'équilibre du budget de l'Assemblée nationale en 2017 serait assuré grâce à un prélèvement sur ses disponibilités financières de près de 63 millions d'euros, contre 15 millions d'euros en 2016.
La dotation de l'État au Sénat demeure également à son niveau de 2016, à 323,6 millions d'euros. Le Sénat poursuit donc les efforts engagés depuis 2008. Comme l'Assemblée nationale, le Sénat connaîtra une hausse substantielle de ses charges en dépit de la stabilité de la dotation de l'État : les dépenses de notre assemblée augmenteront de 30,7 millions d'euros par rapport à 2016. Cette évolution est due au renouvellement partiel du Sénat - dont le coût est estimé à 5,3 millions d'euros - et à d'importants travaux au cours de l'année à venir, qui expliquent la hausse de 25,4 millions d'euros du budget d'investissement. Débuterait en particulier la réhabilitation des bureaux des 26 et 36, rue de Vaugirard. Toutefois, les indemnités des sénateurs ne croîtront que de 1,5 % en 2017, « du fait de l'augmentation du point d'indice et de la hausse prévue des allocations de retour à l'emploi au profit de sénateurs non reconduits en 2017 ». Les dépenses de rémunération des personnels reculeront de 0,51 %, en raison notamment de la suppression de sept postes.
Les dépenses liées au Jardin du Luxembourg baisseront de près de 590 000 euros, du fait de l'achèvement, en 2016, de la rénovation du chauffage des serres. Les charges prévisionnelles du Musée du Luxembourg s'élèveront quant à elles à 89 000 euros environ - mais ce poste demeure profitable au Sénat, dès lors qu'il est associé à des produits évalués à 250 000 euros.
Pour participer pleinement au redressement des comptes publics, le Sénat devrait vendre, en 2017, plus de cinq millions d'euros de biens immobiliers, ce qui financera en partie les travaux engagés. À l'instar de l'Assemblée nationale, il équilibrerait son budget de 2017 par un prélèvement de 29,3 millions d'euros sur ses disponibilités financières.
La dotation de la chaîne LCP-Assemblée nationale, d'environ 16,6 millions d'euros, est identique à celle de 2015. Quant à la dotation demandée par Public-Sénat, en baisse pour la première fois de 3,2 %, elle s'établit à 18,25 millions d'euros. En vertu du contrat d'objectifs et de moyens signé le 10 décembre 2016, une nouvelle baisse des crédits accordés à Public-Sénat devrait avoir lieu en 2018.
Après sept années consécutives de baisse, la dotation demandée par le Conseil constitutionnel augmente de 4 millions d'euros en 2017, essentiellement en raison des dépenses prévues au titre de l'élection présidentielle, d'un montant de près de deux millions d'euros, soit à peu près autant qu'en 2012. En effet, selon l'article 58 de la Constitution, le Conseil constitutionnel « veille à la régularité de l'élection du Président de la République ».
À cela s'ajouterait une augmentation des dépenses de personnel d'environ 1,5 million d'euros, due aux recrutements effectués par le Conseil. Ont ainsi été recrutés un chargé de mission numérique et un spécialiste de droit comparé ; les effectifs des services juridique et de documentation ont aussi été étoffés, le premier comptant désormais dans ses rangs un administrateur du Sénat en plus d'un administrateur de l'Assemblée nationale et de deux magistrats.
Enfin, les dépenses d'investissement affichent une progression de près de 252 000 euros, correspondant « en particulier à des investissements informatiques et à des travaux inéluctables de remise aux normes de l'entresol du Conseil constitutionnel ». L'enveloppe consacrée aux membres du Conseil constitutionnel reste, quant à elle, presque inchangée.
J'en viens enfin à la Cour de justice de la République qui, conformément à l'article 68-1 de la Constitution, est compétente pour juger les membres du Gouvernement pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Le budget prévisionnel de la Cour s'élève à 861 500 euros, comme en 2016.
Je vous propose l'adoption, sans modification, des crédits de la mission « Pouvoirs publics ».

Le Sénat fait des efforts pour augmenter ses recettes, comme j'ai pu le constater au sein de la commission de contrôle des comptes. Des espaces du jardin sont loués à des entreprises ou pour des tournages. La recherche de recettes complémentaires me semble être de bonne politique. Le jardin du Luxembourg, mis à la disposition des Parisiens et des touristes, coûte 12 millions d'euros : c'est une contribution du Sénat.

Comment comprendre qu'une assemblée souveraine élue au suffrage universel, direct ou indirect, ne débatte pas de son budget en séance plénière ? C'est ce que je réclame au Sénat depuis des années, et c'est ce qui se pratique dans de nombreux pays. Cette absence de transparence est incompréhensible dans une assemblée démocratique.

La dotation du Sénat fait partie de la mission « Pouvoirs publics » qui est examinée en séance publique. Quant au budget des assemblées, il est approuvé par leur Bureau, sur proposition des questeurs.

Nous disposons du « bleu » budgétaire, et pouvons déposer des amendements !
À l'issue de ce débat, la commission décide de proposer au Sénat l'adoption, sans modification, des crédits de la mission « Pouvoirs publics ».
La réunion est levée à 18 h 40.