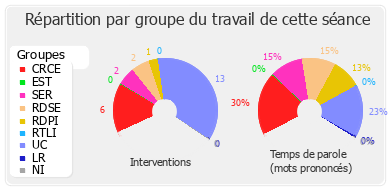Séance en hémicycle du 13 janvier 2011 à 14h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à douze heures cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Roger Romani.

La séance est reprise.

Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation des sénateurs appelés à siéger au sein de deux organismes extraparlementaires.
La commission de la culture, de l’éducation et de la communication propose la candidature de M. Ambroise Dupont, en qualité de membre titulaire, et de M. Ivan Renar, en qualité de membre suppléant, pour siéger au sein du Haut Conseil des musées de France, ainsi que la candidature de M. Philippe Nachbar, pour siéger en qualité de membre suppléant au sein de la Commission du Fonds national pour l’archéologie préventive.
Ces candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.

L'ordre du jour appelle le débat sur la désertification médicale, organisé à la demande du groupe CRC-SPG.
La parole est M. Bernard Vera, orateur du groupe ayant demandé ce débat.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le fait que notre assemblée puisse débattre, aujourd’hui, de la médecine de proximité, en dehors de toute loi de financement de la sécurité sociale ou de l’examen d’un projet ou d’une proposition de loi portant sur le sujet, n’est ni anodin ni sans conséquence.
Les conseillers municipaux, les maires, les conseillers généraux ou régionaux, que nous représentons, les territoires et les populations qui les habitent, tout nous invite à poser clairement la question, afin de rechercher par tous les moyens, à garantir l’accès de toutes et de tous à une médecine de proximité, de qualité, et j’ajoute, car ce n’est pas sans importance, à tarifs opposables.
La manière avec laquelle le Sénat s’est approprié les débats de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite loi « HPST », le fait que la première proposition de loi tendant à la modifier soit d’origine sénatoriale, bien que nous soyons loin de l’approuver, confirme l’analyse de notre groupe, qui nous a conduits à proposer ce débat sur la désertification médicale.
Le Sénat a en effet toute légitimité pour aborder de front cette question, et beaucoup reste à faire, d’autant que Mme Roselyne Bachelot-Narquin a décidé, à l’occasion du congrès de médecine générale qui s’est tenu à Nice en juin dernier, de renoncer à deux mesures censées lutter contre les problèmes de démographie médicale. Pour mémoire, il s’agissait des « contrats santé solidaires » et des « déclarations préalables d’absence », deux mesures à nos yeux peu efficaces.
Si nous avons toujours douté de la capacité de ces deux seules mesures à répondre aux besoins de nos concitoyens, nous ne pouvons que regretter la manière dont celles-ci ont été écartées. Madame la secrétaire d'État, il n’est pas selon moi de bonne politique que le Gouvernement décide, seul, de surseoir à l’exécution de mesures législatives adoptées par la représentation nationale, surtout lorsqu’elles étaient censées améliorer les droits des habitants des territoires qui souffrent d’une sous-densification médicale.
Ce « gel » trouvera sans doute sa conclusion par la suppression de ces mesures, comme le propose notre collègue Jean-Pierre Fourcade, au motif que le Gouvernement et sa majorité veulent témoigner de leur confiance aux professionnels de santé.
Pendant ce temps, nos concitoyens peinent toujours davantage dans leur recherche de médecins de proximité. Pour reprendre les propres termes de Mme Élisabeth Hubert, qui a remis il y a peu un rapport concernant la désertification médicale, « l’état démographique de cette profession [fait] peser un réel danger sur toute l’offre de santé ».
C’est dire, madame la secrétaire d'État, s’il y a urgence à agir !
Plus les réponses tardent à venir, plus les difficultés auxquelles font face nos concitoyens sont grandissantes.
Si la densité médicale était de 275 généralistes pour 100 000 habitants en 1985 et de 340 praticiens en 2005, toutes les études prévoient, à l’horizon 2025, qu’elle tombe à 283 généralistes pour 100 000 habitants, soit un taux à peine supérieur à celui du milieu des années quatre-vingt.
Or le vieillissement de la population, les souffrances liées au travail, les pathologies consécutives aux pollutions ou, tout simplement, les évolutions démographiques ont fait naître des besoins nouveaux qu’il faudra bien satisfaire.
Mes chers collègues, au vu de ces éléments et alors que le nombre de médecins, y compris de médecins de premier recours, n’a jamais été aussi grand, il serait erroné de considérer que seul un problème de démographie se pose aujourd’hui.
Voilà une erreur derrière laquelle il est aisé de se cacher pour renoncer à agir sur la vraie problématique : celle de la régulation géographique.
En revanche, il y aura bien, demain, un réel problème de démographie, avec un manque criant de médecins généralistes dont les patients seront les victimes. Selon les atlas régionaux de la démographie médicale, le nombre total des médecins en activité devrait en effet diminuer de 10 % à l’horizon 2025.
À plus ou moins long terme, l’enjeu auquel nous sommes confrontés est donc bien l’accès de toutes et de tous à des soins de proximité.
Cette ambition est loin d’être réalisée dans la mesure où, actuellement, selon un sondage réalisé par le Collectif interassociatif sur la santé, le CISS, et l’institut Viavoice, 10 % des Français affirment déjà avoir des difficultés à trouver près de chez eux un médecin généraliste. Le pourcentage atteint 27 % dès lors qu’il s’agit de médecins spécialistes et explose à 34 % pour l’accès à des professionnels de santé ne pratiquant pas de dépassement d’honoraires.
La situation est alarmante alors qu’il y a actuellement 214 000 médecins en activité, soit une progression de 22 % du nombre de professionnels depuis les années quatre-vingt-dix. Dans le même temps, la population française ne progressait, elle, que de 10 %.
Ainsi, la répartition inégale des médecins sur le territoire constitue bien la principale difficulté à laquelle sont à ce jour confrontés nos concitoyens.
Selon les données recueillies dans les vingt-trois atlas régionaux de la démographie médicale, certaines régions connaissent une réelle pénurie, et d’autres une sur-densification.
Il est à noter, par exemple, que la région Provence-Alpes-Côte d’Azur arrive en tête de la densité médicale, avec 375 médecins généralistes en activité pour 100 000 habitants, contre à peine 164 pour la région Nord-Pas-de-Calais. Cette situation résulte principalement du fait que de nombreux jeunes médecins, récemment diplômés, ont pendant longtemps fait le choix d’une installation non dans leurs régions d’origine, mais dans celles où la qualité de vie est considérée comme meilleure.
Pour autant, l’implantation des professionnels dans ces régions à forte densité médicale est également inégale en interne. Si l’on observe une importante densité le long de la côte, dans l’arrière-pays, des régions entières sont pratiquement abandonnées.
De la même manière, s’il est vrai que les départements ruraux souffrent le plus des déserts médicaux, les départements urbains, y compris parmi les plus peuplés, en pâtissent également.
Si Paris compte 742 généralistes pour 100 000 habitants, ils sont sept fois moins nombreux en Seine-Saint-Denis. Et mon département, l’Essonne, fait face à une diminution du nombre de praticiens en activité de 27, 5 % par rapport à l’année dernière, conséquence du vieillissement des médecins en exercice et d’un nombre insuffisant d’installations.
On le voit bien, les déserts médicaux actuels sont donc moins dus à une pénurie médicale qu’à une régulation inefficace ou plutôt, devrais-je dire, qu’à une absence de régulation.
La liberté d’installation que vous défendez conduit à l’évidence, et nos concitoyens le vivent quotidiennement, notamment dans les territoires ruraux et les zones urbaines sensibles, à des conditions d’accès aux soins inacceptables.
Les mesures incitatives et volontaristes que vous n’avez eu de cesse de proposer depuis plus de dix ans ont fait la preuve de leur inefficacité. Votre refus d’adopter d’autres mesures, plus contraignantes, seules à même de garantir dans le temps et dans l’espace une implantation médicale adéquate aux besoins en santé des femmes et des hommes de notre pays confine à l’irresponsabilité.
Je ne prendrai que deux exemples : celui des bourses régionales et celui des aides délivrées par l’État et l’assurance maladie, plus spécifiquement l’avenant 20 de la convention médicale, qui accorde une majoration de 20 % des honoraires des généralistes exerçant en zone déficitaire et en groupe, mode d’exercice d’ailleurs plébiscité par les médecins.
Cette mesure n’a absolument pas permis de réduire les déserts médicaux.
Selon une étude menée conjointement par le CISS, la FNATH, la Fédération nationale des accidentés du travail et handicapés, et l’UNAF, l’Union nationale des associations familiales, sur 100 caisses primaires, seules 28 ont mis en œuvre les dispositions contenues dans cet avenant. Et dans 17 de ces 28 caisses, l’application de ce dispositif s’est tout de même traduite par une baisse de la densité médicale, alors que l’incitation financière l’accompagnant est de l’ordre de 25 000 à 28 000 euros annuels et par médecin, un complément de rémunération pourtant non négligeable.
Certes, l’attribution de bourses régionales en contrepartie d’une période d’exercice obligatoire dans la collectivité de financement constitue une première étape intéressante, mais elle est largement insuffisante, et ce à un triple titre.
Elle est insuffisante, d’abord, car elle repose, là encore, sur le volontariat et sur la capacité de financement des régions, lesquelles subissent de plein fouet une politique marquée avant tout par une réduction des ressources dont elles disposent, et donc par une compression des dépenses.
Elle est insuffisante, ensuite, car elle entérine la suppression d’un principe fondamental pour notre groupe : l’égalité d’accès aux soins entre tous nos concitoyens, indépendamment de leur lieu de résidence ou de leurs moyens financiers.
Elle est insuffisante, enfin, car, dans le même temps où le Gouvernement plaide en faveur de l’installation volontaire des professionnels de santé dans les territoires qui en manquent cruellement, il pratique une casse méthodique et organisée de l’ensemble des services publics : fermeture des écoles, des postes, des maternités, des gendarmeries et des hôpitaux de proximité.
Mes chers collègues, reconnaissons qu’il est tout de même paradoxal de proposer à des jeunes médecins de s’installer dans des territoires que l’État abandonne lui-même peu à peu.

Ça, c’est votre point de vue, mon cher collègue !
C’est pourquoi nous sommes convaincus, sans remettre totalement en cause ce principe auquel les professions libérales sont attachées, qu’il est aujourd’hui indispensable de limiter les nouvelles installations dans les zones déjà fortement pourvues de médecins.
Sans anticiper sur l’intervention de ma collègue Nicole Borvo Cohen-Seat, il me semble que nous devrions nous inspirer des mécanismes législatifs qui existent déjà actuellement dans certaines professions de santé : je pense par exemple à ceux qui concernent l’ouverture des officines ou à la régulation de la démographie infirmière.
De même, nous devrions rendre opposable le Schéma régional de l’organisation des soins ambulatoires fixant les besoins en santé des populations par bassin.
Mais il faudra également, comme nous y invite le rapport de Mme Hubert, trouver les réponses structurelles et à long terme pour éviter qu’à l’avenir ne se généralisent les déserts médicaux.
Cela exige de donner à la médecine de proximité, et singulièrement de premier recours, toutes ses lettres de noblesse. La reconnaissance de la médecine générale comme une spécialité ainsi que la possibilité ouverte aux praticiens titulaires du diplôme de médecine générale de percevoir des honoraires similaires à ceux des autres spécialistes pourraient constituer des facteurs déterminants dans le choix des étudiants en faveur de la médecine générale, à condition que cette filière soit réellement soutenue et que le Gouvernement prenne l’ensemble des mesures nécessaires à la création de véritables services universitaires de médecine générale ambulatoire.
Force est de constater que nous en sommes encore loin et que, pour reprendre l’expression retenue par Rémy Senand et Marie Kayser dans un article paru le 8 juin dernier dans la revue Pratiques, l’enseignement de la médecine générale est encore « au milieu du gué ».
J’en veux pour preuve le nombre encore trop faible de professeurs titularisés par la commission d’intégration – à peine 20 – quand les représentants des enseignants de médecine générale estiment nécessaire de titulariser au plus vite plus de 30 professeurs associés, dont les statuts sont particulièrement précaires.
Par ailleurs, compte tenu du faible nombre de nominations par la voie « normale » du Conseil national des universités, se pose sans doute la question de la prolongation de la durée de vie de la commission d’intégration initialement prévue pour cinq ans.
Revaloriser la médecine générale suppose un préalable indispensable qui aujourd’hui fait défaut : une véritable professionnalisation et une revalorisation de la formation initiale des futurs médecins. Autant d’éléments indispensables qui impliquent que l’on accorde enfin « à la filière universitaire de médecine générale les moyens dont elle a besoin » comme le demandent les associations représentant les étudiants de médecine générale. Je pense notamment à la création de postes d’enseignants ne reposant pas, comme c’est très souvent le cas, sur des postes vacants dans d’autres spécialités. Les universitaires savent trop combien, en règle générale, un poste vacant est un poste perdu.
Il n’est pas non plus acceptable que la seule alternative consiste à supprimer un poste d’enseignant dans une filière pour l’affecter à la filière universitaire de médecine. Cette logique comptable ne constitue pas une réponse durable aux enjeux de formation des futurs médecins de premier recours.
Mais il faut également que le processus de formation des étudiants prenne en compte la spécificité propre à cette discipline, c’est-à-dire son caractère ambulatoire. Il faut par exemple permettre la réalisation effective en cabinet médical du stage prévu en second cycle afin de sensibiliser les étudiants à ce mode d’exercice en leur permettant de découvrir une autre réalité que celle du modèle hospitalo-universitaire, aujourd’hui encore très majoritaire.
Alors que certains proposent de réduire la durée des études formant les médecins généralistes, nous considérons, pour notre part, qu’il faudrait au contraire pérenniser la quatrième année de spécialisation comme c’est le cas pour les autres spécialités.
Celle-ci pourrait principalement être orientée vers la réalisation de stages de longues durées, pouvant aller de six mois à un an et dans des territoires qui souffrent d’une sous-densification. Cela permettrait d’assurer de manière continue une présence médicale conjointe à celle du médecin maître de stage, soulageant ce dernier dans ses amplitudes de travail et facilitant l’accès aux soins des patients.
Cela suppose naturellement un accompagnement financier permettant de lever les obstacles liés à l’accueil d’un stagiaire en cabinet. En effet, la présence d’un interne nécessite de la part du maître de stage un investissement en énergie et en temps qui rallonge la consultation et réduit d’autant le nombre de patients qu’il peut accueillir dans la journée.
Cela peut avoir des conséquences financières substantielles dans le cadre d’une rémunération à l’acte et les compensations actuellement consenties semblent insuffisantes pour pallier les pertes réelles.
Enfin, comme le préconise le rapport de Mme Hubert, il apparaît impératif de tenir compte des envies mêmes des médecins et des étudiants concernant les modes d’exercice de leur profession.
Toutes les enquêtes menées auprès des professionnels l’attestent, les médecins, principalement les jeunes diplômés, veulent rompre avec l’isolement qui est le leur. Ils sont de plus en plus nombreux à redouter une installation synonyme de solitude et d’amplitude horaire trop importante. Cela implique de favoriser l’exercice regroupé, principalement pluridisciplinaire, notamment au sein de maisons de santé.
Chacun s’accorde à reconnaître que la pluridisciplinarité constitue un avantage certain, tant pour les professionnels que pour les patients qui disposent ainsi dans un même lieu de l’ensemble des prestations dont ils peuvent avoir besoin.
Or ce mode d’exercice, qui suppose un projet de soins, induit des temps de travail et de concertation qui ne sont pas des temps de soins et par conséquent ne donnent pas lieu, dans le cas d’un paiement à l’acte, à une rémunération.
Il faut donc impérativement développer, comme nous l’avions proposé dans le cadre de l’examen par le Sénat de la loi HPST, une rémunération forfaitaire. Celle-ci pourrait notamment inclure la compensation du temps de travail spécifique issu des besoins liés à l’exercice regroupé, la prise en charge des temps dédiés à l’éducation thérapeutique ou aux missions de prévention.
Si nous sommes favorables à ces expérimentations, nous les associons à la condition primordiale du respect par ces professionnels des tarifs opposables. Nous ne pouvons concevoir que des fonds publics puissent être destinés à des professionnels de santé dont la pratique tarifaire aurait pour effet de participer à leur manière à l’accroissement des renoncements aux soins pour des motifs financiers.
Enfin, pour conclure, je voudrais aborder la question des centres de santé municipaux, mutualistes ou associatifs, qui constituent le mode le plus ancien et le plus répandu de l’exercice collectif et pluridisciplinaire de la médecine.
À l’image du rapport de M. Vallencien, celui de Mme Hubert note l’importance des centres de santé, notamment parce qu’ils contribuent à lutter à la fois contre la désertification médicale et contre le renoncement aux soins, bien que celui-ci reste principalement axé sur la médecine libérale.
Ce tropisme est regrettable car de plus en plus de jeunes diplômés s’orientent vers un exercice salarié qu’ils estiment davantage en adéquation avec leur conception de la médecine, mais aussi avec leur mode de vie.
De la même manière, nous regrettons, à l’instar de la Fédération nationale des centres de santé, que ce rapport limite les centres de santé à « une réponse sanitaire d’exception qu’il serait bon de développer uniquement en cas de défaillance de l’organisation libérale ».
Cette conception, particulièrement anachronique à nos yeux, ne tire aucune conclusion des réussites réalisées quotidiennement par ces centres qui permettent une approche globale des patients, avec la pratique du tiers payant, la prévention, l’éducation en santé ou encore la pluridisciplinarité.
Aussi, nous considérons que ce mode d’exercice ne doit pas être écarté des autres modes collectifs d’exercice et nous souhaitons que le Gouvernement s’engage à étendre aux centres de santé les financements qu’il entend développer pour favoriser l’exercice collectif libéral.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste. – M. Robert Tropeano applaudit également.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, notre système de santé présentait, jusqu’à récemment, tous les avantages : liberté individuelle d’accès aux soins quasi universelle pour le patient ; universalité de la couverture avec la CMU ; faible coût pour les intéressés de leurs études et de leur formation ; liberté de prescription, d’installation, de mode d’exercice pour le médecin ; enfin, qualité reconnue des soins.
Pour résumer, il est fondé sur la socialisation quasi intégrale du coût des choix individuels, qu’il s’agisse du médecin ou du patient.
Côté médecin, le système assure globalement un bon niveau de revenus, progressant plus vite que le salaire moyen, et aucune contrepartie sociale autre que celle qu’il s’impose à lui-même ne lui est demandée, pas même, depuis 2003, d’assurer des gardes.
Le nerf du système est la rémunération, pour tout ou partie, à l’acte de 67 % des omnipraticiens et de 50 % des spécialistes, dont 69 % des radiologues et 64, 5 % des cardiologues. Ce mode de rémunération est désormais appliqué globalement à l’hôpital public, dont les ressources dépendent du nombre et de la qualité des actes qui s’y pratiquent.
Un système libéral financé par l’argent public, impossible de rêver mieux !
Mais le système s’est mis à dysfonctionner en termes de coûts et en termes qualitatifs : files d’attente qui s’allongent pour l’accès à certaines spécialités ; surchauffe des urgences qui, ici ou là, prennent ponctuellement des allures de cours des miracles ; extrême disparité de la démographie médicale, sujet du débat de cet après-midi.
Le diagnostic est connu : la présence médicale est très variable d’une région à l’autre, entre les départements d’une même région, entre les villes et les zones rurales, entre les quartiers des villes et même entre les secteurs ruraux d’un même département.
Elle est encore plus variable s’agissant des spécialistes. Entre les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Picardie, la densité des spécialistes varie du simple au double ; vous auriez, mes chers collègues, de nombreux exemples à apporter sur ce point.
Même une démographie médicale favorable, comme c’est le cas dans mon département du Var, ne signifie pas pour autant que la permanence des soins est assurée dans les zones rurales. Je peux vous citer l’exemple d’un canton de 5 000 habitants qui dispose de sept médecins – ce qui me paraît tout de même suffisant – mais dans lequel, pour autant, trouver un médecin disponible après les heures de bureau est difficile.
On avance le chiffre de 2 600 000 personnes qui rencontreraient des difficultés pour accéder à un généraliste, un spécialiste ou un professionnel de santé, et ce en dépit du fait que, comme cela a été souligné, il n’y a jamais eu autant de médecins en France, notamment de médecins libéraux et de spécialistes, et que notre densité médicale est tout à fait comparable, voire légèrement supérieure à la moyenne constatée dans les pays de l’Europe à quinze. De même, le nombre d’actes n’a pas cessé d’augmenter, surtout les actes de spécialité.
Le constat s’impose donc : même si, dans les dix ans qui viennent, la question des effectifs compliquera encore la donne, ce n’est pas le manque de médecins et de professionnels de santé qui est responsable des déserts médicaux, c’est le système.
En effet, pourquoi voulez-vous que des diplômés, essentiellement d’origine urbaine aisée, formés à une médecine de plus en plus technique, aillent gagner leur vie en zone rurale et acceptent des contraintes horaires fortes s’ils peuvent faire autrement ? Dans la mesure où ils n’ont aucune obligation, pourquoi s’en imposeraient-ils ?
Lors d’une précédente discussion dans cette assemblée, j’avais exposé le dilemme à Mme Bachelot-Narquin, et sa réponse m’avait étonné : « J’indiquerai, pour faire écho au débat engagé par M. Collombat, que nous ne pourrons pas faire, sur ce sujet, l’économie d’une réflexion philosophique. Quand la puissance publique, c’est-à-dire le contribuable local, le contribuable national ou le cotisant à la sécurité sociale, aura financé à grand renfort de subventions des maisons médicales de garde ou des centres de santé, participé au fonctionnement de ces installations, réglé les cotisations sociales des médecins, augmenté les rémunérations comme nous le faisons déjà, avec une progression de plus de 20 % dans certains secteurs, rémunéré la permanence des soins en plus des consultations et des visites majorées – 150 euros la nuit –, payé forfaitairement la prise en charge des malades chroniques, pourrons-nous toujours arguer qu’il s’agit de médecine libérale ? ». Tels ont été les propos de Mme Bachelot !
Les jeunes médecins pourront-ils toujours revendiquer la liberté d’installation ? Certains médecins refusent d’assumer les tâches les plus contraignantes, comme les gardes de nuit puisque le système repose sur le volontariat.
J’indique aussi qu’un principe irréfragable veut que qui paie commande ! Certaines exigences présentées benoîtement, ici ou là, sur toutes les travées, comme des mesures techniques impliquent in fine un changement de système et l’instauration d’un service public étatisé ou para-étatisé. Il faut avoir le courage non seulement de dire les choses mais d’en tirer les conséquences. Mais on en est resté là !
Toute mesure curative un tant soit peu sérieuse étant actuellement politiquement impossible, on se limitera donc à quelques granules homéopathiques, ce que fait très bien le dernier rapport de Mme Hubert. Celles de ses propositions que je préfère, c’est de maintenir en activité des médecins au-delà de soixante ans – les pauvres ! –, de faire appel à des médecins retraités et d’« inciter les internes à effectuer une année supplémentaire de mission de service public ».
Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, puisque nous sommes dans des déserts, pourquoi ne pas faire appel aux organisations non gouvernementales, les ONG ? Je pense que les vocations ne manqueraient pas !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG. – M. Robert Tropeano applaudit également.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, longtemps vanté comme l’un des meilleurs du monde, notre système de santé présente aujourd’hui de redoutables symptômes : engorgement des hôpitaux, inégalités sociales dans l’accès aux soins, inégalités territoriales. Ce sujet a déjà été évoqué ce matin lors du débat sur la ruralité...
Les avancées scientifiques et technologiques ont certes rendu la médecine plus fiable, mais les problèmes d’organisation des soins et de démographie médicale privent un grand nombre de Français du bénéfice de ces performances. Derrière la crise budgétaire, bien réelle, est apparue la fracture sanitaire.
Dans certains territoires, en particulier ruraux, la permanence des soins est approximative, les délais d’accès en cas d’urgence sont incompatibles avec l’efficacité des soins, les files d’attente chez les spécialistes s’allongent. En bref, le désert médical s’installe et gagne du terrain dans nos campagnes !
Les origines de ce problème sont évidemment diverses. Ce n’est pas tant, pour l’heure, le nombre de médecins qui est en cause – d’après le dernier atlas du Conseil national de l’ordre, celui-ci est en effet stabilisé à un niveau élevé –, mais leur répartition sur le territoire. L’Île-de-France compte 222 spécialistes pour 100 000 habitants, soit le double de la Picardie, qui n’est pourtant pas à proprement parler une zone rurale reculée !
Le manque d’attractivité de certains territoires est évidemment pour beaucoup dans ces inégalités. Il est clair qu’on ne fera jamais venir un jeune médecin, avec son conjoint, dans une commune où il n’y a pas une offre de services de qualité ou un accès au numérique de nouvelle génération !
Les conditions brutales et souvent anarchiques dans lesquelles sont conduites, depuis quelques années, les restructurations hospitalières ont également un impact fort. Elles démotivent les professionnels et désorganisent la coordination des soins.
Enfin, la désaffection pour la médecine généraliste et l’exercice libéral y est aussi pour quelque chose. La carrière de médecin fait, certes, encore rêver des générations de jeunes gens qui y voient non seulement une manière de gagner leur vie, mais aussi une forme d’engagement, d’altérité, d’humanisme. En revanche, à la différence de leurs aînés, les jeunes diplômés rejettent le schéma traditionnel du médecin à tout faire, isolé dans son cabinet, corvéable jour et nuit.
Parmi les nouveaux inscrits à l’ordre au 1er janvier 2010, moins d’un sur dix exerce en cabinet, deux tiers optent pour une activité salariée et un quart pour des remplacements. Ce faible attrait pour l’exercice libéral se vérifie même en radiologie, discipline souvent pointée comme l’une des plus lucratives.
Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas le niveau insuffisant de la rémunération qui prime dans le refus de l’installation, mais surtout la charge administrative trop lourde, la solitude de l’exercice ou encore les contraintes des gardes.
Face à cette évolution préoccupante, qui ne date pas d’hier, on ne peut plus se contenter de mesures isolées, de promesses. De telles inégalités entre territoires ne sont pas admissibles dans notre république !
Ce ne sont ni les incitations fiscales et sociales en zones de revitalisation rurales, ni la réforme de la première année des études médicales qui a été engagée cette année, ni les quelques mesures de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite loi HPST – certaines, comme la régionalisation du numerus clausus, la reconnaissance de la médecine de premier secours ou le contrat d’engagement de service public, étaient au demeurant positives... – qui régleront le problème durablement.
On le sait, la pénurie de médecins va s’aggraver avec le vieillissement de la population médicale. Actuellement, dans mon département de l’Hérault, 60 % des médecins sont âgés de plus de soixante ans.
Nous devons donc aller plus loin. La qualité, le nombre, la formation, la répartition, les types de pratiques, les modes et niveaux de rémunération des hommes de l’art médical sont sans doute à repenser à la lumière des besoins médicaux.
Notre collègue Bernard Vera a évoqué le rapport d’Élisabeth Hubert sur la médecine de proximité, remis en novembre au Président de la République, dans lequel elle propose un ensemble de mesures : appui à l’exercice regroupé, refonte totale des tarifs de consultation, rémunération spécifique et incitative pour l’exercice en zones sous-denses, développement de la télémédecine...
Certaines de ces mesures sont intéressantes. Le regroupement de médecins et autres professionnels médicaux ou paramédicaux en un même lieu, par exemple dans les maisons de santé, est une solution en milieu rural et répond au besoin de partager l’expérience.
Le Gouvernement s’est engagé sur un objectif de 250 maisons de santé pluridisciplinaires. Je m’en réjouis, mais, comme je l’ai déjà dit, le succès de cette démarche est lié à la présence dans les territoires concernés d’un minimum de services pour répondre aux besoins légitimes des professionnels de santé et de leurs familles. Or, à cet égard, le désengagement de l’État constitue le maillon faible du dispositif.
Quoi qu’il en soit, il est plus que temps de décider et d’agir, d’autant qu’en matière de santé, plus encore que dans d’autres domaines de l’action publique, les fruits se récoltent à moyen et à long terme.
Une question essentielle demeure : pourra-t-on, un jour, contraindre les jeunes praticiens à adopter une forme ou un lieu d’exercice en fonction des besoins ? Sans être adeptes de la coercition, nous sommes nombreux à douter de l’efficacité des simples incitations.

Pouvez-vous nous dire combien de contrats d’engagement de service public ont été signés depuis l’adoption de la loi HPST ? Je me demande d’ailleurs si ce contrat n’est pas, en réalité, une fausse bonne idée. C’est finalement aux étudiants les plus modestes qu’on demandera d’aller exercer en zones rurales car, à n’en pas douter, les plus aisés n’auront pas besoin d’obtenir une bourse !
Quant au contrat santé solidarité, il apparaît, là encore, comme un leurre. Comment croire qu’il permettra de lutter contre les déserts médicaux, quand on imagine les difficultés de mise en œuvre et la faiblesse des pénalités ? On entend dire, d’ailleurs, que vous pourriez revenir, madame la secrétaire d’État, sur cette disposition. Qu’en est-il exactement ?
On peut aussi se demander comment nous pourrions redonner l’envie aux étudiants en médecine d’exercer le métier de généraliste. Il est urgent de régler cette question qui devient épineuse, tant pour le corps médical que pour les pouvoirs publics, mais également pour nos concitoyens, que la désertification médicale inquiète, notamment en milieu rural, et qui craignent de ne pouvoir être soignés s’ils tombent malades.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, à l’occasion de la présentation de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, le Gouvernement a prouvé, hélas, qu’en matière d’égal accès aux soins, il n’avait aucune solution nouvelle à proposer. Quelques mois plus tard, le rapport d’Élisabeth Hubert pointe les graves problèmes, déjà évoqués lors du débat au Parlement, que posent les déserts médicaux. Les solutions proposées, en revanche, ne sont guère convaincantes ; l’opposition, en tout cas, n’est pas convaincue...
Lors du débat sur la loi HPST, que n’a-t-on entendu dire, du côté de la majorité, à propos de l’éventualité de mesures contraignantes visant à inciter les professionnels de santé à s’installer dans des territoires souffrant d’un déficit patent de médecins !
Ainsi M. Alain Vasselle, qui connaît bien ces questions, est-il allé jusqu’à affirmer que la remise en cause du principe de liberté d’installation des médecins généralistes était inconstitutionnelle ! Évidemment, ce n’est pas le cas. Jusqu’où ne faut-il pas aller pour essayer de convaincre...
De toute évidence, le principe de la liberté d’installation restait, en 2009 encore, un tabou pour la majorité parlementaire, mais pas de façon unanime.

Je propose à ceux qui aiment les comparaisons de considérer la situation de l’Allemagne, dont le régime politique, que je sache, est loin d’être « soviétique »...
Ce pays est revenu sur le principe de liberté d’installation des médecins généralistes dans les années quatre-vingt-dix. Aujourd’hui, les Allemands, tout en n’étant pas moins bien soignés que les Français, ont réussi à résorber une partie de leurs « déserts médicaux ». Pendant ce temps, les nôtres se développent : ce phénomène n’est en effet plus cantonné dans les territoires faiblement peuplés, mais gagne aussi les villes et les régions où la démographie est dense et dynamique ! C’est ainsi le cas en Seine-Saint-Denis et dans d’autres départements urbains.
Après avoir fait mine d’agir et fait voter par le Parlement, en 2009, deux dispositions, la première obligeant les médecins à déclarer leurs congés, la seconde mettant en œuvre des contrats santé solidarité, votre prédécesseur, madame la secrétaire d’État, s’est empressée de décider, à la fin de l’année 2010, de surseoir à la publication de leur décret d’application. On est donc revenu à la case départ : ne rien faire !
La première disposition, a précisé Mme Bachelot, était en définitive trop discriminante et péchait parce qu’elle indisposait le corps médical.

En ce qui concerne la seconde, gageons que la ministre a fini par se rallier aux arguments de ceux, dont nous faisons partie, qui pensaient qu’elle était absolument inutile, car rigoureusement inapplicable !
Comment imaginer sérieusement, en effet, de demander à des médecins installés en zone surdense de se rendre ponctuellement en zones sous-dotées pour y faire des consultations et y assurer de façon pérenne un accès aux soins ? C’est surréaliste !
Aujourd’hui peut-être, plus qu’il y a deux ans, nous pourrons vous convaincre, mes chers collègues, ainsi que le Gouvernement, qu’il existe des solutions à cette situation grave, et susceptible de s’aggraver encore, compte tenu de l’évolution de la pyramide des âges dans les prochaines années.
Tout d’abord, plutôt que de tenter en vain et à tout prix d’attirer les médecins dans les zones sous-dotées, il est possible de considérer le problème sous un autre angle et de chercher à dissuader les omnipraticiens de s’installer dans les zones surdotées.
Pour ce faire, on peut envisager de soumettre l’installation des médecins à l’autorisation des agences régionales de santé.

On peut aussi décider de refuser de façon temporaire le conventionnement des médecins de premier recours qui veulent exercer dans les zones où l’offre de soins est déjà plus que satisfaite.
Par exemple, sur le plan de la démographie médicale, Paris est une zone surdotée. Il faut cependant préciser que deux tiers des médecins spécialistes et 50 % des médecins généralistes y exercent en secteur 2. Et personne parmi vous, chers collègues de la majorité, n’y trouve rien à redire !
Si la population parisienne aisée est très satisfaite de cette situation, les patients les plus modestes, en revanche, sont de plus en plus nombreux à faire la queue dans les services des urgences des hôpitaux.
Marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste.

En outre, si l’on veut essayer de régler un problème différent, mais connexe, car lui aussi aggrave les difficultés d’accès aux soins, on peut également décider de retirer le conventionnement de ceux qui, bien que diplômés de la spécialité de médecine générale, ne pratiquent pas effectivement cette médecine de premier recours. Ainsi, certains de ces médecins s’installent en tant qu’acupuncteurs ou exercent l’angéiologie...
Il nous semble que cette piste, plus que le seul rehaussement du numerus clausus, permettrait de donner une réponse concrète à la pénurie d’omnipraticiens dans certains territoires.
Ensuite, il est envisageable, comme l’a proposé notre collègue Hervé Maurey, d’instituer une sorte d’obligation pour les jeunes médecins de s’installer, pour une durée déterminée, là où ils sont particulièrement utiles.
L’Académie de médecine évoquait déjà cette possibilité en 2007 – et on ne peut pas accuser cette dernière d’être contre la médecine – : dans la mesure où la formation de chaque médecin représente pour la société une charge financière de l’ordre de 200 000 euros, il ne paraît pas incongru de demander aux médecins nouvellement diplômés, comme dans certaines grandes écoles, de consacrer quelques années de leur vie professionnelle au service de la nation.
Pour ma part, j’ajouterai qu’il serait peut-être intéressant de favoriser également l’accès aux études médicales de jeunes issus de catégories sociales modestes, un accès en général difficile, par un système de prise en charge post-bac avec pour contrepartie l’obligation de service dans leur département ou dans les départements sous-dotés pendant un certain nombre d’années.
Pour conclure, il nous semble aussi particulièrement nécessaire de fixer des règles d’accessibilité aux soins de premier recours, de sorte que la politique régionale de santé contribue effectivement à réduire les inégalités en la matière.
Tout d’abord, le temps d’accès à un professionnel de santé doit se mesurer en termes de distance et de durée. Dans un rapport sénatorial de 2008, il était préconisé un temps de trajet d’une durée maximale de trente minutes, ce qui paraît tout de même suffisamment important.
En outre, l’accessibilité aux soins doit prendre en compte le temps d’attente ; il faut pouvoir consulter son médecin dans un délai raisonnable.
Enfin, et cet aspect nous semble être de la plus grande importance, il faut que l’accès aux tarifs opposables, c’est-à-dire non soumis à dépassements d’honoraires, devienne un critère essentiel dans l’appréciation de l’accessibilité aux soins de premier recours.
Par conséquent, mes chers collègues, nous attendons de vous que vous fassiez des propositions concrètes et opérationnelles. Madame la secrétaire d’État, nous vous demandons de faire preuve d’ouverture et de pragmatisme car il est urgent d’agir.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE et de l’Union centriste.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, tout d’abord je me réjouis que le groupe CRC-SPG ait souhaité la tenue de ce débat. D’ailleurs, l’ordre du jour de cette première semaine de travaux au Sénat – il a été débattu de la politique agricole commune mardi, de la ruralité et des problèmes médicaux ce matin, de la désertification médicale cet après-midi – montre bien que nous sommes préoccupés par la vie dans l’espace rural et par les solutions que nous pouvons apporter aux populations.
Le Sénat s’est d’ailleurs beaucoup mobilisé. Il a la chance de compter parmi ses membres M. Fourcade, qui est chargé d’évaluer la loi HPST deux ans après sa promulgation et a déjà engagé un travail très important. Le débat vient donc à son heure.
Madame la secrétaire d’État, alors qu’un tel débat a lieu, il est important de rappeler certains faits. Vous venez de prendre en charge la santé aux côtés de M. Xavier Bertrand. Du temps où lui-même travaillait avec M. Douste-Blazy, alors ministre de la santé, le professeur Yvon Berland avait déjà élaboré un rapport sur le sujet et alerté le ministre sur les besoins et les risques existants en termes de couverture médicale.
Dans ses conclusions, l’auteur de ce rapport mentionnait l’augmentation progressive et raisonnée du numerus clausus. Je sais qu’il s’agit d’un sujet qui fâche…

… mais, sur ce point, je souhaite qu’ait lieu une vraie révolution culturelle. Madame la secrétaire d’État, je vous demande de vous libérer de l’influence des théories de ceux qui se livrent à des comparaisons de chiffres se rapportant à des situations tout à fait différentes.
Je ne supporte plus qu’on nous explique que trop de médecins seraient formés et qu’on n’en manquerait pas. Madame la secrétaire d’État, quand on apprécie le nombre de médecins formés, il faut examiner leur affectation véritable.
Ainsi, dans le département de la Lozère, dont je suis l’élu, l’hôpital de Mende a besoin de dix-neuf médecins pour assurer le fonctionnement de son service des urgences. Connaissez-vous un autre pays au monde où, dans une situation équivalente, notamment en termes de population, il faut un nombre de médecins comparable ? Pourquoi en faut-il précisément dix-neuf ? Ce ne sont pas les médecins qui sont en cause : ce sont les 35 heures et les astreintes. Nous disposons de médecins mais ils ne sont pas suffisamment nombreux pour répondre aux besoins existants.
Quel élu, ici, n’a pas vécu la situation à laquelle je fais allusion, à l’hôpital public, dans une clinique mutualiste ou privée ou dans le cabinet d’un praticien exerçant en libéral, s’agissant d’une zone où les médecins n’ont pas envie de s’installer ? Je n’ai rien contre l’idée de faire appel à des médecins étrangers, mais une telle solution a pour conséquence de priver les pays d’origine de diplômés de qualité.
Madame la secrétaire d’État, ne tombez pas dans le piège tendu par ceux qui disent que le nombre de médecins formés est suffisant ; ce n’est pas vrai ! Le numerus clausus, bien sûr, était une nécessité, mais il a été mal appliqué par les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, et on ne forme pas assez de médecins.
Trop de jeunes, nous le voyons bien, qui ont échoué à l’issue de leur première année de médecine, dans le cadre d’un concours dénué de toute dimension humaniste, auraient pourtant fait d’excellents médecins. Arrêtons donc de dire qu’il y a assez de médecins ! Voilà le premier point sur lequel je souhaitais insister.
Deuxième point, et cela figurait également dans le rapport Berland, des solutions incitatives pour l’installation de médecins doivent être mises en œuvre dans les « zones médicales défavorisées ». C’est là que nos points de vue divergent : pour ma part, je pense qu’il faut faire confiance aux acteurs, …

M. Jacques Blanc. … je suis contre les contraintes et pour le respect de la liberté d’installation. En revanche, je souhaite que soient mises en place de vraies mesures d’incitation.
Protestations sur les travées du groupe socialiste.

Mon cher collègue, je vous invite à venir en Lozère. Dans ce département, neuf étudiants internes ont signé un contrat – je peux vous montrer le guide d’installation –, et l’un d’entre eux vient de s’installer à Florac. Ces contrats accordent une indemnité d’étude en contrepartie de l’engagement à exercer pendant cinq ans dans une zone déficitaire, ce qui constitue une mesure d’incitation tout à fait forte ; les médecins peuvent d’ailleurs décider de s’installer plus longuement. Mais il faut du temps pour mettre en œuvre des mesures de ce type.

Il en va de même pour les contrats d’engagement, qui ont été mis en place par la loi HPST ; cette dernière disposition n’ayant que deux ans d’existence, elle ne peut porter ses fruits dès aujourd’hui !
Ces différentes mesures d’incitation devraient permettre l’installation de médecins dans les zones rurales où, d’ailleurs, la qualité de vie aujourd’hui fera que, demain, j’en suis convaincu, les nouveaux arrivants décideront de rester.
Une autre incitation consiste à accorder des indemnités d’hébergement et de déplacement – les frais nécessaires pour aller suivre des cours à l’université – au moment des stages.
De telles mesures incitatives ont été mises en œuvre dans le cadre de la loi HPST avec Mme Roselyne Bachelot-Narquin.
Des mesures d’incitation financière ont également été insérées dans la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : des exonérations de charges dans les zones de revitalisation rurale ont ainsi été prévues.

Un certain nombre de mesures n’ont pas encore fait la preuve de leur efficacité, mais leur conjugaison …

Mes chers collègues, quand je vois ce qui s’est passé en Grande-Bretagne, …

… ce qui se passe aux États-Unis, je me dis que le modèle français est bien le meilleur !

La pénurie sévit partout ; en France, on peut préserver la qualité.
À cette fin, il faut former davantage de médecins et les inciter à s’installer dans les zones rurales déficitaires par les mesures que j’ai rappelées à l’instant. L’acte d’installation doit cependant rester volontaire. Il n’y a en effet rien de pire que d’obliger un médecin à aller s’installer à tel ou tel endroit. On mérite mieux dans l’espace rural !
Je demande à notre collègue Jean-Pierre Fourcade d’évaluer le développement de ces mesures incitatives. Ne disons pas qu’elles ne fonctionnent pas alors qu’elles ont été mises en œuvre voilà à peine deux ans par la loi HPST pour les unes, et par la loi sur le développement des territoires ruraux pour les autres.
Madame la secrétaire d’État, je souhaite donc que vous vous libériez des a priori à la lumière du rapport Hubert, qui vient compléter les études menées auparavant, et grâce au recul que nous pouvons avoir aujourd’hui par rapport à la loi HPST. Je vous demande, premièrement, de faire sauter les blocages liés au numerus clausus et, deuxièmement, d’augmenter le nombre de contrats d’engagement signés avec l’État – 400 contrats dont 200 pour les internes – s’agissant des incitations à l’installation en zone de revitalisation rurale.
J’avais déposé un amendement visant à favoriser le remplacement dans les zones de revitalisation rurale. Mme Roselyne Bachelot-Narquin l’avait trouvé intéressant mais avait renvoyé sa mise en œuvre à un décret.
Mes chers collègues, vous le savez, aujourd’hui, les médecins effectuent des remplacements pendant dix ans avant de s’installer définitivement à leur compte. Si on favorise la venue de ces remplaçants dans les zones en désertification, on les fixera.
Le principe fondamental de liberté d’installation n’est donc pas remis en cause. Il y a eu des échecs partout !

N’allez pas me dire que des résultats spectaculaires et positifs ont été jusqu’à présent apportés ! Tirons les leçons de la situation actuelle, qui se dégrade à cause du manque de médecins…

… et de l’absence jusqu’à présent de mesures incitatives.
Par ailleurs, j’en suis convaincu, la mise en place de maisons de santé pluridisciplinaires constitue une excellente réponse.
Pour ma part, j’ai exercé la médecine dans un espace rural ô combien isolé, la Lozère. Je sais ce que c’est que de se lever la nuit, de partir seul sur les routes voir des malades, de travailler vingt-quatre heures.

C’est fini ! Il faut donc permettre aux médecins de travailler dans des maisons de santé pluridisciplinaires tout en gardant la possibilité d’exercer en libéral.
Dans la modeste commune de La Canourgue, dont je suis le maire, je crée un établissement de ce type qui sera ouvert à la fin de cette année et qui nous permettra d’être attractifs.

Nous avions quatre médecins. Deux d’entre eux prennent leur retraite ; les deux autres ne peuvent pas rester seuls. Ils ont besoin de travailler ensemble, avec des infirmières.
Car nous ne formons pas assez d’infirmières, de kinésithérapeutes et de membres d’autres professions paramédicales. La maison de santé pluridisciplinaire est une bonne réponse, qui respecte l’exercice libéral tout en permettant de lever certains blocages.
En effet, et je terminerai sur ce point, l’une des causes de la désertification médicale, c’est l’angoisse du médecin, qui, en dehors des problèmes d’organisation de vie, peut le faire hésiter à s’installer seul, on l’oublie trop souvent. Mes chers collègues, certains d’entre vous le savent peut-être : quand vous êtes seul face à un malade et qu’il faut établir un diagnostic ou mettre en œuvre un acte thérapeutique d’urgence, c’est terriblement anxiogène ! Si vous êtes dans une maison de santé pluridisciplinaire avec une infirmière, vous pouvez discuter avec d’autres médecins, vous pourrez même utiliser à l’avenir les techniques nouvelles grâce au très haut débit.
Ne cassons pas ce qui est la chance même de la qualité de la distribution des soins dans notre pays, à savoir l’exercice libéral associé au système hospitalier. Traitons les vrais problèmes – le nombre insuffisant de médecins, …

… l’absence de mesures incitatives – et appuyons-nous sur les maisons médicales pluridisciplinaires qui permettront aux médecins de travailler dans des conditions susceptibles de les libérer de cette angoisse qui est parfois terrible mais qui est tout à l’honneur du corps médical.
N’oublions pas cette réalité humaine, n’allons pas casser notre système ; au contraire, faisons confiance aux acteurs et allons de l’avant !
Madame la secrétaire d’État, vous avez une grande responsabilité. Ne tombez pas dans le piège qui peut être tendu parfois pour des raisons idéologiques !

M. Jacques Blanc. Restons fiers ! Mes chers collègues, quand on fait le tour du monde, on s’aperçoit que c’est encore en France qu’on est le mieux soigné !
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Monsieur le président, madame le secrétaire d'État, mes chers collègues, le présent débat est un peu comme le mur des lamentations, l’espoir en moins.
Je remercie d’emblée le groupe CRC-SPG de l’avoir initié, parce qu’il est fondamental pour beaucoup d’entre nous.
En effet, d’une loi de financement de la sécurité sociale à l’autre, la situation ne s’améliore pas du tout ; on peut même dire que, de débats en débats, de rapports en rapports, elle empire. Nous sommes d’ailleurs presque à un anniversaire : le 26 janvier 2006, Xavier Bertrand présentait déjà devant le conseil des ministres un plan d’action pour endiguer les problèmes de démographie médicale. Nous voilà cinq ans après !
Alors que la moyenne nationale est de 320 praticiens pour 100 000 habitants, l’Orne a une densité de 70 médecins pour 100 000 habitants. Nous sommes pratiquement « lanterne rouge » ou « lanterne noire », l’Eure, que représente mon collègue Hervé Maurey, se situant juste après nous.
La situation est donc grave et le problème est non pas théorique mais extrêmement pratique. En outre, les densités médicales mentionnées n’expriment que des moyennes : la situation de certains territoires est très dégradée, quand elle n’est pas à proprement parler totalement alarmante.
Les travaux conduits par l’union régionale des médecins libéraux en lien avec l’ARS sur la médecine libérale mettent en exergue des zones étendues confrontées à une sous-médicalisation. Il en est ainsi de la totalité du département de l’Orne, de la moitié de celui de la Manche et d’un quart de celui du Calvados situés dans la région Basse-Normandie à laquelle j’appartiens.
À cela s’ajoute le départ en retraite des médecins. D’ici à quinze ans, la proportion de praticiens ayant cessé leur activité dépassera 60 % dans le département de l’Orne.
Au regard des sorties annuelles du cursus universitaire médical ces prochaines années, le solde demeurera négatif : il est à envisager que le nombre d’entrées dans la profession de médecin ne puisse égaler le nombre de sorties qu’en 2020.
Madame la secrétaire d’État, je vous fais part de faits concrets et non d’incantations.
Comme d’autres orateurs, je veux à mon tour souligner que les besoins de santé vont évoluer du fait du vieillissement de la population.
Il faut aussi prendre en considération les aspirations des nouveaux praticiens.
Par ailleurs, certaines spécialités se trouvent dans une situation délicate. Ainsi, dans mon département, il faut attendre plus de six mois pour obtenir un rendez-vous avec un ophtalmologiste.

Partageant le temps de parole accordé au groupe de l’Union centriste avec Hervé Maurey, je serai assez brève. Je veux cependant profiter de mon intervention pour rendre hommage aux élus locaux, auxquels sont imputables – et non au législateur – les premières solutions apportées en la matière.
Les premières maisons de santé ont été créées dans les années quatre-vingt-dix dans mon département. Il s’agit, selon moi, d’une réponse parmi d’autres à la désertification. Des maisons de santé peuvent être très bien organisées sans toutefois disposer de médecins. L’existence de telles structures peut fidéliser un certain nombre de jeunes praticiens, éventuellement les inciter à s’installer dans une région ; ceux-ci peuvent se sentir sécuriser au sein d’un groupe, je le conçois, monsieur Blanc. Ce n’est pas en tout cas la seule solution.
Je voudrais également rendre hommage à Pierre-Jean Lancry, directeur de l’Agence régionale de santé de Basse-Normandie qui gère la pénurie avec brio et intelligence ; il essaie de faire au mieux avec les moyens du bord. Son dialogue avec les élus est tout à fait essentiel.
J’estime qu’il faut absolument trouver des solutions pertinentes au problème existant. Celles qui sont applicables en Lozère ne sont pas forcément adéquates en Basse-Normandie ou dans les périphéries des grandes villes sous-dotées, même si les difficultés se posent dans les mêmes termes.

Développer les ARS et apporter des réponses adaptées aux territoires me semble être la bonne solution.
Cela étant, dans ma région, le plan Hôpital 2012 a connu un vrai succès, même si sa mise en œuvre a été un peu chahutée. Le résultat est excellent.
Il ne sera pas possible d’endiguer la pénurie médicale sans l’adoption de mesures coercitives tendant à faire venir les médecins en zone rurale ou en zone sous-équipée. Tous les PSLA, les pôles de santé libéraux ambulatoires, installés par les élus ne fonctionneront pas si les praticiens indispensables sont absents, malgré des équipements chers et lourds.
Comment évoquer la télémédecine ou la médecine à distance dans des régions dépourvues du haut débit, où les portables ne fonctionnent pas en raison de l’existence de zones blanches ?
C’est l’effet Matthieu : « À celui qui a, tu donneras et il aura tout en abondance ; à celui qui n’a pas, tu enlèveras même ce qu’il a. » Dans un territoire démuni de haut débit, de médecins, de sapeurs-pompiers volontaires, nos concitoyens se dirigent vers l’hôpital et les urgences sont indûment encombrées.
Je conclurai en disant, madame la secrétaire d’État, que le bonheur est dans le pré, à condition d’être en bonne santé !
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, en introduction, permettez-moi de profiter de cette tribune pour brièvement évoquer les difficultés d’accès aux soins. Comme cela a été indiqué, l’inéquitable répartition des médecins entre les régions de France participe à cette difficulté. La précarité, la pauvreté sont aussi des facteurs de retard en matière de soins, ainsi que le refus de certains professionnels d’ausculter des patients bénéficiant de la CMU.
Que dire des nouvelles dispositions sur l’aide médicale d’État ? Imposer aux malades sans papiers et sans ressource une contribution forfaitaire de 30 euros revient à les condamner à un retard de soins, si ce n’est à une absence totale de soins. C’est une atteinte à la dignité humaine et une faute de santé publique.
Le Gouvernement fait peu de publicité au récent rapport de l’Inspection générale des affaires sociales et de l’Inspection générale des finances pour lesquelles ce dispositif est « financièrement inadapté » et « porteur de risque sanitaire ». Il serait bon, madame la secrétaire d’État, que le Gouvernement entende les nombreuses voix qui demandent la suspension de cette mesure inique et discriminatoire.
Le débat qui nous réunit cet après-midi, sur l’initiative de nos collègues du groupe CRC-SPG, doit nous permettre d’apporter des solutions concrètes et immédiates à la disparition lente et inéluctable de la présence des professionnels médicaux non seulement dans nos communes rurales, mais aussi dans certaines de nos villes.
Je rappellerai rapidement le constat qui vient d’être dressé.
Les médecins qui sont présents dans nos territoires vieillissent. Dans certains cantons du Finistère, leur moyenne d’âge est de cinquante-six ans. Le tiers des médecins a plus de soixante ans. Ils ont de plus en plus de difficultés à trouver un professionnel qui veuille bien les remplacer. Les jeunes praticiens ne veulent plus être corvéables à merci. Ils ne veulent plus exercer leur métier de manière isolée. Ils expriment la volonté de profiter de leurs enfants et d’avoir des loisirs. Leur conjoint veut également exercer sa profession.
Les habitants, quant à eux, sont inquiets de la disparition de leurs médecins. Après la fermeture de nombreuses maternités et de certains hôpitaux de proximité, nos concitoyens voient les temps d’attente pour consulter un spécialiste s’allonger – je rappelle qu’en Bretagne il faut patienter un an pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologiste – et les distances pour se rendre chez un médecin généraliste augmenter. Il en résulte un encombrement des services des urgences par la « bobologie ».
À titre d’exemple, Morlaix, commune de 18 000 habitants, ne dispose plus de gynécologue.
Les élus, notamment les maires, sont les premiers interlocuteurs à qui l’on reproche ces carences, alors que – je veux le rappeler dans cet hémicycle de façon solennelle – l’accès aux soins est une prérogative de l’État. Des annonces sont faites régulièrement par les pouvoirs publics, jurant, la main sur le cœur, que cette situation sera prochainement enrayée.
Pourtant, tout récemment encore, le Président de la République a semblé découvrir le problème. En effet, dans un discours prononcé le 1er décembre à Orbec qui succédait à un autre discours sur le même thème le 16 avril à Livry-Gargan, il a déclaré : « Vous n’aurez pas longtemps à attendre avant de voir la détermination du Gouvernement en la matière ».

Nous attendons toujours...
La loi HPST avait instauré le contrat santé solidarité. Ce dernier ne semblait déjà pas à l’époque aller assez loin ; certes, il avait le mérite d’exister. Des solutions plus radicales, plus coercitives devaient être trouvées. Lors de la discussion du projet de loi susvisé, j’avais déposé un amendement tendant à obliger les nouveaux médecins à exercer au moins deux ans dans des zones déficitaires, espérant qu’ils y trouvent intérêt. Je n’ai pas été suivi.
La majorité n’a rien trouvé de mieux que de vider de sa substance ce contrat santé solidarité dès l’été suivant l’adoption de la loi HPST. Les quelques mesures contraignantes – obligation de donner la date de ses absences, obligation de soutien dans les zones déficitaires – ont été tout simplement annulées.
Pourtant, et les associations de patients l’ont encore rappelé au mois de décembre, les déserts médicaux persistent, alors que l’assurance maladie verse annuellement à chaque médecin installé en zone déficitaire une prime de 25 000 à 28 000 euros !
Comme le pointe dans son rapport Élisabeth Hubert, l’une des pistes est de bien définir ce qu’est un désert médical. Elle renvoie cette définition au travail des nouvelles agences régionales de santé qui ont, avec la loi HPST, un rôle important en la matière.
Sur cette question, le Gouvernement fait, comme à son habitude, un pas en avant et trois pas en arrière. Nous ne percevons aucun projet construit, travaillé, qui permette de penser qu’il y ait une réelle volonté de structurer une offre de santé harmonieuse et efficace auprès de tous les Français.
Les maisons de santé, remède miracle dont se gaussent nos gouvernants, se développent, sur l’initiative de nos collectivités, qui s’endettent pour répondre à des obligations qui ne sont pas les leurs. L’État participe faiblement à leur financement. En effet, les maires des communes rurales ou des communes périurbaines, que le Gouvernement tend trop souvent à stigmatiser comme mauvais gestionnaires, font face à la pénurie en raison de l’urgence. Ils doivent séduire des professionnels de santé, dont le nombre est en augmentation – des orateurs précédents l’ont déjà indiqué –, mais qui n’ont aucune obligation, aucune contrainte, les réunir autour d’une table et les inviter à rédiger un projet médical. Les élus doivent aussi construire une maison de santé, tout cela sans aucune assurance de maintien d’une offre de santé pérenne sur leur territoire. À l’issue de ce processus, le résultat peut être négatif, d’autres orientations ayant été retenues ou les jeunes médecins espérés faisant défaut.
Aussi, je le répète, l’État doit prendre sa pleine part de responsabilité pour lutter contre la désertification médicale.
Dans sa convention sur l’égalité réelle, le parti socialiste propose la mise en place d’un bouclier rural. C’est ce vers quoi nous devons tendre. Il convient de faire en sorte que les services publics essentiels, dont fait bien évidemment partie la médecine généraliste, ne nécessitent pas un déplacement de plus de vingt minutes pour chaque citoyen. Les services des urgences et les maternités, quant à eux, ne doivent pas être situés respectivement à plus de trente minutes et de quarante-cinq minutes du domicile de nos concitoyens.
Plus qu’une politique de réconciliation avec les médecins, dont le métier est difficile et essentiel, c’est ce pacte républicain aujourd’hui urgent que nous devons engager avec nos concitoyens pour un égal accès aux soins pour tous.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG. – M. Robert Tropeano applaudit également.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, au cours de ces derniers mois, le Président de la République a rappelé que dans le domaine de la santé, après la réforme de l’hôpital, la priorité est la médecine libérale. Plusieurs déplacements ont été l’occasion pour lui de faire des annonces en faveur des médecins généralistes, mais le problème concerne tout autant les médecins spécialistes.
Débattre de la désertification médicale, c’est évoquer entre autres des problèmes géographiques, sociologiques. Deux défis majeurs doivent être relevés.
Le premier d’entre eux, que Jacques Blanc a largement évoqué tout à l’heure, consiste à enrayer la baisse du nombre de médecins.

En 2009, on dénombrait 290 médecins pour 100 000 habitants. Or nous savons que la situation devrait se dégrader jusqu’en 2020, date à laquelle la densité de médecins aura retrouvé son niveau de 1980. Ce fait suppose une forte réaction.

De surcroît, cette réduction touche plus fortement l’exercice libéral. Les départs en retraite non remplacés en sont l’illustration principale dans les départements. À cela s’ajoute la répartition inégale des effectifs sur le territoire, phénomène qui concerne non seulement la France profonde, mais également des départements proches de grandes villes. Ainsi, dans le sud de l’Essonne existent des zones non denses où ne restent plus que six médecins âgés de plus de cinquante-huit ans. D’ici à quelques années, la situation sera dramatique.

Le second défi majeur est donc de rendre la médecine libérale plus attractive. L’exercice libéral a perdu de son attractivité en raison, notamment, de l’évolution de l’hôpital, qui offre le salariat et permet un travail en équipe sécurisant – Jacques Blanc l’a souligné à juste titre –, et de celle des attentes des médecins, qui aspirent dorénavant à travailler avec leurs confrères et de manière plus flexible.
Un médecin diplômé sur dix seulement fait aujourd’hui le choix de l’exercice libéral, chiffre qui doit retenir notre attention.
Certes, le numerus clausus des étudiants en médecine a augmenté – insuffisamment, je n’y reviens pas –, mais nombre d’entre eux deviennent médecins conseils ou médecins du travail, et les femmes médecins choisissent de préférence des voies leur permettant d’avoir plus de temps pour élever leurs enfants, ce que personne ne songerait à leur reprocher.
De plus, les médecins font face à une bureaucratisation croissante – un généraliste consacrerait en moyenne 36 % de son temps de travail à des tâches administratives, …

… à des contrôles permanents de la sécurité sociale, ainsi qu’à des horaires à rallonge.
À juste titre, les médecins ne veulent d’ailleurs plus assurer seuls des horaires de huit heures à vingt-deux heures, dans des endroits peu sûrs, avec parfois des cas lourds qui prennent plus de temps et les transforment en assistants sociaux.
Le médecin de famille tel qu’on le concevait autrefois n’existe quasiment plus.
Sur la base du rapport de Mme Élisabeth Hubert, ancienne ministre de la santé, le Président de la République a précisé, le 1er décembre dernier, son projet de réforme de la médecine de proximité et de la rémunération des généralistes libéraux.
L’idée n’est pas de revenir sur le paiement à l’acte, mais d’y ajouter des compléments en fonction de ce qu’il convient d’appeler « des contraintes ».
Le premier niveau de la rémunération resterait donc constitué par le paiement à l’acte, auquel s’ajouterait une part de rémunération forfaitaire qui financerait certaines activités, comme les permanences de garde dans les maisons médicales ou la « fonction de service public » que remplissent les médecins en s’installant dans les « déserts » médicaux.
Je crois sincèrement aux maisons de santé, notamment rurales, avec généralistes, infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, etc., pour remédier à la désertification médicale : avec leur potentiel de patients, elles pourraient constituer une amorce de nature à attirer d’autres médecins, tant généralistes que spécialistes.
L’institution d’un nouveau véhicule juridique adapté à la diversité des situations pour les pôles de santé regroupés me semble également un excellent objectif.
L’Essonne manque d’infirmiers – toute une zone dans le sud du département est même dépourvue de service de soins infirmiers à domicile – et, là également, il faut attendre six mois pour obtenir un rendez-vous avec un spécialiste, ophtalmologiste ou gynécologue notamment. Ce n’est pas le record de la Bretagne, mais ce n’en est pas moins insupportable.

Le troisième niveau de la rémunération serait défini en fonction des objectifs de santé publique et de leur respect.
La dernière mesure que je citerai dans cette énumération non exhaustive est la création d’un guichet unique destiné à faciliter la création de ces pôles de santé avant le 1er juillet 2011 pour tous les professionnels de santé qui voudraient créer un pôle de santé avec les élus me paraît une excellente réponse à la demande forte de nos départements ou de nos cantons où persiste la désertification médicale.
Madame la secrétaire d'État, nous comptons sur vous pour apporter des solutions à nos concitoyens, qui attendent du Gouvernement une réaction à la hauteur de cette situation préoccupante.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

La parole est à M. Hervé Maurey, qui, grâce à Mme Nathalie Goulet, bénéficie de quelques minutes supplémentaires de temps de parole.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je veux d’abord remercier le groupe CRC-SPG d’avoir pris l’initiative de ce débat, et remercier ensuite ma collègue Nathalie Goulet d’avoir bien voulu me laisser une partie de son temps de parole.
Madame la secrétaire d'État, si j’ai souhaité disposer de quelques minutes supplémentaires, ce n’est pas pour parler du département de l’Eure, qui a le triste privilège d’être au dernier rang en matière de démographie médicale, mais pour dire avec toute ma conviction que nous ne réglerons pas le problème de la démographie médicale en restant dans l’incitatif.
Je suis – vous m’en voyez navré – en désaccord profond avec mon collègue et ami Jacques Blanc. Je ne suis pas, pour reprendre son expression, un « idéologue de gauche »
Sourires sur les travées du groupe socialiste

En cela, je partage l’avis du Président de la République, qui, en septembre 2007, disait : « En matière de démographie médicale, il faut s’inspirer au minimum des négociations entre l’assurance maladie et les infirmières, ces dernières ayant accepté de ne pas s’installer dans les zones où elles sont trop nombreuses. »

Je ne partage pas, en revanche, l’avis du Président de la République, lorsque, voilà quelques semaines, il disait : « La coercition, ça ne marche jamais. »

Ce qui ne « marche » pas, ce sont les mesures purement incitatives, comme des personnalités bien plus compétentes que moi l’ont constaté dans divers rapports. Il y a ainsi eu, voilà quelques années, le rapport de notre collègue Jean-Marc Juilhard, le rapport de Marc Bernier, député de l’UMP, à la suite de la mission présidée par Christian Paul, député socialiste, le rapport du Haut Conseil de l’assurance maladie, le rapport du Conseil national de l’Ordre…

Lors de l’examen, en 2009, du projet de loi HPST, j’avais déposé deux amendements que je tiens à rappeler, car je suis convaincu que, un jour, on viendra aux dispositions que j’avais alors proposées.
Le premier de ces amendements visait à prévoir que les médecins s’installant dans une zone où l’offre de soins est élevée ne bénéficieraient pas du remboursement de leurs honoraires, selon le modèle qui s’applique pour les infirmières.
Le second amendement, quant à lui, prévoyait que les jeunes diplômés s’installent, au minimum, trois ans dans une zone où l’offre de soins est déficitaire, disposition que je proposais de n’appliquer qu’à partir de 2017 pour laisser le temps aux mesures incitatives de faire, éventuellement, leurs preuves, cas dans lequel, naturellement, elle aurait perdu son objet.
Il est intéressant que ces deux amendements aient suscité des réactions caricaturales d’une incroyable violence, le rapporteur n’hésitant pas à dire que je voulais rétablir le STO et forcer les médecins à s’installer dans des « trous » !

Il est également intéressant de rappeler par qui ces amendements, que j’avais souhaité maintenir – ils ont recueilli très peu de voix –, ont été votés. Sur l’un d’eux, j’avais d'ailleurs demandé un scrutin public : le groupe CRC-SPG l’a voté en totalité ; quelques membres du RDSE et de l’Union centriste l’ont également voté ; en revanche, aucun sénateur de l’UMP, aucun sénateur socialiste n’a voté ces amendements qui étaient, semble-t-il, politiquement incorrects.
Aujourd’hui, ma conviction est intacte. Je reste convaincu que les mesures incitatives ne « marchent » pas et je donne rendez-vous à tous ceux qui le souhaitent dans cinq ans, dans dix ans, dans quinze ans !

Je suis navrée que Mme Bachelot-Narquin ait mis entre parenthèses le dispositif « contrat santé solidarité ». C’était le seul élément un tant soit peu contraignant – très peu d’ailleurs – de la loi HPST, qui, je le dis avec beaucoup de gravité et de tristesse, n’aura aucun effet sur la démographie médicale.
Je suis convaincu, je le répète, qu’un gouvernement peut-être plus courageux que les autres – j’espère qu’il sera de droite plutôt que de gauche, mais peu importe en l’espèce – aura, un jour, le courage de prendre des mesures fortes en la matière.

M. Hervé Maurey. Je trouve qu’il n’y a rien de choquant à demander à de jeunes diplômés, dont les études ont été financées par l’État, de rendre service à celui-ci en s’installant là où l’on a besoin d’eux pendant quelques années !
Applaudissements sur plusieurs travées du groupe socialiste. – Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat et Nathalie Goulet applaudissent également.

… sans que cela choque qui que ce soit. Je ne vois pas pourquoi il en irait différemment pour les médecins.
Ce matin a eu lieu dans cet hémicycle un débat très intéressant sur la ruralité ; nous restons en plein dans ce sujet puisque Bruno Le Maire a considéré, en conclusion, que le problème numéro un de la ruralité était la démographie médicale.

M. Hervé Maurey. Je partage naturellement son avis et, parce que je le partage, j’espère que le Gouvernement ne jouera pas indéfiniment l’autruche en refusant de voir les choses telles qu’elles sont et qu’il prendra les mesures courageuses qui s’imposent. Il en va de la vitalité et, même, de la vie tout court de nos territoires ruraux.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, ce débat tombe à point nommé puisqu’il me permet d’aborder le problème criant du secteur de la santé dans mon département, la Guyane. Je tiens donc à remercier le groupe CRC-SPG, qui est à l’origine de cette initiative.
Il est ici question de désertification médicale. En Guyane, malheureusement, nous avons dépassé ce stade : nous ne sommes pas dans un processus de déficit ou d’exode de médecins tout simplement parce que nous sommes déjà un désert médical !
Le diagnostic est sévère, et d’autant plus implacable que le département est confronté à une croissance démographique exceptionnelle, avec un taux de 3, 9 %, soit le plus important de France et l’un des plus importants au monde, et qu’il détient des indicateurs de santé parmi les plus mauvais de France, pour ne pas dire les plus mauvais.
En effet, en Guyane, l’espérance de vie – soixante-dix-neuf ans pour les femmes, soixante-douze pour les hommes – est inférieure de quatre ans à celle de la métropole. Le taux de mortalité infantile est de 10, 5 pour 1 000 naissances, au lieu de 4 pour 1 000 dans le reste de la France. Plusieurs pathologies – diabète, hypertension artérielle, sans oublier le virus de l’immunodéficience humaine, le VIH – y ont des prévalences plus élevées que dans le reste de la France. Le taux des maladies entériques, est important, surtout dans les communes de l’intérieur, ces maladies, telles que typhoïdes, gastro-entérites, diarrhées infectieuses, entraînant des retards de développement et des retards scolaires chez les enfants.
Cette situation sanitaire plus que dégradée nécessiterait une couverture sanitaire adaptée à des besoins croissants. Pourtant, force est de remarquer qu’en matière de démographie médicale la Guyane souffre toujours d’un déséquilibre important par rapport à la métropole. Le département est entièrement classé comme zone déficitaire en médecins libéraux, et la directrice de la caisse générale de sécurité sociale de Guyane n’a pas hésité à déclarer que le nombre de médecins était trois fois inférieur aux besoins.
La densité moyenne en médecins généralistes, médecins spécialistes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et dentistes est plus qu’alarmante.
Selon les données de 2009, on compte, pour 100 000 habitants, 38 médecins généralistes en Guyane contre 112 en France métropolitaine et, respectivement, 83 et 82 en Martinique et en Guadeloupe ; 22 médecins spécialistes contre 88 en France métropolitaine et, respectivement, 48 et 60 en Martinique et en Guadeloupe ; 38 chirurgiens-dentistes contre 62 en France métropolitaine.
Encore faut-il préciser que les médecins généralistes et spécialistes ont, pour 30 % d’entre eux, entre 55 et 70 ans et qu’ils sont concentrés sur l’île de Cayenne et sur Kourou. Beaucoup de communes ayant déjà une densité inférieure à trois médecins généralistes par tranche de 5 000 habitants se trouvent ainsi très éloignées d’un service d’urgence.
La sonnette d’alarme a été maintes fois actionnée. Les propositions ne manquent pas. Elles ont largement été développées dans des rapports, avis et plans divers, tant locaux que nationaux – le rapport de Mme Hubert a été remis le 23 novembre 2010 au Président de la République – mais ce sont les mêmes mesures qui sont toujours avancées.
La Guyane doit être dotée d’une véritable politique volontariste d’incitation à l’installation de médecins libéraux. Certes, il y a eu des avancées, notamment en ce qui concerne le tarif de la consultation et l’installation de médecins étrangers, exception guyanaise en France, mais il est des demandes locales, telles que la zone franche médicale et la réduction de l’octroi de mer pour le matériel professionnel et technique afin de faciliter l’investissement des spécialistes, qui sont restées lettre morte.
L’accent doit être également mis sur la continuité territoriale, qui doit être renforcée. Dans un territoire aussi grand que le Portugal, avec de très fortes disparités territoriales et une fracture entre la bande littorale, assez bien équipée, et l’intérieur enclavé, c’est un point essentiel.
L’absence d’avion sanitaire dédié ou d’hélicoptère pour la sécurité civile pose, autant que l’isolement de certaines populations, un problème majeur en matière d’égalité d’accès aux soins.
Certaines communes sont particulièrement démunies en infrastructures. Les délais d’intervention sont extrêmement longs. Les systèmes de communication en cas d’alerte restent insuffisants.
Je rappelle que le dispositif d’aide aux transports aériens et la définition des critères d’octroi constituent l’un des objectifs du plan « santé outre-mer ». Or, à ce jour, aucune initiative n’a été communiquée. C’est pourtant un élément crucial au titre de la continuité territoriale afin de réduire les importantes charges de transport des établissements.
Par ailleurs, de réels moyens financiers doivent être garantis pour améliorer la couverture sanitaire en équipements technologiques de pointe. Il est navrant de constater que, dans le plan Hôpital 2012, seuls 2, 2 % de l’enveloppe globale sont consacrés aux outre-mer.
Une autre mesure essentielle est le renforcement de la formation et son adaptation aux spécificités du département.
À ce sujet, la demande d’augmentation du numerus clausus par les outre-mer n’a été que partiellement entendue puisque, pour la rentrée universitaire 2010-2011, seulement trois places de plus ont été prévues pour l’université d’Antilles-Guyane.
La faculté de médecine d’Antilles-Guyane, créée en 1988, ne dispose, quant à elle, à l’heure actuelle que de vingt-trois personnels hospitalo-universitaires.
Sans une accélération du nombre de créations de postes, cette faculté ne parviendra au niveau du CHU de Limoges que dans soixante ans ! Pourtant, celui-ci est le moins pourvu de France après le CHU d’Antilles-Guyane !
Pour l’heure, nous sommes donc très loin des promesses du conseil interministériel de l’outre-mer, ou CIOM, du 6 novembre 2008, qui prévoyait la création d’un cursus complet des études médicales aux Antilles-Guyane et souhaitait, notamment pour la Guyane, faire de la santé une activité de pointe.
Une fois de plus, ces très bonnes intentions sont encore loin de la réalité.
Madame la secrétaire d’État, l’égalité devant les soins ne serait-elle qu’un vœu pieux ?
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG ainsi que sur plusieurs travées de l’UMP – Mme Nathalie Goulet applaudit également.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je remercie tout d’abord le groupe CRC-SPG de nous avoir donné l’occasion de débattre d’une question essentielle.
La santé est un sujet fondamental parce que le droit à la santé est fondamental. La question de la désertification médicale nous interpelle sur le droit d’accéder aux soins en tout point de notre territoire.
Parler, discuter, débattre de la démographie médicale est essentiel tant la santé des Français est prioritaire.
Je vous le dis en préambule, avec M. Xavier Bertrand, nous nous battrons pour que tous les Français disposent d’une médecine de qualité sur l’ensemble du territoire national.
Je voudrais, en premier lieu, partager un constat avec vous sur cette désertification médicale dont nous venons de parler et contre laquelle ce Gouvernement se bat.
La problématique de la désertification médicale ne peut se résumer au manque de médecins généralistes dans certaines communes rurales.
Vous l’avez dit, monsieur Vera, la désertification médicale concerne également les zones périurbaines. Chacun le sait, vous l’avez d’ailleurs rappelé, en banlieue, à quelques kilomètres parfois du centre d’une grande ville, il est encore difficile, voire impossible, de trouver un médecin généraliste ou spécialiste.
Plus largement, la désertification médicale englobe toutes les questions liées à l’offre de soins, à la coopération entre professionnels de santé et à leur répartition sur le territoire national.
De plus, la démographie des professions de santé se caractérise par une inégale répartition des professionnels entre les régions.
Le nombre de médecins est de 209 143 en France métropolitaine, dont 101 667 généralistes. Leur densité moyenne sur le territoire métropolitain est 339 pour 100 000 habitants.
Mais, et vous l’avez signalé à de nombreuses reprises, cette densité est très variable d’une région à l’autre. Vous avez cité certains chiffres, je vous communique ceux dont je dispose. Cette densité moyenne va de 256 en Picardie à 405 en Île-de-France et 412 en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Et, d’un département à l’autre au sein d’une même région, par exemple en Île-de-France, la densité varie même de 123 en Seine-et-Marne à 288 à Paris.
À ce nombre de médecins, il faut ajouter les autres professionnels de santé qui remplissent un rôle primordial au cœur de notre système de santé.
Le nombre des autres professionnels de santé, en 2010, est de 825 190 en France métropolitaine. Il est composé pour une large majorité d’infirmiers, 515 754, soit 62 %, puis viennent les pharmaciens, 74 059, les masseurs-kinésithérapeutes, 68 923, et les chirurgiens-dentistes, 40 930.
Les infirmiers connaissent ainsi la densité la plus importante, soit 830 pour 100 000 habitants. Il faut aussi souligner la diversité de cette densité, qui va de 1 074 infirmiers pour 100 000 habitants dans le Limousin à 662 dans le Centre. Je reviendrai ultérieurement sur ce point pour répondre à M. Georges Patient à propos de la question des formations.
Pour lutter contre la désertification médicale et pour mieux répartir les professionnels de santé sur le territoire national, de nombreuses mesures ont été prises depuis cinq ans.
Pour commencer, puisque vous me parlez des décrets d’application de la loi HPST, je souhaite préciser que les huit ordonnances prévues ont toutes ont été publiées, ainsi que 106 des 154 décrets. Nous travaillons sur les autres en ce moment. Cela a demandé un travail énorme de la part des services du ministère de la santé et je tiens à relever ici la qualité de ce qui a été produit.
Dans le cadre de la loi HPST, les mesures incitatives ont été privilégiées. J’ai bien entendu, à ce sujet, les avis parfois divergents qui ont été exprimés.
Nous avons, en effet, confiance dans les professionnels médicaux pour faire face à leurs responsabilités et répondre aux enjeux de santé publique.
Les dispositifs tels que la répartition quinquennale des postes d’internes par spécialité et par région, les quotas paramédicaux ou encore le rééquilibrage des numerus clausus permettent une régulation territoriale des flux de formation des professionnels de santé.
J’ajouterai quelques précisions concernant le numerus clausus. Le nombre d’étudiants autorisés à poursuivre leurs études en médecine a doublé en dix ans.
Peut-être, mais je tiens à souligner cette dynamique.
Nous sommes passés de 3 700 en 1999 à 7 400 en 2011. Ces places supplémentaires – c’est important – ont été prioritairement affectées dans les régions dont la densité médicale est inférieure à la moyenne nationale : l’Ouest, le Nord-Ouest et le Nord-Est. Aux Antilles et en Guyane, le numerus clausus a augmenté, entre 2000 et 2010, de 15 à 76.
Par ailleurs, les postes offerts à l’issue des épreuves classantes nationales, qui répartissent les étudiants en médecine entre les différentes spécialités, ont été augmentés au sein des régions et des spécialités, avec un objectif de rééquilibrage entre les régions.
À ce titre, une attention particulière a été portée à la médecine générale afin de garantir une offre de soins de premier recours efficiente et accessible.
En outre, l’arrêté du 12 juillet 2010 détermine, pour la période 2010-2014, le nombre d’internes à former par subdivision et spécialité.
Il s’agit du premier arrêté pluriannuel glissant prévu par la loi HPST, une mesure dite « de filiarisation ». Il consiste, pour les spécialités médicales et chirurgicales, à proposer des postes d’internes par diplôme d’études spécialisées, ou DES, soit trente spécialités, et non plus par discipline, au nombre de onze.
Ainsi, les flux d’internes seront progressivement adaptés aux besoins démographiques, avec une vision prospective des besoins de soins et une adaptation des capacités de formation correspondante.
S’agissant des épreuves classantes, je souhaite revenir, chiffres à l’appui, sur les départements des Antilles et de la Guyane. Nous sommes passés de 46 postes offerts en 2000 à 108 en 2010. En ce qui concerne les postes d’internes vacants pour les médecins généralistes, monsieur Patient, je précise que 45 postes étaient vacants en 2005 et que ce chiffre a été réduit à 5 en 2010.
Mais, je le sais, et vous l’avez rappelé, à eux seuls, ces dispositifs ne permettent pas d’obtenir une répartition équilibrée des professionnels de santé, du fait, notamment, de la liberté d’installation.
Toutefois, conjugués à des mesures incitatives, ces dispositifs contribuent à un pilotage renforcé de la démographie des professionnels de santé.
L’article 46 de la loi HPST a, par ailleurs, instauré le fameux contrat d’engagement de service public, le CESP, à destination des étudiants admis à poursuivre des études médicales à l’issue de la première année ou ultérieurement.
Les étudiants bénéficiaires se voient verser une allocation mensuelle de 1 200 euros jusqu’à la fin de leurs études, financée au titre du Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins, le FIQCS.
En contrepartie, les étudiants s’engagent à exercer leurs fonctions, à compter de la fin de leur formation, dans des lieux d’exercice spécifiques, proposés dans des zones où la continuité des soins fait défaut. La durée de leur engagement est égale à celle correspondant au versement de l’allocation et ne peut être inférieure à deux ans.
Monsieur Tropeano, vous m’avez interrogée sur ces contrats, dont vous souhaitez connaître le nombre. À ce jour, 200 étudiants et internes ont d’ores et déjà été sélectionnés pour bénéficier de ce contrat. Ce dispositif a été opérationnel en septembre. Avec 200 contrats, la mise en place de cette mesure commence de manière positive ! Nous procéderons prochainement une évaluation de ce dispositif.
Le post-internat est aussi un facteur majeur de fidélisation des futurs médecins. Aujourd’hui, il permet aux jeunes diplômés de se ménager de plus larges possibilités de carrière, en secteur hospitalier comme en libéral, et de meilleures perspectives de rémunération.
Il résulte, le plus souvent, du besoin d’acquérir une capacité d’exercice autonome ou un complément de formation dans certaines spécialités, notamment chirurgicales. Il constitue également la première étape d’une carrière universitaire. À ce titre, l’État a créé 400 postes d’assistants de spécialistes partagés, répartis dans les régions les moins bien dotées.
Il convient également de poursuivre les efforts déjà entrepris pour rendre la médecine générale de premier recours plus attractive et pour sensibiliser les étudiants en médecine à cet exercice. Ces dernières années ont vu la structuration de la filière universitaire de médecine générale et la généralisation du stage de médecine générale en deuxième cycle et du stage chez le praticien libéral au cours du DES de médecine générale.
Permettez-moi de vous faire part de quelques chiffres du bilan de l’année 2010. Nous comptons aujourd’hui 69 chefs de clinique de médecine générale en poste, 86 postes de professeurs de médecine générale et 81 maîtres de conférences en médecine générale. En 2011, nous poursuivrons cette progression dans ce domaine. Nous sommes, en effet, convaincus du bien-fondé d’une filière universitaire en médecine générale.
Parallèlement, le nombre de postes d’internes de médecine générale offerts est passé de 46 % de l’ensemble des postes ouverts en 2004 à 53 % en 2010. J’ajoute que 49 % des étudiants de deuxième cycle ont suivi un stage d’externat de médecine générale en 2010.
L’amélioration des conditions d’exercice des professionnels constitue une mesure incitative importante pour renforcer l’attractivité de l’exercice libéral.
Ainsi, les modalités d’exercice médical ont été assouplies par différents dispositifs, tels que l’exercice médical en cabinet secondaire ou le concours d’un médecin collaborateur libéral ou d’un étudiant en médecine.
La mise en place de structures d’exercice coordonné répond également au souhait des professionnels d’un cadre d’exercice rénové, qui optimise le temps médical et évite l’isolement ; vous êtes nombreux à avoir souligné, mesdames, messieurs les sénateurs, que les médecins souhaitaient se regrouper et pratiquer leur activité à plusieurs. Un tel cadre d’exercice est plus attractif pour les jeunes professionnels et contribue à pérenniser l’offre de santé sur le territoire. Le regroupement des professionnels constitue en outre l’une des réponses adaptées aux besoins de santé de la population et à l’amélioration de la qualité des soins – parcours des patients, continuité des soins et qualité des prises en charge.
Les structures d’exercice regroupé revêtent plusieurs formes et offrent une réponse adaptée aux attentes des professionnels qui les composent, du cabinet de groupe à la maison de santé pluridisciplinaire, en passant par les pôles de santé.
Enfin, les incitations financières demeurent. Par exemple, les médecins exerçant en zone déficitaire perçoivent, comme cela a été souligné au cours de ce débat, des honoraires majorés de 20 %, ce qui constitue une aide à l’installation.
À l'échelle régionale, la stratégie d’organisation des soins ambulatoires est déterminée au sein du volet ambulatoire du schéma régional d’organisation des soins.
Une méthode a été proposée aux agences régionales de santé pour construire une offre de soins ambulatoires visible et organisée de façon à assurer l’accès aux soins, la continuité des prises en charge ainsi que la qualité et la coordination des soins. Il s’agit également de répondre aux aspirations des professionnels de santé, qui souhaitent un exercice moins isolé, une optimisation du temps médical, un assouplissement et un allégement de la pratique au quotidien.
L’objectif visé est de réduire les disparités géographiques et de consolider l’offre existante dans les secteurs fragilisés.
La méthode d’élaboration du volet ambulatoire du SROS associe les professionnels de santé. Ainsi, dans les territoires, c’est avec eux que les agences régionales de santé non seulement construiront une vision partagée du diagnostic mais aussi dégageront des axes d’amélioration et apporteront un soutien à ces acteurs porteurs de projets.
Cette dynamique d’élaboration et la contribution des professionnels de santé sont autant de gages de la réussite du projet et de la définition de réponses adaptées aux besoins des territoires.
Je voudrais d'ailleurs remercier Mme Goulet d’avoir évoqué le travail, qui est excellent, il faut le dire, du directeur de l’ARS de la région dont elle est l’élue. Ce dernier s’efforce d’élaborer un schéma d’offre de soins qui réponde le mieux possible aux besoins et aux spécificités territoriales.
Je veux maintenant évoquer les perspectives qui s’ouvrent devant nous et les actions que nous mènerons afin de lutter contre les déserts médicaux.
Vous l’avez tous souligné : nous disposons désormais des réflexions de Mme Élisabeth Hubert sur la médecine de proximité.
Avec Xavier Bertrand, je déclinerai les principales mesures proposées par Élisabeth Hubert dans son rapport remis le mois dernier au Président de la République, mesures qui méritent d’être appliquées.
Monsieur Béteille, vous avez tout à l'heure évoqué le problème de la charge administrative des médecins libéraux. À cet égard, nous mettrons en œuvre, dans les prochains jours, des mesures de simplification administrative.
Il faut en effet rendre du temps médical aux praticiens libéraux, qui souffrent de nombreuses tracasseries administratives.
Le temps médical est précieux.
Il faut le libérer au maximum, car c’est le patient qui en sera le principal bénéficiaire.
Le lancement du dossier médical personnel, le DMP, permettra également, à terme, de gagner du temps médical et d’améliorer le suivi du parcours de soins du patient. Élisabeth Hubert insiste d’ailleurs tout particulièrement sur l’amélioration des systèmes d’information.
Par ailleurs, les données démographiques conjuguées aux progrès techniques et aux évolutions des métiers de la santé conduisent à développer une meilleure coopération entre les professionnels médicaux et paramédicaux.
Les coopérations entre les professionnels de santé favorisent également une meilleure organisation de la prise en charge du patient et permettent de dégager du temps médical. Elles seront facilitées par les nouveaux modes d’exercice regroupés et coordonnés, notamment au sein des maisons de santé.
Bien entendu, pour accompagner l’émergence de ces nouvelles modalités d’exercice et d’organisation des professionnels de santé libéraux, les modes de rémunération doivent être adaptés. Pour valoriser certaines missions comme la prévention, le suivi de pathologies chroniques, l’éducation thérapeutique ou encore la coordination, des expérimentations sont en cours en ce qui concerne les nouveaux modes de rémunération, même si le paiement à l’acte reste au cœur du dispositif, car il constitue l’essence de l’exercice libéral.
Enfin, le service unique d’aide à l’installation des professionnels de santé prévu par l’article 118 de la loi HPST sera mis en place par les ARS au plus tard en juillet 2011. En effet, les étudiants ou les internes manquent d’information sur les conditions d’exercice en libéral et les aides à l’installation existantes et ils éprouvent des difficultés à identifier le bon interlocuteur. Les professionnels de santé qui s’installent ou qui ont un projet de regroupement font également l’expérience d’une offre de service à l’installation éclatée entre de nombreux acteurs et variable selon les régions.
L’objectif de la mise en place de ce service unique est de mobiliser les acteurs institutionnels du premier recours et de coordonner leurs activités à destination des professionnels de santé libéraux. On voit bien qu’il est nécessaire de mettre en place une porte d’entrée unique, et non plus une usine à gaz, pour faciliter l’installation des médecins.
M. Fourcade, dont je salue la présence, a d’ailleurs déposé une proposition de loi visant à améliorer certaines dispositions de la loi HPST, notamment en ce qui concerne la structure juridique des maisons pluridisciplinaires de santé, et je l’en remercie.
Pour conclure, mesdames, messieurs les sénateurs, la démographie médicale et paramédicale constitue pour moi, comme pour Xavier Bertrand, une priorité. Les Français ont besoin d’une médecine de qualité accessible partout sur le territoire.
Pour cela, il n’y a pas de méthode miracle : il faut conjuguer plusieurs mesures qui, par leur complémentarité et leur diversité, ont pour ambition de répondre aux enjeux de la démographie médicale.
Ces mesures, nous les mettrons en œuvre dans les semaines et les mois à venir, conformément à l’engagement pris par le Président de la République. Je sais que, en la matière, nous avons le soutien des élus de terrain, qui constatent au quotidien les difficultés rencontrées par nos concitoyens.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Je rappelle que la commission de la culture, de l’éducation et de la communication a proposé des candidatures pour deux organismes extraparlementaires.
La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.
En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame :
-M. Ambroise Dupont membre titulaire et M. Ivan Renar membre suppléant du Haut conseil des musées de France ;
-M. Philippe Nachbar membre suppléant de la Commission du Fonds national pour l’archéologie préventive.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 18 janvier 2011 :
À neuf heures trente :
1. Questions orales.
De quatorze heures trente à seize heures quarante-cinq :
2. Débat sur des questions de politique étrangère.
De dix-sept heures à dix-sept heures quarante-cinq :
3. Questions cribles thématiques sur « Outre-mer et Europe ».
À dix-huit heures et le soir :
4. Deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (n° 195, 2010-2011).
Rapport de M. Jean-Patrick Courtois, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale (n° 214, 2010-2011).
Texte de la commission (n° 215, 2010-2011).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à seize heures vingt-cinq.