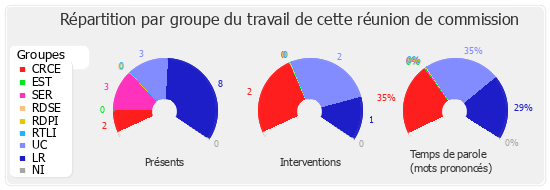Commission des affaires sociales
Réunion du 18 juin 2020 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion
Projet de loi organique relatif à la dette sociale et à l'autonomie
Projet de loi relatif à la dette sociale et à l'autonomie - Audition de M. Rémi Pellet professeur à l'université de paris et à sciences po paris spécialiste en droit financier public et social en téléconférence

Mes chers collègues, je vous prie tout d'abord d'excuser l'absence du président Milon, retenu dans son département.
J'ai le plaisir d'accueillir ce matin M. Rémi Pellet, professeur à la faculté de droit de l'Université de Paris et à Sciences Po Paris.
Monsieur Pellet, vous êtes spécialiste de droit financier public, de droit de la santé et de droit de la protection sociale. Les spécialistes des finances sociales sont rares ; certains contestent cette appellation même, ainsi que la singularité de cet objet au sein des finances publiques. Il est vrai que cette discipline est relativement jeune, le premier projet de loi de financement de la sécurité sociale ayant porté sur l'exercice 1997.
Nous vous entendons aujourd'hui sur une autre singularité : celle de la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades).
Je rappelle qu'à sa création, en 1996, la Cades avait pour objectif de rembourser la dette accumulée par la sécurité sociale à l'échéance de 2009. La création d'un impôt dédié, la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), visait à rembourser non seulement les intérêts des emprunts, comme le fait l'État avec la charge de la dette, mais aussi le capital, conformément au principe suivant : les dépenses de la sécurité sociale étant des dépenses de fonctionnement, leur financement ne devait pas reposer sur les générations futures, mais bien sur ceux qui avaient exposé ces mêmes dépenses.
Je crois pouvoir dire sans risque que ces principes vertueux ont été mis en échec par l'incapacité de la sécurité sociale à revenir à l'équilibre entre deux crises. La Cades a donc été prolongée à plusieurs reprises, sans toutefois qu'aucun gouvernement ne se résolve à augmenter la CRDS à due concurrence. Cela fait maintenant vingt-quatre ans ; on peut dire désormais que la dette a bel et bien été reportée sur une autre génération. Et les textes qui nous sont soumis aujourd'hui proposent une énième prolongation de la Cades, à l'heure où la dette publique s'apprête à dépasser 120 % de la richesse nationale.
En termes de finances publiques, la Cades a une vertu : les remboursements en capital ont pour effet comptable une diminution du déficit public présent, même s'il s'agit du remboursement de déficits passés. Faut-il y voir une raison de l'attachement du Gouvernement à la prolongation de la durée de vie de la Cades ?
Monsieur le professeur, nous souhaitons recueillir votre analyse sur cette singularité et sur les textes soumis aujourd'hui à l'examen du Parlement, qui prévoient d'ailleurs un élargissement du champ des lois de financement de la sécurité sociale.
J'examinerai, comme vous me le demandez, la spécificité de la dette sociale d'un point de vue universitaire, mais aussi en tenant compte de l'expérience qui fut la mienne à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) et à la Cour des comptes.
Partons d'un constat : la Cades n'a pas d'équivalent dans le monde. Au Royaume-Uni et dans les pays où c'est l'État qui prend en charge directement le financement de la sécurité sociale, selon le modèle beveridgien, il est logique qu'il n'y ait pas de dette sociale à côté de la dette publique gérée par l'État, et qu'il y ait unité de gestion. En Allemagne, où les organismes de sécurité sociale ont une personnalité morale propre, il n'y a pas de Cades parce qu'il n'y a pas de dette, les régimes étant à l'équilibre. La France ayant adopté un système d'inspiration bismarckienne, mais ses caisses de sécurité sociale ayant accumulé une importante dette, elle s'est dotée d'une Cades, distincte de l'Agence France Trésor chargée de la gestion de la dette de l'État.
Bien qu'elle soit née un mois avant les lois de financement de la sécurité sociale, par l'ordonnance du 24 janvier 1996, la Cades peut trouver sa justification juridique dans la réforme constitutionnelle du 22 février 1996. La création des lois de financement de la sécurité sociale a en effet consacré au plus haut niveau de notre droit interne, le droit constitutionnel, la spécificité des finances sociales par rapport aux finances de l'État. Partant, il devenait logique de distinguer la dette sociale du reste de la dette publique.
Fondamentalement, qu'est-ce qui fait la spécificité des finances de la sécurité sociale par rapport à celles de l'État ? On pourrait, pour répondre à cette question, recourir à des arguments économiques, en considérant que les dépenses de la sécurité sociale ne sont que des dépenses de transfert, alors que l'État prend en charge des dépenses d'investissement et de fonctionnement. Mais il me semble important de faire valoir d'abord un argument juridique.
Dans le système budgétaire de l'État s'applique le principe d'universalité, qui se traduit par le principe de non-affectation d'une recette particulière à une dépense particulière parce qu'il n'y a pas de lien de nature entre un impôt spécifique et une dépense spécifique. Or la sécurité sociale est fondée sur le principe exactement inverse d'affectation d'une recette à une dépense, inspiré du droit des assurances : une cotisation ou une prime particulière doit servir à financer la couverture d'un risque particulier. Comme il existe plusieurs risques de nature différente, ceux que l'on a historiquement distingués, vieillesse, maladie, accidents du travail, famille, auxquels on propose aujourd'hui d'ajouter un cinquième, il existait autant de cotisations différentes. Et le produit de chacune de ces cotisations est affecté au financement d'un risque particulier. C'est ce principe qui est désigné sous le terme de « branches », introduit tardivement dans le code de la sécurité sociale par imitation du code des assurances.
Or, point capital, ce principe d'affectation a été appliqué lorsque le législateur a fiscalisé la sécurité sociale. Ainsi, le produit de la contribution sociale généralisée (CSG), qui, selon le Conseil constitutionnel, appartient à la catégorie des impositions de toutes natures visée à l'article 34 de la Constitution, a été affecté à certaines branches particulières choisies pour leur caractère de solidarité nationale. Le même principe a été appliqué à la Cades, puisque la CRDS lui a été affectée, alors qu'il n'existe aucun impôt directement affecté au financement de la dette de l'État.
Autre point capital : la fiscalisation de la sécurité sociale a été sélective, fondée sur une distinction opérée au sein des dépenses de sécurité sociale selon leur nature. Les prestations, pensions de retraite, indemnités journalières (IJ) de l'assurance maladie, qui représentent une forme de salaire différé auraient dû rester financées par des cotisations sociales assises sur le revenu professionnel et proportionnelles à ce revenu ; tel était le cas jusqu'aux dernières - funestes - réformes. En revanche, les dépenses sociales qui sont devenues des prestations de solidarité, par exemple le remboursement des soins de l'assurance maladie, doivent être financées par des impôts frappant tous les revenus, car il est socialement injuste de ne faire peser que sur les salaires la charge de prestations sans rapport avec eux. Cette distinction a été opérée successivement au sein de l'assurance chômage, de l'assurance vieillesse et de la branche maladie, les IJ devant à l'origine rester financées par une cotisation sociale de 0,75 % des salaires, tandis que les prestations en nature devaient l'être par la CSG. Quant aux prestations familiales, elles furent aussi fiscalisées, leur conception évoluant. Conçues à l'origine comme une forme de sursalaire à la charge des employeurs, elles sont devenues un instrument de redistribution des revenus dans une logique de solidarité nationale, ce qui justifiait qu'elles fussent elles aussi financées par l'impôt plutôt que par des cotisations.
Or ce principe a été également appliqué à la Cades lors de sa création. En 1996, la Cades a repris à sa charge une dette qui provenait essentiellement de la branche maladie de la sécurité sociale, dont 95 % des dépenses sont des remboursements de soins. Il était donc logique qu'un excès de dépenses maladie « de solidarité » fût refinancé par la CRDS, impôt de solidarité conçu comme la CSG, avec simplement, à l'origine, une assiette un peu plus large.
Reste une question : pourquoi l'État n'a-t-il pas pris à sa charge le remboursement de la dette sociale, puisqu'il finance lui aussi des dépenses de solidarité, le revenu de solidarité active (RSA) par exemple ? L'idée qui a prévalu à l'époque repose sur une distinction économique : les dépenses d'investissement peuvent être financées par l'emprunt, car elles se traduisent par un enrichissement du patrimoine public, qu'il est normal que les générations futures contribuent à financer, puisqu'elles en bénéficieront elles aussi. En revanche, la dette sociale originelle, celle de l'assurance maladie, résultait, elle, d'un excès de dépenses de transfert qui ne bénéficiait qu'aux générations de l'époque. Il ne fallait donc pas transmettre la charge de cette dette aux générations futures, qui auraient, elles aussi, à financer leurs propres soins. C'est pourquoi il fallait amortir la dette sociale, c'est-à-dire rembourser non seulement les intérêts, mais aussi le capital, pour éteindre définitivement cette dette.
La dette de l'État est gérée tout différemment : il n'y a pas d'impôt affecté à son remboursement, et il n'y a pas amortissement, car elle est traitée comme si elle était éternelle. Pourquoi cette distinction de traitement ? Parce qu'en France - tel n'est pas le cas en Allemagne -, on considère qu'il n'est pas possible de distinguer au sein du budget de l'État entre les dépenses d'investissement, finançables par l'emprunt, et les dépenses de transfert et de fonctionnement, qui ne doivent être financées que par des recettes définitives, non remboursables. Au soutien de cette logique franco-française, on donne toujours l'exemple des dépenses de l'éducation nationale : sur le plan économique, le traitement des professeurs doit être considéré comme une dépense d'investissement, et non de fonctionnement ; l'éducation permet en effet d'accroître le capital intellectuel de la Nation, et il est normal que les jeunes qui en bénéficient paient la dette publique qui a servi à les former. Ainsi, selon ce type de raisonnement, la dette de l'État n'a pas à être amortie : elle doit être gérée comme si elle était éternelle. Au sein du budget de l'État, on n'inscrit donc que la charge des intérêts, car ils représentent, eux, des dépenses définitives sans contrepartie.
En répondant à vos questions, j'aurai peut-être l'occasion d'expliquer pourquoi je pense que ces beaux principes économiques et juridiques ont été remis en cause ces dernières années au point de rendre totalement incohérent le système de financement de la protection sociale.
Mais, pour conclure ce propos introductif, je m'en tiendrai à la seule question de la gestion de la dette sociale par l'Acoss et la Cades.
Les pouvoirs publics ont autorisé de longue date l'Acoss à emprunter pour couvrir non pas des besoins de trésorerie, mais des besoins de financement. Cette pratique viole les statuts de l'agence, dont je rappelle que l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale lui assigne une mission particulière, celle « d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches du régime général », et non pas la gestion d'un déficit de financement.
Par ailleurs, il y eut aussi violation de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, qui dispose que « la loi de financement de la sécurité sociale adoptée tous les ans arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources » - il est bien question de « besoins de trésorerie », et non de besoins de financement.
Malheureusement, le Conseil constitutionnel n'a pas censuré les lois de financement de la sécurité sociale qui autorisaient l'Acoss à emprunter pour couvrir non pas des besoins de trésorerie, c'est-à-dire des déficits infra-annuels, mais des déficits de financement, c'est-à-dire structurels. La Cour des comptes n'a dénoncé le procédé que tardivement, en 2014, réitérant cette critique en 2017 ; je l'avais, pour ma part, formulée publiquement dès 1999, lorsque j'étais encore rapporteur à la Cour des comptes.
L'accumulation d'emprunts à long terme au niveau de l'Acoss ne pouvant pas durer, la Cades a été rouverte plusieurs fois : le législateur lui a transféré de la dette en allongeant la durée de perception de la CRDS. Puis, lorsque ce procédé a été interdit à la suite de la réforme voulue par le Premier ministre Raffarin, le transfert de dette s'est accompagné d'un transfert de recettes ; mais ces recettes provenaient d'organismes de la sécurité sociale, en particulier le Fonds de solidarité vieillesse (FSV), qui ont pâti à leur tour d'un manque de recettes et, par conséquent, d'un déficit - nouvel avatar de la politique du sapeur Camember. La Cades se retrouve ainsi avec deux recettes : la CRDS, d'une part, et, d'autre part, un morceau de CSG.
Ces procédés sont évidemment contraires à l'objectif du constituant de 1996. Cette année, du fait de la crise économique née de la pandémie et de sa gestion par les pouvoirs publics, autrement dit le confinement, les recettes de la sécurité sociale se sont effondrées. En conséquence, par décret du 20 mai 2020, l'Acoss a été autorisée à emprunter jusqu'à 90 milliards d'euros. Ces sommes doivent être évidemment transférées, l'Acoss ne pouvant durablement les porter. Précisément, le projet de loi sur lequel vous me consultez prévoit le transfert de cette dette à la Cades, la période d'amortissement étant prolongée jusqu'en 2033, ce qui rend nécessaire la modification de la loi organique, et donc la dénaturation de la Cades.
Pourquoi les pouvoirs publics ne choisissent-ils pas de transférer la dette à l'État, alors qu'un tel choix serait source d'économies, l'Agence France Trésor pouvant emprunter à un taux plus faible que la Cades - l'écart de taux varie, selon un député de l'opposition, énarque de formation, entre 0,1 et 0,3 point ? Ce même député explique que le Gouvernement refuse de transférer cette « dette Covid » à la charge de l'État parce qu'il souhaite « réduire les marges de manoeuvre de la sécurité sociale » : la stratégie du Gouvernement consisterait à pousser à une baisse des dépenses sociales en faisant ressortir l'importance de la dette mise à la charge des générations futures.
Pour ma part, j'avancerai une hypothèse différente : le ministère des finances souhaite que la Cades perdure afin que la CRDS soit maintenue. Si la dette sociale n'était pas alourdie de la dette Covid, le reliquat serait remboursé rapidement et la CRDS devrait alors être supprimée, car elle ne pourrait pas être réorientée, en application du principe de nécessité de l'impôt. La CRDS ayant été créée pour amortir la dette sociale, à défaut d'une telle dette, il n'y aurait plus besoin d'impôt. Or il me semble que Bercy n'aimerait pas voir disparaître cet impôt qui possède, à ses yeux, toutes les vertus : une assiette très large et un taux faible et proportionnel, c'est-à-dire, très exactement, le contraire de l'impôt sur le revenu. La disparition d'un tel impôt serait une catastrophe pour Bercy, qui aurait beaucoup de mal, par la suite, à justifier sa recréation s'il fallait financer à nouveau une dette sociale. Si le Gouvernement ne souhaite pas transférer la dette Covid à l'État, c'est donc parce qu'il veut faire perdurer la CRDS comme un impôt éternel, alors même que cette contribution avait été conçue comme un impôt provisoire destiné à amortir, c'est-à-dire à éteindre définitivement, la dette sociale mise à la charge d'un établissement ad hoc, la Cades.
Je citais M. Boris Vallaud.

Merci, monsieur le professeur, pour cet excellent cours. Votre expérience nous permet de pénétrer les tréfonds de ce qu'est la Cades.
Le Gouvernement nous propose que la Cades prenne en charge l'amortissement d'un tiers de la dette hospitalière, soit 13 milliards d'euros. Cette dette se distinguerait fortement du reste de la dette portée par la Cades : il s'agirait en l'espèce, pour l'essentiel, d'investissements immobiliers dans les hôpitaux. Considérez-vous qu'un tel transfert se justifie néanmoins, ou qu'il serait plus légitime que ce soit l'État qui porte cette dette ?
Concernant la création d'une cinquième branche de sécurité sociale, prévue dans ce projet de loi organique, le « cinquième risque », qui n'est pas précisément nommé, est lié à la perte d'autonomie. Le projet de loi prévoit également un financement partiel de cette branche par un transfert, à partir de 2024, d'une fraction de CSG de 2,3 milliards d'euros actuellement affectée à la Cades. Vous semble-t-il opportun de procéder à un tel transfert, et à une telle échéance ?
Troisième question : les effets économiques de la crise actuelle seront peut-être derrière nous en 2024, mais ne faut-il pas assurer le respect du principe d'équilibre des finances de la sécurité sociale par l'instauration d'une règle d'or au niveau organique, comme en Allemagne ?
Quatrièmement, ne pensez-vous pas qu'un choc de simplification s'impose dans le financement des branches ? Le système des recettes affectées est devenu une tuyauterie affreusement compliquée, entre CSG, TVA, cotisations, taxes diverses. Au fil des ans, l'accumulation de besoins de financement supplémentaires a abouti à un véritable patchwork.
Avant de vous répondre, je tiens à préciser que je n'ai aucun engagement politique. Mes propos sont inspirés par le souci de l'intérêt général et par l'analyse que je fais des finances sociales depuis trente ans, et non par une quelconque préoccupation politique. Mes réponses sont donc des réponses de conviction, les réponses d'un technicien : elles ne sont pas orientées.
Vous avez raison, la dette hospitalière a servi à financer des investissements ; or la Cades n'a pas été conçue pour cela, mais pour amortir les déficits de financement de la branche maladie, les dépenses de l'assurance maladie étant des dépenses de transfert. La mise à la charge de la Cades de ces sommes aurait pour effet de modifier la nature de cette caisse ; elle est donc critiquable.
Je la critiquerai aussi, pour ma part, d'un autre point de vue. En 1945 a été posé le principe suivant : l'assurance maladie devait prendre en charge les dépenses de santé de ville et les dépenses hospitalières. Elle a été dotée d'un pouvoir de négociation avec les syndicats des professions libérales de santé pour convenir des tarifs ; certes, ces conventions font l'objet d'un agrément ministériel, mais au moins l'assurance maladie a-t-elle, en la matière, une marge de manoeuvre. Le financement des hôpitaux, en revanche, lui échappe complètement. Depuis 1945, les hôpitaux sont des établissements publics dont les agents sont des agents publics, des fonctionnaires pour la plupart et, pour ce qui est des praticiens, des contractuels de droit public régis par un statut particulier. Comme plus de 70 % de la dépense hospitalière est de la dépense de personnel, l'assurance maladie n'a donc pas son mot à dire.
Et la situation a été aggravée avec la création des agences régionales de santé (ARS) : c'est le directeur de l'ARS - le préfet sanitaire -, révocable ad nutum en conseil des ministres, qui est en charge de l'attribution des crédits aux hôpitaux, l'assurance maladie n'ayant qu'un droit de consultation pour faire valoir son point de vue. Comme, derechef, l'assurance maladie n'a pas son mot à dire dans la gestion de ces crédits, je ne vois pas pour quelle raison on attribuerait à la Cades la responsabilité du remboursement de la dette des hôpitaux. Il pourrait en être autrement si l'on appliquait une réforme pour laquelle je milite depuis longtemps, c'est-à-dire si l'assurance maladie avait, comme avec les professions libérales de santé, un droit de négociation direct avec les hôpitaux. Cette réforme serait justifiée puisque l'assurance maladie prend en charge plus de 90 % de la dépense hospitalière.
Si l'assurance maladie avait un tel pouvoir de négociation direct avec les hôpitaux, on pourrait comprendre qu'un excès de dépenses d'investissement soit repris dans le cadre de la Cades. Comme c'est l'État qui décide de tout, c'est à lui de reprendre la dette des hôpitaux, dont je rappelle qu'ils ont leur compte ouvert au Trésor public, alors même que la sécurité sociale a un circuit financier propre, la Caisse des dépôts et consignations lui servant de banquier, et l'Acoss de trésorier. J'avais constaté, il y a quelques années, que les hôpitaux, malgré leur déficit, avaient un encours moyen de trésorerie de plusieurs milliards d'euros. Je trouvais un peu bizarre un tel excédent déposé dans les comptes de l'État alors que cet excédent vient, pour l'essentiel, de l'assurance maladie. Je préconise donc que les hôpitaux soient raccordés à la même banque que celle de l'assurance maladie, la Caisse des dépôts et consignations. Je signale au passage que la Cour des comptes avait repris cette proposition et que le ministre des finances de l'époque, Dominique Strauss-Kahn, avait validé une telle réforme.
Vous m'interrogez sur la création d'une cinquième branche et sur le mode de financement d'une telle assurance contre le risque dépendance. Il est prévu une nouvelle opération du sapeur Camember : après qu'on a alimenté la Cades par un peu de CSG prise au FSV, qui s'est trouvé en déficit, on lui retirerait ce bout de CSG pour l'affecter au financement de la dépendance ; la Cades se trouvant alors en déficit de recettes, on allongerait la durée d'amortissement de la dette. Cette opération conduirait à remettre en cause le principe vertueux qui avait été consacré au moment de la réforme voulue par le Premier ministre Raffarin. Cette idée me paraît néfaste ; sa concrétisation reviendrait à rendre éternelle une dette qui était censée être amortie rapidement.
Cette cinquième branche me semble en effet poser un problème de financement ; ce problème ne peut être réglé que par un impôt national permettant une mutualisation des risques. Les départements pourraient conserver une fonction de gestion des crédits, mais il faut en finir avec le système actuel, qui est baroque et financièrement absurde : une caisse nationale, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), reçoit une partie des fonds ; les départements complètent ces fonds par des ressources propres pour financer des prestations qui sont déterminées sur le plan national. Cette situation me paraît abracadabrantesque, comme aurait dit un Président de la République ; il faut un financement national qui permette une mutualisation et une péréquation.
D'où viendraient ces fonds ? Cela justifierait-il la création d'une nouvelle branche ? Pour ma part, je n'en vois pas la raison, sinon d'affichage politique. En réalité, ce risque est essentiellement pris en charge par l'assurance maladie : les dépenses de dépendance sont en grande partie des dépenses de soins. Quant aux crédits correspondant aux dépenses d'accompagnement et d'hébergement, ils pourraient très bien être transférés de la branche vieillesse ou de la branche famille vers l'assurance maladie. Je ne vois donc pas la nécessité de créer une nouvelle branche. Je vois bien, en revanche, quel est l'intérêt de ceux qui gèrent la CNSA à faire perdurer cet établissement - c'est humain. Je suis, pour ma part, pour supprimer la CNSA et laisser les départements, en collaboration avec l'assurance maladie, gérer l'attribution des fonds.
Pour répondre à la troisième question relative aux effets économiques de la crise : faut-il adopter une règle d'or ? Assurément ! En réalité, cette règle d'or existe : c'est la loi organique du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, modifiée par la loi organique du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale. Ce texte prévoit que le législateur peut autoriser un régime à recourir à des ressources non permanentes - l'emprunt -, mais uniquement pour satisfaire des besoins de trésorerie, non pour couvrir des besoins de financement. Un besoin de trésorerie est lié au décalage, dans une même année, entre le rythme des recettes et celui des dépenses ; il s'agit donc d'une simple avance de trésorerie, le régime doit être à l'équilibre à la fin de l'année.
Cette disposition a été violée, parce qu'on a autorisé l'Acoss à recourir à des montants allant au-delà de ses besoins de trésorerie pour couvrir des besoins de financement ; quand ces emprunts deviennent trop importants, l'Acoss ne peut plus les porter, il faut les transférer à la Cades.
J'en reviens donc à mon point de vue de 1999, repris en 2014 puis en 2017 par la Cour des comptes : n'autorisons l'Acoss à recourir à l'emprunt que pour satisfaire des besoins de trésorerie.
Cela posé, quelle règle de gestion adopter en cas de crise exceptionnelle, comme celle que nous vivons ? Le confinement a conduit à l'arrêt de l'activité ; le déficit de la sécurité sociale de 52 milliards d'euros est lié, non à un excès de dépenses de santé - le surcroît de dépenses hospitalières liées au coronavirus a été compensé par les économies de dépenses pour la médecine de ville -, mais à un déficit de recettes. Or, à l'origine de ce déficit, se trouve l'État - je ne lui en fais pas grief -, donc c'est à lui de prendre en charge cette dette.
Sans doute, pour continuer de verser les cotisations sociales, on pouvait autoriser l'Acoss à emprunter 52 milliards d'euros, mais c'était dangereux, car les marchés auraient pu s'inquiéter d'un emprunt de ce montant de la part d'un établissement public. L'État aurait pu emprunter à sa place, car l'Agence France Trésor (AFT) emprunte à des conditions très favorables, pour des montants très importants.
Par conséquent, la règle d'or pour la sécurité sociale, oui, mais elle existe déjà ; appliquons-la donc strictement, selon les recommandations réitérées de la Cour des comptes.
Quatrième et dernier point : le choc de simplification ; vous ne pouviez pas me faire plus plaisir qu'avec cette question. J'ai proposé une simplification ; je vais tenter de vous l'expliquer aussi clairement que possible.
La sécurité sociale a été conçue comme une assurance du revenu professionnel : on cotisait en proportion de son revenu pour financer un salaire différé. Le meilleur exemple réside dans les cotisations d'assurance vieillesse : on cotise, pendant sa période d'activité, en proportion de son revenu et, si l'on est vivant à l'âge auquel on ne peut plus travailler, l'assurance vieillesse nous verse un substitut de salaire proportionné au salaire perdu.
Les autres branches ont été conçues comme l'assurance vieillesse. On concevait, à l'origine, l'assurance maladie comme une assurance du revenu professionnel que l'on risquait de perdre à cause de la maladie ; quand on tombe malade, on cesse de travailler et l'on perd son revenu. D'où la nécessité d'un revenu de substitution : les indemnités journalières. Le financement de l'assurance maladie repose donc sur des cotisations assises sur le revenu professionnel, qui donnent droit à des prestations proportionnées à ce revenu. Il y a un autre type de dépenses de santé, le paiement des soins, mais, initialement, ces soins étaient pris en charge gratuitement par les hôpitaux ou, pour les plus riches, par leur propre revenu. Surtout, on a considéré qu'il s'agissait également de dépenses du revenu professionnel : quand je paie pour mes soins, je dépense une partie de mon revenu professionnel. Ainsi, en 1945, il y avait un financement exclusif de l'assurance maladie par des cotisations assises sur le revenu professionnel.
Or la nature des risques a changé ; l'assurance maladie n'est plus, aujourd'hui, pour l'essentiel, une assurance du revenu professionnel, car 95 % des dépenses d'assurance maladie sont des remboursements de soins. Il a donc paru injuste de financer ces soins sur le seul revenu professionnel, alors que le coût des soins varie non pas selon le revenu de la personne, mais selon son état de santé. Par conséquent, on a fiscalisé l'assurance maladie, comme on l'avait fait pour la branche famille.
On a opéré pareille distinction pour la branche vieillesse : ceux qui peuvent travailler sans être affectés par le chômage paient des cotisations et touchent une pension proportionnée au revenu d'activité ; pour ceux dont la carrière est heurtée parce qu'ils connaissent le chômage, il faut un minimum vieillesse, financé par la solidarité nationale. Ainsi, le gouvernement d'Édouard Balladur a instauré la CSG, destinée à financer le FSV, qui prend en charge ce minimum vieillesse. On a également appliqué cette distinction dans la protection contre le chômage : c'est une assurance du revenu professionnel, puis, en fin de droits, s'y substituent une prestation forfaitaire puis une prestation de solidarité nationale, le RSA.
Cette distinction entre l'assurance du revenu professionnel et la solidarité nationale a guidé le législateur pendant trente ans, quelle que soit la majorité, et c'était très heureux, mais elle a été remise en cause par des réformes récentes. Ainsi, le Président de la République a voulu que l'assurance chômage fût financée par la CSG. On aboutit à une situation aberrante, dans laquelle des prestations proportionnées au revenu professionnel, qui peuvent dépasser 4 500 euros par mois, sont financées par la CSG, qui pèse également sur les retraités à partir de 1 000 euros de revenu. Cela me paraît abracadabrantesque ; on ne peut financer une prestation proportionnée au revenu professionnel par un impôt de solidarité nationale, la CSG.
On a commis la même erreur pour les cotisations salariales de maladie, servant en principe à financer les indemnités journalières. Pour le financement de l'assurance maladie, on avait voulu qu'un impôt de solidarité nationale finance les dépenses de prestations de soins - c'était tout à fait logique, c'était l'objet de la réforme Jospin, tout à fait bienvenue - et on avait donc maintenu une cotisation de 0,75 % sur les salaires destinée à financer les indemnités journalières. Cette distinction a été remise en cause par la suppression de cette cotisation de 0,75 %. Désormais, les prestations de l'assurance maladie réservées aux salariés - les indemnités journalières - sont financées non plus par les cotisations salariales, mais par de la CSG et de la TVA, des prélèvements de solidarité nationale. C'est aberrant.
Pour mettre un terme à cette aberration et pour simplifier la tuyauterie incompréhensible pour les parlementaires - on ne peut pas comprendre ces bricolages successifs si l'on n'est pas spécialiste et, même quand on le devient, on perd parfois pied -, il faudrait adopter le principe suivant : remettre en cause le principe d'affectation de la recette à la dépense pour les dépenses sociales de solidarité nationale et ne le conserver que pour les dépenses sociales d'assurance du revenu professionnel.
Ainsi, l'assurance vieillesse de base et complémentaire - prestations proportionnées au revenu professionnel - doit être financée par des cotisations exclusivement assises sur le revenu professionnel. De même, les indemnités journalières doivent être financées par des cotisations proportionnées au salaire. Il en va de même avec l'assurance chômage : les prestations réservées aux salariés qui se retrouvent au chômage doivent être financées par des cotisations proportionnelles au revenu professionnel. La logique de l'affectation de la recette à la dépense garde, dans ce cas, toute sa pertinence et il faut la conserver.
En revanche, les prestations de solidarité nationale - minimum vieillesse, financé par le FSV, dépenses en nature de l'assurance maladie, prestations familiales, qui sont forfaitaires et autres prestations de solidarité nationale - doivent être financées par l'impôt, avec une assiette la plus large possible, sans affecter un morceau d'un impôt particulier à une branche en particulier. Il faut globaliser les dépenses de solidarité nationale, puis affecter les crédits, comme dans le budget de l'État, aux différentes dépenses de solidarité nationale.
En effet, il faut appliquer le principe de non-affectation, qui s'applique pour l'État, à la protection sociale, sans quoi perdurera ce système absurde d'affectation de morceaux d'impôt - TVA, CSG ou autres - à des dépenses de solidarité. Ces réaffectations n'ont aucun sens ; il faut globaliser les crédits. Vous, parlementaires, devez choisir les impôts de solidarité que vous souhaitez, faire masse de cette somme puis décider comment les attribuer aux branches. Cela permettrait de conserver le système des objectifs nationaux de dépenses, comme l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam) ; on pourrait tout à fait en imaginer un pour la vieillesse et pour la famille.

Ces réponses précises et complètes font mon bonheur. Elles permettront d'enrichir notre rapport et de susciter un débat.

Votre intervention revient aux fondamentaux de la création de la sécurité sociale : cotiser en fonction de ses ressources et percevoir des prestations en fonction de ses besoins. La société a évolué, mais nous sommes là au coeur du problème. Nous devons articuler des propositions en ce sens.
Quand il était rapporteur général de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, l'actuel ministre des solidarités souhaitait que le financement de la dépendance soit assuré, après l'extinction de la Cades en 2024, par la CRDS. Le Gouvernement comptait sur la croissance pour effacer, au moment de l'extinction de la Cades, la dette résiduelle de l'Acoss, estimée entre 40 et 50 milliards d'euros quand nous avons entendu Gérald Darmanin, en novembre dernier ; nous préconisions, pour notre part, de retrouver une source de financement pour la Cades.
Vous avez indiqué que les taux auxquels emprunte AFT sur les marchés financiers sont plus favorables de 0,1 à 0,3 point par rapport à ce que peut obtenir la Cades. Or, le président de celle-ci nous a indiqué, en audition, que le transfert à l'État de la dette liée à la Covid n'avait pas de sens, car la Cades jouit, grâce à sa notoriété, de conditions d'emprunt très favorables sur les marchés. Confirmez-vous donc cette différence de taux, favorable à l'État, entre l'AFT et la Cades ? Que pensez-vous de l'évolution des taux d'intérêt et de l'incidence, pour l'équilibre de la Cades, d'une augmentation significative des taux ?
Sur les taux, j'ai pris la précaution de citer ma source. Je ne peux en garantir la véracité, mais cela me paraît logique : si la Cades a une telle qualité de signature sur les marchés, c'est qu'elle jouit de la garantie de l'État. Que le responsable de la gestion de la Cades vante son établissement, c'est normal, mais cet établissement a toujours été admirablement géré parce qu'il bénéficie de la garantie de l'État. Je ne vois pas comment la Cades, garantie par l'État, pourrait emprunter à de meilleurs taux, sauf à ce qu'il y ait une particularité que j'ignore.
En outre, sous le premier mandat du président de la Cades, Jean-Louis Rey, cet établissement a été accolé à AFT. Par conséquent, selon mon point de vue, la Cades n'est aujourd'hui rien d'autre qu'une coquille vide ; c'est l'administration des finances, les spécialités d'AFT, qui la gèrent et on a maintenu, pour des raisons d'optique, l'existence de cette caisse. Il m'étonnerait beaucoup que les gestionnaires d'AFT aient, pour l'État, des conditions de refinancement inférieures à celles qu'ils obtiennent pour gérer la Cades. C'est un trompe-l'oeil juridique.
En ce qui concerne l'évolution des taux, personne ne peut la prévoir. J'ai évoqué, dans un article récent, le refinancement des États grâce au soutien des banques centrales. Tant que celles-ci rachètent la dette publique - cela constitue d'ailleurs une monétisation de la dette publique parfaitement contraire, de mon point de vue, aux traités européens -, on a une garantie et les investisseurs, qui sont tenus d'avoir dans leur portefeuille, pour des raisons prudentielles, des titres d'État, continueront de prêter aux États, en les payant, puisque les taux sont négatifs ; c'est comme s'ils mettaient de l'argent au coffre-fort.
Si les taux devaient remonter, ne serait-ce que sous l'effet de l'inflation, cela aurait des effets considérables sur le coût de la dette publique en général et de la dette sociale en particulier. Cela dit, comme on décide de reporter le remboursement de cette dette et de prolonger le prélèvement, rien n'interdirait de recommencer l'opération.
Je me suis livré à une étude historique sur les différentes caisses d'amortissement, en France et en Angleterre, puisque c'est dans ce pays que la notion a été inventée. En 1926, nous en avons créé une, en modifiant une des lois constitutionnelles de la IIIe République pour lui donner un statut constitutionnel. Cela n'a pas empêché que cette caisse d'amortissement serve à tout autre chose que ce pour quoi elle avait été fondée : amortir. Au lieu d'éteindre la dette, on lui a affecté une nouvelle charge et, in fine, on a récupéré les crédits de cette caisse. Il y a une sorte de malédiction des caisses d'amortissement, qui ne servent jamais à ce pour quoi elles sont créées.
On pensait que la Cades allait faire exception ; on était proche du but, il restait peu de milliards à amortir. On, aurait pu constater ce fait inouï, inédit dans l'histoire de nos pays : l'amortissement d'une dette par une caisse destinée à cela. Le projet de loi qui vous est proposé s'inscrit dans la continuité historique, mais ce n'est pas à l'honneur des gestionnaires.

Cela transforme ainsi une dette sociale en une dette éternelle. En outre, on veut reprendre, au travers du projet de loi, l'amortissement de la dette des hôpitaux comme justification : comme on réamortit la dette, on peut se permettre de prendre jusqu'à 13 milliards à la dette des hôpitaux ce qui signifie, pour caricaturer, qu'avec une recette, on fait deux dépenses.
Vos propos sur la CNSA et sur les ARS sont décoiffants, mais vous n'avez pas abordé la question du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), dont on envisage de prélever les réserves, destinées à se prémunir contre les aléas démographiques ou économiques pour les pensions, afin de rembourser la dette sociale ou d'abonder une nouvelle branche. Qu'en pensez-vous ?
Pensez-vous qu'il faille élargir le périmètre des lois de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour y inclure l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic) et les retraites complémentaires ?
J'ai proposé de longue date d'étendre le périmètre des LFSS aux régimes complémentaires de retraite et à l'assurance chômage. La Cour des comptes a repris cette idée. Cela se justifie totalement ; je le rappelle dans un article à paraître dans le numéro de la revue Droit social de juillet prochain. Il est normal que ces régimes entrent dans le périmètre des LFSS. En outre, il n'y aurait pas à modifier la loi organique, car celle-ci ne définit pas la notion de sécurité sociale.
On devrait inclure les retraites complémentaires et l'Unedic dans ces lois, pour des raisons non seulement politiques, mais surtout juridiques.
Les prélèvements qui financent l'Unedic sont une part de la CSG, en vertu de la réforme funeste que j'ai dénoncée précédemment, et des contributions patronales à l'assurance chômage. Or ces contributions ont été qualifiées par le Conseil constitutionnel de prélèvements ayant la même nature que les cotisations de sécurité sociale. Par conséquent, l'Unedic est financée par des prélèvements obligatoires, qui sont de même nature que les cotisations de sécurité sociale, lesquelles entrent dans le champ des lois de financement de la sécurité sociale. Il paraîtrait donc tout à fait normal d'introduire les comptes de l'Unedic dans le périmètre de ces lois.
Pour ce qui concerne les régimes complémentaires, ceux-ci ont été créés sur l'initiative des partenaires sociaux - en 1947 pour l'Association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc) et en 1961 pour l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco) - parce que le législateur avait plafonné l'assiette du financement de la sécurité sociale en 1945, dans le seul but de créer une part de marché pour les assureurs privés. C'est ce que mon maître, M. le professeur Jean-Jacques Dupeyroux, appelait le « Yalta de la sécurité sociale » : le « monde socialiste » sous le plafond et le « monde libéral » de l'assurance privée au-dessus du plafond.
Les partenaires sociaux ont donc occupé le terrain, en créant les régimes complémentaires, mais ceux-ci ont été rendus obligatoires par une loi de 1972 ; en outre, ces régimes et le régime de base sont interdépendants, car les systèmes complémentaires sont obligés de suivre l'évolution des régimes de base ; en effet, on voit mal des salariés partir avec leur retraite de base et attendre leur partie complémentaire. Les deux systèmes sont donc liés et il est absolument certain que ces régimes devraient figurer dans les lois de financement. En outre, ces régimes sont considérés par le droit européen comme des régimes de sécurité sociale bénéficiant de l'autorisation de monopole et dérogeant au droit des assureurs privés.
Pour ces deux raisons, on devrait étendre le périmètre des lois de financement de la sécurité sociale, afin que celles-ci deviennent des lois de financement de la protection sociale. Cela dit, si le changement de terme nécessite une révision constitutionnelle, le changement de champ n'implique aucune réforme, parce que la loi organique ne définit pas la notion de sécurité sociale. Le législateur serait donc parfaitement fondé à juger, de lui-même, qu'il peut élargir le champ de ces lois aux régimes complémentaires et à l'Unedic.
J'en viens au FRR : juste avant sa création, une dette des régimes vieillesse avait été transférée de l'Acoss vers la Cades. Celle-ci, qui est financée par la CRDS, un impôt de solidarité, devait donc financer, à son tour, un excès de dépenses provenant de l'assurance du revenu professionnel. Il s'agissait, selon moi, d'une erreur économique et sociale.
Et tandis que la Cades empruntait pour rembourser cette dette, le FRR devait, quant à lui, accumuler des réserves et les placer sur les marchés financiers afin de couvrir d'éventuels déficits du même régime ! Or, lorsque les courbes de taux sont normales, les placements rapportent moins que ce que coûtent les emprunts... Il est arrivé que le Fonds bénéficie d'un taux de rendement supérieur au coût de refinancement de la Cades, mais la situation fut exceptionnelle.
On annonce désormais le remboursement de la dette de la Cades par une partie des réserves du FRR, une opération logique. Mais il y a un problème pour Bercy : contrairement à la CSG, impôt qui n'a pas d'affectation particulière, la CRDS a été créée spécifiquement pour rembourser la dette sociale. En vertu du principe de nécessité de l'impôt, le Conseil constitutionnel pourrait donc juger que la réaffectation de cette contribution sur un autre poste viole une obligation constitutionnelle.
Le ministère des finances tient à ce que la CRDS perdure : si la dette sociale venait à s'éteindre, il faudrait en effet créer une nouvelle contribution, décision difficile à assumer politiquement.
S'agissant des relations de l'assurance maladie et des ARS, la situation est absurde. L'assurance maladie, qui finance à plus de 90 % la dépense hospitalière, n'a pas son mot à dire sur la gestion des hôpitaux, même si elle a des représentants au sein des ARS. Mais ces agences ne sont que des « préfets sanitaires » : elles représentent le ministre au niveau régional. Il ne s'agit en aucun cas de décentralisation administrative, mais de déconcentration politique. Les arbitrages sont faits par des représentants de l'État, qui prennent des décisions touchant l'activité des établissements non pas dans l'intérêt des finances de l'assurance maladie et des assurés sociaux, mais selon des critères sociaux de politique salariale.
Les ARS ne peuvent donc pas procéder aux arbitrages qui seraient financièrement rationnels. Une réforme logique serait qu'elles passent sous la tutelle de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (Uncam). Voici le schéma que je propose : le Parlement vote un Ondam par secteur - hôpitaux, médecine de ville, etc. -, puis assigne cette enveloppe à l'Uncam. Celle-ci deviendrait ainsi une véritable agence, au sens non pas français, qui est dévoyé, mais anglo-saxon du terme : elle aurait un véritable mandat de gestion pour une durée donnée, par exemple cinq ans, à charge pour elle d'arbitrer entre les différentes catégories d'offreurs de soins. Enfin, les ARS rendraient compte devant l'Uncam.
La loi Bachelot, qui a changé les agences régionales de l'hospitalisation (ARH) en ARS, a étendu leurs compétences, lesquelles vont désormais des hôpitaux à la médecine de ville. C'est absurde : alors que la loi Douste-Blazy avait précédemment renforcé les pouvoirs du directeur de l'Uncam vis-à-vis des directeurs de caisses primaires d'assurance maladie (CPAM), notamment pour négocier avec les syndicats des professionnels de santé, dans le même temps, ces caisses sont sous la tutelle des ARS...
Les CPAM sont donc placées sous une double tutelle, qui peut s'avérer contradictoire. Or il faudrait une unité de gestion. Pour résoudre le problème, certains énarques proposent que l'État reprenne totalement la main sur l'assurance maladie, le pilotage étant assuré par le ministère. Je considère qu'une telle réforme serait catastrophique. Je préconise qu'un mandat de gestion soit confié à l'Uncam, les ARS passant sous le giron de celle-ci. Le directeur de l'Uncam répondrait devant un conseil d'administration composé de représentants des partenaires sociaux. Il s'agirait d'une véritable démocratie sociale.
M. Cardoux évoquait le projet de 1945, qui ne correspond ni au modèle anglais ni au modèle allemand. Le père de cette sécurité sociale française était le conseiller d'État Pierre Laroque, qui a rédigé les deux principales ordonnances, signées par le ministre Alexandre Parodi. Selon le parti communiste, le ministre Ambroise Croizat serait le fondateur de la sécurité sociale ; c'est historiquement faux. Mais je ne fais pas ici de politique, car j'ai beaucoup de respect pour tous les partis.
Selon Pierre Laroque, la conception britannique du modèle social tendait à donner à tous un minimum uniforme et vital. Lui défendait une autre conception, visant à proportionner les cotisations et les prestations au revenu perdu. Ce principe doit perdurer pour ce qui concerne l'assurance vieillesse : aucune réforme ne doit conduire à réduire au plus bas niveau ces prestations et à saborder le système par répartition pour faire place à des régimes de capitalisation.

Selon vous, le choix du Gouvernement de faire supporter la dette par la Cades plutôt que par le budget de l'État est non pas technique, mais profondément politique. Je partage votre point de vue, ainsi que celui de Boris Vallaud : l'affichage d'un tel déficit pourra peser sur les dépenses à venir.
Il y a deux sujets de préoccupation actuellement. Le premier est le remboursement de la dette, notamment les 50 milliards d'euros au titre de 2020. Le second est encore plus important : il faut équilibrer les finances de la sécurité sociale en prenant en compte les nouvelles dépenses, celles qui sont liées à la perte d'autonomie, à la réforme de l'hôpital et à l'allongement de la vie. Il serait de bonne politique au cours des cinq ou dix prochaines années de se servir des recettes sociales, dont la CSG, pour bâtir un nouvel équilibre de la sécurité sociale en intégrant ces besoins nouveaux, tout en assurant le remboursement de la dette par le budget de l'État. Ce dernier point ne pose aucun problème, car le niveau bas des taux sera garanti aussi longtemps que la Banque centrale européenne (BCE) rachètera de la dette publique. L'État a également la possibilité de contracter des emprunts à très long terme, jusqu'à trente ans, ce que ne peut pas faire la Cades. Mais le Gouvernement préfère consacrer la CSG et d'autres recettes au remboursement de l'emprunt...

Je rappelle que la sécurité sociale fut élaborée par le Conseil national de la Résistance (CNR) en 1944 et que sa création résulte des ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 rédigées par Ambroise Croizat, dont le rôle est reconnu non pas seulement par les communistes, mais par l'Histoire !
Outre les questions sanitaires et économiques liées à la crise du coronavirus, se pose désormais le problème de la dette sociale. Que faire des dettes publiques qui s'accumulent depuis le début de cette pandémie et qui viennent alourdir un montant déjà considérable ?
Pour financer les investissements publics, il est nécessaire de taxer les plus hauts revenus et patrimoines, les entreprises multinationales, ainsi que de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et sociale. Par ailleurs, ne pourrait-on sortir la dette des États des marchés financiers et la faire porter par la BCE ?
La crise a également remis en question l'utilité sociale des emplois. Pourquoi ne pas mettre à contribution les revenus financiers, comme c'est le cas - partiellement - avec la CSG, pour financer la sécurité sociale ? Il conviendrait aussi de moduler les cotisations sociales des entreprises en fonction de leur politique sociale, salariale et environnementale.

Vous avez dit que vos réponses n'étaient pas orientées politiquement, que vous étiez neutre. Je suis dubitative : nous avons tous une orientation politique qu'il faut assumer.
Il est très curieux que vous refassiez l'histoire ! Le ministre Ambroise Croizat a travaillé main dans la main avec un haut fonctionnaire de grande qualité, M. Laroque. Mais que je sache, ce sont les élus de la République, les ministres et les parlementaires qui prennent les décisions politiques. Il faut donc rendre à César ce qui lui appartient.

Ce débat est très intéressant, car notre modèle social, unique au monde, est fondé sur les valeurs de 1945. Nous y sommes tous attachés, quelle que soit notre philosophie personnelle.
Contrairement à M. Trump, je ne crois pas que les faits varient en fonction des opinions politiques. Les ordonnances de 1945 ont bien été rédigées par Pierre Laroque et publiées sous la signature de M. Alexandre Parodi : ce sont des faits vérifiables, et non des opinions. M. Croizat a succédé à M. Parodi après la publication de ces ordonnances. Pour autant, je n'ai pas dit que le parti communiste n'avait pas lutté pour que soit créée la sécurité sociale. Il a beaucoup pesé dans les débats, et il faut lui en rendre hommage.
M. Croizat, qui a été ministre jusqu'en 1947, a, quant à lui, validé une loi entérinant la diversité des régimes, alors que le projet originel était la création d'un régime général et universel qui aurait couvert l'ensemble de la population. Je suis universitaire, mon rôle consiste à lire les textes et je pourrai vous adresser les preuves de ce que j'avance.
Madame Apourceau-Poly, la prise en charge des dettes par la BCE existe d'ores et déjà. Cette banque rachète sur le marché secondaire les titres émis par les États et revendus par les banques. Je me félicite qu'elle ait adopté une telle politique, mais, d'un point de vue juridique, il s'agit d'une monétisation de la dette publique. Il n'y a en effet aucune différence entre l'achat direct effectué par la Réserve fédérale des États-Unis ou la Banque centrale du Royaume-Uni, et le rachat sur le marché secondaire. C'est aussi l'analyse du tribunal constitutionnel allemand, qui y voit une atteinte aux traités européens.
Une reprise directe de la dette par la BCE serait contraire à la lettre des traités. Pour le moment, elle mène une politique ambiguë, mais qui aboutit au résultat que vous souhaitez : elle permet aux États de se financer sur les marchés autant qu'ils le souhaitent, et à des taux négatifs. Deux raisons à cela : les banques et les sociétés d'assurance ont des obligations prudentielles les contraignant à détenir des titres publics ; la BCE se porte garante du rachat de ces titres. Si la BCE n'agissait pas ainsi, les États devraient contracter des emprunts à des taux très élevés.
Monsieur Daudigny, vous regrettez que l'on ne se donne pas les moyens de réformer le financement de la santé en empruntant via le budget de l'État. Mon point de vue est légèrement différent : il n'y a pas en France de problème de financement des dépenses de santé. Notre taux de dépenses sociales est le premier au monde et nous dépensons 11 % du PIB pour la santé, comme l'Allemagne ; or ce pays ne connaît pas de déficit de l'assurance maladie, finance ses hôpitaux sans problème et a mieux géré que la France la crise du coronavirus.
Le blocage français a pour origine non pas le manque de moyens des hôpitaux, mais le statut des établissements. En Allemagne, les hôpitaux sont dotés d'un statut de droit privé et leurs agents sont des salariés. C'est le cas, aussi, des caisses d'assurance maladie françaises : depuis 1945, elles sont des organismes de droit privé en charge d'un service public administratif, et leurs personnels sont salariés. Les fondateurs de la sécurité sociale, y compris le partir communiste et les syndicats, ne souhaitaient pas qu'elles soient gérées par des représentants de l'État !
Si les hôpitaux avaient un tel statut, leurs directeurs auraient des marges de manoeuvre plus importantes, une plus grande capacité de gestion. Plusieurs de ces directeurs ont d'ailleurs appelé à ce changement. Notons que les caisses nationales de sécurité sociale créées par les ordonnances Jeanneney de 1967, qui ont un statut d'établissement public, se sont vu reconnaître par le législateur le droit d'employer, à l'instar des caisses de base, des salariés. Je ne comprends pas que l'on ne transpose pas ce modèle aux hôpitaux. Les directeurs ainsi que l'ensemble du personnel soignant et des agents administratifs y gagneraient en termes de souplesse de gestion. Les établissements seraient beaucoup plus réactifs et pourraient faire face aux crises aussi efficacement qu'en Allemagne.
Le nerf de la guerre sanitaire est non pas l'argent, mais le statut des acteurs du soin. Il faut modifier radicalement les relations des professionnels de santé et des ARS avec l'assurance maladie, ainsi que le statut des hôpitaux publics. Et ce n'est pas de la politique !

Nous vous remercions, monsieur le professeur. Vos propos décapants et pertinents vont nourrir notre réflexion. Les bonnes intentions originelles ont pu évoluer, mais nous devons être les garants de notre modèle social. Nous ferons part de nos échanges au président Alain Milon.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui sera disponible en ligne sur le site du Sénat.
La téléconférence est close à 12 h 20.