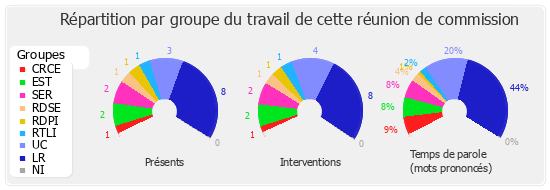Commission des affaires économiques
Réunion du 4 novembre 2020 à 9h30
La réunion

Bienvenue, tout d'abord, à Marie-Agnès Évrard qui rejoint notre commission en remplacement de M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État en charge du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie : nous vous accueillons avec plaisir.
Monsieur le haut-commissaire au Plan, mes chers collègues, au moment où nous avons tant de mal à éclairer le présent ou juste ce qui nous attend dans les prochains jours, nous sommes intéressés et curieux de vous entendre sur votre rôle et votre vision de l'avenir de notre pays. Dans l'après-guerre, le plan était un élément essentiel pour raffermir la confiance ; aujourd'hui - comme le suggère la première note assez lucide du Commissariat - il s'agit également de préparer le pays à des moments difficiles. Je rappelle que le décret du 1er septembre 2020 vous désignant comme haut-commissaire au Plan vous confie la mission d'éclairer les choix des pouvoirs publics en prenant en considération tous les aspects économiques, sociaux, culturels et environnementaux... Nos commissions parlementaires, que vous connaissez bien, sont spécialisées, donc votre soutien nous sera précieux, en particulier au sein de notre commission des affaires économiques qui s'appelait elle-même, il n'y a pas si longtemps, commission des affaires économiques et du plan. Seul l'aspect politique, qu'il faut articuler avec ces données, n'est pas cité dans votre champ de compétences mais vous nous direz comment vous voyez cette articulation entre votre rôle et celui de vos collègues et amis du Gouvernement.
Vous partez d'un constat que nous partageons à peu près tous : la France est sans doute « championne du monde » dans la production de rapports et d'études de qualité. Mais les décisions publiques semblent parfois plus influencées par l'émotion et l'irrationnel que par la raison, sans tenir suffisamment compte des possibles ricochets ou des effets de bord que nous subissons dans les territoires. Nous écouterons donc attentivement les axes de votre réflexion et souhaitons également pouvoir comprendre les moyens dont vous disposez pour mener à bien votre mission et mettre en perspective, voire réajuster, les décisions gouvernementales ou les propositions citoyennes qui vous paraîtraient en décalage avec le diagnostic des experts.
Votre première publication du 28 octobre est très synthétique : elle brosse en une douzaine de pages un scénario intitulé « Et si la Covid durait ? ». Je suggère que vous puissiez rapidement évoquer vos recommandations alors que nous sommes ici au Sénat très inquiets, à la fois des difficultés actuelles d'anticipation du Gouvernement et de la situation d'exaspération des Français.
Permettez-moi, à ce stade, de poser plusieurs questions à la fois très concrètes et transversales. La première concerne notre endettement et la politique de relance industrielle. D'un côté, nous approuvons tous la relocalisation industrielle et pour cela le pays va durablement s'endetter via son plan de relance. Bien entendu, l'endettement est à la fois un moyen de sauvetage immédiat et un moyen de prospective mais c'est aussi une « bombe à retardement ». L'État cherche donc des sources de désendettement et l'une d'entre elles est la cession de ses participations au capital de certaines entreprises gérées par l'Agence des participations de l'État. Pouvez-vous nous donner votre avis d'expert sur cette politique de cessions ? Certaines nous paraissent stratégiques du point de vue industriel, comme les Chantiers de l'Atlantique, que l'État pourrait céder pour un montant de 100 millions d'euros, ce qui nous semble très peu élevé. Je pense aussi au Groupe ADP qui nous a beaucoup occupés lors des débats sur la loi dite PACTE (loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises). Je rappelle que, globalement, le volume total du portefeuille de l'État représente moins de 5 % de la dette publique. Estimez-vous souhaitable, dans cette période, la cession de ces actifs ? La mobilisation de l'épargne nationale ne vous semblerait-elle pas préférable à des transferts potentiels de savoir-faire ?
Nous avons également besoin d'une expertise sur le sujet fondamental du télétravail. D'abord, le télétravail est, par nature, délocalisable. Ensuite, il suppose un saut en avant technologique, comme l'a souligné le commissaire européen Thierry Breton. Enfin et surtout, au regard de la productivité économique et du risque de désocialisation, pouvez-vous nous éclairer sur les équilibres qu'il conviendrait donc de construire ?
Dans la « guerre sanitaire », vous proposez aussi de désengorger les métropoles pour revitaliser les villes moyennes : ici au Sénat, nous applaudissons bien entendu cette stratégie d'aménagement du territoire mais pouvez-vous nous préciser sur quels éléments elle se fonde du point de vue sanitaire car, pour prendre l'exemple de Taiwan, le minimum de morts a été atteint dans des zones record de densité et de métropolisation et cela a aiguisé notre curiosité.
Ma question suivante est plus compliquée puisqu'elle porte sur les capacités prospectives de l'État : quelles sont d'après vous les limites de l'État stratège ? Vous citez avec un brin de nostalgie l'avance prise par la France dans les technologies de l'information avec le Minitel. Mais la vision française d'un ordinateur central avec des terminaux a été pour le moins bousculée par le concept décentralisé d'ordinateur personnel. Cela illustre la difficulté de la prospective et la nécessité d'écouter les entrepreneurs, les territoires et les forces vives de notre pays qui sont au plus près des réalités et des aspirations. Quelle est, pour vous, la place des autres acteurs, au-delà de l'État lui-même et de son bras armé qu'est aujourd'hui le Haut-Commissariat accompagné de France Stratégie, dans la définition du plan ?
Vous soulignez enfin le risque de tensions intergénérationnelles : pouvez-vous nous expliquer la teneur de vos craintes et votre vision des conséquences des évolutions démographiques de long terme pour l'avenir de la France et de l'Europe ?
Merci de votre invitation à laquelle je suis extrêmement sensible. Voici tout d'abord un panorama rapide de ce que je pense que le Plan doit être. Je me suis battu depuis 15 ans autour de cette nécessité impérieuse - ou obligation ardente - pour un pays comme le nôtre, d'arriver à se représenter les exigences de l'avenir à moyen et long terme. Un pays comme la Chine, dont je ne partage pas toutes les orientations, gouverne à 30 ans avec une réflexion prospective continuelle et peut-être doit-on considérer ses achats de terre un peu partout dans le monde comme une des applications de la vision à long terme de ce pays. En France, nous gouvernons parfois à 30 jours, et encore. La pression de l'actualité et de l'urgence sont des éléments déterminants pour la prise de décision au sommet. J'ai donc toujours trouvé qu'il s'agissait d'une erreur absolue de faire entrer dans une obscurité bienveillante le travail de prospective.
Au début de la crise, il m'est apparu qu'on était dans une situation d'impréparation et le Président de la République a partagé ce point de vue. Il n'est cependant pas exact d'affirmer que la crise du coronavirus n'avait pas été prévue : elle a été parfaitement envisagée dans le livre blanc sur la défense de 2008 qui faisait l'hypothèse d'une épidémie pulmonaire virale. J'ai toujours pensé que cela pouvait se produire car j'avais beaucoup étudié et écrit sur la grippe espagnole qui a provoqué entre 30 et 50 millions de morts. Je reconnais cependant ne pas avoir imaginé le désordre mondial que cela engendrerait à notre époque.
Pendant l'épidémie on a vu tout d'un coup, pour nous qui pensons être un des premiers pays au monde pour l'organisation de la médecine, une menace de rupture d'approvisionnement pour des molécules essentielles dans cinq domaines : chimiothérapie, anesthésie, corticoïdes, antibiotiques et même paracétamol. C'est dire à quel point nous avons mesuré notre fragilité non pas dans l'absolu mais en situation de crise. J'ai toujours été admiratif de la stratégie des militaires pour se préparer à faire face à des menaces non pas réalisées mais potentielles. Lorsque le Président de la République a souhaité recréer le Commissariat au Plan, nous avons donc envisagé la question sous l'angle de la souveraineté. En effet, un pays comme le nôtre, avec son histoire et sa tradition d'indépendance, ne peut pas ignorer les domaines essentiels qui peuvent se trouver brutalement mis en cause en cas de crise parce qu'ils sont soumis à des décisions lointaines, en Extrême-Orient par exemple. Voilà un des motifs qui a présidé à la mise en place de cet outil de planification à destination des citoyens et des décideurs.
Quelle méthode allons-nous suivre ? La France est championne du monde non seulement des rapports mais aussi et surtout des compétences non utilisées. Les rapports du Conseil économique, social et environnemental (CESE), de France Stratégie et même les rapports parlementaires ont tendance à s'entasser sur les rayons des bibliothèques. J'ajoute que parmi les gisements de ressources inemployées, il y a des centaines de chercheurs qu'on n'interroge jamais - l'un d'entre eux, particulièrement illustre, m'a dit un jour : « c'est la première fois qu'on m'interroge depuis 10 ans ». Il y a aussi des entrepreneurs à qui on ne demande pas assez leur avis. Ce sont donc toutes ces mines d'intelligence que nous voulons mettre en exploitation.
S'agissant de nos moyens, j'ai souhaité qu'ils soient très faibles, reprenant ainsi le modèle de Jean Monnet, qui était ministre, et avec lequel je n'étais pas toujours d'accord, mais qui a ouvert la voie à une organisation très légère ne mobilisant pas de moyens importants. Je suis ici entouré de M. Éric Thiers, secrétaire général, et de M. Philippe Logak, rapporteur général de notre petite organisation et, au maximum, nous serons une quinzaine de personnes. Je prévois cependant que nous puissions être en contact intime, comme le faisait Jean Monnet, avec tous ceux qui sont les acteurs de cette réflexion de long terme - industriels et chercheurs universitaires. Je suis frappé de constater que ces derniers sont en France, à la différence de tous les autres pays du monde, déconnectés de la décision publique alors qu'ils peuvent servir puissamment la réflexion. Nous devons donc mettre en synergie ou en symphonie ce grand gisement de travaux déjà élaborés et de compétences. Je compte également travailler avec trois séries d'acteurs et tout d'abord avec le CESE - que ses membres appellent la « société civile organisée » - et qui a été créé dans le même esprit que le Commissariat au Plan. En second lieu les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat sont aussi des producteurs de rapports et des gisements de compétences qui ne sont pas suffisamment mis en valeur. Nous sommes dans une phase de réflexion en jachère. Je dirais avec diplomatie que, dans ses mémoires, Jean Monnet indique que la création du Commissariat général au Plan n'a pas enthousiasmé tout le monde dans l'organisation de l'État et il me semble que ce phénomène est encore d'actualité. Je n'ai d'ailleurs pas perçu d'élan particulier pour faciliter les mises à disposition de personnel nécessaires à notre action : c'est humain. Vous m'interrogez sur mes rapports avec l'État et je souligne que ses serviteurs auraient bien tort de craindre quelque empiètement que ce soit. Je m'empresse de souligner que je n'ai pas de compétence sur le plan de relance : je ne le souhaite d'ailleurs pas car Bercy et le Trésor ont tous les moyens et toutes les compétences nécessaires pour définir leurs orientations. Si cela est possible je ferai des suggestions ou m'efforcerai d'avoir un peu d'influence mais ce serait une erreur, pour le Commissariat, de rechercher du pouvoir car ce dernier est du domaine de l'exécutif. L'essentiel, pour moi, est de réimplanter dans le débat les questions d'avenir et d'avoir ainsi de l'influence.
J'en viens à vos questions. Tout d'abord, comme vous le savez, j'ai passé une longue partie de ma vie et de ma carrière politique à mettre en garde contre une certaine désinvolture à propos de l'endettement. Aujourd'hui tout a changé : nous aurons été contemporains du changement du mode de pensée des économistes sur la monnaie et la dette et c'est un tournant historique. J'ai rencontré la semaine dernière le prix Nobel Jean Tirole et Olivier Blanchard, ancien chef économiste au Fonds monétaire international. Celui-ci était un défenseur d'une orthodoxie assez stricte en matière de dette mais il pense aujourd'hui que le problème s'est déplacé. Il faut donc aborder la situation de manière différente et ma conviction est que personne ne sait exactement comment s'y prendre. En effet, les banques centrales ont changé de paradigme en donnant la priorité à l'alimentation de l'économie en liquidités : elles ont, par conséquent, appliqué des taux d'intérêt de plus en plus réduits et même négatifs. C'est ce qu'on appelle le « quantitative easing » qui tangente parfois la « monnaie hélicoptère » (distribution directe de liquidités au citoyen). Je précise que la création monétaire ne dépend pas seulement du système bancaire : on considère que pour un dollar créé par les banques centrales deux sont créés par le système moins visible du « shadow banking ». Tout cela a créé des trillions de dollars de disponibilités : le mystère est que ces liquidités ne créent pas d'inflation et également qu'elles n'irriguent parfois pas suffisamment l'économie réelle. Une des explications de cette étrangeté est que, lorsque des facilités sont créées, les banquiers cherchent à se garantir en achetant des collatéraux dont le principal exemple est celui des bons du trésor américain : or ces titres sont de moins en moins abondants et c'est pourquoi le nuage massif de liquidités, qu'on estime à 17 trillions de dollars, n'alimente pas suffisamment l'économie. Si vous avez des idées pour sortir de cette situation, dites-les-moi et je vous embauche immédiatement ... Les banques centrales ont, par deux fois depuis 2008, essayé de remonter les taux. La catastrophe était telle qu'elles ont fait marche arrière. En effet, quand vous avez un portefeuille obligataire à taux zéro et que les banques centrales remontent leur taux, votre portefeuille est immédiatement dévalorisé et dans votre bilan, vos actifs sont dévalués. La situation actuelle est donc inédite et, à ma connaissance, personne ne sait comment en sortir. Nous sommes face à un nouveau modèle, dans un paradigme sans précédent. Le François Bayrou que vous auriez interrogé il y a dix ans avait des idées « granitiques » sur la dette et sur les garanties à apporter. Aujourd'hui, en dialoguant avec les meilleurs spécialistes du sujet, on constate que nous sommes dans un univers d'incertitude où il est très difficile d'investir.
La cession des participations de l'État est-elle à l'échelle de cette description ? Je le dis avec humilité et humour, je n'en suis pas certain. Et je ne m'exprime pas comme le responsable de la réserve fédérale qui disait : « si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé » !
La solution pour utiliser l'épargne excédentaire est plutôt du côté de la consommation. Mobiliser l'épargne pour l'investissement, dans un univers de prêts à taux zéro, ne fonctionne pas vraiment. Nous pouvons convaincre nos concitoyens de consommer mais ils constatent eux aussi les incertitudes. Les deux moteurs de l'économie, l'investissement et la consommation, sont dans des situations critiques. Par ailleurs, les secteurs vitaux de la France sont atteints : je pense à l'aéronautique par exemple. Nous vivons un drame, une catastrophe de ce point de vue. Tout ce qui peut être fait pour parier sur l'avenir - moteurs verts, carburants verts, recours aux matières végétales - mérite d'être soutenu.
Les risques de désocialisation liés au télétravail que vous évoquez sont réels. Beaucoup de nos concitoyens ont vu cette crise comme une parenthèse après laquelle nous retrouverons le monde comme il était. Un monde où l'on ne s'embrasse plus, où l'on ne se serre plus la main, où l'on ne se visite plus, où l'on ne voyage plus, où les échanges se trouvent remis en cause n'a rien de commun avec le monde que nous avons connu. L'augmentation constante et exponentielle des échanges est aujourd'hui menacée. Est-ce un changement passager ? J'en doute. Il y a peut-être là un changement anthropologique, quelque chose de profond qui va toucher le travail. Le télétravail est exposé aux risques de désocialisation mais aussi aux risques d'« ubérisation », avec des garanties moindres que celles du salariat. Nous allons beaucoup travailler, au sein du Haut-Commissariat au Plan, sur ce sujet.
Par ailleurs, vous m'avez très chaleureusement parlé de l'aménagement du territoire. Nous nous trouvons face à la nécessité de repenser cette politique. Les grandes unités urbaines ont découvert leurs fragilités pendant le confinement. Vous m'opposez le cas de Taïwan : je ne suis pas sûr que les Français souhaitent suivre ce modèle. La métropolisation de nos sociétés européennes est à repenser et il y a une demande d'équilibre des territoires, comme nous l'avons constatée avec la crise des « gilets jaunes ». À ce titre, j'avais prévenu le Président de la République de mon intention de localiser une petite partie de l'équipe du Haut-Commissariat à Pau. Il est nécessaire de montrer que chacun peut participer aux réflexions du pays, même depuis les provinces les plus lointaines. Nous vivrions différemment si tout le monde se pensait comme acteur de la vie, y compris intellectuelle, de notre pays. L'aménagement du territoire implique la numérisation et la réforme de l'État, qui sera aussi un de nos axes de réflexion. Notre État a des capacités immenses et j'espère qu'il sera de moins en moins bloquant et qu'il soutiendra au mieux le changement et les nouvelles initiatives. La crise nous plonge dans l'obligation de revisiter des réflexions conduites auparavant. Nos concitoyens ont compris qu'il y a d'autres modes de vie que la métropolisation galopante.
Votre dernière question, qui porte sur les risques de tensions intergénérationnelles, est pour moi la plus préoccupante. Je considère la démographie du pays comme essentielle et nous allons produire un rapport sur ce sujet dans les prochaines semaines. Il n'y a pas de vitalité d'un pays sans vision positive de sa démographie. Il y a effectivement une question lourde dans la vision proposée aux plus jeunes pour leur avenir. Quand on a 17 ou 23 ans, et que l'on vit confiné sans porte d'entrée vers le marché du travail, il y a des risques de tensions. Depuis des décennies, il n'y a pas eu de discours, de projets attractifs à destination des plus jeunes, et un certain nombre de ces projets sont des impasses. Globalement, j'ai une certitude et une réserve : nous allons nous en sortir car notre pays a des atouts, des capacités et un potentiel considérable mais ma réserve se situe au niveau des plus jeunes.
Parmi les propositions que nous avons faites, nous soutenons qu'il faut retrouver notre indépendance dans des secteurs d'activités vitaux pour notre souveraineté, comme les médicaments ou les composants électroniques. À l'image de ce que prévoyait la Défense nationale, il nous faut un plan de mobilisation en cas de crise.
D'autre part, nous avons puissamment soutenu le modèle social qui est le nôtre. Mais ce modèle social ne sera durable que s'il peut s'appuyer sur un appareil productif capable de le soutenir, c'est précisément sur le plan de reconstruction de l'appareil productif que nous aurons à discuter. Nous sommes à un tournant de la production dans le monde, centrée sur le numérique, les algorithmes et la robotisation. Les industries de main-d'oeuvre sont en difficulté. D'ici peu, les pièces seront usinées par des imprimantes 3D : c'est déjà le cas dans nos unités de production les plus avancées. Nous avons une capacité de recherche, dans le numérique et dans les algorithmes, plus puissante que beaucoup de pays dans le monde et je vois donc cet aspect avec optimisme. Nous sommes aussi l'un des pays les mieux équipés numériquement. Pour poursuivre cette progression, il n'en coûtera que quelques dizaines de milliards.
Je le redis, la question de la jeunesse reste pour moi une préoccupation majeure. Nous devons y consacrer une grande partie de notre travail et de notre empathie pour renouer avec la jeunesse sans leur proposer des modèles qui soient des impasses.

Il y a quelques semaines, France Stratégie a publié une note d'étape sur la lutte contre la pauvreté. Ce document révèle, en cette période épidémique, des faiblesses de nos politiques publiques en matière de lutte contre la pauvreté, et souligne combien le logement est au coeur du dispositif. Nous savons que cette crise sanitaire va engendrer à court terme de fortes demandes d'emploi liées à des faillites voire à la disparition de pans entiers d'activité. Une partie de la population frôle aujourd'hui la pauvreté, en particulier chez les travailleurs indépendants. Selon la formule de Jean Monnet, « le Plan ne décide pas, il oriente ». Comment envisagez-vous d'orienter les options du Gouvernement pour éviter cette situation de précarité dont on se redresse très difficilement ?

La création de ce Haut-Commissariat était attendue pour nous inscrire dans une nécessaire stratégie prospective de moyen et long terme. Ma question est la suivante : comment comptez-vous associer les collectivités territoriales à votre travail ? En particulier, les régions sont au coeur de ces stratégies économiques et d'aménagement du territoire. Ensuite, nous avons bien compris que votre action concerne aussi les enjeux de souveraineté. Pourriez-vous évoquer ces enjeux dans les domaines numérique, agricole et bioéconomique ? Enfin, quelles seraient vos propositions de réforme structurelle et d'évolution des institutions ?

Je me concentrerai sur la numérisation. Vous avez évoqué à plusieurs reprises le télétravail et les nouvelles formes de commerce. Il s'agit ici de progresser dans la couverture numérique du territoire et l'appropriation du numérique par nos concitoyens. Aujourd'hui, 13 millions de personnes et un tiers des entreprises, particulièrement les TPE et les commerces, n'ont pas accès à internet dans des conditions satisfaisantes. Cette lacune empêche la continuité de leur activité économique et commerciale en ce moment. Pouvez-vous nous indiquer vos réflexions et préconisations dans ce domaine essentiel pour l'avenir et la modernisation de notre société ?

Le nouveau confinement mène un trop grand nombre de commerces de proximité, déjà très fragilisés, à la fermeture définitive malgré les aides du Gouvernement. C'est un enjeu crucial pour notre pays et pour la population des territoires ruraux toujours plus lésés en matière d'accès aux commerces. Quelles solutions à moyen et long terme proposez-vous pour sauver le commerce de proximité ?
Je vais aborder ces questions dans mes fonctions de haut-commissaire, mais également de maire et de président de communauté d'agglomération. Mon point de vue sera donc local et prospectif. La question la plus difficile est évidemment celle de la précarité. Il nous faut réfléchir à d'autres approches de lutte contre la pauvreté qui prennent en compte tous ses aspects. En particulier, la solitude est une pauvreté, parfois plus cruelle en ville. Il me semble que la prise en charge des moyens de lutte contre la solitude est un moyen de lutter contre la pauvreté. Par exemple, une personne seule avec 700 euros est dans la misère totale. Deux personnes avec 1400 euros ou trois personnes avec 2100 euros constituent déjà une cellule de vie commune dans laquelle on peut se nourrir. Mais notre système social ne facilite pas les solutions de cet ordre. J'ai été confronté au cas d'une veuve bénéficiaire du RSA qui a recueilli chez elle son beau-père pour passer ce cap difficile : les services sociaux ont alors supprimé leurs allocations au motif de leur vie commune. Chacun est donc reparti chez lui, avec 700 euros, dans un retour à la misère. On ne se tire pas tout seul de l'extrême pauvreté. Or actuellement, la puissance publique a tendance à pousser à la solitude. Avec les bailleurs sociaux, nous avons travaillé pour permettre ce genre de cohabitation ou colocation sans perte d'allocations. À titre personnel, je pense que cela impose un changement de perspective. Ces approches différentes sont prometteuses : elles ne coûtent pas plus cher mais apportent des réponses différentes et plus humaines. Je suis convaincu que l'on peut faire mieux sans dépenser plus.
Cette question rejoint celle du logement - je souligne ici que de nombreux logements sont disponibles en France - et également celle de l'appareil productif, nécessaire pour lutter contre la pauvreté.
Monsieur Menonville, je suis convaincu que la question du travail avec les collectivités territoriales est vitale pour la société. Si nous comparions les nombres de lignes dans les journaux consacrées aux 65 millions de Français non parisiens avec le nombre de lignes susceptibles d'intéresser les deux millions d'habitants de Paris et ses environs, nous constaterions un très grand déséquilibre. Le rééquilibrage de la France est vital, encore faudrait-il que les collectivités territoriales fussent bien équilibrées elles-mêmes. À titre absolument personnel, je trouve que le découpage de certaines régions défie le bon sens. Il ne faut jamais être allé en France pour prétendre que Pau est dans la même région que Limoges, Poitiers ou Bressuire.
Un travail en commun efficace ne sera possible qu'à condition de travailler le bon équilibre entre la réalité et la responsabilité. Nous venons de le voir avec la crise, quand ça va mal, seul l'échelon de proximité tient, car il est d'une grande richesse et d'une absolue nécessité de pouvoir faire face « de près » : l'État ne pourra que le reconnaître.
Sur la question du numérique, nous avons progressé et l'équipement en 5G nous permettra de faire un pas en avant très important, notamment dans les zones non couvertes. Le débat autour de ces équipements devrait être écarté : presque tous les experts s'accordent à reconnaître que les émetteurs en 5G présentent moins de danger en termes de puissance d'émission et de longueur d'ondes que les émetteurs en 4G.
Sur l'agriculture et la bioéconomie, je reprends votre affirmation. En parlant des carburants verts pour l'aviation, j'ai esquissé des voies de découverte qui rendront à l'agriculture une partie de sa fonction non-alimentaire. Mais peut-être serons-nous confrontés à la question des capacités de production ?
Enfin, pour ce qui concerne les réformes structurelles, nous allons, je l'ai dit, travailler sur la question de l'État. Cela est rendu plus facile car notre démarche n'est pas électorale. Lorsque cela va mal, l'État est plus que jamais nécessaire mais se trouve souvent en situation d'auto-blocage. Nous produisons nous-mêmes nos propres blocages, en étant à la fois les contempteurs et les producteurs des normes.
Dans ce contexte, nous avons deux chances à saisir : l'immense développement des capacités du numérique et les réserves de productivité de l'État qui constituent, elles aussi, une mine inexploitée.
Monsieur Babary, je ferai au fond la même réponse pour le commerce. À Pau, nous avons construit un outil numérique qui permet aux clients de visiter chacune des boutiques du centre-ville et de commander en direct. C'est une ressource qui n'est probablement pas la seule. De plus, au-delà des polémiques actuelles, les difficultés économiques de la grande distribution prouvent que le modèle des grandes surfaces alimentaires est de moins en moins attrayant. Il faut sans doute y voir, là encore, une demande de société à dimension humaine. Bien entendu, cela pose la question des outils dont nous disposons dans le domaine commercial - en particulier les foncières - pour opérer ce rééquilibrage.
La question de l'accès au numérique est fascinante mais pas nouvelle : j'y travaille depuis les années 1980. Il y avait alors eu une intuition formidable des gouvernants consistant à proposer un terminal numérique dans chaque foyer. Un très petit groupe de chercheurs a pensé le langage numérique ayant permis Internet, il comprenait des Français. Nous sommes des précurseurs, mais nous ne participons pas aux fruits de la recherche. Cela interroge l'état et la mentalité de notre pays. Il n'y a nulle part, dans l'appareil de gouvernance de l'État, d'organisation pour encourager de développement de l'innovation après sa découverte. Si le monde de l'entreprise peut y contribuer également, il n'en demeure pas moins qu'en France on cherche et on trouve, mais d'autres cueillent les fruits. Je pense que la 5G est une solution. La ville de Pau a fourni à tous un réseau numérique fibré sur investissements publics. Nous en récoltons les fruits actuellement, un retour sur investissement est donc possible.

Votre note souligne que « la réduction drastique des relations interpersonnelles, notamment entre personnes relevant de catégories socioprofessionnelles différentes, est porteuse de menaces sur la cohésion sociale ». C'est la problématique majeure aujourd'hui : on oppose trop les personnes, les professions, les minorités les unes contre les autres. Il faut redonner du sens à la politique qui ne doit pas sombrer dans ce type de messages. Malheureusement nous connaissons cela depuis trois ans : la loi Egalim a renforcé l'agri-bashing, la loi économie circulaire le plastic-bashing, la suppression de la taxe d'habitation a vu naître le hashtag « balance ton maire ». Ce n'est pas tenable et conduira inévitablement à la disparition de la cohésion sociale. Le vrai plan de relance est là. Si on ne restaure pas chez chacun la capacité de comprendre ce que fait l'autre et pourquoi il le fait, au lieu de condamner, les milliards du plan de relance seront vains. Cette proposition ne coûte pas cher et aidera certainement notre pays dans la période qui l'attend.

Nous avons beaucoup évoqué la question du numérique qui est incontestablement un enjeu incontournable. Dans le cadre de la mission d'information sénatoriale sur l'illectronisme, nous avons cependant insisté sur la nécessité de garantir une diversité et une égalité d'accès aux services publics dans les territoires. Certains, pour des raisons diverses, ne peuvent se contenter d'un recours exclusif aux solutions numériques. C'est pourquoi nous avons suggéré le développement d'une filière de médiateurs numériques compétents à qui il faudra garantir pérennité et stabilité. Les PME et TPE ont besoin d'un accompagnement spécifique pour leur formation et leur équipement. Le plan de relance devrait prévoir un volet pour la formation. Que pensez-vous de ces propositions et quelles seraient les vôtres à long terme ?

Je voulais vous remercier pour votre présence et vos propos, tout aussi denses qu'inquiétants...
J'espère aussi porteurs d'espoir !

Je souhaiterais revenir sur un sujet qui m'est cher, à savoir le numérique. Internet est né en France, dans l'Ain, un département dont je suis le représentant. Je voudrais évoquer plusieurs points complémentaires : concernant les infrastructures, le Plan France Très Haut Débit (PFTHD) a été mis en place. Il n'est pas encore complet sur le territoire national, mais nous insistons depuis plusieurs années pour qu'il s'accélère et à cet égard le plan de relance semble être l'occasion pour le mener à bien.
Il y a également des décisions importantes à prendre en matière d'inclusion numérique : ce service devient indispensable pour nos compatriotes et s'impose à nous. Les plateformes se trouvent plutôt à l'extérieur de notre pays alors que nous avons un besoin de souveraineté. La problématique de l'inégalité fiscale vis-à-vis de ces plateformes se pose et je voulais savoir quels chantiers vous comptiez ouvrir sur ce point, car il y a besoin d'apporter des réponses rapidement.
En matière de télétravail, qui peut être une solution dans la crise actuelle, la problématique sociale a été évoquée, mais je pense que nous pourrions également développer des espaces dédiés, il s'agit d'une voie qui ne semble pas ouverte jusqu'à présent.
Pour terminer sur la question du numérique, nous sommes dans un monde de défiance comme cela a été rappelé : vous avez été rassurant à propos de la 5G, je ne le suis pas du tout. On sent une inquiétude de la part de nos compatriotes, il y a sans doute des problématiques d'information et de pédagogie sur le sujet. Le numérique a aussi ses inconvénients, notamment du point de vue environnemental où son poids n'est pas négligeable. Je signale l'excellent rapport sénatorial sur l'empreinte environnementale du numérique, qui me paraît important à prendre en compte afin que le remède ne soit pas pire que le mal.
Enfin, dans votre note vous avez évoqué le retour du politique, de quelle manière le voyez-vous et à quelle échéance ?

Je vous rassure : je ne vous donnerai pas la solution sur la question de la monnaie et du changement de la Banque centrale européenne, car sinon vous seriez obligé de m'embaucher et cela risquerait de poser quelques difficultés.
J'ai un point d'accord avec vous : la période que nous sommes en train de traverser est porteuse de doutes, et il nous faut douter. Douter non pas pour retarder les échéances et ne pas prendre de décisions, mais douter avec nos différences politiques qui nous obligent à nous interroger et à construire des solutions porteuses d'avenir. Il y a des choses extrêmement intéressantes dans votre première note, mais je n'y trouve pas de rupture avec les politiques qui étaient menées avant crise : vous tracez un chemin qui s'inscrit dans une logique libérale.
Vous nous avez dit que le Haut-Commissariat ne possède pas de moyens propres mais dispose des équipes de France Stratégie, est-ce bien confirmé ? Vous avez également indiqué que vous ne vouliez pas de pouvoir, mais de l'influence. En réalité, c'est un choix contraint : les plans quinquennaux à l'époque de Jean Monnet et du général de Gaulle en 1946 s'appuyaient sur un secteur bancaire nationalisé et des grandes entreprises en situation de monopole public. Cela permettait de construire un aménagement du territoire avec le principe d'égalité républicaine. Aujourd'hui, il s'agit bien d'un choix contraint : le secteur bancaire est totalement privatisé, les entreprises publiques ont été démantelées, ce qui vous prive de tout levier.
Je partage l'enjeu de numérisation des entreprises, mais nous avons un leader, le groupe Pages Jaunes, devenu SoLocal, qui, aspiré par Google, connaît des restructurations et plans sociaux depuis quatre ans sans aucune action de la part du Gouvernement. Le constat est simple : nous n'avons aucun outil industriel pour arriver à l'objectif qui est fixé.

Merci pour votre présentation. Vous qui êtes là pour éclairer l'action publique sur le long terme avez évoqué une préoccupation : la jeunesse. Comment redonner espoir à cette jeunesse qui est en recherche et en errance par rapport à ces projections dans l'avenir ?
Vous avez indiqué que la France était championne du monde des compétences gâchées et je souhaiterais recueillir votre point de vue sur deux rapports. Le premier a été présenté il y a moins d'un an devant notre commission par M. Jean-Louis Borloo et porte notamment sur la politique de la ville et l'état des banlieues, il était intitulé « vivre ensemble, vivre en grand pour une réconciliation nationale ». Pour ce qui est des territoires ruraux, je voudrais évoquer un rapport de l'Institut du développement durable et des relations internationales, « Une Europe agroécologique en 2050 : une agriculture multifonctionnelle pour une alimentation saine ». Je souhaiterais avoir votre réaction s'agissant de ces deux rapports.

La mission que vous a confiée le Président de la République consiste à penser la France dans les vingt à cinquante années qui viennent...
Cinquante, c'est beaucoup, je dirais dix à trente ans...

Dans le contexte de la crise sanitaire et économique que nous vivons, il paraît difficile de décoller des inquiétudes du présent. Pourtant, il est tout à fait essentiel de sortir de l'immédiat et de l'actualité brute afin de bâtir la France de demain. Comme le dit l'adage : « l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare ». Parmi les premières leçons que nous pouvons tirer de cette pandémie, l'une d'entre elles concerne la gestion politique de la crise et l'équilibre entre l'État central et les territoires français.
Prise en tenaille entre un discours scientifique hétérogène, une très forte pression médiatique et l'omniprésence des réseaux sociaux dans le débat public, la parole de l'État semble très affaiblie. Face à cette situation, nos élus locaux ont montré leur capacité à répondre à l'urgence, à être aux côtés des plus fragiles, à sortir de la rigidité administrative pour être en phase avec les besoins du terrain. L'heure est enfin venue de faire confiance aux territoires français et de leur donner pleinement les moyens d'agir. Les Français ne veulent pas davantage d'État, mais mieux d'État. L'exemple des arrêtés municipaux pris par de nombreux élus pour sauver le commerce de proximité doit faire réfléchir jusqu'au sommet de notre nation. Cet exemple est révélateur d'une situation de tension et d'incompréhension forte d'élus locaux et d'une partie de la population vis-à-vis des décisions de l'État. Préparer l'avenir de la France commence par réaliser vraiment la décentralisation et rééquilibrer les rapports entre les différentes strates de l'État. Nous ne ferons à nouveau nation que dans un pays où l'égalité des territoires est assurée et l'État perçu comme facilitateur des choix locaux.

Vous venez de dire que l'exigence de la vie à moyen et long terme passe par un travail de prospective qui est indispensable et notamment sous l'angle de la souveraineté. Vous nous avez aussi expliqué que les élus ne se trouvaient pas toujours en adéquation avec cette méthode. Entourés de technocrates souvent éloignés du terrain, ils ont du mal à s'approprier les avis des experts, ainsi que les nombreux travaux de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Conseil économique, social et environnemental. Les élus se retrouvent trop focalisés sur le temps de leur mandat. Ne pensez-vous pas qu'il conviendrait de mettre en place des formations poussées qui leur soient destinées ? Ne faudrait-il pas aussi que les élus s'approprient davantage la démocratie participative et avez-vous d'autres idées d'outils pour la développer ?
M. Duplomb évoque à travers sa question un constat qui m'a accompagné tout au long de ma vie politique : on ne peut pas perpétuellement dresser une partie du pays contre l'autre - les élections américaines aujourd'hui sont le résultat de cette politique. S'il m'est arrivé de m'opposer à certains présidents de la République, c'est parce que les choix stratégiques conduisant à alimenter les affrontements entre une partie du pays et l'autre étaient dangereux. Si j'ai toujours refusé la bipolarisation, je crois également que c'est le rôle du politique de rendre du sens. J'ai d'ailleurs écrit un livre il y a vingt-cinq ans, Le Droit au sens, sur le sujet de la laïcité. Le citoyen a un droit que les responsables publics devraient prendre en compte et assumer : donner du sens à notre action collective. Cela fait écho au constat de M. Cabanel d'élus trop souvent coupés des réalités et sous l'emprise des technocrates. De ce point de vue, l'interdiction du cumul des mandats, si elle comportait des avantages et était souhaitée par l'opinion, laisse toutefois ouverte la question de l'enracinement des élus...
Je vais vous laisser le faire... En tout cas, je reconnais qu'il y a une question, tout comme en ce qui concerne la distance entre la haute fonction publique, la décision politique et le terrain. Quand le Président de la République a proposé une réforme de la haute fonction publique, qui n'a pas été suivie d'effet, il s'agissait de créer des chemins différents de respiration ou de perspiration entre le terrain et la décision - administrative et politique - au sommet. Nous en sommes très loin. La conception que l'histoire longue - y compris monarchique - de la France, au travers de la Troisième République comme de la Cinquième, a portée au travers d'une haute fonction publique formée pour cela, a eu des effets de long terme résultant en une distanciation et une séparation. Les milieux de décision ne parlent plus la langue que les gens comprennent.
Je n'oublierai jamais lors d'une campagne électorale la rencontre avec une jeune femme, qui prenait pour la première fois la parole en public et a livré un témoignage émouvant et intéressant. Le mercredi après-midi, elle avait l'habitude de regarder les questions au Gouvernement à la télévision et m'a dit la chose suivante : « d'abord, vous vous tenez mal, si mes enfants se tenaient comme ça à l'école, je serais morte de honte ; ensuite, je ne comprends rien à ce que vous dites ». Le langage qui est devenu le nôtre au sens large - haute fonction publique et responsables politiques - a pris un vocabulaire, des tournures, une sémantique, une utilisation des statistiques, qui le rend très éloigné du langage que les gens parlent. Cette rupture exige-t-elle une formation, plus de démocratie participative ? Sans doute faut-il plus de démocratie tout court, une nouvelle organisation du fonctionnement des assemblées ou des rapports entre les assemblées parlementaires et l'exécutif. Je suis constamment minoritaire sur cette question y compris parmi mes amis, mais je l'assume.
Madame la Sénatrice Viviane Artigalas, je suis d'accord avec vous pour penser que le numérique ne peut pas être le seul point de contact entre l'administration et les citoyens. Je suis souvent exaspéré quand je dois téléphoner à un fournisseur d'énergie ou de téléphone : il est totalement impossible pour quelqu'un qui n'est pas rodé aux procédures des plateformes et à leur langage de jongler avec le téléphone, internet et ses documents personnels pour retrouver au bon moment son numéro d'usager. À force, ceux qui maîtrisent mal ces codes n'osent même plus appeler. C'est également vrai pour les administrations. Je crois aux vertus de progrès du numérique mais il faut absolument préserver un truchement humain dans les relations avec les usagers. La mise en place des maisons de service public répondait, par exemple, à cette préoccupation.
Monsieur le Sénateur Patrick Chaize, nous travaillons avec l'Union européenne pour augmenter les prélèvements sur l'activité et les bénéfices des GAFA. Il s'agit de ne pas laisser s'amoindrir ou disparaitre la base fiscale et également l'assiette des cotisations sociales. Le télétravail a une limite : c'est, au mieux, utile pour le secteur tertiaire mais l'industrie requiert obligatoirement de la présence physique. S'agissant de l'empreinte écologique du numérique, je lirai attentivement votre rapport d'information sur la transition numérique écologique.
Monsieur le Sénateur Fabien Gay, merci pour vos propos. Contrairement à ce que vous indiquez, il y a bien une rupture essentielle : je l'ai écrit et, si vous me lisez, nous tomberons d'accord. Pendant les trente dernières années, grosso modo, la doctrine générale était que la somme des décisions prises par les entreprises, chacune pour leur compte, et la somme des décisions individuelles faisaient l'intérêt général. Nos quatre précédents présidents de la République ont vécu sur cette conception dominante qui ne donne pas de légitimité particulière au travail de prospective publique dans le processus de décision. Je pense, pour ma part, que les décisions individuelles des entreprises sont bien adaptées - mieux que les décisions qui tombent du sommet - pour servir leur propre intérêt ; mais la somme des intérêts particuliers ne fait pas l'intérêt général. Il y a là une des explications des déséquilibres actuels avec des grands secteurs dont on a accepté la disparition parce que cela allait dans le sens des intérêts de tel ou tel opérateur.
Ma présence signifie que nous pouvons désormais penser le contraire et retrouver un sens de l'intérêt général prospectif qui était une des aspirations de l'après-guerre. De ce point de vue, la présente audition est un signe de rupture. Ceux qui ont fait des gorges chaudes sur le caractère archaïque d'un Commissariat au Plan pensaient que le temps de la planification était révolu ; je pense au contraire que cela est indispensable pour ouvrir de nouvelles perspectives.
Monsieur le Sénateur Joël Labbé, vous me prenez par les sentiments en citant les rapports de Jean-Louis Borloo. La bioénergie est une voie que l'on ne peut pas ignorer : si on considère que les émissions de CO2 sont la principale menace pour le climat, alors nous sommes obligés de trouver des substituts et, sans nul doute, l'utilisation des biocarburants doit progresser. Leur introduction dans le transport aérien est, en particulier, souhaitable pour faire baisser les émissions : je vous assure de ma détermination à aller dans ce sens. Il faut aussi avoir le courage de dire que si on veut vraiment minimiser les émissions de gaz à effet de serre, on ne peut pas continuer à penser qu'il faut poursuivre la fermeture des centrales nucléaires. L'Allemagne est un contre-exemple puisqu'après avoir fermé des installations nucléaires, elle achète de l'électricité produite dans les pays voisins à partir de centrales à charbon trente fois plus émettrices de CO2 que le nucléaire. Je suis également partisan du photovoltaïque et je note au passage que l'éolien suscite plus de contestations et de rejets. Je précise ici que le photovoltaïque au silicium nécessite sept ans de fonctionnement pour équilibrer son bilan carbone tandis que pour le photovoltaïque organique, utilisé à Pau, cette durée est seulement de sept jours, avec certes une productivité trois fois moindre que celle du photovoltaïque au silicium. Je ne peux pas non plus m'empêcher de signaler que la seule ligne de transport à hydrogène de France a été mise en place à Pau.
Monsieur le Sénateur Jean-Marie Janssens, comme vous l'indiquez, la parole de l'État, et plus généralement la parole publique, ont été affaiblies. Nous sommes dans un monde ou toute prescription pour autrui a tendance à être mise en cause : c'est vrai pour les politiques et aussi pour les médecins puisque les Français, à l'occasion de la crise sanitaire, ont découvert que les médecins ne sont pas d'accord entre eux, avec même des affrontements passionnés qui dépassent la mesure.

Je vous remercie de nous rassurer sur le fait que le Haut-Commissariat est une structure d'anticipation et non pas une technostructure supplémentaire. Comment allez-vous travailler avec les ministères pour avoir une véritable emprise et ne pas devenir un simple think tank ? Je témoigne à mon tour du recul social qui frappe un grand nombre de nos concitoyens et je souligne tout particulièrement le cas des jeunes étudiants qui ne disposent pas d'un accès numérique performant sur nos territoires. Je rappelle que plus de 50 % des locaux d'habitation ou de travail ne sont pas desservis par la fibre optique. S'agissant du pouvoir de la finance, je me demande si ceux qui « tirent les ficelles » de la dette ont vraiment intérêt à sortir de l'opacité, et, comme le disait Einstein, « on ne résout pas un problème avec ceux qui l'ont créé ». Par ailleurs, économiquement, tout est tributaire de notre capacité et de notre souveraineté énergétique ; or les nouvelles énergies peu émettrices de CO2 sont en vive croissance mais à des coûts exorbitants. Quelles sont vos réflexions à ce sujet ? Enfin, quels sont les atouts différentiels de la France et ses leviers de croissance à long terme ?

Depuis une trentaine d'années, il n'y a pas eu de politique sérieuse d'aménagement du territoire. Tout, ou presque, a évolué en faveur des métropoles et des centres urbains aux dépens de 80 % du territoire où vit 20 % de la population. On reparle aujourd'hui de territoires ruraux et de réindustrialisation mais cela nécessite, tout d'abord, une volonté politique. Il faut aussi des outils et des moyens financiers comme les zones de revitalisation rurale ou le FEADER qui étaient centré sur la ruralité : tout ceci a quasiment disparu. Et pourtant, la redynamisation des zones rurales est possible puisque, sur mon territoire, avec la communauté de communes que j'ai présidée, nous avons réussi en vingt ans à augmenter de 50 % l'emploi avec une politique volontariste et les moyens disponibles qui se sont aujourd'hui taris. Quel volet aménagement du territoire prévoyez-vous dans votre plan ? Cela me semble indispensable.

Je me félicite de cette réflexion prospective dans notre monde court-termiste où on oppose la fin du monde à la fin du mois. Je fais observer que parmi la pile des rapports qui dorment il y a également ceux du GIEC. Le numérique est-il vraiment la solution majeure ou ne fait-il pas également partie du problème ? Pour faire fonctionner le numérique et le construire, il faut des terres rares, dont nous ne disposons plus et de l'énergie. Je ne partage pas tout à fait votre analyse sur l'éolien mais en tout cas, notre indépendance énergétique est fondamentale : quel est votre point de vue sur ces questions ? Par ailleurs, vous avez évolué sur la question de la dette et je me demande si vous évoluerez sur celle de la consommation : faut-il pousser encore à plus de consommation ?

Je m'interroge sur le principe même de la planification. Est-ce bien compatible avec une économie mondiale ultralibéralisée ? Comment parviendrez-vous à associer à cette politique les grands groupes mondiaux comme les GAFA, qui me semblent suffisamment puissants pour s'affranchir de toute tutelle ? Parallèlement, quels seront, au niveau de l'État, vos appuis pour mener une politique active de planification ? Je crois à l'utilité d'une telle politique aujourd'hui tout autant qu'hier. Il faut réfléchir à long terme mais les décisions à court terme impactent l'avenir. Au niveau industriel, on discute en ce moment de la décision de vente de la participation de l'État dans les Chantiers de l'Atlantique, c'est-à-dire un fleuron industriel : n'est-on pas en train d'obérer notre potentiel dans la construction navale ? En second lieu, en quoi les signatures de traités comme le CETA permettent-elles de sauvegarder notre indépendance agricole ?

J'imagine la difficulté d'élaborer un plan à 20 ou 25 ans car une telle planification doit reposer sur des bases solides alors que ces dernières sont ébranlées par la pandémie. Nos concitoyens vivent en ce moment au jour le jour : je m'interroge donc sur la justification et la faisabilité actuelle d'un tel plan. Par ailleurs, vous avez exposé publiquement, sur France Inter, votre opposition à un reconfinement généralisé, en indiquant qu'« on ne peut pas refermer le pays sur lui-même », d'autant que la première vague épidémique a permis de mieux se préparer à la seconde. L'actualité donne malheureusement tort à votre seconde prédiction et je le regrette. L'actualité témoigne d'une absence de dialogue avec les élus locaux et d'une improvisation dans l'édiction de règles qui entraînent des dommages économiques collatéraux : tel est le cas pour les grossistes en boissons exclus de nombreux dispositifs d'aides, les auto-écoles qui peuvent faire passer certains examens mais pas dispenser de leçons de conduite et les producteurs de sapins de Noël. Peut-être serons-nous prêts pour la troisième vague... Quels enseignements, de nature à nous rassurer, tirez-vous de cette situation ?

Votre note s'intitule « Et si la Covid durait ? » ; pourquoi n'avez-vous pas ajouté « et même si la Covid ne durait pas » ?
Je suis totalement d'accord et je m'en explique en introduction de ce document.

Trois éléments, qui sont antérieurs à la crise sanitaire, me paraissent fondamentaux : la mondialisation, la métropolisation et l'individualisation. Vous n'avez pas cité le mot mondialisation qui a pourtant entraîné de graves conséquences financières et a participé à la désindustrialisation. Je partage ensuite votre analyse de la métropolisation : cette concentration de la richesse a eu des conséquences pénalisantes et ce sont d'ailleurs les territoires les plus pauvres en zone dense qui ont été les plus frappés par l'épidémie avec un impact non seulement sanitaire mais aussi psychologique qu'on aurait tort d'oublier. En troisième lieu, la voie de l'individualisation qui a été choisie est aujourd'hui subie par la jeunesse. Comment « empêcher un marronnier de bourgeonner » et contenir la jeunesse dans un système où les jeunes ne peuvent pas se côtoyer et demeurent sans perspectives d'emploi attractives. Le facteur déclenchant était, comme vous l'avez rappelé, prévisible : vous avez cité le Livre blanc de la Défense et je mentionne également les travaux publiés en 2016 par des chercheurs de l'UMR de Montpellier qui apportent un éclairage porteur d'espoir en matière de détection et de traçage de l'épidémie. On aurait d'ailleurs, dans ce domaine, pu mieux tirer parti des épidémies et de la médecine animales.
L'attachement au système social de notre pays appelle enfin plusieurs interrogations. On a bien vu que l'Asie a contrôlé plus strictement les mouvements aux frontières : est-ce un facteur de retour à l'État-Nation - en écartant les connotations négatives de cette formule - auquel sont attachés nos concitoyens ? Vous n'avez pas non plus évoqué le rôle de l'Europe dans cette stratégie de protection et d'indépendance sanitaire ou industrielle. Je cite également une phrase, un peu polémique, de Thomas Gomart, qui dirige l'Institut français des relations internationales (IFRI) : « le mode de gestion des entreprises a contaminé la sphère publique alors que les finalités sont fondamentalement différentes. En Europe, on a tenu les notions de plan et de planification pour obsolètes au profit d'outils de gestion à horizon trimestriel. Dans les business schools, on n'a cessé d'encourager l'hyper-rotation des actifs, la liquidité plutôt que la solidité. ». Je résume ce phénomène en disant qu'on a préféré la quantité des profits à la qualité des produits. Que pensez-vous de ces considérations qui ont été reprises par Hubert Védrine ?

J'insiste sur l'urgence de remédier à la pénurie d'approvisionnement en vaccins contre la grippe. Quelles pistes pouvez-vous activer pour y remédier, et, plus globalement renforcer notre indépendance dans ce secteur stratégique pour la santé de nos concitoyens ?
Merci de ces questions très variées.
Madame la Sénatrice Catherine Loisier a raison de rappeler qu'un certain nombre de jeunes se retrouvent en confinement et isolés des réseaux. Il faut, pour répondre à cette situation, mettre en place des outils garantis en alimentation numérique et offerts à tous ceux qui en ont besoin. Il ne peut s'agir ici que d'une réponse de service public, en s'inspirant du rôle que jouaient autrefois les bibliothèques. On doit aider les étudiants alors que les universités font face à d'énormes difficultés.
S'agissant de l'opacité de la finance, les chiffres que je vous ai donnés montrent l'ampleur du problème, mais l'État sert précisément à y remédier et je saisis l'occasion de dire à M. Daniel Salmon que, quand j'évoque la puissance publique, je ne distingue pas entre les autorités étatiques et l'Union européenne et les collectivités locales : ces institutions forment un continuum. Elles ont, par ailleurs, un rôle accru à jouer en faveur de l'indépendance énergétique. On aurait ainsi dû empêcher les Allemands de se draper dans la vertu antinucléaire et contribuer indirectement à ouvrir des centrales à charbon en Pologne.
Quels sont les atouts différenciés de la France ? C'est la question centrale : nous sommes un pays magnifiquement équipé avec une tradition industrielle et de recherche performante, ainsi qu'une histoire unitaire et une identité - cela nous distingue, par exemple, de la société américaine soumise à de très vives tensions. A-t-on cependant fait suffisamment sur l'éducation, dans les dernières décennies, et en particulier sur les fondamentaux ? Il n'est pas impossible que l'éducation populaire puisse suppléer aux insuffisances constatées dans ce domaine et en matière de culture générale. Je travaille depuis longtemps sur l'illettrisme et je pense qu'on va trouver les outils qui vont y remédier. En tout état de cause, le niveau général de la main-d'oeuvre, en France, est bon. La question est de savoir comment faire en sorte que les personnes dépourvues d'emploi acceptent de se tourner vers les emplois disponibles dans des secteurs, comme le BTP, qui ont des difficultés de recrutement. C'est un problème « à se taper la tête contre les murs ». A-t-on fait suffisamment pour l'image de ces métiers ? La progression importante de l'apprentissage, qui est un succès enregistré ces dernières années, contribue à améliorer la situation.
Monsieur le Sénateur Pierre Louault, s'agissant de l'aménagement du territoire, je pense que le mouvement des temps va ouvrir une large fenêtre d'opportunités sur ce sujet. J'en suis convaincu. En particulier, on peut harmoniser l'accès lointain avec une présence humaine garantie grâce à la formation au numérique pour tous, qui fait partie du plan anti-solitude que je prépare, et un progrès dans les équipements.
Monsieur le Sénateur Daniel Salmon, le numérique, comme la langue, peut être la meilleure et la pire des choses. Le numérique peut isoler mais il peut aussi réunir. Une partie de la solution à ce problème est entre les mains des gouvernants car l'essentiel de la responsabilité publique est d'apporter aux gens des raisons de vivre plutôt que d'apporter des réponses toutes faites. Il nous faut faire comprendre à tous que notre vivre-ensemble repose sur un principe de protection des libertés et en même temps de respect mutuel. Dans ce contexte, on ne peut pas se priver de cet outil numérique extraordinaire. Vous vous demandez également si la consommation est le but ultime : non, et cela renvoie également à nos principes de vie en commun ; en un mot, la réussite ce n'est pas la Rolex.
Monsieur le Sénateur Serge Mérillou, tout d'abord, j'ai choisi ce mot de plan pour relever une tradition fondamentale pour l'avenir de notre pays. Ensuite, je rappelle que le CETA a été fortement critiqué mais c'est bien la France qui est le grand bénéficiaire de ce traité avec une explosion de ses exportations agricoles : il n'est donc pas interdit de faire preuve de discernement.
Monsieur le Sénateur Olivier Rietmann, il est vrai que j'étais opposé au confinement généralisé et on ne l'a pas institué puisque les trois domaines que j'avais cités - les écoles, les entreprises et les Ephad - sont restés ouverts. Par ailleurs, vous rappelez que tout change assez rapidement mais pour le Commissariat au Plan, il ne s'agit pas tant de prévoir que de réduire l'incertitude.
Monsieur le Sénateur Laurent Somon : je vous signale au passage que mon fils est vétérinaire, spécialiste de virologie ; c'est dire à quel point je suis en phase avec vos propos. Les peuples d'Asie ont mieux résisté à la Covid car ils avaient déjà des masques et ont des attitudes de vie plus distantes. Il est possible que ces comportements soient liés à des épidémies antérieures. Je suis d'ailleurs prêt à parier qu'on s'embrassera moins et qu'on se saluera plus à distance dans notre pays, à l'avenir. A contrario, la proximité physique et les vacances de l'été sur la côte basque cet été ont certainement joué un rôle dans la reprise de l'épidémie : je n'ai aucun doute à ce sujet.
Enfin, Monsieur le Sénateur Bernard Buis, je promets une intervention rapide sur l'approvisionnement en vaccin contre la grippe.