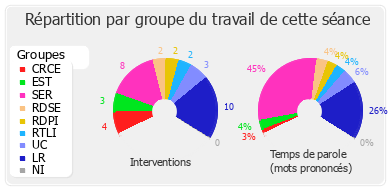Séance en hémicycle du 4 mai 2021 à 21h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.

La séance est reprise.

L’ordre du jour appelle le débat, organisé à la demande du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, sur le thème : « Enjeux nationaux et internationaux de la future PAC. »
Nous allons procéder au débat sous la forme d’une série de questions-réponses, dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents.
Je rappelle que l’auteur de la demande dispose d’un temps de parole de huit minutes, puis le Gouvernement répond pour une durée équivalente.
À l’issue du débat, l’auteur de la demande dispose d’un droit de conclusion pour une durée de cinq minutes.
Dans le débat, la parole est à M. Jean-Claude Tissot pour le groupe auteur de la demande.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a souhaité l’inscription de ce débat sur la question, fondamentale des enjeux de la prochaine politique agricole commune (PAC).
Parmi les politiques européennes, la PAC tient une place à part. Elle reste en effet, à ce jour, la seule véritable politique européenne intégrée, dotée d’un budget spécifique. Quant à notre pays, il en est aujourd’hui le premier bénéficiaire.
Après de premières annonces inquiétantes, l’accord du Conseil européen du 21 juillet 2020 a finalement permis un relatif maintien du budget de la PAC, en euros courants, à hauteur de 386 milliards d’euros. La France bénéficiera ainsi d’une enveloppe stable à hauteur de 62, 4 milliards d’euros : 51 milliards sur le premier pilier et 11, 4 milliards sur le second.
Pourtant, le maintien facial de ce budget cache en réalité une baisse, car, exprimé en euros courants, il ne prend pas en compte l’inflation. Si celle-ci atteint 2 % par an sur la période, on perdrait en réalité 39 milliards, en euros constants, par rapport au budget précédent, soit plus d’une année d’aides du premier pilier.
Cette baisse, qui n’est qu’en partie imputable au Brexit, n’est pas un bon signal alors que les défis qui sont devant nous n’ont jamais été aussi grands.
Parmi les dix objectifs de cette nouvelle PAC, je retiendrai : assurer un revenu équitable aux agriculteurs ; agir contre le changement climatique ; garantir la qualité des denrées alimentaires et la santé ; dynamiser et soutenir le développement économique des zones rurales. Comme vous le voyez, face à de tels enjeux, ce n’est pas le moment de baisser la garde !
Le plan stratégique national (PSN) est la grande nouveauté de cette future PAC. À partir de 2023, chaque État membre devra obligatoirement mettre en place un PSN qui définira les modalités de mise en œuvre opérationnelle de la PAC à l’échelle nationale.
Nous devrons être très vigilants afin que cette subsidiarité accrue ne fasse pas perdre le sens du « C » de la PAC, qui doit être résolument préservé. En effet, si les déclinaisons des PSN revenaient à faire autant de politiques agricoles qu’il y a d’États membres, des distorsions, voire du dumping, pourraient apparaître. Il faut, je le répète, que la PAC reste une politique collective et que tous les agriculteurs, quel que soit leur pays, soient traités sur un pied d’égalité.
En outre, le PSN doit garantir que l’agriculture bio ne soit pas la grande oubliée de la future PAC. Actuellement, seulement 2 % du budget de la PAC sont consacrés au bio, ce qui est loin d’être suffisant car, pour atteindre l’objectif de 25 % de terres cultivées en bio en 2030, fixé dans les stratégies Biodiversité et Farm to F ork, il faut des mesures fortement incitatives pour transformer les pratiques agricoles.
Le PSN, qui conditionnera les règles d’attribution des aides, pourrait donc être le levier pour se rapprocher de l’objectif de 15 % de surfaces en bio en France à l’horizon 2022, que vous aviez réaffirmé, monsieur le ministre, dans le cadre du plan Ambition Bio. Il y en aura besoin car, en 2020, nous en étions seulement à 8, 5 %. C’est dans ce sens que nous avons signé une tribune, avec 300 élus locaux et nationaux de différentes sensibilités, sur l’initiative de la Fédération nationale pour l’agriculture biologique (Fenab), appelant le Gouvernement à intégrer l’objectif du bio dans le PSN.
L’autre enjeu de cette nouvelle PAC est une meilleure redistribution des subventions. Le 21 juin 2020, le Conseil a validé le principe d’un plafonnement des aides à hauteur de 100 000 euros par exploitation. Les États membres auront, en outre, la faculté de mettre en place un mécanisme progressif de réduction des aides à partir de 60 000 euros.
Ce plafonnement à 100 000 euros nous semble trop peu ambitieux, d’autant qu’il n’est finalement que facultatif. Je souhaite que notre pays se saisisse de ces mécanismes de plafonnement et de dégressivité. Sans un réel plafonnement des aides, monsieur le ministre, tout le reste n’est que littérature !
Je terminerai par un mot sur les enjeux internationaux de cette nouvelle PAC. Ses objectifs vont dans le bon sens, mais ils sont en complète contradiction avec ce que l’Europe fait, dans le même temps, avec le CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement – accord économique et commercial global) ou le Mercosur.
Les normes sanitaires et environnementales que la France et l’Union européenne imposent à nos agriculteurs ont fait évoluer leurs pratiques, faisant de notre agriculture l’une des plus sûres au monde, toujours plus vertueuse en matière de protection de l’environnement.
Or ces évolutions ont un coût pour nos agriculteurs en termes d’investissement, de formation et de prise de risque. A contrario, avec le CETA et le Mercosur, l’Union européenne veut ouvrir le marché européen à des produits alimentaires moins chers, mais qui s’affranchissent des normes sanitaires et environnementales s’imposant à nos paysans.
C’est pourquoi je voudrais terminer mon intervention par une question très solennelle, monsieur le ministre : quand aurons-nous enfin un vrai débat avec vous sur ces traités et sur leurs conséquences sur l’agriculture et l’alimentation dans notre pays ?
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis une trentaine d’années, chaque phase de négociation de la PAC constitue une période d’incertitudes pour les professionnels du monde agricole, en particulier pour les éleveurs. C’est précisément la définition des arbitrages pour répartir un budget en baisse qui ouvre le champ à de vives inquiétudes de la part de nombreux territoires et filières.
Le 7 avril dernier, vous avez notamment rappelé au Sénat, monsieur le ministre, que la PAC française devait encourager une agriculture de territoires avec une attention portée aux spécificités locales, le maintien de l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) et une meilleure prise en compte des zones intermédiaires.
Faute, pourtant, d’une définition officielle et unique, l’identification de ces zones intermédiaires, et donc le ciblage de leurs aides, est bien plus difficile que pour les zones défavorisées, qui bénéficient par exemple de l’ICHN.
Le critère géographique est lui-même variable selon les appréciations, puisque les pouvoirs publics situent les zones intermédiaires sur une diagonale allant de la Charente au Grand Est. Cette interprétation arbitraire exclut toutefois de nombreux territoires, par exemple dans les régions Nouvelle-Aquitaine ou Occitanie qui, pourtant, sembleraient être parmi les plus concernées. Un travail de définition précis de ces zones intermédiaires est donc attendu de votre part.
Il nous faudra aussi savoir comment celles-ci seront identifiées au sein de la PAC, et de quelles aides spécifiques elles pourront bénéficier, à l’image de l’ICHN. S’agissant de cette indemnité, le maintien au niveau actuel que vous proposez pose question. Pour atteindre cet objectif, il faudra que la France le finance sur son budget afin de combler la baisse du taux de cofinancement européen de 10 % actée par le Conseil en octobre dernier. C’est un arbitrage qui se défend mais qui aura nécessairement, à enveloppe globale constante, des conséquences sur les autres aides.
À cet égard, les zones de polyculture-élevage et les professionnels de l’élevage allaitant craignent que le rééquilibrage de l’enveloppe des aides couplées en faveur de notre autonomie protéique ne se fasse à leurs dépens. Ces aides représentent actuellement 13 % au maximum de l’enveloppe des aides directes, et 2 % pour ce qui est des protéines végétales.
Or le Gouvernement envisage une augmentation jusqu’à 4 % des aides dédiées aux protéines afin de renforcer notre indépendance alimentaire et de limiter le recours aux importations. L’objectif est louable, mais les exploitations précitées, qui ont déjà été, pour certaines, sorties du dispositif de l’ICHN et demeurent fragiles, ne pourront pas supporter de nouvelle diminution.
Par exploitation, le montant des aides allouées correspond à peu près au salaire mensuel des éleveurs, c’est-à-dire 800 euros par mois. Si rééquilibrage il doit y avoir, celui-ci devra engager financièrement les filières agricoles les moins impactées par la crise. Par ailleurs, notre groupe attend des avancées sur le sujet des paiements redistributifs et sur la convergence des aides.
Si rien n’est encore acté, je tiens tout de même à rappeler que ces aides couplées bénéficient pour 80 % à l’élevage. La Fédération nationale bovine (FNB) s’est fait l’écho de cette préoccupation, en demandant que les aides couplées du premier pilier soient impérativement maintenues à leur niveau actuel. Il y va de la survie de nombreuses exploitations et donc, plus largement, de l’équilibre économique mais aussi environnemental de nombreux territoires ruraux.
L’élevage extensif qui les caractérise contribue, grâce aux prairies permanentes, à la captation du carbone et permet l’approvisionnement des agglomérations proches des exploitations en produits de qualité via des circuits courts. Il présente donc de nombreux avantages qui correspondent aux objectifs fixés par la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite Égalim, en matière d’accessibilité à une alimentation saine et durable.
Le volet concernant l’équilibre des relations commerciales entre producteurs et grande distribution de cette loi étant un échec manifeste après trois ans de mise en œuvre, on est en droit d’attendre du Gouvernement un soutien massif en faveur de ce modèle agricole.
D’autre part, une question demeure concernant l’augmentation de notre autonomie protéique : visera-t-elle en priorité l’alimentation animale ou humaine ? Sur ce point, les éleveurs manquent de précisions, surtout au regard du souhait du Gouvernement de pérenniser les repas végétariens hebdomadaires dans les cantines scolaires.
Face à ces multiples impératifs – préserver notre modèle d’élevage extensif et augmenter notre autonomie protéique – où placer le curseur ? Comment arbitrer ?
Monsieur le ministre, il faut selon moi, avant tout, déterminer quel modèle agricole et alimentaire nous voulons. Un modèle qui promeut des pratiques, tant d’élevage que de culture, vertueuses et respectueuses de l’environnement, des animaux et des hommes ? Ou un modèle d’agriculture intensive dont on ne cesse de rappeler les multiples effets dévastateurs ?
Une fois ce choix fait, les arbitrages devraient logiquement en découler. Pour une fois, faites en sorte que les éleveurs ne soient pas les seuls à porter l’effort budgétaire, alors que leur situation ne le permet pas. Pouvez-vous nous assurer que les zones de polyculture-élevage ne seront pas les sacrifiées de la future PAC ?
Applaudissements sur les travées du groupe SER. – M. Jean-Pierre Corbisez applaudit également.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le débat d’aujourd’hui porte sur une politique absolument structurante en matière de souveraineté, de territoires, de développement économique et d’environnement : la politique agricole commune.
Je voudrais d’abord rappeler le contexte européen dans lequel se situe cette PAC. La première proposition de budget faite par la Commission européenne n’était absolument pas acceptable pour la France. Sur l’initiative de la France, nous avons réussi à revenir sur cette proposition d’octobre 2018 pour faire en sorte que le budget de la politique agricole commune soit, en euros courants, peu ou prou le même que celui de la PAC actuelle.
Je vous laisse imaginer la teneur des débats que nous aurions eus ce soir si nous n’avions pas réussi à faire revenir la Commission sur son premier jet ! Nous aurions débattu d’une PAC dont le budget aurait été, en fonction des dispositifs dont elle est constituée, en diminution de 5 % à 15 %.
La seconde étape a été, à l’automne dernier, le Conseil européen des ministres de l’agriculture, qui nous a permis d’élaborer le cadre politique de cette PAC avec, notamment, un élément très important : les fameux écorégimes. Ceux-ci doivent s’appliquer à tous les États membres, sans exception, sans dérogation, pour faire, enfin, de cette convergence dans les normes et les standards agroenvironnementaux une réalité, y compris au sein du marché commun.
Nous avons obtenu gain de cause, reste maintenant à établir le plan stratégique national. Vous l’avez dit, monsieur le sénateur, il faut absolument veiller à ce que ces PSN ne créent pas à cette aune des distorsions de concurrence, mais soient bien tous conformes au cap de la PAC.
Les négociations au niveau européen sont toujours en cours, ce qui complexifie le débat. Le trilogue n’est pas encore finalisé. On ne sait pas, par exemple, si l’écorégime s’appliquera à 20 %, à 25 % ou à 30 % du premier pilier. Il nous faut faire avec ! Le trilogue se terminera probablement d’ici à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin, en tout cas sous la présidence portugaise.
Quelques avancées ont cependant déjà été actées, dont l’une me tenait particulièrement à cœur et sur laquelle nous nous sommes beaucoup battus : l’inclusion du droit à l’erreur au sein des fondamentaux de la PAC. À mon sens, c’est essentiel. Combien d’entre vous ont déjà alerté le ministre que je suis ou mes prédécesseurs en évoquant un rappel non justifié des paiements de la PAC ? Ce point est résolu puisque nous avons obtenu gain de cause sur l’inclusion du droit à l’erreur.
Un autre exemple est la prolongation des autorisations de plantations viticoles de 2030 à 2045. Les grands défenseurs des territoires viticoles que vous êtes savent à quel point il s’agissait d’une demande importante du secteur.
D’autres questions sont encore sur la table : l’écorégime, la conditionnalité d’un certain nombre de règles, la rotation des cultures – un sujet sur lequel nous nous battons aussi –, l’organisation commune des marchés, c’est-à-dire des mécanismes permettant de soutenir le secteur en cas de crise, comme l’épisode dramatique de gel de ces dernières semaines.
Notre agenda consiste à finaliser ce PSN d’ici à cet été, puis à mener les évaluations environnementales requises afin d’être en mesure de solliciter l’approbation définitive de la Commission avant la fin de l’année. Nous avons déjà franchi beaucoup d’étapes pour parvenir à ce résultat.
Nous nous sommes tout d’abord livrés à un exercice de diagnostic avec l’ensemble des filières.
Nous avons ensuite mené une consultation sous la forme d’un débat public, ainsi que la loi l’exige. La très forte participation des citoyens à cet exercice nous a permis de recueillir plus de 1 083 recommandations. Nous avons rendu les conclusions de cette consultation au mois d’avril dernier.
Enfin, nous nous livrons à un exercice de concertation et de consultation de l’ensemble des filières, des organisations civiles, notamment les ONG, mais aussi – c’est très important – des régions car, comme vous le savez, la loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit national au droit de l’Union européenne, dite Ddadue, que le Sénat a adoptée, prévoit le transfert aux régions d’une partie du deuxième pilier, notamment les aides non surfaciques telles que l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs. Toutes ces concertations sont en cours et leur calendrier se resserre.
Au-delà de ces différents éléments de contexte, permettez-moi de préciser la vision que je souhaite porter au travers de ce PSN. Celle-ci s’articule autour de quatre axes primordiaux sur lesquels nous reviendrons en détail dans le cadre du débat interactif.
Le premier axe est celui de la compétitivité.
La PAC doit permettre de garantir le revenu des agriculteurs au travers de mesures de soutien direct. Cela nécessite une certaine stabilité dans la politique menée et suppose, par exemple, de ne plus opérer de gros transferts tels que ceux décidés dans le cadre des deux précédentes PAC. Ces transferts avaient notamment conduit, monsieur le sénateur Redon-Sarrazy, à une diminution très significative des paiements de base dans les zones intermédiaires. Si certains s’en sont réjouis, d’autres, notamment dans les zones intermédiaires, en ont subi les conséquences. J’estime pour ma part qu’une forme de stabilité est nécessaire pour préserver les territoires, les cultures et les filières végétales et animales.
Le deuxième axe est la souveraineté alimentaire. Cela passe par la production de protéines, mais aussi par la structuration au sein des filières et par un certain nombre de revues visant notamment – nous y reviendrons – à calculer les aides couplées en fonction des unités de gros bétail (UGB) ; nous en discutons avec la filière.
Assurer la souveraineté alimentaire suppose également – il ne faut jamais l’oublier – d’agir sur d’autres leviers que la PAC. Je pense notamment à la loi Égalim, dont nous avons longuement débattu dans cette haute assemblée, mais aussi au nouveau projet de loi qui sera examiné dès le mois de juin à l’Assemblée nationale puis au Sénat.
Le troisième axe est la transition agroécologique. Il faut que les écorégimes soient corrigés de manière à devenir inclusifs. Pour ma part, j’estime qu’il est très important que les écorégimes soient appliqués par tous les États membres et qu’ils soient inclusifs, de sorte que nos cultures n’en soient pas exclues mais qu’elles soient au contraire accompagnées dans cette transition.
Le quatrième axe est la prise en compte des spécificités des territoires, notamment de montagne, et des zones intermédiaires.
Au-delà de ces quatre axes stratégiques, je tiens à rappeler qu’il ne s’agit pas d’un débat budgétaire. Celui-ci a déjà eu lieu, et la France – je vous remercie de l’avoir rappelé, monsieur le sénateur Tissot – a obtenu gain de cause.
Il s’agit aujourd’hui de répartir cette enveloppe financière au sein des différentes productions et des différents territoires. Nous ne pouvons donc renforcer tel secteur qu’en opérant de facto un transfert au détriment d’un autre. Nous devons être conscients que chaque « plus » que nous allouons à un budget suppose d’en grever un autre d’un « moins ». L’exercice n’en est évidemment que plus complexe.
Pour conclure, je souhaite insister sur deux derniers points.
En dehors du PSN, nous devons continuer à avancer sur le sujet de la rémunération des agriculteurs dans le cadre de la revue de la loi Égalim. Celle-ci a permis des avancées, mais il faut aller plus loin.
Par ailleurs, je suis intimement convaincu – cette conviction est largement partagée sur les travées de cet hémicycle – qu’il faut absolument aller plus loin dans ce qu’on appelle les « clauses miroirs ». Alors que la transition agroécologique s’accélère au sein du marché commun où l’écorégime devient un standard – et c’est très bien ainsi –, nous devons absolument sortir d’une forme d’hypocrisie et arrêter d’importer des produits qui ne respectent pas les standards imposés par l’Union européenne elle-même.
Cela nécessite un travail à l’échelon européen – je le mènerai dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne – mais aussi à l’échelon international, notamment avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui édicte les règles du commerce international. C’est un point absolument essentiel dont je souhaite faire un marqueur fort de mon action.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – M. Pierre Louault applaudit également.

Nous allons maintenant procéder au débat interactif.
Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes au maximum pour présenter sa question, avec une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente.
Dans le cas où l’auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à la condition que le temps initial de deux minutes n’ait pas été dépassé.
Dans le débat interactif, la parole est à M. Henri Cabanel.

Monsieur le ministre, après la gelée noire subie dans la nuit du 8 au 9 avril par un grand nombre d’exploitations en France et compte tenu de mes travaux depuis 2016 sur ce sujet, je n’aborderai qu’un seul thème : celui de l’assurance récolte.
La gestion des risques – nous en sommes désormais tous convaincus – est centrale pour l’avenir de notre agriculture. En France, les filières se sont engagées dans des modes de production durables. L’Europe, via la future PAC, a conditionné les aides à des objectifs de verdissement. Ces mutations répondent à la demande sociétale et aux enjeux de santé publique et de protection de l’environnement.
Mais encore faut-il accompagner notre agriculture dans sa résilience. Celle-ci doit s’appuyer sur plusieurs solutions : l’épargne de précaution, les mesures de stockage, les outils de stabilisation des revenus et l’assurance récolte.
Cette dernière ne correspond pas aux besoins de nos agriculteurs puisque, malgré la mise en place du contrat socle, seuls 30 % sont assurés. De nombreuses préconisations ont été formulées par la profession pour qu’un maximum d’agriculteurs s’engagent. Les réponses restent toujours en suspens, en raison – nous en avons conscience – des enjeux financiers que constituent la réforme du calcul de la moyenne olympique, l’abaissement du seuil de déclenchement de 30 à 20 % du potentiel de recueil et l’augmentation des aides de 65 à 70 % pour la souscription de contrats.
Le 24 juin 2020, lors du débat sur la proposition de résolution visant à encourager le développement de l’assurance récolte déposée par le groupe RDSE, M. Marc Fesneau avait évalué le surcoût important que cela entraînerait, amputant de près de 2 milliards d’euros le budget du second pilier. Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à défendre ces objectifs dans la future PAC ?
Monsieur le sénateur Cabanel, le sujet de l’assurance récolte est absolument essentiel.
Aujourd’hui, le budget de l’assurance récolte au sein du second pilier est d’environ 150 millions d’euros. Or les risques s’accumulant, nous savons que nous devons revoir nos projections tendancielles.
Il est vrai que l’on ne tire pas le règlement Omnibus au maximum de ses possibilités. Comme vous l’avez indiqué, nous pourrions abaisser de 30 à 20 % le montant de la franchise et augmenter les subventions de 65 à 70 %, mais financer ces mesures au moyen de la PAC impliquerait de faire d’autres choix.
En effet, je rappelle que le second pilier finance l’ICHN, les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC), le bio et l’assurance récolte. Nous devons choisir : effectuer un transfert soit du premier pilier au bénéfice du second – mais alors, quid de l’impact compétitif sur les revenus ? –, soit au sein du second pilier. C’est une sacrée question, d’autant que les enjeux financiers sont très importants.
Pour avoir beaucoup travaillé avec mes équipes sur le sujet, j’estime qu’il faut non pas revoir les critères mais refonder complètement le modèle. Très peu de pays ont réussi à le faire. L’Espagne, qui a été confrontée il y a plusieurs décennies aux mêmes questions, est un exemple qui doit nous inspirer. Ce pays a mis plusieurs années à élaborer un système qui repose sur plusieurs dispositifs, notamment des subventions sur les primes, des pools de coassurance et des réassurances.
D’autres systèmes existent, que nous étudions également. Quoi qu’il en soit, nous devons repenser complètement le modèle pour créer une nouvelle architecture. Nous y travaillons actuellement.
Par ailleurs, s’agissant du financement, j’ai la conviction que le monde agricole ne peut pas financer seul les aléas liés au changement climatique. Or un financement de ces aléas par la PAC reviendrait à cela.
Si nous souhaitons pérenniser le dispositif, nous devons assumer qu’une forme de solidarité nationale accompagne le monde agricole. À défaut d’une telle solution, je vous renvoie à la difficulté des choix que j’ai résumés au début de la réponse à votre question.

Je suis bien conscient des enjeux financiers que vous avez évoqués monsieur le ministre. Permettez-moi toutefois de souligner l’importance du plan que vous avez annoncé dans l’Hérault, ce dont je vous remercie. D’un montant de plus de 1 milliard d’euros, celui-ci permettra d’apporter une réponse à cette gelée noire, exceptionnelle tant par son intensité que par son ampleur.
Pour autant, les professionnels attendent beaucoup des arbitrages à venir. Je comprends la difficulté de faire des choix avec des budgets contraints. Vous appelez de vos vœux une solidarité élargie au-delà du monde agricole. Cela me rassure car, comme chacun dans cet hémicycle, vous savez qu’au vu des circonstances, notre agriculture a plus que jamais besoin d’acquérir une forme de résilience. Nous attendons fermement vos propositions en ce sens.

Monsieur le ministre, le traité de Lisbonne spécifie que la PAC a pour but « de stabiliser les marchés » et surtout d’assurer « un niveau de vie équitable à la population agricole ». Force est de constater que depuis le découplage des aides, ces objectifs ne sont plus remplis.
Or la PAC demeure un levier d’accompagnement majeur de l’agriculture. Je conçois que l’exercice soit complexe, et que les aides du premier pilier soit structurantes pour l’économie d’un grand nombre d’exploitations agricoles. Permettez-moi toutefois de citer deux chiffres : un maraîcher qui exploite un hectare et emploie cinq salariés perçoit 5 000 euros de PAC quand un céréalier qui exploite 5 000 hectares percevra 1 million d’euros.
Mme Sophie Primas le conteste.

Bref, nous avons besoin d’une politique plus redistributive et plus juste, car une distribution plus équitable permettrait aussi une meilleure rémunération, par exemple des 52 premiers hectares. Cela est également vrai pour le second pilier.
Par ailleurs, monsieur le ministre, il ne serait pas anormal que vous puissiez vous appuyer sur les collectivités territoriales, singulièrement les régions, pour définir la mise en œuvre d’un certain nombre de dispositions spécifiques du second pilier.
Il nous faut donc obtenir de l’Europe l’application du principe de subsidiarité et la possibilité pour la France de moduler et de plafonner elle-même ses aides.
Applaudissements sur les travées des groupes CRCE et SER.
Monsieur le sénateur, vous dites qu’il faut effectuer davantage de paiements redistributifs, en particulier au bénéfice des exploitations de moins de 52 hectares. Je le conçois, et cela d’autant plus si l’on considère le territoire de vos origines. Mais je laisse M. le sénateur Redon-Sarrazy vous indiquer ce que les agriculteurs de son propre territoire en penseraient ! Pourtant, vos valeurs ne sont pas si éloignées…
Dans les zones intermédiaires, le paiement redistributif a une conséquence très importante sur le revenu des agriculteurs. Toute la difficulté est là : ce qui est probablement favorable aux agriculteurs de votre territoire ne l’est pas du tout pour des agriculteurs d’autres territoires, notamment dans les zones intermédiaires.
Dans ces zones, l’une des conséquences de la mise en place du paiement redistributif est que le niveau de rémunération de base, les fameux droits à paiement de base (DPB), est aujourd’hui inférieur à la moyenne nationale et très inférieur aux moyennes constatées dans le reste de l’Europe. Ceux qui souhaitent passer de 10 à 20 % de paiements redistributifs ont-ils évalué les conséquences d’une telle augmentation dans les zones intermédiaires ?
Je suis opposé à toute approche qui ne tiendrait compte que de la taille des exploitations. Dans les zones intermédiaires – M. Redon-Sarrazy vous le dirait mieux que moi –, les agriculteurs ont de grandes exploitations non parce qu’ils sont riches, mais parce que la rentabilité d’un hectare cultivé est si faible qu’il faut beaucoup d’hectares pour pouvoir en vivre. Telle est la réalité !
C’est pourquoi l’accentuation du paiement redistributif aurait des conséquences dramatiques dans les zones intermédiaires. Nous devons donc trouver le juste équilibre. C’est une tâche difficile, car certains jugent toujours que ce n’est pas assez quand d’autres estiment que cela va beaucoup trop loin.

J’entends vos arguments, monsieur le ministre, mais il faut tout simplement être plus juste. J’observe que l’Allemagne infléchit ses politiques dans un sens plus redistributif…
L’Allemagne est beaucoup moins redistributive que nous !

M. Gérard Lahellec. Or il arrive que l’on fasse référence à la politique allemande, y compris dans cette enceinte. Il s’agit d’une mesure de justice qui, à mon sens, pourrait être mieux définie et relever de la compétence et des choix politiques de l’État français.
Mme Cathy Apourceau-Poly approuve.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Je souhaite tout d’abord saluer le travail du ministre de l’agriculture qui a engagé une forte concertation et approfondi de multiples hypothèses.
Une enveloppe a effectivement été définie pour conduire la PAC. Il faut continuer à se battre pour infléchir la politique européenne afin que les États membres obéissent aux mêmes règles et disposent de marges de manœuvre locales beaucoup plus réduites, et que soit limitée la concurrence entre pays. En effet, l’agriculture française est soumise à des règles de concurrence qu’elle a du mal à tenir.
J’ai eu l’occasion de vous parler des zones intermédiaires, monsieur le ministre, un sujet dont vous vous êtes saisi. Il faut comprendre que le schéma est un peu faussé car dans ces zones se trouvent souvent des vignobles, par exemple, qui contribuent à augmenter le revenu global des agriculteurs.
La situation de l’agriculture est catastrophique. Il n’y a plus ni revenus ni jeunes qui veulent s’installer. À défaut d’autre solution, la seule issue est malheureusement l’agrandissement des exploitations. Nous devons d’urgence trouver des solutions pour les zones intermédiaires qui, bien souvent, sont des zones de polyculture, en partie d’élevage bovin et en partie de cultures céréalières. La suppression des zones défavorisées a été une catastrophe pour l’élevage.
Par ailleurs, monsieur le ministre, il faut se battre pour ne pas faire de surtransposition dans le droit français : il faut des règles européennes, et rien que ces règles.
Enfin, même si les calculs sont forcément un peu compliqués, je tiens à insister sur la nécessité de faire simple pour éviter tous les conflits de contrôle, qu’ils concernent les agriculteurs ou même la France. Je rappelle en effet que notre pays a déjà été condamné parce que la lisibilité n’était pas suffisante et que les règles n’étaient pas forcément respectées.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.
Je vous remercie de vos propos, monsieur le sénateur Louault. Comme je l’ai indiqué dès que j’ai été nommé à ce poste, les zones intermédiaires constituent à mes yeux une priorité. Les deux dernières politiques agricoles communes ont très largement affecté les revenus des 80 000 à 90 000 agriculteurs qui sont installés dans ces zones.
Nous partons toutefois d’une situation donnée. Les agriculteurs installés dans les zones intermédiaires demandent à juste titre une augmentation de leur rémunération. Mais en l’état actuel des choses, cela suppose d’opérer des transferts massifs au sein du premier pilier. Or les seuls transferts possibles sont entre les aides couplées et le paiement de base. Je me tourne donc vers les autres représentants du secteur de l’élevage, avec lesquels – je l’imagine – vous aurez un débat nourri, monsieur le sénateur…
Il nous faut trouver à nouveau un équilibre tout en ayant deux points en tête.
Premier point : le fameux écorégime que j’évoquais a une vertu très intéressante pour les zones intermédiaires puisqu’il consiste à répartir de 20 à 30 % – cette proportion n’est pas encore arrêtée – du premier pilier à l’ensemble des agriculteurs dès lors qu’ils atteignent les conditions de l’écorégime. Cette répartition est calculée sur la base d’un taux moyen à l’échelle nationale du paiement de base. Or les zones intermédiaires se situant en moyenne très largement en dessous du taux moyen national, ce système de convergence totale permettra de redonner un peu d’air auxdites zones.
Deuxième point : nous ne sommes pas parvenus, depuis 2012, à affecter suffisamment de crédits des MAE aux zones intermédiaires. Il s’agit de l’un des grands défis de cette nouvelle PAC.
Je pourrais évoquer d’autres sujets, mais le temps qui m’est imparti est épuisé. Quoi qu’il en soit, soyez assuré, monsieur le sénateur, que je suis très attentif à ce sujet.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Imputé sur le second pilier de la PAC, l’ICHN s’élève à environ 1, 1 milliard d’euros par an et bénéficie à un tiers des exploitations françaises.
Monsieur le ministre, vous vous êtes engagé publiquement à plusieurs reprises en faveur du maintien en l’état de l’enveloppe consacrée à l’ICHN dans la nouvelle PAC. Malgré cela, le taux de cofinancement européen proposé par le Conseil passe de 75 % à 65 %. Si ce taux était définitivement retenu et si la France décidait de maintenir l’enveloppe actuelle, elle devrait financer sur son budget 10 % supplémentaires, soit environ 108 millions d’euros.
Dans le contexte de la négociation qui va s’ouvrir demain à enveloppe fermée, quels arbitrages comptez-vous faire pour financer ces 108 millions d’euros, si bien entendu vous comptez le faire ?
Le second volet est lié aux conséquences de la sortie du zonage des zones défavorisées dites « simples ».
Ce zonage a fait l’objet d’une révision en 2018. Celle-ci a eu pour effet d’exclure 1 350 communes de la cartographie, laquelle fut présenté à la Commission européenne par vos prédécesseurs dans des conditions plus que déplorables, au vu desquelles ils s’étaient fermement engagés à la tribune du Sénat à accompagner par de multiples mesures les exploitations qui sortaient du dispositif, pour éviter l’effet ciseaux.
Qu’en est-il ? Dans l’Aude, rien, nada : l’ICHN a bel et bien disparu, mais aucune des promesses faites n’a été tenue. Quel dispositif avez-vous prévu pour aider, soutenir ces agriculteurs et ces éleveurs qui ne demandent qu’à vivre dignement de leurs exploitations ?
Applaudissements sur les travées du groupe SER, ainsi que sur des travées du groupe CRCE.
Madame la sénatrice Jourda, permettez-moi d’évoquer deux points très importants.
L’ICHN est financée par le second pilier de la PAC, dont le budget est arrêté à l’échelon européen et éventuellement complété par des transferts du premier pilier.
Or tout transfert du premier pilier vers le second entraîne une diminution de la rémunération de nos agriculteurs. Dans la mesure où je prône une PAC compétitive, vous comprendrez que je n’y sois guère favorable.
Les quatre principaux enjeux du second pilier sont : le financement des MAEC, levier d’accompagnement spécifique dont il convient de maintenir le niveau ; le maintien du niveau de l’ICHN ; l’assurance récolte ; le bio.
Si nous voulons maintenir les ambitions du second pilier de la PAC, il faut que l’État apporte non pas seulement 108 millions, mais 140 millions d’euros du budget national. La négociation de cette PAC nous conduit donc à faire des choix budgétaires. Telles sont les discussions que nous avons au sein du Gouvernement, au cours desquelles, pour ma part, je défends le maintien d’une grande ambition.
À défaut de cet effort supplémentaire de l’État à hauteur de 140 millions d’euros par an, soit 700 millions d’euros sur la période, nous ne pourrons pas maintenir nos objectifs en termes de bio, de maintien des MAEC et de l’ICHN, de tendanciel de l’assurance récolte. C’est dire l’importance de notre tâche.

J’entends vos propos, monsieur le ministre. Cependant – je vous l’avais indiqué lorsque vous étiez venu dans l’Aude –, quand on fait des effets d’annonce en promettant à nos agriculteurs de les accompagner en cas de coup rude, comme la sortie d’une cartographie ou lorsqu’ils font face à des risques naturels, il faut respecter la parole donnée.
C’est pourquoi j’attends que des accompagnements soient au rendez-vous pour atténuer le drame que traversent ces éleveurs et agriculteurs, en particulier les jeunes qui avaient investi dans des secteurs défavorisés et qui ne peuvent plus vivre.
Applaudissements sur des travées du groupe SER.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Depuis sa présentation le 1er juin 2018, le projet de réforme de la Commission européenne pour la PAC a nourri de difficiles échanges au sein du Conseil et du Parlement européens.
Le Sénat a effectué pour sa part un important travail de réflexion et de proposition. Ainsi, trois propositions de résolution européenne ont été adoptées en 2017, 2018 et 2019, les deux dernières en séance publique et à l’unanimité.
Au-delà de la question de la stabilité des moyens budgétaires, nous nous sommes vivement inquiétés de l’architecture générale du projet de la Commission européenne, notamment de l’impact du nouveau mode décentralisé de mise en œuvre de la PAC.
Décentraliser la PAC, c’est prendre le risque de distorsions de concurrence supplémentaires au sein du marché unique. Le Sénat y voit un réel danger de remplacement de la PAC par vingt-sept politiques agricoles nationales, désormais de moins en moins compatibles entre elles. En dernière analyse, nous courons le risque d’une déconstruction de la PAC.
Or, sur tous ces points essentiels, la position de la Commission européenne n’a pour ainsi dire jamais changé d’un iota. Depuis 2017, vos prédécesseurs, monsieur le ministre, n’ont pas agi à temps et efficacement pour faire bouger les lignes. Cette réforme ne correspondra donc guère aux vœux du Sénat ni aux besoins de nos agriculteurs dont l’inquiétude va croissant.
Reste désormais à clarifier un problème de fond : celui de l’articulation entre les modalités détaillées de la future PAC et la transcription juridique des objectifs affichés dans la transition verte.
J’en viens ainsi à mes deux questions, qui sont liées : qu’en est-il de la publication par la Commission européenne de ses études d’impact sur la stratégie concernant la biodiversité et sur celle nommée « de la ferme à la table » ? Comment, selon vous, articuler la réforme de la PAC et le Green Deal si l’on veut éviter un recul drastique de la production agricole européenne à l’horizon 2030, recul que le ministère américain de l’agriculture évalue pour sa part à 12 % ? Autre question de taille : face à une perspective de décroissance d’une telle ampleur de nos productions nationales, que deviendrait l’objectif de souveraineté alimentaire ?
Monsieur le sénateur Rapin, je vous trouve sévère dans votre analyse de la régionalisation de la PAC.
Premièrement, le cadre politique de la PAC a été défini par les ministres en octobre de manière très précise. Par exemple, ce cadre impose l’écorégime à tous les États membres et empêche les effets d’éviction ou les dérogations.
Deuxièmement, si je n’ai pas encore obtenu gain de cause, sachez que je me bats pour que les fameux PSN soient non pas simplement signés dans des bureaux entre les États membres et la Commission, mais présentés au niveau du Conseil des ministres. En effet, j’estime que le plan stratégique national est un document politique dont tous les ministres des États membres doivent avoir connaissance et pouvoir discuter.
J’en viens à vos questions. Nous ne disposons toujours pas d’étude d’impact concernant la stratégie Farm to Fork. D’autres ministres européens en demandent sans relâche, comme moi, la réalisation.
Cette situation est d’autant plus problématique, notamment en termes de pur signal démocratique, que la seule étude d’impact dont nous disposons aujourd’hui concernant cette stratégie est américaine. Ce n’est pas acceptable, mais soyez assuré, monsieur le sénateur, qu’avec plusieurs ministres d’autres États membres, nous suivons ce dossier de près.
Cela étant dit, il ne faut pas confondre la stratégie Farm to Fork et la PAC. La première fixe des ambitions dont les moyens sont fournis par la seconde. Cela minimise d’ailleurs les conséquences du point précédent.
Enfin, je fais partie de ceux qui considèrent que la PAC est un des éléments du Green Deal. Mais tous les efforts que nous faisons dans le cadre de la PAC ne serviront à rien si la filière commerce, le fameux trade, ne suit pas. C’est pourquoi je me bats avec mes collègues, notamment Franck Riester et Clément Beaune, pour que l’écorégime que nous établissons pour la filière agricole soit transposé dans la filière commerce. En effet, nous ne pourrons lutter contre les distorsions de concurrence à l’échelle internationale sans nous assurer du respect de ce socle par les accords conclus à l’avenir.

Monsieur le ministre, le violent épisode de gel qui a frappé nos agriculteurs vient alourdir des années compliquées. Je tiens de nouveau à leur apporter tout mon soutien et à saluer leur courage. En Aveyron, l’arboriculture a été touchée.
Les annonces sont plutôt rassurantes, notamment la création d’un fonds de solidarité exceptionnelle doté d’un milliard d’euros, comme l’a indiqué précédemment mon collègue Henri Cabanel.
Les enjeux restent toutefois nombreux : le changement climatique, la pandémie de covid-19, les défis de souveraineté et d’alimentation… L’agriculture est, depuis toujours, synonyme d’adaptation.
Je voudrais faire remonter les craintes de nos agriculteurs de zones très rurales au sujet de la future PAC. Les exploitations y sont de taille moyenne, voire petite, avec un modèle souvent orienté vers l’élevage – l’Aveyron est le premier département ovin de France, et l’un des tout premiers pour l’élevage bovin. Il s’agit d’une agriculture exigeante, qui demande un travail 365 jours par an !
Les aides directes du premier pilier de la PAC sont d’une importance capitale dans ces territoires.
Bien sûr, des ajustements sont nécessaires : nous comprenons les appels à l’évolution du système assurantiel du second pilier, mais nous redoutons des transferts depuis le premier pilier, qui auraient pour conséquence une diminution des aides impactant de plein fouet nos petites fermes. Une nouvelle étape dans l’exode rural que nous subissons déjà pourrait alors être franchie, malgré les efforts considérables de nos maires ruraux.
Monsieur le ministre, alors que vous planchez sur le plan stratégique national, quelles sont vos pistes concernant les vases communicants, et plus précisément l’évolution du taux de transfert du premier vers le second pilier dans la future PAC ?
M. Pierre Louault applaudit.
Monsieur le sénateur, pour moi, il y a quatre maîtres-mots dans la nouvelle politique agricole commune.
Nous voulons une PAC compétitive, c’est-à-dire de production, une PAC qui tienne compte des spécificités des territoires, une PAC qui accompagne – le mot est très important – les transitions, notamment agroécologiques, enfin une PAC qui nous permette de regagner en souveraineté alimentaire.
Il ne sera possible d’atteindre ces quatre objectifs que si nous arrivons à stabiliser le premier pilier. Il a beaucoup été question des rémunérations lors des premières prises de parole. Mais si l’on veut aussi réussir l’accompagnement au titre du second pilier, l’État devra abonder ce dernier à hauteur de 140 millions d’euros par an pendant cinq ans, soit 700 millions d’euros.
Les discussions et les négociations qui sont en cours avec l’ensemble des parties prenantes montrent l’ampleur du défi, sans parler de la refonte de l’assurance récolte, que j’évoquais en réponse à M. le sénateur Cabanel. Si ce sujet est intrinsèquement lié à la PAC, car il relève du règlement Omnibus, j’ai aussi la conviction qu’il ne peut pas être traité exclusivement au sein de la politique agricole commune, sauf à opérer un transfert massif du premier pilier vers le second ou à réduire significativement l’ICHN, les MAEC ou le programme Ambition Bio, bref, le deuxième pilier dans son ensemble.
S’agissant de l’assurance récolte, il me semble que le monde agricole ne peut pas, seul, sur ses propres budgets ou ceux de la PAC, faire face aux aléas du changement climatique. D’où ma proposition de refonte du système.

Monsieur le ministre, en termes d’aménagement du territoire, nous avons la chance en France d’avoir un maillage extrêmement dense, avec des fermes et des agriculteurs partout sur notre sol.
Mais certains agriculteurs gagnent très mal leur vie, nombre d’entre eux touchant moins de 1 000 euros par mois. Je vous demande, à travers la PAC, d’être attentif à cette situation.
Enfin, permettez-moi de nouveau de vous inviter en Aveyron, monsieur le ministre. Nous vous recevrons de façon fort amicale et exprimerons ici et là nos problématiques.
Applaudissements sur les travées du groupe GEST.

Elle était belle, l’ambition de la France, impulsée par Stéphane Le Foll, d’atteindre 15 % de la surface agricole utile (SAU) en bio en 2022.
Or, vous l’avez annoncé vous-même il y a une dizaine de jours, monsieur le ministre, la France n’atteindra pas cet objectif de développement, loin de là. Il en ira très vraisemblablement de même de l’objectif d’intégration de 20 % de produits bio dans la restauration collective, voté dans la loi Égalim.

Pourtant, malgré ces échecs, le Gouvernement continue de baisser l’accompagnement financier à cette agriculture. Après la fin du financement national de l’aide au maintien, c’est aujourd’hui la réforme de la PAC qui acte un nouveau recul.
Alors que la performance économique, sociale et environnementale de l’agriculture biologique est établie, alors que la demande des consommateurs ne cesse de croître, alors que l’urgence écologique est toujours plus prégnante, les premières propositions du PSN montrent que la bio sera la grande perdante de cette réforme.
D’après les chiffres qui sont sur la table des négociations, un agriculteur bio ne serait rémunéré qu’à hauteur de 70 euros d’aides environnementales par hectare dans la prochaine programmation, contre 202 euros dans la PAC actuelle, soit une baisse de 66 %.
Monsieur le ministre, comment expliquez-vous une telle diminution du soutien au maintien en agriculture biologique, alors même que la rémunération des services environnementaux faisait partie des engagements présidentiels ?
Il est certes essentiel d’accompagner tous les agriculteurs dans la transition, et pas seulement ceux qui sont en bio. Pour autant, monsieur le ministre, comment justifier ce coup de frein ? Allez-vous proposer un scénario alternatif permettant d’atteindre les objectifs de la France et de rémunérer ce système à la hauteur de ses performances économiques et écologiques conjuguées ?
Applaudissements sur les travées du groupe GEST.
Monsieur le sénateur Labbé, tout d’abord, notre objectif était effectivement 15 % de bio en 2022. On finira vraisemblablement à 12, 5 % ou 13 %. Je suis le premier à dire que ce n’est pas assez, mais c’est tout de même une augmentation de 50 % par rapport à 2017. Sans se contenter de ce résultat, on ne peut pas non plus critiquer à l’excès – ce n’est pas ce que vous faites, mais d’autres n’hésitent pas. Notre gouvernement aura augmenté de 50 % la SAU en bio dans notre pays en l’espace de cinq ans. Nous n’avons pas à rougir de ce résultat.
Quant aux écoles, il ne vous aura pas échappé que ce n’est pas moi qui passe les commandes ! Mais je sais que vous vous engagez aussi au niveau local.
Enfin, sur la PAC, j’ai pris connaissance avec grand étonnement de ce chiffre avancé d’une diminution de 66 %. Il y a en effet un différend sur la question de l’aide au maintien – nous en avons souvent parlé dans cet hémicycle. Faut-il plutôt porter nos efforts sur l’aide au maintien ou sur d’autres dispositifs ?
Mais les scenarii mis sur la table des négociations prévoient que l’enveloppe de financement du bio passerait de 250 millions à 340 millions d’euros. Cela, personne ne le dit ! On préfère clamer que le Gouvernement propose une diminution de 66 % des aides. Certains savent mieux que d’autres utiliser ce genre de chiffres quelque peu magiques.

Nous sommes d’accord sur les grandes masses, monsieur le ministre, mais vous ne pouvez nier le développement extraordinaire de l’agriculture biologique, lequel doit encore être accéléré.
L’attention au revenu des agriculteurs est louable et nécessaire, mais beaucoup d’agriculteurs restent aussi oubliés de la PAC. Je pense aux petites fermes, aux maraîchers, aux arboriculteurs, aux paysans herboristes, qui sont en marge du système et qui ne sont pas pris en considération, alors qu’ils assurent la résilience, l’emploi et le respect de l’environnement.

Monsieur le ministre, pour notre pays, qui occupe la première place de l’Union européenne en matière agricole, l’agriculture est un secteur stratégique, qui se situe aujourd’hui au carrefour de nombreux enjeux. En plus de devoir assurer notre souveraineté alimentaire, il doit répondre à une exigence croissante de qualité.
Il s’agit aussi pour la profession de s’orienter vers une agriculture plus durable, respectueuse de l’environnement et soucieuse du climat.
Répondre à ces enjeux nécessite de la part des agriculteurs qu’ils réalisent de gros efforts, alors même qu’ils sont déjà soumis à de nombreuses contraintes telles que la multiplication des aléas climatiques ou encore la volatilité des prix. Dans ce contexte, les négociations en cours concernant la PAC constituent un enjeu de taille pour notre pays et ses agriculteurs.
À ce titre, nous savons tous que vous n’avez pas ménagé vos efforts pour placer la France au cœur des enjeux européens, ce qui a permis à la PAC de demeurer le premier budget européen, et à notre pays de conserver l’enveloppe qui lui était allouée. Ces aides de la PAC, sans lesquelles beaucoup d’agriculteurs auraient des revenus négatifs, doivent les encourager sur le chemin de ces mutations.
Les contours encore flous de cette nouvelle PAC suscitent toutefois des inquiétudes chez les agriculteurs. Ils craignent notamment qu’une mise en œuvre différenciée des objectifs de la politique européenne au travers des PSN n’aboutisse à des situations de distorsion de concurrence entre États membres.
Ils se soucient également des critères d’accès aux écorégimes, qui doivent être aussi inclusifs et incitatifs que possible.
Comment entendez-vous répondre à ces inquiétudes ? Plus largement, comment préserver la compétitivité et la rentabilité de notre agriculture tout en encourageant sa mutation vers un modèle plus durable et plus raisonné ?
Madame la sénatrice, tout d’abord, nous nous sommes beaucoup battus sur le caractère obligatoire de l’écorégime pour tous les États membres. Cette obligation est essentielle à mes yeux, car elle concourra véritablement à stopper la spirale de concurrence déloyale au sein du marché commun européen.
Rien n’est plus décourageant et désespérant que de voir deux produits issus de deux lieux de production différents au sein d’un même marché commun répondre à des normes de production différentes. L’écorégime va enfin permettre d’inverser cette tendance et de rétablir une concurrence loyale au sein du marché commun, puisqu’il s’imposera à tous les États membres.
J’insiste aussi sur le fait que cet écorégime, élément de transition agroécologique de la nouvelle PAC, doit être inclusif et permettre l’accompagnement des agriculteurs. La transition ne se fera pas sans les agriculteurs, et le dispositif doit être accessible. Il nous faut trouver les voies et moyens de parvenir au bon équilibre.

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre. Venant d’un territoire frontalier, l’Alsace, je tenais encore à insister sur les inquiétudes en termes de concurrence que pourraient engendrer les mesures de la future PAC.
Le risque de concurrence déloyale existe à l’intérieur des frontières de l’Union européenne, mais aussi à ses portes.
Aussi, nous comptons sur vous, avec l’Europe, pour veiller à ce que les importations extraeuropéennes répondent à des exigences qui soient au moins équivalentes à celles que nous imposons à nos agriculteurs. Il y va de la survie de notre agriculture.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Ils s’appellent Pascal, Sébastien, Joël, Claude, Françoise, Muriel. Ils sont agricultrices et agriculteurs de nos zones de montagne du sud du Massif central et lancent aujourd’hui un véritable cri d’angoisse et de désespérance face à la situation sans précédent qu’ils vivent.
Ils étaient 105 000 agriculteurs en zone de montagne en 1995, puis 75 000 en 2005 et moins de 70 000 aujourd’hui. Cette situation de déprise est difficile et injuste, car l’agriculture de montagne et d’élevage est plus respectueuse de l’environnement : grâce à une moindre densité, elle produit souvent des produits de qualité.
Pourtant, lundi dernier, au marché de Valence-d’Albigeois, les veaux se sont vendus au même prix qu’il y a trente ans. C’est inacceptable ! Face à cette situation, les attentes de nos agriculteurs et de nos éleveurs sont particulièrement fortes.
Il faut maintenir l’ICHN et prévoir des mesures d’accompagnement permettant de favoriser l’installation des jeunes agriculteurs et de stopper cette véritable hémorragie.
Pouvez-vous nous rassurer, monsieur le ministre, sur les perspectives à moyen terme de cette agriculture ?
Applaudissements sur les travées du groupe UC.
Je vous remercie, monsieur le sénateur, pour l’hommage que vous avez rendu à nos éleveurs : ils contribuent à la souveraineté alimentaire de notre pays et forgent l’identité de beaucoup de nos territoires qui, additionnés, dessinent la physionomie de notre beau pays.
S’agissant de la rémunération, je ne reviendrai pas sur l’ICHN. Gardons juste en mémoire que, pour maintenir l’ensemble des éléments du second pilier, il faudrait que le budget national complète la solidarité européenne au titre de la PAC à hauteur de 140 millions d’euros par an pendant cinq ans, soit 700 millions d’euros. Maintenir ainsi l’intégralité du second pilier, qui se compose de l’ICHN, des MAEC, des aides au bio et de l’assurance récolte, témoignerait du choix stratégique de l’État d’accompagner fortement notre agriculture.
Sur les aides couplées, beaucoup a été dit. Ma conviction, assez largement partagée, est qu’il est pertinent de passer au modèle de l’unité de gros bétail (UGB). Toutefois, le diable se cache dans les détails, et il reste encore beaucoup de paramètres à définir. D’importants travaux sont en cours à ce sujet.
Le troisième élément concerne bien évidemment l’installation des jeunes agriculteurs. Celle-ci peut relever du premier ou du second pilier, et, dans ce dernier cas, elle sera désormais de la compétence des régions. Il est important que vous l’ayez en tête, car cela fera aussi partie des discussions à mener avec les régions sur la dotation jeune agriculteur (DJA).
Enfin, la question de la rémunération, notamment sur les marchés, relève de tous les travaux que nous avons entrepris en remettant sur le métier la loi Égalim, avec notamment cette fameuse proposition de loi Besson-Moreau, dite Égalim 2, dont nous aurons, je l’espère, l’occasion de discuter très rapidement au Sénat.
La loi Égalim était une avancée, mais la loi Égalim 2 doit aller au bout de la logique pour améliorer, enfin, la rétribution dans les cours de ferme.

Vous nous communiquez un élément particulièrement important, monsieur le ministre. Sachez toutefois que ce cri du cœur des agriculteurs est vraiment un cri de désespérance.
Tout se tient en effet dans nos secteurs de montagne et de ruralité. Lorsqu’il n’y a plus ni élevage ni agriculture, le reste s’effondre : emplois induits, services publics…
Or, pour des raisons physiques, nous n’avons à ce jour pas d’autres choix que l’élevage dans nos secteurs de montagne. Il est donc essentiel que nous soyons soutenus et appuyés dans le cadre d’une juste compensation des handicaps naturels.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Monsieur le ministre, vous nous disiez, ici même, le 7 avril dernier, que le soutien à une agriculture de territoire de montagne avec une meilleure prise en compte des spécificités et le maintien de l’ICHN était l’une des priorités de la nouvelle PAC.
Élu d’un territoire de montagne, je ne peux que souscrire à cette volonté, qui permet de maintenir un maillage d’actifs agricoles et une présence humaine dans ces territoires. C’est le plus sûr moyen d’empêcher l’abandon des terres et leurs conséquences négatives en termes de paysage, de biodiversité et de développement, notamment touristique.
La PAC 2023-2029 introduira une innovation en termes de gouvernance, à travers les PSN, qui renvoient à chaque État membre le soin de définir les modalités de mise en œuvre de la PAC à l’échelle nationale. Vous aurez donc, monsieur le ministre, à décider du soutien que vous accorderez à l’agriculture de montagne.
Bruxelles a d’ores et déjà annoncé une baisse de 10 % de l’enveloppe pour l’ICHN. L’État français abondera-t-il de 10 % l’enveloppe consacrée à l’ICHN pour compenser la baisse européenne annoncée ? J’ai entendu que vous vous engagiez à hauteur de 140 millions d’euros par an. J’espère que cette promesse sera tenue !
Pouvez-vous aussi nous confirmer que les surcoûts des exploitations de montagne liés aux handicaps naturels continueront d’être compensés au moins à leur niveau actuel, au travers d’une ICHN forte qui ne subira pas de baisse ? Et qu’en est-il de possibles extensions à certaines productions végétales ?
Enfin, monsieur le ministre, si nous appelons de nos vœux une meilleure gestion et prise en charge des risques climatiques, il ne faudrait pas non plus que de nouvelles mesures viennent diminuer les aides existantes.
Monsieur le sénateur, j’ai déjà eu l’occasion de répondre à plusieurs reprises sur le volet ICHN. Aujourd’hui, nous sommes en train de finaliser la recherche du meilleur équilibre.
Il me semble que nous pouvons collectivement nous satisfaire de la négociation budgétaire : c’est véritablement grâce à la France, et singulièrement au Président de la République, que nous avons réussi à maintenir des budgets conséquents.
Mais, encore une fois, si nous voulons maintenir toutes les ambitions du second pilier, il faut l’abonder par des crédits nationaux à hauteur de 140 millions d’euros par an. Sauf à opérer des transferts du premier vers le second pilier – mais cela aurait alors des conséquences très importantes sur un grand nombre de cultures présentes sur le territoire représenté par votre voisin… §–, cet abondement est nécessaire. Nous sommes en train de discuter de ces différents éléments, mais ma vision est très claire, et je me battrai pour la faire prévaloir : il s’agit d’allier une PAC à la fois compétitive, de production, à une PAC qui prenne aussi en compte les spécificités des territoires.
Enfin, pour reprendre les propos de certains de vos collègues, il ne me semble pas que le problème réside vraiment dans une opposition entre l’assurance récolte et les normes.
Mettons-nous à la place d’un jeune agriculteur. Comment pourra-t-il s’installer en ayant cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête, à savoir le risque de perdre sa récolte une année sur deux, comme cela a malheureusement été le cas dernièrement avec le gel dans le territoire que vous représentez ? Si l’on ne prévoit pas de filet de sécurité, il sera très compliqué de convaincre la jeune génération de s’installer, alors que 50 % des agriculteurs vont partir à la retraite dans les cinq à sept prochaines années.
Réussir à refonder le modèle de l’assurance récolte, c’est donc aussi une question de souveraineté. C’est un sacré chantier, mais on s’y attelle depuis des mois et j’espère bien le faire aboutir.

M. Jean-Jacques Michau. Ne sacrifiez pas l’agriculture de montagne, monsieur le ministre !
Applaudissements sur les travées du groupe SER.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le ministre, aux yeux des Français et des principaux concernés eux-mêmes, les agriculteurs, la PAC reste complexe, mal comprise. Pourtant, chacun s’accorde à dire combien elle est nécessaire pour répondre aux enjeux complémentaires et parfois contradictoires qui permettent d’assurer notre sécurité alimentaire, tout en renforçant les actions favorables à l’environnement mais aussi au tissu socioéconomique des zones rurales.
À cet égard, une évidence se fait jour : la France doit effectuer des propositions qui vont dans le sens de la simplification, en rendant la PAC plus accessible et plus lisible. Dans cette perspective, elle se doit de construire l’architecture des PSN autour de celui qui fait l’agriculture : l’agriculteur. Ce dernier doit être au centre de nos préoccupations pour redonner du bon sens aux politiques européennes.
L’agriculteur, qu’il soit entrepreneur ou paysan, est en effet un professionnel qui produit, et qui aménage le territoire avec des approches et des pratiques différentes. Il se doit d’être accompagné dans la réalité de son métier pour percevoir une juste rémunération. Il en va de la reconnaissance de la valeur travail comme du nécessaire renouvellement des générations.
Au regard de l’évolution du métier, du revenu, de la main-d’œuvre occupée sur l’exploitation et de l’objet social, au regard de ceux qui exercent non seulement une véritable activité agricole, mais aussi des activités non agricoles en dehors de leur exploitation, au regard des spécificités des surfaces et des territoires – je pense là aux zones de châtaigneraies, de chênaies, ou encore aux zones humides de Camargue, dans le département du Gard, qui sont encore soumises à dérogation –, pourrions-nous définir, afin de le protéger, un statut de l’agriculteur ?
Pouvons-nous compter sur vous, monsieur le ministre, pour porter l’exigence de cette clarification et intégrer cette question dans les prochaines échéances ?
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Madame la sénatrice, vous évoquez un sujet très important, dont la spécificité est double. Ce n’est pas votre cas, mais on a parfois tendance dans les débats à assimiler les actifs et les agriculteurs véritables, alors que ce sont deux sujets très différents.
La question des actifs est un premier sujet au niveau européen. Aujourd’hui, les aides de la PAC sont fondées sur les hectares des exploitations, et non sur le nombre de personnes qui y travaillent. D’ailleurs, un de vos collègues se demandait précédemment s’il ne fallait pas revenir sur un système « à l’actif », plutôt qu’à l’hectare.
Soyons très clairs : si nous faisions cela, la France y perdrait beaucoup. En effet, toutes choses égales par ailleurs, il y a davantage d’actifs dans certains pays de l’Union européenne qu’en France, et des niveaux de salaires qui ne sont pas comparables. Si la répartition des aides se faisait sur le nombre d’actifs, la somme totale dont la France bénéficierait au titre de la PAC serait bien inférieure à celle dont elle dispose aujourd’hui, notamment parce qu’on ne s’est jamais entendu au niveau européen sur la définition de l’actif.
Je comprends que certains veuillent avancer sur ce sujet, mais si c’est pour réduire l’enveloppe globale que la France perçoit de la PAC, personne n’y a intérêt. Nous devons donc avancer au niveau européen sur cette définition de l’actif, en tenant compte des spécificités des uns et des autres.
Le deuxième sujet, porté notamment par les jeunes agriculteurs, concerne l’agriculteur véritable. Je suis prêt à travailler sur cette question, une fois que nous nous serons entendus sur les répartitions, notamment pour éviter les cas que vous soulevez dans votre question, madame la sénatrice. Nous aurons d’ailleurs un peu de temps pour le faire, puisque ce thème n’est pas à proprement parler inclus dans les maquettes financières.

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre et, à l’instar de mon collègue Alain Marc, je vous renouvelle mon invitation à venir déguster les produits locaux de nos agriculteurs gardois !
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les crises sanitaires et les dérèglements climatiques mettent en évidence la nécessité de repenser nos modèles économiques et de développement.
Construire des circuits courts, économes en énergie, de la production à l’assiette du consommateur, élaborer des process de qualité, entretenir et améliorer chaque jour le cadre naturel et environnemental, tels sont aujourd’hui les principaux axes de travail pour tous les États membres de l’Union européenne, à l’heure où nous discutons de la réforme de la politique agricole commune.
Le modèle d’exploitation agricole français s’est construit à partir d’unités de production de taille modeste, souvent familiales et transmises sur plusieurs générations. Alors que beaucoup jugeaient ce modèle dépassé au profit de plus grandes unités, il retrouve sa pertinence dans le cadre de la mutation nécessaire vers un véritable Green Deal.
Pourtant, ce modèle subit une érosion démographique très forte qui menace son existence même. La réforme de la PAC et le plan stratégique national, le PSN, qui l’accompagne nous semblent être l’occasion d’affirmer l’importance de ce modèle économique, qui a montré sa grande résilience. Nous souhaitons aujourd’hui nous assurer, monsieur le ministre, que telle est bien votre ambition.
Dans ce contexte, dans le dédale complexe de la PAC et du futur PSN, comment entendez-vous favoriser concrètement les exploitations petites et moyennes, ainsi que l’emploi en leur sein ?
Par quels mécanismes précis envisagez-vous de privilégier les aides à l’actif – j’ai entendu vos réticences sur ce point –, plutôt que la majoration des aides sur les premiers hectares, qui risque de pénaliser les zones intermédiaires ? Quel équilibre mettre en place pour favoriser les petites exploitations ?
Applaudissements sur les travées du groupe SER.
Madame la sénatrice, vous affirmez que le modèle français est fondé sur des exploitations petites et moyennes. Il est vrai que la taille des exploitations dans notre pays est souvent bien plus petite que chez nos partenaires européens, notamment en ce qui concerne l’élevage, qu’il soit bovin – allaitant ou laitier –, de volailles ou encore de truies. C’est encore plus vrai si nous procédons à des comparaisons internationales plus larges.
Pour autant, la réalité de la ferme France est nettement plus diverse en termes de taille d’exploitation. Nous en avons parlé tout à l’heure, cette diversité tient d’abord à nos territoires, qui sont eux-mêmes très divers : ils sont évidemment très différents, que nous nous situions en zone intermédiaire, en zone de montagne ou encore dans ma belle Normandie, que j’aime tant. C’est ce que l’on appelle le taux de chargement, c’est-à-dire le nombre d’animaux rapporté à la taille de l’exploitation.
Il n’existe donc pas un modèle unique en France, et ce serait une erreur de penser que nous devrions tendre vers un tel schéma. C’est aussi ce qui rend la recherche d’un équilibre si difficile.
En ce qui concerne les paiements redistributifs, je n’ai pas dit que j’y étais opposé ; j’ai simplement constaté que notre système est plus redistributif qu’en Allemagne : j’ai d’ailleurs vérifié ce point depuis nos échanges précédents et je puis vous indiquer que le taux de redistribution est de 10 % en France, contre 7 % en Allemagne.
Faut-il aller plus loin ? À cette question, je réponds que nous devons être prudents, parce que cela impliquerait une réduction significative de revenus pour certains exploitants.
Nous devons aussi trancher une autre question dans le cadre de la politique agricole commune : aujourd’hui, la taille moyenne des exploitations est de 63 hectares, et le paiement redistributif s’applique dans la limite de 52 hectares, ce qui est favorable aux exploitations de petite taille. Modifier ou non ce critère ne revient pas à toucher au taux global des paiements redistributifs, mais il nous faudra prendre une décision.

Monsieur le ministre, je sais que les équilibres sont complexes et que les exploitations agricoles ont des tailles diverses.
Pour autant, nous avons absolument besoin d’une PAC sociale, pour soutenir les femmes et les hommes qui contribuent à nous fournir une alimentation de qualité et pour favoriser l’emploi et la création de valeur ajoutée.
Il faut aussi que la PAC soutienne notre souveraineté alimentaire, offre une plus grande attractivité aux territoires ruraux et permette de lutter contre l’accroissement endémique de la taille des exploitations.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Nadia Sollogoub applaudit également.

M. Fabien Genet . Monsieur le ministre, il y a quelques jours, vous en appeliez dans une tribune à « revenir à l’essentiel ». Naturellement, les conceptions gouvernementales en matière d’essentiel et de non essentiel peuvent parfois nous interpeller…
Sourires.

En tout cas, en matière agricole, l’essentiel est aujourd’hui effectivement en jeu, notamment pour l’élevage bovin allaitant.
« Alors que les agriculteurs ont un genou à terre, nous devons les aider à se relever », écriviez-vous. La question que je souhaite vous poser ce soir est celle que se posent en fait les éleveurs de viande charolaise de mon département de la Saône-et-Loire : la nouvelle version de la politique agricole commune pour la période 2023-2027 va-t-elle les aider à se redresser, ou ne fera-t-elle, au contraire, qu’accentuer les difficultés actuelles, qui peu à peu dissuadent les éleveurs de poursuivre leur exploitation et les jeunes de s’installer ?
Trois ans après la loi Égalim, les éleveurs de bovins ont perdu 30 % de leurs revenus, pour se contenter désormais de moins de 700 euros par mois en moyenne, ces maigres revenus correspondant justement aux aides de la PAC qui leur sont versées… Diminuer ces aides signifierait réduire encore leurs revenus.
C’est cela l’essentiel, monsieur le ministre ! Dans ce contexte, vous engagez-vous à garantir à ces éleveurs, au minimum, le niveau d’aides actuel ? Pouvez-vous nous préciser votre projet de modification des aides couplées pour les bovins allaitants ?
L’aide à l’unité de gros bétail, l’UGB, que vous souhaitez instaurer sera-t-elle la même pour les bovins laitiers et les bovins allaitants ? Quel en sera le montant ? Allez-vous les plafonner à 100 UGB ? En effet, les plafonner, ce serait condamner plusieurs milliers d’exploitations de Bourgogne-Franche-Comté à une chute des aides de 30 % à 50 %.
En cas de baisse importante de ces aides, comment éviterez-vous une décapitalisation violente dans les élevages, avec les conséquences que l’on imagine sur les prix et la filière ?
Ce ne sont pas là, monsieur le ministre, des « carabistouilles », pour reprendre votre expression, mais des questions empreintes d’inquiétude, qui appellent des réponses précises et chiffrées.
Monsieur le sénateur, le département de la Saône-et-Loire, comme d’autres territoires de même nature ayant des zones intermédiaires, a une spécificité : il est plutôt bénéficiaire de la convergence, en particulier en ce qui concerne l’écorégime.
S’il peut être naturel de nourrir des inquiétudes dans le cadre d’une telle réforme, il me semble que tout le monde est convaincu que passer à un système d’UGB est une bonne idée.
Néanmoins, il est vrai que le diable se cache dans les détails et que plusieurs questions se posent. Par exemple, faut-il un UGB commun au secteur laitier et au secteur allaitant ? Cette piste avait été évoquée au début de nos discussions, mais je pense que nous devons mettre en place deux niveaux distincts, parce que les seuils sont très différents, si bien que les transferts seraient trop importants. Si une telle décision était prise, il resterait bien sûr à définir précisément ces deux UGB.
En ce qui concerne les paramètres, ceux-ci sont en fait plusieurs. Vous avez évoqué le plafond de 100 UGB, mais nous avons évalué différentes hypothèses à ce sujet, certaines à 120 UGB et d’autres plus élevées encore. Sur le taux de chargement, nous avons aussi considéré plusieurs hypothèses : 1, 4, 1, 5, 1, 6, etc. Par ailleurs, devons-nous appliquer les mêmes critères à toutes les filières concernées ? Devons-nous mettre en place un dispositif mixte ?
Vous le voyez, bien des questions se posent. Elles nécessitent d’importantes et larges concertations ; ce ne sont pas les services du ministère qui vont inventer seuls les dispositifs permettant d’y répondre ; et ce sera encore moins le ministre tout seul… Ces concertations sont en cours.
Je suis plutôt convaincu à ce stade que nous devons mettre en place des niveaux différents, et pas un niveau unique. Nous devons être attentifs à la création de valeur et aux territoires dont nous avons déjà parlé, par exemple les zones intermédiaires. Il nous faut trouver un équilibre, ce qui constitue un véritable travail d’orfèvrerie. D’où la nécessité de réaliser des concertations et de prendre le temps nécessaire.

Monsieur le ministre, j’étais prêt à vous laisser mon temps de parole de réplique pour que vous puissiez nous donner des chiffres précis…
En effet, vous nous avez parlé de la problématique d’ensemble, mais pas des choses concrètes. Surtout, vous ne répondez pas à la question : allez-vous garantir le maintien du niveau d’aide, afin que le revenu des éleveurs ne baisse pas ?
À cette heure tardive de nos débats, méditons le vers de Jean de La Fontaine : « Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras » ! Il ne faudrait qu’il se transforme, pour nos éleveurs, en : « Moins tu auras »…
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Nadia Sollogoub applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la déclinaison française de la politique agricole commune 2023-2027, au travers du plan stratégique national, inquiète les producteurs de grandes cultures, en particulier la filière betterave-sucre-alcool, qui requiert une attention particulière.
Fleuron de notre secteur agroalimentaire et de nos territoires ruraux, notamment dans l’Eure, cette filière connaît depuis 2017 une succession de crises.
Depuis trois ans, en effet, le prix du sucre se situe sous le seuil d’alerte, le revenu des betteraviers a reculé de plus de 30 % et la taille des surfaces françaises a diminué de près de 20 %, pour revenir à son niveau de 2016.
En 2019, la France a perdu quatre sucreries. En 2020, la crise de la jaunisse a fait perdre un tiers de la production betteravière nationale. Ces dernières semaines, c’est le gel qui affecte de manière inédite la filière : quelque 40 000 hectares de betteraves en cours de levée ont ainsi été détruits.
Enfin, le Brexit peut nous faire craindre une réorientation des flux commerciaux, ce qui fait peser des risques supplémentaires sur les débouchés.
Monsieur le ministre, la filière betteravière est aujourd’hui en réel danger. Vous insistez régulièrement sur la question de la souveraineté alimentaire de notre pays ; cette filière y participe, et les enjeux sont aussi agricoles qu’industriels. Il faut répondre à cette urgence, et il est essentiel que le plan stratégique national de la PAC comporte un volet de nature à sécuriser, conforter et relancer la filière de la betterave.
Au-delà de la question des dispositifs des premier et deuxième piliers et de l’accompagnement de la structuration des filières, les professionnels en appellent à une stratégie sectorielle de gestion des risques, complémentaire du développement de l’assurance récolte.
Ils soutiennent également la mise en œuvre d’un instrument de stabilisation qui serait de nature à conforter les revenus des betteraviers face au choc économique et aux sinistres sanitaires non éligibles au Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale, le FMSE, tels que la jaunisse.
Monsieur le ministre, que prévoit le Gouvernement, en termes de priorités, de dispositifs et de moyens, dans le cadre de la prochaine PAC, pour sauvegarder et relancer la filière betteravière ?
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
M. Julien Denormandie, ministre de l ’ agriculture et de l ’ alimentation. Madame la sénatrice, je crois que je n’ai plus à démontrer mon amour pour la filière betteravière… Je resterai sans doute connu comme le ministre de la betterave, et j’en suis très fier !
Sourires.
Plusieurs questions de fond se posent aujourd’hui pour cette filière.
Tout d’abord, son accès à l’écorégime. Des concertations sont en cours à ce sujet, et elles abordent de manière très précise les sujets qui sont posés. Les modèles initiaux ne distinguaient pas entre les différents types de plantes ; il n’y avait pas de spécificité pour telle ou telle plante. Nous sommes en train de voir comment faire évoluer les choses.
Ensuite, la gestion des risques. La mise en place de fonds de stabilisation a été engagée dans plusieurs textes européens ; nous essayons de les mettre en œuvre et la filière betterave est très allante. D’autres systèmes peuvent également être envisagés.
Je rappelle d’ailleurs que les risques sanitaires et climatiques sont souvent intrinsèquement liés. C’est le cas par exemple pour les pucerons, puisque ces derniers se multiplient dès lors que les hivers n’ont pas été suffisamment froids. En tout cas, en ce qui concerne la refonte du système de gestion des risques, je vous renvoie à ce que j’ai déjà indiqué à l’occasion d’une question précédente.
Enfin, l’accompagnement des filières. La nouvelle politique agricole commune nous fournit des instruments, notamment les programmes opérationnels. Nous devons maintenant décider où nous mettons de l’argent et à quelle hauteur. Nous pouvons les financer soit par des aides couplées, soit par des droits au paiement unique, soit par les deux.
Néanmoins, nous retombons sur le problème que j’ai déjà évoqué : nous devons faire des choix, parce que chaque fois qu’il y a un plus quelque part, il y a un moins ailleurs. Autrement dit, si nous abondons un dispositif, nous prenons de l’argent à un autre. Nous devons tous avoir ce problème en tête.

Monsieur le ministre, vu l’urgence de soutenir la filière betteravière, peu importe le volet que vous utilisez ! Cette filière se porte vraiment mal : les agriculteurs ont perdu entre 400 et 500 euros par hectare, certains planteurs ont carrément arrêté la betterave…
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le ministre, les objectifs de la PAC 2021-2027 sont posés : favoriser une agriculture assurant souveraineté et santé alimentaire ; développer les actions favorables aux objectifs environnementaux et climatiques fixés par l’Union européenne ; renforcer le tissu économique des zones rurales.
Depuis 2014, la convergence progressive des aides a eu pour conséquence une forte baisse des aides directes pour certaines régions, dont les Hauts-de-France, au profit d’autres régions. La moyenne par exploitation dans la Somme, par exemple, a diminué de 42 % en dix ans.
En 2014, le paiement redistributif, passé de 5 % à 10 %, a permis à certaines régions de compenser pour partie cette convergence du paiement de base. Tel ne fut pas le cas dans la Somme, qui, de plus, comme d’autres départements, ne bénéficie pas des indemnités compensatoires de handicaps naturels, les ICHN, du second pilier.
Les importants transferts du premier pilier au second pilier ont donc eu un impact négatif sur les paiements de base dans ces territoires. La convergence progressive aujourd’hui proposée à 80 % correspond, dans la Somme, à une nouvelle diminution de 12 euros par hectare, soit 5, 66 millions d’euros. Et, si la convergence était de 100 %, elle serait de 8, 5 millions d’euros.
Dans le cadre du plan stratégique national, le PSN, vous devez, entre autres objectifs, définir les quatre modalités de la convergence interne du montant de paiement de base : convergence nationale ou régionale ; seuil de déclenchement de la convergence ; écart à la moyenne comblée par convergence ; limitation ou non et compensation ou non des pertes suscitées par la convergence.
Monsieur le ministre, quelles garanties apportez-vous sur le montant du premier pilier et sur le transfert ou non des montants du premier au second pilier permis par le règlement ? Quelle convergence, quel taux et quel calendrier envisagez-vous ?
Par ailleurs, pour limiter la compensation des pertes successives pour les systèmes de production des grandes cultures, dont dépendent les filières industrielles, comme le blé, le protéagineux ou la betterave, permettrez-vous un accès aux écorégimes simples à tous les modèles de production, avec la prise en compte des évolutions agroéconomiques, comme la gestion de l’eau ou l’agriculture de précision, et quelle convergence des droits sera appliquée ?
Enfin, dans le cadre de la convergence, à quel niveau allez-vous fixer la part du paiement redistributif, dont on sait qu’il est, certes, un facteur de convergence des aides découplées, mais dont le doublement de la part, de 10 % à 20 % du montant du premier pilier, entraînerait, dans la Somme, une perte supplémentaire de 5 euros à 10 euros l’hectare ?
Monsieur Somon, votre intervention fait écho à celle de votre collègue de Saône-et-Loire, voilà quelques minutes. Or, dans ce dernier cas, la convergence est positive, alors que, dans votre département de la Somme, elle a un impact négatif.
La question qui est posée est la suivante : faut-il aller très rapidement vers la convergence, sachant que, aujourd’hui, on a le choix entre 85 % et 100 % ? Votre collège aura tendance à répondre par l’affirmative, car cela permet d’améliorer encore plus le revenu des agriculteurs de son territoire, ce qui était le point saillant de son intervention.
En revanche, vous y êtes opposé, au motif que cela va dégrader le revenu des agriculteurs de la Somme, qui ont parfois la même activité, puisque la convergence est indépendante de cet aspect – c’est ce que l’on appelle les bases historiques.
Il faut donc que je trouve le bon équilibre, car, de toute manière, il faut continuer à réaliser cette convergence, ce que personne ne remet en cause. La question, je le répète, est de savoir s’il faut l’achever très rapidement, à l’horizon de 2027, ou progressivement.
Vous aurez compris, je crois, dans mes propos, que je suis plutôt un partisan de la stabilité, et je ne crois pas que c’est là un manque de courage. Parfois, avoir de la stabilité fait beaucoup de bien.
Par ailleurs, s’agissant des écorégimes, c’est oui, mille fois oui, ils doivent être accessibles. En revanche, et j’ai eu l’occasion d’attirer l’attention des filières sur ce point, cette accessibilité doit être fondée non pas uniquement sur des moyens, mais sur des résultats.
Autrement dit, on doit continuer avec l’ensemble des professionnels, en étant d’accord sur des critères de résultats, et pas seulement sur des critères de moyens. Je comprends la philosophie qui consiste à se fonder sur les moyens, mais, en l’occurrence, pour reprendre une expression de votre collègue, qui me citait justement, il ne faut jamais raconter de carabistouilles.
Sourires.
En effet, si l’on se limite à cela, le plan stratégique national ne passera pas les fourches caudines de la Commission européenne, précisément parce que l’on s’est battu pour que ce soit obligatoire pour tous les États membres et pour que ce soit vérifiable.
Si l’on reste sur les moyens, certains vont profiter de la brèche « au carré » et ils ne feront jamais la convergence vers ces standards que nous appelons de nos vœux pour pouvoir justement lutter contre la concurrence déloyale.
En résumé, je dis oui aux écorégimes accessibles et je souhaite plutôt des transitions que des bascules importantes.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le ministre, comme vous le savez, le Sénat est le reflet de nos territoires. C’est pourquoi j’aimerais fertiliser ce débat en exprimant le point de vue des agriculteurs du territoire que je représente, la Haute-Saône, qui se disent aujourd’hui très inquiets.
Cette inquiétude est très légitime au regard des nombreux points de désaccord et de la très lente progression des négociations en trilogue sur la réforme de la PAC. Et elle est renforcée dès lors que l’on mesure les conséquences que pourraient avoir des arbitrages sur les équilibres fragiles de certaines exploitations.
En Haute-Saône, monsieur le ministre, plus de 80 % de la surface agricole utile est en zone défavorisée, caractérisée par des sols superficiels, voire très superficiels.
Pour pallier ces handicaps, les efforts sont incontestables. En polyculture-élevage, les agriculteurs développent des systèmes particulièrement autonomes, résilients et vertueux sur le plan environnemental, qui méritent une attention toute particulière.
La politique agricole commune, au travers du second pilier, soutient et accompagne ces exploitations situées en zone défavorisée. Or la PAC va changer, mais les contraintes de production, elles, ne changent pas ; elles ont même tendance à s’aggraver.
Si la faible qualité des sols est presque routinière pour nos paysans, le fléau de l’excès de sécheresse est une calamité à laquelle on ne se fait pas.
Dans ce contexte, un changement brutal de paradigme serait un coup mortel porté à nos agriculteurs, dont les revenus sont au plus bas, et, en cascade, à nos paysages et à notre biodiversité.
Pour éviter ce désastre, une prise en considération totale de l’ICHN s’impose en faveur des zones défavorisées simples, en Haute-Saône notamment. Il importe aussi de reconnaître certaines spécificités, comme celles des zones intermédiaires. L’État devra également s’engager à compenser la baisse des cofinancements du Fonds européen agricole pour le développement rural, le Feader.
Monsieur le ministre, dans quelle mesure ces spécificités territoriales seront-elles prises en compte ? En d’autres termes, quelle « agriculture des territoires » attend demain ces paysans des terres à handicap et à faible potentiel ?
Monsieur Rietmann, la prise en compte de difficultés territoriales est une spécificité de la politique agricole française. Nombre de pays européens ne les prennent pas en compte, mais, en France, nous avons fait ce choix, et je m’en félicite.
Certes, pour maintenir, notamment, ce niveau d’ICHN, comme je le disais à vos collègues, et de manière générale, pour conserver le second pilier, il est nécessaire que l’État abonde ce dernier à hauteur de 140 millions d’euros par an sur cinq ans, soit 700 millions d’euros. C’est un choix politique considérable que nous avons à faire.
Sur les zones intermédiaires qui ne sont pas éligibles à l’ICHN, certains de vos collègues ont réclamé un abondement en paiements de base, mais, dans ce cas, c’est au titre du premier pilier, et cela nécessite d’opérer un transfert massif, j’y insiste, des aides couplées vers les paiements de base. Et là, l’élevage ne s’en relèverait pas.
Il faut vraiment l’avoir en tête, un écorégime accessible, y compris dans un département comme le vôtre, permettra de bénéficier, sur 20 % à 30 %, d’une convergence totale, si je puis dire, et de redonner plus à des zones intermédiaires. Votre territoire est un très bon exemple à cet égard.
Se pose aussi le problème des mesures agroenvironnementales, les MAE, qui n’ont jamais fonctionné dans les zones intermédiaires. Il nous faut, cette fois, trouver les voies et moyens adéquats.
Voilà ce que je voulais vous indiquer sur les zones intermédiaires, sachant que le principal enjeu en la matière, aujourd’hui, mais encore plus demain, c’est la gestion du risque et, surtout, l’accessibilité à l’eau. Vous connaissez mon engagement sur ce sujet ; nous allons notamment organiser un « Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique » dans les prochains jours.
Comme c’est ma dernière prise de parole, je veux vraiment vous remercier, mesdames, messieurs les sénateurs, d’avoir permis un débat de cette qualité. Vous avez tous réclamé des aides urgentes et martelé que vos territoires avaient des besoins, tout en reconnaissant qu’il était difficile d’y pourvoir.
C’est toute la complexité du sujet : dès qu’il y a un plus quelque part, il y a un moins ailleurs. Je dois donc trouver des équilibres. À la fin, je subirai les remontrances de tout le monde, mais la conjugaison de ces reproches montrera peut-être que j’ai trouvé un bon point d’équilibre. C’est la difficulté de l’exercice. Heureusement, je peux compter sur un budget qui a été préservé, je le répète, grâce à l’action de la France.
En tout cas, même si, à la fin, les résultats des uns et des autres sont considérés comme insuffisants, j’aurai la certitude d’avoir fait ces choix avec le plus de concertation et de professionnalisme possible. C’est un engagement de moyens et pas forcément de résultats.
Pardonnez-moi de me contredire par rapport à ma réponse de tout à l’heure, monsieur le sénateur, mais je crois que c’est ainsi que l’on fait avancer les choses, en tout cas dans le cadre d’un PSN, avec, et je veux les remercier, des services qui, derrière moi, travaillent jour et nuit depuis de nombreux mois sur cette question pour mener ces concertations, qui ne manquent pas de complexité. Je remercie en tout cas le Sénat d’avoir permis d’en débattre.
Pour conclure, je soumets une idée à votre sagacité, mesdames, messieurs les sénateurs. Il se trouve que la loi prévoit énormément de concertations, mais n’exige pas la tenue de débats au Parlement. Vous en avez organisé un de vous-même, et c’était très important, mais nous devrions peut-être mener une réflexion collective sur ce point dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune.
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, UC et RDSE.

M. le président. En conclusion du débat, la parole est à M. Franck Montaugé, pour le groupe auteur de la demande.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au terme de ce débat de contrôle demandé par le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, je voudrais remercier tous les intervenants des groupes, ainsi que M. le ministre, qui a développé devant nous les positions et les approches du Gouvernement.
Dans ce moment inédit de mise au point du plan stratégique national, le PSN, dont l’issue aura de lourdes conséquences pour nos agriculteurs et nos territoires, et en m’inspirant des mots du philosophe – « Que puis-je connaître ? Que m’est-il permis d’espérer ? Que dois-je faire ? » –, je vais m’attacher à conclure ce débat.
Tout d’abord, nous connaissons le budget dont bénéficiera la ferme France. Le contexte du cadre financier pluriannuel était difficile avec le départ des Britanniques, contributeurs nets. Il est facialement équivalent à celui de la période précédente, mais il sera en baisse en euros constants, seule unité de mesure sérieusement utilisable pour comparer des budgets sur longue période.
On constate donc une perte en matière de soutien, qu’il faudra compenser par ailleurs, pour, au mieux, maintenir la compétitivité, ainsi que le revenu qui en est pour moi une composante essentielle.
Le PSN est aussi construit sur la base de l’enveloppe nationale et il doit répondre à dix objectifs, comme nous le savons maintenant.
Permettez-moi de rappeler un principe cardinal préalable, auquel nous tenons : les agriculteurs français doivent tous pouvoir vivre décemment de leur métier. La Nation doit leur assurer un revenu équitable, tout en répondant aux attentes de la société en matière de qualité, de santé et d’impact sur l’environnement et le climat.
Avec un budget en baisse et des marchés que nous ne maîtrisons pas – il s’agit d’un sujet que nous n’avons pas abordé –, où va-t-on trouver les moyens de répondre à cet objectif ?
Tout d’abord, il faut rééquilibrer les pouvoirs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. La loi Égalim première version a été, malgré nos avertissements de l’époque, un échec. Il est urgent de rouvrir le débat sur la base d’une construction du prix payé par le premier acheteur, intégrant des critères de coûts de production dans un cadre contractuel pluriannuel.
C’est tout l’inverse du ruissellement, dont le premier des Américains vient de nous dire qu’il n’a jamais marché… Les paysans français l’avaient compris depuis longtemps à leurs dépens. Il aurait certainement fallu les écouter !
Et que dire aux agriculteurs qui ont été injustement et dramatiquement sortis de la carte des zones défavorisées ? Pour beaucoup d’entre eux, le revenu correspondait aux ICHN, pour un travail réalisé vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, je le rappelle au passage.
Aussi, vous comprenez, monsieur le ministre, que le désespoir et la colère montent chez ces agriculteurs, comme chez ceux à qui l’on a dit que la prime à la vache allaitante allait baisser. Ne faites pas l’erreur de jouer les protéines contre l’élevage allaitant. La réforme de l’unité de gros bétail, l’UGB, doit apporter aux éleveurs, et non pas les affaiblir
À enveloppe constante, nous pensons qu’il faut cibler les aides sur les systèmes productifs à enjeu, comme le bio, l’agriculture de conservations des sols, les démarches de qualité certifiée, telles que l’agriculture biologique, ou AB, la haute valeur environnementale, ou HVE, voire la responsabilité sociale des entreprises agricoles, ou RSEA, sans oublier les appellations et autres marques de pays.
Garantir la qualité des denrées alimentaires et la santé en réponse aux attentes de la société passe indéniablement par ces démarches, qu’il faut soutenir davantage.
Par ailleurs, pour appuyer le renouvellement des générations, nous vous demandons de plafonner à 60 000 euros les aides du pilier 1, ou P1, et de mieux cibler les aides du pilier 2, ou P2.
Les écoschémas du P1 doivent intégrer des dispositifs de valorisation des externalités positives de l’agriculture, à travers la mise en place de paiements pour services environnementaux, ou PSE. Plus largement, la notion d’aménités rurales doit se traduire par une meilleure reconnaissance de la place de la ruralité dans notre pays.
C’est un enjeu national, qui déborde le strict cadre de l’agriculture. Monsieur le ministre, nous vous demandons d’ouvrir ce chantier.
L’objectif de préservation des paysages et de la biodiversité doit être travaillé à l’aune du concept d’« aménités rurales », que le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, le CGAAER, vous propose de mettre en œuvre.
Il y va aussi de la dynamisation et du soutien au développement des zones rurales. Les collectivités locales y auront toute leur place, en lien avec l’agenda rural. La question cruciale du renouvellement des générations passera par là. La définition de l’actif agricole et des nouvelles dispositions de gestion du foncier agricole y contribuera également grandement.
Nous souhaitons en outre que votre feuille de route sur les zones intermédiaires, les ZI, puisse prendre en compte la diversité des territoires en difficulté. Les ZI ne se limitent pas à la diagonale « Charente-Maritime-Moselle », ou aux terroirs de grandes cultures. Bien des systèmes productifs en grande difficulté peuvent y prétendre. C’est le cas, par exemple, de la polyculture-élevage, qui caractérise, vous le savez, mon département du Gers. Nous espérons pouvoir travailler avec vous sur ce point, monsieur le ministre.
Le revenu et la compétitivité passeront aussi par la protection et la création de ressources naturelles, au premier rang desquelles nous plaçons la ressource en eau. Vous avez ouvert le dossier, et nous sommes disponibles pour travailler avec vous sur ce sujet majeur et urgent, qui ne concerne pas que le sud de la France.
Il faudra donc améliorer la compétitivité sans sacrifier les enjeux de qualité alimentaire, de santé et d’impact des productions sur l’environnement. S’il est indispensable que les circuits courts et autres projets alimentaires territoriaux, les PAT, se développent, ceux-ci ne suffiront pas, seuls, à régler la question du revenu et de la compétitivité agricole nationale.
Monsieur le ministre, quatre ans après que le Sénat eut voté à l’unanimité une proposition de loi socialiste visant à développer les outils de gestion des risques en agriculture, à laquelle j’avais travaillé avec Henri Cabanel, vous rouvrez le chantier. C’est une bonne chose, et nous sommes prêts, là encore, à travailler avec vous.
Pour conclure, je dirai un mot sur les enjeux internationaux de la PAC pour notre pays.
Monsieur le ministre, nous vous demandons de faire en sorte que les producteurs français soient traités équitablement, donc que les critères d’exportation soient équivalents aux critères d’importation et intègrent notamment la problématique du carbone et des normes sanitaires. Je vous rappelle enfin le souhait du Sénat de pouvoir discuter du CETA, l’accord économique et commercial global, dans cet hémicycle.
L’agriculture française ne peut ni ne doit être la variable d’ajustement d’autres secteurs économiques nationaux, fussent-ils à enjeux. La souveraineté alimentaire nationale passe aussi par là. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous remercie tous de votre participation.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Nous en avons terminé avec le débat sur le thème : « Les enjeux nationaux et internationaux de la future PAC ».

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, mercredi 5 mai 2021 :
À quinze heures :
Questions d’actualité au Gouvernement.
À seize heures trente :
Débat sur la réponse européenne à la pandémie de covid-19 ;
Débat sur le thème « Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE), ne pas confondre vitesse et précipitation ».
Le soir :
Débat sur le thème « L’impact de la Réduction Loyer Solidarité sur l’activité et l’avenir du logement social ».
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures quinze.