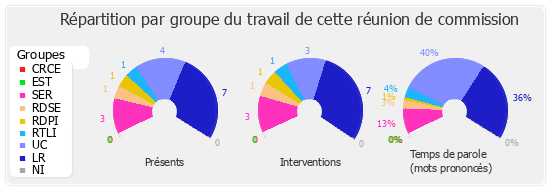Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
Réunion du 18 mai 2021 à 15h00
Sommaire
La réunion

Monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est un plaisir de vous accueillir. Ce n'est pas la première fois que nous vous recevons comme ministre depuis 2017, mais c'est la première fois que nous vous recevons comme ministre de l'agriculture ! Vous connaissez déjà bien certains des sénateurs présents parmi nous même si aujourd'hui les enjeux d'aménagement numérique du territoire laisseront la place aux enjeux agricoles. Nous vous recevons aujourd'hui dans le cadre de l'examen prochain par le Sénat du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, qui comporte désormais une trentaine d'articles entrant dans le champ de compétence de votre ministère.
Comme vous le savez, le Sénat a fait le choix de s'appuyer sur l'expertise des commissions permanentes plutôt que de créer une commission spéciale comme à l'Assemblée nationale : compétente sur la majorité des articles, notre commission est donc saisie au fond de ce texte, avec comme rapporteurs Marta de Cidrac, Pascal Martin et Philippe Tabarot. La commission des affaires économiques recevra une délégation au fond pour traiter plusieurs dizaines d'articles. Les commissions des finances, des lois et de la culture se sont également saisies pour avis.
S'agissant du volet « agricole » du projet de loi ou des éléments ayant une incidence sur ce secteur, notre commission est compétente au fond sur l'article 1er relatif à l'affichage environnemental, les articles 19 à 19 bis C et 19 bis G à 19 bis relatifs à la protection des écosystèmes aquatiques, 56 et suivants relatifs aux aires protégées, 58 A et suivants relatifs au recul du trait de côte, 59 quater, 61, 61 bis relatifs à notre politique alimentaire, 62, 63 relatifs aux émissions de protoxyde d'azote et d'ammoniac du secteur agricole et 63 bis à 64 ter relatifs à la lutte contre la déforestation importée, ainsi que l'article 66 ter.
J'en profite pour vous indiquer que le groupe de travail « Alimentation durable et locale », commun à notre commission et à celle des affaires économiques, rendra ses conclusions demain.
Nous comptons sur les six sénateurs membres de ce groupe de travail et sur nos rapporteurs pour traduire concrètement leurs propositions par des amendements au projet de loi.
Avant de vous laisser la parole pour un propos liminaire, j'ai plusieurs questions à vous poser. Tout d'abord, monsieur le ministre, quelle est la philosophie d'ensemble du volet agricole de ce projet de loi ?
Globalement, ce texte mélange des mesures programmatiques, des prorogations et modifications de mesures à peine ou non entrées en vigueur, des coordinations de mesures anticipées avec d'autres textes qui pourraient être examinés au Parlement dans les prochains mois ou années, quelques mesures d'interdiction et d'effet direct, une demi-douzaine d'habilitations à légiférer par ordonnance, mais aussi désormais une quarantaine de demandes de rapports du Gouvernement au Parlement.
Le volet agricole ne fait pas exception à la règle, avec des mesures prolongeant des dispositions de la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « Egalim », mais aussi des articles à la portée normative discutable alors même qu'ils affichent des objectifs symboliques très forts. Je pense notamment au projet de taxe sur les engrais azotés : on voit bien les objectifs et la trajectoire fixés, mais quel sera l'accompagnement proposé à nos agriculteurs ? Certes, il y a le plan de relance, mais les dispositions de la loi « Climat et résilience » auront des effets bien au-delà de la période actuelle de crise sanitaire et économique et elles supposent un accompagnement dans la durée, faute de quoi nous aurons uniquement dégradé la compétitivité de notre agriculture et ouvert la voie à des importations toujours plus nombreuses qui ne respectent pas nos normes nationales, sur les plans sanitaires, environnementaux et sociaux, ce qui va à rebours de l'objectif de maîtrise de notre empreinte carbone et de la protection de nos concitoyens.
Par ailleurs, avez-vous pu évaluer l'effet réel sur l'environnement et sur nos émissions de gaz à effet de serre (GES) des mesures ajoutées lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale sur le volet agricole ? Nous manquons d'évaluations. L'étude d'impact du projet de loi est globalement lacunaire et le suivi des mesures introduites à l'Assemblée n'est pas simple, car les amendements adoptés, que ce soit sur proposition des députés ou du Gouvernement, ne comportaient pas de mention de leur impact climatique, en dépit des recommandations du Haut Conseil pour le climat (HCC). Selon vous, à l'issue de son examen par l'Assemblée nationale, l'ambition climatique du volet agricole a-t-elle été relevée ?
Enfin, quels sujets nouveaux souhaitez-vous travailler avec le Sénat ? Quelles dispositions souhaitez-vous retravailler avec nous ? Des amendements du Gouvernement sur le volet agricole sont-ils en préparation ?
Ma vision politique est construite autour de la notion de souveraineté agroalimentaire. Dans le cadre de la semaine de l'agriculture, je participais ce matin à un colloque consacré à ce sujet et j'y ai rappelé qu'elle était à la fois un objectif pour toute une Nation - pas de pays fort sans une agriculture forte -, une question d'identité et un sujet de protection face aux enjeux du changement climatique, mais aussi de protection du consommateur. La qualité environnementale et nutritionnelle est la marque de fabrique de notre agriculture, nous la revendiquons à travers le monde, mais elle est trop souvent dénigrée dans notre propre pays.
Garantir notre souveraineté alimentaire suppose de sortir de nos dépendances. Je pense tout d'abord à notre dépendance à l'égard de certaines importations, comme le soja brésilien. Le plan de relance prévoit à cet effet 120 millions d'euros en faveur d'un plan protéique qui était attendu depuis de nombreuses années et ce projet de loi permettra de lutter contre la déforestation importée. Je pense aussi à notre dépendance à l'égard des aléas climatiques, ou à l'égard d'une guerre des prix défavorable à notre modèle agricole français dont la compétitivité hors coût est majeure.
Dans son volet agricole, le projet de loi reprend sept propositions de la Convention citoyenne pour le climat (CCC). Notre politique agricole relève en effet largement de l'échelon législatif européen au travers de la politique agricole commune (PAC) et des normes et des standards de production. Elle relève également de mesures non législatives, comme les 50 millions d'euros que le plan de relance a prévus pour les cantines ou les 80 millions d'euros qu'il débloque pour financer les projets d'alimentation territoriaux (PAT).
Les cantines sont un lieu profondément républicain, qui nous permet de lutter contre les inégalités sociales nutritionnelles. Laissons le choix dans les menus, sans dogmatisme, car chacun a le choix de son régime alimentaire. Mais l'équilibre nutritionnel doit être garanti et mon combat, c'est celui de la qualité nutritionnelle dans les cantines, notamment des viandes dont près de 60 % sont importées : on sert parfois dans nos cantines du poulet ukrainien ou brésilien, qui ne présente pas le même apport nutritionnel qu'un poulet français. Nous avons donc renforcé les dispositions de la loi Egalim sur la qualité des viandes dans les cantines afin d'atteindre 60 % de produits sous label.
J'ai demandé à ce que l'étude d'impact prévue par la loi Egalim sur l'expérimentation obligatoire d'un menu végétarien par semaine soit rendue plus tôt que prévu afin que ses conclusions nous permettent de recommander une généralisation de cette expérimentation.
Les collectivités qui proposent un menu à choix multiple pourront expérimenter le menu végétarien et, dès 2023, l'État proposera, lui aussi, un menu végétarien dans tous ses menus à choix multiple.
Le projet de loi prévoit deux modifications des règles de la commande publique afin de faciliter l'approvisionnement des cantines en produits locaux : des critères additionnels environnementaux - fraîcheur, degré de transformation - sont institués et le seuil du gré à gré est relevé à 100 000 euros.
Les fruits et légumes de saison présentent une bien meilleure qualité nutritionnelle que les autres ; or nous nous sommes progressivement habitués à consommer tous les fruits et légumes toute l'année... Le projet de loi va dans le sens d'une meilleure prise en compte de la saisonnalité, mais nous pourrons encore progresser au Sénat sur ce sujet.
Enfin, je tiens à être très clair : le texte n'introduit aucune taxe ou redevance sur les engrais azotés. Mais si, deux années de suite à compter de 2024, la France ne respecte pas ses engagements européens en termes de trajectoire de réduction des émissions de protoxyde d'azote et d'ammoniaque et si le sujet n'a pas avancé au niveau européen, alors il sera envisagé d'instaurer une telle taxe, votée par le Parlement. Il ne s'agit donc absolument pas d'une surtransposition comme on l'entend souvent !
Enfin, le projet de loi introduit des dispositions sur la forêt et sur l'eau : l'eau est un élément essentiel en agriculture, sur lequel nous devrons avancer avec courage. Nous pourrons continuer à travailler sur ce volet.

Je souhaitais vous interroger sur deux volets à titre principal : l'eau et la maîtrise de l'empreinte carbone de notre alimentation.
L'article 19 porte sur la préservation et la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques et marins et affirme que ces écosystèmes « constituent des éléments essentiels du patrimoine naturel de la Nation ». Quels sont les effets juridiques attendus d'une telle disposition ? Le Conseil d'État en a relevé la faible normativité, mais les fédérations agricoles s'inquiètent d'une possible augmentation des contentieux sur le fondement de cet article. Selon elles, il remettrait en cause la gestion équilibrée et durable de la ressource qui repose sur la conciliation entre les usages. Quelle est votre analyse ?
Je m'interroge sur l'opportunité du maintien de l'article 19 bis B, introduit à l'Assemblée nationale, qui impose la restauration des milieux aquatiques et notamment des zones humides. Cette disposition est susceptible de faire peser une charge lourde sur les finances publiques - nationales comme locales -, le débiteur de cette obligation de restauration n'étant pas identifié... Or le code de l'environnement dispose déjà depuis 2005 « que la préservation et la gestion durable des zones humides sont d'intérêt général ». Le Conseil d'État considère qu'inscrire des listes énumératives non exhaustives dans la loi n'est pas satisfaisant. Faut-il imposer une obligation de restauration spécifique à ces zones humides ? Ne peut-on pas considérer que celle-ci est induite par l'article 19, qui prévoit de manière plus pragmatique « la préservation et, le cas échéant, la restauration » des écosystèmes aquatiques et marins ?
L'article 19 bis est issu des travaux du député Martial Saddier, président du comité de bassin Rhône-Méditerranée : les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) devront identifier les masses d'eau souterraine stratégiques pour l'alimentation en eau potable et définir les mesures de protection nécessaires pour assurer leur préservation. Des craintes s'expriment au sujet d'une difficulté croissante à pouvoir prélever dans les nappes aux fins d'irrigation à certaines périodes de l'année : quels éléments pouvez-vous apporter en réponse à ces préoccupations ? Par qui et comment les restrictions d'usage pour assurer l'équilibre quantitatif entre les prélèvements et leur capacité à se reconstituer naturellement seront-elles arbitrées ?
Vous avez également annoncé le lancement d'un « Varenne de l'eau » et de l'adaptation au changement climatique pour l'été prochain : pouvez-vous nous en dire plus ?
Enfin, sur le volet agricole, plusieurs questions. L'article 61 bis prévoit la possibilité pour le porteur d'un projet alimentaire territorial (PAT) d'engager une démarche collective de certification environnementale pour l'ensemble des exploitations contractantes. Concrètement, quel en sera le coût pour le porteur ? Quelle est la valeur ajoutée de cet article ? L'engagement d'une démarche collective de certification par un porteur de PAT n'est-il pas déjà possible actuellement dans le silence de la loi ? Si tel n'était pas le cas, la rédaction de cet article mériterait a minima d'être clarifiée.
L'article 66 ter prévoit une information obligatoire sur la saisonnalité des fruits et légumes frais dans les magasins de plus de 400 mètres carrés. Ne pourrait-on pas abaisser ce seuil pour augmenter le champ d'application de la mesure à d'autres lieux de vente ? Comment seront pris en compte les produits cultivés sous serre en France ?
Je laisserai ma collègue Anne-Catherine Loisier vous interroger sur le sujet de la déforestation importée, qui fera l'objet, demain, de propositions concrètes lors la présentation du rapport du groupe de travail « Alimentation durable et locale », commun à notre commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et à la commission des affaires économiques. Ces propositions feront ensuite l'objet d'amendements au projet de loi « Climat et résilience ».
Sur la maîtrise de l'empreinte carbone du secteur agricole, la rédaction des articles 62 et 63 relatifs aux engrais azotés me semble largement perfectible d'un point de vue juridique et peu concrète pour nos agriculteurs. Si vous me permettez l'expression, ces dispositions sont cosmétiques : il s'agit d'un objectif politique et symbolique, qui s'inscrit dans une démarche de communication. Pourriez-vous nous rappeler les engagements européens de la France en matière de réduction des émissions de protoxyde d'azote et d'ammoniac, la trajectoire en cours pour ces émissions et les principaux contributeurs par activité économique ? Quel est l'état de la consommation d'engrais en France à l'hectare par rapport aux autres pays européens et mondiaux ? Pourquoi avez-vous choisi de retarder l'application d'une redevance et de ne prévoir que la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement dans cette rédaction que j'évoquais plus tôt ?
Plusieurs pays européens ont mis en place une taxe de ce type avant de se raviser et de la supprimer : sans harmonisation européenne, une telle mesure ne serait-elle pas tout simplement contre-productive à la fois pour la survie de nos agriculteurs et pour la transition agroenvironnementale ? En outre, il me semble que cette mesure oublie l'élasticité prix des usages des engrais : à défaut d'alternative, la grande majorité des agriculteurs continueront à utiliser ces produits... Comment le Gouvernement compte-t-il inciter les agriculteurs à réduire ces pollutions diffuses ? Pourquoi ne pas envisager un crédit d'impôt en faveur des engrais organiques ?

Pour ma part, je souhaiterais vous interroger sur l'affichage environnemental, dont la généralisation obligatoire sur les biens et services est envisagée à l'issue d'une période d'expérimentation d'une durée maximale de cinq ans par l'article 1er du projet de loi.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de la rapporteure Aurore Bergé, qui introduit un alinéa spécifique aux produits agricoles, sylvicoles et alimentaires. Je m'interroge sur la pertinence de maintenir cet alinéa en l'état, pour des raisons de clarté de la loi et de respect du principe d'égalité. Êtes-vous favorable au maintien en l'état de ce nouvel alinéa ou préféreriez-vous une rédaction globale pour tous les biens et services, avec toutefois l'ajout de la mention des externalités environnementales ?
Par ailleurs, l'entrée en vigueur de cet affichage environnemental me paraît très lointaine. Des travaux - nationaux et européens - sont pourtant en cours depuis une quinzaine d'années et l'accélération de cette idée date du Grenelle de l'environnement organisé sous l'égide du président Nicolas Sarkozy ! La généralisation de ce dispositif requiert certes un socle technique exigeant et la définition d'une méthodologie robuste, mais les acteurs y travaillent depuis plusieurs années. La France doit s'engager maintenant pour peser dans les discussions qui auront lieu au niveau européen. C'est aussi une opportunité pour nos producteurs qui proposeront des produits plus vertueux du point de vue de l'environnement et qui susciteront l'adhésion des consommateurs. Dans le secteur des produits alimentaires, par exemple, un appel à projets de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) a été lancé en septembre 2020 et huit candidats s'y sont engagés. La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (AGEC) prévoyait une expérimentation de 18 mois, qui s'achèvera en août 2021. Or avec cet article nous en reprenons pour cinq ans si vous me passez l'expression... Seriez-vous favorable à inscrire une date d'entrée en vigueur plus proche - 2023 ou 2024 - pour les cinq secteurs qui sont d'ores et déjà engagés dans ce processus : ameublement, habillement, hôtellerie, produits électroniques et produits alimentaires ?

J'ai un sujet à vous soumettre, monsieur le ministre. De nombreuses études ont montré le potentiel des biocarburants dans la décarbonation des transports. Je pense qu'il faut soutenir cette filière qui permet à nos agriculteurs de diversifier leurs sources de revenus tout en accompagnant la transition écologique de nos modes de propulsion : la France doit s'engager pleinement dans le développement des biocarburants !
Or j'ai le regret de constater que la problématique de la décarbonation des transports est quasiment absente du projet de loi : un projet portant sur le dérèglement climatique ne devrait-il pas intégrer cette question ? Ne pourrait-on pas se fixer des objectifs spécifiques pour le développement des biocarburants ? Cela serait un signal fort pour la filière. Il semblerait que les contraintes de production constituent le principal obstacle à leur développement : qu'en est-il ? Les biocarburants ne pèsent encore que 8 % dans le secteur des transports : c'est bien peu...

Aucun dispositif n'est proposé pour accompagner les agriculteurs dans la réduction de l'usage des engrais azotés et l'inflexion de la trajectoire est attendue dans des délais très limités : pour eux, c'est un ultimatum ! Que propose le Gouvernement pour les aider à aller vers des pratiques plus vertueuses ? Le délai ne laisse pas aux agriculteurs le temps d'évoluer dans leurs pratiques et la période prise pour référence est inadaptée. C'est pourquoi cette disposition est mal vécue : comme une punition, sans réelle alternative.
Par ailleurs, le Gouvernement va-t-il s'engager sur le sujet des chèques alimentaires dès 2022 ? Avec quel financement ? Comment un tel dispositif pourrait-il servir la cause du « consommer français » ?
Le développement des repas végétariens est-il compatible avec la montée en puissance du plan Protéines ? Nous ne sommes déjà pas en capacité d'approvisionner nos cantines et importons 70 % des fruits et légumes qui y sont servis... Est-il bien raisonnable d'appuyer sur l'accélérateur ? Je partage les objectifs posés pour la viande, mais aurons-nous la capacité d'atteindre nos objectifs s'agissant des produits de la pêche ?
Les articles relatifs à la forêt font primer la protection sur la gestion durable : ces dispositifs sont-ils compatibles avec notre stratégie nationale de mobilisation de la ressource et la réglementation environnementale 2020 (RE 2020) ?
Monsieur Martin, l'article 19 présente en effet un impact juridique très limité ; il a essentiellement une valeur symbolique. Par ailleurs, je partage votre avis sur l'article 19 bis B. S'agissant de l'article 19 bis, il devra être retravaillé afin de calmer les craintes que vous avez évoquées.
Le « Varenne de l'eau », avec la question de l'adaptation au changement climatique est un projet essentiel : il nous permettra de revenir aux fondamentaux sur un sujet aussi important que celui de l'eau, qui n'a pas toujours eu la place qu'il méritait au sein de mon ministère. Il faut « remettre de la pensée ». Les conflits sur l'usage de l'eau sont vieux comme le monde et se rencontrent à toutes les échelles, du bassin versant et à l'échelle d'un continent. Sur un sujet aussi compliqué, il faut des idées simples si vous me permettez de citer le général de Gaulle, de la méthode, de la concertation et de la raison. Prélever un mètre cube d'eau, ce n'est pas pareil si les nappes phréatiques sont pleines et le sol gorgé d'eau ou pas... Il faut pouvoir poser le débat en ces termes.
Nous allons connaître de plus en plus de sécheresses estivales et de pluies diluviennes hivernales : comment fera-t-on ? Le plan de relance prévoit 200 millions d'euros pour adapter nos cultures au changement climatique. Je pense au gel, avec le récent épisode que nous avons connu, historique par son ampleur, à la sécheresse, à la grêle...
Enfin, nous constatons que l'assurance récolte et le régime des calamités agricoles ne fonctionnent pas. Il faut avancer aussi sur ce sujet.
Ces trois sujets seront au centre du « Varenne », qui devra privilégier la pensée à la posture. Je suis très attaché à la raison et à la science...
Dans le prolongement de la loi Egalim qui avait fixé un objectif de 50 % de produits de qualité dans nos cantines, l'article 61 bis enclenche un cercle vertueux qui permettra de privilégier les produits de nos territoires au travers des PAT qui développeront des certifications.
Je ne me prononcerai pas sur votre proposition d'abaisser le seuil des commerces concernés par la disposition sur la saisonnalité de 400 à 200 mètres carrés, car elle nécessiterait une étude d'impact. Idem sur la question des productions sous serre, parfois réalisées à partir d'énergies renouvelables...
Je vous transmettrai les données chiffrées demandées sur l'usage des engrais azotés. Je fais confiance au monde agricole pour tenir les engagements pris au niveau européen. Je crois plus à la confiance et à la responsabilisation qu'à la pénalisation. Le texte rappelle notre obligation d'honorer nos engagements. Il y a certes un travers français à faire des surtranspositions, mais permettez-moi de vous rappeler qu'elles sont bien souvent le fait du pouvoir législatif...
L'engrais, c'est la nourriture de la plante, ce n'est pas de l'hormone de croissance ! On ne se passera donc jamais d'engrais. Pour pousser, les plantes ont besoin d'engrais organiques ou chimiques, mais ceux-ci ne présentent pas les mêmes potentiels d'émission, ni d'assimilation par la plante.
Madame de Cidrac, le carbono-score prévu à l'article 1er fournira une information utile au consommateur, en lui permettant de privilégier les circuits de distribution les plus vertueux. Mais cette méthodologie, pilotée par l'Ademe, présente encore des travers et fait apparaître des absurdités : c'est ainsi qu'un élevage extensif de 60 charolaises en France présentera un carbono-score moins bon qu'un élevage intensif de 10 000 bêtes en Argentine, voyage compris... Des travaux sont en cours afin de sortir de ce paradoxe.
Monsieur Tabarot, de mémoire, la Convention citoyenne pour le climat (CCC) n'avait pas formulé de recommandation sur les biocarburants : cela explique que ce sujet soit absent du projet de loi, qui a été construit sur la base des propositions de la CCC.
J'en profite pour saluer les travaux en cours de la mission d'information du Sénat sur la méthanisation. Il est important que le monde agricole participe au développement des énergies renouvelables, sans remettre pour autant en cause la souveraineté alimentaire : si nous devions importer massivement faute de capacités de production, il n'y aura pas de cercle vertueux.
À titre personnel, je crois beaucoup aux biocarburants et au biogaz, mais leur développement doit s'intégrer dans des politiques publiques très clairement établies.
Madame Loisier, nous accompagnons les agriculteurs sur la question des nitrates au travers du compte d'affectation spéciale « Développement agricole et rural » (Casdar) pour ce qui concerne le financement de la recherche, mais surtout grâce au plan de relance qui finance les agroéquipements à hauteur de 100 millions d'euros et le plan Protéines à hauteur de 120 millions d'euros qui permettra l'apport d'azote dans le sol par la rotation des cultures. Il faut considérer les émissions dans leur globalité et travailler aussi sur la directive « Nitrates ».
Le Président de la République s'est engagé sur le sujet des chèques alimentaires. Il s'agit d'une aide non pas sociale, mais nutritionnelle. Aujourd'hui, environ 8 millions de Français n'ont pas suffisamment accès à des aliments satisfaisants au plan nutritionnel. La mise en oeuvre de ce dispositif très ambitieux sera sans doute complexe. En effet, comment distinguer les aliments de qualité nutritionnelle satisfaisante dans un supermarché, ou même sur un marché ? Une première étape pourrait consister à proposer aux jeunes de 18 à 25 ans des paniers de fruits, de légumes et de viande de qualité via des plateformes numériques.
S'agissant des repas végétariens, notre capacité à produire suffisamment de légumineuses et de protéines végétales est effectivement un sujet d'inquiétude. C'est pourquoi le plan Protéines végétales prévoit une augmentation de 50 % de la surface agricole associée.
Je transmettrai vos questions relatives aux produits de la pêche à Annick Girardin.
Nous observons aujourd'hui que la forêt avance et que le bois recule. Autrement dit, nous importons du bois. C'est pourquoi je me suis tant battu, lorsque j'étais ministre du logement, pour que la captation de carbone par ce matériau soit prise en compte dans l'analyse du cycle de vie d'une construction en bois.

Je regrette que ce projet de loi insiste sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) dont est responsable le secteur agricole sans évoquer le potentiel de celui-ci, qu'il s'agisse de la méthanisation, des biocarburants ou des techniques de conservation des sols qui participent efficacement à la captation de carbone dans les sols.
Depuis 2019, notre souveraineté est mise à mal. Va-t-on se passer encore longtemps des progrès de nos ingénieurs agronomes et de nos biologistes végétaux, qui permettraient de sélectionner des végétaux moins exigeants en eau et en engrais ? Une agriculture audacieuse et ambitieuse n'est pas incompatible avec des objectifs climatiques et environnementaux.
S'agissant de la pêche, il est désolant qu'une ONG comme Sea Shepherd soit favorable à la disparition de la pêche, alors que le poisson est une précieuse source de protéines directement utilisable.

Comment l'introduction d'un menu végétarien dans les services de restauration collective s'articulera-t-elle avec l'expérimentation du menu végétarien hebdomadaire prévue par la loi Egalim ? Quand disposerons-nous du bilan de cette expérimentation ? Est-il opportun de lancer une nouvelle expérimentation avant même d'avoir obtenu les conclusions de la précédente ?
Par ailleurs, l'article 11 prévoit que les supermarchés devront proposer au moins 20 % de leurs produits en vrac d'ici à 2030. Des professionnels, notamment de la filière de la pomme de terre, s'inquiètent des modalités de mise en oeuvre de l'interdiction, prévue par la loi AGEC au 1er janvier 2022, des emballages en plastique pour les fruits et légumes. En effet, ils ont dû constituer d'importants stocks d'emballages pendant les confinements lorsqu'on craignait des ruptures. Des concertations sont-elles prévues avec les professionnels pour que cette sortie des emballages plastiques puisse se dérouler au mieux ?

Les données de santé indiquent que l'obésité des enfants progresse. Ne faudrait-il pas limiter le recours aux plats industriels ultra-transformés dans la restauration collective ?
Par ailleurs, la consommation de légumes secs est insuffisante. Or il s'agit de débouchés qui pourraient être rémunérateurs pour les agriculteurs. J'espère qu'ils seront encouragés à s'engager dans cette voie.
Enfin, pour ma part, je me félicite que la question des engrais azotés soit posée. Nous sommes les quatrièmes consommateurs mondiaux de ces produits importés dont l'épandage a des effets très néfastes. L'article 62 n'a certes pas de portée normative, mais j'espère que ce n'est qu'un début.

La souveraineté alimentaire est plus que jamais un enjeu stratégique. Nous importons 40 % des légumes, 60 % des fruits et 50 % des poulets que nous consommons.
Le volet agricole du plan de relance vise à renforcer l'autonomie alimentaire de la France. Toutefois, l'agriculture est avant tout une question de terre. Le projet de loi prévoit de réduire par deux la surface de sols artificialisés sur les dix prochaines années. Si cela peut paraître légitime, pensez-vous que l'objectif d'atteindre une artificialisation proche de zéro, quelles que soient la nature et la qualité agronomique des terres, soit cohérent et partagé par les élus locaux ? Vous semble-t-il susceptible de contribuer à renforcer notre souveraineté alimentaire ?

Le débat relatif aux barrages et aux moulins est très sensible au sein du monde agricole. Ces dispositifs qui existent depuis fort longtemps permettent de puiser de l'eau dans les rivières plutôt que dans le cénomanien. C'est pourquoi je souhaiterais que la question d'éventuels arasements fasse l'objet d'une véritable réflexion plutôt que d'une simple décision des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal), en vertu de la continuité écologique.
Par ailleurs, l'abaissement de 50 % de la surface des terres artificialisées, en particulier des terres arables, risque d'entraîner l'abandon de certaines terres qu'il deviendrait trop coûteux de cultiver, surtout si on ne peut plus les arroser. Dans la Sarthe, des groupes veulent investir pour développer le tourisme mais ne peuvent le faire, car ils n'obtiennent pas de permis de construire. En la matière, il me semble important de penser « local » plutôt que « global ».
J'en viens enfin au sujet de la forêt. Comme vous le savez, les forestiers français souhaitent le rétablissement du code de bonnes pratiques sylvicoles. Pour ma part, je regrette que l'on défriche la forêt pour y installer des éoliennes sans schéma directeur, en contrepartie de sommes qui peuvent s'élever à 11 000 euros pour les particuliers ou les communes qui y consentent.
La forêt est considérée à tort comme la première source de captation de carbone. De fait, les sols agricoles en captent bien plus. Pourtant, si les forestiers sont considérés comme des acteurs majeurs du changement climatique, les agriculteurs ne le sont pas. À l'aune de ce constat, le débat relatif au glyphosate aurait été très différent, puisqu'il nous aurait conduits à opposer les deux objectifs contradictoires et pourtant tous deux légitimes que sont la préservation de la biodiversité et la captation de carbone dans les sols par l'agriculture de conservation qui nécessite le désherbage.
Nous travaillons avec de jeunes agriculteurs à la création de crédits de captation de carbone dans le sol agricole. Les méthodologies sont établies ; il ne reste plus qu'à créer des plateformes d'échange entre une offre et une demande pour valoriser le crédit carbone. Cela permettrait de créer du revenu supplémentaire pour nos agriculteurs en tant que capteurs de CO2 dans le sol.
La sélection variétale existe depuis 10 000 ans. Il faut prendre garde que les nouvelles techniques de sélection végétales (NBT) n'amènent pas à des dérives et à écarter les risques auxquels elles nous exposent, mais en aucun cas il ne faut les confondre avec les organismes génétiquement modifiés (OGM). Dans un rapport récent, la Commission européenne défend d'ailleurs cette position.
Nous disposons du rapport sur l'expérimentation relative à l'introduction d'un repas végétarien par semaine prévue par la loi Egalim. Les conclusions de ce rapport étant plutôt positives, elles nous ont encouragés à donner un avis favorable à la généralisation de l'expérimentation obligatoire. Je m'engage à vous transmettre ce rapport rapidement.
S'agissant des décrets relatifs à la suppression du plastique dans les emballages de fruits et légumes en 2022, je vous confirme qu'une grande concertation est en cours avec les professionnels.
La limitation des plats transformés serait effectivement légitime, madame Préville, mais nous nous heurtons à une difficulté de définition de ce qu'est un plat transformé. En effet, en l'état actuel des classifications, une salade niçoise et un plat de lentilles seraient inclus dans cette catégorie. Nous avons demandé à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) de nous fournir des préconisations sur ce sujet.
Par ailleurs, il faut effectivement encourager la consommation de légumes secs. Cela est prévu dans le plan Protéines végétales.
Au-delà des règles, l'artificialisation des sols est d'abord une affaire de volonté politique. Dans le cadre de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Élan), j'avais pris des positions très dures sur l'ouverture de complexes commerciaux géants et même sur la création de maisons individuelles en périphérie. Bien que cela m'ait valu les foudres de certains, j'estime préférable de privilégier le réaménagement de friches industrielles et la réhabilitation des logements vacants en centre-ville.
S'agissant enfin du code de bonnes pratiques sylvicoles, je n'ai pas encore trouvé la solution. En effet, son rétablissement doit faire l'objet d'une modification législative recevable ; or celui-ci n'est pas réellement en rapport avec le présent texte. Nous étudions la possibilité de l'introduire via une proposition de loi, mais je suis preneur de toute autre solution que le Sénat pourra me proposer !

Comme vous, le Sénat est mobilisé pour défendre nos agriculteurs et leurs produits de qualité. Prenons garde de ne pas les entraver en permettant par ce texte de nouvelles distorsions de concurrence.
Comment envisagez-vous de conduire le « Varenne de l'eau » ? Comment le Parlement y sera-t-il associé ?
Ce projet de loi comporte un volet relatif aux chemins ruraux qui inquiète nos agriculteurs. Quelle est votre position ?
Enfin, la création d'un chèque alimentaire inquiète les acteurs de la solidarité alimentaire, car ce dispositif risque de court-circuiter l'organisation actuelle qui fonctionne bien en dépit des disparités territoriales.

La solidarité alimentaire ne se résume pas à la distribution de denrées : elle implique des échanges et des contacts qui sont importants tant pour les personnes défavorisées que pour les bénévoles.

La rédaction de l'Assemblée nationale remet en cause les fondements actuels du droit de l'eau. Cela m'inquiète d'autant que si vous vous déclarez favorable aux retenues collinaires, cela ne se traduit pas nécessairement dans les faits.
Par ailleurs, je me réjouis que la taxe sur les engrais azotés ait été abandonnée, car ce dispositif aurait créé une distorsion de concurrence au sein de l'Union européenne.
Enfin, je souhaite insister sur la décarbonation que l'agriculture rend possible. Un hectare de maïs produit vingt tonnes d'oxygène et absorbe quatre fois plus de CO2 qu'un hectare de forêt. Quand ces captations de CO2 et ces productions d'oxygène seront-elles rémunérées ?

Je regrette que les préconisations de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée ne soient pas contraignantes. Ce projet de loi n'aurait-il pas pu être l'occasion d'être plus prescriptif ?
S'agissant des biocarburants, une tribune publiée en novembre 2020 par plusieurs associations indique que la France continue d'importer des produits liés à la déforestation, en particulier plus de 3 millions de tonnes de soja par an en provenance du Brésil. Ces associations déplorent l'absence de prise en compte des demandes faites par des parlementaires sur l'exclusion des produits à base d'huile de palme et de soja dans les agrocarburants. Ce projet de loi n'aurait-il pas pu être l'occasion d'affirmer la volonté de transparence de la France en la matière ?
L'agriculture est responsable pour partie de la dégradation de la biodiversité. Malgré une prise de conscience indéniable, certaines tendances lourdes persistent, conduisant notamment à l'intensification des cultures et à l'agrandissement des exploitations. Pensez-vous que les mesures prises dans ce projet de loi sont de nature à inverser ces tendances ?

Il convient de lever la confusion entretenue par certains autour du label agroécologie. En effet, les bénéfices en termes de captation de carbone de l'agriculture de conservation sont variables.
L'aide au maintien a été supprimée pour le « bio ». Ne faut-il pas maintenir ce dispositif pour certaines productions afin que les prix soient moins élevés pour les consommateurs ?
Enfin, nous ne sommes pas à l'abri d'un retournement du marché qui pourrait « casser les prix ». En Autriche, les producteurs bio vendent leurs produits quasiment au même prix que les agriculteurs traditionnels. Ne pourrait-on pas imaginer un système qui conditionnerait la conversion au bio à une forme de contractualisation ?

Comment faire entrer l'agriculture dans l'urbanisme ? Sur quels outils d'urbanisme les acteurs locaux peuvent-ils s'appuyer pour développer les PAT ?
Quelle nouvelle dynamique d'accompagnement de la gestion du foncier local pourrait être développée pour aider les collectivités locales dans leurs stratégies alimentaires et foncières ? En effet, il convient de sortir du cercle vicieux par lequel un propriétaire espère que sa parcelle deviendra constructible pour mieux la vendre, ce qui favorise la déprise agricole, les friches et, à terme, l'étalement urbain.

Quel regard portez-vous sur la proposition émanant du collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation de sanctuarisation d'un budget alimentaire de 150 euros par mois et par personne intégré dans le régime général de sécurité sociale ?

Votre gouvernement envisage d'encourager la construction en bois. Cela exigera notamment un effort de formation.
Le béton de chanvre, en revanche, peut être mis en oeuvre par les maçons traditionnels. Le chanvre étant naturellement peu exigeant, sa culture permettrait de mettre à profit les champs actuellement en friche du fait de la pauvreté de leur terre tout en fournissant un complément de revenu aux agriculteurs, à condition toutefois d'aider des industriels à effectuer sa transformation en matériaux de construction.
La compétitivité de l'agriculture est bien sûr liée aux charges. Si les agriculteurs estiment que celles-ci sont trop lourdes, je rappelle que le monde agricole ne paye pas de taxe de production. Elle est aussi liée à la modernisation et à l'innovation. En 2017, la moitié des drones utilisés à titre économique dans notre pays l'étaient par des agriculteurs. Elle est enfin liée aux économies d'échelle mais il serait dramatique de considérer que notre compétitivité ne tient qu'à la taille de nos exploitations. Un élevage de truies compte en moyenne 190 têtes dans notre pays, alors qu'il en compte 10 000 aux États-Unis. C'est pourquoi j'estime que nous devons avant tout préserver la compétitivité hors coût qu'est la qualité.
Nous allons lancer très prochainement un premier cycle du « Varenne de l'eau ». Celui-ci s'articulera autour de trois groupes de travail qui se concentreront respectivement sur la gestion des risques, l'adaptation de nos pratiques culturales face au changement climatique et le volet hydraulique.
S'agissant des chemins ruraux, j'avoue ne pas être en capacité de vous répondre précisément car ce sujet a été porté par d'autres ministres à l'Assemblée nationale. Je me renseignerai.
Les chèques alimentaires, ou plutôt nutritionnels, sont destinés non pas à aider des personnes qui n'auraient pas les moyens de se nourrir mais à favoriser la consommation de produits de qualité. C'est une politique de santé, et non sociale.
Monsieur Pointereau, je partage votre impatience quant aux retenues d'eau. Il convient toutefois de noter certaines avancées significatives. Par exemple, le décret sur les débits d'usage de l'eau, qui paraîtra prochainement, permettra de combler le vide juridique qui entourait depuis près de dix ans les prélèvements effectués par arrêtés préfectoraux sur les retenues.
Par ailleurs, dans le cadre du plan de relance, j'ai délégué plus de 30 millions d'euros aux territoires afin de compléter les financements locaux des retenues d'eau et des bassines. Comme vous le savez, tout projet de retenue ou de bassine ne peut se faire sans une forte volonté politique locale. Or il n'est pas rare que l'exécutif local renonce à financer ces projets. Enfin, je souhaite que le plan de relance soit l'occasion d'avancer sur le sujet du curage des bassines, qui, de l'avis général, permettrait d'augmenter sensiblement leurs capacités.
Seule l'Europe est compétente pour interdire l'importation de certains produits liés à la déforestation. Pour l'heure, les règles européennes comme celles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) reposent sur une forme d'hypocrisie puisqu'elles permettent d'interdire l'importation des seuls produits qui ont un impact sur notre santé ou sur notre environnement. Autrement dit, loin des yeux, loin de ma conscience environnementale. Ce sont ces règles que nous devons changer et c'est pourquoi le Président de la République a retiré son soutien à l'accord entre l'Europe et le Mercosur.
Vos propos m'ont interloqué, monsieur Jacquin. Je vous accorde que la définition législative de l'agroécologie est très large. S'agissant du bio, le Gouvernement a fait le choix de miser sur l'aide à l'installation plutôt qu'au maintien en agriculture biologique, car il considère que le marché bio est suffisamment mature. Nous discutons actuellement de l'opportunité d'augmenter les aides versées au bio au titre de la PAC de 250 à 340 millions d'euros par an. Les aides à l'agriculture biologique resteront donc massives.
J'estime que conditionner toute nouvelle installation de culture bio à la contractualisation de marchés est un travers qu'il faut éviter. Il faut au contraire favoriser l'entrée de nouveaux producteurs dans le bio.
Le PAT est une organisation territoriale visant à la valorisation du territoire. Les collectivités locales dans leur diversité doivent en conserver l'initiative.
L'agriculture urbaine permet de réconcilier les dissensions entre ruraux et urbains. Le plan de relance permettra notamment le financement d'une bergerie dans les quartiers Nord de Marseille et d'une ferme dans le quartier des Mureaux.
S'agissant du foncier, nous devons avancer en matière de portage.
La RE 2020 vise bien les matériaux biosourcés, monsieur Bacci. Par ailleurs, nous disposons aujourd'hui des technologies nécessaires au développement de la construction bois.

Je vous remercie, Monsieur le ministre.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.

Le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dit « 4D », a été présenté en Conseil des ministres et déposé le 12 mai dernier sur le Bureau du Sénat, date à laquelle le Gouvernement a engagé la procédure accélérée.
Le calendrier d'examen de cette réforme s'annonce très serré puisque le texte devrait être discuté en séance publique dès le début du mois de juillet, à l'ouverture de la session extraordinaire et alors même que notre commission achèvera tout juste l'examen du projet de loi « Climat et résilience ». L'examen en commission devrait d'ailleurs intervenir pendant l'examen du projet de loi « Climat et résilience » en séance publique. Ce calendrier me met en colère, car le texte sera examiné en premier lieu au Sénat et nous aurions besoin de temps pour entendre les élus des territoires ! Je m'en suis entretenu avec le président de la commission des lois et j'ai fait une proposition pour décaler son examen à une autre semaine de juillet.
La commission des lois a désigné comme rapporteurs Mme Françoise Gatel et M. Mathieu Darnaud. D'autres commissions pourraient se saisir pour avis. Notre commission est concernée au titre de trois de ses compétences, puisque le texte comporte des dispositions relatives au climat et à l'environnement - biodiversité, eau et assainissement, économie circulaire, prévention des risques, littoral -, aux transports - routiers, mais aussi ferroviaires - et à l'aménagement du territoire - lutte contre la désertification médicale, gouvernance des collectivités et ingénierie. Plus de vingt articles justifient donc notre saisine pour avis et vont nécessiter un travail approfondi sur un texte dont l'ambition ne semble pas au rendez-vous des attentes.
J'ai reçu la candidature de M. Daniel Guéret : je vous propose de le désigner en qualité de rapporteur pour avis.
La commission demande à être saisie pour avis du projet de loi (n° 588, 2020-2021) relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale et désigne M. Daniel Guéret en qualité de rapporteur pour avis.
La réunion est close à 17 h 10.