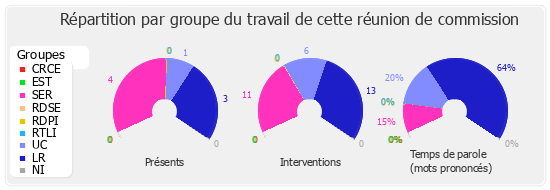Commission des affaires européennes
Réunion du 14 décembre 2023 à 9h05
Sommaire
- Politique étrangère et de défense
- Session d'automne de l'assemblée parlementaire de l'osce en arménie du 18 au 20 novembre 2023 : communication de m. pascal allizard (voir le dossier)
- Institutions européennes
- Réunion des présidents des commissions des affaires européennes et des affaires étrangères organisée par le parlement de la république de moldavie à chisinau du 3 au 5 novembre 2023 : communication de m. andré reichardt (voir le dossier)
- Culture
- Liberté des médias proposition de règlement du parlement européen et du conseil établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010-13-ue com2022 457 final : communication de mmes catherine morin-desailly et karine daniel (voir le dossier)
- Questions diverses
La réunion

Chers collègues, le caractère à première vue assez disparate de notre ordre du jour de ce matin illustre la diversité, mais aussi la cohérence des missions de notre commission.
Nous nous retrouvons en effet, après avoir débattu hier soir en séance publique, avec la secrétaire d'État, avant le Conseil européen qui se réunit aujourd'hui et demain dans un moment historique pour l'Union européenne.
Les chefs d'État ou de gouvernement auront à prendre leur responsabilité, à l'unanimité, pour l'avenir de la construction européenne, concernant l'élargissement en particulier. Nous avons joué hier soir notre rôle de contrôle de l'action du Gouvernement, et la secrétaire d'État nous rendra compte a posteriori des décisions du Conseil européen jeudi prochain. Notre rôle est aussi de suivre l'évolution des organisations internationales qui ont la charge de réguler l'espace européen au sens large, Conseil de l'Europe, et, au-delà, dans l'esprit hélas révolu de l'après-guerre froide, l'OSCE qui sait combien l'Europe est solidaire, pour sa sécurité, de l'Amérique du Nord mais aussi de l'Asie.
La dernière réunion de l'assemblée parlementaire de l'OSCE s'est tenue le mois dernier à Erevan, au coeur d'une zone de conflit entre pays partenaires et voisins de l'Europe, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, après la tragique évacuation des Arméniens du Haut Karabagh à la suite de son annexion fin septembre par l'Azerbaïdjan.
Avant de céder la parole à Pascal Allizard, pour nous présenter le compte rendu de cette mission, je tiens à le féliciter pour sa réélection comme premier vice-président de la délégation française, lors de la réunion reconstitutive qui s'est tenue le 5 décembre dernier, à la suite du renouvellement sénatorial.
Pascal Allizard demeure en outre Représentant spécial pour les affaires méditerranéennes et président de la sous-commission du Règlement de l'AP-OSCE.
Je tiens à féliciter aussi Gisèle Jourda, qui prend à l'AP-OSCE la suite de Jean-Yves Leconte, et maintient, avec Valérie Boyer, la représentation de notre commission au sein de la délégation, tout en faisant au passage progresser la parité. Je la félicite aussi pour son élection comme vice-présidente de la délégation, et souhaite la bienvenue à nos collègues Ludovic Haye, qui a quitté notre commission mais reste dans la délégation à l'AP-OSCE, et Stéphane Demilly, qui a été lui aussi réélu vice-président. Je souhaite également la bienvenue à notre collègue Lucien Stanzione, vice-président du groupe d'amitié France-Arménie. La parole est à Pascal Allizard.

Monsieur le Président, cher Jean-François, chers collègues, nous sommes face à un paradoxe. L'organisation internationale intergouvernementale OSCE, dans sa branche exécutive, traverse sans doute la plus grave crise de sa jeune histoire - nous commémorerons le cinquantenaire de l'Acte final d'Helsinki dont elle est le fruit dans deux ans ! Elle est condamnée sur le plan budgétaire et logistique à un court-termisme jamais vu : jusqu'à la conférence de Skopje, au début de ce mois, elle n'avait aucune visibilité, pour le mois prochain, début de l'année civile 2024, sur sa présidence tournante, assurée par la Macédoine du Nord, sur l'identité de sa secrétaire générale, sur celle des responsables de ses trois principales agences. Son budget était soumis à de difficiles négociations sur des douzièmes provisoires et des contributions volontaires en raison du retrait russe. Puis, la venue du ministre des Affaires étrangères russe à Skopje et le talent des diplomates ont dissipé cette incertitude. Pour combien de temps ?
Le paradoxe, c'est que par contraste, dans un tel climat, l`assemblée parlementaire fonctionne et se porte plutôt bien, dans le sens où elle fait entendre sa voix et peut témoigner d'actions qui ont une certaine influence.
Ainsi, l'on peut dire que la session d'automne qui s'est tenue du 18 au 20 novembre à Erevan a été un succès. Tout d'abord, un succès pour l'Arménie et pour le Parlement arménien, hôte dans un contexte politique international très difficile, après l'annexion du Haut-Karabagh par l'Azerbaïdjan deux mois plus tôt et l'accueil consécutif de 100 000 à 120 000 réfugiés.
Le président du Parlement et le Premier ministre arménien sont venus s'exprimer devant l'AP-OSCE et le Premier ministre Nikol Pachinian a présenté son plan de paix en l'absence, tout de même, de l'Azerbaïdjan, de la Turquie et de la Russie, qui sont pourtant les principaux protagonistes du conflit, voire, dans le cas de la Russie, garante d'une paix possible.
D'autres points plus spécifiques ont été abordés en commission permanente, où je représentai la délégation française, constituée de quatre sénateurs- Valérie Boyer, Gisèle Jourda et Stéphane Demilly - et deux députés. Outre les conflits Ukraine/Russie et Arménie/Azerbaïdjan, le conflit au Proche Orient était également au centre des débats, d'autant plus que s'est aussi tenu le Forum méditerranéen de l'AP-OSCE, que je présidai, en tant que Représentant spécial pour les affaires méditerranéennes. J'y reviendrai dans un instant après avoir abordé brièvement les points relatifs au fonctionnement.
Tout d'abord permettez-moi de faire un point sur le budget 2024, évoqué en commission permanente à Erevan. Le rapport du Trésorier, le Suédois Johann Buser, a insisté à juste titre sur l'inflation, en évoquant des tendances haussières caractérisées. 2024 sera une année d'élections, dans de très nombreux pays membres, ce qui entraînera une augmentation du budget dédié aux missions d'observation électorale de l'AP-OSCE. Les dépenses de personnel vont aussi croître car elles dépendent du droit social en vigueur au Danemark, lequel aligne les salaires sur l'inflation.
Le trésorier dit en outre vouloir faire un effort particulier pour « mettre à niveau » les salaires et avantages sociaux du personnel du secrétariat international de l'assemblée parlementaire sur ceux du personnel des organisations des Nations Unies, ce qui risque inévitablement d'entraîner une hausse sur plusieurs années ; le trésorier dit avoir comme objectif de réaliser cette mise à niveau progressivement sur les quatre prochaines années.
A ces motifs de hausse, j'ajoute les conséquences du retrait russe, qui n'a pas été jusqu'à présent pris réellement en compte au niveau des prévisions budgétaires de l'AP-OSCE. Certes, le Trésorier a fait un appel aux contributions volontaires des États membres, en particulier de ceux, l'immense majorité, dont la contribution est inférieure à 10 000 euros, tout en rappelant que les parlements des États membres peuvent contribuer en mettant à disposition du personnel (cas de l'Allemagne, de l'Italie, de la Turquie), des locaux (cas du Danemark et de l'Autriche) ou en contribuant volontairement à des missions spécifiques. Or, tout cela ne prend pas en compte l'impact structurel du retrait de la Russie, qui est un contributeur important, pour mémoire, de l'ordre de 253 000 euros sur un budget total de 4,2 millions d'euros. La France contribue, elle, pour près de 394 000 euros (l'Allemagne et l'Italie idem) ; le Royaume Uni 383 000 euros ; les États-Unis, plus gros contributeur, 484 000 euros ; le Canada, 233 000 euros ; l'Espagne 193 000 euros...
La volonté d'une renégociation des clés de répartition par pays est affirmée, comme elle est réaffirmée avec constance par la France depuis une dizaine d'années au moins, mais à ce stade et compte tenu du blocage du volet intergouvernemental de l'OSCE, il est permis de douter, hélas, des effets concrets de telles déclarations d'intention. Dans ce contexte, j'ai pris la parole et réaffirmé clairement que les assemblées parlementaires françaises n'accepteraient pas de hausse supplémentaire.
Deuxième sujet, nous avions à discuter d'un amendement du collègue letton Richard Kols. En tant que président de la sous-commission du Règlement, j'ai été amené à prendre la parole sur cet amendement assez paradoxal : il vise en effet à inscrire dans le règlement la règle non écrite qui consiste, dans le cadre de la règle dite du « consensus moins un », à tenir compte des objections formulées par écrit par des délégations qui ne pourraient être présentes aux réunions de la commission permanente, instance décisionnelle principale de l'assemblée, notamment sur le Règlement.
Cet amendement viserait donc à inscrire dans le Règlement une pratique. Seulement, celle-ci fut, comme j'en ai rendu compte, assez contestée, récemment lors de l'assemblée annuelle à Vancouver et auparavant à Varsovie et à Vienne. On ne peut qu'être surpris en outre du fait que le promoteur de cet amendement, notre collègue letton Richard Kols, dit être contre cette pratique, qu'il propose donc de mettre aux voix pour la voir rejetée et ainsi possiblement bannie des usages pourtant constants de l'assemblée. Il souhaitait faire tomber cet usage afin d'exclure les objections formulées par la Russie, or on ne peut exclure juridiquement la Russie de l'AP-OSCE. L'OSCE reste une plateforme de débat et il est nécessaire de conserver ce canal de discussion, en dépit des intentions clairement formulées par notre collègue letton.
C'est pourquoi j'ai pris la parole pour demander solennellement à la commission permanente réunie à Erevan de surseoir à statuer et de renvoyer l'examen approfondi de cet amendement et de toutes ses conséquences à une prochaine réunion de la sous-commission du règlement, qui en rendra compte à la commission permanente, probablement lors de la session d'hiver à Vienne fin février. C'est la décision qui a été prise. Gardez donc en tête que cette règle de « l'unanimité moins un » paralyse la commission permanente actuellement et qu'il y a un vrai risque de rupture de dialogue.
Ces considérations techniques, mais importantes pour le fonctionnement de l'assemblée, étant faites, la réunion de Erevan fut, je l'ai dit, un réel succès : 47 délégations présentes et physiquement représentées de bout en bout (sur les 57 États membres de l'OSCE), plus une délégation « observatrice », celle du Maroc, j'y reviendrai dans un instant - pendant les trois jours et jusqu'au forum méditerranéen qui eut lieu le lundi 20 novembre, certes, je le rappelle, en l'absence remarquée de la Russie, de la Turquie et de l'Azerbaïdjan.
Un des moments forts fut, lors de la séance inaugurale, la présentation par le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, de son plan de paix, visant à désenclaver politiquement et économiquement l'Arménie, en consolidant, rétablissant ou ouvrant de nouvelles liaisons routières et ferroviaires, et cela au lendemain du refus par le président azerbaïdjanais de participer à des pourparlers de paix, sous l'égide du Secrétaire d'État américain.
Il semble que l'on constate depuis lors une relative accalmie des tensions avec l'Azerbaïdjan, liée à sa volonté d'accueillir la COP29, mais nous pouvons sans doute craindre un « gel » du conflit, ouvrant la voie à des revendications futures, alors que Bakou ne donnerait aucun signe concret, en dépit des efforts des uns et des autres, et notamment la France, de vouloir se réengager dans les discussions conduites sous la direction des États-Unis ou de l'UE. Sans doute pouvons-nous aussi nous interroger sur la capacité de la Turquie à passer des messages de modération à l'Azerbaïdjan.
Dans ce contexte omniprésent sur place, que je tenais à rappeler, la première séance fut consacrée au thème de la sécurité et au rôle de l'OSCE dans cette période de conflit, en présence de Mme Helga Schmid, secrétaire générale de l'OSCE, qui était alors encore dans l'incertitude de la prolongation de son poste, finalement intervenue à Skopje au début de ce mois.
Le dimanche s'est ouvert sur une séance consacrée à la lutte contre la corruption, sujet récurrent et menace fondamentale pour la paix et la sécurité, présidée par la vice-présidente chypriote, Irene Charalambides et en présence notamment de représentants de la Banque mondiale et du bureau international de la démocratie et des droits de l'homme (BIDDH), agence importante de l'OSCE.
L'après-midi fut consacré au thème du « respect » et de la protection des minorités et des populations affectées par les conflits, qui sont au coeur de la dimension humaine de l'OSCE. Tous les membres de la délégation se sont exprimés dans les débats, et la plupart dans chaque séquence. On peut dire que la voix de la délégation française a été portée et entendue, sur chacun des sujets à l'ordre du jour.
À noter, pendant les débats de l'AP-OSCE, la présence d'une délégation biélorusse qui s'est plutôt bien tenue, même si ses interventions étaient parfois assez surréalistes, par exemple quand elle s'est mise à accuser la Pologne et l'Union européenne d'avoir fermé leurs frontières à la Biélorussie.
Nous avons pu aussi nous entretenir avec l'ambassadeur de France à Erevan et avec l'attaché de Défense, dont le poste vient d'être créé il y a trois mois après des années de partage de ce poste entre l'Arménie et la Géorgie, marquant le soutien important de la France à l'Arménie dans le domaine de la défense.
En tant que Représentant spécial pour les affaires méditerranéennes, j'ai présidé le Forum méditerranéen, le premier à se réunir en présentiel depuis la Covid. Je rappelle que les six pays partenaires de la Méditerranée sont le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, Israël (donc la Knesset et le conseil national palestinien en son temps) et la Jordanie.
En novembre 2021, il eut lieu en visio-conférence, avec une participation algérienne, marocaine et israélienne. En dépit de mes démarches auprès des représentants permanents des six pays, ne fut présente physiquement à Erevan que la délégation bicamérale du Maroc, comportant des membres de la Chambre des Représentants et de la Chambre des Conseillers. Pour autant, le président de la Knesset avait demandé à participer en visio-conférence. Les Algériens avaient annoncé leur venue mais ne se sont finalement pas présentés. Les Tunisiens sont hélas aux abonnés absents depuis un moment, sur fond de crise politique dans le pays. Les Égyptiens et Jordaniens, pourtant relancés, n'ont pas fait le voyage.
Presque toutes les délégations présentes les deux jours précédents étaient là, permettant une vraie richesse des échanges et des positions au cours de ce forum, où j'ai, pour ma part, dans le climat d'émotion extrême que vous imaginez, tenté de défendre une ligne claire et équilibrée : solidarité totale avec Israël face aux attentats terroristes du 7 octobre et condamnation du Hamas, appel à la libération de tous les otages, reconnaissance du droit d'Israël à se défendre, mais rappel du droit international humanitaire et de la nécessité d'une solution politique, dont la seule actuellement envisageable et internationalement reconnue, quelles que soient les difficultés ou réactions qu'elle suscite, est la solution à deux États.
Cet exercice de dialogue fut réussi, en présence des Marocains, avec qui nous avions tenu préalablement une réunion bilatérale, et de la plupart des représentants des parlements des États membres de l'OSCE. La solution à deux États demeure la solution privilégiée lors des débats avec d'autres délégations. Je souligne le soutien fort à la cause palestinienne chez nos collègues parlementaires du Nord de l'Europe, et constate des visions éclectiques sur la question parmi les membres de l'AP-OSCE.
Cette réunion sera à prolonger, car il me semble qu'avec sa nouvelle présidente finlandaise Pia Kauma, l'Assemblée parlementaire, en l'état de quasi-» mort cérébrale » où se trouve l'organisation intergouvernementale, peut prendre des initiatives en faveur de la paix et de la sécurité et porter la voix des peuples des pays membres : des initiatives concertées, mesurées, mais des initiatives symboliques et fortes. Selon moi, une AP-OSCE sans la Russie n'aurait pas de sens. C'est ce que je retiens, au fond, de cette session à Erevan : la place et le pouvoir de la diplomatie parlementaire, place modeste mais pouvoir réel et significatif.
Je terminerai en vous faisant part d'échanges que nous avons eus avec des étudiants en droit de l'Université franco-arménienne (UFAR). Ces jeunes d'une vingtaine d'année ont tous fait leur service militaire. J'ajoute que 12 jeunes faisant leur service militaire ont péri lors du conflit. Ces jeunes, courageux, volontaires et prêts à retourner au front, sont, il me semble, en décalage avec la situation militaire réelle de leur pays. L'Azerbaïdjan et l'Arménie ont récupéré une structure militaire soviétique à leur indépendance. Si l'Azerbaïdjan a modernisé son armée grâce à ses importants revenus gaziers, l'Arménie ne dispose pas d'une armée moderne et le fossé militaire entre les deux États est aujourd'hui important : quand l'Azerbaïdjan a une centaine d'avion de guerre modernes, l'Arménie en compte dix fois moins et d'une piteuse qualité. Il est donc d'autant plus important de permettre l'envoi en Arménie de matériels militaires, notamment d'anti-missiles, mais également d'instructeurs français destinés à former les troupes locales, tels des chasseurs alpins.
Je vous rappelle enfin qu'entre 100 000 et 120 000 habitants du Haut-Karabagh se sont réfugiés en Arménie, qui tente actuellement de trouver des logements à ces déplacés. J'ai rencontré dans un centre de réfugié des familles, généralement composées de 6 à 8 personnes. Cela peut vous donner une idée du nombre d'appartements ou maisons nécessaires pour accueillir ces populations. Dans ce centre de réfugiés, j'ai pu constater la présence de psychiatres et pédopsychiatres. Les réoccupations des logements abandonnés par les Arméniens ayant fui le Haut-Karabagh sont filmées et diffusées sur les réseaux sociaux en Arménie. Les populations déplacées voient ainsi leur ancienne demeure réoccupée par d'autres familles, provoquant un choc psychologique important chez les familles. C'est selon moi une sorte de cyber-attaque, un exemple de guerre psychologique moderne. Je vous remercie et suis disponible pour répondre à vos questions.

L'intervention de Pascal Allizard a parfaitement retranscrit le climat de notre déplacement. Il s'agissait de ma première participation en tant que membre nouvellement nommée de l'assemblée parlementaire de l'OSCE, où j'ai pris la suite de Jean-Yves Leconte et je remercie mes collègues membres de la délégation française qui m'ont fait confiance, en m'élisant vice-présidente de celle-ci, qui compte huit députés et cinq sénateurs. Nous étions, comme l'a rappelé le président Pascal Allizard, deux députés et quatre sénateurs à Erevan. Nous avons mis au coeur de nos travaux la paix et sécurité, auxquelles j'ajoute la notion de respect, respect des personnes et du droit international.
Je voudrais revenir sur la situation au Haut-Karabagh. Vous connaissez comme moi son histoire, le tracé des frontières en 1991, les tensions qui en ont découlé, les épisodes de guerre, les tragiques déplacements des personnes, tantôt azerbaidjanaises, tantôt arméniennes. Je tiens à rappeler que des drames ont été vécus autant par des familles arméniennes comme azerbaidjanaises, et que les déplacements de population sont traumatiques des deux côtés du conflit. Il est nécessaire de condamner les actions des dirigeants des États agresseurs, mais il est indispensable de garder en tête les douleurs ressenties par les populations civiles.
Je me suis donc exprimée de façon volontariste en faveur de la paix, de la sécurité et de la coexistence pacifique, au-delà des très grandes difficultés présentes.
Il importe en effet que les populations civiles soient protégées, que leurs droits et libertés soient garantis, conformément aux textes nationaux et internationaux. J'ai dit mon soutien aux efforts de la France et de l'Union européenne en ce sens. Comme Pascal Allizard l'a rappelé, il a vu, après notre départ, des centres d'accueil de réfugiés aidés par notre ministère des affaires étrangères.
J'ai aussi exprimé le souhait que l'Azerbaïdjan revienne sur sa décision de ne pas s'engager dans les pourparlers de paix sous la médiation américaine ou européenne et j'ai lancé un appel pour qu'il prenne la voie qui mène vers la signature d'un accord de paix avec l'Arménie. Il me semble que le rôle de cette assemblée parlementaire de l'OSCE est précisément d'inviter toutes les parties prenantes à se rassembler pour trouver une solution définitive, juste, durable et équitable, pour que personne ne se sente spolié et pour que tous retrouvent la paix et la sécurité.
En dépit et à cause même des dures réalités géopolitiques, le long chemin vers la réconciliation doit être amorcé sans attendre. Historiquement, le processus de réconciliation se fait dans le temps long ; après tout, pensions-nous que des négociations de paix puissent aboutir entre la France et l'Allemagne ? Je suis fière que d'une réunion parlementaire puisse surgir une voix vers l'apaisement et le dialogue.
Dans le même esprit, je suis revenue sur la situation en Israël et dans la bande de Gaza. L'acte terroriste horrible et inouï du 7 octobre a déclenché une réponse israélienne vive et sans concessions. L'éradication du Hamas est devenue le but de l'offensive militaire, par les airs et par la terre. L'État d'Israël a le droit et le devoir de se défendre contre le Hamas, qui ne représente en rien le peuple palestinien. Il a aussi le devoir de respecter le droit international, à commencer par le droit international humanitaire.
Les principes du droit international humanitaire, tels que prévus dans la quatrième convention de Genève, visent à protéger les populations civiles en temps de guerre. Il s'agit là d'un pilier essentiel, fondateur même, du droit international qui doit être respecté quelles que soient les circonstances. Il est essentiel de protéger les populations civiles ; il nous faut penser aux enfants, dont près de 10 000 sont décédés sous les bombes à Gaza.
J'ai appelé de mes voeux un Proche-Orient en paix et en sécurité, en invitant l'AP-OSCE à susciter le dialogue en tant que force de réflexion et de proposition pour un avenir plus serein. Telle est aussi la mission du Forum méditerranéen que préside notre collègue Pascal Allizard. Je vous remercie.

Je vous remercie pour votre invitation, Monsieur le Président, représentant Gilbert-Luc Devinaz, président du groupe d'amitié France-Arménie.

Je remercie Gisèle Jourda et Pascal Allizard pour ce très intéressant exposé. Lorsqu'on avait encore la possibilité de se déplacer en Azerbaïdjan, j'ai rencontré il y a 10 ans certains des 800 000 déplacés azerbaïdjanais du Haut-Karabagh, rejetés dans l'indifférence totale de l'agression arménienne dans la région, soutenue par la Russie. Il ne faut pas oublier que Moscou a soutenu activement l'armée arménienne à l'époque. La France était alors présidente du groupe de Minsk, qui n'a pas écouté suffisamment les avertissements des uns et des autres. Si l'armée arménienne est dans l'état décrit par Pascal Allizard, c'est car elle dépendait fortement des armes et financements russes ; or la Russie a lâché aujourd'hui l'Arménie, ouvrant la voie aux ingérences turques et iraniennes dans la région.
Plus rien n'empêchait donc l'agression menée par l'Azerbaïdjan. Je ne la défends pas, je souhaite briser une vision manichéenne du conflit, car les agresseurs d'aujourd'hui sont les agressés d'hier. Je rappelle également que si un grand nombre d'Arméniens du Haut-Karabagh ont quitté l'Arménie pour l'Europe, les Azerbaïdjanais n'avaient pas eu en 2009 cette possibilité. Des dizaines de milliers de réfugiés en provenance du Haut-Karabagh étaient contraints de vivre sous des tentes à Bakou car le secteur de la construction du pays n'arrivait pas à suivre la cadence. Je souhaite ainsi souligner qu'il faut se souvenir des évènements passés sur cette question du Haut-Karabagh.

Vous avez tout à fait raison. Il est vrai que le Caucase a toujours été une région complexe. La question est selon moi de savoir jusqu'où l'Azerbaïdjan est prêt à aller : souhaite-t-il édifier un « grand Azerbaïdjan », annexer l'Arménie et faire d'Erevan une capitale régionale ? Ce n'est pas qu'un fantasme. Vous avez cité l'Iran, c'est en effet un vrai sujet. Les trois puissances voisines du Caucase portent une vraie responsabilité sur la situation actuelle, tant dans le rôle d'influence et d'aide directe ou indirecte apportée à un des belligérants. Si la Russie n'a pas soutenu l'Arménie cette fois, elle tient ses engagements à la frontière arméno-turque. Mais nous savons également qu'une consigne suffit pour changer le statu quo, telle est la stratégie russe dans les conflits gelés. Concernant le groupe de Minsk, je tiens à souligner les efforts entrepris malgré le manque de résultats. Il semble que la volonté de revanche a primé sur ces intentions.

Merci pour vos éclairages. Je constate un parallélisme au sein des différentes organisations internationales accueillant des débats parlementaires : l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe est traversée par les mêmes débats et tensions entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Je constate que les Arméniens sont particulièrement vindicatifs. Ils se sentent aujourd'hui agressés mais oublient parfois de considérer la situation au Haut-Karabagh dans un contexte plus large de démantèlement de l'URSS. Le corridor de Latchine est aujourd'hui une réelle source d'inquiétude.
Il est toujours difficile d'appréhender le rapport de force tant militaire que géopolitique. Sur le premier point, l'Arménie est particulièrement faible vis-à-vis de l'Azerbaïdjan comme vous l'avez déjà dit. Diplomatiquement, l'Arménie est isolée : la réponse de l'Union européenne a été disons modérée, même si la France était en pointe et soutenait activement le pays. Il est nécessaire de mettre la pression sur l'Azerbaïdjan pour qu'il respecte le droit international et l'intégrité territoriale de l'Arménie. Et ce, même si certains États européens ont des intérêts à maintenir une bonne relation avec Bakou, grand producteur et exportateur de gaz.

Je partage totalement les propos de Didier Marie. J'ajoute que la force de l'Arménie est également sa faiblesse, à savoir sa diaspora à l'internationale. Celle-ci parle souvent plus fort que les Arméniens qui vivent en Arménie. En échangeant avec les étudiants, j'ai eu l'impression qu'ils comptaient énormément sur la diaspora malgré les limites évidentes de se reposer sur cette dernière. Je reste très inquiet sur l'évolution prochaine de la situation locale. Le professeur de ces étudiants s'est par ailleurs offusqué sur le manque d'aide concrète apportée au pays. Je lui ai rappelé qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de soutien de l'opinion publique en faveur d'une intervention de troupes au sol en Arménie dans un contexte de retrait des troupes américaines d'Irak ou des troupes françaises du Sahel.
C'est pour cela qu'il est primordial de continuer à soutenir la voie diplomatique. L'hypothèse d'un « grand Azerbaïdjan » est une menace réelle et agitée dans les négociations et c'est notre devoir de rester vigilant à cet égard. Quant à l'Arménie, je souligne que l'environnement national reste difficile, avec une trajectoire économique et militaire incertaine et en retard sur les enjeux du XXIème siècle.

Il faut être vigilant vis-à-vis de la diaspora arménienne. Je ne suis pas persuadée que les Arméniens d'Arménie partagent les sentiments et visions de cette diaspora. C'est à nous, parlementaires, de veiller à éviter toute distorsion de réalité.

Je profite de ces débats pour interroger les initiatives de la Commission des affaires européennes concernant le Partenariat oriental. Le 11 décembre, une réunion s'est tenue entre les ministres de l'UE ayant abouti à un accord sur la nécessité de renforcer le Partenariat oriental avec de nouvelles modalités. Il peut être, selon moi, opportun pour la commission de relancer son travail à cet égard. Pourquoi ne pas recevoir les ambassadeurs des États membres du partenariat par exemple, pour faire le point sur les accords en cours ?

L'accord avec l'Azerbaïdjan est en cours d'élaboration mais n'a jamais été signé.

Je tiens à souligner qu'un déplacement de la commission des affaires européennes est prévu en Géorgie. On peut bien sûr envisager une table-ronde réunissant les six ambassadeurs concernés mais il serait sûrement délicat de les réunir tous autour de la même table en ce moment

Pour conclure en revenant sur les propos de Gisèle Jourda, il est effectivement nécessaire de miser sur la voie diplomatique. Ce sont toujours les populations civiles qui souffrent le plus, quel que soit le conflit.

J'en profite pour faire valoir que la conférence des présidents a décidé d'inscrire à l'ordre du jour la proposition de résolution portée par Bruno Retailleau et Gilbert-Luc Devinaz condamnant l'agression de l'Azerbaïdjan et appelant à éviter la reproduction des évènements récents au Haut-Karabagh. Elle sera examinée le 17 janvier prochain en séance. Il est absolument nécessaire de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter que la situation empire.

Après l'Arménie, nous allons évoquer un autre partenaire, plus proche, car déjà candidat à l'adhésion et directement concerné par le Conseil européen de ce jour : la Moldavie. Dans le cadre de nos tables rondes sur l'élargissement, nous avons auditionné il y a quinze jours sa dynamique ambassadrice à Paris. Nos contacts sont réguliers et étroits avec ce pays, dont nous recevons régulièrement les parlementaires, notamment la présidente de la commission de la politique étrangère et de l'intégration européenne de son Parlement, Sonia Gherman, qui a réuni le 4 novembre dernier à Chisinau, quelques jours avant la publication du paquet «élargissement » de la Commission européenne, les collègues présidentes et présidents des commissions des affaires européennes des parlements nationaux de l'UE. Je n'ai pu m'y rendre et je remercie André Reichardt de m'y avoir représenté, comme vice-président de la commission. Il a la parole pour nous rendre compte de sa mission.

Merci Monsieur le Président, cette communication est d'actualité, puisqu'a lieu aujourd'hui la réunion du Conseil européen qui doit se pencher sur l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Ukraine, la Moldavie et la Bosnie-Herzégovine et sur l'octroi du statut de candidat à la Géorgie.
J'eus l'honneur et le plaisir de vous représenter, Monsieur le Président, à la réunion des présidents des commissions des affaires européennes et des commissions des affaires étrangères des parlements de l'Union européenne, organisée à Chisinau, le samedi 4 novembre dernier, par la présidente de la commission de la politique étrangère et de l'intégration européenne du Parlement de la République de Moldavie, Mme Sonia Gherman.
Cette réunion, qui se tint sous le label « United 4 (for) Moldova » fut à ma connaissance une première. Certes, nous avons déjà échangé avec votre homologue moldave, à de nombreuses reprises, en particulier depuis que la Moldavie s'est vue reconnaître le statut de pays candidat par le Conseil européen de juin 2022 : au Sénat, lors de la Cosac pour ce qui vous concerne et lors du précédent déplacement que je fis en Moldavie avec Gisèle Jourda et Marta de Cidrac, du 24 au 27 avril dernier, un mois avant le sommet de la Communauté Politique européenne.
Cette fois-ci, la volonté manifeste du Parlement moldave et de la Présidente de la République Maïa Sandu, très impliquée, avec son gouvernement, dans cet événement, était de réunir une plateforme parlementaire européenne de soutien à la Moldavie, dans la perspective de la décision que pourrait prendre le Conseil européen réuni aujourd'hui et demain à Bruxelles, quant à l'ouverture de négociations avec deux des pays candidats, l'Ukraine bien sûr, mais aussi la Moldavie.
Le sort de cet État frontalier de la Roumanie à l'Ouest et de l'Ukraine à l'Est, qui fut en première ligne dès le déclenchement du conflit, en accueillant plus de 600 000 réfugiés, dont plus de 100 000 sont restés, paraît en effet indissolublement lié à celui de son grand voisin en guerre. Et pourtant, cette réunion avait pour objectif de faire valoir ses « mérites propres » dans la perspective de l'ouverture, éventuellement prochaine, de négociations d'adhésion.
D'où cette véritable plateforme parlementaire de soutien à la Moldavie, élargie à l'ensemble des parlements de l'Union européenne, par analogie avec la plateforme gouvernementale créée dès le printemps 2022 par la France, l'Allemagne et la Roumanie, pour aider le pays à faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine : conséquences humanitaires, bien sûr, mais aussi énergétiques - le pays importait alors la totalité de son gaz de Russie ou de Transnistrie occupée par la Russie - ainsi qu'économiques et financières, la France et l'Allemagne ayant mobilisé massivement l'aide européenne mais aussi celle des bailleurs de fonds internationaux en faveur de ce pays confronté à une inflation vertigineuse.
C'est le rôle de la diplomatie parlementaire que de faire écho, de stimuler et d'épauler les initiatives gouvernementales. Comme l'a indiqué le président Rapin, le Sénat n'a pas manqué d'appuyer les efforts du gouvernement français en faveur de la Moldavie.
J'y suis allé avec votre homologue de l'Assemblée nationale, M. Pieyre-Alexandre Anglade, qui a dû regagner Paris avant la fin de la réunion. Il est vrai que nous avions mis une bonne journée à rejoindre, la veille, la capitale moldave, en raison des vicissitudes des liaisons aériennes, nous faisant vivre concrètement à quel point ce pays demeure enclavé. Certes, il est bien relié à la Roumanie, toute proche, mais sinon, un besoin criant de liaisons aériennes directes plus nombreuses et plus régulières se fait ressentir.
Peut-être faut-il y voir l'une des raisons du périmètre des parlements présents représentant une bonne moitié des pays membres, mais avec quelques absents de taille, notamment l'Espagne, présidente en exercice du Conseil de l'Union européenne, et l'Allemagne. Des pays aspirant à la candidature étaient aussi représentés, telle la Géorgie. J'ai noté, outre la très forte présence de nos collègues roumains, une importante délégation italienne, qui fit le geste significatif de venir accompagnée de ses interprètes, afin de pouvoir s'exprimer dans sa langue, sans sacrifier au bilinguisme roumain-anglais imposé lors de cet exercice, j'espère pour des raisons strictement logistiques...
La réunion était opportunément programmée à quelques jours de la publication du rapport de la Commission européenne sur le pays, dans le cadre du « paquet élargissement », sorti le 8 novembre. À entendre les propos du chef de la délégation de l'UE sur place, son appréciation positive ne faisait aucun doute, la Commission ayant, vous le savez, souligné les progrès réalisés par le pays dans la mise en oeuvre de ses neuf recommandations, lui permettant de se rapprocher des critères de Copenhague, en particulier en matière d'État de droit, de justice, de lutte contre la corruption, domaines qui furent au coeur des débats et du bilan présenté par les autorités moldaves : outre la présidente Maïa Sandu, le président du Parlement, M. Igor Grosu, le Premier Ministre, M. Dorin Recean, mais aussi les ministres de l'intérieur et de l'énergie, et le remarquable conseiller de la présidence pour la défense et la sécurité nationales.
Gouvernement et Parlement ont ainsi souligné à l'unisson l'ampleur des progrès, des attentes, mais aussi des difficultés de la Moldavie, économiques et énergétiques, mais aussi de sécurité, dues aux importantes « menaces hybrides » venant de la Russie.
Les débats ont porté sur trois points, et je me suis efforcé de porter notre voix sur chacun d'entre eux.
Le défi de l'intégration européenne, tout d'abord, avec des regards croisés intéressants, dans une approche qui se voulait autant rétrospective que prospective, en essayant de tirer les enseignements des précédents élargissements. Dans mon intervention, tout en rendant hommage aux efforts remarquables réalisés par le pays en peu de temps et dans un contexte très difficile, j'ai attiré l'attention sur la nécessité que les pays candidats respectent les trois critères de Copenhague - État de droit démocratique, économie de marché, acquis communautaire- mais aussi qu'un quatrième, souvent passé sous silence et qui relève pleinement de notre appréciation de parlementaires nationaux, soit respecté : je veux parler de la capacité d'absorption de l'Union européenne. Sur ce dernier point, j'ai senti que certains pays européens ne partageaient pas vraiment ma position, estimant qu'il fallait intégrer rapidement la Moldavie ou l'Ukraine.
Le deuxième thème abordé fut le développement économique et la sécurité énergétique du pays. Cette dernière a beaucoup progressé, grâce au développement des interconnexions et avec le soutien financier important de l'Union européenne. Mais un effort accru est requis pour intégrer la Moldavie au marché intérieur européen de l'énergie. J'ai souligné l'implication de l'agence française de développement.
Principale partenaire commerciale et investisseure dans le pays, l'Union européenne joue naturellement un rôle majeur, dans la droite ligne des acquis du partenariat oriental.
J'ai aussi rappelé l'importance de progrès concrets pour la population moldave. La réduction des frais d'itinérance, que vous avez soutenue, Monsieur le Président, auprès du Commissaire Thierry Breton, en est un, particulièrement apprécié, comme l'a rappelé ici même l'ambassadrice de Moldavie lors de la table ronde du 30 novembre dernier.
Je suis néanmoins revenu de Chisinau avec le sentiment d'une inquiétude persistante sur la résilience économique et sociale du pays. Certes, les derniers chiffres affichés sont bons : le gouverneur de la Banque Nationale Moldave a annoncé que le taux d'inflation avait reflué par rapport à son plus haut niveau il y a un an, qui atteignait près de 35 %, pour revenir à quelque 6 % au mois d'octobre 2023. Mais est-ce soutenable ?
Le projet de loi de finances prévoit notamment une hausse du salaire minimum de 208 à 260 € ainsi qu'une augmentation de 15 % du traitement des enseignants.
Il reste du travail à faire. Lors de cette mission, nous avons été dans d'autres parties de la Moldavie, comme à Orhei, qui ressemblait à une campagne française de la seconde moitié du siècle dernier. Alors qu'il s'agissait d'une zone touristique, il n'y avait pas de voies asphaltées, mais des puits pour récupérer l'eau. Je suis donc un peu inquiet sur la résilience économique et sociale du pays.
Une grande partie de la population bénéficiera cet hiver encore de la prise en charge par l'État d'une partie du montant des factures d'énergie grâce à un fonds abondé par l'Union européenne. Si les manifestations orchestrées par le parti Shor et ses affiliés ont disparu, elles sont actuellement remplacées par celles des producteurs locaux de céréales dont les dizaines de tracteurs stationnent devant le bâtiment du gouvernement pour protester contre l'insuffisance du soutien financier de l'État à ce secteur sensible.
Autre domaine abordé lors de la réunion parlementaire de Chisinau, qui fait apparaître la résilience, certes, mais aussi la vulnérabilité de ce pays : la sécurité. J'ai réitéré le soutien de la France aux efforts d'équipement de la défense moldave, soutenus notamment dans le cadre de la facilité européenne pour la paix, le pays tentant de développer ses capacités, dans le contexte de la neutralité à laquelle la grande majorité des responsables et la population semblent très attachés, cette neutralité étant inscrite dans sa Constitution telle une assurance-vie.
La guerre en Ukraine a évidemment accru l'exposition géopolitique - déjà forte - de la Moldavie, dont une partie du territoire, à l'Est, la Transnistrie, est autoproclamée indépendante, et de fait occupée par la Russie à la suite d'un conflit violent, gelé depuis 1992. Or c'est là que se trouvent l'industrie et les seules ressources énergétiques de ce pays très rural. Au Sud, « l'unité territoriale autonome de Gagaouzie » est peuplée d'une communauté turcophone fortement russifiée et la gouverneure, pro-russe, élue en mai 2023, membre de droit du gouvernement moldave, est issue du parti pro-russe de l'oligarque en exil Ilan Shor.
Cette réunion intervenait aussi, et sans doute n'est-ce pas un hasard du calendrier, la veille du premier tour des élections locales. Le Vice-Premier Ministre Nicu Popescu nous avait d'emblée prévenu, lorsque nous l'avions rencontré fin avril, qu'elles ne seraient pas favorables au Parti Action et Solidarité (PAS) de Maïa Sandu, car concentrées sur les enjeux locaux. J'ajoute une autre raison : la non-participation à ces élections de la très nombreuse diaspora moldave.
Elles visaient à élire pour quatre ans 898 maires et 12 000 conseillers locaux désignant les 32 présidents de districts. Les résultats furent mitigés, avec une participation de 41 % au premier tour, identique à celle des élections de 2019, et de 37 % au second tour qui eut lieu le 19 novembre.
Si le PAS a obtenu le plus grand nombre de mairies lors de ces élections, il a dû concéder deux défaites dans les deux principales villes du pays. Dans la capitale, le maire sortant M. Ion Ceban, leader d'un parti « centriste » qui se prétend pro-européen mais rallie en fait les suffrages des pro-Européens et des pro-Russes, le Mouvement alternatif national (MAN), a été réélu dès le premier tour, avec 51 % des voix. Il est vu comme un candidat sérieux à l'élection présidentielle de l'an prochain contre Maïa Sandu. A Balti, deuxième ville du pays, le candidat du PAS n'a pas non plus atteint le second tour. L'ancien communiste Alexandr Petkov, élu maire, sous l'étiquette « Notre Parti », financée par un homme d'affaires ayant des liens avec la Russie, a déclaré que les résultats de ces élections montrent que « de nombreux Moldaves sont favorables au développement des relations avec la Russie ». Aucun candidat du PAS n'est élu dans les 11 principales villes du pays. D'autres maires élus dans des villes petites ou moyennes demeurent liés à Ilan Shor.
Même si la plupart des observateurs parient sur la réélection de Maïa Sandu lors des élections présidentielles de novembre 2024, l'obtention d'une majorité parlementaire lors des élections législatives du printemps 2025 paraît incertaine. Et la Moldavie fait partie des pays où la culture de coalition n'est guère encore entrée dans les moeurs.
À Chisinau comme ailleurs, la présidente Sandu a martelé que l'adhésion à l'Union européenne est une question existentielle pour un pays qui, pendant trente ans, a payé le prix de sa situation géopolitique d'État « tampon » et de sa dépendance multiforme à l'égard de Moscou. La récente stratégie nationale de sécurité qui nous a été présentée désigne ainsi la Russie comme la première menace et dénonce la « guerre hybride de haute intensité » menée par cette dernière dans le but de « prendre le contrôle politique et économique » de la République de Moldavie.
Les Moldaves nous ont demandé de faire attention à eux. Si la Moldavie ne devait pas entamer les négociations avec l'Union européenne, ce serait un signal fort envoyé à la Russie. S'il y avait eu un déclenchement de la guerre en Ukraine avec une Moldavie sous obédience russe, l'Ukraine aurait été enclavée.
C'est dire combien les attentes sont fortes à l'égard du Conseil européen qui se réunit aujourd'hui et demain. La Moldavie estime avoir suffisamment de mérites pour entrer dès à présent dans les négociations d'adhésion. Des efforts ont été faits, mais il appartiendra au Conseil européen de déterminer s'ils sont suffisants. Nous avons intérêt à examiner de près ce sujet, car j'ai le sentiment - et je ne suis pas le seul - qu'il y a encore beaucoup de travail à faire.

Je suis d'accord sur le fait que la réflexion doit être approfondie sur cette question. J'ai rencontré Maïa Sandu à plusieurs reprises, et nous avons de bonnes relations avec nos homologues. Je ferai trois séries d'observations : d'abord 80 % des Moldaves ont des passeports roumains, et sont quasi-de fait dans l'Union européenne, mais pas dans l'espace Schengen. Si l'on décide de faire entrer la Roumanie dans l'espace Schengen, on y ferait ainsi quasiment rentrer la Modalvie. Deuxième point : les soldats russes qui sont en Transnistrie où il y a des réserves de munition très importantes depuis la Seconde guerre mondiale représentent un risque, qui est - pour le moment - contenu en raison d'accords fragiles puisque Maïa Sandu nous a indiqué qu'il ne faudrait qu'une demi-journée aux 1 700 soldats russes pour envahir la Moldavie, qui n'a pas de moyens de défense. Troisième point : la capacité d'intégration de la Moldavie avec la pression forte des oligarques dont l'influence reste importante, notamment dans les élections, malgré leur absence. Ces facteurs de risque doivent être pris en compte dans la réflexion en cours sur l'ouverture des négociations d'adhésion, tout comme le fait que la Moldavie est un pays francophone et francophile.

La situation de la Moldavie est l'illustration de la dislocation de l'URSS et de sa stratégie de colonisation, et bien avant de la volonté de l'impérialisme russe. La présence russe en Transnistrie est militaire mais aussi civile, avec la présence d'une population russophone très importante en Transnistrie.
J'ai été surpris positivement des propos de l'ambassadrice de Moldavie, que notre commission a auditionnée la semaine dernière, indiquant que le gouvernement moldave recherchait un accord de réintégration de la Transnistrie par le développement des échanges et soulignant qu'il y avait autant de personnes en Transnistrie qui avaient des passeports roumains, que dans le reste de la population moldave, laissant ainsi entendre que la population ne se sentait pas nécessairement dans une république autonome, mais était partie prenante de la Moldavie et de son aspiration européenne. Je ne sais pas quelle portée il faut donner à cette observation.

Oui, mais cela nous rappelle l'obligation géopolitique qui est la nôtre d'apporter à ce pays notre soutien dans ce conflit larvé, avec la présence de 1 700 militaires russes. On peut également s'interroger sur la passivité de ces militaires russes, à la frontière de l'Ukraine alors que la zone de conflit se trouve à côté. On peut imaginer l'avantage que pourrait retirer la Russie d'une mobilisation de ces militaires pour intervenir en Ukraine...

Je souhaitais apporter un tempérament à ces observations. Nous devons faire attention à ne pas projeter le souhait des gouvernements sur que pense la population. Lorsque nous nous sommes rendus, en Moldavie, avec Marta de Cidrac et André Reichardt, nous avions discuté avec de jeunes étudiants francophones, qui n'étaient pas contre l'Europe mais pas non plus anti-russes, puisque certains avaient des membres de leur famille russes en Transnistrie. Il faut également rappeler que les progrès faits en matière de justice, de droits de l'homme, ou de corruption par exemple - dans le cadre des contrats d'association de la Moldavie mais aussi de l'Ukraine et de la Géorgie - ont pu être suivis de régressions...Il faut donc être prudent sur cette question.

Je rappellerais aussi une image qui m'a marqué : quand nous sommes allés en Roumanie - dans le cadre d'un déplacement de la commission -, nous avons vu, à la frontière moldave, les agriculteurs cultiver leurs champs avec des chevaux et des carrioles. De même, à la frontière entre la Slovaquie et l'Ukraine, nous avons eu l'impression d'un retour 30 ans en arrière. Il s'agit pour ces populations d'effectuer une transformation profonde de leur mode de vie. À l'inverse, il nous reviendra d'intégrer ces populations et de les faire converger. Aujourd'hui par exemple, il y a une très grande différence de mode de vie entre la Roumanie et la Moldavie.
Culture
Liberté des médias proposition de règlement du parlement européen et du conseil établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010-13-ue com2022 457 final : communication de mmes catherine morin-desailly et karine daniel

Nous poursuivons notre ordre du jour avec une autre facette de notre rôle de suivi des travaux des institutions européennes, un rôle d'information et d'alerte, sur l'évolution des textes législatifs européens. Ce rôle ne se limite pas à l'adoption de résolutions ou d'avis, qui sont officiellement transmis à notre Gouvernement et à la Commission européenne et au Parlement européen. Après que nous avons adopté et transmis ces positions politiques, il nous revient de suivre le parcours législatif de ces textes et d'en informer nos collègues.
C'est ce que nous faisons ce matin, sur le projet de règlement européen sur la liberté des médias, sur lequel nous avions adopté, il y a presque un an jour pour jour, un avis motivé au titre de la subsidiarité. Nous avons aussi organisé, au printemps et cet été, deux tables rondes sur les enjeux de ce texte, pour la presse écrite et l'audiovisuel, en commun avec la commission de la culture.
C'est Catherine Morin-Desailly, qui a sur ces sujets une longue et profonde expertise qui nous en parle, avec Karine Daniel, qui a repris le flambeau d'André Gattolin et de Florence Blatrix Contat et dont je salue la première communication dans notre commission.

C'est une brève communication que nous vous proposons aujourd'hui sur un texte qui a eu un assez long parcours législatif européen : le projet de règlement européen, dit aussi « acte européen » sur la liberté des médias, désormais connu, sous son acronyme anglais de Media Freedom Act ou MFA.
Son ambition est grande : instaurer un cadre législatif européen commun pour l'ensemble du secteur des médias et de la presse.
Nous partageons l'objectif louable de cette nouvelle législation européenne : il s'agit, au vu des constats qui ont pu être faits depuis plusieurs années dans quelques pays de l'Union, et récemment en Pologne ou en Hongrie, de renforcer la liberté et l'indépendance éditoriale des entreprises de médias, en recommandant des financements dédiés aux médias de service public, des mesures sur l'attribution équitable et transparente de la publicité, des règles sur la transparence de la propriété des organes de presse et un contrôle des concentrations.
Ce texte institue pour cela un comité de régulation européen qui jouerait également un rôle spécifique dans la lutte contre la désinformation et les fake news. Ce comité se substituerait au groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels (dit Erga, de son acronyme en anglais, European Regulators Group for Audiovisual Media Services, institué par la directive de l'UE sur les services de médias audiovisuels, dite directive SMA). D'où les modifications proposées de ladite directive, supprimant son article 30 ter instituant l'Erga, et remplaçant en conséquence les références qui y sont faites pour le remplacer par un « Comité » européen de régulation des médias, dénommé « Board » en anglais.
Il s'agit ainsi de protéger les entreprises de médias contre des mesures nationales « injustifiées, disproportionnées et discriminatoires », afin de préserver le pluralisme du paysage médiatique européen, de garantir son bon fonctionnement et de renforcer la protection de l'État de droit, dans un contexte international et européen où celui-ci est parfois remis en cause, au sein même de l'Union européenne, dans certains États membres, mais aussi dans des États candidats ou potentiellement candidats, et, dans la plupart des États membres, souvent mis au défi par l'expansion d'internet, des grandes plateformes et des réseaux sociaux, mais aussi par les risques d'ingérences d'États tiers, dans les campagnes électorales nationales ou européennes, notamment. La France n'échappe pas à ces faits.
Qui ne souscrirait à cette vaste ambition ?
Elle fit partie du programme de la Commission européenne dès le début de son mandat et fut en conséquence annoncée dès 2021 par la présidente Ursula von der Leyen : « Les médias ne sont pas des entreprises comme les autres. Leur indépendance est essentielle. Voilà pourquoi l'Europe a besoin d'une loi qui garantisse cette indépendance. »
Notre commission avait évoqué ce texte initialement le 8 décembre 2022, sur le rapport de Catherine Morin-Desailly, André Gattolin et Florence Blatrix Contat, afin d'examiner sa conformité au principe de subsidiarité et avait conclu que la proposition initiale de la Commission européenne du 16 septembre 2022 n'était pas conforme à ce principe, pour des raisons qui sont détaillées dans l'avis motivé adopté devenu résolution du Sénat le 11 décembre 2022.
Sans les reprendre toutes, permettez-moi de les rappeler à grands traits.
Tout d'abord, la Commission européenne fondait sa proposition législative sur le seul article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) relatif au marché intérieur. Or nous faisions valoir, aux côtés d'autres parlements nationaux, dont le Bundesrat, et de nombreux acteurs du secteur, que cette seule approche était réductrice, au regard de la diversité culturelle et linguistique dont les médias et la presse, régionale en particulier, et les radios locales sont aussi l'expression naturelle. C'est pourquoi l'article 167 du TFUE qui se réfère à la diversité culturelle constituait, à notre avis, une base juridique tout aussi pertinente et robuste.
Or, en cette matière, selon l'article 6 c) du TFUE, l'UE ne dispose que d'une compétence d'appui, venant en complément ou en soutien de celle des États membres, ce qui ne justifie nullement une harmonisation législative, laquelle pourrait d'ailleurs se faire aussi bien par le haut que par le bas, entraînant un risque de nivellement pour les États membres ayant un corpus législatif ancien et solide en ce domaine, tel notre pays.
Ainsi, notre avis motivé rappelle la solidité de notre cadre législatif national, reposant sur deux grands piliers que sont les grandes lois républicaines du 29 juillet 1881 pour la presse et du 30 septembre 1986 pour l'audiovisuel.
Nous pointions aussi les risques d'incohérence ou en tout cas d'articulation insuffisante avec les trois principaux textes européens qui constituent la base de l'acquis communautaire en matière de régulation des médias : la directive sur les services de médias audiovisuels (dite SMA) ; la directive établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio (dite CabSat2) ; et le règlement relatif à un marché unique des services numériques (dit DSA).
Nous avions enfin souligné la nécessité de respecter les spécificités professionnelles et législatives de deux écosystèmes qui demeurent très différents, en dépit des convergences numériques : la presse et l'audiovisuel.
Nous n'avons, pas, à l'époque, suscité suffisamment de vocations dans d'autres parlements nationaux, pour envoyer un « carton jaune » à la Commission européenne. Mais nous avons été entendus sur bien des points, au fur et à mesure du cheminement législatif de ce texte, qui approche désormais de sa phase finale.
Notre commission y a contribué, en organisant, les 23 mars et 22 juin de cette année, en commun avec la commission de la culture, deux tables rondes qui nous ont permis de « débroussailler » les enjeux de ce texte, avec les acteurs du secteur et le régulateur national du secteur audiovisuel, l'Arcom, dont nous avons entendu le président, M. Maistre : la première était consacrée à la presse écrite ; la seconde, aux médias audiovisuels. Nous y avons convié notamment le rapporteur pour avis de la commission du marché intérieur du Parlement européen, qui a porté plusieurs de nos préoccupations au cours du parcours de ce texte au sein de l'Assemblée de Strasbourg.
Nous nous en réjouissons car la période estivale, puis le renouvellement sénatorial ne nous ont pas permis de nous exprimer plus avant sur ce texte, pendant qu'il poursuivait son cheminement institutionnel.

Merci, j'ai plaisir à travailler dorénavant avec vous d'autant que nous siégeons ensemble à la commission de la culture. Je tiens aussi à saluer le travail accompli par Florence Blatrix Contat, ici présente, depuis que nous nous sommes saisis de ce texte il y a plus d'un an. Nous avons également une pensée pour notre ancien collègue André Gattolin.
Le Parlement européen a adopté, le 3 octobre dernier, de très nombreux amendements à ce texte, dont la version finale devrait être adoptée demain ; nous avons la satisfaction de constater que plusieurs d'entre eux l'améliorent notablement au regard de nos observations.
Parmi les principaux apports du Parlement européen, je retiendrai les quatre suivants.
Tout d'abord, dans la droite ligne de notre avis motivé, adopté il y a un an, nous pouvons nous féliciter de l'accent mis par le Parlement européen sur la visée de ce texte qui est de créer une norme minimale pour protéger le pluralisme et l'indépendance des médias dans l'ensemble de l'UE.
En effet, comme le Bundesrat allemand, mais aussi plusieurs pays nordiques, nous estimons que cette harmonisation législative a minima doit laisser toute latitude aux États membres de maintenir des normes plus élevées - comme c'est le cas en France - et de continuer aÌ développer leur propre réglementation des médias afin de protéger la libertéì et le pluralisme et de promouvoir la diversité culturelle et linguistique. Cela est très important car ce n'était pas très explicite dans le projet initial de la Commission européenne et aurait pu amener, à terme, à la remise en cause, au nom du droit de la concurrence ou du marché intérieur de certaines dispositions favorables au secteur qui sont ainsi mieux protégées.
Sur le financement du service public, qui est en débat en France actuellement, comme nous l'avons vu la semaine dernière au Sénat, les fondamentaux sont précisés, tout en maintenant la marge de manoeuvre qui doit être laissée aux États, laquelle est importante, en vertu du traiteì sur le fonctionnement de l'Union européenne et de son protocole n° 29 sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres (dit « protocole d'Amsterdam »). Si le règlement entend protéger les médias publics, le texte initial ne comportait qu'une formule évasive : le secteur public « doit bénéficier de financements suffisants et stables » et assurer une prévisibilité et une planification. Le texte actuel correspond en tous points à nos débats au Parlement français : « il est nécessaire de garantir que, sans préjudice des règles de l'Union relatives aux aides d'État, les fournisseurs de médias de service public bénéficient d'un financement stable et suffisant pour remplir leur mission, qui assure la prévisibilité de leur planification et leur permette de concevoir des offres pour de nouveaux domaines d'intérêt pour le public ou de nouveaux contenus et formats ainsi que d'évoluer technologiquement afin de conserver une position concurrentielle sur le marché intérieur des médias. Ce financement devrait être déterminé et alloué selon des procédures prévisibles, transparentes, indépendantes, impartiales et non discriminatoires, sur une base pluriannuelle, conformément à la mission de service public des fournisseurs de médias de service public, afin d'éviter les risques d'influence indue liés à des négociations budgétaires annuelles. »
Cela fait vraiment écho aux débats que nous avons eus la semaine dernière, où nous avons demandé à la ministre de la culture qu'après la suppression de la redevance, la LOLF (loi organique relative aux finances publiques) soit modifiée, afin que soit inscrite la pérennité de l'attribution d'une part de la TVA au financement de l'audiovisuel public. Sans modification de la LOLF, nous arriverons à la fin de 2024 au « bout du bout », et l'audiovisuel public se retrouvera sans ressources. L'enrichissement du texte au Parlement européen soutient et justifie nos exigences, tous groupes politiques confondus. Le Sénat est encore une fois à la pointe sur ce sujet.
Dans la jungle numérique actuelle, il importe de développer des contrepoids à la désinformation. Nous avions évoqué ce point également très important du texte européen l'an dernier dans le débat sur notre avis motivé. Le renforcement des droits des médias d'information face aux très grandes plateformes en ligne est une avancée très importante, qu'il convient de préserver, dans le cadre d'une bonne articulation que nous avions exigée avec le DSA, qui a été correctement précisée, nous semble-t-il, par le Parlement européen.
Je souligne un point de vigilance quant au contrôle des concentrations au niveau européen : nous attirons l'attention sur l'importance de bien prendre en compte les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et de réserver les nouveaux outils européens proposés par ce texte à l'échelle strictement européenne qui est celle du marché intérieur et, pour le reste, de s'en tenir aux dispositifs existants mis en place par les États membres.
Nous abordons maintenant la phase finale du trilogue, que la présidence espagnole a bien, semble-t-il, l'intention de mener à son terme. Une phase décisive, et que la présidence espère conclusive, doit avoir lieu demain. S'ensuivra un examen technique, puis une validation par le Coreper, si tout se passe bien. Sinon, le relais sera transmis à la présidence belge, qui aura pour mission de conclure avant la fin du mandat.
Les compromis qui semblent avoir été trouvés sur la plupart des points clés nous paraissent globalement satisfaisants. Nous tenions à rappeler qu'ils répondent à ce stade à la plupart de nos préoccupations.
Soulignons les trois points suivants à ce stade de la négociation.
À l'article 6, les obligations de transparence des services de médias paraissent raisonnables, et le paragraphe 2 concernant l'information du public est limité aux médias d'information, ou, en anglais, seule langue de négociation, produisant des contenus de « news and current affairs ».
S'agissant du comité européen et de son secrétariat (articles 8 et 11), leur indépendance a été renforcée sans leur donner la personnalité juridique qui en aurait fait potentiellement une nouvelle agence, ou une nouvelle institution qu'il n'était pas souhaitable de rigidifier. L'indépendance du secrétariat à l'égard de la Commission demeure incontournable pour nous.
On est passé, à l'article 11, paragraphe 1, de la rédaction initiale de la Commission européenne (« Le comité dispose d'un secrétariat, qui est assuré par la Commission. ») à celle du Parlement européen, qui doit être maintenue selon nous :
« Le comité est assisté par un secrétariat distinct et indépendant. Le secrétariat reçoit des instructions uniquement du comité. »
À l'article 17, l'articulation avec le DSA a été précisée, ainsi que le rôle respectif des autorités nationales et du comité dans le processus de dialogue établi avant tout retrait de contenu émanant de services d'information, avec une possibilité d'agir dans l'urgence telle que prévue dans le DSA.
À l'article 4, relatif à la protection des journalistes et de leurs sources, qui a été extrêmement approfondie et renforcée par le Parlement européen, demeure un point d'achoppement pour la France, qui prône une prise en compte de considérations de sécurité nationale.
Il s'agira sans doute d'un « point dur » dans les négociations qui devront aboutir pour achever le trilogue.
En effet, la protection prévue à cet article a été étendue par le Parlement européen pour devenir très large et extensive. Elle concerne les journalistes bien sûr, leur famille, leurs proches, mais aussi tout leur « réseau », leurs contacts, réguliers et occasionnels. Potentiellement toute personne qui a été en contact avec eux. On le comprend, car il y a eu des cas, dans certains États membres, d'espionnages de journalistes, par l'usage de logiciels espions.
La rédaction adoptée par le Parlement européen ne prévoit qu'un nombre très restreint d'exceptions limitativement énumérées, pour des crimes graves, notamment de terrorisme, sous un contrôle judiciaire extrêmement strict.
Certains États, dont la France, plaident au Conseil pour un assouplissement, une possibilité de dérogation, pour motif de « sécurité nationale », toujours sous contrôle strict a posteriori, d'instances qui ne sont pas nécessairement judiciaires, mais administratives, dans notre pays.
C'est assurément un sujet d'interprétation délicat, qui a suscité l'émoi bien légitime et compréhensible d'associations et d'ONG comme Reporters sans frontières, qui s'est exprimée à ce sujet, et que nous avions auditionnée dans le cadre de la table ronde sur la presse écrite, mais pas sur ce point précis. Ce sujet a « fuité » récemment, dans la phase finale des négociations, lesquelles sont, je le rappelle, de la seule responsabilité et prérogative de l'exécutif.
Notre préconisation en pareille matière, où nous entendons bien sûr les arguments des journalistes mais aussi ceux des représentants des services de sécurité, serait, là encore, une fois de plus, d'appeler au respect des principes fondamentaux que nous avons rappelés dans notre avis motivé, de s'en remettre, en l'occurrence, au principe de subsidiarité et de proportionnalité. En effet, la sécurité nationale est de la seule compétence des États, et non de l'Union européenne, et ne peut être déléguée, qui plus est sur le fondement de l'article 114, je le rappelle, au nom du marché intérieur. Dois-je rappeler dans cette enceinte, qui a toujours été très attentive à la défense des libertés fondamentales, en particulier de la liberté de la presse et des droits des journalistes, que les États sont tenus par les traités, notamment l'article 2 du traité sur l'Union européenne, la charte des droits fondamentaux et la jurisprudence, de respecter les droits de l'homme et la liberté de la presse qui est une composante fondamentale de la démocratie et de l'identité de l'Europe ? Il y a là, sans doute, un cadre utile pour une législation d'objectif louable et nécessaire mais d'application délicate.

Quelques interrogations sur ce sujet complexe, technique. La première porte sur les phénomènes de concentration tels que ceux que l'on connaît en France aujourd'hui. Deuxièmement, qu'est-ce qui garantit dans le texte l'indépendance des rédactions à l'égard des détenteurs de capital ? Est-ce renvoyé exclusivement au titre de la subsidiarité aux autorités nationales ? Y a-t-il enfin des éléments spécifiques à la protection des sources des journalistes ?

Le Parlement européen est allé assez loin dans la protection des journalistes et de leurs sources. Je l'ai déjà dit : il y a un débat délicat sur les dérogations réclamées par certains États pour la sécurité nationale. À cet égard, nous renvoyons à l'application du principe de subsidiarité, tout en soulignant que les traités et la charte des droits fondamentaux protègent les droits et libertés incontournables.

Effectivement certains États pourraient remettre en cause les protections acquises par ce texte au nom de la sécurité intérieure, notamment la France.

Est-ce à dire qu'il pourrait y avoir des recours devant la CJUE et qu'il faut attendre une jurisprudence pour déterminer ce qui peut relever de préoccupations de sécurité intérieure ou non ?

Des organisations comme Reporters sans frontières (RSF) se mobilisent et alertent sur ces questions.

Tout à fait.
Sur la concentration des médias, l'objectif est bien d'établir un cadre minimal, un corpus de règles spécifiques, au niveau européen. C'est le nouveau comité européen qui succède à l'Erga et réunit les autorités de régulation dont l'Arcom, qui sera chargé d'appliquer les règles, ce qui ne constituera pas a priori une jurisprudence à proprement parler, mais un cadre de référence commun.

Je rebondis sur la question précédente, ayant travaillé il y a quelques années sur le sujet des lanceurs d'alerte. Les journalistes seront-ils intégrés dans ce cadre ? C'est un débat qui dure à l'échelle européenne, où les conceptions sont très différentes. On est très sensible à cette question en France, il en va différemment ailleurs, notamment en Pologne à l'époque - et l'on peut espérer que ce pays évolue positivement. Est-elle abordée dans le texte ?

L'article 4 pose le cadre de la protection complète des journalistes et de leurs sources, incluant tous leurs contacts, leur entourage et cela pourrait inclure des lanceurs d'alerte, même si le mot même de « lanceur d'alerte » n'apparaît pas en tant que tel dans le texte, mais c'est un vrai sujet.

Nous avions, lors de notre première analyse de subsidiarité, quelques craintes sur d'éventuelles menaces envers la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Sont-elles complètement levées ?

Oui, je crois pouvoir dire qu'à cet égard les principes de subsidiarité et de proportionnalité seront respectés, puisque c'est une norme a minima qui est établie par ce texte : elle n'empêche pas des normes plus exigeantes en matière de protection des libertés dans chaque État membre.

Pas à ma connaissance. Cependant, comme je le disais à l'instant, il reste quelques points en débat sur l'article 4. Je saisis cette occasion pour aborder l'acte sur l'intelligence artificielle (IA), que nous avions examiné avec Florence Blatrix Contat, et qui a abouti à un texte assez équilibré. Nous étions soucieuses d'innovation, afin que l'Europe reste dans la course mondiale, mais aussi de la garantie d'un certain nombre de règles, afin de prévenir les mésusages de l'IA, d'assurer une transparence et une licéité de l'usage des données, de protéger les droits d'auteur. Il s'en est suivi une guerre entre le ministère de la culture et Bercy, qui plaidait pour beaucoup plus d'innovation et l'abandon de règles qui pourraient nous mettre en désavantage concurrentiel. Nous nous réjouissons que le ministère de la culture ait eu, semble-t-il, gain de cause à l'issue de ce bras de fer. Il resterait encore quelques points à débattre. Je rappelle que la France a toujours été motrice sur la protection des droits d'auteur, des droits voisins, de la propriété intellectuelle. C'est un étalon d'or pour le reste du monde.

Sur l'IA, nous avons reçu la semaine dernière, à la commission de la culture, les syndicats, représentants des traducteurs interprètes, qui estiment que leur profession pourrait être décimée en six mois. Les premiers films et séries traduits à l'aide de l'IA seront diffusés sur la plateforme à partir de janvier. Dans ce secteur mondialisé, la question de la concordance des droits et de la mobilité des oeuvres se pose. L'enjeu est important en France où nous avons un secteur très structuré de la traduction et du doublage. Il peut en aller différemment dans des pays plus petits où le secteur est moins structuré et moins performant. Une coordination des positions des États sur ce sujet risque d'être compliquée.
Didier Marie est désigné membre de ce groupe de travail.
La réunion est close à 11 h 05.
Nous suivre sur les réseaux
Liens pratiques
Services
Nous contacter
Sénat 2024. Tous droits réservés.