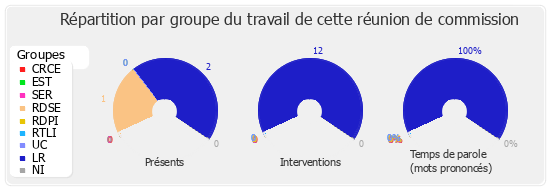Commission d'enquête sur l'immigration clandestine
Réunion du 25 janvier 2006 : 1ère réunion
Sommaire
- Audition de m. pierre-yves rébérioux délégué général de la commission interministérielle pour le logement des populations immigrées (voir le dossier)
- Audition de m. jean-michel colombani commissaire divisionnaire directeur de l'office central pour la répression de la traite des êtres humains (voir le dossier)
- Audition de m. michel pélissier président de la société nationale de construction pour les travailleurs sonacotra (voir le dossier)
- Audition de m. léon bertrand ministre délégué au tourisme maire de saint-laurent du maroni (voir le dossier)
La réunion
La commission d'enquête a tout d'abord entendu M. Pierre-Yves Rébérioux, délégué général de la commission interministérielle pour le logement des populations immigrées (CILPI).
a tout d'abord indiqué que la CILPI ne disposait pas d'informations particulières sur la question du logement des immigrés en situation irrégulière et n'avait pas de compétence en ce domaine, puisque seuls les étrangers en situation régulière peuvent prétendre à l'attribution d'un logement.
Il a ensuite précisé la distinction entre le processus d'hébergement, c'est-à-dire le passage par les centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) ou les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), et l'accès au parc locatif social. II a déclaré que la possession d'un titre de séjour ouvrant éligibilité au parc locatif social était une condition nécessaire pour prétendre à un tel logement.
Concernant le parc privé, il a expliqué que cette distinction était moins nette. Il a cité l'exemple d'un bailleur privé qui louerait un logement à un étranger détenteur d'un visa de trois mois ou d'un titre de séjour d'un an qui ne serait pas renouvelé ultérieurement.
Concernant le contrôle par les maires des attestations d'accueil délivrées aux hébergeurs, il a indiqué que la CILPI n'avait pas à en connaître directement.
En revanche, il a noté que la présence significative de sans-papiers était très fréquemment observée à l'occasion des opérations d'éradication de l'habitat indigne, qu'il s'agisse de squats, de bidonvilles ou d'habitats insalubres. De la même façon, il a indiqué que la question de la présence de sans-papiers dans les foyers de travailleurs migrants se posait également, ajoutant que la CILTI était particulièrement mobilisée sur ce dernier point.
a déclaré que dans ces foyers le taux de sur-occupation pouvait atteindre 300 %, surtout en Ile-de-France, ces estimations ayant été faites à partir de la consommation d'eau enregistrée ou du volume d'ordures ménagères récupérées. Il a cité le cas d'un foyer de 300 chambres, de 9 m² chacune, occupé par environ 900 personnes. Il a précisé que tous les sur-occupants n'étaient pas des sans papiers.
Il a estimé à 20 000 le nombre total de sur-occupants en Ile-de-France, la proportion de sans-papiers pouvant varier de 10 à 50 % selon les foyers. Il a ajouté qu'une part important des sur-occupants était d'origine malienne, en situation irrégulière ou non.
a ensuite évoqué le problème de la polygamie et de son articulation avec la gestion des attributions de logement.
En l'absence de chiffre précis, il a évalué à plusieurs milliers le nombre de ménages polygames en Ile-de-France, notamment d'origine malienne, une partie de ces personnes n'étant pas en règle au regard de la législation sur le séjour.
Il a rappelé que la loi du 24 août 1993 interdit d'attribuer ou de renouveler un titre de séjour à un étranger vivant en état de polygamie et que par conséquent les situations de polygamie devraient générer un certain nombre de sans-papiers, notamment à l'occasion du renouvellement des cartes de résident de dix ans. Néanmoins, il a déclaré que la réalité était plus complexe, les préfectures ne retirant pas systématiquement les titres de séjour.
Il a ajouté que les ménages polygames posaient aussi le problème de la sur-occupation de certains logements et de la délimitation du périmètre exact de la famille pour décider de l'attribution d'un logement adapté.

a demandé si les gestionnaires des foyers de travailleurs migrants avaient les moyens de constater la présence d'étrangers en situation irrégulière.
a tout d'abord expliqué que dans les foyers il n'y avait en principe que des hommes seuls. Toutefois, il a précisé que cela ne signifiait pas que ces derniers n'aient pas de famille logée à proximité. Il a ainsi indiqué que, pendant les week-ends, était constatée la présence de femmes et enfants dans les foyers.
Il a ensuite exposé que les gestionnaires de foyers, au nombre d'environ 150 en région parisienne, n'avaient pas véritablement les moyens de les gérer, si tant est qu'ils les aient jamais eus. Il a notamment indiqué que les gestionnaires ne maîtrisaient pas les flux d'arrivée dans ces foyers, en particulier ceux occupés par des travailleurs africains. Il a également rappelé que pendant longtemps les gestionnaires comme la SONACOTRA n'étaient pas propriétaires des foyers.
Il a expliqué que les gestionnaires disposaient théoriquement de la liste des résidents. Toutefois, exprimant des doutes sur la fiabilité de ces listes, il a indiqué que, lors de chaque opération de réhabilitation d'un foyer, la première mesure consistait à missionner une maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale (MOUS) pour les mettre à jour et poser les bases d'une gestion locative normale.
Il a estimé que les gestionnaires manquaient de personnel face à une situation qui les dépassait, tout en soulignant qu'une plus grande fermeté était de mise depuis quelques années sur le contrôle des départs et des arrivées. Toutefois, il a expliqué que le pouvoir d'attribution des hébergements était en partie entre les mains des comités de résidents de ces foyers qui indiquent au gestionnaire les sorties et les entrées.
a tenu à souligner que la responsabilité de cette situation était partagée, personne ne s'en étant réellement soucié pendant longtemps, qu'il s'agisse de l'Etat, des employeurs ou des collectivités territoriales.
Indiquant qu'un amendement au projet de loi portant engagement national pour le logement prévoyait de mieux encadrer et de clarifier les modes de gestion de ces foyers, il a précisé que ce texte tendait en contrepartie à admettre la présence dans ces foyers des occupants surnuméraires en situation régulière et à leur offrir à terme une solution de relogement.

a souhaité avoir des précisions sur le traitement des situations des ménages polygames, s'interrogeant sur l'existence d'une tolérance de fait.
a tout d'abord expliqué qu'une application pure et simple de la loi du 24 août 1993 aboutirait à des situations extrêmement difficiles, de nombreuses familles polygames s'étant regroupées avant l'entrée en vigueur de cette loi. Il a indiqué qu'une solution consistait à substituer, à la carte de résident de dix ans délivrée à la seconde épouse, un titre de séjour d'un an, de sorte que si juridiquement la polygamie subsiste, la vie en France en état de polygamie n'est en revanche plus constituée. Il a expliqué qu'un logement autonome était alors attribué à l'épouse titulaire de la carte de séjour d'un an. Il a ajouté que la situation sociale et juridique pouvait être encore compliquée par l'existence d'enfants nés en France de chaque épouse.
Face à des situations aussi complexes, il a déclaré qu'un accompagnement social important était indispensable pour mener à bien le processus de « décohabitation ». Il a précisé qu'une question délicate était d'apprécier avec justesse la bonne distance entre le logement du foyer principal et le logement de la seconde épouse, remarquant qu'à une époque, la pratique consistait à attribuer un logement se trouvant sur le même palier, solution qui n'est plus considérée comme satisfaisante aujourd'hui.
Il a ensuite évoqué une autre difficulté relative à l'attribution et au calcul de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation de parent isolé. Il a expliqué qu'il était parfois difficile de calculer le niveau de ressources de leur bénéficiaire, notamment sur le point de savoir si les revenus du mari devaient ou non être pris en compte. Il a indiqué que désormais ceux-ci n'étaient plus intégrés dans le calcul des conditions de ressources.

Il a conclu en estimant, en réponse à une question de M. François-Noël Buffet, rapporteur, que ces situations concernaient entre cinq et quinze mille ménages polygames en Ile-de-France, chaque ménage pouvant compté entre dix et quinze personnes.

a tout d'abord déclaré que, comme sans doute beaucoup d'autres maires, il connaissait plusieurs cas de polygamie dans sa commune. Concernant l'attestation d'accueil, il a demandé si une solution ne consisterait pas à responsabiliser davantage les hébergeurs. Il a également demandé des précisions sur les conditions d'allocation de logements à des sans-papiers par des bailleurs privés.
Concernant la délivrance des attestations d'accueil, M. Pierre-Yves Rébérioux a jugé que le recul depuis l'adoption de la loi du 26 novembre 2003 était encore insuffisant pour évaluer correctement ses effets et l'opportunité de modifier le dispositif. Il a ajouté n'avoir aucune information particulière sur ce sujet.
Concernant les bailleurs privés, il a déclaré ne pas être certain que la loi permette de sanctionner suffisamment fort « les marchands de sommeil », ces derniers pouvant d'ailleurs être de la même nationalité que les étrangers logés. Rappelant toutefois que la loi dite SRU prévoyait qu'en cas de prise d'un arrêté de péril ou d'insalubrité, le locataire n'était plus redevable d'aucun loyer, il a souligné que le contentieux de ces affaires était généralement extrêmement complexe et se heurtait au droit de propriété.
s'est interrogé sur la cohérence entre les conditions de logement exigées pour autoriser le regroupement familial et les critères retenus pour l'attribution d'un logement social, ces derniers étant beaucoup plus stricts que les premiers en terme de nombre de mètres carrés par personnes supplémentaires.
a répondu qu'une difficulté récurrente pour les bailleurs sociaux consistait à bien évaluer la taille présente et à venir d'un ménage lors de l'attribution d'un logement. Il a indiqué que, fréquemment, un logement conçu pour trois à quatre personnes se retrouvait quelques années plus tard en situation de sur-occupation.

a demandé s'il ne serait pas plus logique d'aligner les critères de superficie des logements requis en matière de regroupement familial sur les critères retenus pour l'attribution des logements sociaux.
a répondu que l'adéquation entre la taille des ménages et celle des logements proposés était un problème permanent. Il a enfin signalé qu'il n'était pas rare de voir dans les squats africains d'Ile-de-France vingt personnes vivant dans un logement de deux pièces.
Audition de M. Jean-Michel Colombani commissaire divisionnaire directeur de l'office central pour la répression de la traite des êtres humains
Audition de M. Jean-Michel Colombani commissaire divisionnaire directeur de l'office central pour la répression de la traite des êtres humains
La commission d'enquête a ensuite entendu M. Jean-Michel Colombani, commissaire divisionnaire, directeur de l'office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH).
a tout d'abord rappelé que l'OCRTEH avait été créé en 1958 en prévision de la ratification par la France, en 1960, de la Convention internationale des Nations-Unies sur la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui.
Il a indiqué que, placé sous l'autorité du directeur central de la police judiciaire, l'office était chargé de centraliser tous les renseignements pouvant faciliter la recherche du trafic des êtres humains et de coordonner les opérations tendant à la répression de ce trafic. Il a précisé que tous les services de police et de gendarmerie étaient tenus d'informer l'office de leurs activités en matière de répression du proxénétisme. Enfin, il a indiqué que l'office était l'interlocuteur privilégié sur ces questions des organismes internationaux et des services de police étrangers.
a ensuite commenté l'évolution de la prostitution depuis une dizaine d'années en France. Il a expliqué que depuis 1992, la part de la prostitution d'origine étrangère en France n'avait cessé de progresser, une accélération de cette évolution ayant été constatée à partir de 1999. Il a indiqué que la prostitution d'origine étrangère, qui représentait en 1992 environ 30 % de la prostitution à Paris et 15 % en province, en représentait en 2004 73 % à Paris et plus de 50 % en province.
Il a expliqué que ce bouleversement avait eu des répercussions importantes sur la lutte contre le proxénétisme, ce type de prostitution étant principalement organisé par des réseaux étrangers aux méthodes particulièrement violentes. Il a également mentionné l'extrême mobilité des prostituées étrangères, comme à Nice où les services estiment que les deux tiers de la population prostitutionnelle étrangère se renouvelaient dans l'année.
Concernant l'activité des services de police et de gendarmerie, il a indiqué qu'en 2004, 717 personnes (504 hommes et 213 femmes) avaient été mises en cause pour proxénétisme, chiffre en hausse continue depuis 2000 où 472 personnes avaient été mises en cause. Il a précisé que la proportion des étrangers était de 54,7 % en 2004 contre 48 % en 2000 et 2001, la très grande majorité des intéressés étant originaire des pays d'Europe de l'est et des Balkans.
Quant au profil des victimes, il a indiqué que, sur 999 victimes identifiées dans les procédures établies par la police nationale en 2004, 75 % étaient des étrangères dont 60 % originaires des pays d'Europe de l'est et des Balkans et 25 % d'Afrique.
Il a déclaré que les victimes étaient très rarement mineures, les réseaux évitant de se placer sous le coup de cette circonstance aggravante.
Concernant la situation des prostituées étrangères au regard des règles sur l'entrée et le séjour en France, il a indiqué que beaucoup entraient régulièrement munies d'un visa puis restaient sur le territoire français ou dans l'espace Schengen. Il a précisé que les prostituées africaines étaient très souvent détentrices d'un récépissé de demande d'asile. En revanche, il a remarqué que les proxénètes séjournaient généralement régulièrement sur le territoire français.
A propos de la prostitution de voie publique, M. Jean-Michel Colombani a affirmé que la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure avait permis de mieux recenser l'étendue du phénomène de la prostitution étrangère en France. Il a indiqué qu'en 2003, 3.181 procédures de racolage avaient été établies (dont 3.129 pour la police nationale) pour 2.425 mis en cause, et 5.152 (dont 5.066 par la police nationale) en 2004 pour 3.290 mis en cause.
Il a ensuite indiqué que 47 réseaux avaient été démantelés en 2004, contre 39 en 2003 et 29 en 2002, précisant que sur ces 47 réseaux, 32 avaient leur source en Europe de l'est et dans les Balkans (dont 12 bulgares, 12 roumains et 4 albanais), 6 en Afrique et 3 en Amérique du sud.
Evoquant les liens entre immigration clandestine et criminalité organisée, il a jugé qu'ils étaient difficiles à établir de manière générale. En revanche, il a affirmé que ces liens étaient évidents dans le domaine du proxénétisme international. Toutefois, il a indiqué qu'il n'y avait pas de logique dans ce type de flux migratoire, les étrangers arrivant dans l'espace Schengen par le pays qui leur offre à cet égard le plus de facilité (accords bilatéraux, présence d'un compatriote, transport moins onéreux) puis se déplaçant vers les pays où leur activité est facilitée par des contrôles plus souples. Il a conclu en déclarant que ce nomadisme prostitutionnel était particulièrement difficile à appréhender.

a demandé quelle était la part de l'esclavage domestique dans le total des infractions relatives à la traite d'êtres humains.
a répondu que l'esclavage domestique représentait une proportion très faible de la traite des êtres humains, l'esclavage sexuel en représentant à lui seul plus de 80 %.

a demandé quel était le bilan de l'application de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Il a notamment souhaité savoir si cette loi n'avait pas eu pour effet de déplacer le problème au lieu de le résoudre.
a répondu que cette loi avait eu plusieurs effets parfois contradictoires. En premier lieu, il a jugé qu'elle avait permis de mieux connaître le phénomène de la prostitution et par conséquent d'élaborer des stratégies mieux adaptées. Il a cité l'exemple de la signature de deux protocoles d'accord avec la Bulgarie et la Roumanie afin notamment de continuer à suivre le parcours des prostituées retournées dans leur pays. Il a évoqué également des partenariats avec des associations étrangères pour prendre en charge l'accueil des prostituées éloignées dès leur arrivée.
En second lieu, il a indiqué que la loi avait eu pour effet direct une désertion de la voie publique par les prostituées, mais que cet effet dissuasif s'était progressivement estompé en raison de la faiblesse de la réponse pénale, souvent réduite à un simple rappel à la loi. Il a en outre précisé que les modes opératoires avaient changé depuis la loi du 18 mars 2003, la prostitution de voie publique se diffusant dans les bois à proximité des villes ou le long des routes nationales.
Il a également souligné l'essor des réseaux de prostitution sur Internet ou par téléphone.
En conclusion de ce bilan contrasté, il a relevé la très forte baisse de la prostitution de voie publique à Paris.

a demandé si les accords bilatéraux étaient une solution efficace pour traiter en profondeur le problème de la prostitution étrangère.
a souligné les très bons résultats obtenus grâce à la coopération avec les autorités bulgares. Il a estimé que le succès des accords de ce type reposait sur la capacité à développer des relations de travail solides et confiantes entre les policiers intervenant sur le terrain.

a demandé quel était le bilan de l'application de l'article 76 de la loi du 18 mars 2003 qui permet la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à l'étranger qui porte plainte ou témoigne contre une personne qu'il accuse d'avoir commis les infractions de proxénétisme ou de traite des êtres humains.
a déclaré que ce dispositif fonctionnait bien, même si quelques prostituées avaient essayé de le détourner. Il a indiqué que de mars 2003 à fin 2004, 352 autorisations provisoires de séjour avaient été délivrées. A l'inverse, il a indiqué que 417 reconduites à la frontière avaient été prononcées en 2003 (188 exécutées) contre 542 en 2004 (248 exécutées).

a souhaité connaître les demandes des prostituées qui parvenaient à sortir de ces réseaux.
a indiqué que la majorité souhaitait rester sur le territoire et recevoir une formation professionnelle.
a indiqué qu'aux Antilles et en Guyane, la prostitution était surtout d'origine brésilienne, dominicaine ou guyanienne. Il a toutefois précisé qu'il ne s'agissait pas de filières aussi structurées qu'en métropole.

a souhaité avoir plus de détails sur la situation en Guyane et sur l'existence de filières entre la Guyane et la Martinique.
a indiqué qu'en 2005, sept affaires de proxénétisme avaient été traitées, six personnes mises en cause et une écrouée. Il a noté que peu de procès-verbaux avaient été dressés pour racolage en Guyane.
La commission d'enquête a ensuite entendu M. Michel Pélissier, président de la Société nationale de construction pour les travailleurs (SONACOTRA).
a tout d'abord indiqué que la Sonacotra était a priori peu concernée par le problème de l'immigration clandestine puisqu'elle loge seulement des étrangers en situation régulière.
Il a ensuite procédé à une rapide présentation de la société : la Sonacotra a été créée en 1956, sous la forme d'une société d'économie mixte contrôlée majoritairement par l'Etat, pour loger les travailleurs algériens venus participer à l'effort de reconstruction du pays. Elle a construit, à cette fin, des foyers pour célibataires et des logements plus spacieux destinés aux familles. Elle a connu une crise à la fin des années 1980, en raison de l'arrêt de l'immigration légale et du vieillissement de ses foyers. Pour y remédier, la société a procédé à une recapitalisation et a élargi son objet à l'hébergement des personnes défavorisées, quelle que soit leur nationalité. La Sonacotra loge aujourd'hui 73.000 personnes dans les 450 foyers de travailleurs migrants ou résidences sociales, répartis dans soixante départements, dont elle assure la gestion.
a souligné que la clientèle de la Sonacotra se caractérisait par un triple phénomène de diversification, de paupérisation et de vieillissement. Sa clientèle s'est diversifiée, puisque 52 % des résidents sont ressortissants d'un pays du Maghreb, 16 % d'un pays d'Afrique sub-saharienne et 27 % sont de nationalité française ; la société gère par ailleurs 6.000 places d'accueil pour demandeurs d'asile, ce qui représente un tiers de la capacité d'accueil existant au niveau national. Sa clientèle s'est également paupérisée : 15 % des résidents sont titulaires de minima sociaux, 18 % sont demandeurs d'emploi et 35% sont salariés. Enfin, 20 % des résidents sont âgés de plus de 65 ans et 50 % de plus de 55 ans ; en effet, contrairement à ce qui avait été initialement envisagé, les travailleurs maghrébins logés par la Sonacotra n'ont pas regagné leur pays au moment de leur départ en retraite.
Abordant plus précisément la question de l'immigration clandestine, M. Michel Pélissier a d'abord fait observer que les gestionnaires des logements Sonacotra vérifiaient la régularité du séjour de leurs résidents étrangers et n'accueillaient donc pas, en principe, d'immigrés en situation irrégulière.
Les résidents âgés effectuent de fréquents allers-retours entre la France et leur pays d'origine et peuvent donc perdre le bénéfice des aides au logement, qui requièrent une présence sur le territoire pendant au moins huit mois de l'année. La Sonacotra loue parfois un même logement à plusieurs résidents successifs pendant l'année afin de tenir compte de ces longues périodes passées à l'étranger.
Les immigrés sénégalo-maliens d'ethnie Soninké, présents en région parisienne, posent un problème spécifique : ils tendent à reconstituer, dans leurs foyers, le mode de vie communautaire caractéristique des villages africains et hébergent, au nom de l'hospitalité, un grand nombre de parents et amis, qui sont parfois en infraction avec les règles de séjour. M. Michel Pélissier a cité le cas d'un foyer de 300 places qui accueillait 700 personnes en situation régulière et 100 personnes en situation irrégulière. Ce foyer a été détruit pour céder la place à des logements plus spacieux, afin d'accueillir convenablement l'ensemble de ces personnes, mais le phénomène de sur-occupation est très rapidement réapparu. Les gestionnaires des logements effectuent des contrôles avec huissier pour lutter contre la sur-occupation et s'efforcent de transformer les foyers en logements ordinaires.
a rappelé que la Sonacotra gérait 6.000 places d'accueil de demandeurs d'asile, dont 1.500 places d'accueil d'urgence réparties entre 34 établissements. Grâce à l'accompagnement qui leur est prodigué par les travailleurs sociaux, 68 % des demandeurs d'asile hébergés par la Sonacotra obtiennent le statut de réfugié, alors que ce taux est seulement de 17 % au niveau national. La durée des procédures -deux ans en moyenne- demeure cependant longue et conduit parfois, lorsque des naissances se produisent sur le territoire national, à ce que des étrangers ne puissent plus être ni expulsés ni régularisés. En outre, en raison de la difficulté d'obtenir un logement, 20 % des places en centres d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) sont occupées par des personnes ayant obtenu le statut de réfugié. A l'inverse, un cinquième des places en CADA est occupé par des personnes déboutées du droit d'asile mais n'ayant pas encore quitté le territoire.

a demandé si les caractéristiques des logements proposés par la Sonacotra permettaient aux étrangers d'exercer leur droit au regroupement familial.
a répondu que les logements de la Sonacotra ne permettaient pas de procéder au regroupement familial. Des étrangers hébergent parfois irrégulièrement leur famille à leur domicile et les gestionnaires des logements engagent alors des actions en justice. Il a ajouté qu'un gestionnaire de foyer avait été condamné pour aide au séjour irrégulier et que la Sonacotra se montrait, depuis lors, très vigilante.
La commission d'enquête a enfin entendu M. Léon Bertrand, ministre délégué au tourisme, maire de Saint-Laurent du Maroni.
Précisant qu'il s'exprimait devant la commission d'enquête en sa qualité de maire de Saint-Laurent du Maroni, M. Léon Bertrand a estimé que les chiffres officiels de l'INSEE évaluant la population de la Guyane à environ 185.000 habitants ne reflétaient pas la situation de l'immigration dans l'ensemble de ce département d'outre-mer.
Evoquant la situation de Saint-Laurent du Maroni, il a souligné que la population officielle de cette commune, qui comptait 6.000 habitants en 1983, était évaluée à 20.000 personnes en 2005 selon l'INSEE, mais qu'en réalité, elle s'élevait à 35.000 personnes. Il a expliqué que cette estimation reposait sur plusieurs constats, à commencer par la demande de scolarisation dans la commune, comptant 11.750 élèves, qui avait rendu nécessaire la construction de deux nouveaux groupes scolaires en 2004 et d'un groupe en 2005, ce qui constituait des charges pérennes grevant les finances communales.
a souligné que la majeure partie des patients accueillis à hôpital intercommunal de Saint-Laurent du Maroni étaient de nationalité étrangère, tandis que plus de 50 % du budget de cet établissement était alimenté par les différents dispositifs d'aide médicale. Il a indiqué qu'il y avait entre 5 à 7 naissances par jour, pour l'essentiel provenant de femmes de nationalité étrangère, évoquant l'existence de filières organisées depuis Paramaribo, capitale du Surinam, pour l'acheminement en Guyane de femmes surinamiennes enceintes. Il a rappelé que, pour éviter cet afflux, l'Etat français avait participé au financement de la reconstruction de l'hôpital d'Albina, au Guyana, et qu'une assistance par des médecins de Saint-Laurent du Maroni y avait été mise en place, mais que cet hôpital n'était déjà plus en activité.
Il a souligné que la guerre civile intervenue au Surinam en 1986 avait conduit environ 13.000 Surinamiens à se réfugier sur le territoire guyanais, quatre camps ayant été créés à cet effet dans l'ouest du département, le nombre de ces ressortissants étrangers étant parfois supérieur à celui des Guyanais résidant dans cette zone. Il a rappelé que ces personnes ne s'étaient pas vues reconnaître la qualité de réfugiés, mais avaient été considérées comme des « personnes provisoirement déplacées » (PPDS), le Gouvernement français ayant estimé à l'époque que ces populations retourneraient au Surinam une fois la situation politique rétablie. Il a indiqué que l'Etat avait accordé des aides pour le retour de ces populations dans leur pays, mais que cette mesure s'était inefficace, la plupart des PPDS n'étant pas repartis ou étant revenus par la suite sur le territoire français. Il a souligné que ces populations s'étaient installées dans plusieurs communes de l'ouest guyanais, notamment à Saint-Laurent du Maroni, à Mana, à Apatou, à Grand-Santi, à Papaïchton et à Maripassoula.
Il a observé que des difficultés similaires se rencontraient également dans l'est de la Guyane en raison de la traversée du fleuve Oyapock par de nombreux Brésiliens, à la hauteur de la commune de Saint-Georges.
Abordant les causes de l'immigration clandestine en Guyane, M. Léon Bertrand a indiqué que l'une des explications de l'afflux d'étrangers résultait des caractéristiques géographiques de ce département, au territoire étendu et aux frontières perméables, et de la présence d'or, dont le cours avait fortement augmenté. Il a mis en exergue l'attraction exercée par les prestations sociales offertes par l'Etat et les collectivités territoriales ainsi que l'image valorisante que pouvaient avoir sur les ressortissants des pays voisins les activités spatiales menées en Guyane. Il a également considéré que le voisinage du Brésil et du Surinam, pays dotés d'un faible revenu national brut par habitant, tendait à renforcer cette attractivité.
Il a estimé que ces causes multiples étaient propres à la Guyane, ce qui empêchait d'y comparer le phénomène de l'immigration clandestine à celui que connaissent les autres collectivités ultramarines, toutes insulaires et marquées par un environnement différent.
S'agissant des solutions qui devraient être envisagées pour remédier à la situation actuelle, M. Léon Bertrand a estimé que les actions menées, tels le plan « Alizée bis » et les patrouilles sur le Maroni, restaient insuffisantes.
Il a rappelé qu'il avait proposé, en 1993, que les allocations familiales soient réduites à partir du troisième enfant dans certaines zones de la Guyane, le solde étant reversé sous la forme d'autres prestations pour les besoins des services publics. Il a indiqué que ces propositions avaient été rejetées tant par l'opposition socialiste que par le Gouvernement de l'époque. Il a souligné que le but de nombreux immigrés clandestins était d'avoir des enfants sur le sol français, de les y faire scolariser et de percevoir des prestations sociales qu'ils dépensaient ensuite au Surinam et au Brésil, ajoutant qu'ils ne pouvaient plus être expulsés et attendaient du préfet la régularisation de leur séjour. Il a indiqué que l'existence d'enfants permettait de percevoir des prestations qui étaient ensuite dépensées au Surinam ou au Brésil.
a indiqué qu'il avait également suggéré, sans succès, que la maternité de Saint-Laurent du Maroni soit considérée comme une zone d'extraterritorialité afin que les enfants qui y naîtraient ne puissent disposer que de la nationalité de leurs parents. Il a jugé qu'il s'agissait d'une mesure symbolique destinée à décourager la venue de femmes étrangères enceintes motivées par la seule volonté de voir leur enfant naître sur le sol français.
Il a considéré qu'il convenait d'être plus imaginatif dans les solutions mises en oeuvre par les pouvoirs publics, évoquant l'utilisation éventuelle des mécanismes d'expérimentation mis en place lors de la révision constitutionnelle du 25 mars 2003.
Il a estimé indispensable d'instituer une véritable coopération avec les Etats voisins, regrettant que les actions diplomatiques n'aient jusqu'ici porté, avec le Surinam et le Guyana, que sur des accords de réadmission, alors qu'il convenait de prévoir une coopération plus globale. Il a considéré que les services déconcentrés de l'Etat n'avaient pas les moyens suffisants pour mettre en oeuvre une coopération efficace.
a souligné que la situation actuelle avait conduit à maintenir depuis plusieurs années, sur le territoire guyanais, des étrangers en situation irrégulière, dont les enfants étaient nés en France et y étaient scolarisés, et qui vivaient dans des conditions sanitaires déplorables imposant aux maires de lourdes responsabilités en matière de services publics. Il a indiqué que cette situation impliquait, en conséquence, des mesures de régularisation, estimant que celles intervenues dans les années 1990 s'étaient révélées peu satisfaisantes, de nombreux étrangers étant demeurés dans une sorte de « flou administratif » au regard de leur séjour sur le territoire français, ce qui tendait à créer un effet d'appel pour les habitants des pays voisins.
Il a également préconisé des solutions de nature économique au problème de l'immigration clandestine, affirmant qu'il existait un lien réel entre l'insécurité que connaissait la Guyane et l'afflux d'immigrants clandestins, dans la mesure où la misère dans laquelle se trouvaient ceux-ci les conduisaient à commettre des actes de délinquance, relevant que près de 80 % des personnes incarcérées dans le département étaient d'origine étrangère.
Compte tenu de la nature particulièrement violente de la délinquance dans certaines parties de la Guyane, pour lesquelles les forces de la gendarmerie nationale n'étaient pas véritablement adaptées, M. Léon Bertrand a rappelé qu'il avait récemment suggéré l'intervention de la légion étrangère. Il a néanmoins indiqué que cette mesure avait été repoussée par le ministère de la défense au motif que la légion étrangère n'avait pas pour mission d'assurer ce type d'opérations et devait surveiller les installations de la base spatiale de Kourou. Il a pourtant estimé que les légionnaires constituaient la seule force à même d'évoluer dans des bonnes conditions dans la forêt guyanaise pour y effectuer les opérations qui s'imposent.
Il a jugé que la société guyanaise n'était pas en mesure d'absorber le flot actuel d'immigrants, ce qui avait pour conséquence de susciter une exaspération croissante des Guyanais.

a relevé que les services de la gendarmerie nationale avaient fait part à la délégation de la commission d'enquête en Guyane du manque de moyens logistiques pour effectuer des opérations de plus grande envergure. Il a interrogé le ministre sur les perspectives d'évolution du statut juridique du fleuve Maroni qui, en l'état actuel, ne permettait pas d'exercer facilement des contrôles.
a reconnu qu'il existait un réel manque d'effectifs et de moyens matériels, soulignant que les immigrants clandestins disposaient parfois d'équipements très performants leur permettant d'échapper aux contrôles. Il a rappelé que, depuis plusieurs années, la livraison prochaine d'un nouvel hélicoptère de la gendarmerie nationale était annoncée.
S'agissant du statut du fleuve Maroni, il a indiqué qu'aucune démarche n'avait été engagée par les autorités françaises, ce qui pouvait s'expliquer par l'absence de pouvoir démocratique stable au Surinam jusqu'au milieu des années 1990. Il a indiqué que, jusqu'à présent, les actions de coopération engagées avec cet Etat reposaient seulement sur la bonne volonté de quelques personnes de chaque côté du fleuve, mais que la venue, envisagée, du Président de la République en Guyane pourrait être l'occasion d'engager une telle démarche.

a interrogé le ministre sur l'incidence du travail clandestin sur l'immigration clandestine en Guyane.
a reconnu que le travail clandestin pouvait favoriser la venue d'immigrants irréguliers, tout en observant que ce type de pratique n'était pas propre à la Guyane, ni même aux collectivités ultramarines. Il a estimé que les populations concernées par le travail clandestin étaient principalement brésiliennes, car elles étaient souvent bien formées. Il a relevé que des contrôles avaient lieu et aboutissaient à des sanctions à l'égard des employeurs, les Surinamiens et Haïtiens étant moins concernés.

a estimé que la Guyane connaissait une situation exorbitante au regard de l'immigration clandestine, évoquant notamment la charge écrasante qu'elle engendrait pour les finances des communes. Il a estimé que le phénomène du travail clandestin, très développé en Guyane, n'était souvent pas assez pris en compte dans la lutte contre l'immigration irrégulière. Il a demandé s'il n'existait pas une imbrication entre certains guyanais eux-mêmes et les immigrants clandestins, évoquant notamment les cas de reconnaissances frauduleuses d'enfants.
Souscrivant à ces propos, M. Léon Bertrand a ajouté que les prestations sociales versées en France avaient pour effet d'attirer les populations des pays voisins, et a évoqué la recrudescence des mariages blancs conclus moyennant finances.

a souligné la faiblesse des moyens de l'Etat pour assurer la surveillance de l'ouest guyanais, ainsi que le manque de personnels à la sous-préfecture de Saint-Laurent du Maroni. Il a estimé que la question de l'adaptation du droit de nationalité à Mayotte se posait également pour la Guyane, bien qu'il s'agisse d'un département d'outre-mer. Il a jugé que donner un statut extraterritorial à l'hôpital de Saint-Laurent du Maroni n'empêcherait pas la scolarisation des enfants qui y naîtraient et n'aurait donc qu'un effet limité sur l'afflux des étrangers. Il a demandé s'il serait judicieux de prévoir des dispositions spécifiques pour la Guyane en matière de nationalité et, plus généralement, s'il convenait de traiter la question de l'immigration clandestine en outre-mer de manière séparée de celle de la métropole et en adoptant deux lois distinctes, l'une sur la métropole, l'autre sur l'outre-mer.
a reconnu que l'extraterritorialité de l'hôpital de Saint-Laurent du Maroni ne mettrait pas fin à l'afflux d'étrangers mais a insisté sur le signal qu'une telle mesure pourrait constituer pour les populations des Etats voisins, en montrant que le fait d'être en France ne donnait pas nécessairement vocation à devenir Français. S'agissant de la réforme du droit de la nationalité, il a marqué sa préférence pour un dispositif particulier à la Guyane, dans le cadre d'un texte spécifique, reconnaissant néanmoins l'existence de limites constitutionnelles.

a souligné que le fait de conférer un statut d'extraterritorialité à l'hôpital aurait pour effet de permettre la reconduite à la frontière des mères étrangères et de leurs enfants, alors qu'une telle mesure était inenvisageable si l'enfant était né sur le territoire français.

a estimé que, compte tenu des caractéristiques géographiques de la Guyane, la reconduite de Surinamiens à la frontière ne les empêcherait pas de revenir dès le lendemain sur le territoire national et d'y obtenir la scolarisation de leurs enfants.

a demandé si l'inscription des enfants de ressortissants surinamiens ne créait pas des difficultés dans les conditions de scolarisation des enfants guyanais, souhaitant connaître l'attitude des parents de nationalité française face à ces inscriptions massives.
a reconnu que cette scolarisation était fréquemment source de difficultés dans le cadre de la gestion des inscriptions des enfants guyanais.

ayant demandé si la commune de Saint-Laurent du Maroni, comme les autres communes du fleuve, bénéficiait d'une dotation spécifique de l'Etat pour la construction d'établissements scolaires, M. Léon Bertrand a répondu par l'affirmative, en précisant que le montant de cette dotation tendait à décliner et que son versement était souvent très tardif, ce qui occasionnait des problèmes de gestion pour les communes. Il a insisté sur le fait que le fonctionnement de ces établissements entraînait des charges lourdes et pérennes pour les communes, indiquant que celles-ci recouraient en priorité aux contrats aidés tels que les contrats emploi-solidarité, les contrats emploi-consolidé ainsi que les contrats d'avenir. Il a ajouté que le financement des travaux d'entretien était particulièrement difficile, soulignant que la commune de Saint-Laurent du Maroni ne disposait pas des moyens nécessaires à l'entretien des établissements construits il y a cinq ou six ans. Il a indiqué que ces besoins de financement empêchaient les investissements dans d'autres services publics également indispensables à la commune.

a estimé qu'il existait un problème structurel de ressources financières pour les communes de Guyane. Il a mis en doute l'opportunité d'axer le renforcement des moyens de l'Etat en Guyane sur les reconduites à la frontière, soulignant que près d'un cinquième des reconduites pratiquées en France l'étaient dans la région frontalière du Maroni. Il a estimé que le caractère non suspensif des recours contre les arrêtés de reconduite à la frontière n'avait pas, depuis 1993, suffi à arrêter l'afflux de clandestins. Il s'est demandé si les moyens considérables consacrés aux reconduites à la frontière ne devraient pas être en partie affectés à d'autres actions.
a reconnu que, si les mesures de reconduite à la frontière des clandestins devaient se poursuivre, elles ne devaient pas être les seules réponses des pouvoirs publics, rappelant qu'il avait déjà souligné l'importance des actions de coopération avec les Etats voisins à entreprendre ou les mesures à prendre en matière de prestations sociales.

a souhaité savoir si la création, dans l'ouest guyanais, d'un centre de rétention administrative, d'une chambre détachée du tribunal de grande instance de Cayenne, d'un commissariat de police à Saint-Laurent du Maroni, ainsi que la possibilité de détruire les véhicules ayant permis le transport des immigrés clandestins, seraient de nature à améliorer la situation.
a indiqué que ces diverses mesures lui paraissaient nécessaires, marquant cependant sa préférence pour le maintien de la compétence de la gendarmerie nationale à Saint-Laurent du Maroni. Il a néanmoins estimé qu'il était d'abord nécessaire d'agir sur l'origine des flux, en limitant l'attractivité du territoire français vis-à-vis des pays voisins. Il a de nouveau insisté sur la nécessité d'une politique de coopération avec le Surinam, jugeant que cette coopération pourrait être conditionnée à la surveillance par cet Etat de ses propres ressortissants.