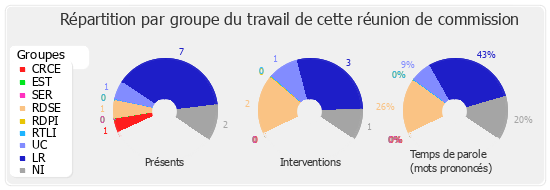Commission des affaires économiques
Réunion du 14 février 2007 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion

Au cours d'une première réunion tenue dans la matinée, la commission a tout d'abord entendu M. Marcel Deneux sur son déplacement au Brésil dans le cadre d'un voyage effectué avec le pôle de compétitivité Champagne-Ardennes.
Il a d'abord précisé que cette mission du pôle « Industries & Agro-Ressources » des régions françaises Champagne-Ardennes et Picardie s'était déroulée du 27 novembre au 1er décembre 2006, en deux phases, à savoir un colloque de trois jours à Brasilia sur les biocarburants et un programme de visite dans la région de Sao Paulo. Précisant que la délégation française se composait d'une cinquantaine de personnes issues, notamment, de trois universités, de l'Institut français du pétrole, des ministères du développement durable et de l'agriculture, il a expliqué que l'objectif de cette mission était de mieux appréhender la réalité des biocarburants dans un pays qui est le leader mondial pour l'éthanol, carburant à base de canne à sucre, et de détecter, également, des possibilités de collaboration scientifique, technologique, voire industrielle à différents niveaux de la chaîne de valeur des biocarburants.
Il a déclaré que la politique brésilienne dans le domaine des biocarburants se caractérisait à la fois par son ambition -satisfaire, à terme, 5 à 10 % du marché mondial des carburants liquides- et sa cohérence, qui portait la marque du très influent ministère des affaires étrangères brésilien.
Il a ensuite présenté les grands chiffres caractérisant le Brésil : une population de 180 millions d'habitants, un PIB par tête de 3.100 dollars (à comparer au chiffre français de 26.000 dollars), une croissance économique annuelle de 5 % depuis quelques années, une inflation égale à 7,6 %, un chômage de 12 %, prévu pour revenir à 9 % en 2007, un budget en équilibre et un commerce extérieur excédentaire de 33 milliards de dollars, le déficit des échanges extérieurs de la France avec le Brésil atteignant 700 millions de dollars. Afin de donner quelques ordres de grandeur en matière agricole, il a indiqué que la superficie totale du pays était de 850 millions d'hectares (contre 30 en France) et que la surface agricole utile atteignait 360 millions d'hectares, dont 200 millions d'hectares de prairies, 22 millions d'hectares de soja et 6 millions d'hectares de canne à sucre. Il a fait observer que la conquête des terres « vierges » du Brésil n'était pas terminée, même si elle était en train de se ralentir.
S'agissant de la situation des biocarburants, M. Marcel Deneux a souligné que la production d'éthanol à partir de la canne à sucre était ancienne, mais qu'elle avait connu trois accélérations successives : en 1972-73, suite au premier choc pétrolier, au cours des années 90 avec le développement des exportations du sucre, et depuis le début des années 2000, avec le développement de la production de l'alcool lié à la crise pétrolière mondiale et l'apparition de véhicules « flexfuel ». Il a noté qu'il y avait aujourd'hui 346 usines en fonctionnement, que 46 étaient en construction et que 47 nouveaux projets venaient d'être approuvés. Précisant que la production annuelle actuelle était d'environ 386 millions de tonnes de canne à sucre débouchant, outre le sucre, sur 170 millions d'hectolitres d'alcool, il a relevé que le coût de production de l'hectolitre d'alcool était revenu en vingt ans de 90 dollars par tonne à 30 euros par tonne, grâce aux gains de productivité obtenus sous l'effet d'une politique sans commune mesure avec celle, pourtant active, déployée par la France en matière de biocarburants.
Il a expliqué que la production s'organisait sous forme de « clusters » autour d'une sucrerie associée à une distillerie, ce qui permettait d'ajuster la production en fonction des marchés du sucre et de l'alcool. Il a relevé que la vinasse était la plupart du temps recyclée dans les champs proches de l'usine, mais les incidences environnementales de cette pratique conduisaient de plus en plus à une valorisation énergétique par méthanisation.
Il a ensuite précisé que la production de biodiesel s'était développée de manière beaucoup plus récente et restait encore très modique par rapport à la production d'éthanol. Après avoir rappelé que le diesel était réservé au Brésil aux véhicules utilitaires, il a fait état d'un changement politique à l'égard du biodiesel, aujourd'hui seulement conseillé aux utilitaires et aux camions, mais destiné à devenir obligatoire pour 5 % d'entre eux à partir de 2013. Concernant le rendement de cette production, il a indiqué que l'ambition était de passer d'une production moyenne de 600 litres à 6.000 litres par hectare. Quant à la valorisation de la glycérine, il a relevé qu'elle faisait l'objet de recherches actives. Observant enfin qu'une sole d'oléagineux pouvait être placée entre deux cultures de canne à sucre et avait souvent des effets très bénéfiques, il a jugé que cela pouvait inciter les complexes sucriers à implanter un atelier dédié au biodiesel.
Abordant enfin les carburants de deuxième génération, il a estimé qu'ils faisaient l'objet d'un vif intérêt de la part de l'administration brésilienne, qui avait lancé des programmes de recherche concernant l'hydrogénisation de l'huile végétale non raffinée et la fabrication de biodiesel à partir d'huile de ricin et d'alcool.
a ensuite insisté sur ce que la délégation française avait pu percevoir à travers ses rencontres au Brésil. Il a relevé que le ministre brésilien de l'agriculture avait présenté la question des biocarburants comme une « cause nationale » et profité de la présence d'une délégation française importante pour faire passer plusieurs messages, notamment sur la capacité de son pays à produire et exporter des biocarburants dans des conditions « socialement et écologiquement soutenables ». Il a notamment fait observer que le ministre avait déclaré que le développement de la culture de canne ne se ferait pas au détriment de la déforestation de la forêt amazonienne. Mettant en doute le caractère irréprochable, sur le plan environnemental, de l'agriculture brésilienne, M. Marcel Deneux a remarqué que des voix s'élevaient, même au Brésil, pour dénoncer les atteintes à l'environnement de l'agriculture intensive. Il a néanmoins noté le souci de la part des représentants des pouvoirs politiques brésiliens de placer la question des biocarburants dans le contexte des grands enjeux environnementaux auxquels l'ensemble de la planète devra faire face.
Revenant sur le sujet de l'éthanol, il a fait valoir l'augmentation de la productivité en sucre de 1 % par an depuis 30 ans et jugé que le Brésil était entré « dans l'âge mûr » du bioéthanol de première génération, le marché intérieur de l'alcool-carburant correspondant actuellement à 35 % en volume des carburants des véhicules légers. Il a jugé que c'était désormais vers l'exportation que s'orientaient maintenant les ambitions brésiliennes, comme le prouvaient la construction d'infrastructures spécifiques de transport par pipelines et d'un terminal d'exportation, l'idée étant d'affréter au retour les pétroliers venus d'Arabie Saoudite aux Etats-Unis.
S'agissant de la production d'éthanol de deuxième génération, il a estimé que l'hydrolyse enzymatique de la cellulose représentait un enjeu mondial, auquel serait d'ailleurs consacré le futur centre de recherches sur la fermentation enzymatique destiné à s'implanter en Haute-Marne, mais que les Brésiliens, sans attendre, s'étaient engagés dans l'hydrolyse acide et avaient développé le concept de « bio-raffinerie », orienté essentiellement sur la production d'éthanol.
a conclu en indiquant que le développement fulgurant des véhicules de type « flexfuel » -fonctionnant à 85 % à l'éthanol-, qui représentaient 80 % des ventes de véhicules neufs aujourd'hui, attestait du choix politique du Brésil de miser prioritairement sur l'éthanol pour les années à venir. Il a jugé que la France aurait tout intérêt à soutenir activement la mise en place d'une politique européenne de l'énergie, où elle jouerait un rôle actif.

a rebondi sur l'intervention de M. Marcel Deneux, s'appuyant sur son propre séjour d'une semaine, effectué au Brésil le mois dernier, dans le cadre d'un travail sur la biodiversité entrepris avec le sénateur Laffitte. Il a assuré qu'il tirait de son voyage les mêmes conclusions que M. Marcel Deneux, jugeant que le Brésil représentait un grand partenaire mondial dans l'approvisionnement alimentaire et énergétique de la planète. S'agissant de la culture de soja et des recherches en la matière, il a précisé qu'il convenait de se défaire d'une image du Brésil comme d'un pays en développement. Il a déclaré avoir établi des contacts avec plusieurs instituts de recherche de taille équivalente, pour l'un à l'Institut national de recherche agronomique (INRA), pour l'autre à l'Institut Pasteur, dont la plupart des chercheurs avaient d'ailleurs été formés en France.
Concernant la dimension environnementale du développement brésilien, il a estimé que l'objectif affiché était de développer, dans le respect de l'environnement, une production massive, le développement agricole étant officiellement identifié comme levier du développement global du pays. S'il est convenu de l'existence de programmes de recherche sur les méthodes de gestion durable de la forêt amazonienne et d'un souci affiché d'exploitation raisonnée de l'environnement, il a considéré que subsistaient beaucoup de zones de non-droit, certains acteurs économiques utilisant d'importants moyens financiers pour défricher sauvagement certains territoires, puis pour régulariser juridiquement leur situation en se faisant attribuer de faux droits par le biais de réseaux véreux.
En matière de biodiversité, M. Claude Saunier a relevé l'attachement manifesté par les Brésiliens au principe de souveraineté. Sans nier que l'Amazonie représentait le poumon de la planète, les interlocuteurs brésiliens se sont montrés très inquiets de toute ingérence dans la gestion de l'Amazonie, malgré l'existence avérée d'une « bio-piraterie » pillant la biodiversité. Il en a conclu que l'idée d'une organisation des Nations-Unies de l'environnement, si souhaitable fût-elle, devrait être promue avec la plus grande diplomatie afin d'assurer l'intégration des grands espaces brésiliens comme élément du patrimoine mondial, dans le respect de l'indépendance nationale. S'appuyant sur les échanges qu'il avait pu avoir avec l'ambassadeur de France au Brésil, il a mis en avant le bénéfice qu'il y aurait, pour la France, à multiplier les échanges avec le Brésil, naturellement francophile, par exemple par le biais du développement de relations interparlementaires.

a abondé en ce sens et évoqué son propre souvenir de la capacité d'adaptation des Brésiliens dans le domaine économique, notamment automobile, comme l'illustrait la construction en 18 mois d'une usine Renault employant des personnes d'une moyenne d'âge de 26 ans, d'une formation supérieure de deux ans après le baccalauréat, formation que les employés complétaient le soir par des cours financés sur leurs propres deniers.

s'est interrogé sur la part de la population active brésilienne employée dans l'agriculture.

a ensuite souhaité avoir des informations sur l'élevage, puisque M. Marcel Deneux avait évoqué les 200 millions d'hectares répertoriés en prairies, ainsi que sur les organismes génétiquement modifiés (OGM). Il s'est également demandé si la France, en matière de biocarburants, n'avait pas une bataille de retard.

a souhaité savoir si les chiffres de production de canne cités par M. Marcel Deneux visaient bien la production annuelle par hectare.

lui a répondu par l'affirmative. Puis après avoir évoqué les tensions sur les prix agricoles mondiaux, il a estimé qu'il existait des interférences entre les domaines alimentaire et non alimentaire, comme le prouvait l'exemple français, où l'équilibre de la filière éthanol reposait sur les co-produits, et donc sur la participation financière des éleveurs. Concernant les OGM, il a rappelé que les essais se développaient en France, et que 50 % d'entre eux portaient sur les betteraves à sucre.
La commission a poursuivi l'audition de M. Marcel Deneux à propos de son déplacement à Bruxelles, les 5 et 6 février, à l'occasion de la IIIe rencontre parlementaire, associant le Parlement européen et les Parlements nationaux sur la mise en oeuvre de la stratégie de Lisbonne.

Ayant rappelé que la stratégie de Lisbonne, adoptée en mars 2000, tend à faire de l'économie européenne la plus dynamique et la plus compétitive au monde à l'horizon 2010, en impliquant toute une série de domaines politiques comme la recherche, l'éducation, l'environnement et l'emploi, M. Marcel Deneux a indiqué qu'en novembre 2004, la Conférence des Présidents du Parlement européen avait décidé de mettre en place un groupe responsable du suivi de la position du Parlement européen sur la stratégie de Lisbonne. Ce groupe, composé de 33 membres, représente les différentes commissions concernées, et a pour mandat de faire des propositions à la Conférence des Présidents et d'organiser des réunions avec les Parlements nationaux, afin de renforcer le dialogue parlementaire sur ce sujet.
Après deux réunions tenues en 2005 et 2006, cette IIIe rencontre organisée conjointement par le Parlement européen et le Bundestag allemand, et donc coprésidée par M. Hans-Gert Pöttering, nouveau président élu du Parlement européen, et M. Norbert Lammert, président du Bundestag, a vu la participation de tous les Etats membres et de représentants du Parlement turc, de la Croatie et de la Macédoine.
a indiqué que les trois sujets traités, à savoir marché intérieur et innovation, énergie durable et enfin capital humain à travers l'éducation, la création d'emplois et les aspects sociaux, avaient donné lieu à des ateliers distincts et qu'il avait participé à celui consacré à l'énergie durable.
Présentant les conclusions du groupe de travail consacré au marché intérieur et à l'innovation, il a fait valoir qu'un très net consensus s'était dégagé pour recommander l'achèvement du marché intérieur afin d'améliorer la compétitivité de l'Union européenne et répondre dans les meilleures conditions à la mondialisation alors que, trop souvent dans l'opinion publique, cet achèvement apparaît comme son corollaire négatif. Il a précisé que cet achèvement devait concerner tous les secteurs, le marché de l'énergie, les marchés financiers, les services postaux et les télécommunications ayant été cités comme les plus importants, ainsi que celui des transports et du tourisme. Il a été également mis en avant le lien existant entre l'achèvement du marché intérieur et le processus de ratification du traité institutionnel.
a indiqué que la question des petites et moyennes entreprises avait également été abordée pour recommander un allègement de leurs charges administratives, leur faciliter l'accès au marché intérieur et renforcer leur implication en matière d'innovation.
Sur ce dernier point, a-t-il fait remarquer, le débat a porté sur les moyens de mieux diffuser le savoir et l'innovation au niveau des entreprises et dans les circuits économiques. Le rôle positif des pôles de compétitivité régionaux a été souligné, ainsi que l'intérêt de mieux utiliser les outils disponibles pour assurer leur développement, notamment en matière fiscale.
Il a ensuite exposé que le deuxième groupe de travail consacré au capital humain, à travers l'éducation, l'emploi et les aspects sociaux, s'était surtout attaché, d'une part, à vérifier si des mesures concrètes nationales étaient prises pour mettre en oeuvre la stratégie de Lisbonne et, d'autre part, à définir le bon niveau d'exécution des programmes nationaux.
Parmi les principales recommandations émanant du groupe de travail, il a cité la lutte contre les discriminations, avec une attention particulière portée à l'accès au marché du travail des jeunes salariés et des travailleurs âgés, un investissement dans un dialogue social approfondi qui doit aller de pair avec le développement économique, le renforcement de la formation professionnelle tout au long de la vie et le rapprochement entre les universités et le monde du travail.
Le groupe de travail a aussi débattu de la « flexi-sécurité », en soulignant la nécessité d'une approche équilibrée entre un marché du travail flexible favorisant la mobilité professionnelle et une meilleure allocation des compétences et un niveau adapté de protection et de droit sociaux.
Il a souligné que l'Union européenne devait jouer un rôle essentiel en définissant un niveau minimum de protection sociale à respecter par tous, l'amélioration des standards de protection devant se faire sur un jeu gagnant-gagnant pour l'ensemble des intervenants.
Le groupe de travail a aussi souhaité que la stratégie de Lisbonne intègre spécifiquement l'évolution de la démographie dans les Etats membres, en développant des politiques prenant en compte le vieillissement de la population.
a ensuite présenté la synthèse du groupe de travail, consacré à l'énergie durable, en soulignant qu'un large consensus s'était dégagé sur la nécessité d'une politique commune au niveau européen sur la sécurité des approvisionnements et d'un engagement européen fort dans la lutte contre le changement climatique. Plus généralement, a-t-il ajouté, les intervenants ont insisté sur la nécessité d'une politique communautaire en matière d'énergie, tout en indiquant que des divergences subsistaient entre les Etats membres et le Parlement européen sur les mesures à adopter au niveau communautaire.
En ce qui concerne la lutte contre le changement climatique, tout le monde est d'accord pour souhaiter que l'Europe joue un rôle précurseur et pour accroître les actions conduites dans ce domaine. Bien que les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre aient été jugés difficiles à atteindre pour beaucoup d'Etats-membres, la volonté exprimée est d'engager les négociations sur l'après-Kyoto en persuadant d'autres pays de rejoindre la table des négociations.
Il a relevé que beaucoup avaient souligné la nécessité de prendre en compte le secteur des transports, contributeur important en matière d'émissions de gaz à effet de serre, et qu'il s'agissait également d'améliorer l'efficacité énergétique, car des marges de progrès importantes pouvaient être obtenues, tant du côté des producteurs d'énergie que du côté des consommateurs.
Tous les participants ont été également d'accord pour encourager la diversification des sources d'énergie afin de diminuer la dépendance énergétique de l'Union européenne, mais aussi de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Si une très grande majorité, a-t-il fait valoir, approuve le renforcement des objectifs à atteindre en matière d'énergies renouvelables, la majorité considère que chaque Etat membre doit définir le mix-énergie qui lui est plus adapté et, en particulier, aucun consensus ne s'est dégagé sur le recours à l'énergie nucléaire.
Il y a, en revanche, un consensus sur la nécessité d'achever le marché intérieur de l'énergie pour améliorer sa compétitivité, son efficacité, ainsi que la sécurité des approvisionnements, même si des divergences importantes subsistent sur la manière d'y parvenir. Si certains considèrent qu'il est important de mettre en place un régulateur de concurrence, tous ne partagent pas la proposition du Parlement européen sur la séparation totale de la propriété des réseaux et son impact sur les prix n'a pas été réellement examiné.
Après avoir insisté sur la nécessité de renforcer la recherche sur le développement des nouvelles technologies en matière d'énergie, tant en ce qui concerne le stockage des énergies renouvelables que la 4e génération des réacteurs nucléaires, les participants ont considéré, en conclusion, que les propositions faites par la Commission en janvier 2007 sur une nouvelle politique de l'Union européenne dans le domaine de l'énergie pouvaient contribuer aux objectifs de la stratégie de Lisbonne en matière de croissance et de création d'emplois qualifiés.
a ensuite évoqué l'intervention de M. José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, qui a déclaré prendre bonne note du souhait exprimé en faveur du renforcement de la coopération au niveau communautaire, notamment en matière de recherche.
Il a souligné, également, l'urgence des réformes à entreprendre au sein de l'Europe pour que celle-ci s'adapte au contexte de la mondialisation et sur la nécessité de mieux communiquer sur les avantages que l'Union européenne tire de l'élargissement en termes de marchés et d'emplois.
En matière de coopération et de solidarité intracommunautaire, le président de la Commission européenne a insisté sur le bon usage des fonds structurels, pour améliorer la compétitivité des Etats-membres, d'où la nécessité de leur fléchage « stratégie de Lisbonne ».
Après avoir rappelé qu'historiquement les questions énergétiques avaient joué un rôle fondamental dans la construction européenne, à travers la CECA et Euratom, il a considéré que la sécurité de l'approvisionnement énergétique et la lutte contre le changement climatique constituaient désormais des enjeux essentiels. Il a souhaité que l'Union européenne soit à l'avant garde dans les propositions de réduction des émissions de gaz à effet de serre et s'est déclaré convaincu d'un changement d'attitude des Etats-Unis.
Enfin, il a considéré que l'économie mondiale était confrontée à une nouvelle révolution post-industrielle, moins consommatrice en carbone, et qu'il fallait accompagner ce changement de façon collective.
En conclusion, M. Marcel Deneux a jugé très important que les parlementaires nationaux participent à ce genre de réunions même si, sur le fond, le débat apporte peu d'éléments novateurs.
En effet, a-t-il ajouté, il convient d'oeuvrer pour favoriser l'appropriation nationale de la stratégie de Lisbonne, car ses objectifs en matière de croissance économique, d'emploi qualifié, d'investissement dans le capital humain, de renforcement de la cohésion sociale et de prise en compte de la dimension internationale influent durablement sur l'avenir de tous. Aussi bien a-t-il suggéré, pour une meilleure information des commissaires, d'entendre, une fois par an, le ministre en charge de la mise en oeuvre de la Stratégie de Lisbonne -actuellement, il s'agit de Mme Catherine Colonna, ministre déléguée aux affaires européennes- afin de faire le point sur les mesures concrètes adoptées par la France pour parvenir aux objectifs fixés dans la stratégie et sur l'évaluation des résultats obtenus.

a confirmé que beaucoup de secteurs relevant de la compétence de la commission des affaires économiques étaient influencés par les objectifs de la stratégie de Lisbonne et il s'est déclaré favorable à l'audition, par la commission, du ministre en charge de sa mise en oeuvre.

s'est interrogé sur le bien-fondé des objectifs de la stratégie de Lisbonne, en se demandant s'il ne s'agissait pas plutôt de la réflexion d'une « société savante » cherchant à se donner conscience. Il a considéré, en effet, que ni les responsables politiques, ni les acteurs économiques n'étaient prêts à recommander une diminution de la consommation énergétique, l'abandon de l'énergie nucléaire ou encore l'interdiction des transports aériens « inutiles », et plus généralement à prôner une décroissance économique, pour lutter efficacement contre le changement climatique.

Lui répondant, M. Marcel Deneux, tout en déclarant partager certaines de ses interrogations, s'est déclaré convaincu que la croissance économique pouvait être plus économe en énergie grâce à une véritable révolution technologique, en citant l'exemple des bio-carburants. Il a considéré, en outre, que les pays industrialisés devront prendre des engagements de réduction plus importants afin de préserver les marges de croissance économique des pays en voie de développement.
La commission a ensuite procédé à l'audition de M. Patrick Kron, président-directeur général d'Alstom.

a souhaité la bienvenue à l'intervenant, au nom de la commission des affaires économiques, mais également du groupe d'amitié France-Canada, présidé par M. Marcel-Pierre Cléach, présent à ses côtés. Rappelant que M. Patrick Kron avait été nommé à la tête de la société Alstom en 2003, alors que cette dernière connaissait de grandes difficultés, il a souligné l'importance actuelle du groupe que la délégation en Chine de la commission, en 2005, avait constatée en rencontrant plusieurs de ses représentants à Shanghai.
Précisant qu'il était accompagné par M. Maurice Benassayag, directeur des relations publiques d'Alstom-Transport et par M. Fred Einbinder, directeur juridique d'Alstom, M. Patrick Kron a tout d'abord présenté le groupe Alstom. Employant 60.000 à 65.000 personnes dans le monde, celui-ci concentre les deux tiers de son activité dans la fabrication et la maintenance de centrales électriques. Alimentées par des ressources extrêmement diversifiées (gaz, charbon, énergie nucléaire ou hydroélectrique) et représentant 25 % de l'énergie électrique produite sur la planète, elles font de la société le deuxième ou troisième groupe mondial du secteur. Le transport ferroviaire, constituant la seconde activité d'Alstom, offre une large gamme allant de la fabrication des matériels roulants -TGV, tramways, métros, trains régionaux et interrégionaux, locomotives de fret ...- à la fourniture de services, en passant par la construction d'infrastructures et la signalisation. Présent dans 60 pays, Alstom possède 25 % de ses effectifs en France, où il réalise 10 % de ses ventes et investit 50 % de ses dépenses de recherche et développement, son activité sur notre territoire ayant donc un rôle d'entraînement majeur à l'international.
Rappelant les difficultés rencontrées par le groupe en 2003, M. Patrick Kron a rappelé que ce dernier avait dû vendre une partie substantielle de ses activités, notamment à la demande de la Commission européenne, perdant ainsi 35.000 de ses salariés, mais également se restructurer industriellement, perdant de ce fait 15.000 employés supplémentaires. Dans le cadre de la restructuration financière du groupe, l'Etat a pris une participation de 20 % au capital, mais a souscrit auprès des autorités communautaires l'engagement de céder ses parts au plus tard en 2008. Il a donc revendu celles-ci à Bouygues, qui en possède désormais 25 %. Les pouvoirs publics ont réalisé, à cette occasion, une plus-value appréciable, en récupérant 2 milliards d'euros, après en avoir investi 800 millions deux ans auparavant. La reprise des marchés a ensuite permis au groupe de se redresser et de se développer, jusqu'à recruter 7.000 personnes en 2006, dont un millier en France et la moitié pour des postes d'ingénieurs et cadres, prouvant ainsi que les difficultés rencontrées trois ans auparavant n'avaient été qu'accidentelles et que la société était restée viable sur le long terme.
Evoquant ensuite les problèmes rencontrés plus récemment au Canada, M. Patrick Kron a tout d'abord précisé qu'il était par principe favorable à l'ouverture des marchés et à la libéralisation des échanges internationaux. Soulignant qu'ils n'avaient pas nécessairement pour conséquence une destruction des emplois sur notre territoire, et qu'ils donnaient même lieu à un accroissement des effectifs nationaux du groupe, il a précisé que deux tiers d'entre eux travaillaient à l'export et que, de même, le tiers de ce que produisait le groupe dans l'Union européenne était commercialisé dans des pays tiers. Il a néanmoins conditionné cette libéralisation à l'existence de règles communes et réciproquement appliquées, disant accepter pleinement l'idée que l'entreprise canadienne Bombardier remporte des appels d'offre en France pour la fournitures de trains en région d'Ile-de-France dès lors qu'une mise en concurrence symétrique serait pratiquée au Canada à l'égard des entreprises étrangères. Or, cela n'a pas été le cas, a-t-il estimé, indiquant que le groupe canadien s'était vu accorder des contrats de gré à gré à Toronto et Montréal lui permettant d'accroître ses marges sur le marché intérieur, et donc de proposer ensuite une offre plus compétitive que celle de ses concurrents, à l'international. Le Canada a considéré, en effet, que les autorités provinciales -celles du Québec, en l'occurrence- pouvaient s'exonérer des règles générales d'appel d'offres et passer des marchés de gré à gré. Considérant que la procédure suivie à cet effet n'était même pas conforme au droit local, Alstom à porté l'affaire devant les juridictions canadiennes.
Certes, a poursuivi M. Patrick Kron, l'Union européenne a prévu un dispositif écartant l'application des règles générales de mise en concurrence à des entreprises relevant d'un pays ne respectant pas ces mêmes règles à l'égard d'entreprises européennes sur son propre territoire. Néanmoins, ces mesures n'ont, à l'heure actuelle, pas encore été intégrées dans l'ordre juridique communautaire et n'ont donc pas été appliquées, du fait notamment d'arguments portant sur la nationalité du groupe Bombardier. Si cette carence n'indispose pas les pays qui, comme le Royaume-Uni, d'ailleurs aujourd'hui dépourvu d'industrie ferroviaire, y voient un moyen de bénéficier de prestations plus compétitives de la part d'un groupe étranger comme Bombardier, il serait cependant opportun, a-t-il conclu, de donner aux autorités européennes et nationales les instruments juridiques leur permettant de s'assurer que les règles de passation des marchés publics soient appliquées de façon symétrique sur le territoire communautaire et extra-communautaire.

Convenant que la restructuration du groupe Alstom, bien que difficile, avait été indispensable, et que les difficultés qu'il avait rencontrées au Canada constituaient une réelle anomalie à laquelle l'Organisation mondiale du commerce (OMC) devrait remédier, M. Jean-Paul Emorine, président, a dit partager entièrement l'avis de l'intervenant et appelé les élus à réagir pour préserver l'activité de l'entreprise.

Assurant ses collègues du plaisir qu'il avait à revenir devant la commission des affaires économiques, dont il avait été membre, M. Marcel-Pierre Cléach a félicité l'intervenant pour le redressement de son entreprise. Estimant que les autorités européennes et nationales avaient fait preuve d'une certaine naïveté, il s'est dit interloqué par l'absence d'instruments juridiques permettant d'encadrer les marchés publics, aboutissant à ce que des constructeurs asiatiques aient été retenus, après adjudication par le ministère de la défense, pour fournir en automobiles la gendarmerie française. Puis il a interrogé l'intervenant sur sa vision de l'avenir du groupe Alstom, eu égard notamment à sa diversification vers les énergies nouvelles, ainsi que sur le dossier du TGV pendulaire.

Soulignant que le parcours boursier d'Alstom n'avait pas systématiquement correspondu à son activité réelle, M. Marcel Deneux souscrit à l'opinion de l'intervenant sur la naïveté dont avaient fait preuve l'Union européenne et la France, ajoutant qu'elle n'était pas partagée, loin s'en faut, par des pays comme les Etats-Unis ou le Japon. Puis il l'a également questionné sur la façon dont il entendait concilier objectifs économiques et contraintes écologiques, ainsi que sur l'importance des recherches consacrées à l'amélioration de l'efficacité énergétique des produits vendus par le groupe.

Rappelant que le Sénat avait lancé une réflexion, par le biais d'une mission d'information, sur les notions de centre de décision économique et d'attractivité du territoire, M. Christian Gaudin a interrogé l'intervenant sur ce sujet, ainsi que sur la pertinence du concept de nationalité d'une entreprise.
Soulignant qu'il n'entendait entrer en conflit avec quiconque, et surtout pas avec les autorités canadiennes, M. Patrick Kron s'est dit favorable à la création d'un organisme comme l'Observatoire de la concurrence. Estimant que les Etats -et non des entreprises, pas même publiques- devaient seuls avoir compétence pour décider si les règles de mise en concurrence étaient ou non symétriquement appliquées, il a incité à plaider en ce sens auprès des institutions communautaires.
Considérant que la protection de l'environnement constituait une problématique fondamentale, il a estimé qu'il était possible de trouver un nouvel équilibre entre besoins énergétiques et contraintes écologiques, en particulier en augmentant l'efficacité des centrales électriques déjà installées. Rapportant que les experts prévoyaient une répartition à parts égales de la production d'électricité entre le gaz et le pétrole d'une part, le charbon d'autre part, et enfin les autres formes d'énergie, il a assuré que des recherches étaient actuellement menées pour améliorer l'efficacité énergétique des centrales électriques. Ajoutant que l'augmentation de 2 % seulement du rendement du parc installé produisant de l'électricité à partir du charbon, actuellement estimé à environ 30 %, réduirait de 5 % l'ensemble des émissions de gaz carbonique, il a escompté que les clients souhaitant acquérir des équipements sûrs et respectueux de l'environnement s'adressent préférentiellement à des entreprises offrant ces technologies innovantes plutôt qu'à celles de pays émergents, moins chères, mais moins performantes. S'agissant de l'énergie hydraulique, principale énergie renouvelable, il a souligné qu'Alstom, avec 30 % du marché, était leader mondial, ajoutant qu'il serait à présent opportun pour le groupe de pénétrer sur le marché de l'éolien.
Répétant qu'il était vain d'opposer développement des échanges internationaux et maintien d'une base européenne forte, l'un alimentant l'autre, il a indiqué que l'existence d'un marché domestique et le développement de la base industrielle d'un pays étaient attentivement examinés avant de décider d'y implanter des unités de production en vue d'honorer un contrat d'approvisionnement. Enfin, précisant que la langue de travail du groupe était l'anglais, il a néanmoins insisté sur la nécessité de développer des lycées français partout dans le monde, regrettant à cet égard la réduction des financements publics leur étant consacrés.

a considéré que le marché remporté par la société Bombardier pour les transports en Ile-de-France était pénalisant pour Alstom, tant sur le plan économique que psychologique. Après s'être interrogé sur l'organisation de la chaîne de fournitures dans le secteur ferroviaire, il a souhaité savoir si le contrat décroché par Bombardier en Ile-de-France allait profiter aux équipementiers français et connaître le montant des cotisations de taxe professionnelle acquitté respectivement par Alstom et Bombardier à la région d'Ile-de-France. Enfin, après avoir évoqué la restructuration de l'entreprise Alstom, notamment par la vente de la branche des chantiers navals, il s'est demandé si l'entrée de Bouygues dans le capital du groupe, à hauteur de 25 %, mettait Alstom à l'abri d'une opération d'offre publique d'achat.

a déclaré partager entièrement les propos de M. Patrick Kron sur l'exigence de règles symétriques dans les conditions d'accès aux marchés publics des pays industrialisés. Mais faisant valoir que le siège mondial de Bombardier Transport, filiale de Bombardier, était localisé à Berlin et que l'usine française de Bombardier située à Crespin (59) allait fabriquer et assembler une partie du matériel permettant d'honorer le contrat remporté par Bombardier en Ile-de-France, il a considéré que les interrogations de la Commission européenne sur l'identité de ce groupe pouvaient être légitimes.
Evoquant les activités du groupe Alstom dans le secteur de l'énergie, et notamment l'équipement de la partie conventionnelle des installations nucléaires, il s'est demandé si l'entrée de Bouygues dans le capital du groupe ne constituait pas le prélude à des rapprochements avec d'autres entités présentes dans le secteur.
Tout en rappelant qu'Alstom avait connu un grand succès avec le TGV, caractérisé par la technique d'une rame articulée entre deux motrices, ce qui avait permis le développement des TGV en duplex, il a fait valoir qu'en ce qui concerne les trains à grande vitesse à un niveau, la demande portait sur du matériel ferroviaire à motorisation répartie sur l'ensemble de la rame, ce qui permettait d'augmenter le nombre de places disponibles. Soulignant que Siemens, sur ce segment, disposait actuellement d'une avance technique, il a voulu savoir à quelle date Alstom serait en mesure de commercialiser la technologie innovante de l'AGV (automotrice à grande vitesse), fondée sur le concept d'une rame entièrement articulée et à motorisation répartie.

rappelant qu'il avait été chargé d'une mission temporaire par les ministres en charge des affaires étrangères, de l'éducation nationale et de l'économie sur les modes de financement de l'enseignement français à l'étranger, s'est félicité de ce que les ambassadeurs soient désormais chargés de bâtir un plan Ecole sur trois ans en associant à ce projet toutes les composantes de la communauté française concernée. Il a fait valoir toute l'importance des lycées français pour contribuer au rayonnement de la culture et de la langue française dans le pays d'accueil et a regretté la faible implication des entreprises françaises implantées à l'étranger sur le plan élaboré par les ambassades de France.
Il s'est ensuite interrogé, à propos de la branche Transports du groupe, sur les marges de progrès identifiées par Alstom pour tendre vers l'excellence, à travers le « benchmarking » pratiqué vis-à-vis des entreprises concurrentes.
Evoquant l'expansion du secteur ferroviaire en Afrique du Sud, il a regretté qu'Alstom n'ait pas été retenu dans le contrat concernant la réalisation de la ligne Johannesbourg-Prétoria.
Leur répondant, M. Patrick Kron a apporté les éléments d'information suivants :
- Alstom emploie en France 7.500 salariés dans l'activité Transport et Bombardier six fois moins, ce qui se répercute sans doute sur les montants de taxe professionnelle acquittés par les deux entreprises ;
- la qualité de la chaîne de fournitures est un élément essentiel pour le groupe Alstom, qui achète 50 % des produits qu'il vend ; il ne s'agit cependant pas de la même organisation que dans le secteur automobile, les séries produites étant plus courtes dans le domaine ferroviaire ;
- Alstom entend développer sa capacité d'adaptation aux besoins spécifiques de ses clients, à partir de « composants génériques » compétitifs et d'une compétence ingénierie permettant de répondre précisément à la demande ;
- l'intérêt du plan Ecole développé par les ambassades de France à l'étranger est réel et justifie pleinement que l'Etat français supporte financièrement ce projet ;
- Alstom s'est engagé dans des projets importants en Afrique du Sud dans le secteur de l'énergie, tant sur des centrales thermiques au charbon que sur des installations nucléaires ;
- Bouygues et Alstom n'ont pas d'obligation d'intégration verticale dans leur démarche commerciale, mais mettent en oeuvre des partenariats lorsque cela est opportun ;
- le débat sur la nationalité de l'entreprise Bombardier s'est enlisé au niveau européen, alors même qu'au Canada, celle-ci est clairement et légitimement considérée comme une entreprise canadienne ;
- Alstom intervient dans le secteur nucléaire, un tiers des centrales nucléaires au niveau mondial étant équipé d'un matériel conventionnel qu'il fabrique, mais il n'existe pas de projet de rapprochement avec Areva, car l'ouverture du capital de cette entreprise n'est pas à l'ordre du jour ; il s'est néanmoins déclaré favorable à une réflexion sur la filière nucléaire ;
- la technologie innovante de l'AGV doit permettre de produire un prototype d'ici à la fin de l'année 2007 permettant des gains de place importants et offrant plus de souplesse sur la taille des trains, mais il s'agit d'un produit haut de gamme sur lequel les grandes compagnies de transport ferroviaire ne se sont pas encore prononcées pour le lancement.

s'est déclaré très intéressé par l'affirmation qu'un groupe industriel peut produire en France, en intégrant des préoccupations sociales et en cherchant à concilier activité économique et normes environnementales. Il a souhaité savoir quelle avait été la position adoptée par le président de la région Ile-de-France à propos du contrat remporté par Bombardier. Il s'est demandé si l'évolution morphologique des personnes impliquait une adaptation des normes de fabrication du matériel ferroviaire. Evoquant enfin le démarrage difficile du ferroutage en France, il a voulu savoir si cela était lié à des difficultés techniques concernant le matériel disponible.

s'est demandé si, dans sa démarche de développement durable, le groupe Alstom allait intégrer la technique de capture du CO2 dans ses développements futurs. Jugeant inéluctable un rééquilibrage des différents modes de transport en faveur du ferroviaire, il a souhaité savoir quels étaient les projets du groupe en ce qui concerne le TGV pendulaire pour répondre aux attentes des élus de l'ouest de la France et s'il était envisageable qu'Alstom, seul ou avec ses partenaires européens, développe une stratégie ferroviaire commune sur des matériels exportables dans le monde entier.

rappelant l'implantation de Bombardier dans le Nord de la France et les coopérations développées entre Alstom et ce groupe industriel, a mis en garde contre les excès d'un patriotisme économique à l'encontre d'un concurrent qui pourrait nuire à une entreprise installée et produisant en France.
Il a considéré que le contrat remporté par Bombardier s'inscrivait dans le cadre de la libre concurrence, que le Gouvernement français ainsi que les autorités européennes n'avaient pas souhaité exiger des règles de symétrie dans les conditions d'ouverture des marchés publics au Canada et qu'il s'agissait d'une décision politique qui s'imposait ensuite à tous les opérateurs économiques. Il a fait valoir qu'Alstom, historiquement, avait également bénéficié des procédures du marché de gré à gré passé avec la SNCF et que le lancement du TGV avait bénéficié en son temps de soutiens publics.
S'appuyant sur son implication en tant que président d'une commission de concertation à propos de l'installation d'une boucle d'essai ferroviaire dans la région Nord-Pas-de-Calais, il a fait valoir tout l'intérêt de ce projet pour permettre à Alstom de tester son matériel, dès lors que l'entreprise ne peut plus utiliser les sillons dont la SNCF est propriétaire. Il s'est demandé qui aurait la maîtrise d'ouvrage entre l'Etat, la région Nord-Pas-de-Calais ou alors Alstom, en coopération éventuellement avec Bombardier et Siemens pour assurer la rentabilité du dispositif. Relevant, en outre, l'impact environnemental du projet et l'émotion légitime des populations concernées par le tracé, il a souhaité avoir des informations précises sur le degré d'engagement d'Alstom, craignant que le choix d'un autre pays de l'Union européenne n'entraîne des délocalisations ultérieures, alors même qu'en matière de recherche, des synergies fortes existent entre ce projet et le pôle universitaire de Valenciennes.
Relevant enfin que le TGV, malgré son succès indéniable en France, avait été finalement peu exporté en raison des contraintes liées à l'obligation de construction de voies nouvelles, il a fait valoir tout l'intérêt de l'alternative offerte par le train pendulaire qui ménage plus de flexibilité dans le tracé et les voies utilisées, ainsi que des performances très intéressantes en matière de vitesse.

s'est félicité du partenariat exemplaire entre les collectivités territoriales, l'université et le laboratoire Pearl de l'usine Alstom de Tarbes intervenant dans le domaine de l'électronique embarquée et il s'est demandé si ceci avait été généralisé sur d'autres sites.
En réponse, M. Patrick Kron a réaffirmé ne pas vouloir opposer développement international et délocalisations dans le secteur ferroviaire, dès lors que la France conserve une avance technologique. De même, en matière de protection sociale et de préservation de l'environnement, dès lors qu'on reste vigilant sur l'exigence de symétrie dans une économie de plus en plus ouverte.
Il a déclaré n'avoir pas encore obtenu de rendez-vous avec le président de la région d'Ile-de-France s'agissant du contrat remporté par Bombardier et reconnu, à ce propos, que la proposition faite par Alstom ne correspondait pas exactement aux besoins de la SNCF, qui recherchait un matériel ferroviaire plus standard pour ses lignes de banlieue ; le train proposé par Alstom s'est avéré plus performant, mais plus cher.
Il a considéré que le développement du ferroutage n'était pas obéré par des questions techniques, mais par un problème de solvabilité de la filière, alors qu'elle peut jouer un rôle structurant pour l'aménagement du territoire.
Il a considéré comme inopportun la création d'un « Airbus ferroviaire », mais souligné que la réflexion était largement engagée sur un indispensable travail de normalisation, relevant, à titre d'exemple, qu'il fallait embarquer sept systèmes de signalisations sur le tracé Paris-Amsterdam.
a également soutenu tout l'intérêt du projet de boucle d'essai ferroviaire défendu par la région Nord-Pas-de-Calais comme pôle d'excellence ferroviaire, souhaitant qu'une juste répartition des financements puisse être définie et M. Maurice Benassayag a ajouté que la région était prête à financer le projet à hauteur de cent millions d'euros et que des modifications du tracé initial étaient envisageables pour tenir compte des remarques des élus et éviter des zones fortement urbanisées.
rappelant qu'Alstom proposait une gamme de trains couvrant les segments de la très grande et de la grande vitesse a jugé que, dans certaines régions, la difficulté résidait dans la combinaison de tronçons associant TGV et train pendulaire, la SNCF ne souhaitant légitimement pas que les sillons dédiés au TGV soient utilisés par les trains pendulaires. Il a indiqué que les recherches portaient notamment sur l'augmentation de la puissance d'un train pendulaire pour le faire aller plus vite sur des lignes dédiées au TGV.
Il a enfin souhaité que les liens avec l'université du laboratoire Pearl de l'Usine Alstom à Tarbes soient maintenus.
Puis M. Jean-Paul Emorine, président, a remercié M. Patrick Kron de la clarté et de la franchise de ses propos, en soulignant que son audition avait suscité beaucoup d'intérêt.