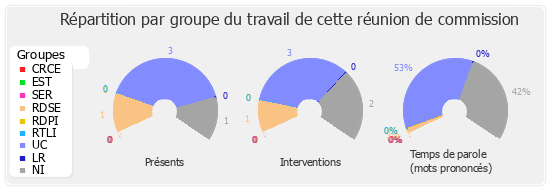Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation
Réunion du 10 juin 2008 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion
Au cours d'une réunion commune, les commissions des finances et des affaires culturelles ont entendu les conclusions de MM. Philippe Adnot et Jean-Léonce Dupont, corapporteurs, présentées au nom du groupe de travail commun sur la réforme de l'allocation des moyens par l'Etat aux universités.

a exposé tout d'abord les critiques du système analytique de répartition des moyens (San Remo), considéré comme « à bout de souffle ». Il en a rappelé les principes :
- la détermination théorique des besoins des établissements en crédits et en fonctionnement ;
- les trois critères principaux : les effectifs d'étudiants, l'encadrement en emplois administratifs et techniques, les surfaces consacrées à l'enseignement, qui servent à calculer quatre types de financement.
Puis il a présenté les limites du dispositif : complexité, inadaptation par rapport aux besoins et effets pervers des critères, instabilité due à un changement fréquent des paramètres et faible lisibilité nécessitant des rectifications, incapacité à corriger les écarts et tendance inflationniste, inadaptation au système LMD (Licence-Master-Doctorat) et à la logique de performance ou à une appréciation qualitative.
Il a conclu à l'impérieuse nécessité de faire évoluer le mode d'allocation des moyens par l'Etat aux universités.

a poursuivi en présentant l'économie générale du dispositif qui pourrait succéder au système San Remo.
Il a souligné que les travaux du groupe de travail avaient pour objectif la mise en place d'un système à la fois clair, lisible et transparent, ayant pour double ambition de restaurer une plus grande équité entre les universités, tout en incitant ces dernières à davantage d'efficience dans l'utilisation de leurs moyens.
Après avoir précisé que le groupe de travail s'était appuyé sur les travaux engagés par la direction générale de l'enseignement supérieur (DGES) et les inspections générales, il a énoncé les principes constitutifs du nouveau modèle :
- un système applicable à l'ensemble des établissements, quelle que soit leur date de passage à l'autonomie ;
- une répartition des moyens à partir des crédits et des plafonds d'emplois votés en loi de finances initiale ;
- un périmètre élargi afin de mieux prendre en compte les financements de l'Etat (incorporation de la masse salariale) et de mieux appréhender les missions de service public des universités (intégration de l'activité recherche au côté de la formation) ;
- une vocation incitative nouvelle grâce à la mise en place d'un financement compétitif lié aux performances aussi bien qualitatives que quantitatives des établissements. Ce financement est complémentaire d'un financement de base majoritaire calculé à partir d'un « forfait étudiant » et prenant en compte l'activité des établissements.
S'agissant de la détermination du montant des crédits alloués sur la base de la performance, il a expliqué qu'une distinction devait être faite entre la formation, qui actuellement ne fait pas l'objet d'un financement qualitatif, et la recherche, dont le financement s'inscrit d'ores et déjà dans un processus de performance.
Il a ainsi proposé que, si 10 % des crédits de formation pouvaient être attribués en fonction de résultats qualitatifs, ce qui serait une novation majeure, cette part pourrait être portée à 30 ou 50 % pour la recherche. Au total, la proportion des crédits de formation et de recherche alloués au titre de la performance pourrait donc être comprise entre 13,5 % et 20 % dès 2009.
Afin de pondérer les résultats issus de l'application du nouveau modèle, il a souhaité qu'une part limitée des crédits fasse l'objet d'une négociation entre le ministère et l'établissement. Cette marge d'appréciation qualitative devrait permettre de prendre en compte des éléments essentiels et non quantifiables, tels que la qualité du projet d'établissement ou de la gestion de l'université, ainsi que d'éventuelles spécificités, liées par exemple à l'aménagement du territoire.
Il a précisé que cette part contractuelle négociée pourrait, dans une fourchette limitée (1 à 2 % des crédits alloués), faire varier le montant attribué à la performance. Il a indiqué, néanmoins, que la condition d'un tel dispositif reposait sur sa transparence. Ainsi, afin d'être légitime, l'attribution de cette « enveloppe qualitative » devra être motivée par le ministère, éventuellement en fonction d'une grille d'appréciation, et connue de l'ensemble des autres établissements.

a présenté ensuite les critères d'évaluation préconisés par le groupe de travail. Il a précisé d'emblée que ces critères - ou faisceaux de critères - à la fois quantitatifs et qualitatifs devraient permettre de mieux évaluer la capacité des établissements à accomplir leurs différentes missions ainsi que leurs progrès en la matière.
Il a souligné que la mise en place du système était conditionnée par la disponibilité et la fiabilité des informations. Le ministère devra donc veiller à l'établissement d'indicateurs et de processus d'évaluation pertinents.
Il a précisé, bien que tous les critères ne soient pas immédiatement et parfaitement applicables, qu'ils devraient néanmoins être fixés d'emblée. Il importe, en effet, d'afficher les objectifs dès le lancement de la réforme si l'on veut garantir son caractère incitatif. En revanche, leur pondération devra varier au cours du temps, en fonction de la capacité à les renseigner.
Il a jugé que la réussite de cette dynamique dépendrait à la fois des moyens mis en oeuvre par les universités d'une part, et de l'exigence du calendrier de montée en charge des nouveaux critères d'autre part.
a évoqué ensuite le financement de la formation. S'agissant ainsi de la mise en place d'un « forfait étudiant », le groupe de travail soutient l'entreprise de simplification engagée par le ministère, mais compte tenu des effets pervers d'un critère fondé sur le taux de réussite, il s'est prononcé en faveur d'un critère d'insertion professionnelle (quantitative et qualitative). Les critères suivants semblent pertinents :
- le taux d'insertion professionnelle à 6 mois et à 3 ans, sachant que la poursuite d'études doit être prise en compte, notamment au niveau de la licence.
- sur le plan plus qualitatif, le niveau de salaire ou le statut de cadre (pour les diplômes niveau master ou les doctorats).
Il a relevé que ce critère posait des problèmes méthodologiques. Afin de pouvoir en disposer le plus rapidement possible et de manière fiable, il a suggéré :
- d'inscrire d'ores et déjà la date de transition vers ce critère : par exemple en 2010 pour des simulations et 2012 pour une mise en oeuvre effective ;
- d'élaborer un cahier des charges commun à l'ensemble des universités, afin que chacune évalue l'insertion professionnelle selon les mêmes critères et méthodes, cette homogénéité étant nécessaire à la crédibilité de l'indicateur ;
- d'inciter les universités à mettre en place les moyens de renseigner ces critères : implication des équipes pédagogiques, prise en compte de la rapidité de mise en oeuvre de ce critère.
a insisté sur la nécessité de croiser ce critère d'insertion avec des indicateurs permettant de prendre en compte l'origine socio-économique ou la formation scolaire des étudiants, afin de mieux évaluer la valeur ajoutée apportée par l'université.
Par ailleurs, les procédures d'auto-évaluation des universités devront être développées, la certification des processus d'auto-évaluation (type ISO 9000) pouvant constituer un bon indicateur à cet égard.
Il a exprimé le souhait que le ministère veille à la cohérence globale de l'offre de formation et s'assure notamment du maintien sur le territoire d'une offre suffisante dans toutes les disciplines. Il ne faudrait pas, en effet, que le nouveau système entraîne, à terme, la disparition pure et simple de formations rares, car elles contribuent au développement de la connaissance.
S'il apparaît difficile de continuer, comme par le passé, à flécher les crédits des composantes internes des universités, tels que les IUT ou les écoles d'ingénieur, il a, en revanche, insisté sur la nécessité que les établissements développent rapidement une méthodologie garantissant un dialogue interne, en vue d'assurer un pilotage cohérent et équitable des moyens budgétaires. En outre, les IUT et écoles d'ingénieurs devraient pouvoir gérer une enveloppe financière globale allouée par leur université afin de mettre en oeuvre leur projet.
Puis, s'agissant du financement de la recherche, M. Jean-Léonce Dupont, corapporteur, a souligné la nécessité de :
- mieux appréhender l'activité des enseignants-chercheurs, ce qui implique de se détacher du prisme des publications en accordant une plus grande attention aux activités de valorisation de la recherche, qui ne se résument pas au dépôt de brevet. Cette mission fondamentale, souvent insuffisamment assurée par les universités, n'est pas assez prise en compte par la notion de « chercheur publiant » de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement (AERES) ;
- prendre pleinement en compte, dans la cotation des laboratoires, la capacité de ces derniers à lever des fonds extérieurs, notamment compétitifs, compte tenu de l'importance croissante de cette voie de financement, aussi bien au niveau national que communautaire.
En outre, M. Jean-Léonce Dupont, corapporteur, a insisté pour que des critères de gestion administrative soient élaborés et pris en compte dans l'attribution des financements, tels que :
- le taux d'occupation des locaux : la gestion immobilière étant un sujet de préoccupation, il convient d'inciter les universités à une gestion vertueuse de leurs locaux, même si le présent modèle n'intègre pas la totalité des crédits immobiliers ;
- l'appréciation du niveau d'encadrement administratif qualifié ou la valorisation de services de gestion externalisés ;
- l'évaluation qualitative globale de l'amélioration de la gestion administrative des universités. Cette évaluation pourrait faire l'objet d'une sorte de cotation (du type A+, A, B, C, D), à l'instar de celle appliquée par l'AERES dans le domaine de la recherche. Elle pourrait prendre en compte tout un faisceau d'indicateurs, au titre desquels, par exemple, la certification des comptes et le nombre de réserves éventuellement émises, le taux de consommation des crédits de fonctionnement et d'investissement, le taux de ressources propres et le taux de progression de ces dernières, la capacité à redéployer des emplois en fonction de l'évolution des besoins de l'université.

a précisé ensuite le contexte dans lequel s'inscrivait la réforme :
- des arbitrages budgétaires a priori favorables à la mission « Recherche et enseignement supérieur », compte tenu des engagements présidentiels d'augmenter de 50 % d'ici à 2012 le budget de l'enseignement supérieur ;
- la révision générale des politiques publiques (RGPP), qui soulève des interrogations notamment quant à l'application de l'un de ses principes, à savoir le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux ;
- la présentation d'un projet pluriannuel qui devrait garantir une certaine lisibilité du financement des politiques publiques sur les trois prochaines années ;
- une situation peu satisfaisante de notre enseignement supérieur, qui nécessite aussi bien une réforme qualitative qu'une revalorisation quantitative.
a observé que le nouveau modèle d'allocation des moyens devait nécessairement s'appuyer sur des marges de manoeuvre financières supplémentaires, dans le but de concilier à la fois les objectifs d'équité et d'efficience du système universitaire.
Il a précisé que l'organisation du rééquilibrage, nécessairement étalé dans le temps, devait faire l'objet d'une attention accrue afin que celui-ci se réalise sans pour autant mettre en échec la dynamique qualitative souhaitée.
Il a ainsi jugé qu'en 2009 aucune université ne devrait être « perdante » : les universités considérées comme « déficitaires » dans le cadre du nouveau modèle devant bénéficier d'une première tranche de rattrapage, les universités dites « excédentaires » conservant leurs moyens. Il a indiqué que la détermination des dotations les années suivantes tiendrait à la fois compte de la situation initiale par rapport audit rééquilibrage, de l'évolution de l'activité et des progrès qualitatifs.
S'agissant des établissements dits « déficitaires », il a proposé que les éventuelles augmentations de dotation liées à l'activité ou à des résultats positifs en matière de performance s'ajoutent à la part annuelle de rattrapage. En revanche, les éventuelles diminutions de dotation liées à l'activité ou à des résultats négatifs de performance devraient s'imputer sur le « crédit » fixé à l'initialisation du système et ne devraient se traduire par une baisse de dotation qu'une fois ce « crédit » épuisé.
S'agissant des établissements dits « excédentaires », il a précisé que les éventuelles augmentations de dotation liées à l'activité ne devraient pas, contrairement aux augmentations liées à la performance, se traduire par un surplus. En outre, les éventuelles diminutions de dotation liées à l'activité ou à la performance devraient être effectivement appliquées.
s'est ensuite intéressé à la question du rééquilibrage en termes d'emplois, en soulignant que ce sujet délicat pourrait être singulièrement compliqué par l'application de la règle du non-remplacement d'un départ sur deux à la retraite. Le rééquilibrage devait se fonder sur une approche pragmatique afin de développer une politique qualitative d'emplois (repyramidage, politique indemnitaire, recrutements de personnels de cadres administratifs de haut niveau, attractivité à l'égard des chercheurs...). Cette orientation nécessite d'accorder une compensation financière aux universités qui accepteraient de « rendre » des emplois budgétaires.
En conclusion, il a souhaité que le nouveau système soit à même de permettre à chaque université de développer une politique d'établissement adaptée à son environnement, à ses atouts et à ses ambitions.
Un large échange de vues a suivi l'exposé des rapporteurs.

et Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles, ont salué l'initiative de Mme Valérie Pécresse, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui a invité le Parlement à se saisir de ce dossier essentiel. Ils se sont réjouis de la création de ce groupe de travail, qui a permis la mise en commun des acquis, complémentaires, des deux commissions permanentes. En dépit du très bref délai imparti, ils ont jugé ces travaux prometteurs et de nature à accompagner efficacement l'autonomie des universités.

a souligné la difficulté de porter un regard sur un système en mouvement. Il a rappelé que la création des deux instruments fondamentaux que sont l'Agence nationale pour la recherche (ANR) d'une part, et l'AERES, d'autre part, imposait aux universitaires une « révolution » culturelle. Il a estimé que l'autonomie des universités supposait une évaluation et donc des outils pertinents pour ce faire. Après avoir relevé l'ampleur du travail conduit par l'AERES depuis un an, avec l'évaluation de 30 universités et 72 écoles doctorales, il a évoqué le caractère composite du système universitaire, qui pouvait compliquer la méthode par laquelle l'activité et les résultats de chacun pouvaient être identifiés.
S'agissant de la structuration de l'offre d'enseignement sur l'ensemble du territoire, il a souligné tout l'intérêt pour l'université de participer à un pôle de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) ou à un pôle de compétitivité. Ce dernier permet une meilleure valorisation de la recherche et la création de liens de proximité entre universités, laboratoires de recherche et entreprises. Il favorise également l'insertion professionnelle des docteurs.

a souligné le souci d'écoute du groupe de travail à l'égard de l'ensemble des personnalités entendues. Il a estimé que les corapporteurs avaient rendu compte, de façon synthétique, des points de vue ainsi exprimés et du travail conduit en commun par les deux commissions, même si cela n'empêchera pas d'éventuelles contestations.
A titre personnel, il a jugé souhaitable une grande fermeté, dans les quatre ans à venir, pour contrôler la volonté des universités de progresser en fonction de leurs moyens.

a félicité les corapporteurs pour la qualité de leur présentation. Après s'être à nouveau réjoui que cette évaluation d'une politique publique soit accomplie de concert par deux commissions permanentes, il s'est félicité que, dorénavant, les conseils d'administration des universités travaillent sur la base d'un budget consolidé, c'est-à-dire intégrant la masse salariale de leur personnel. Il s'est interrogé ensuite sur la capacité des systèmes d'information universitaires à répondre aux nouvelles exigences.

a souligné l'intérêt des exposés complémentaires des deux corapporteurs. Il a partagé le sentiment exprimé sur la difficulté de régir un système en mouvement. Il a évoqué, ensuite, la question du pilotage de la recherche (auto-saisine par les scientifiques eux-mêmes ou choix stratégiques liés aux attentes de la communauté nationale...).

Après avoir salué la qualité de la présentation des corapporteurs, M. Ivan Renar a estimé qu'elle « réveillait » néanmoins différentes préoccupations :
- le taux d'échec des étudiants en premier cycle ;
- la question de la pérennité du soutien de l'Etat, notamment pour ce qui concerne l'immobilier universitaire ;
- l'avenir des pôles universitaires non retenus au titre de l'opération Campus, avec le risque de voir se développer des inégalités entre les universités et entre les territoires ;
- la question récurrente des droits d'inscription.

a évoqué la diversité des universités en taille et en rayonnement, relevant néanmoins que des pôles d'excellence existaient - et pouvaient être développés - dans de petites universités.
Il a indiqué que les exemples étrangers montraient le caractère essentiel de la gestion des talents et des compétences. Par conséquent, il est fondamental d'apprécier la qualité de la gestion des ressources humaines, de l'organisation et de la capacité à travailler en commun des équipes de recherche ou des équipes pédagogiques.

Après avoir, lui aussi, souligné le grand intérêt des présentations, M. Adrien Gouteyron a déclaré adhérer au caractère pragmatique et progressif de la démarche suggérée par les corapporteurs, car il s'agit de l'une des conditions de la réussite de la réforme.
Le dispositif reposant largement sur l'évaluation, rendue difficile par l'extrême diversité des universités, il a demandé des précisions sur le processus envisagé. Il s'est ensuite interrogé sur les effets des propositions avancées en termes de gestion des personnels et d'emploi. Enfin, il a demandé si l'ensemble des recommandations pourra être retenu par le gouvernement et mis en oeuvre.
ont avancé les éléments de réponse suivants :
- compte tenu des retards en matière de systèmes d'information, quatre années seront sans doute nécessaires pour les mettre à niveau, mais il conviendra d'être incitatif pour que les progrès soient réels durant cette période ;
- la situation très inégalitaire constatée entre les universités concerne leurs dotations, mais aussi l'origine sociale de leurs étudiants. D'où l'ambition consistant à rééquilibrer les moyens à partir d'une « photo » de la situation actuelle. Les comparaisons internationales montrent que l'on ne peut pas parler d'universités « surdotées », mais éventuellement d'établissements « mieux dotés » que d'autres. L'application de critères tenant à la valeur ajoutée et à l'insertion professionnelle devrait contribuer à ce rééquilibrage ;
- les fonds consacrés à l'opération Campus ne font pas partie de l'enveloppe budgétaire concernée par la réforme. A l'avenir, l'amélioration des critères relatifs à la gestion immobilière incitera davantage à la vertu dans ce domaine ;
- le budget pluriannuel devra permettre une meilleure lisibilité dans l'évolution des dotations ;
- la question des droits d'inscription n'a pas été abordée ; en tout état de cause, elle ne relève pas de l'initiative des universités, mais d'une décision nationale ;
- s'agissant des critères d'insertion professionnelle, l'établissement d'une grille nationale, par le ministère ou par un prestataire qu'il aura choisi, devrait permettre de garantir la lisibilité et la fiabilité des informations ;
- s'agissant de l'impact des critères de performance à l'égard des personnels, certains « chantiers » en cours devraient permettre d'y répondre, notamment la commission présidée par M. Rémi Schwartz sur la gestion des carrières, qui rendra ses conclusions au début de juillet 2008 ;
- le réel impact des positions adoptées par le Sénat lors de l'examen de la loi sur la liberté et les responsabilités des universités du 10 août 2007 laisse présager que son influence sera également importante pour ce qui concerne la présente réforme.
Les commissions ont ensuite, à l'unanimité, approuvé le rapport du groupe de travail et en ont autorisé la publication sous la forme d'un rapport d'information commun.