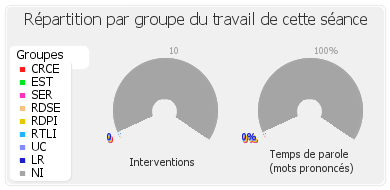Séance en hémicycle du 30 octobre 2007 à 10h00
Sommaire
La séance
La séance est ouverte à dix heures.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

M. le président du Sénat a été informé du rejet par le Conseil constitutionnel, dans sa séance du 25 octobre 2007, de la requête contestant les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 août 2007 dans le département de l'Hérault pour l'élection d'un sénateur.
Acte est donné de cette communication.

M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel deux lettres par lesquelles il informe le Sénat que le Conseil constitutionnel a été saisi, en application de l'article 61, alinéa 2 de la Constitution, le 25 octobre 2007, par plus de soixante députés, et le 26 octobre 2007 par plus de soixante sénateurs, d'une demande d'examen de la conformité à la Constitution de la loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile.
Acte est donné de ces communications.
Le texte des saisines du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, en application de l'article 52 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il sera transmis à la commission des finances et sera disponible au bureau de la distribution.
Je signale par ailleurs que ce rapport fera l'objet d'une déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, lors de la séance du Sénat du 8 novembre.

J'informe le Sénat que la question orale n° 72 de M. Jean-Pierre Chauveau est retirée du rôle des questions orales et de l'ordre du jour de la séance du mardi 6 novembre 2007, à la demande de son auteur.
Ordre du jour réservé

L'ordre du jour appelle la discussion de la question orale avec débat n° 1 de M. Bruno Sido à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur l'approvisionnement électrique de la France.
Cette question est ainsi libellée :
M. Bruno Sido interroge M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur les suites que le Gouvernement pourrait donner aux propositions de la mission commune d'information du Sénat sur la sécurité d'approvisionnement électrique de la France et les moyens de la préserver.
Si les travaux de la mission ont permis de démontrer que cette sécurité était garantie dans des conditions satisfaisantes en France, aussi bien à court qu'à moyen terme, ils ont toutefois ouvert les pistes pour en assurer la préservation à long terme, tant dans le domaine de la production que dans celui du transport et de la distribution ainsi qu'en matière de maîtrise de la demande d'électricité. Plusieurs des quarante propositions adoptées par la mission visent à atteindre cet objectif et rendent nécessaires des décisions rapides au plan national. Mais l'existence d'une plaque électrique interconnectée européenne impose aussi l'examen de la dimension communautaire de la question de la sécurité d'approvisionnement du pays. À cet égard, la situation apparaît plus préoccupante et plusieurs constats établis par la mission ont conduit cette dernière à préconiser des initiatives qui ne peuvent s'inscrire que dans un cadre européen.
Dans ces conditions, M. Bruno Sido souhaiterait connaître tant les traductions législatives et réglementaires que pourraient prochainement recevoir les préconisations du rapport de ses collègues, rapporteurs de la mission commune d'information du Sénat sur l'électricité, que les initiatives qui pourraient être prises par la France dans ce domaine à l'occasion tant de la discussion du nouveau paquet énergétique communautaire que de sa présidence de l'Union européenne.
La parole est à M. Bruno Sido, auteur de la question.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le 4 novembre 2006, voilà presque un an, se produisait l'une des plus importantes pannes électriques subies par les Européens tant par son étendue géographique - toute l'Europe occidentale - que par le nombre des personnes touchées - plus de 15 millions de foyers. Mais cette panne n'eut heureusement que des conséquences pratiques bénignes en raison de sa durée limitée - de quelques dizaines de minutes à une heure selon les réseaux - et de la période à laquelle elle survint - un samedi soir à vingt-trois heures.
Il n'en reste pas moins que cette panne révéla brutalement la fragilité des réseaux électriques nationaux, qui est due à leur interconnexion d'un bout à l'autre du continent ainsi qu'à la dépendance très forte de notre organisation sociale et économique à ce bien si particulier et si vital qu'est l'électricité. C'est pourquoi il apparut rapidement nécessaire qu'une mission commune d'information se penche sur le dossier de l'approvisionnement électrique de la France, afin que le Sénat puisse disposer d'abord d'une analyse des causes réelles de l'incident, ensuite d'une évaluation des risques pesant sur la sécurité de cet approvisionnement, enfin de préconisations pour préserver cette sécurité, voire l'améliorer.
Du mois de janvier au mois de juin dernier, la mission que j'ai eu l'honneur et le plaisir de présider a mené six mois de travaux passionnants. À Paris, trente-deux auditions lui ont permis de rencontrer plus d'une cinquantaine de personnalités représentatives du secteur de l'électricité et de couvrir l'ensemble du champ de la réflexion qui s'ouvrait à elle. Afin d'inscrire sa réflexion dans une dimension européenne, des délégations se sont rendues à Bruxelles et dans six pays européens pour y rencontrer plus d'une centaine d'interlocuteurs. Enfin, quelques déplacements en région parisienne et à Dunkerque ont également donné l'occasion d'observer in situ des installations et des sites de production, donnant ainsi un caractère concret à nombre de propos entendus lors des différents entretiens.
Le rapport d'information que Michel Billout, Marcel Deneux, Jean-Marc Pastor et moi-même avons « tiré » de ces rencontres aborde successivement les trois domaines dans lesquels il faut agir pour garantir la sécurité d'approvisionnement électrique de la France : la production d'abord, le transport et la distribution ensuite, la maîtrise de la consommation enfin.
Bien que distinctes, ces trois parties sont assises sur un socle commun que mes trois collègues rapporteurs et moi-même approuvons et que je résumerai ainsi : un constat, deux observations et trois principes fondamentaux.
Le constat, c'est que le système électrique français fonctionne correctement, dans un cadre garantissant aux consommateurs une fourniture d'électricité d'excellente qualité, avec une grande régularité et à un coût satisfaisant ; c'est une bonne nouvelle. La sécurité d'approvisionnement électrique du pays est donc réelle aujourd'hui, ce qui n'interdit évidemment pas de chercher à la préserver, même à l'accroître.
La première observation, c'est que les caractéristiques intrinsèques de l'électricité sont si particulières - je vous rappelle que l'électricité est un bien indispensable, qui ne se stocke pas, qui, dans de nombreuses circonstances, n'a pas de substitut, et qui restera à jamais soumis à des lois physiques incontournables - que, d'une part, elles justifient pleinement la notion de service public qui est traditionnellement attachée en France à la fourniture d'électricité, et que, d'autre part, elles semblent rendre inadaptées à cette fourniture les règles habituelles de fonctionnement des marchés libéralisés.
La seconde observation, c'est que notre réflexion sur la sécurité d'approvisionnement s'inscrit dans un cadre communautaire sur l'énergie fixé par le Conseil européen au mois de mars dernier. Or celui-ci a retenu deux autres axes qui peuvent parfois apparaître contradictoires avec la recherche de la sécurité d'approvisionnement : l'amélioration de la compétitivité du marché et la lutte contre le réchauffement climatique.
De ce constat et de ces observations résultent les trois principes directeurs de notre rapport d'information.
D'abord, il est absolument nécessaire pour la France de conserver une maîtrise publique dans le domaine électrique et pour l'Europe de bâtir un système où la régulation, par nature publique, permettra d'anticiper les problèmes et d'éviter les crises.
Ensuite, il est essentiel d'affirmer que la composition des bouquets énergétiques des différents pays interconnectés n'est pas uniquement une question d'ordre national et que l'interconnexion des réseaux électriques doit faire primer les préoccupations de sécurité et de solidarité sur les intérêts commerciaux.
Enfin, un aspect majeur de la sécurité d'approvisionnement passe par la maîtrise de la demande d'électricité : je pense ici à la gestion des « pointes », aux mécanismes dits « d'effacement » ou encore à l'efficacité énergétique des processus industriels, des bâtiments et des équipements. À l'avenir, nombre de nos comportements doivent changer, non pas forcément pour moins consommer d'électricité, mais pour toujours la consommer mieux.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, les bases sur lesquelles est structuré le rapport avec ses quarante propositions, adopté le 27 juin dernier par l'ensemble des membres de la mission commune d'information, à l'exception de Mme Voynet.
Depuis, quatre mois se sont écoulés, au cours desquels trois événements ont renforcé l'actualité de nos travaux.
Je pense tout d'abord au Grenelle de l'environnement, monsieur le secrétaire d'État. En tant que président du groupe de suivi de la commission des affaires économiques du Sénat, j'ai pu apprécier très directement la richesse et la qualité des débats que cette initiative du Président de la République et du Gouvernement a suscités. Nous avons discuté ici même, voilà quelques semaines, tant de la démarche que de ses premiers résultats. Des décisions essentielles ont été adoptées la semaine dernière à l'issue des trois journées de tables rondes et le Président de la République a publiquement annoncé, jeudi dernier, ses engagements en la matière.
Je veux y revenir un instant, car, dans le domaine de l'électricité, cette fructueuse réflexion collective n'a pas manqué d'aboutir à des propositions identiques ou très similaires à nombre de celles que la mission avait elle-même suggérées et qui s'appuyaient sur le principe de bon sens suivant : la meilleure façon de sécuriser l'approvisionnement électrique est encore de ne pas gaspiller l'électricité.
Dans cette perspective, les préconisations les plus importantes du groupe de travail n° 1 du Grenelle de l'environnement, intitulé « Lutter contre les changements climatiques et maîtriser l'énergie », me semblent celles qui concernent le secteur du bâtiment : rendre obligatoires les normes de construction haute performance environnementale, dites « HPE », pour toutes les constructions neuves, d'une part, procéder à la rénovation thermique progressive du parc ancien de logements et de bureaux pour en améliorer l'isolation, d'autre part. Compte tenu de la place qu'occupe ce secteur dans le bilan énergétique national - près de la moitié de l'énergie finale consommée en France -, il s'agit évidemment d'une piste prioritaire.
Notre mission l'avait elle-même considérée comme telle puisque, dans ce bilan, la part de l'électricité est prépondérante : représentant les deux tiers de la consommation du secteur résidentiel-tertiaire, elle a fortement augmenté en trente ans, en raison de cette particularité française qu'est le chauffage électrique, qui équipe encore 70 % des constructions récentes.
C'est ce constat qui a conduit notre mission à proposer pour le bâtiment une demi-douzaine de mesures complémentaires et, me semble-t-il, parfois originales : favoriser, dans les bâtiments nouveaux, l'installation de systèmes de chauffage alternatifs aux convecteurs électriques ; modifier l'assiette et certains taux du crédit d'impôt dédié aux économies d'énergie ; moduler les droits de mutation pesant sur les bâtiments disposant des labels « HPE » et haute qualité énergétique, dites « HQE », et imposer l'utilisation de ces labels pour toutes les constructions ou rénovations de bâtiments appartenant à l'État ; instituer, pour les particuliers, un prêt à taux zéro pour les dépenses réalisées sur des bâtiments existants ayant pour objet de réduire la consommation d'énergie et, pour les collectivités publiques, un fonds de déclenchement des investissements immobiliers efficaces en énergie pour les bâtiments publics.
Ces encouragements, ces obligations, ces facilités resteront lettre morte si deux difficultés essentielles, pointées tant par notre mission que par le Président de la République, ne sont pas résolues très rapidement, l'information des professionnels du bâtiment et de leurs clients sur les nouveaux matériaux, techniques et appareils favorisant la maîtrise de la demande d'énergie, ainsi que la qualification desdits professionnels à ces technologies. La méconnaissance et l'incapacité à savoir faire sont autant de freins aux pratiques vertueuses que les questions de coût de l'investissement et de fiscalité. Il faut donc agir également en ce domaine et très rapidement.
C'est pourquoi la mission a également suggéré d'établir un plan national de formation des professionnels à la performance énergétique du bâtiment et de réaliser, dans le cadre du programme de recherche et d'expérimentation sur l'énergie dans le bâtiment, PREBAT, des études sur les facteurs socio-économiques de la sous-utilisation des technologies d'amélioration de cette performance.
Ainsi, à l'évidence, les mesures pratiques à mettre en oeuvre dans le secteur du bâtiment, en application des conclusions du Grenelle de l'environnement, devront aussi s'appuyer sur les propositions de la mission d'information et les reprendre.
Mais, au-delà de ce secteur, le groupe 1 du Grenelle de l'environnement a également formulé d'autres propositions identiques à celles de la mission, qui ont été reprises dans les décisions finales et expressément approuvées par le Président de la République dans son intervention de jeudi dernier, ce dont je me félicite vivement. Il s'agit d'étendre l'étiquetage énergétique à tous les appareils de grande consommation électrique et d'imposer des régimes de veille peu consommateurs, d'interdire la vente des lampes à incandescence à l'horizon 2010 et, bien entendu, de développer la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie.
Le seul point d'achoppement entre nos travaux et ceux du Grenelle de l'environnement, concerne, évidemment, le recours à l'énergie nucléaire. La mission recommande le maintien de l'option nucléaire et le remplacement du parc actuel par les technologies nucléaires les plus avancées. J'ai déjà eu l'occasion de dire à cette tribune, le 4 octobre dernier, à quel point je juge essentielle cette option pour faire face au défi du changement climatique ; je le répète aujourd'hui en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement électrique du pays.
Le deuxième événement intervenu depuis la remise de notre rapport, c'est l'adoption par la Commission européenne, le 19 septembre, du troisième paquet énergie, dont l'un des objectifs est précisément de renforcer la sécurité de l'approvisionnement de l'Union. Face à ce nouveau train de propositions législatives, ma position est mitigée. Elle est partagée entre la satisfaction, une fois encore, de voir traduites en décisions positives plusieurs des préconisations de la mission et l'inquiétude suscitée par la fixation d'objectifs inopportuns, voire dangereux, car inadaptés au cas très particulier de l'électricité, dont je vous ai déjà rappelé les caractéristiques.
Au chapitre des satisfactions, je citerai la création d'une agence de coopération des régulateurs nationaux de l'énergie habilitée à arrêter des décisions de nature obligatoire, comme le suggérait notre proposition n° 17 , le renforcement de l'indépendance des régulateurs nationaux dans les États membres assorti des mécanismes garantissant cette indépendance, qui répond en partie à notre proposition n° 16, et la mise en place d'une nouvelle organisation de collaboration des gestionnaires européens de réseau de transport chargée, notamment, d'élaborer des normes de sécurité et des codes commerciaux et techniques communs, de planifier et de coordonner les investissements nécessaires au niveau de l'Union, conformément à nos propositions n° 13 et 14.
Mais j'éprouve aussi des inquiétudes. Il en est ainsi, bien entendu, à l'égard de l'obligation de séparation patrimoniale entre producteurs d'électricité et gestionnaires de réseaux de transport, le fameux « unbundling ». Pour régler un problème qui se pose, à l'évidence, dans certains pays, la Commission s'enferre dans une seule direction, faisant fi du modèle français, qui démontre par l'exemple, au quotidien, qu'il est parfaitement efficace pour garantir, grâce à un contrôle et une régulation publics rigoureux, l'indépendance du gestionnaire du réseau, l'accès non discriminatoire au réseau et les investissements de capacité. Il me semble que la Commission se rend en l'espèce coupable d'un raisonnement strictement idéologique bien regrettable. Aussi, j'encourage le Gouvernement à poursuivre, au sein du Conseil, son entreprise pédagogique pour obtenir qu'une majorité d'États se prononce pour la reconnaissance de l'organisation française comme alternative à l'unbundling.
Mais le biais de l'idéologie ne se niche pas simplement dans cette option ; il colore l'ensemble du paquet énergie, non pas tant dans ce qu'il propose que dans ce qu'il ne propose pas. Conformément à sa doxa traditionnelle, la Commission estime que l'approfondissement de la libéralisation du marché de l'énergie va améliorer la situation. Or, en ce qui concerne l'électricité, je suis convaincu - je ne suis pas le seul - qu'elle fait fausse route et qu'au contraire il est nécessaire que ce secteur connaisse une forte maîtrise publique.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

En France, notre système électrique, dont la performance est enviée pour la puissance de son parc productif, l'étendue et la sûreté de ses réseaux, la qualité de sa fourniture, le niveau raisonnable de ses prix, s'est construit dans ce cadre. Cette efficacité résulte du programme nucléaire, du bilan prévisionnel entre l'offre et la demande réalisé par Réseau de transport d'électricité, RTE, de la programmation pluriannuelle des investissements, PPI, bref, d'un ensemble de mécanismes qui impose des responsabilités à la puissance publique. Du reste, notre système est tellement efficace que nos voisins ne seraient pas mécontents d'en avoir l'usufruit sans en supporter les contraintes.

Nous nous en sommes rendu compte lors de nos déplacements à l'étranger. Ainsi réclament-ils, par exemple, un renforcement des interconnexions transnationales, non pas tant pour accroître la solidarité entre les pays en cas de difficultés que pour bénéficier de l'électricité nucléaire française à bas prix !

Or, la France n'a pas vocation à devenir le poumon nucléaire de l'Europe, pas plus que les Français n'ont de raison de supporter un prix de l'électricité déterminé par le coût marginal de la production de centrales à fioul étrangères. C'est exactement l'inverse de ce qui se passe sur les marchés ; c'est là que le bât blesse et que le paquet énergie est insuffisant. Il manque tout un pan des préconisations de notre mission d'information qui seules peuvent durablement assurer la sécurité d'approvisionnement électrique de l'Union européenne. Il faut, en particulier, obliger chaque État membre à élaborer un document prospectif indiquant la manière dont est garantie la satisfaction des besoins en électricité à un horizon de dix ans, la Commission étant chargée par le Conseil d'en effectuer la synthèse au plan communautaire. Il convient également d'instaurer des normes minimales de production afin que chaque État soit en mesure de produire globalement l'électricité qu'il consomme et de développer des interconnexions internationales aux seuls endroits où elles sont nécessaires pour améliorer la sûreté des réseaux et non les flux strictement commerciaux.
Sur ce dernier point, je veux souligner que la mission a également préconisé d'instituer une procédure de déclaration d'utilité publique européenne pour les grandes structures intégrées d'intérêt supérieur européen, et je regrette que cette idée ne figure pas non plus dans le projet de la Commission.
Le dernier événement que je souhaite relever vise la publication du rapport rédigé par le président de la « commission énergie » du Centre d'analyse stratégique, M. Jean Syrota, qui aborde aussi de nombreux aspects examinés par notre mission et formule des propositions similaires, sinon identiques, aux nôtres. Je veux en citer une, que nous avons développée dans le rapport d'information sans la faire apparaître comme telle dans nos quarante propositions finales. Il s'agit de l'extension accordée aux propriétaires-bailleurs des avantages fiscaux pour les dépenses favorisant les économies d'énergie et l'utilisation d'énergies renouvelables. Il nous semble indispensable, compte tenu de l'importance du parc locatif en France, de trouver un mécanisme incitant les propriétaires-bailleurs, qui n'ont eux-mêmes pas d'intérêt direct à la réduction des factures énergétiques de leurs locataires, à investir dans la performance énergétique de leurs biens.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la mission d'information du Sénat a oeuvré dans un contexte très propice à la réflexion. L'implication de nos trois rapporteurs - que je veux remercier très sincèrement et chaleureusement en cet instant et féliciter pour la qualité de leur travail - a permis de formuler quarante propositions importantes et nécessaires. Qu'elles rejoignent d'autres idées qui foisonnent en ce moment ou qu'elles s'en écartent, je souhaite qu'elles soient toutes mises en oeuvre, car je suis convaincu qu'elles sont indispensables à la sécurisation de l'approvisionnement électrique de notre pays et, plus globalement, de l'Union européenne.
C'est pourquoi, monsieur le secrétaire d'État, il serait utile, après avoir entendu les rapporteurs de la mission, puis les orateurs inscrits dans la discussion, que vous exposiez au Sénat les traductions législatives et réglementaires que le Gouvernement entend donner à celles de ces quarante préconisations qui peuvent être mises en oeuvre au plan strictement national.
Il serait également souhaitable que vous nous indiquiez les initiatives qu'il prendra, notamment quand la France exercera la présidence de l'Union européenne, pour favoriser l'adoption des propositions relevant du niveau communautaire afin de combler les insuffisances du troisième paquet énergie de la Commission européenne et de donner à l'Union les moyens d'une véritable stratégie de politique publique en matière électrique.
De même, le cas échéant, il serait judicieux que vous nous fassiez part des propositions de la mission d'information qui ne recueillent pas l'agrément du Gouvernement et que vous nous en précisiez les raisons.
Ce dialogue entre le Gouvernement et le Sénat sera, bien entendu, appelé à se poursuivre lorsque le Parlement examinera les textes résultant du Grenelle de l'environnement, ainsi que, vraisemblablement, une proposition de résolution sur le paquet énergie, mais je vous suis reconnaissant, monsieur le secrétaire d'État, de nous permettre de l'ouvrir dès à présent.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, quelle heureuse initiative a prise notre collègue M. Sido de susciter ce débat sur la sécurité de l'approvisionnement en électricité !
Monsieur le secrétaire d'État, vous risquez d'entendre des propos similaires, car nous étions tous en phase lors de nos discussions, surtout lorsqu'il s'agissait de défendre les intérêts de nos compatriotes en soutenant la maîtrise publique du secteur énergétique.
En tant que corapporteur de la mission commune d'information, aux côtés de mes collègues MM. Bruno Sido, Michel Billout et Marcel Deneux, et ayant été plus particulièrement chargé de la partie liée à la production d'électricité, j'ai eu l'occasion de mener des investigations approfondies sur ce sujet. Je dois, d'ores et déjà, vous faire part d'un premier constat, le désordre qui semble régner aujourd'hui en Europe au sujet du problème énergétique.
M. Jean Desessard applaudit.

Ainsi, en Allemagne, au sein d'un même gouvernement, certains prônent le recours au nucléaire alors que d'autres se déclarent favorables à l'éolien.
En Italie, le gouvernement a décidé de ne pas recourir au nucléaire, mais les responsables politiques seraient bien contents si deux ou trois centrales étaient implantées de l'autre côté des Alpes, de manière à pouvoir alimenter leur pays. De tels propos ont bel et bien été tenus !

L'Espagne s'étant, quant à elle, engagée dans un premier temps dans le secteur éolien, fait aujourd'hui une pause, après s'être rendu compte qu'on ne maîtrise pas l'énergie éolienne comme on le veut.
La Grande-Bretagne avait joué la carte du gaz venant de la mer du Nord. Aujourd'hui, elle s'interroge sur la diminution des réserves. Attendre que le marché apporte une réponse ne semble pas satisfaisant.
Et je ne parle pas de la Pologne qui nous a tendu les bras et nous a demandé de lui venir en aide. En effet, 90 % de son énergie nucléaire sont produits dans des centrales à charbon obsolètes qui dégagent du CO2, ce qui laisse ce pays démuni.
Voilà très schématiquement brossée une situation assez inquiétante. De surcroît, chaque État a son « code de la route » pour le transport de l'électricité et les règles sont parfois concurrentes.
En France, l'électricité est produite sur le territoire. C'est énorme ! Garantir la sécurité de l'approvisionnement électrique implique d'abord de s'assurer que des moyens de production adéquats sont disponibles à tout instant pour répondre à la consommation.
Il s'agit, en France, d'une règle de base du service public de l'électricité, consacrée dans la loi du 10 février 2000.
Ainsi, Réseau de transport d'électricité élabore tous les deux ans un bilan pluriannuel prévisionnel qui permet d'anticiper les risques de déséquilibre à un horizon de dix ans. Vient s'y superposer, comme M. Bruno Sido l'a indiqué, une programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité élaborée pour dix ans par le Gouvernement, ce qui permet de situer les projections en termes d'investissement.
La PPI, gage de diversité des sources de production, constitue l'une des traductions concrètes de la politique énergétique nationale.
Ces deux outils, qui relèvent pleinement de la maîtrise publique du secteur, permettent donc d'anticiper et de prévenir les risques de défaillance de l'offre d'électricité.
De même, le bilan de RTE met régulièrement en évidence les fragilités en matière de sécurité d'approvisionnement des deux régions françaises que sont la Bretagne et la région PACA, qui sont sous-équipées en moyens de production pour la première, et en moyens de transport pour la seconde.
La mission a d'ailleurs préconisé, à cet égard, de réfléchir à l'institution d'une obligation d'équilibrage régional entre production et consommation, qui pourrait être définie sur la base de grandes « régions électriques ».
Cette règle de bon sens - veiller à l'adéquation entre l'offre et la demande - est malheureusement loin d'être partagée en Europe, comme je l'évoquais à l'instant.
Nombre d'États de l'Union européenne n'ont pas une conception aussi active de la politique énergétique que nous et font preuve d'une foi quasi intangible dans les vertus du marché, qui, selon eux, est un outil efficace de régulation et d'incitation aux investissements. La Commission européenne partage au demeurant pleinement cette vision.
Je préfère le préciser, la mission s'est, à l'unanimité, déclarée en opposition complète avec ce modèle.
D'une part, ce modèle de « tout-marché » conduit nombre d'États à fonder le développement de leurs moyens de production en très grande partie sur des centrales à gaz, dont une majeure partie est située en Russie, faisant ainsi un pont d'or, indirectement, à cette dernière.
Certes, ces unités présentent l'avantage de pouvoir être mises en service rapidement, en moins de deux ans, et d'émettre moins de C02 que leurs concurrentes directes, les centrales à charbon.
Pour autant, cette évolution est assez inquiétante au regard de la sécurité d'approvisionnement et de l'indépendance politique de l'Union européenne, qui importe déjà près de 57 % de son gaz et devrait importer 84 % en 2030, si l'évolution actuelle se poursuit. La diversification permise par le gaz naturel liquéfié ne sera pas suffisante pour réduire le poids dominant de la Russie dans nos importations, avec toutes les conséquences politiques et économiques que cela suppose.
D'autre part, la plupart de ces mêmes pays refusent tout développement de capacités nucléaires sur leur territoire mais, dans le même temps, verraient d'un bon oeil l'installation de ce type d'unités chez leurs voisins, en l'occurrence la France pour l'Europe occidentale, ce qui leur permettrait d'importer de l'électricité « bon marché ».
Je le répète, la mission a la conviction que la France - M. Bruno Sido l'a indiqué - n'a pas vocation à devenir le « poumon nucléaire » de l'Europe et à être le seul pays à devoir gérer tous les à-côtés sociaux et environnementaux de cette option énergétique.
Pour ces raisons, il est indispensable de réorienter en profondeur la politique communautaire de l'énergie.
M. Bruno Sido a rappelé quelles étaient les principales propositions de la mission à cet égard : d'une part, obligation pour chaque État de réaliser des bilans prévisionnels d'équilibre entre l'offre et la demande, ainsi que d'élaborer un document prospectif indiquant comment est garanti cet équilibre, construit sur le modèle d'une programmation pluriannuelle française et, d'autre part, imposition de normes minimales de production afin qu'aucun État ne puisse fonder durablement la satisfaction de ses besoins en électricité sur les importations.
Cette réorientation devrait idéalement prendre corps au sein d'un pôle public européen de l'énergie.
Cette organisation, qui fonctionnerait sur la base d'une réelle solidarité entre pays, notamment pour les questions ayant trait au développement des énergies renouvelables ou pour le respect des engagements environnementaux, devra tenir compte des conceptions de chacun concernant le bouquet énergétique. Il nous semble que ces nouvelles fondations de l'Europe de l'énergie seront de nature à donner naissance à de nouvelles régulations du secteur.
Malheureusement, les dernières propositions de la Commission européenne ne s'inscrivent absolument pas dans cette logique, ce que je ne peux que déplorer. Ce que l'on appelle « troisième paquet énergie » a précisément pour objet de renforcer la concurrence dans les secteurs de l'électricité et du gaz, en ce qu'il vise, notamment, à la séparation patrimoniale entre les entreprises de production et de commercialisation et celles qui sont chargées du transport.
Cette proposition est d'ailleurs très dangereuse, car elle va « casser » nos groupes énergétiques, alors qu'à l'étranger se constituent des mastodontes, Gazprom, pour n'en citer qu'un, qui n'auront pas à subir de telles contraintes. Tout est orienté sur le marché concurrentiel.
Quel bilan peut-on tirer des premières années d'ouverture à la concurrence des marchés énergétiques ?
Il faut reconnaître que les entreprises qui s'étaient engouffrées dans cette voie voilà maintenant deux ans ont pratiquement toutes demandé à faire marche arrière.
C'est la raison pour laquelle a été mis en place sur le territoire national le fameux tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, le TARTAM, qui permet un rééquilibrage entre prix régulés et prix du marché, ces derniers ayant explosé.
La Commission européenne plaide en faveur d'un recours accru aux marchés libres et considère que les prix de l'électricité ont vocation à converger en Europe au fur et à mesure des progrès de l'unification des marchés intérieurs de l'électricité.
Or, plusieurs raisons empêchent d'appliquer à l'électricité les règles habituelles du marché.
D'une part, ce bien est tout à fait hors normes en raison de ses caractéristiques physiques : il s'agit d'un bien non stockable, qui nécessite un équilibrage permanent entre l'offre et la demande.
D'autre part, les différentes techniques de production n'ont pas le même coût et rien ne justifie que l'électron nucléaire soit facturé le même prix que l'électron issu d'une centrale à charbon ou à gaz.

Notre pays doit faire entendre sa voix. Nous attendons du Gouvernement que, dans le domaine de l'énergie, il mette en oeuvre une politique beaucoup plus forte, afin que le système tarifaire français soit défendu et pérennisé.
Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons nous satisfaire du nouveau train de mesures de libéralisation présenté par la Commission, qui ne fait qu'accentuer les règles déjà existantes d'organisation des marchés de l'énergie, sans souci de l'élaboration d'une véritable politique énergétique intégrée en Europe.
Les flux d'électricité étant transnationaux, les décisions - mais aussi l'absence de décision, ce qui est encore plus grave - prises par les États ont des conséquences plus que directes sur l'organisation du secteur électrique des pays voisins.
Il est clair que l'Europe de l'électricité présenterait un tout autre visage sans les 63 TWh - Terra Watt heure - d'électricité d'origine nucléaire exportés chaque année par la France. Alors que les obligations de réduire les émissions de C02 vont devenir de plus en plus lourdes, chaque État devra en tirer les conséquences dans la composition de son bouquet énergétique.
D'un autre côté, ces objectifs ambitieux - il s'agit de réduire de 20 % les émissions de CO2 d'ici à 2020 - ne pourront être atteints sans solidarité sur le plan européen et donc sans un pôle d'entreprises publiques plus soucieuses des missions de service public que de la rémunération de leurs actionnaires.
Il est proprement irréaliste de penser que la Pologne, qui produit plus de 90 % de son électricité à partir de charbon, sera en mesure d'atteindre cet objectif d'ici à 2020.
Le groupe socialiste souhaite que le Gouvernement fasse preuve de fermeté lors des négociations sur le « troisième paquet énergie » pour défendre l'idée d'une politique intégrée de l'énergie, refuser fermement la séparation patrimoniale et défendre l'existence des tarifs réglementés.
Monsieur le secrétaire d'État, quelles mesures comptez-vous prendre, sur le plan national, pour que prennent corps les quarante propositions que notre mission a adoptées à l'unanimité moins une voix, ce qui mérite d'être souligné ? Je vous remercie de bien vouloir nous apporter tous les éclaircissements nécessaires.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées de l'UMP.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, à la suite de la panne électrique du 4 novembre 2006, le Sénat a décidé de mettre en place une mission d'information sur l'approvisionnement électrique.
Présidée par notre collègue M. Bruno Sido, cette mission s'est livrée à de nombreuses auditions et à plusieurs déplacements dans des pays européens avant de présenter les fruits de ses analyses en juin dernier dans un rapport intitulé Approvisionnement électrique : l'Europe sous tension.
C'est dans les perspectives de ce rapport que M. Bruno Sido a déposé la question orale qui est aujourd'hui l'objet de notre débat.
Je tiens à souligner la pertinence de cette initiative à plusieurs titres. Elle permet de donner un réel écho aux travaux écrits de la mission, d'enrichir les échanges que le Parlement entretient avec le Gouvernement sur le dossier énergétique, de défendre une approche globale en termes de sécurité et d'indépendance énergétique au plan tant national qu'européen tout en intégrant les impératifs de préservation de l'environnement ; elle participe de la position que pourra défendre notre pays face aux propositions formulées par la Commission européenne, notamment celles du 19 septembre dernier. Enfin, elle est totalement d'actualité, au lendemain des premières conclusions du Grenelle de l'environnement et à la veille de la présidence française de l'Union européenne.
Si les conclusions de la mission présidée par M. Bruno Sido sont relativement rassurantes sur le court terme, en revanche, sur le plus long terme, elles plaident pour une grande vigilance et la mise en place de dispositions tant françaises qu'européennes pour garantir notre approvisionnement électrique au meilleur prix.
Mes collègues du groupe de l'UMP et moi-même partageons cette analyse.
Nous sommes très conscients que toute politique en la matière doit intervenir sur plusieurs fronts simultanément, qu'il s'agisse d'anticiper l'évolution de la demande, de préserver un bouquet énergétique national équilibré, de diversifier la fourniture géographiquement et commercialement, de permettre au mieux la prévisibilité des prix de l'électricité, de maintenir un réseau de transport dense, d'améliorer le réseau de distribution, de maîtriser la demande d'électricité.
Enfin, comme les membres de la commission, nous nous interrogeons sur la nécessité de tenir compte, dans notre choix, des caractéristiques propres à l'électricité, un bien qui ne se stocke pas, qui n'est pas substituable dans de nombreuses circonstances et dont la consommation est relativement inélastique au prix.
C'est pourquoi, comme nous l'avons dit lors de précédents débats, notamment celui sur la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique, nous entendons, au plan national, conforter notre bouquet énergétique.
Cela suppose de trouver le juste équilibre entre le maintien de l'option nucléaire et le développement des énergies renouvelables afin de tenir nos engagements européens en la matière, la recherche de cet équilibre devant être aussi abordée par nos partenaires européens.
Quarante préconisations sont formulées dans le rapport de la mission. Dans l'absolu, nous souhaitons, monsieur le secrétaire d'État, que le Gouvernement puisse nous faire part de son appréciation sur chacune d'entre elles, sachant que les décisions arbitrées à l'occasion du Grenelle de l'environnement constituent également une réponse aux suggestions de la mission, notamment en ce qui concerne l'efficacité énergétique des bâtiments, l'encouragement à l'utilisation d'équipements vertueux et la promotion de nouveaux comportements chez nos concitoyens.
Cependant, il nous semble important que le Gouvernement puisse nous éclairer sur certains points.
Quels arguments développer face à la proposition de la Commission européenne sur l'indépendance des réseaux, qui aboutit à la séparation entre le propriétaire et l'exploitant et implique, dans la formulation actuelle, un quasi-démantèlement des grands groupes intégrés tels que EDF ou GDF ?
Où placer le curseur entre ouverture du marché et régulation ?
Quelle sera notre position quant à la création d'une agence européenne de régulateurs nationaux de l'énergie ? Comme la mission, nous plaidons pour une Europe de l'énergie plus intégrée. Encore faut-il que chaque État membre dispose d'un régulateur du type de la Commission de régulation de l'électricité.
Qu'en sera-t-il de la proposition de la mission d'établir des documents prospectifs communs au plan européen et de celle de créer une procédure de déclaration d'utilité publique européenne pour les grandes infrastructures ?
Pour conclure, je soulignerai, une dernière fois, tout l'intérêt d'organiser aujourd'hui ce débat. Il nous permet de participer pleinement aux prémices de ce que devrait être l'Europe de l'énergie, garantie de la meilleure sécurité d'approvisionnement possible.
Applaudissements sur les travées de l'UMP, ainsi que sur celles du groupe socialiste.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous voici donc réunis pour débattre des perspectives ouvertes par les conclusions des travaux de la mission commune d'information du Sénat sur la sécurité d'approvisionnement électrique de la France et les moyens de la préserver et, je l'espère, pour former le voeu commun d'une rapide traduction législative et réglementaire de ses quarante propositions.
Je commencerai toutefois mon intervention par quelques remarques générales.
Nous assistons actuellement à une dérive institutionnelle particulièrement grave, où le Parlement non seulement n'effectue pas son travail dans des conditions satisfaisantes, mais tend également à être privé de son pouvoir législatif.
En témoigne le nombre de projets de loi passés en urgence, notamment dans le secteur de l'énergie.
En témoigne, aussi, la censure de la commission des finances sur toute proposition engageant les deniers publics, comme cela a été le cas quand le groupe communiste républicain et citoyen a proposé la fusion entre EDF et GDF, et ce alors même que cette censure empêche tout débat de fond sur la politique nationale énergétique et les alternatives concrètes au projet proposé par le Gouvernement.
Nous nous retrouvons donc avec un Parlement dont la mission est réduite à la simple exécution de la volonté présidentielle.
Je suis donc, dans ce contexte, particulièrement attaché à ce que les propositions formulées et partagées par la quasi-totalité des membres de la mission commune d'information ne tombent pas dans l'oubli, mais trouvent au contraire une traduction concrète. J'appuie donc la demande du président Bruno Sido.
Cela étant, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, venons-en au fond.
Il y a maintenant un an, le groupe communiste républicain et citoyen soumettait à la Haute Assemblée une proposition de résolution tendant à créer une commission d'enquête sur les causes de la panne d'électricité survenue le 4 novembre 2006.
Compte tenu de la dimension communautaire d'une telle commission et de l'impossibilité des parlementaires français de contraindre nos partenaires européens, c'est une mission commune d'information sur la sécurité d'approvisionnement en France et en Europe qui a vu le jour et dont les travaux se sont déroulés au printemps dernier.
Je ne reviendrai pas sur les conclusions de cette mission, son président nous les ayant très bien exposées. Elles mettent particulièrement en lumière les contradictions des politiques libérales menées à travers les directives européennes.
Il faudrait, selon la Commission européenne, démanteler les monopoles publics et organiser la concurrence entre les opérateurs, alors même que ceux-ci remplissent une mission d'intérêt général. Cette nouvelle organisation, toujours selon la Commission, bénéficierait aux clients, qui disposeraient d'une offre plus attractive par le jeu de la concurrence.
Pourtant, la mission a fait un tout autre constat.
D'une part, la libéralisation du secteur énergétique s'est soldée par une hausse vertigineuse des tarifs sur le marché libre et par des risques accrus sur la sécurité d'approvisionnement. D'autre part, les besoins importants en termes de production d'électricité ainsi que la question du vieillissement du parc nucléaire en France imposent des investissements massifs pour la création de nouvelles capacités.
Pour finir, la mission a constaté que ces questions se posent dans un monde où les principales ressources énergétiques se raréfient. Cela a été rappelé plusieurs fois à cette tribune, l'électricité est un bien particulier, car non stockable. Par conséquent, la mission a souligné les risques que font naître, en termes géopolitiques, la rupture de la sécurité d'approvisionnement ainsi que la perte d'indépendance énergétique et, donc, d'indépendance économique et politique.
La mission est naturellement arrivée à la conclusion que, l'énergie n'étant pas une commodité comme les autres, sa maîtrise doit donc rester publique.
Selon les termes même du rapport, ce secteur ne peut être laissé à la seule « main invisible » du marché.
Les rapporteurs se sont également intéressés aux tarifs d'accès à l'électricité et se sont inquiétés de leur envolée dans la plupart des pays de l'Union européenne. C'est pourquoi ils proposent le maintien des tarifs réglementés et des contrats d'approvisionnement dits « de long terme ».
Depuis, plusieurs mois se sont écoulés, ponctués par de multiples rebondissements nationaux, européens et internationaux dans le secteur de l'énergie, qui confirment une nouvelle fois les enjeux pointés par les travaux de la mission.
Ainsi, le nouveau Président de la République a annoncé le prochain rapprochement entre Alstom et Areva, organisant ainsi une ouverture très importante du nucléaire civil aux capitaux privés en ce qui concerne la construction de centrales, la production énergétique, ainsi que la gestion des déchets.
Le chef de l'État a également contribué largement à rendre effective la fusion entre GDF et Suez.
Or, la constitution de ce nouveau groupe privé, dont l'État détiendra seulement 35 % des actions, organise la perte de la maîtrise publique non seulement sur le secteur du gaz, mais aussi bien au-delà.
Ce sont les intérêts des actionnaires qui prévaudront et, notamment, leur logique de profit maximum. Dans ce sens, lors de leur première déclaration, les P-DG du futur groupe ont indiqué que les actionnaires recevront plus de la moitié du résultat net sous forme de dividende, qui devrait croître par action de 10 % à 15 % par an en moyenne entre 2007 et 2010.
Voilà qui résume bien les priorités industrielles de ce nouveau groupe !
Autre élément inquiétant de cette première déclaration, le P-DG de Gaz de France, Gérard Mestrallet, évoquant les réacteurs nucléaires de troisième génération, a précisé : « Le nouveau groupe GDF Suez prendra une décision soit en 2008 soit en 2009 pour construire un ou plusieurs EPR en Europe, dans les pays où cela sera possible et souhaitable », afin de « disposer de ces capacités entre 2017 et 2020 ».
Nous pouvons alors émettre de sérieux doutes sur la pérennité du monopole accordé à EDF concernant la production de l'énergie nucléaire en France. J'avais déjà évoqué cette crainte voilà plusieurs mois, lors de la discussion du projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
Pour sa part, la mission commune d'information réaffirme dans ses conclusions le choix du nucléaire, notamment au regard des impératifs environnementaux. Cependant, elle reconnaît que la sûreté nucléaire ne peut être garantie que par une forte maîtrise publique.
Seule une maîtrise publique peut permettre la transparence nécessaire sur les objectifs industriels et de recherche, ainsi que sur le niveau de sécurité des installations.
Monsieur le secrétaire d'État, je profite donc de ce débat pour vous demander des précisions sur ce sujet.
Au niveau européen, une nouvelle directive, parachevant le marché de l'énergie, vient d'être adoptée. Elle prône la séparation patrimoniale entre les réseaux de transport et les centres de production.
À ce titre, dans un communiqué de presse, le président et les rapporteurs de la mission commune d'information ont exprimé leurs réserves sur ce nouveau paquet énergétique, notamment concernant la pérennité des contrats d'approvisionnement de long terme et la séparation patrimoniale.
Cette fuite en avant libérale conduit aujourd'hui M. Sido, président de la mission et membre éminent de la majorité parlementaire, à solliciter M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur les suites que le Gouvernement entend donner aux quarante propositions formulées dans le rapport de cette mission.
Je ne peux que soutenir une telle initiative, a fortiori si l'on considère que ledit rapport a été voté à la quasi-unanimité des membres de la mission. Si un consensus existe entre les parlementaires de tous bords pour reconnaître que l'énergie n'est pas un produit de consommation comme les autres et que sa maîtrise doit être publique, il faut que le Gouvernement non seulement entende cette exigence, mais également qu'il la traduise en acte. Cela passe, notamment, par une transcription législative et réglementaire des quarante propositions.
Pour autant, si les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen partagent les conclusions du rapport, ils estiment que les décisions à prendre doivent aller plus loin qu'un simple perfectionnement de la régulation du secteur de l'énergie.
Nous le voyons bien, et c'était le sens de mon intervention lors de la récente discussion de la proposition de loi de notre collègue Ladislas Poniatowski, il y a une antinomie fondamentale entre la mise en oeuvre de la concurrence libre et non faussée comme pierre angulaire de toute politique publique et le maintien d'un service minimal pour chacun, notamment dans le secteur de l'énergie.
Les tarifs réglementés en sont un bon exemple. Dans la configuration libérale, ils sont voués, in fine, à disparaître, car contraires aux objectifs de l'Union européenne. Toute disposition transitoire ou dérogatoire en la matière s'apparente donc à une correction à la marge.
Pour les sénateurs communistes républicains et citoyens, c'est donc au Gouvernement d'engager une réorientation complète de la politique énergétique au niveau national et de l'impulser au niveau européen.
Cela suppose, en préalable, de faire le bilan des dix années de libéralisation dans le secteur de l'énergie et de s'orienter vers une renégociation des directives européennes.
Nous avons suffisamment d'exemples pour savoir que l'ouverture à la concurrence n'a pas atteint les objectifs escomptés, bien au contraire. Certains pays reviennent même progressivement à une plus ample maîtrise publique.
Les enjeux sont fondamentaux et multiples. Ils font de l'énergie une denrée exceptionnelle, qui ne peut être considérée comme une simple marchandise.
Ce constat, partagé par la mission commune d'information, ne peut aboutir qu'à une seule conclusion : une politique de l'énergie ambitieuse, donnant la priorité à la recherche d'économies d'énergie, à la diversification des moyens de production électrique, ainsi qu'à la coopération avec les autres acteurs énergétiques européens ne peut se réaliser qu'avec des opérateurs publics, porteurs de l'intérêt général.
Force est de constater que la politique d'entreprise des opérateurs historiques, depuis l'ouverture de leur capital, a également changé de cap. L'objectif d'augmenter la rentabilité pour les actionnaires est maintenant mentionné dans les contrats de service public.
Au final, les anciens monopoles, qui auraient dû être modernisés et démocratisés, seront remplacés par des oligopoles privés. D'après l'estimation que nous a fournie la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne, d'ici à une dizaine d'années, il resterait uniquement cinq ou six oligopoles dans l'Union européenne.
Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen en tirent les conséquences. D'une part, nous estimons qu'une véritable maîtrise publique passe par le respect d'une condition stricte, la nécessité de garantir des capitaux uniquement publics au sein des opérateurs énergétiques, toute prise de capitaux privés modifiant irrémédiablement la politique d'entreprise. D'autre part, nous estimons que les synergies doivent être renforcées dans le secteur de l'énergie entre les opérateurs historiques au sein d'un pôle public de l'énergie, qui pourrait s'étendre au pétrole.
C'est pourquoi nous avons proposé la fusion d'EDF et de GDF au sein d'un nouvel EPIC, un établissement public industriel et commercial.
Cette idée de fusion a été immédiatement réfutée, au nom des contreparties qui seraient, semble-t-il, imposées par Bruxelles.
Pourtant, la création du géant Suez-GDF se fait également au prix d'importantes contreparties, notamment la cession de contrats d'approvisionnement de long terme pour GDF, la séparation du pôle environnement pour Suez et la création du principal concurrent d'EDF en France, et ce sans les bénéfices d'une véritable maîtrise publique.
L'avenir énergétique de la France est donc, avant tout, l'affaire de choix politiques.
Au moment même où le Gouvernement affine ses propositions dans le cadre du « Grenelle de l'environnement », nous estimons que les enjeux du secteur énergétique intègrent pleinement ceux de la préservation de l'environnement.
Travailler à la maîtrise de la consommation de l'énergie, au développement des énergies renouvelables et non polluantes, ainsi qu'à l'égal accès de tous à ce bien universel suppose, j'y insiste, une véritable maîtrise publique du secteur.
Le développement durable doit être dégagé de la pression des marchés financiers et des intérêts de court terme.
Dans ce cadre, les propositions formulées par la mission commune d'information dans son rapport, qui prône une maîtrise publique de l'énergie et la création d'instruments de régulation prospectifs, sont de véritables points d'appui, qui, je l'espère, trouveront une traduction législative et réglementaire énergique et courageuse.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

M. Marcel Deneux, rapporteur de la mission commune d'information. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la sécurité d'approvisionnement électrique est une question à multiples facettes. Je concentrerai mon intervention sur l'une d'entre elles, car elle me paraît essentielle. Il s'agit de l'objectif de maîtrise de la demande d'électricité, qui part d'un principe simple, selon lequel la meilleure électricité est encore celle qui n'est pas consommée.
Ah !sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Ce n'est pas un hasard si c'est le thème sur lequel a « planché » le premier groupe de travail du « Grenelle de l'environnement ».
En effet, la maîtrise de la demande d'électricité permet de relâcher les contraintes à la fois financières, techniques et politiques qui pèsent sur l'augmentation des capacités de production et de transport. Produire, puis transporter l'électricité coûte très cher et prend beaucoup de temps, alors que le potentiel de maîtrise de la demande peut être rapidement mobilisable.
La maîtrise de la demande d'énergie permet aussi de réduire la dépendance énergétique de la France, que ce soit en énergies fossiles ou en uranium.
Elle entraîne des économies à long terme pour les ménages et les industriels.
Enfin, elle diminue les émissions de gaz à effet de serre, ce qui permet de préserver l'environnement et la santé humaine.
On pourrait appeler cela le quadruple bonus de la maîtrise de la demande d'électricité, et j'en tire comme conclusion qu'il s'agit d'un impératif majeur.
Je me réjouis que cette vision soit partagée par l'ensemble des pays de l'Union européenne, qui se sont donnés pour objectif de réduire de 20 % la consommation énergétique de l'Europe par rapport aux projections pour l'année 2020, telles qu'elles sont estimées par la Commission dans son Livre vert sur l'efficacité énergétique.
Dans la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, la France s'est quant à elle fixée pour objectif d'améliorer son intensité énergétique finale, c'est-à-dire le rapport entre la consommation et le produit intérieur brut, de 2 % par an à partir de 2015, puis de 2, 5 % par an après 2030.
Si chacun s'accorde sur le résultat à atteindre, les moyens pour y parvenir sont plus discutés. Pour ma part, j'ai la conviction que le jeu du marché et le niveau des prix ne suffiront pas à déclencher les investissements nécessaires en matière d'efficacité énergétique. Nous voyons là se dégager un principe politique, monsieur le secrétaire d'État : cette incapacité du marché à inciter à la maîtrise de la consommation impose la mise en place permanente d'une politique publique comprenant des mesures à la fois économiques, institutionnelles et réglementaires.
Je vais développer ces solutions en distinguant les mesures d'incitation à la maîtrise de la consommation d'électricité en direction des particuliers, d'une part, et des entreprises, d'autre part.
Je n'insisterai pas sur l'importance de l'isolation des bâtiments, axe essentiel de la politique de réduction de la consommation d'énergie, car ce sujet a été excellemment développé par notre collègue Bruno Sido, ainsi que dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Les mesures de structuration de l'offre, d'une part, et d'incitation à la demande en bâtiments basse consommation, d'autre part, sont les deux piliers essentiels sur lesquels doit reposer la stratégie de diminution de la consommation énergétique des bâtiments.
Je développerai plus longuement les propositions concernant l'incitation à l'utilisation des équipements vertueux par les consommateurs, émises en juin dernier par la mission sénatoriale.
On constate, depuis plusieurs décennies, une forte hausse de la consommation du secteur résidentiel du fait de l'accroissement des équipements domestiques « blancs » et « bruns ». Je rappelle que les professionnels des appareils électroménagers distinguent les « produits blancs », c'est-à-dire les réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières, lave-linge et lave-vaisselle, des « produits bruns », tels que les aspirateurs, téléviseurs, magnétoscopes, matériels hi-fi et informatiques.
Il semble que la réglementation soit insuffisante dans ce secteur et qu'une limitation de la puissance de veille des appareils à 1 watt doive être imposée. En effet, l'un des problèmes majeurs posés par les produits « bruns » est que ceux-ci sont très consommateurs, même en mode veille. Bien que les puissances unitaires concernées restent apparemment minimes, entre 5 et 15 watts par appareil, ces consommations ont lieu toute la journée, le plus souvent inutilement. Du fait de leur multiplication, elles peuvent représenter, selon une étude de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, jusqu'à 10 % de la consommation totale d'électricité d'un ménage. Un document de travail de la Commission européenne, élaboré dans la perspective de l'application de la directive sur les exigences en matière d'écoconception, préconise, au demeurant, de fixer, pour les modes veille, une consommation maximale, de 1 watt dans un premier temps et de 0, 5 watt dans un second temps.
S'agissant de la consommation courante des appareils, un étiquetage européen assez efficace a été imposé. Il semble aujourd'hui que, pour favoriser pleinement les appareils de classe A, A+ et A++, qui sont les plus économes en énergie, un passage à 5, 5 % de la TVA qui leur est appliquée constituerait la meilleure des solutions. Compte tenu de l'évolution des technologies et des différences entre les étiquetages selon les appareils, il faudrait bien sûr veiller à ce que la liste des produits bénéficiant de ce taux réduit soit régulièrement révisée afin qu'elle ne concerne que les appareils les plus performants. Je souhaite que la France profite du fait qu'elle exercera la présidence de l'Union, au second semestre de l'année prochaine, pour soutenir auprès de ses partenaires le projet d'une TVA réduite sur les produits écolabellisés.
Par ailleurs, j'ai la profonde conviction que l'interdiction unilatérale de la vente d'ampoules à incandescence sur le territoire national dès 2010, qui permettrait une réduction de la consommation de 8 térawattheures par an, soit plus que la production d'une tranche nucléaire, est une impérieuse nécessité. J'ai été ravi d'entendre le Président de la République retenir cet objectif dans son discours du 25 octobre dernier.
Je dois insister sur le fait que certaines consommations ne seront réduites que par une modification des habitudes de consommation. Des mesures d'information sont donc nécessaires. L'idée d'apposer des affichettes rappelant les principales recommandations en matière d'économies d'énergie dans les administrations, les écoles et les entreprises est simple et potentiellement très efficace en matière de maîtrise de la demande d'énergie.
Je tiens à signaler que le président et les rapporteurs de la mission commune d'information sur l'approvisionnement électrique ont adressé un courrier aux questeurs du Sénat afin que soient apposées, dans toutes les salles de réunion et dans tous les bureaux de la Haute Assemblée, des affiches incitant les utilisateurs à éteindre les lumières quand les locaux sont inoccupés, ainsi que les équipements informatiques et les téléviseurs, le soir et en fin de semaine.
Dans ce même courrier, nous nous sommes félicités du remplacement progressif des ampoules à incandescence par des dispositifs à faible consommation, mais nous avons aussi souhaité que cette politique soit complétée par l'installation, dans tous les lieux de passage, de mécanismes d'allumage et d'extinction automatique de l'éclairage. Le Sénat serait ainsi à la pointe de la maîtrise de la consommation d'électricité, et c'est essentiel. L'idéal serait bien sûr de faire un véritable bilan « carbone », comme je l'avais demandé, en décembre 2002, dans un courrier adressé aux questeurs du Sénat. Cela viendra !
Je rappelle, à ce titre, que la circulaire adressée par le Premier ministre à l'ensemble du Gouvernement, le 28 septembre 2005, souligne que l'État se doit de contribuer à l'évolution des comportements et d'être exemplaire dans le cadre de la commande publique. Parmi les orientations fixées figure, notamment, l'achat d'équipements et d'appareils de bureautique économes en énergie. La mise en application de cette circulaire mériterait d'être davantage contrôlée et je m'interroge, monsieur le secrétaire d'État, sur la réalité de sa diffusion, en particulier dans les services déconcentrés. J'insiste vraiment sur cette dimension d'exemplarité de l'État, qui doit montrer au public quelles sont les bonnes pratiques.
Ainsi, le réglage des appareils permet de faire des économies à peu de frais. Certaines collectivités utilisent, par exemple, des régulateurs-variateurs en matière d'éclairage public, qui font varier les flux lumineux en fonction de nombreux facteurs, parmi lesquels figurent l'utilisation de la voie et, éventuellement, l'intensité de la lumière naturelle. Ces dispositifs, qui commencent à se diffuser dans les collectivités, sont à vulgariser.
Outre l'exemplarité, l'État a un devoir d'éducation de la population aux problématiques d'économie d'énergie.
J'estime qu'il serait bon d'inscrire dans le cahier des charges de France Télévisions et de Radio France l'obligation de diffuser des émissions consacrées à la maîtrise de la consommation énergétique.
Je pense également qu'un travail doit être réalisé auprès des plus jeunes. La circulaire du ministère de l'éducation nationale du 29 mars 2007, relative à la seconde phase de généralisation de l'éducation au développement durable, est une bonne initiative.
Monsieur le secrétaire d'État, à la suite du rapport sur le changement climatique que j'avais eu l'honneur de présenter il y a cinq ans, au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, 5 600 CD-Rom de présentation de ce rapport ont été diffusés dans les lycées français par le Centre national de documentation pédagogique, le CNDP, et ont été agréés pour les travaux des classes de première et de terminale. Il ne faut pas se priver de cet outil pédagogique. Avec M. Darcos, nous rappelons actuellement aux recteurs l'intérêt de l'utilisation de ce document.
Le deuxième volet de mon argumentation concerne l'amélioration de l'efficacité énergétique des entreprises, principalement dans l'industrie. Le potentiel d'économie est loin d'être négligeable, puisqu'il est estimé à 20 térawattheures par an. Son exploitation passe prioritairement par l'amélioration des process industriels. Dans un environnement international très compétitif, il a été considéré que les mesures adoptées en ce domaine devaient éviter de grever la productivité des entreprises et des programmes de soutien ont été mis en oeuvre.
Trois programmes européens ont ainsi permis la mise en place de protocoles d'aide et de recherche à la maîtrise d'énergie, respectivement dans l'industrie automobile, l'informatique et la plasturgie. Toutefois, dans la mesure où l'on ne peut pas multiplier les aides et où l'enjeu environnemental devient essentiel, il est temps que les aides attribuées par l'État et les collectivités territoriales aux entreprises soient conditionnées au respect de certains critères relatifs à la maîtrise de la demande d'électricité, d'autant que c'est économiquement rentable à moyen terme.
Au cours des années qui viennent de s'écouler, et suivant les périodes, on a pu s'interroger sur la volonté politique des gouvernements d'aller dans cette direction. Depuis l'élection présidentielle et la séquence du Grenelle de l'environnement qui s'est déroulée ces dernières semaines, on ne peut plus douter de cette volonté politique, le temps est venu de passer à l'action. Dans le domaine qui nous occupe aujourd'hui, la maîtrise de la demande d'électricité, c'est par une politique des petits pas, se traduisant par des petits gestes allant tous dans la même direction, que nous parviendrons à réduire la consommation d'électricité et à desserrer la contrainte qui pèse sur nos capacités de production et de transport.
En conclusion, monsieur le secrétaire d'État, je vous poserai simplement trois questions.
Tout d'abord, quelles sont vos priorités en matière de maîtrise de la consommation d'énergie électrique ?
Ensuite, quels engagements êtes-vous d'ores et déjà prêt à prendre sur la question de la hausse des certificats d'énergie, dont la reconduction aura lieu en 2009 ? C'est dans quatorze mois !
Ma troisième question, enfin, est particulièrement d'actualité. J'avais proposé d'allonger la période d'heure d'été afin de caler encore mieux les heures d'activité de la population avec l'ensoleillement.
M. Jean Desessard s'exclame.

Monsieur le secrétaire d'État et cher ami, c'est avec beaucoup d'intérêt que j'écouterai vos réponses.
M. Jean-Marc Pastor applaudit.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, comment ne pas évoquer, ce matin, dans le cadre du débat sur l'indépendance énergétique de la France, le « troisième paquet » de libéralisation du marché intérieur de l'électricité et du gaz, qui comprend cinq nouvelles propositions législatives complétant la démarche engagée depuis plus de dix ans ?
La mesure phare de ce troisième paquet est sans aucun doute la séparation patrimoniale entre la gestion des réseaux de transport, d'une part, et les activités de fourniture et de distribution, d'autre part.
Neuf États membres, dont la France, avaient fait part, en juin dernier, de leur ferme opposition, ce qui n'a pas empêché la Commission de proposer ce nouveau paquet au Parlement européen, le 19 septembre dernier. Pour contourner la minorité de blocage qui était en train de se constituer, la Commission a imaginé un régime dérogatoire, dit de « gestionnaire de réseau indépendant » ou, dans le jargon de Bruxelles, Independent System Operator, ISO, et ce sans évaluation de la mise en oeuvre des précédentes directives, en particulier depuis l'ouverture du marché au 1er juillet 2007.
C'est aussi la fin du service public de l'énergie que prévoit ce paquet. Certes, est prévue la désignation de fournisseurs en « dernier ressort » pour les plus défavorisés, mais les moyens pour financer ce service et pour organiser une péréquation appropriée ne sont pas définis.
Des questions essentielles, à savoir les investissements et la sécurité d'approvisionnement, sont laissées sans réponse.
Selon Gaz de France, « l'investissement dépend moins de la structure patrimoniale que de l'action du régulateur sur les conditions de rémunération des investissements ». C'est logique.
De plus, selon EDF, « ce sont les groupes intégrés qui ont intérêt à investir dans de nouvelles interconnexions. Les gestionnaires de réseaux de transport détenus par des fonds - quels qu'ils soient - vivent des goulets d'étranglement », et donc des revenus que ceux-ci leur procurent.
Et quid des garanties contre les prises de contrôle par des tiers à l'Union européenne, sauf - et c'est en fait une reconnaissance de la nature stratégique du secteur de l'énergie - à déterminer au cas par cas quelle société non européenne est acceptable ou ne l'est pas ?
Même si une coopération européenne en matière de normes techniques facilitant les interconnexions est positive, le troisième paquet nous paraît inacceptable, et cela pour plusieurs raisons.
Première de ces raisons, la construction d'une politique de l'énergie européenne ne pourrait se faire sur la base du seul marché. Il doit s'agir d'une véritable politique publique à la fois en termes d'investissements, d'objectifs environnementaux, de sécurité d'approvisionnement et de régulation des prix, comme le rappelle la confédération européenne des syndicats. Je me référerai à cet égard à M. Boiteux, qui a tout de même une certaine compétence dans ce domaine : « L'ouverture du marché n'a pas pour effet de faire baisser les prix et c'est au contraire la hausse des prix et des tarifs qui permet l'existence du marché. »
Deuxième raison pour laquelle nous le rejetons, le troisième paquet ne donne pas de garantie en termes de maintien du service universel de l'énergie : d'une part, le champ de citoyens couverts est très réduit - j'ai mentionné la désignation de fournisseurs en « dernier ressort » - ; d'autre part, il n'y a pas de dispositions concernant le financement de ce service, dans un contexte difficile pour la France, où les tarifs réglementés sont d'ores et déjà attaqués.
La troisième raison tient à l'absence d'un véritable mécanisme de contrôle des prix.
Quatrième raison, de forts doutes subsistent quant au financement, rendu plus délicat par la séparation patrimoniale, des investissements dans les réseaux.
Cinquième raison, les objectifs environnementaux peuvent être atteints par d'autres moyens que par la séparation patrimoniale.
Enfin, on peut mettre en doute le principe de proportionnalité - les moyens proposés sont proportionnels aux objectifs poursuivis - de la mesure de dissociation patrimoniale présentée.
Le troisième paquet est une offensive ou, plus exactement, la poursuite d'une offensive européenne à l'encontre des entreprises du secteur énergétique : il revient à considérer qu'une entreprise qui reste verticalement intégrée aurait tendance à sous-investir dans de nouveaux réseaux et à privilégier ses sociétés de vente.
C'est aussi le démantèlement et la privatisation des opérateurs historiques, car, en s'attaquant au caractère intégré de ceux-ci, la Commission européenne remet en cause l'architecture même du système d'organisation de notre secteur énergétique et son type de régulation, fondé sur des obligations de service public, notamment en matière d'investissements avec la PPI, la programmation pluriannuelle des investissements, qui est le seul outil garantissant la sécurité de nos approvisionnements.
Enfin, il faut savoir qu'il ouvre la voie à la privatisation d'EDF et/ou de son réseau de transport RTE, filiale à 100 %. La séparation patrimoniale rendrait dans ce cas EDF opéable alors que RTE est, on l'a dit à plusieurs reprises, un actif hautement stratégique - tout comme l'est d'ailleurs aussi GRTgaz, le réseau de transport de Gaz de France - alors que l'indépendance des gestionnaires du réseau n'a été contestée par aucun opérateur, même alternatif.
Comment peut-on construire une politique européenne de l'énergie si l'on n'a pas, comme le recommande la mission, une maîtrise publique ?
Je souhaiterais donc savoir, monsieur le secrétaire d'État, quelle sera votre position au Conseil des transports qui aura lieu à la fin du mois de novembre ?
Par ailleurs, la présidence française, au second semestre de 2008, entend-elle faire évoluer le dogme de la Commission selon lequel la concurrence a pour effet de faire baisser les prix, alors que toutes les expériences montrent qu'il n'en est rien et que certains États sont en train de faire machine arrière ?
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État chargé des transports - qui sera bientôt chargé aussi des autoroutes ferroviaires et maritimes...-, mes chers collègues, je commencerai par souligner que je suis en accord avec certains aspects du rapport.
Tout d'abord, je relève dans celui-ci une critique virulente de la libéralisation du marché de l'électricité, de l'abandon des tarifs régulés, des projets de directive prévoyant, dans le cadre du troisième paquet de libéralisation, la privatisation des réseaux de transport d'énergie.
Le président de la mission l'a dit, l'électricité n'est en effet pas un bien comme les autres, tout d'abord parce qu'elle ne se stocke pas, ensuite parce qu'il s'agit d'un bien de première nécessité et, enfin, parce que sa gestion détermine notre indépendance énergétique et, surtout, notre niveau de pollution.
Mais ce que je ne comprends pas, monsieur le président de la mission, c'est pourquoi les parlementaires de l'UMP en France critiquent la libéralisation, alors même que leurs collègues au Parlement européen la votent régulièrement, à chaque occasion, depuis dix ans !

M. Bruno Sido, président de la mission commune d'information. C'est cela, la proportionnelle !
Sourires.

M. Jean Desessard. Avoir plusieurs points de vue dans un même parti, ce n'est pas simple ! Nous le savons : nous l'avons vécu...
Nouveaux sourires.

Seconde satisfaction, je lis dans le rapport que la France n'a pas vocation à se transformer en « poumon nucléaire de l'Europe », comme vous venez de le redire, monsieur le président de la mission.
Arrêtons donc d'exporter l'électricité - cela représente 20 % de la production -, d'autant que nous la vendons à perte et que c'est la France qui assume ensuite la gestion des déchets, ...

...ce qui risque de faire de notre pays non seulement le « poumon nucléaire de l'Europe », mais aussi sa poubelle radioactive !

Précisons que ce « trop-plein » d'électricité est dû aux prévisions surévaluées du lobby nucléaire : en 1975, EDF annonçait que les besoins de la France seraient de 1 000 térawattheures en 2000, soit une surestimation de plus du double !
J'ajouterai même que la France n'a pas vocation à être l'exportateur universel de la technologie nucléaire. C'est bien pour cela qu'il faut refuser la construction de l'EPR, lequel produira encore plus d'électricité - une électricité qui sera exportée alors que l'électricité devrait être économisée - et sert de maquette de vente pour l'étranger.
Vous comprendrez donc, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, que, malgré ces quelques points d'accord, je ne puisse pas approuver la position en faveur du nucléaire prise dans le rapport.
Cette position, fortement majoritaire dans cette chambre, n'est cependant pas consensuelle puisque Dominique Voynet, comme vous l'avez rappelé, monsieur le président de la mission, a voté contre et, se faisant, elle a représenté les 54 % de Français qui jugent anormal d'investir 3 milliards d'euros pour une nouvelle centrale nucléaire.
La plupart des Français sont en effet conscients des dangers de la filière nucléaire : risques d'attentats, d'accidents, de tremblements de terre, de prolifération nucléaire et absence de solution pour les déchets, qui resteront radioactifs pendant des millénaires.
Même sur le plan de la sécurité de l'approvisionnement électrique de la France, le nucléaire ne constitue pas un « atout », comme l'écrivent les rapporteurs.
L'électricité d'origine nucléaire nous a été présentée comme la garantie de l'indépendance énergétique de la France depuis les années soixante. Cela reste à prouver !
La production de cette électricité est dépendante de l'uranium, un minerai qu'on ne trouve plus en France depuis 2001, ...

...ce qui nous place dans une position de dépendance énergétique totale envers le Niger, le Canada ou l'Australie.
La filière nucléaire s'arrêtera un jour puisqu'elle dépend d'une ressource non renouvelable qui devrait manquer d'ici à soixante-dix ans si elle continue à se développer ainsi.

Preuve que cette ressource se raréfie inexorablement, son cours a été multiplié par dix depuis 2002.
Quant à la génération 4, qui permettrait au nucléaire de recycler ses propres déchets, elle n'en est qu'au stade de la spéculation et on ne peut donc pas raisonnablement compter dessus.
La même remarque vaut pour le gaz.
L'entreprise Gaz de France ne mérite plus son nom puisque, depuis la fin de l'exploitation du gisement de Lacq, la totalité du gaz naturel consommé est importée. Or il y a dans toutes les régions de France des sites, parfois de dimensions réduites mais nombreux, qui pourraient produire des gaz de décharge, préférables aux gaz à effet de serre, comme le méthane, dont la composition chimique est pratiquement identique à celle du gaz de terre que nous importons de Russie.
On estime par ailleurs que le biogaz valorisable pourrait représenter jusqu'à 20 % de notre consommation de gaz naturel, alors qu'aujourd'hui la quantité valorisée est seulement de 0, 5 %...

Pour assurer la sécurité de l'approvisionnement, c'est donc très simple : il faut recourir aux énergies renouvelables. Voilà la véritable indépendance énergétique : l'éolien, les déchets, la micro-hydraulique, la géothermie profonde, le solaire, le bois de chauffage...
À cet égard, le Grenelle de l'environnement a posé des objectifs ambitieux - augmenter de 20 millions de tonnes équivalent pétrole la production d'ici à 2020 - et je m'en réjouis, mais il n'a pas encore précisé les moyens financiers pour les atteindre.
Or, pour développer réellement les énergies renouvelables, il faudrait leur consacrer les milliards d'euros qui sont promis au nucléaire. Il faut donc faire des choix.
Voilà trente ans, en matière d'hydraulique, la France disposait d'un savoir-faire unique, que nous avons perdu à cause du choix du tout-nucléaire.
De même, pour les cycles combinés au gaz, qui se développent pourtant partout à l'étranger, nous avons un train de retard.
Comme le rappelait un représentant de Greenpeace France en réaction aux annonces de Nicolas Sarkozy, « on ne peut lancer un grand programme d'économies d'énergie et développer les renouvelables, tout en continuant d'investir dans le nucléaire » !
En plus des énergies renouvelables, pour diminuer notre vulnérabilité énergétique, nous devons consommer moins.
Cela passe par une politique tarifaire qui incite aux économies d'énergie et par des certificats d'économie d'énergie ayant des objectifs ambitieux. L'électricité est le seul secteur dans lequel la France n'a pas réalisé des économies ces trente dernières années. Au contraire, depuis trente-cinq ans, notre consommation finale d'électricité a été multipliée par trois ! Il faut dire qu'EDF a longtemps fait la promotion, dans ses campagnes télévisées, de la surconsommation et ses agents commerciaux sont encore payés au kilowattheure vendu...
Pourtant, des gisements d'économie importants existent : l'éclairage, comme l'a dit M. Deneux, les appareils en mode veille, l'isolation des logements et l'électronique de contrôle pour tous les usages...

Encore faut-il accepter d'augmenter les standards : des réfrigérateurs A++ pour tous, des normes haute performance environnementale dans tous les nouveaux logements, etc.
Il y a enfin une source de gaspillage qui est trop peu abordée dans le rapport : le chauffage électrique, qui représente tout de même 12 % de notre consommation d'électricité.

Certes, M. Sido l'a qualifié d'« aberration » au détour d'une audition, mais sans tirer suffisamment les conséquences de la diffusion de ce mode de chauffage, qui équipe 70 % des maisons récentes.
Or, le chauffage électrique est une hérésie énergétique, il nous fragilise l'hiver durant les périodes de pointe et il aggrave les impayés des locataires. Dès lors, pourquoi ne pas imiter les Danois, qui l'ont tout simplement interdit, sauf cas de force majeure ?
Les avancées dans ce domaine supposent une régulation forte, mais aussi une organisation souple, décentralisée, diversifiée, au plus près des besoins, qui ne gaspille pas d'énergie dans des réseaux interminables, une organisation qui ne dépende pas entièrement d'un centre, d'une technique de production, d'un seul carburant. Bref, l'opposé du nucléaire !
Et comme ce rapport fait la part belle au nucléaire, malgré un certain nombre d'analyses très intéressantes, vous comprendrez que je ne peux que renouveler l'opposition des sénatrices et des sénateurs Verts, comme l'avait fait Dominique Voynet. Les Verts voteront donc contre ce rapport.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, tout d'abord, je tiens à vous remercier, au nom de Jean-Louis Borloo, dont je vous prie d'excuser l'absence, et en mon nom, pour le travail accompli par la mission commune d'information sur la sécurité d'approvisionnement électrique de la France et les moyens de la préserver, présidée par M. Bruno Sido, et à saluer la grande qualité du rapport de MM. Michel Billout, Marcel Deneux et Jean-Marc Pastor. J'ai également écouté avec beaucoup d'attention les interventions de MM. Yannick Texier, Daniel Raoul et Jean Desessard.
Au travers des très nombreuses auditions réalisées durant six mois, en partant de l'incident du 4 novembre dernier qui avait plongé l'Europe dans le noir - incident largement rappelé par la presse ce matin -, votre mission a su prendre toute l'ampleur de la question de notre sécurité d'approvisionnement électrique.
En vous fondant sur cette panne géante, vous avez élargi vos investigations au-delà du problème de sûreté de fonctionnement des réseaux, pour vous pencher sur l'ensemble des déterminants de la politique de la sécurité d'approvisionnement électrique. Vous vous êtes interrogés sur la politique de régulation du secteur et vous avez replacé cette réflexion dans le cadre des autres objectifs de notre politique de l'énergie, à savoir, d'une part, la compétitivité et le pouvoir d'achat et, d'autre part, la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Ces sujets sont d'autant plus intéressants qu'ils ont constitué les thèmes des travaux du groupe 1 du Grenelle de l'environnement.
Avant d'examiner vos observations et vos préconisations, et de vous exposer le sentiment du Gouvernement à cet égard, je ferai deux remarques préliminaires.
D'abord, je veux vous dire à quel point le Gouvernement se réjouit de la communauté de vues qui existe entre les orientations générales de sa politique énergétique et les recommandations exprimées dans votre rapport. Nous y reviendrons d'ailleurs en abordant les questions de maîtrise de la demande d'énergie et de régulation européenne du marché de l'électricité, pour ne citer que ces deux thèmes. Cette tonalité générale de notre accord n'exclut pas certaines nuances, que je préciserai au cours de mon intervention.
Ensuite, je veux souligner le premier constat de votre mission - important pour tous nos concitoyens -, celui d'un satisfecit : la sécurité d'approvisionnement électrique est aujourd'hui assurée en France.
Il me paraît essentiel d'insister sur ce point : la France dispose d'instruments - le bilan prévisionnel des besoins en électricité, la programmation pluriannuelle des investissements - et elle s'appuie sur des acteurs - l'administration, la Commission de régulation de l'énergie, Réseau de transport d'électricité - qui sont les garants de cette sécurité d'approvisionnement. Cette maîtrise publique est un facteur important dans ce résultat. Le Gouvernement est attaché à ce qu'elle perdure, conformément au souhait que vous avez exprimé, monsieur Billout, lors de votre intervention.
Pour l'essentiel, le Gouvernement partage l'analyse du rapport qui confirme le bien-fondé de la politique mise en oeuvre à l'échelon français depuis plusieurs années, quels que soient les gouvernements. Toutefois, comme vous le soulignez, la France doit faire face à un double mouvement qui modifie en profondeur la conception de notre politique énergétique.
En premier lieu, nous devons accentuer nos efforts dans la lutte contre le changement climatique. Les conclusions du Grenelle de l'environnement en témoignent. Nous souhaitons une rupture et prendre des responsabilités nouvelles.
En second lieu, comme vous l'avez évoqué, le marché intégré de l'électricité au sein de l'Union européenne exige une nouvelle approche européenne.
Ces deux évolutions majeures sont au coeur de la politique énergétique du Gouvernement et c'est par rapport à ces évolutions que je souhaite répondre à vos préoccupations et à vos recommandations.
Permettez-moi d'évoquer d'abord le Grenelle de l'environnement. Les travaux de la mission commune d'information sont intervenus à point nommé et ont montré, comme le Grenelle de l'environnement, qu'il y a une convergence politique, au sens le plus noble du terme, entre la lutte contre le changement climatique - qui devient une cause nationale - et notre sécurité d'approvisionnement. Pour reprendre ce qui fait désormais figure d'adage, l'électricité la moins chère et la plus sûre est celle que l'on ne consomme pas. On pourrait y ajouter qu'elle est l'électricité la plus protectrice de notre environnement.
Le Grenelle de l'environnement est le signe d'une prise de conscience de la société française, mais - vous l'avez rappelé, monsieur Sido - il est aussi le point de départ de réformes de grande envergure, dont certaines parmi les plus ambitieuses ont trait à la manière dont nous consommons notre énergie. Ces réformes font écho aux préconisations de votre rapport. Les mesures les plus emblématiques portent sur l'efficacité énergétique et la réduction des consommations, mesures dont vous nous avez rappelé à juste titre l'urgence, monsieur Deneux.
Comme le Président de la République l'a annoncé la semaine dernière, il s'agit, d'abord, de la mise en place d'un programme de rupture dans le bâtiment neuf pour aller vers des solutions à énergie positive, impliquant des exigences de performance énergétique très élevées pour les bâtiments publics - 50 kilowattheures par mètre carré dès 2010 - et, pour les logements privés neufs, une généralisation des logements neufs à basse consommation à partir de 2012.
Il s'agit, ensuite, du lancement d'un grand chantier de rénovation thermique des bâtiments existants, portant aussi bien sur les bâtiments publics, sur le parc HLM, sur les bâtiments traités par l'Agence nationale de rénovation urbaine, que sur les bâtiments privés.
Il s'agit, enfin, de la conduite d'un plan de développement des énergies renouvelables, qui s'inscrit dans l'objectif européen, auquel nous souscrivons, de 20 % d'énergies renouvelables en 2020.
Ce programme dans le bâtiment est magnifique, certes, mais s'il se révèle nécessaire, c'est que le retard est considérable. Nous avons donc beaucoup à faire et il va falloir nous retrousser les manches.
Il conviendra d'élaborer, d'ici au 15 décembre, les programmes bâtiments et énergies renouvelables.
Il faudra effectivement se préoccuper des moyens, des entreprises et songer à la formation appropriée des salariés.
L'aspect de la formation a été évoqué à de nombreuses reprises dans les débats du Grenelle de l'environnement, en particulier par la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, la CAPEB.
Sans préjuger les travaux d'élaboration de ces programmes, l'ampleur des réformes à conduire et la mobilisation des acteurs publics et privés qu'ils exigent supposent que nous mettions en place de nouvelles mesures en matière de réglementation, d'incitations, de sensibilisation et d'information, ainsi que de formation professionnelle comme je l'ai dit à l'instant.
Dans le cadre de cette réflexion, nous examinerons naturellement les propositions de la mission commune d'information - dont je vous remercie, monsieur Sido - en matière d'incitations fiscales et économiques, de formation professionnelle et de rôle exemplaire de l'État.
Je ne citerai qu'un exemple, sur lequel votre mission a, là aussi, bien travaillé : la rénovation énergétique des bâtiments est un investissement initial dont le retour s'étale sur plusieurs années. Pour rendre possible cet effort financier, il faut un juste partage des coûts et des revenus qu'une telle rénovation représente entre le bailleur et le locataire. Nous devrons donc trouver des mécanismes financiers innovants pour assurer une répartition équitable.
De même, les propositions issues du Grenelle de l'environnement en matière d'efficacité énergétique des équipements rejoignent vos réflexions, je pense notamment aux recommandations concernant l'action auprès de l'Union européenne en faveur de l'étiquetage des produits bruns, cités par M. Deneux, à la limitation de la puissance de veille des appareils - c'est le bon sens - et à l'interdiction programmée des ventes de lampes à incandescence.
La mise en oeuvre de ces mesures passera par un renforcement de la réglementation. Mais, comme pour tout programme ambitieux, elle exige aux côtés de la réglementation un plan d'accompagnement des acteurs, en particulier pour sensibiliser les consommateurs et pour mobiliser les distributeurs.
D'ailleurs, pour répondre à une question précise de M. Deneux, on estime aujourd'hui à un térawattheure l'économie d'énergie réalisée au travers du changement d'heures, mesure instaurée dans notre pays en 1975. Le Gouvernement est favorable à ce que ce mécanisme se poursuive. Le rapport que la Commission européenne doit livrer, avant la fin de l'année, sur l'impact du passage à l'heure d'été dans les différents secteurs économiques nous permettra de nous prononcer sur l'opportunité d'une évolution de ce dispositif.
Sur le thème des énergies renouvelables, le débat dans le cadre du Grenelle de l'environnement l'a montré : développer les énergies renouvelables ne saurait se faire au détriment d'autres exigences environnementales.
Je pense à l'acceptabilité paysagère pour les éoliennes - nous vivons tous ce problème dans nos départements -, qui doit être gérée. Je pense également à la préservation des espèces et des ressources halieutiques dans les cours d'eau pour la production d'énergie hydraulique. Je pense encore à la protection des sols lorsqu'il s'agit de produire des biocarburants. Il nous faut donc concilier notre ambition en matière d'énergies renouvelables avec un critère de « haute qualité environnementale » pour chacune des filières.
Mais les gisements existent. Il faut mieux valoriser la biomasse, tirer parti de l'évolution de la réglementation sur l'eau pour exploiter au mieux le potentiel hydroélectrique, comme le recommande votre mission. C'est donc un vrai plan de mobilisation de nos ressources renouvelables incluant tous les acteurs de la chaîne qui doit être élaboré filière par filière.
Cette réflexion sur le développement des énergies renouvelables me permet d'aborder la question de notre parc de production d'électricité.
Il faut répondre à une préoccupation que vous avez formulée, monsieur Sido, et à certaines préconisations de votre rapport.
Tout d'abord, en ce qui concerne notre production électronucléaire, le développement des énergies renouvelables et l'intensification des efforts en matière d'efficacité énergétique permettront peut-être de diminuer la part du nucléaire dans notre bouquet énergétique. Il n'en reste pas moins, et le Président de la République l'a affirmé clairement, qu'il n'y a pas de solution à notre équation énergétique - énergie compétitive, sûre et sans CO2 - sans le nucléaire. Par conséquent, notre programme nucléaire ne saurait en aucun cas être remis en cause.
À ce titre, j'ai écouté attentivement les propos tenus par M. Pastor. Je profite de mon intervention pour rappeler la position constante du Gouvernement sur la question des tarifs réglementés de vente de l'électricité : ceux-ci sont compatibles avec les directives européennes et doivent être maintenus. Les tarifs réglementés couvrent, en effet, l'ensemble de nos coûts de production et leur niveau ne fait donc que refléter la grande compétitivité de notre parc de production électrique.
Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que, outre ses avantages économiques, le parc de production électronucléaire contribue très fortement à limiter nos émissions de CO2. Par rapport à un parc de production qui serait fondé sur le charbon, notre parc électronucléaire permet d'éviter entre 300 millions et 400 millions de tonnes de CO2 par an. C'est un choix énergétique qui nous permet aujourd'hui d'afficher des émissions de gaz à effet de serre par habitant inférieures de 25 % à celles de nos voisins européens.
Je tiens à dire à M. Desessard que le nucléaire contribue à la sécurité d'approvisionnement globale non pas tant parce que l'électricité est ainsi produite en France, mais parce que le nucléaire nous permet de diversifier notre approvisionnement. Notre alimentation en matières premières énergétiques ne dépend pas uniquement des zones riches en hydrocarbures que chacun connaît, elle dépend aussi du Niger, du Canada, de l'Afrique du Sud et de l'Australie.
Ensuite, s'agissant de l'opportunité d'obligation minimale de production au sein de chaque État européen, que vous proposez dans votre rapport, la position du Gouvernement est plus réservée. Dans le cadre d'une politique européenne de l'énergie, nos objectifs en matière d'énergie renouvelable sont européens, nos réseaux sont interconnectés. Il convient donc de tenir compte des spécificités de chaque État membre. Le Gouvernement estime - mais le débat n'est jamais fermé - que le fait d'imposer une production locale peut conduire à ce que l'on appelle, avec bonheur - moins pour la langue française ! -, une « désoptimisation ». Si une telle possibilité ne saurait être écartée a priori, la France entend d'abord mettre l'accent sur des planifications nationales coordonnées à l'échelon européen.
Ces questions relatives à la production d'électricité nous ramènent au deuxième thème de notre discussion : l'avènement d'une politique européenne de l'énergie.
Votre mission a conduit ses travaux pendant un moment important, la phase préparatoire d'une nouvelle série de directives sur le marché intérieur de l'énergie.
Dans cette phase, notre pays a mis en avant certains dysfonctionnements, émis de nombreuses propositions et exprimé son attachement à l'émergence d'un marché de l'électricité intégré, sûr, efficace et bénéficiant in fine au consommateur.
Tel est bien le message de la France : l'Europe de l'énergie, le marché de l'énergie ne doivent se construire qu'au bénéfice des consommateurs. Et dans un secteur aussi complexe que celui de l'électricité - qui, comme vous l'avez rappelé, mesdames, messieurs les sénateurs, constitue un bien essentiel et non stockable -, le rôle des pouvoirs publics, de la régulation à la surveillance en passant par la planification, est primordial.
Messieurs les rapporteurs, vous insistez sur l'importance des interconnexions dans la sécurité d'approvisionnement d'un pays - nous en débattons souvent avec nos voisins espagnols, notamment -, ainsi que sur la nécessaire coordination à l'échelle européenne des réglementations s'appliquant aux gestionnaires de réseaux de transport en France. Il s'agit là d'un message que nous portons hautement à Bruxelles.
La sûreté du système électrique passe par un contrôle strict du gestionnaire de réseau de transport. Telle est la position que nous défendons, et que la Commission européenne a d'ailleurs partiellement reprise à son compte dans son troisième paquet énergétique.
Les règles mises en oeuvre par les gestionnaires de réseaux doivent être contraignantes et particulièrement suivies : il faut que tout manquement, à l'instar de celui qu'a connu, le 4 novembre 2006, la République fédérale d'Allemagne, soit sanctionné. La France milite donc pour une régulation contraignante, comme le recommande d'ailleurs la mission commune d'information.
Ainsi que vous l'avez souligné tout à l'heure, monsieur Sido, la mesure la plus emblématique du troisième paquet énergétique concerne la séparation patrimoniale, présentée par la Commission européenne comme la réponse aux dysfonctionnements du marché et notamment aux problèmes de sûreté du système électrique.
Or la France ne partage pas cette position. Elle considère que RTE, Réseau de transport d'électricité, a parfaitement montré par le passé sa capacité à gérer le système électrique sans incident majeur. Pour preuve, le dernier incident majeur remonte au 12 janvier 1987, quand des délestages importants se produisirent dans l'ouest de la France, beaucoup d'entre nous s'en souviennent.
Le renforcement de la sûreté passe aussi par une coopération accrue entre les gestionnaires de réseaux de transport. Là encore, nous voulons être exemplaires : le mémorandum d'entente signé le 6 juin 2007 par les ministres chargés de l'énergie des cinq pays du forum pentalatéral, c'est-à-dire la Belgique, le Luxembourg, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, constitue une illustration de la politique que nous souhaitons promouvoir en Europe.
Ce mémorandum vise des objectifs précis et ambitieux, à savoir l'élaboration d'un bilan prévisionnel global, la création d'une échelle de classification des incidents de réseau et la mise en place d'une plate-forme commune de coordination des gestionnaires de réseaux de transport afin que, demain, nous soyons assurés que les gestionnaires communiquent effectivement entre eux et utilisent les mêmes outils.
Tous ces objectifs rejoignent les propositions de la mission commune du Sénat, me semble-t-il, et doivent être mieux pris en compte dans le troisième paquet énergétique.
À cet égard, voilà quelques semaines que les discussions ont débuté au Conseil européen. Comme l'indiquait M. Daniel Raoul, il s'agit pour la France de peser dans ces négociations, aux côtés de ses partenaires européens, afin d'aboutir à un texte ambitieux, garantissant que les objectifs soient atteints, sans pour autant nuire à l'intégrité de nos opérateurs.
Ainsi, la France et l'Allemagne ont déjà réuni sept pays européens sceptiques devant une mesure qu'ils considèrent comme étant disproportionnée. Ensemble, nos deux pays s'efforceront de faire évoluer dans le bon sens les projets de textes européens de ce paquet énergétique.
Au final, s'agissant de l'émergence d'une politique européenne de l'énergie au travers des négociations communautaires en cours, le Gouvernement reprend à son compte quasiment toutes les propositions de la mission d'information du Sénat, dont il partage le constat et les objectifs.
Toutefois, sur certains points, en nombre limité d'ailleurs, il émet quelques réserves quant à la façon de parvenir au résultat attendu. Il en est ainsi de la proposition, sur laquelle nous reviendrons, visant à encadrer le fonctionnement du réseau par des textes européens juridiquement contraignants, tels que des directives techniques, ou de celle, formulée par M. Yannick Texier, tendant à encadrer le développement des interconnexions par une déclaration d'utilité publique européenne - si du moins tel est bien le sens de votre proposition, monsieur Texier.
En effet, il nous semble que de tels processus, assez lourds, pourraient à terme ralentir l'intégration européenne et aller à l'encontre de l'effet recherché.
En revanche, la France est favorable à une régulation concrète au niveau européen et à la mise en place de coordinateurs européens, qui permettraient, sur des projets d'interconnexion, de fluidifier le dialogue entre les pays concernés.
Pour conclure, et sans tomber dans le péché de l'unanimisme, qui n'est jamais propice à l'exercice de la démocratie, je tiens à rendre hommage à la mission commune d'information du Sénat pour les enseignements précieux qu'elle a dégagés, dans un moment particulièrement crucial pour notre politique de l'énergie, tant nationale qu'européenne.
Je souhaite que le dialogue entre le Gouvernement et la Haute Assemblée se poursuive, voire s'intensifie, car il reste certaines questions dont je souhaite débattre avec vous, mesdames, messieurs les sénateurs, particulièrement lors de la déclinaison, au mois de décembre prochain, des différents programmes opérationnels issus du Grenelle de l'environnement.
Monsieur le président, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, je me félicite du travail qui a été réalisé par le Sénat et je vous en remercie.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Je constate que le débat est clos.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à onze heures cinquante, est reprise à seize heures quinze, sous la présidence de M. Adrien Gouteyron.