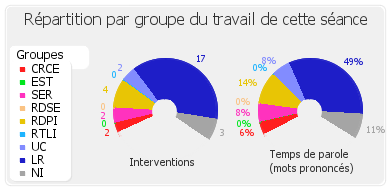Séance en hémicycle du 9 avril 2013 à 9h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Questions orales (voir le dossier)
- Enregistrement de l'institut supérieur d'ostéopathie de lille au niveau 1 du répertoire national des certifications professionnelles (voir le dossier)
- Règle particulière régissant le financement des interventions de l'établissement public foncier paca (voir le dossier)
- Situation des communes isolées intégrant une communauté de communes à fiscalité additionnelle (voir le dossier)
- Suppression des aides financières extra-légales pour les personnes bénéficiant de l'allocation aux adultes handicapés (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

La parole est à M. Michel Teston, auteur de la question n° 169, adressée à M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Monsieur le ministre, sur proposition de la Commission européenne, la réforme de l’organisation commune de marché vitivinicole prévoyait la libéralisation des droits de plantation à compter du 1er janvier 2016.
La suppression de cet outil essentiel de régulation du secteur du vin a provoqué de vives inquiétudes dans l’ensemble de la filière viticole française, qui redoutait en particulier de perdre la maîtrise de l’offre et de subir par conséquent une dévalorisation des zones d’appellation ainsi qu’une baisse des prix.
Cette situation explique la forte mobilisation des élus des territoires concernés en faveur du maintien de ce régime d’encadrement des plantations de la vigne. Du reste, une étude de l’assemblée des régions européennes viticoles, ou AREV, a démontré que la suppression de ce dispositif ne permettrait à la viticulture européenne ni d’être plus compétitive ni de mieux répondre aux évolutions de la demande mondiale.
Monsieur le ministre, je tiens à saluer tout particulièrement la détermination et le volontarisme dont vous avez fait preuve sur ce dossier, en particulier en obtenant l’accord de treize autres pays producteurs pour la création d’une « plateforme commune » établissant la nécessité d’une régulation du potentiel de production viticole.
Les recommandations présentées le 14 décembre dernier par le groupe à haut niveau, ou GHN, ont suscité un certain soulagement dans la mesure où elles vont dans le sens de cette plateforme et reprennent l’essentiel des demandes exprimées par les viticulteurs européens.
Le consensus atteint par les ministres de l’agriculture dans le cadre des négociations sur l’avenir de la PAC est donc satisfaisant. À cet égard, je souligne que ce compromis est largement inspiré des recommandations du GHN, lesquelles sont fondées sur un système d’autorisations de plantation.
Toutefois, les viticulteurs français souhaitent une amélioration de ce dispositif, concernant surtout sa durée, laquelle est actuellement limitée à six ans, et le plafond annuel de plantations nouvelles qu’ils souhaitent voir porté de 1 % à 0, 5 %.
Ces demandes ont-elles une chance d’être acceptées ? Plus globalement, sommes-nous proches d’un accord final garantissant un régime pérenne et efficace de régulation du secteur du vin en Europe ?
Monsieur le sénateur, cher Michel Teston, vous avez souligné mon engagement et celui du Gouvernement tout entier sur la question des droits de plantation.
Je me suis effectivement saisi de ce dossier dès mon arrivée au ministère de l’agriculture, en visant l’objectif suivant : rassembler le plus grand nombre de pays producteurs viticoles afin de créer une plateforme viticole commune, et de revenir ainsi sur une décision prise entre 2007 et 2008. Il ne s’agissait pas, je le souligne, d’un enjeu anodin dans l’histoire de la PAC ! Il faut en mesurer toute la portée.
Du reste, les résistances exprimées remettaient en cause la pertinence même de la décision de suppression des droits de plantation : ce choix revenait en effet à considérer que l’Europe avait un potentiel de développement à l’exportation pour le vin, et que nous devions partant étendre notre vignoble pour conquérir de nouveaux marchés, dans une logique très libérale. Revenir sur cette décision est donc un acte extrêmement fort.
Ensuite, le GHR a remis des conclusions sur la base desquelles le Conseil des ministres de l’agriculture des 18 et 19 mars dernier a statué.
Il a tout d’abord acté le fait que l’on allait revenir sur la décision prise antérieurement. Reste à présent la procédure de trilogue avec le Parlement européen pour finaliser une réforme de la PAC, même si la question des droits de plantation ne se rattache pas directement à celle-ci.
Vous l’avez rappelé, en vertu de la nouvelle réglementation, l’évolution des plantations viticoles sera suivie et maîtrisée. Ce nouveau système entrera en vigueur en 2019, pour une durée de six ans. Nous disposons donc, pour les onze années à venir, d’une structure permettant de réguler le marché du vin. C’est là l’élément essentiel.
Ensuite, se posent les questions techniques que vous avez évoquées.
Concernant le pourcentage d’évolution des surfaces, la Commission, vous le savez, avait proposé à l’origine un taux de 2, 5 %. Pour notre part, grâce au rôle extrêmement utile joué par la plateforme des quatorze pays, nous sommes parvenus à réduire ce chiffre à 1 %.
Pouvons-nous aller plus loin ? Aujourd’hui, je vous le dis clairement, je ne veux en aucun cas ouvrir de nouveau le débat, face à ceux qui pourraient être tentés de remettre en cause cet acquis.
Pour l’heure, en ce qui concerne la durée de ce système et le taux d’augmentation des surfaces, le cadre semble donc a priori fixé.
Désormais, tout le débat va porter sur la manière dont nous allons gérer ce dispositif, et en particulier sur les autorisations et la surveillance dont les droits de plantation feront l’objet. En effet, la faculté d’augmenter les surfaces de 1 % reste soumise à une procédure d’autorisation. C’est d’ailleurs ainsi que l’on peut veiller à ce que la nouvelle réglementation ne conduise pas à une augmentation beaucoup trop forte et trop rapide des droits de plantation. Et c’est ainsi qu’il sera possible de corriger encore le dispositif.
Monsieur le sénateur, telle est la réponse que je tenais à vous apporter. Je le répète, on ne mesure pas assez l’importance de la décision obtenue, annulant un arbitrage qui avait été opéré il y a moins de cinq ans ! Nous sommes revenus de ces négociations avec un objectif et un dispositif qui, à mes yeux, correspondent largement à la position défendue par la France en la matière.

Monsieur le ministre, je vous remercie de ce bilan très précis concernant l’état actuel de cet important dossier.
J’ai bien entendu votre réponse, notamment sa seconde partie. Toutefois, pour limiter les risques toujours possibles d’une libéralisation des droits de plantation à terme, mieux vaut, à mon sens, garantir la régulation la plus pérenne qui soit.
Il s’agit là d’un enjeu essentiel pour l’ensemble des viticulteurs européens. Je vous demande donc de continuer à œuvrer avec la même détermination pour aboutir à la régulation la plus efficace possible.

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, auteur de la question n° 306, adressée à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Je souhaite attirer l’attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les difficultés financières auxquelles se heurtent les gestionnaires de logements très sociaux, tels que les logements accompagnés, les résidences sociales, les foyers de jeunes travailleurs ou de migrants, autant d’hébergements proposés à des personnes dont les ressources sont si faibles qu’elles ne peuvent accéder à un logement social classique.
Les redevances dont s’acquittent les résidents, composées d’un équivalent loyer et d’un équivalent charges locatives, sont plafonnées via la convention APL. Ce dispositif garantit l’accueil de personnes à faibles revenus.
Depuis 2009, l’indexation de ces redevances est fondée sur le seul indice de référence des loyers, l’IRL. Or cet indicateur ne prend pas suffisamment en compte le poids de l’entretien, de la construction, de l’énergie, des fluides et des services.
Qui plus est, ce mode de calcul n’est pas adapté au secteur des foyers et des résidences sociales, car les charges sont forfaitaires et non récupérables. Il place certes les résidents à l’abri de la précarité énergétique, mais il empêche parallèlement les gestionnaires de couvrir l’augmentation du coût de l’énergie. En effet, le poids des combustibles, de l’eau et de l’électricité dépasse de loin, pour les gestionnaires de foyers et de résidences sociales, les montants accordés sur la base de l’IRL.
De plus, l’augmentation de ces charges comme de celles qui sont liées à l’entretien du logement est largement supérieure à celle de l’IRL. Il est donc indispensable de revenir à un indice composite obtenu au travers de la pondération de l’IRL par les indices « électricité, gaz et autres combustibles » et « services d’entretien du logement », tel qu’il était en vigueur jusqu’en 2008.
Madame la ministre, quelles dispositions le Gouvernement compte-t-il mettre en œuvre pour assurer de manière pérenne la viabilité financière d’un secteur qui, représentant tout de même 180 000 logements, risque de ne plus pouvoir exercer ses missions dans la mesure où il se trouve à la fois contraint par l’augmentation des coûts de l’énergie et empêché de dégager des recettes de gestion suffisantes pour faire face à ses obligations ?
Monsieur le sénateur, la politique du logement doit répondre à toute la diversité des situations, et cette ambition explique l’existence, notamment, des résidences sociales.
Votre question fait référence à la modification de l’indexation des charges qui sont aujourd’hui forfaitisées dans ce type de redevance. Cette décision a été prise pour freiner une augmentation importante du montant des charges que doivent acquitter les personnes logées en résidences sociales, ces dernières figurant parmi les publics les plus fragiles et les plus précaires des personnes occupant actuellement un logement social.
Je ne mésestime cependant pas les difficultés que rencontrent les gestionnaires de résidences face à cette situation. C’est pourquoi nous avons travaillé à réduire la part qui constitue un aléa de fait pour les gestionnaires. Nous devons en effet nous garder de placer les locataires de ces résidences sociales en situation de trop souffrir de l’aléa du coût de l’énergie. Je rappelle d’ailleurs que la maîtrise individuelle des charges n’est pas possible pour ces logements.
En revanche, vous savez bien que, afin de répondre à cette difficulté, la loi qui vise à préparer la transition vers un système énergétique sobre, adoptée définitivement le 11 mars dernier par l’Assemblée nationale, ouvre le bénéfice de la tarification spéciale « produit de première nécessité » aux gestionnaires des résidences sociales. Les sommes correspondantes devront être déduites des redevances des résidents.
Dans ce nouveau contexte, nous réfléchirons au meilleur moyen d’assurer aux gestionnaires un équilibre économique leur permettant de gérer au mieux leurs résidences.
De la même manière, il me semble absolument décisif d’avancer vers une réduction des consommations. À cet effet, l’État a mis en place des dispositifs incitatifs pour la rénovation énergétique du parc social, notamment l’éco-prêt logement social, dont le Président de la République a annoncé voilà quelques jours la relance avec un taux d’intérêt désormais fixé à 1 %. Des travaux massifs d’économies d’énergie pourront donc être réalisés, qui permettront aux gestionnaires de voir diminuer de manière très importante leur consommation.
C’est par cette maîtrise globale de la dépense énergétique, réalisée sans impact trop important sur le budget des personnes fragiles que sont ces résidents, que nous pourrons réaliser la difficile protection conjointe, d’une part, du public sensible aux aléas de l’augmentation des coûts de l’énergie et, d’autre part, des gestionnaires à vocation sociale qui assurent une mission extrêmement utile et doivent trouver les moyens de leur équilibre financier et économique durable.
Cette réflexion est ouverte, elle se fait en lien avec les associations qui fédèrent les gestionnaires, et je ne manquerai pas de vous tenir informé de son avancée.

Madame la ministre, cette réponse apporte des éléments qui, ensemble, sont à même de rassurer les différents gestionnaires, et je vous en remercie.
Je suis d’accord avec vous sur la nécessité de trouver un équilibre entre, d’une part, la protection des personnes accueillies et, d’autre part, la situation des gestionnaires. Votre réponse va éclairer un peu les perspectives de ces derniers, dont certains sont en situation de souffrance, comme me l’ont indiqué ceux que j’ai récemment rencontrés dans mon département.

La parole est à M. Jean Bizet, auteur de la question n° 313, adressée à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Madame la ministre, permettez-moi d’attirer votre attention sur les préoccupations exprimées par plusieurs élus de mon département à propos de la difficulté de mobiliser des crédits en faveur de la modernisation de l’habitat dans les zones rurales.
Depuis la modification, en 2010, des priorités de l’Agence nationale de l’habitat, l’ANAH, sont désormais privilégiées, en milieu rural, la lutte contre la précarité énergétique des propriétaires occupants, et, pour l’ensemble du territoire, la lutte contre l’habitat indigne dans le parc locatif. La mobilisation du parc vacant et l’amélioration du parc locatif ne sont donc plus traitées que marginalement.
Obtenir un gain énergétique dans les logements constitue, bien entendu, un objectif louable sur le principe, et j’y souscris. Mais il s’avère particulièrement difficile d’atteindre le seuil de 25 % de gain énergétique nécessaire au déclenchement des aides.
Dans la plupart des cas, et en particulier pour des projets modestes, la réforme du régime des aides de l’ANAH se révèle défavorable. Seuls les dossiers présentant des montants de travaux importants sont avantagés par le nouveau régime. Dans un département rural tel que celui de la Manche, il est souvent difficile d’atteindre un tel niveau d’investissement. Il s’ensuit un sentiment de frustration et de déception de la part des propriétaires, sentiment bien évidemment partagé par les élus.
Cette décision est lourde de conséquences, puisqu’elle rend difficile la réalisation d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat, ou OPAH, et supprime ainsi l’outil privilégié des collectivités locales pour lutter contre la vacance en secteur aggloméré. Elle vient donc en contradiction avec le discours général des pouvoirs publics incitant les élus locaux et leurs partenaires à cibler la reconquête des espaces urbains délaissés au cœur des villes et des bourgs, plutôt que de poursuivre la construction et l’urbanisation en périphérie des villes. Je souscris totalement, là encore, à cet objectif, car nous sommes confrontés à ce problème au cœur de nos bourgs ruraux, dans toutes les régions de France.
Cette orientation, reprise et inscrite dans la plupart des schémas de cohérence territoriale, les SCOT, s’impose aux plans locaux d’urbanisme, les PLU. J’y souscris d’ailleurs totalement dans le cadre du SCOT du pays de la baie du Mont-Saint-Michel, dont je m’occupe. La situation semble donc irrationnelle et génère chez les élus de l’incompréhension, puis du découragement.
Je vous demande donc, au moment où une augmentation des crédits destinés à l’ANAH est envisagée, quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour préserver une politique de rénovation de l’habitat dans les zones rurales.
Monsieur le sénateur, ce n’est pas la première fois que l’on attire ici mon attention sur la situation du logement en zone rurale, et vous pouvez être certain que je suis consciente de ses difficultés spécifiques. En effet, si elle est très différente de la situation dans les zones tendues, elle n’en est pas moins délicate. La situation des centres-bourgs et la dégradation du patrimoine, notamment, dans diverses villes petites ou moyennes, posent problème. Le patrimoine en situation de vétusté thermique est plus important dans les zones rurales que dans les zones urbaines car il est, dans un certain nombre de cas, plus ancien.
Sur ces territoires, l’enjeu est donc de mobiliser le parc privé et de travailler à son amélioration. Les propriétaires occupants éligibles aux aides de l’ANAH sont fortement représentés en milieu rural : 38 % y logent contre seulement 27 % de l’ensemble des propriétaires de maisons de la métropole. Ce sont donc des destinataires importants de ce programme.
Vous avez indiqué qu’il était difficile d’atteindre le seuil de 25 % de gain énergétique par isolation. Je tiens à vous dire que ce n’est pas le cas. L’expérience du programme « Habiter mieux » le montre bien, qui visait tout particulièrement des ménages en grande précarité énergétique et disposant de faibles niveaux de ressources, notamment des personnes âgées. Les principales victimes de la précarité énergétique dans notre pays sont en effet aujourd’hui des propriétaires occupants à très faibles ressources, plutôt âgés, habitant des maisons individuelles datant d’une époque où l’on construisait sans se préoccuper des questions d’isolation.
Or, le taux moyen d’économies d’énergie réalisées grâce à ce programme atteint 39 %, au lieu des 25 % exigés par l’ANAH. Nous devons donc être réalistes et travailler sur l’ensemble des clés permettant la rénovation de ce patrimoine, en particulier la clé financière, avec l’amélioration du programme de rénovation thermique annoncée par le Président de la République, qui, en plus des aides classiques issues du crédit d’impôt développement durable ou de l’éco-prêt à taux zéro, va se voir adjoindre une prime d’aide à la rénovation de 1350 euros qui concernera les deux tiers de la population française et pourra atteindre 3 000 euros pour les personnes les plus précaires.
Cet effort se double d’un travail sur l’amélioration de l’habitat, avec les dispositifs existants utilisés par nombre de collectivités locales qui permettent de s’attaquer à la rénovation du patrimoine ancien en centre-bourg, souvent délaissé aujourd’hui – je partage totalement votre avis sur ce point. Cette situation provoque l’apparition de « dents creuses » et l’abandon de certains petits quartiers de centre-bourg, alors même que se poursuit l’artificialisation des sols et la construction de quartiers en périphérie.
Il me semble donc très important, pour l'amélioration de la vie de ces territoires et de ces bourgs ruraux, de mieux prendre en compte ces questions. Cela se fera également dans le cadre de la future loi relative au logement et à l’urbanisme que j’aurai l’occasion de venir présenter ici dans quelques semaines.

Madame la ministre, je prends acte de vos réponses, et j’attends de tester sur le terrain leur efficacité concrète. Je note également la perspective de la loi que vous nous présenterez dans quelques semaines.
En ce qui concerne les propriétaires occupants, j’admets avec vous que leur situation est financièrement plus confortable ; je vous signale néanmoins qu’une grande part de biens situés dans les bourgs ruraux est entre les mains de propriétaires bailleurs. Ce secteur pose un problème considérable car, dans les zones rurales, la génération qui est en train de disparaître avait thésaurisé et investi dans la pierre. Aujourd’hui, de nombreux biens sont totalement laissés à l’abandon parce que leurs propriétaires bailleurs ne peuvent pas réaliser d’opération de rénovation à peu près équilibrée. En effet, en zone rurale, le montant des loyers ne le permet pas, au regard de cet objectif de lutte contre la précarité énergétique qui, encore une fois, est particulièrement louable.
Mais cette orientation, vertueuse et louable sur le papier, reste très difficile à mettre en œuvre.
Je suis prêt à partager avec vos services les simulations que nous avons établies avec un certain nombre d’organismes dans le département de la Manche, qui indiquent que nous ne pouvons pas réaliser ces opérations.
La réponse des maires ruraux à cette problématique a souvent été la consommation d’espace, et il n’a donc pas été aisé de mettre en place les SCOT. Nous y sommes parvenus, dans ce territoire il est vrai un peu particulier qu’est la baie du Mont-Saint-Michel, en faisant comprendre aux élus, après de longues négociations, que la consommation d’espace n’était pas la bonne solution.
Nous avons donc besoin en parallèle d’une réponse satisfaisante de l’État afin de mobiliser des crédits pour rénover ces cœurs de bourgs. Il y a là, vous l’avez dit, une qualité particulière du patrimoine qui disparaîtra complètement dans les dix ou quinze ans qui viennent si nous ne réalisons pas ces opérations.

La parole est à M. Yannick Botrel, auteur de la question n° 345, adressée à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Madame la ministre, je souhaite attirer particulièrement votre attention sur la situation que m’ont signalée plusieurs maires de communes des Côtes-d’Armor qui rencontrent des difficultés en matière d’urbanisme.
Ces difficultés relèvent à la fois de l’application de la loi Littoral, de la complexité de l’élaboration des plans locaux d’urbanisme, ou PLU, liée à l’empilement et à l’enchevêtrement des réglementations, de la montée du juridisme et des recours abusifs, largement facilitée par la complexité précitée, ainsi que de l’interprétation parfois variable par les services de l’État des différents textes applicables, sans oublier celle des juridictions administratives, pouvant aboutir à l’annulation sur des points de détail de documents d’urbanisme représentant un travail d’élaboration considérable entrepris sur plusieurs années.
Si personne ne conteste le bien-fondé de la loi Littoral, il y a lieu de clarifier, par exemple, la notion de continuité de l’habitat, d’ailleurs variable d’un département à l’autre.
Cette notion peut en effet aboutir à des absurdités. Ainsi, une commune dont la limite est très proche du littoral sur une certaine distance, sans toutefois l’atteindre, n’est pas concernée par l’application de la loi Littoral, cependant qu’une autre qui ne le touche que de quelques dizaines de mètres se trouve concernée pour l’ensemble de son territoire alors même que ce dernier s’enfonce de plusieurs kilomètres dans les terres.
Actuellement, une commune bretonne, Plouvien, souhaite céder à sa voisine Tréglenou sa frange littorale afin d’être dispensée de l’application de la loi !
Personne ne conteste sur le fond l’objectif d’une préservation de l’environnement par la conservation des zones humides ou la modération de la consommation de l’espace agricole. Mais, aujourd'hui, l’élaboration d’un PLU doit intégrer les orientations du SCOT, le schéma de cohérence territoriale, veiller à l’application des dispositions du Grenelle 2 et tenir compte de l’existence de zones Natura 2000, ce qui a des conséquences pour tout le territoire communal même si n’est concernée qu’une part très marginale de celui-ci. Il faut même réfléchir à la question de la diminution obligatoire des déplacements, et ce, parfois, dans des communes rurales où il n’existe précisément pas de transports collectifs.
Tout cela a trois conséquences.
La première est la lourdeur de la réalisation d’un document d’urbanisme, qui se traduit par plusieurs années d’études et un coût de plus en plus élevé de l’élaboration de celui-ci.
La deuxième conséquence est la fragilité juridique des documents d’urbanisme, qui sont facilement attaquables, non pas sur le fond mais souvent sur la forme, ce qui débouche sur des annulations.
La troisième conséquence, enfin, est le coût financier qui en résulte : les études sont nombreuses, et il est désormais souvent nécessaire d’avoir recours à un conseil juridique. Ainsi, de nombreuses collectivités font appel à des cabinets d’avocats, sans avoir pour autant la garantie d’être prémunies contre tous les risques.
Madame la ministre, ma question est double : le ministère de l’égalité des territoires et du logement a-t-il conscience de la situation complexe à laquelle sont confrontés les conseils municipaux et les maires en matière d’urbanisme ? Entendez-vous vous-même proposer des moyens nouveaux pour simplifier et sécuriser juridiquement les futurs documents d’urbanisme ?
Monsieur le sénateur, vous avez indiqué un certain nombre de difficultés relatives à l’élaboration ou à la mise en œuvre des documents d’urbanisme. Vous partagez, me semble-t-il, mon avis quant à la nécessité de ces documents pour le développement et l’aménagement durable de nos territoires.
Je vous rejoins très clairement sur un point : ces documents doivent décrire un parti pris d’aménagement qui soit la traduction de la vision politique des élus locaux. C’est l’objectif que ceux-ci doivent poursuivre, et c’est là leur force. Cette vision doit être claire et lisible pour les habitants et les usagers.
Concernant la planification opérationnelle, le plan local d’urbanisme doit être explicite sur les espaces et sur la future vocation de ces derniers, notamment ceux qui traduisent des fonctions de continuité écologique, tout en intégrant les prescriptions des SCOT, élaborés à l’échelle plus large du bassin de vie et demain, peut-être, des schémas régionaux.
Voilà pourquoi le futur projet de loi relatif au logement et à l’urbanisme visera à mettre en cohérence ces différents niveaux de planification, afin de les clarifier et de les simplifier.
Je sais à quel point l’élaboration d’un PLU est aujourd'hui un travail complexe. Il s’agit d’un investissement lourd pour certaines collectivités. C’est pourquoi le Gouvernement souhaite faire avancer l’idée d’élaborer des PLU au niveau intercommunal. Un certain nombre de collectivités ont déjà commencé à le faire, en partageant une vision de planification à une échelle plus large que l’échelle communale, qui est aujourd'hui celle de la vie de l’essentiel des habitants. Pour répondre à la question très pratique que vous m’avez posée, monsieur le sénateur, cela permet de mutualiser les moyens, en vue d’élaborer les documents d’urbanisme.
Pour ce qui concerne la loi Littoral, elle est aujourd’hui assez largement admise eu égard à l’équilibre qu’elle a trouvé. La règle de continuité est justifiée dans son principe dans la mesure où elle permet de protéger les terrains agricoles et les paysages et de limiter le coût des équipements publics aujourd’hui nécessaires pour toute construction habitable. Les communes littorales ont sans doute des contraintes particulières en matière d’urbanisme, mais elles ont aussi des atouts qu’il convient de mettre en valeur de manière durable.
Il n’est évidemment pas interdit de lever les difficultés qui se posent quant à la complexité des procédures, ni de traiter des points de détail. Mais il ne saurait être question de revenir sur la loi Littoral, qui a subi un certain nombre d’attaques visant à remettre en cause le fondement même de la protection accordée à certaines zones d’entrée du territoire, car celles-ci sont, à notre sens, extrêmement précieuses.
En revanche, le projet de loi que je présenterai prochainement au Parlement comportera un volet dédié à la planification qui visera à mieux articuler les différentes obligations pesant sur les collectivités locales – cela peut être celles de la loi Littoral ou de la loi Montagne – ainsi que les différents niveaux de schémas régionaux ou de planification de plus grande proximité. Il convient de simplifier la procédure pour la rendre plus accessible aux élus locaux et aux habitants et rendre plus évidente la prise en compte de la prescription. Les PLU doivent être de véritables outils au service des politiques menées par les élus.

Madame la ministre, je prends acte de votre réponse et des intentions qui sont les vôtres, avec la poursuite de la réflexion à l’occasion de l’examen, dans quelques semaines, du projet de loi que vous avez annoncé.
Pour autant, à l’heure où l’on aborde, dans d’autres domaines, la question de la simplification des normes, il faut remettre un peu d’ordre, en repensant d’une manière globale les documents d’urbanisme. On a assisté au cours des dernières années à une stratification des règles, avec l’arrivée de nouveaux textes qui sont parfois, comme je l’ai indiqué, interprétés différemment par les services de l’État.
Je considère, moi aussi, que la loi Littoral a joué un rôle positif. Néanmoins, elle contient des notions qui sont tout à fait interprétables. Ainsi, certaines personnes chargées d’appliquer les textes peuvent parfois estimer que la notion de continuité de l’habitat concerne également les « dents creuses » entre les parties habitées. Ce sont ces éléments-là qui viennent polluer la discussion dans les communes et qui aboutissent au résultat que j’ai indiqué.
Dans le département des Côtes-d’Armor, je connais une commune qui en est à son sixième contentieux relatif à des permis de construire annulés, alors qu’ils avaient été attribués de manière tout à fait réglementaire. L’insécurité juridique dans laquelle se trouvent les maires est intenable.
Nous aurons l’occasion d’aborder ces questions lors de l’examen du projet de loi, et j’espère que nous saurons avancer pour résoudre certaines des difficultés que j’ai évoquées.

La parole est à M. Bernard Fournier, auteur de la question n° 373, adressée à Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Madame la ministre, je souhaite vivement attirer votre attention, et celle du Gouvernement, sur l’intégration, dans le schéma licence-master-doctorat, ou LMD, de la formation des masseurs-kinésithérapeutes.
Lancée par le processus de Bologne en 1999, voilà quatorze ans, la réforme LMD implique la modification du système d’enseignement supérieur français en vue de créer l’espace européen de l’enseignement supérieur.
Applicable dès la rentrée de septembre 2013, le schéma arrêté au début de l’année prévoit la reconnaissance du diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute au grade de licence.
Comme vous le savez, l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a toujours affirmé que la qualité des soins passe nécessairement par une formation de haut niveau et un diplôme universitaire au grade de master. Malheureusement, l’arbitrage du 25 janvier 2013, que vous avez signé conjointement avec Mme la ministre des affaires sociales et de la santé, ne tient pas compte de ses préconisations.
En effet, par cette décision, le Gouvernement confine la formation professionnelle des masseurs-kinésithérapeutes dans le cadre étriqué des trois années d’études, datant de 1969, sans tenir compte des évolutions enregistrées et de la formation telle qu’elle est aujourd’hui réellement dispensée.
De plus, l’arbitrage proposé n’est pas en adéquation avec le programme défini par le groupe de réingénierie depuis cinq ans.
Il devait s’agir d’une réforme d’envergure, répondant aux évolutions des besoins en matière de santé ainsi qu’aux attentes de longue date des professionnels de santé. Or, n’ayons pas peur des mots, il s’agit ici d’un recul.
Très clairement, il faut procéder à un nouvel arbitrage tenant réellement compte de la réalité de l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute.
Les attentes de toutes les composantes de la profession sont pourtant claires : un master 1 pour l’ensemble des masseurs-kinésithérapeutes et un master 2 pour ceux qui souhaitent poursuivre leur cursus vers des pratiques avancées.
Le master 1 définit un niveau d’autorisation d’exercice cohérent. Il serait dommageable de se priver d’une réforme mettant en phase la profession avec l’évolution du rôle des masseurs-kinésithérapeutes dans le parcours de santé. Le master 2 apportera un complément d’expertise indispensable à la profession et à la société, en conformité avec les nouvelles missions conduites dans le domaine notamment de la coopération.
Vous l’aurez compris, il est indispensable, me semble-t-il, d’élaborer une réforme de la formation initiale permettant de proposer des études conformes aux données actuelles de la science et aux besoins de la population qui garantissent la qualité des soins et la sécurité des patients.
Aussi, quelles mesures envisagez-vous de prendre, madame la ministre, afin de faire rapidement évoluer les choses ?
Monsieur le sénateur, le diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute relève de la compétence de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé.
En vue de son inscription dans le schéma licence-master-doctorat, défini à Bologne, cette formation a fait l’objet d’un premier travail interministériel : la définition des référentiels de compétence par le ministère des affaires sociales et de la santé ; les modalités de la formation et les référentiels retenus par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
L’arbitrage, qui a fait l’objet d’un communiqué de presse le 25 février dernier, apporte des réponses précises aux questions que vous avez posées.
Premièrement, le diplôme d’exercice de masseur-kinésithérapeute sera reconnu au grade de licence, mais obtenu à l’issue d’une formation incluant une première année universitaire qui sera généralisée. Ainsi, les étudiants qui le souhaitent pourront s’inscrire directement en deuxième année de master 2.
L’intégration de l’année de préparation aux études dans le parcours de formation initiale constitue une réelle avancée dans la reconnaissance universitaire et reposera sur une obligation de convention des instituts de formation avec l’université. Cela implique de faire de cette année non seulement une année de sélection et d’orientation, mais aussi une année de formation à part entière.
Deuxièmement, le conventionnement des instituts de formation avec une université sera obligatoire. L’absence de convention entraînera le retrait de l’autorisation de délivrance de la formation.
Troisièmement, l’inscription dans la convention avec l’université devra faire apparaître une offre de master 2 à laquelle les diplômés masseurs-kinésithérapeutes pourront accéder directement. Un travail complémentaire déterminera les champs de pratiques avancées en lien avec l’obtention d’un master.
Le travail à conduire par les deux ministères doit désormais être poursuivi, avec l’objectif d’une mise en œuvre pour la rentrée de septembre 2014. Ce travail sera copiloté dans le respect des exigences liées aux domaines d’intervention de la profession et de préparation des étudiants à leur future condition d’exercice professionnel ainsi qu’à celles qui sont liées à la reconnaissance universitaire.
Enfin, pour information, je vous confirme qu’une mission d’expertise et d’inspection conjointe de l’Inspection générale des affaires sociales et de l’Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche est engagée à la demande de nos deux ministères, avec l’objectif de présenter des recommandations générales relatives au processus d’« universitarisation » des formations initiales des professions paramédicales.
Par ces réponses complètes et – vous l’aurez compris, monsieur le sénateur – le travail qui est actuellement mené, j’espère avoir répondu à vos préoccupations.

Madame la ministre, je vous remercie pour toutes les précisions que vous m’avez apportées.
J’ai bien noté que le travail se poursuivait jusqu’en septembre 2014 pour donner en partie satisfaction aux professionnels de santé, et ce dans l’intérêt des malades.

La parole est à Mme Michelle Demessine, auteur de la question n° 375, transmise à M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Madame la ministre, au moment où notre pays est confronté à un vieillissement croissant, avec près de 13 millions de personnes de plus de soixante ans, l’ostéopathie connaît un très fort engouement et vient d’être reconnue par l’Académie nationale de médecine pour ses vertus thérapeutiques, en vue d’accompagner les médecines traditionnelles.
Cette discipline thérapeutique est sous la responsabilité du ministère de la santé, qui délivre des agréments à des formations supérieures dont les élèves exerceront leur profession au même niveau de responsabilité.
Pourtant, le répertoire national des certifications professionnelles ne loge pas toutes les formations supérieures en ostéopathie à la même enseigne : certaines sont certifiées d’un niveau 1, quand d’autres, malgré leur excellence, le sont d’un niveau 2. C’est notamment le cas de l’Institut supérieur d’ostéopathie de Lille, qui forme depuis 2003 des professionnels avec un haut degré de qualification reconnu.
Les étudiants y suivent un cursus totalisant 4 600 heures d’enseignement, réparties sur cinq ans et demi d’études, en conformité avec les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, qui préconise au moins 4 300 heures d’enseignement.
De plus, dans un souci de qualité de l’enseignement au sein de cet établissement, les cours sont dispensés par cinquante-deux enseignants médecins, dont dix professeurs de médecine, huit praticiens hospitaliers et huit anciens chefs de clinique, et un diplôme n’est délivré qu’à quarante à cinquante étudiants par an.
Pourtant, en décembre dernier, la commission nationale de la certification professionnelle, ou CNCP, a décidé l’inscription de cet établissement au niveau 2 du répertoire national des certifications professionnelles.
Alors que cet institut bénéficie depuis 2007 de l’agrément du ministère de la santé, cette classification empêche ses étudiants d’obtenir une équivalence à l’intérieur du système LMD. Ainsi, à la sortie de leurs études, ces étudiants se trouvent dépourvus d’un diplôme ayant une véritable reconnaissance universitaire ; quant à ceux qui, malheureusement, abandonnent la formation avant son terme, ils se voient dans l’obligation de recommencer leur cursus au niveau du baccalauréat.
Cette situation est de nature à décourager les étudiants désireux d’entreprendre des études d’ostéopathie, d’autant plus que cet établissement, pleinement inscrit dans le paysage de santé publique régional, est le seul du Nord – Pas-de-Calais.
Face à la demande croissante des Français pour les soins ostéopathiques, la classification de cet institut au niveau 2 est d’autant moins opportune que les établissements d’enseignement de la discipline, s’ils sont légion, sont peu nombreux à présenter des gages de débouchés professionnels aussi bons que les siens.
Madame la ministre, quelles mesures le Gouvernement envisage-t-il pour qu’il n’y ait plus deux niveaux de certification délivrés par la commission nationale de la certification professionnelle pour les formations supérieures en ostéopathie ayant reçu l’agrément du ministère de la santé ?
Madame la sénatrice Michelle Demessine, vous avez appelé l’attention du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la décision de la commission nationale de la certification professionnelle, la CNCP, d’enregistrer la formation de l’Institut supérieur d’ostéopathie de Lille au niveau 2 de la nomenclature, et non au niveau 1 comme le souhaitait cet établissement.
Je rappelle d’abord que la CNCP est composée principalement de représentants des partenaires sociaux, des chambres consulaires, des régions et de tous les ministères concernés, notamment du ministère des affaires sociales et de la santé. Ce ministère a agréé l’Institut supérieur d’ostéopathie de Lille pour qu’il puisse dispenser sa formation, sans pour autant lui accorder le niveau qu’il demandait.
La CNCP procède aux enregistrements selon une procédure et des critères définis par le code de l’éducation. En particulier, elle doit apprécier la notion de certification professionnelle dans sa relation à l’emploi. À cet égard, la logique qui prévaut pour l’ensemble des demandes présentées à la CNCP est qu’un emploi peut être exercé dans des contextes très divers et à des niveaux de responsabilité différents. C’est pourquoi le dossier de demande d’enregistrement doit comporter des référentiels d’emploi, d’activités et de compétences, ainsi que l’état des emplois occupés par les étudiants issus d’au moins trois promotions.
La demande d’enregistrement déposée par l’Institut supérieur d’ostéopathie de Lille en juin 2012 faisait suite à l’avis défavorable formulé par la CNCP, en avril 2011, sur une première demande. À l’issue de l’instruction prévue par les dispositions réglementaires, la CNCP s’est à nouveau prononcée en faveur d’un enregistrement au niveau 2. L’institut a refusé ce niveau d’enregistrement et formulé une demande de recours gracieux, en rappelant notamment son statut, la qualité de ses formateurs et la durée de la formation, ainsi que les relations qu’il entretient avec le centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Ces arguments ne pouvant pas être pris en considération dans la procédure de demande d’enregistrement telle qu’encadrée par les dispositions légales et réglementaires du code de l’éducation, ils n’ont pas suffi à convaincre la CNCP du bien-fondé d’un enregistrement au niveau 1.
Il convient également de préciser que le fait d’être agréé par le ministère de la santé pour dispenser la formation d’ostéopathe ne constitue pas une condition d’enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles à un niveau que ce ministère n’a pas lui-même fixé.
Cependant, la CNCP a formulé des recommandations pour améliorer les référentiels proposés et préciser les compétences ; ces recommandations ont fait l’objet d’un échange approfondi entre son président et le responsable pédagogique de l’établissement.
Les arguments avancés pour appuyer une demande d’enregistrement au niveau 1 ne pouvant être retenus et la CNCP ayant rendu son avis conformément au droit, vous comprendrez, madame la sénatrice, que le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ne puisse pas, aujourd’hui, répondre favorablement à votre demande. Néanmoins, on note une progression.
Je souhaite donc que, dans les années qui viennent, l’Institut supérieur d’ostéopathie de Lille, lorsqu’il aura terminé le travail en cours, puisse se voir accorder le niveau 1.

Je remercie Mme la ministre pour sa réponse très argumentée. J’ai bien entendu les raisons qu’elle a fait valoir, noté son insistance sur les recommandations formulées par la CNCP. J’espère que ces recommandations permettront à l’Institut supérieur d’ostéopathie de Lille d’obtenir finalement le niveau 1. En effet, il s’agit du seul établissement d’ostéopathie dans le Nord – Pas-de-Calais, et nous méritons bien d’avoir une école de niveau 1 !

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, auteur de la question n° 262, adressée à M. le ministre des affaires étrangères.

Je souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur la situation des enseignants contractuels de la mission de coopération éducative et linguistique, la MICEL, en Turquie.
La MICEL, qui participe à l’excellence de la coopération française en Turquie dans les établissements scolaires, au lycée Galatasaray et à l’université Galatasaray, est actuellement remise en question. En 2009, en effet, elle a mis en place pour les enseignants des contrats à durée déterminée, dits « deux plus deux plus un », dont certains arrivent à terme cette année.
Auparavant, les personnels de la MICEL bénéficiaient de contrats à durée indéterminée ou de contrats renouvelables chaque année. Ces contrats permettaient de répondre aux exigences d’une coopération de qualité nécessitant, de la part des intervenants, un investissement sur le long terme dans les établissements d’enseignement turcs.
En effet, il est indispensable pour un enseignant français venant travailler dans un lycée turc de parvenir à intégrer les spécificités des programmes de ce pays, ce qui n’est possible que progressivement et si les intervenants ont la garantie de pouvoir s’investir dans la durée. C’est grâce à des intervenants disposant d’un temps d’adaptation suffisant que fut bâtie une relation durable et fructueuse avec nos partenaires turcs au quotidien : professeurs, personnels administratifs, élèves et anciens élèves.
La limitation des contrats dans le temps, introduite par le ministère des affaires étrangères en 2009, nuit très gravement à la qualité de notre outil de coopération en Turquie. Aujourd’hui, avec plus de 60 % de contrats « deux plus deux plus un », notre coopération précarise son excellence en précarisant ses intervenants. Ce problème sera de plus en plus sensible et, si rien n’est corrigé, on peut estimer que, d’ici à cinq ans, 100 % des contrats seront des contrats de ce type, c’est-à-dire des contrats précaires.
Consciente de la gravité de la situation, la partie turque a manifesté son inquiétude à plusieurs reprises. Ainsi, le recteur de l’université Galatasaray et la directrice du lycée Galatasaray ont chacun signé une lettre contre ces contrats limités, dont les premiers arrivent à terme en 2013.
Je demande au Gouvernement de revoir la décision de 2009 et de permettre l’allongement des contrats en cours, ainsi que leur transformation éventuelle en contrats à durée indéterminée. Il est paradoxal que les établissements congréganistes labellisés « Éducation France » aient pu cette année répondre à cette exigence de stabilité en obtenant des détachements directs, alors que la coopération publique est confirmée dans la précarisation. En outre, cette évolution n’est pas comprise par nos partenaires institutionnels turcs. Elle doit donc être revue.
J’ajoute que cette révision n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences du fait de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dite loi Sauvadet. En effet, comme M. le ministre Laurent Fabius l’a indiqué dans un courrier de juillet 2012, le champ d’application de la loi Sauvadet « étant restreint aux agents engagés sur le fondement de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les agents recrutés par la MICEL ne sont pas éligibles aux dispositifs de CDIsation et de titularisation par la voie de recrutement réservés » instaurés par la loi du 12 mars 2012.
Ainsi, il n’y a pas de risque pour la MICEL que l’allongement des contrats n’entraîne des conséquences non souhaitées. Dans ces conditions, il ne devrait pas y avoir de blocage à la révision des contrats offerts par la MICEL.
Les personnels de cette mission, qui œuvrent pour la coopération franco-turque, sont aujourd’hui en grève car ils attendent du Gouvernement l’assurance qu’ils disposeront à l’avenir d’un cadre leur permettant d’exercer correctement leurs fonctions.
Monsieur le sénateur Jean-Yves Leconte, je vous remercie d’avoir attiré une nouvelle fois mon attention sur la situation des personnels de la MICEL et sur leur souhait de bénéficier de contrats à durée indéterminée.
Je voudrais à nouveau exprimer mon attachement au dispositif intégré Galatasaray, au sein duquel les agents de la MICEL sont principalement affectés. Ce dispositif constitue l’instrument d’excellence de notre coopération éducative et universitaire avec la Turquie.
Monsieur le sénateur, je souhaite insister sur l’effort financier considérable que représente le fonctionnement de la MICEL : 2, 9 millions d’euros en 2013, soit 67 % des crédits de coopération alloués au poste, dans un contexte budgétaire particulièrement contraint que vous connaissez parfaitement.
Je vous rappelle que les agents recrutés par la MICEL, dont je tiens à souligner les qualités pédagogiques et l’engagement au sein du projet, sont liés à cet établissement à autonomie financière par des contrats de droit administratif français. En 2009, il a été décidé de mettre en place des contrats limités dans le temps, dits « deux plus deux plus un », afin de maîtriser les conséquences financières du décret du 19 décembre 2007. Ce décret impose la prise en charge de la part patronale des cotisations pour pensions civiles des personnels titulaires détachés. Or cette charge deviendrait rapidement insoutenable s’il devait s’agir de contrats à durée indéterminée.
Je tiens à préciser que la réforme de 2009, qui a été réalisée en concertation avec les partenaires, visait à faire face à ces nouvelles charges : outre la mise en place de nouveaux contrats, elle s’est traduite par le détachement direct, depuis la rentrée 2012, des enseignants français qui étaient jusqu’ici, au sein de la MICEL, mis à disposition des lycées congréganistes français et de la fondation Tevfik Fikret.
Il reste à ce jour soixante agents à la MICEL, dont cinquante-six enseignants qui bénéficient de trois types de contrats différents : quinze d’entre eux, professeurs non titulaires de l’éducation nationale, bénéficient de CDI ; onze sont des titulaires détachés qui bénéficient de contrats renouvelés annuellement sans limite de temps ; quant aux trente enseignants recrutés après 2009, parmi lesquels onze non titulaires et dix-neuf titulaires détachés, ils bénéficient de contrats à durée déterminée de type « deux plus deux plus un ». Ces derniers ont été parfaitement informés de ces conditions ; ils ont donc signé ces contrats en toute connaissance de cause.
Monsieur le sénateur, je suis informée des revendications des enseignants : bénéficier de CDI et voir pris en charge les frais d’écolage de leurs enfants dans le lycée AEFE d’Istanbul. Certains professeurs se sont mis en grève récemment, le 19 mars et le 4 avril. Deux nouveaux préavis ont été déposés : le premier pour aujourd’hui, comme vous l’avez rappelé, le second pour le 12 avril.
Je n’ignore pas non plus que les autorités turques du dispositif Galatasaray s’inquiètent des conséquences de la durée limitée des contrats, ainsi que d’une perte d’attractivité de ces postes qui pourrait avoir, à terme, un effet négatif sur la qualité du recrutement.
Je déplore sincèrement que les enseignants aient choisi de se mettre en grève alors que le ministère avait dépêché une mission sur place. Cette mission a remis très récemment son rapport, et les directions compétentes de mon ministère préparent actuellement différentes options visant à faire évoluer le dispositif tout en préservant l’excellence de notre coopération éducative et linguistique en Turquie, une excellence qui suppose une certaine mobilité du corps enseignant français. Cette démarche tiendra compte de la contrainte budgétaire et s’inscrira dans un esprit de sérénité et de responsabilité

Madame la ministre, je vous remercie d’avoir mentionné l’inquiétude de nos partenaires turcs. J’espère que, dans les conclusions des travaux de la mission que vous avez dépêchée sur place, l’importance de mettre en place des contrats qui garantissent la qualité et la pérennité de notre coopération sera reconnue.
La relation franco-turque est importante ; la Turquie est un partenaire essentiel pour notre pays. Notre coopération avec l’université et le lycée Galatasaray est une politique majeure qui a surmonté toutes les tempêtes dans l’histoire de la relation franco-turque. Quelques millions d’euros, ce n’est pas énorme par rapport à l’enjeu que représente cette relation stratégique !
Madame la ministre, il est particulièrement important de mettre au point un dispositif qui réponde aux inquiétudes de nos partenaires turcs et des intervenants au sein de la MICEL. Compte tenu des observations que vous avez formulées et des difficultés que les enseignants rencontrent pour exercer leurs missions dans le cadre de contrats à durée déterminée, j’espère que la mission que vous avez dépêchée sur place débouchera sur la remise en cause des contrats « deux plus deux plus un » !
M. André Gattolin applaudit.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, auteur de la question n° 357, transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

Madame la ministre déléguée, chargée des Français de l’étranger, ma question porte, non pas sur ces derniers – et je le regrette, bien sûr ! –, mais sur les raisons qui peuvent justifier la règle particulière s’appliquant au financement des interventions de l’établissement public foncier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur par la taxe spéciale d’équipement, la TSE.
Si la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a harmonisé le statut juridique des établissements publics fonciers de PACA, de Normandie et de Lorraine avec le régime de l’ensemble des établissements publics fonciers d’État, les établissements de ces trois régions continuent d’être régis par une règle de financement particulière.
Je m’explique : les établissements publics fonciers mentionnés à l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme sont financés par une taxe spéciale d’équipement dont le montant est fixé chaque année par leur conseil d’administration, dans la limite d’un plafond fixé à 20 euros par habitant du territoire de leur compétence ; cependant, pour les établissements publics fonciers de PACA, de Normandie et de Lorraine, le plafond du produit de la TSE est fixé par la loi de finances et s’établit aujourd'hui, respectivement, à 50 millions, 13 millions et 25 millions d’euros.
Pour l’établissement public foncier de PACA, ce plafond est largement inférieur – environ de moitié – à celui dont il bénéficierait dans le régime de droit commun.
Si j’ignore ce qui pourrait éventuellement justifier le régime appliqué aux EPF des régions Lorraine et Normandie, je ne vous ferai pas l’injure de rappeler que la région PACA est une zone en pleine expansion démographique, particulièrement « tendue » en matière de logement. Doter son EPF, qui est particulièrement actif, des mêmes moyens que les autres est donc une question de bon sens et de principe. Au nom de quoi les règles de financement seraient-elles différentes, alors que le statut juridique de ces établissements est identique ?
Plus étonnant encore est l’acharnement mis par le Gouvernement à faire échouer toute tentative d’harmonisation du financement de ces établissements. Ainsi, le dispositif d’un amendement déposé sur mon initiative et adopté par le Sénat, lors de l’examen en première lecture du projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement, fut-il « évacué » à l’Assemblée nationale, du fait de l’adoption d’un amendement de suppression, dont l’origine pourrait se situer du côté de Bercy. Si le ministère des finances n’y est pour rien, vous me le direz, madame la ministre ! Quoi qu’il en soit, le résultat est là !
Ne comprenant pas ce qui, dans une République normale, peut motiver cet acharnement anormal à l’encontre d’une évolution de bon sens, je vous prie, madame la ministre, de bien vouloir m’expliquer ce qui se passe.
Monsieur Collombat, vous interrogez le ministre chargé du budget sur la légitimité du plafonnement du montant de la taxe spéciale d’équipement affectée aux établissements publics fonciers de Provence-Alpes-Côte d’Azur, de Normandie et de Lorraine.
Je souhaite tout d’abord rappeler les modalités de fixation annuelle du rendement de la taxe spéciale d’équipement destinée au financement des interventions foncières des établissements publics fonciers. La loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale prévoit que le produit de cette taxe est arrêté, avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, par le conseil d’administration de l’établissement public dans la limite d’un plafond fixé à 20 euros par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence.
Les cinq établissements publics fonciers créés avant la promulgation de cette loi demeuraient néanmoins soumis à des dispositions spécifiques. Parmi ces établissements, deux ont vu évoluer le mode de fixation de leur ressource fiscale. Ainsi, les articles du code général des impôts concernant l’EPF de Nord-Pas-de-Calais et l’EPF de l’ouest Rhône-Alpes ont été abrogés respectivement par la loi de finances rectificative du 30 décembre 2006 et par celle du 25 décembre 2007.
Aujourd’hui, tous les EPF voient donc le montant de leur ressource fiscale fixé par un vote de leur conseil d’administration, à l’exception des trois établissements publics fonciers que vous citez, à savoir ceux de PACA, de Normandie et de Lorraine, pour lesquels le montant en question est fixé par la loi de finances, en application des articles 1608, 1609 et 1609 F du code général des impôts.
Par ailleurs, le Premier ministre a très tôt affirmé l’intention du Gouvernement dans son ensemble de ne voir examiner de dispositions fiscales qu’à l’occasion des projets de loi de finances. Cette orientation gouvernementale, qui vise à faciliter le respect de la trajectoire de redressement de nos finances publiques, a ainsi été rendue publique dès le mois de mai 2012.
C’est pour assurer le respect de ce « monopole fiscal » des lois de finances que la ministre de l’égalité des territoires et du logement a proposé, lors de l’examen du premier projet de loi sur la mobilisation du foncier public en faveur du logement, la suppression par l’Assemblée nationale des dispositions adoptées par le Sénat visant à unifier le régime des EPF.
Le Gouvernement comprend toutefois le souci d’harmonisation que vous évoquez, monsieur le sénateur.
Quelle que soit la détermination du Gouvernement à soutenir la construction de logements, il paraît essentiel que la réflexion chemine dans le cadre des travaux tendant à décliner sa politique en matière de taxes affectées. Le Premier ministre a confié au Conseil des prélèvements obligatoires le soin de conduire une mission générale sur ces dernières. Un rapport sera remis au Parlement avant l’été. C’est, me semble-t-il, dans ce cadre que la question du plafonnement des taxes spéciales d’équipement devra être abordée et pourra, si nécessaire, faire l’objet de dispositions dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014.

Madame la ministre, je sais que vous n’y êtes pour rien, et je ne veux pas vous tourmenter, mais ce que vous me dites ne constitue en rien une réponse ! Vous me dites qu’on va faire un rapport… Mais où sommes-nous ? En plein délire bureaucratique !
La région PACA est tout de même « tendue », pour reprendre le jargon que j’ai utilisé tout à l’heure, sur le plan du logement. Puisqu’il faut régulariser et unifier les modes de financement, que ne le fait-on ? Est-il besoin de rapports pour prendre une telle décision ? Si le Gouvernement ne veut pas le faire dans le cadre d’une loi sur le logement, qu’il le fasse dans le prochain projet de loi de finances !
Personnellement, je ne me lasserai pas de poser la question, même si ce n’est sans doute pas vous, madame la ministre, qui me répondrez à chaque fois. Quoi qu’il en soit, j’estime que la réponse qui vient de m’être donnée est complètement irrecevable. Tel est le message que je veux faire passer.
Pour un gouvernement qui se pique de réformes, il est vraiment absurde de ne pas régler les petites choses qui sont à sa portée !

La parole est à M. Roland Ries, auteur de la question n° 368, adressée à Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite attirer votre attention sur la situation des communes isolées intégrant une structure intercommunale à fiscalité additionnelle et, plus particulièrement, sur le phénomène de double imposition au titre de la taxe d’habitation dont sont victimes les contribuables résidant dans ces communes.
La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales prévoit l’achèvement de la carte intercommunale en juin 2013, imposant ainsi aux dernières communes isolées d’adhérer à un établissement public de coopération intercommunale, un EPCI, avant cette date. Certaines de ces communes isolées sont amenées à intégrer une structure intercommunale à fiscalité propre, selon le régime de la fiscalité additionnelle.
L’adhésion de ces communes, au titre de la mise en place du schéma départemental de coopération intercommunale, s’est produite concomitamment à l’instauration d’une autre réforme, celle de la fiscalité locale. La conséquence principale a été, dans les communes isolées rejoignant un EPCI après le 1er janvier 2011, une majoration de la taxe d’habitation des contribuables concernés.
En effet, dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale applicable à compter du 1er janvier 2010, la part départementale de la taxe d’habitation, du fait de la réforme de la taxe professionnelle, a été transférée du département au bloc communal. Cette part départementale est affectée, pour une part, à chaque commune membre d’un EPCI et, pour une autre part, à l’EPCI lui-même. En revanche, les communes isolées ne faisant pas encore partie d’un EPCI à cette date, percevaient alors l’intégralité du taux départemental de la taxe d’habitation et subissaient, parallèlement, un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources, le FNGIR.
Par la suite, l’adhésion de ces communes isolées à un EPCI, comme c’est le cas dans mon département pour la commune d’Urmatt, qui a rejoint la communauté de communes de la Vallée de la Bruche en janvier 2012, n’a pas été accompagnée d’une révision du mécanisme de compensation de la réforme des finances locales, comme si la fiscalité locale et l’achèvement de la carte intercommunale n’étaient pas étroitement liés. Dès lors, les habitants de cette commune isolée ayant rejoint un EPCI sont contraints de supporter deux fois la part départementale de la taxe d’habitation. En effet, le taux de la taxe d’habitation appliqué à ces contribuables se décompose en un taux communal, qui inclut la totalité du taux départemental, et un taux intercommunal, qui inclut une fraction du taux départemental.
Cette situation fiscale baroque, qui n’avait pas, à l’époque, était repérée par le législateur, pose, comme vous pouvez l’imaginer, madame la ministre, de sérieux problèmes. D’une part, elle contribue à mettre en difficulté les élus locaux vis-à-vis de leurs concitoyens et, d’autre part, elle affecte l’image de l’intercommunalité. De ce fait, elle fragilise le consentement fiscal en grevant davantage le pouvoir d’achat des familles les plus modestes dans un contexte économique difficile.
Parce que cette situation concerne, à ma connaissance, quelque 1 000 communes en France, dont cinq dans mon département, je souhaiterais savoir, madame la ministre, quelles mesures le Gouvernement entend prendre rapidement afin de la corriger.
Monsieur le sénateur, vous avez soulevé un problème que, en vous appuyant sur le cas de la commune d’Urmatt, vous nous avez permis de bien appréhender. Cela étant, bien d’autres communes connaissent aujourd'hui le même problème et nous en mesurons aujourd’hui les conséquences.
En effet, du fait de la réforme de la taxe professionnelle, l’adhésion de communes isolées à des EPCI à fiscalité additionnelle entraîne une forte majoration des cotisations de taxe d’habitation des contribuables des communes en question.
C’’est bien à la suite de vos interventions, que nous avons entrepris de régler ce problème. Nous travaillons aujourd’hui avec les services de Bercy pour essayer de trouver des solutions à une difficulté générale, que ces communes et leurs habitants sont susceptibles de rencontrer dans le cadre de l’achèvement de la carte intercommunale, la date butoir pour rejoindre une intercommunalité étant, vous l’avez rappelé, celle du 30 juin 2013.
À ce jour, seules 59 communes restent encore isolées, mis à part les cas particuliers que constituent les communes de la petite couronne de Paris et des îles monocommunales maritimes. On pourrait donc penser que le problème est relativement circonscrit.
À la suite du transfert au bloc communal des taux départementaux de taxe d’habitation, des taux de référence de taxe d’habitation communaux et intercommunaux ont dû être calculés pour 2011.
Deux cas de figure se présentent.
Pour les communes membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle, le taux départemental de la taxe d’habitation a été ventilé entre la commune et l’EPCI.
Pour les communes isolées, le taux de la taxe d’habitation pour 2011 a intégré la totalité du taux de taxe d’habitation du département.
Ainsi, lorsqu’une commune isolée intègre un EPCI à fiscalité additionnelle, si chaque niveau de collectivité adopte des taux proches des taux de référence de 2011, la charge fiscale de taxe d’habitation pour le contribuable se trouve alourdie.
Dans ces conditions et parce que, je le répète, nous avons bien mesuré les conséquences de cette situation sur les collectivités, mes services vont travailler avec ceux de Bercy pour trouver une solution.
Il serait utile et opérant de travailler ensemble à l’élaboration d’un amendement qui serait introduit dans le projet de loi de finances pour 2014, car cette situation est effectivement insupportable pour les communes concernées et pour les citoyens qui y résident.

M. Roland Ries. Madame la ministre, je me tiens évidemment à votre disposition pour travailler sur un amendement qui permettrait de résoudre ce problème important pour les communes concernées. Et, bien entendu, je transmettrai votre réponse aux maires du Bas-Rhin – Bas-Rhin « maintenu », si je puis dire !
Sourires.

La conclusion qui s’impose au vu de cette situation est qu’il est indispensable de travailler selon une méthode de « transversalité législative » : le Parlement a en effet voté deux réformes – l’une sur la fiscalité locale, l’autre sur l’achèvement de la constitution des schémas intercommunaux – qui se sont en fait juxtaposées sans que personne, il faut bien le dire, mesure réellement les effets de cette conjonction.

La parole est à M. Hervé Maurey, auteur de la question n° 317, adressée à M. le ministre de l'intérieur.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur les incertitudes et les difficultés que rencontrent les collectivités locales et leurs groupements pour respecter leurs obligations relatives à la sécurité incendie.
Les premières difficultés portent sur la répartition des compétences entre ces collectivités.
En effet, la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a institué la police de la défense extérieure contre l’incendie, rappelant ainsi la responsabilité du maire en matière de lutte contre l’incendie. Cette compétence et le pouvoir de police spéciale qui y est associé sont transférables aux EPCI.
Par ailleurs, les communes ont, dans de nombreux cas, transféré à des EPCI leur compétence en matière de gestion de l’eau sans pour autant transférer leur compétence en matière de lutte contre l’incendie. Or le respect des normes applicables en matière de lutte contre l’incendie, notamment en termes de débit, impose souvent dans les communes rurales un renforcement des réseaux, et cette action est liée à la compétence eau. Il en résulte des difficultés pour les maires responsables de la sécurité incendie quant au respect de leurs obligations en la matière dès lors qu’ils n’exercent plus la compétence de gestion de l’eau.
Une autre source d’incertitudes tient au fait que le volet réglementaire de la réforme relative à la sécurité incendie, engagée voilà près de dix ans, n’est toujours pas parachevé. Or il s’agit d’un volet important puisqu’il doit préciser des normes aussi indispensables que les débits minimaux ou la capacité des réserves d’eau. La publication d’un décret relatif à l’aménagement et d’un référentiel national de défense extérieure a été reportée à plusieurs reprises par vos prédécesseurs. Ces textes sont plus que jamais attendus et réclamés par les associations d’élus.
Je vous rappelle, madame la ministre, que le bureau de l’Association des maires de France avait donné un avis favorable sur le dernier projet de décret présenté par votre prédécesseur.
Le changement de Gouvernement et la modification des périmètres ministériels semblent avoir imposé de nouvelles procédures, allongeant d’autant le retard pris dans la publication de ces textes.
Les élus sont donc contraints soit de différer leurs projets, avec tous les risques qui en résultent en termes de responsabilité, soit, dans un contexte budgétaire particulièrement difficile pour les collectivités, d’engager des travaux que l’on sait coûteux sans avoir la certitude qu’ils ne seront pas obligés de les revoir à terme.
Madame la ministre, pouvez-vous m’indiquer dans quel délai sera pris le décret attendu et quelles seront ses conséquences en termes de charges financières pour les collectivités ? Par ailleurs, quelles sont les mesures qui pourraient être proposées pour répondre aux difficultés que rencontrent les collectivités lorsqu’il y a répartition, pour ne pas dire éclatement, de compétences et de responsabilités en matière de sécurité incendie entre des communes et des EPCI ?
Monsieur le sénateur, le ministre de l’intérieur, Manuel Valls, retenu aujourd'hui à Alger par un sommet des ministres de l’intérieur, m’a demandé de vous assurer, comme il l’a fait lors de sa réponse à une question analogue de votre collègue M. Ambroise Dupont voilà quelques semaines, de sa volonté de mener à bien la réforme de la sécurité incendie, engagée depuis 2005.
En matière de défense extérieure contre l’incendie, un cadre juridique nouveau a été fixé par l’article 77 de la loi du 17 mai 2011. Le décret d’application nécessaire est aujourd’hui prêt. Il a déjà reçu l’avis favorable de tous les organismes consultatifs concernés, en particulier la Commission consultative d’évaluation des normes. Le bureau de l’Association des maires de France a également apporté son soutien à ce projet. Le texte a été déposé devant le Conseil d’État en avril 2012, mais il n’a pu être examiné avant le changement de gouvernement. Comme vous l’avez indiqué, la réorganisation et la définition de nouveaux périmètres de compétences pour les ministères ont sans doute quelque peu retardé la publication du décret en question.
Le ministre de l’intérieur a donc relancé la procédure d’adoption de ce décret dès l’été 2012.
Avant la saisine du Conseil d’État, il était en effet nécessaire d’engager une nouvelle concertation avec les ministères concernés selon les nouveaux périmètres. Cette procédure arrive à son terme et ce décret sera très prochainement – je ne peux pas vous donner de date précise – présenté devant le Conseil d’État. Il pourra alors être rapidement publié.
Par ailleurs, ce décret sera complété par un arrêté définissant le référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie. Il s’agit d’un recueil des solutions techniques à la disposition des acteurs territoriaux.
Sur le fond, la réforme engagée vise, comme vous le souhaitez, à définir plus clairement le rôle des différents acteurs locaux. La défense extérieure contre l’incendie est désormais une compétence transférable aux EPCI, sur la base du volontariat. Il en va de même du pouvoir de police administrative spéciale attaché à cette compétence, qui sera dévolu au président de l’EPCI. Cette compétence requiert des capacités techniques et juridiques complexes, d’où le caractère indispensable de l’arrêté.
Il est en outre nécessaire de mieux distinguer les deux services publics de l’eau potable, d’une part, et de la défense contre l’incendie, d’autre part. La loi et le futur décret organisent cette répartition, notamment en matière de financement. Les interactions juridiques et techniques entre ces deux services seront précisées par le décret et le référentiel national à venir.
Enfin, vous évoquez le problème du dimensionnement des réseaux d’eau potable, notamment en zone rurale. Vous estimez que les normes applicables en matière de défense contre l’incendie imposent un surdimensionnement de ces réseaux. Le ministre de l’intérieur tient à vous indiquer que des solutions techniques permettent de répondre à cette difficulté ; elles seront, bien sûr, privilégiées. La défense contre l’incendie n’est d’ailleurs pas uniquement alimentée par ces réseaux, mais également par des citernes ou des points d’eau naturels.
La réforme impose l’organisation de partenariats plus étroits entre les différents acteurs locaux : les services départementaux d’incendie et de secours, les opérateurs des réseaux d’eau et les collectivités. Le ministre de l’intérieur y travaille selon une méthode à laquelle il est très attaché, celle du dialogue et de la concertation.

Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse et je me réjouis de savoir que le décret sera publié « très prochainement », même si ces adverbes ne permettent pas véritablement de repérer une date sur le calendrier.
En tout cas, ce décret doit effectivement être publié sans tarder. Il est attendu par les élus, et je suppose que les associations d’élus vous le rappellent régulièrement.
Par ailleurs, ce décret ne devra pas imposer trop de normes supplémentaires. Aujourd’hui, tout le monde, y compris le Gouvernement, est conscient de la nécessité d’alléger les normes. Évitons donc tout excès de zèle en la matière. Nous le savons, les élus croulent sous les normes et sous les dépenses qu’elles impliquent, car leur application a un coût.
Il est clair que, dans une période où les collectivités locales, notamment les communes, vont devoir supporter une baisse de leurs dotations, elles risquent de ne pas pouvoir financer des mesures de sécurité incendie trop coûteuses, quand bien même il est évidemment indispensable de pouvoir lutter efficacement contre les incendies.
Enfin, madame la ministre, il faut trouver des solutions pour que l’action d’un maire ne soit pas freinée, lorsqu’il décide des mesures destinées à assurer la sécurité incendie, par le fait qu’il n’a plus de compétences en matière de gestion de l’eau. Sur le terrain, certains maires se heurtent parfois à cette difficulté et ne parviennent pas à obtenir le renforcement des réseaux parce que la compétence en question a été transférée à un syndicat ou à l’EPCI. J’espère que le décret en tiendra compte et sera extrêmement précis sur ce point.

La parole est à M. Philippe Dominati, auteur de la question n° 83, adressée à M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite, par cette question, attirer à nouveau l’attention du Gouvernement sur l’aménagement ou le réaménagement des voies sur berges au cœur de notre capitale.
Sur la rive droite, il s’agit de couper le flux de circulation ; sur la rive gauche, les voies sur berges ont été purement et simplement fermées. Or ces voies connaissaient un trafic automobile de l’ordre de 30 000 véhicules par jour, et jusqu’à 4 000 véhicules par heure. Tous les Parisiens, tous ceux qui sont concernés par l’activité économique de la capitale connaissent ces chiffres.
La première motivation de cet aménagement répond à des raisons de bien-être et d’écologie. Or, dans la pratique, nous enregistrons des pics de pollution depuis la mise en place du dispositif. D’ailleurs, les sondages montrent que 70 % à 80 % des Parisiens sont hostiles à cet aménagement.
Au-delà du souci écologique, il convient de se demander qui paie l’aménagement des voies sur berges ? Or le financement repose sur l’effort unique de la municipalité, alors que ces voies sont empruntées par de très nombreux citoyens franciliens. Leur aménagement devrait donc relever de la compétence de la région.
Je suis partisan d’un aménagement des voies sur berges et des abords du fleuve, comme cela s’est fait dans toutes les grandes capitales européennes ou dans toutes les villes françaises traversées par un fleuve. Il n’est évidemment pas envisageable de conserver l’infrastructure routière qui remonte à près d’un demi-siècle.
Pour autant, cet aménagement doit être conduit dans la concertation, en bonne intelligence. Or la concertation n’a pas eu lieu. Le maire de Paris avait exprimé sa volonté d’aménagement, mais compte tenu de l’insuffisance des études d’impact, le gouvernement Fillon avait purement annulé ce projet ou en avait au moins reporté la mise en œuvre. C’est votre gouvernement qui a autorisé, ou sollicité, l’aménagement des voies sur berges.
Je vous remercie de votre présence parmi nous aujourd’hui, monsieur le ministre. Je vous ai déjà interrogé à plusieurs reprises sur des affaires concernant le Grand Paris. Mais il est vrai que c’est un domaine où les décisions sont prises parfois par le Premier ministre, parfois par le ministre des finances, par exemple en ce qui concerne la taxe spéciale d’équipement.
À la vérité, aujourd’hui, je m’attendais à voir le ministre de l’intérieur me répondre, car Paris est une ville particulière, où les pouvoirs de police du maire – vous avez été maire, vous connaissez donc bien la nature du mandat municipal – sont détenus non pas par le maire de Paris, mais par le préfet de police, et que celui-ci dépend uniquement et strictement du ministre de l’intérieur. Or M. Valls s’est exprimé tout récemment, le 16 février, dans un quotidien parisien – c’est un peu notre quotidien régional à nous – en expliquant, à propos de cet aménagement, qu’il s’agissait d’une aberration !
Monsieur le ministre, qu’a fait le Gouvernement depuis le 16 février ? Que s’est-il passé depuis que le ministre de l’intérieur, patron direct du préfet de police, a déploré la perturbation quotidienne qui résulte pour la capitale de l’aménagement des voies sur berges ? Où en sommes-nous ?
Monsieur le sénateur, je vous remercie d’avoir exprimé votre satisfaction de me voir ici présent et de pouvoir m’interpeller. Sachez que cette satisfaction est réciproque, votre question me donnant l’occasion de pouvoir m’exprimer sur le thème de la mobilité et sur l’ambition que nourrissent différentes villes, dont Paris, de reconquérir les berges du ou des fleuves qui les traversent.
Paris est une ville mondialement reconnue pour son patrimoine, son histoire, sa grandeur. Dès lors, il importe de pouvoir y concilier son image, les différents modes de transport et l’aménagement de l’environnement urbain. Cette finalité est souhaitée par les citoyens et recherchée par la puissance publique.
Comme vous le soulignez, la modernisation des infrastructures doit prendre en compte à la fois les différents usages – qui peuvent entrer en conflit – et la nécessité de faciliter l’accès à un certain nombre de quartiers, tandis qu’une réflexion doit être conduite sur les transports plus vertueux. À cet égard, le fluvial peut, lui aussi, être une source de développement.
Nous n’avons pas fini de réinventer l’usage de la ville et de repenser les modes de transport urbains. De ce point de vue, la capitale est un vrai laboratoire, et je tiens à saluer les initiatives qui sont prises par sa municipalité, par son maire, qui a une vraie vision, qui a l’ambition de redonner toute sa splendeur à cette ville qui est pour nous source de fierté.
Monsieur le sénateur, vous m’interrogez sur les aménagements en cours. Mon intention n’est pas de faire le point sur l’évolution de ce chantier, mais je vous rappelle que la fermeture des quais bas de la rive gauche date du 28 janvier dernier et qu’il est prévu de réaliser un certain nombre d’aménagements flottants. L’ouverture du site au public, à partir de juin 2013, est très attendue : elle donnera une perspective estivale agréable aux visiteurs, mais également aux habitants de Paris, qui pourront bénéficier d’une amélioration de la qualité de leur environnement.
Je tiens à vous signaler, puisque vous avez abordé la question des compétences, que tout ce qui concerne l’aménagement urbain et l’urbanisme relève bien entendu de la Ville de Paris. D’ailleurs, les bords de Seine appartiennent à son réseau. Sur ces sujets, ce n’est donc pas l’État que vous devez interpeller !
En revanche, l’État a la charge de la réglementation, notamment celle de la circulation routière. Dès lors, la préfecture de police est dans son rôle lorsqu’il s’agit de la réglementation.
Vous avez évoqué les conséquences de ces aménagements.
Un certain nombre d’études ont été réalisées. Des sondages et des comptages effectués en temps réel indiquent, par exemple, que la répercussion du réaménagement des berges de la Liane sur les temps de parcours est faible : entre une et trois minutes ; cela dépend évidemment des heures de circulation.
Sur la pollution atmosphérique, vous avez raison de souligner que nous avons beaucoup d’efforts à faire. D'ailleurs, je vous rappelle que la France risque d’être condamnée en manquement en raison de l’inaction de nos prédécesseurs. Pour que l’on ne nous accuse pas de ne pas répondre à nos engagements européens, avec l’ensemble des membres du Gouvernement, Delphine Batho et moi-même sommes en train de mettre en place un véritable dispositif pour l’amélioration de la qualité atmosphérique.
Vous appelez de vos vœux la mutualisation des espaces et des voiries. Dans toutes les agglomérations, les villes-centres sont toutes confrontées au problème d’une voirie qui leur appartient mais qui est empruntée par des usagers habitant hors de leur territoire. Il va de soi que Paris n’échappe pas à phénomène ; c’est même le contraire qui serait surprenant !
Vous dites qu’il s’agit d’un enjeu de voirie régionale. Mais la région n’a pas de compétence routière ni de domaine public routier ! À moins que vous n’amendiez en ce sens le texte sur la décentralisation qui sera bientôt soumis à votre examen… Du reste, vous êtes en deçà de la réalité puisque, à voir qui sont les usagers des voies sur berges, la responsabilité devrait être d’ordre national, voire international !
Les voies concernées relevant du domaine public communal, c’est à la collectivité qu’il appartient de mobiliser la population pour que l’ambition de redonner tout son faste à l’environnement urbain et d’améliorer la qualité du cadre de vie parisien devienne un objectif partagé.
Monsieur Dominati, je ne doute pas que, dans quelques semaines, vous assisterez à l’inauguration de ces aménagements et que vous applaudirez avec le public, qui sera enthousiasmé par cette transformation qui va dans le sens d’une reconquête de la ville.
M. André Gattolin applaudit.

M. Philippe Dominati. Monsieur le ministre, je vous ai posé une question précise, à laquelle j’attendais une réponse précise. Au lieu de cela, vous me donnez l’impression de lire la plaquette de présentation du maire de Paris !
Sourires.

Vous me dites que ce dernier a une vision, qu’il a une ambition. Il a surtout l’ambition de partir à la retraite, lui qui est en poste depuis douze ans, puisque nous savons qu’il ne va pas se représenter.
M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué. Méfiez-vous ! Ne le poussez pas trop !
Nouveaux sourires.

Je vous pose une question précise, et vous semblez presque me lire un programme électoral… Monsieur le ministre, étant tous deux engagés en politique, nous savons tous deux ce qu’il en est !
Vous ne l’ignorez pas, la région d’Île-de-France investit dans des infrastructures routières : on couvre le périphérique, on couvre des voies d’autoroute dans des départements limitrophes de Paris et, à cinquante mètres de Notre-Dame, on ne serait pas capable à la fois d’aménager le site et de préserver l’activité économique de la capitale en aménageant des voies rapides couvertes ? On fait un projet « à l’économie » ! Certes la somme en jeu n’est pas négligeable, mais elle n’est rien au regard des 2, 5 kilomètres à aménager de part et d’autre du fleuve !
L’État devrait intervenir. Vous affirmez qu’il n’en a pas les pouvoirs. Pourtant, vous disposez bien du pouvoir de réglementation ! De surcroît, dans ses pouvoirs de police, le préfet relève bien du ministre de l’intérieur. Et celui-ci fait une grande déclaration dans un journal parisien pour critiquer cet aménagement. Depuis, qu’a fait le Gouvernement ? Rien !
Vous me parlez d’aménagements flottants, de remise en valeur de la Seine. Mais, à peine élu, il y a douze ans, le maire de Paris avait déjà dit qu’il s’attaquerait à l’axe de la Seine.

Et, il y a encore plus longtemps, quand M. Huchon est arrivé à la tête de la région, lui aussi a promis de s’occuper de la Seine. Une société mixte a même été créée à cette fin. Elle a fait faillite il y a un an et nous sommes aujourd'hui obligés de la renflouer !

… et vous me parlez d’une ambition nouvelle !
Monsieur le ministre, il n’y a pas que les aménagements qui soient flottants : la position du Gouvernement sur le sujet l’est tout autant ! §
Il ne sert à rien que le ministre de l’intérieur fasse semblant de critiquer le projet dans la presse en disant que l’activité économique est en danger à Paris si un autre membre du Gouvernement nous invite à l’inauguration et nous promet que nous serons ravis ! Non, monsieur le ministre, je ne suis pas ravi, et les Parisiens ne le sont pas non plus !

Prenez une position ferme et faites entendre votre voix sur les sujets parisiens, dont je sais qu’ils vous intéressent. Vous qui avez été élu local, ne laissez pas les choses se faire au petit bonheur la chance, à un an des élections, alors que la majorité municipale est en place depuis douze ans !

La parole est à M. Antoine Lefèvre, auteur de la question n° 181, adressée à M. le ministre du redressement productif.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la raréfaction des énergies fossiles implique que les différents acteurs, aussi bien l’État que les entreprises et les particuliers, se préparent à changer d’habitudes et de comportement, en particulier dans le domaine du transport individuel.
C’est dans ce contexte de mutation et de difficultés de l’industrie automobile classique que, voilà tout juste un mois, le 83e salon de l’automobile de Genève ouvrait ses portes.
Force est de constater que l’industrie automobile est enfin entrée dans le tourbillon de l’électrique : de nombreuses marques proposent des modèles, essentiellement de petite taille, à commencer par Renault, avec la Zoé. Certes, il convient, dans le même temps, d’évoquer le dépôt de bilan annoncé hier par Heuliez, qui n’a pas pu, en 2012, écouler plus de 700 de ses véhicules électriques Mia.
En 2012, 5 660 véhicules électriques ont été vendus, représentant 0, 3 % du marché français, et jusqu’à 1, 75 % si l’on inclut les voitures hybrides, soit tout de même deux fois plus qu’en 2011. Mais, dans l’ensemble de l’Europe de l’Ouest, ce ne sont que 24 203 véhicules complexes électriques qui ont été commercialisés, soit 0, 21 % du total des ventes. Or la flotte de véhicules européenne est très ancienne et son renouvellement, eu égard à la lutte contre les émissions de CO2, devient urgent.
Malgré les mesures prises pour relancer les ventes de voitures par le biais de primes à l’achat de véhicules hybrides et électriques, dont la production devra être localisée en France, la demande ne semble pas encore être au rendez-vous.
Alors même que la prise de conscience d’une nécessaire nouvelle approche du transport se fait jour, à l’heure de la hausse continuelle des prix du carburant et aux préoccupations économiques et écologiques partagées par tout un chacun, quelles sont les causes de ce peu d’appétence pour le combustible alternatif qu’est l’électrique ? S’agit-il des problèmes d’autonomie, du prix d’achat du véhicule, des frais de réparation et d’entretien, de l’achat ou de la location des batteries ? S’agit-il du faible nombre de bornes, le risque de panne par manque de bornes de recharge étant régulièrement évoqué ?
À propos des bornes, il faut bien remarquer que celles qui sont d’ores et déjà installées le sont essentiellement en milieu urbain. La recharge ne pouvant se faire que sur des bornes dédiées ou via des prises spécifiques installées chez le particulier, le plein d’énergie demande près d’une heure sur une borne publique, mais six à sept heures à domicile ! Il n’existerait que 1 473 bornes sur notre territoire, dont beaucoup sont en panne ou peu opérationnelles. Mon département de l’Aisne n’en compterait même pas du tout !
Réagissant au très faible niveau de vente des premiers modèles enregistré en 2012, les constructeurs déplorent le manque de bornes, qui pourrait expliquer ces débuts difficiles. Comment l’objectif, fixé en 2009, de 400 000 bornes pour 2020, pourra-t-il être atteint, alors même que les prévisions tablent sur à peine 3 000 bornes en accès public par an ?
Il convient donc que les États, les villes et les constructeurs coopèrent afin que les infrastructures nécessaires soient mises en place. Alors même que le véhicule électrique représente un vaste marché, sur lequel le Gouvernement a parié en faisant de sa construction une priorité, il ne faudrait pas que l’offre faite aux consommateurs voie sa diffusion freinée par manque d’alimentation.
Si la France paraît actuellement faire figure de proue dans le développement de l’électrique, il est bien évident que des coûts d’usage et de maintenance inférieurs à ceux des véhicules thermiques seront les déclencheurs d’une utilisation de masse du véhicule électrique. C’est ainsi que nous relèverons ce défi !
Monsieur le ministre, pouvez-vous dresser un état des lieux des mesures de déploiement des bornes dédiées, au-delà du plan automobile présenté en juillet 2012 et du lancement de la mission Hirtzman le 3 octobre dernier ? Pouvez-vous également nous faire connaître la position du Gouvernement sur la situation d’Heuliez ?
Monsieur le sénateur, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser l’absence du ministre du redressement productif, retenu ce matin par le comité stratégique de la filière mode et luxe, à Paris.
Avec le plan automobile présenté le 25 juillet 2012, le Gouvernement s’est vigoureusement engagé pour promouvoir le véhicule électrique.
L’État et ses opérateurs montrent ainsi l’exemple en consacrant 25 % des achats de véhicules aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables, cette part étant portée à 100 % pour les véhicules urbains.
Le développement du marché des véhicules électriques a été accéléré, en augmentant de 2 000 euros le bonus pour l’achat d’un véhicule électrique, qui a été porté à 7 000 euros.
Les premiers résultats de cette politique ambitieuse sont d'ores et déjà perceptibles : dans un marché automobile français malheureusement en baisse de près de 14 %, les ventes de véhicules électriques ont vu leurs ventes multipliées par deux, qu’il s’agisse des véhicules particuliers ou des camionnettes, qui totalisent respectivement 5 663 et 3 651 unités vendues l’an dernier, contre 2 630 et 1 683 en 2011. Sur les deux premiers mois de l’année 2013, 898 véhicules particuliers et 874 véhicules utilitaires légers électriques ont été immatriculés, soit 1 772 au total, confirmant la progression de 2012. Cette croissance devrait se prolonger, portée par l’arrivée de nouveaux modèles de Renault – Zoé – et PSA –Berlingo et Partner.
Par ailleurs, pour accompagner les initiatives des collectivités territoriales, auxquelles les lois Grenelle ont confié la compétence pour le déploiement d’infrastructures de recharge, l’État a lancé en janvier 2013 un nouvel appel à manifestation d’intérêt, doté de 50 millions d’euros sur les fonds du programme d’investissements d’avenir, et ouvert à toutes les régions, départements, groupements de villes et communautés d’agglomération de plus de 200 000 habitants pour implanter davantage de bornes de recharge ouvertes au public.
Au 1er avril 2013, ce sont 6 500 prises de recharge qui sont implantées en France, contre 1 800 en juillet 2012.
Les premiers projets régionaux ou départementaux sont en cours de formalisation. Ils laissent espérer l’installation de 8 000 prises de recharge avant la fin de l’année.
Nous souhaitons, vous le savez bien, accélérer le développement de ces initiatives et sommes fortement mobilisés pour que ces résultats soient encore plus spectaculaires en 2013. Nous y travaillons avec l’ensemble des acteurs publics et privés.

Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse, bien qu’elle ne me satisfasse pas totalement.
J’ai élaboré ma question voilà six mois mais elle reste d’une brûlante actualité. Entre-temps, le 6 février dernier, s’est tenue une réunion à la Caisse des dépôts et consignations autour du coordinateur du réseau des infrastructures de charge et de la responsable du programme « véhicule électrique du futur » de l’ADEME. Son objectif, vous l’avez rappelé, était de présenter aux collectivités locales les dispositifs de déploiement des infrastructures de recharge.
L’aide de 50 millions d’euros que vous avez évoquée a été mise en œuvre et se révèle bienvenue. Elle est de 50 % pour les bornes à charge normale et de seulement 30 % pour les charges rapides. Pourtant, ce sont ces dernières qui seraient les plus efficaces sur le domaine public.
Enfin, n’a pas été abordée la question cruciale de l’incapacité des constructeurs européens de s’entendre sur un standard de recharge commun. Je vous demande de bien vouloir transmettre ce message à M. Montebourg, afin qu’il relaye ces inquiétudes auprès de Bruxelles, dans la perspective d’une uniformisation à laquelle la Commission doit, me semble-t-il, réfléchir.
Il paraît en effet que la recommandation s’oriente vers la prise allemande de « type 2 », qui est interdite en France pour des raisons de sécurité, liées à l’obligation d’obturateur.
L’avancement de ce dossier est donc loin d’avoir trouvé sa vitesse de croisière. Je compte sur l’action du Gouvernement pour aider au déploiement envisagé.

La parole est à M. Francis Grignon, auteur de la question n° 412, adressée à Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion.

Monsieur le ministre, cette question va peut-être vous paraître d’un intérêt très local.
Président, depuis vingt-cinq ans, du conseil de surveillance d’un hôpital psychiatrique situé dans une ville moyenne de 10 000 habitants, je considère comme une chance le fait que nous ayons pu, avec la municipalité et de nombreuses associations, réaliser plus de 140 logements permettant aux personnes handicapées de ne pas rester à l’hôpital et de continuer à vivre dans la société civile.
J’ai donc été très ému quand j’ai appris qu’était envisagée la suppression des aides financières extra-légales pour les personnes bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés, l’AAH.
En effet, il semblerait que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ait décidé de supprimer les aides financières à compter du mois de juillet 2013 pour les personnes titulaires de l’AAH, aides qui sont destinées à apporter un soutien dans la vie courante de ces personnes : aide ménagère, aide aux courses, etc.
Cette décision aurait de nombreuses conséquences aussi bien pour les usagers que, en termes financiers, pour les associations.
Les associations qui prennent en charge des personnes présentant des troubles psychiques dans le cadre de la réinsertion par le logement proposent un service d’aide ménagère permettant de les maintenir à domicile, ce qui évite souvent les réhospitalisations.
La suppression de ces aides fragiliserait un peu plus ces personnes pour qui le handicap psychique est une difficulté dans le maintien de l’autonomie. Cette perte risque d’accentuer leur isolement social. À terme, ces personnes ne pourront pas être maintenues à domicile ; elles risquent de rechuter et d’être réhospitalisées.
Le coût de ces réhospitalisations sera bien évidemment supérieur à celui des aides dont elles bénéficiaient jusqu’à maintenant.
En outre, ces associations, qui n’auront plus les financements nécessaires, devront éventuellement licencier une partie de leur personnel.
Je souhaiterais donc savoir, monsieur le ministre, si le Gouvernement entend maintenir la suppression de ces aides financières extra-légales pour les personnes bénéficiant de l’AAH.
Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser Mme la ministre déléguée chargée des personnes handicapées, qui, dans l’impossibilité d’être présente ce matin, m’a demandé de vous répondre.
Je tiens tout d’abord à préciser que les aides extra-légales que les caisses primaires d’assurance maladie dispensent relèvent de leur action sanitaire et sociale et sont, à ce titre, de la compétence locale.
Le Gouvernement ne supprime en aucun cas des aides qu’il n’a pas la charge d’accorder ni de cibler.
L’amélioration de l’accès aux soins de tous, en particulier des personnes handicapées, est au cœur de l’action gouvernementale. Elle s’est traduite dans les faits par l’augmentation de 7 % du plafond de l’éligibilité à l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, inscrite dans le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté. Cette augmentation permettra, à terme, de couvrir 750 000 personnes de plus par la couverture maladie universelle complémentaire, la CMU-C, et l'aide à la complémentaire santé, l’ACS. Parmi ces 750 000 personnes, au moins 100 000 sont aujourd’hui bénéficiaires de l’AAH et pourront ainsi bénéficier d’une aide supplémentaire à l’accès aux soins.
À cet égard, l’initiative de la CPAM du Bas-Rhin s’inscrit dans la ligne que le Président de la République a fixée de « généralisation de la couverture complémentaire à tous les Français » lors du congrès de la mutualité d’octobre 2012. Elle complète, en quelque sorte, la mesure nationale du plan de lutte contre la pauvreté en majorant, via des aides extra-légales, le soutien financier apporté aux bénéficiaires de l’ACS et de la CMU-C.
Les personnes handicapées sont aujourd’hui plus nombreuses à bénéficier d’une complémentaire santé. Le Gouvernement reste par ailleurs extrêmement attentif à ce que l’accès aux soins, à la fois pour la santé et l’aide à la vie quotidienne des personnes handicapées s’améliore, dans le cadre du droit commun.
La CPAM du Bas-Rhin a veillé à appliquer un temps de transition dans le « reciblage » de ses aides extralégales en faveur d’une généralisation de la mutualisation, qui couvrira aussi les bénéficiaires de l’AAH. Par ailleurs, ces derniers peuvent cumuler l’AAH avec la prestation de compensation du handicap, la PCH, que leur handicap soit psychique ou non. Nous serons très attentifs à ce que la qualité de prise en charge ne diminue pas pour ces personnes.

Vous dites que les aides dépendent de la caisse primaire d’assurance maladie locale et non du Gouvernement. Certes, mais toutes les aides qui relèvent du domaine social se retrouveront dans le domaine sanitaire, qui relève bien, lui, du Gouvernement. Il faut donc bien veiller à maintenir un équilibre en la matière.

La parole est à M. Alain Gournac, auteur de la question n° 328, adressée à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Madame la ministre, un bruit, qui n’était pas celui d’une bûche dans l’âtre, est parvenu à mes oreilles, un bruit selon lequel il serait désormais interdit aux Français de faire ce que mon père appelait une « flambée », autour de laquelle la famille se retrouvait…
J’observe un vif émoi chez les Franciliens, je rencontre des habitants du Pecq, ville dont je fus longtemps maire, qui m’interpellent : « Est-il vrai, monsieur le sénateur, que l’on va nous empêcher de faire des feux dans nos cheminées à partir de 2015 ? » Bien sûr, j’émets les plus grands doutes, mais je les assure que, faute d’éléments d’information précis, je me renseignerai.
Voilà pourquoi, aujourd'hui, madame la ministre, je m’adresse à vous : pour obtenir ces informations.
Croyez-moi, au moment où l’on met tous les repères par terre, beaucoup de Français, dans mon département ou ailleurs, veulent acheter une maison avec une cheminée ; et s’il n’y en a pas, la première chose qu’ils font en prenant possession de leur maison est d’en faire installer une. Alors, allez donc leur expliquer qu’ils n’auront plus le droit, à partir de 2015, de faire un feu de cheminée à « foyer ouvert », que seuls les feux de cheminée à « foyer fermé » seront autorisés !
Madame la ministre, franchement, où est le danger de la « flambée » ? Comme moi, les Français ne comprennent pas pourquoi le Gouvernement veut leur interdire ce petit plaisir qu’ils s’accordent à la saison froide ou lorsque les nuits sont encore fraîches.
En tant que modeste législateur, je me demande comment mes engagements pourront être crédibles si je dois annoncer à mes concitoyens qu’ils ne pourront plus faire de feux de cheminée et que la famille devra désormais se rassembler autour du radiateur électrique ! §Cela me paraît aberrant !
Bien sûr, je souhaite que la santé publique soit préservée. Mais croyez-vous vraiment que les particules qui s’échappent d’une cheminée nuisent de manière si décisive à notre santé ?
Enfin, cette interdiction a été décidée en catimini, sans aucune publicité ; je lis toute sorte de documents, et je n’en ai trouvé trace nulle part. Ce n’est pas correct ! Il faut respecter les Français !
Madame la ministre, je sais que vous êtes très attentive à tout cela. Par conséquent, j’écouterai votre réponse avec beaucoup d’intérêt.
Monsieur le sénateur, je veux vous répondre de la façon la plus franche.
Bien sûr, tout le monde apprécie un feu de bois dans la cheminée, mais il se trouve que 60 % de la population de notre pays est exposée à une qualité de l’air dégradée, dont les effets sur la santé sont désormais avérés : irritations, allergies, asthme, insuffisances respiratoires graves, maladies cardio-vasculaires, accidents vasculaires cérébraux, cancers…
Selon une étude de la Commission européenne, la pollution par les particules serait à l’origine d’environ 42 000 décès prématurés par an en France.
En outre, notre pays accuse un retard important dans le respect de la directive européenne sur la qualité de l’air de 1996. Nous sommes sous la menace d’une condamnation lourde de la Commission européenne.
C’est un fait : les vieux appareils de chauffage au bois et les foyers ouverts sont fortement émetteurs de particules. Les flambées dans les foyers ouverts représentent ainsi 27 % des émissions de particules dans l’air en Île-de-France.
Il y a là des leviers importants pour réduire significativement ces émissions, sans perte de confort. Je rappelle qu’un foyer ouvert émet six à huit fois plus de particules qu’un foyer fermé à l’aide d’un insert. Une chaudière à bois émet jusqu’à quinze fois moins de particules qu’une cheminée ouverte.
Voilà pourquoi les services de l’État en charge de l’élaboration du plan de protection de l’atmosphère pour l’Île-de-France ont proposé, après concertation – car il y a eu concertation, monsieur le sénateur –, des mesures visant à limiter les émissions de particules dues aux équipements de combustion individuels du bois. Ce plan, approuvé par arrêté interpréfectoral le 25 mars 2013, prévoit ainsi l’interdiction totale de l’utilisation des foyers ouverts à compter du 1er janvier 2015 en zone sensible.
Je vous signale que le préfet de région d’Île-de-France avait déjà interdit, en 2007, l’utilisation des foyers ouverts, sauf pour l’appoint et l’agrément.
À Paris, la combustion du bois sera totalement interdite, sauf dérogation par arrêté préfectoral. Dans la zone sensible, hors Paris, seront autorisées les cheminées à foyer fermé par un insert ou un poêle performant, c’est-à-dire doté d’un bon rendement énergétique, ce que l’on appelle « qualité flamme verte ».
Le remplacement des équipements de plus de quinze ans par des installations performantes sera recommandé et encouragé.
J’ajoute que ces mesures ont été discutées dans le cadre du Conseil national de l’air et ont fait l’objet d’une ample concertation avec l’ensemble des associations et des partenaires de la politique de l’État en matière d’amélioration de la qualité de l’air.

Madame la ministre, j’apprécie votre franchise. Cette qualité est importante pour répondre à ce genre de questions.
Pourriez-vous demander à vos services de rédiger une brève note pour expliquer cela à mes Alpicois et aux habitants de nos campagnes des Yvelines. Sinon, ils vont se dire que leur sénateur est fou ! §
Bien sûr, il va falloir aussi mettre en place une police des foyers ouverts, chargée de surveiller les toits et de vérifier que la fumée sortant des cheminées est bien verte ! §
Moi, madame la ministre, je proteste !
Je ne conteste pas du tout la nécessité de protéger la santé de nos concitoyens, mais sincèrement il est aussi important de pouvoir se retrouver en famille, que ce soit à la campagne ou près de Paris, autour d’une flambée. Dans la famille Gournac, c’était comme ça ! Et ce n’est pas vraiment pour se chauffer qu’on fait un feu dans la cheminée, d’autant que, la plupart du temps, l’habitation possède un vrai système de chauffage !
Décidément, je trouve tout à fait déplaisante cette idée de supprimer le droit de faire du feu dans la cheminée. On ne peut pas continuer à revenir ainsi sur tous nos repères, notre mode de vie. Après s’en être pris au camembert au lait cru, qui ne présentait pas, paraît-il, toutes les garanties d’hygiène, voilà qu’on s’en prend aux bûches qui flambent dans les cheminées ! Les Français perdent pied et ne croient plus du tout que les politiques soient capables de prendre les bonnes décisions.
Madame la ministre, je sens que vous brûlez d’envie de répondre à ma réponse, mais je ne suis pas sûr, monsieur le président, que notre règlement le permette… §

M. le président. Madame la ministre, si vous le souhaitez, je peux vous redonner la parole, pour un retour de flamme !
Nouveaux sourires.
Je ne veux pas déroger au règlement du Sénat, mais puisque vous m’y autorisez, monsieur le président…
Je comprends parfaitement ce que vous dites, monsieur le sénateur, mais nombre d’habitants de l’Île-de-France sont préoccupés par les problèmes de pollution, notamment par les bronchiolites des enfants. Il faut donc faire un véritable travail de pédagogie sur cette question.
Grâce à cette mesure, les émissions de particules du secteur résidentiel pourraient être très sensiblement réduites. Il s’agit donc d’une mesure efficace.
Si elle ne doit entrer en application qu’en 2015 et non en 2013, c’est précisément pour nous laisser le temps de fournir des explications et de mettre en œuvre des mesures d’accompagnement. Ainsi, le remplacement d’un foyer ouvert par un foyer fermé de même que les évolutions que j’ai évoquées concernant les poêles à bois seront éligibles au crédit d’impôt développement durable.

La parole est à M. André Gattolin, auteur de la question n° 352, adressée à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Madame la ministre, la pollution de l’air est un sujet majeur de santé publique, comme vous venez de l’indiquer. Différentes études scientifiques, dont celle de l’Organisation mondiale de la santé, montrent qu’elle est la cause directe ou indirecte de 42 000 décès par an en France.
Face à ce fléau qui ne cesse de prendre de l’ampleur, différentes mesures ont été prises. Ainsi sont nés en 1998 les plans de protection de l’atmosphère, déclinaison française de dispositions européennes concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant.
Vous-même avez déclaré vouloir prendre des mesures permettant de limiter la circulation des automobiles en cas de pic de pollution. Or, quelles que soient les dispositions existantes ou à venir, elles s’appuient toutes sur la mesure de la qualité de l’air. Cette mesure repose actuellement sur un réseau national de surveillance de la qualité de l’air composé d’associations indépendantes.
Dans la région d’Île-de-France, par exemple, c’est l’Association de surveillance de la qualité de l’air en Île-de-France, Airparif, qui est chargée de cette surveillance. Cette structure, comme ses homologues des autres régions, permet d’avoir une information quotidienne sur l’état de l’air et de prendre ainsi les mesures nécessaires à la protection de nos concitoyens.
Dans les Hauts-de-Seine, département où je suis élu, AIRPARIF dispose actuellement de cinq stations de mesure. Récemment, la municipalité d’Issy-les-Moulineaux a déclaré ne plus vouloir de station de mesure sur son territoire. La cause de cette décision semble tenir à l’image négative donnée par l’existence d’un tel équipement ou, en tout cas, par les résultats qu’il produit. Dans le même temps, le conseil général des Hauts-de-Seine a décidé de ne plus verser les 80 000 euros de subvention annuelle qu’il attribuait à AIRPARIF, prétextant des contraintes budgétaires liées au gel des dotations de l’État et estimant également que sa contribution financière n’était pas déterminante.
Madame la ministre, si ces comportements sont suivis par d’autres collectivités locales, toute politique de protection de l’atmosphère pourrait être vouée à l’échec. Pourtant, il serait important pour la santé de nos concitoyens que, dans les villes de plus de 50 000 habitants ou de taille plus réduite mais abritant sur leur territoire des installations industrielles ou situées dans une zone de trafic routier intense, il soit impossible pour les élus locaux de s’opposer à l’installation d’une station de mesure de la qualité de l’air.
Compte tenu des positions récemment adoptées par certaines collectivités locales, quelles dispositions comptez-vous prendre, madame la ministre, afin d’éviter que l’ensemble du système de mesure de la pollution de l’air ne soit remis en cause pour des raisons budgétaires ou… tactiques ? Est-il possible de concevoir l’obligation d’une garantie pluriannuelle de financement ?
Enfin, n’est-il pas nécessaire d’imposer aux villes refusant la présence de stations de mesure de la qualité de l’air sur leur territoire, afin de ne pas avoir un « thermomètre » permettant de constater une pollution trop élevée dans leurs rues, l’installation et le maintien de telles stations ?
Monsieur le sénateur, la pollution de l’air est en effet un enjeu de santé publique majeur. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé d’augmenter le budget destiné à financer les actions d’amélioration de la qualité de l’air de 18 % en 2013, notamment le budget des associations, ce qui, dans un contexte budgétaire contraint, est un effort significatif.
En outre, j’ai présenté, le 6 février dernier, un plan d’urgence pour la qualité de l’air prévoyant un certain nombre de mesures d’ordre public environnemental.
La mesure en continu de la qualité de l’air est bien sûr un outil indispensable à la politique de l’État et des collectivités. Le réseau de stations de surveillance fixes ou mobiles doit respecter des critères stricts, qui sont fixés par les directives européennes.
En France, ce sont les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air, auxquelles je rends hommage, comme Airparif en Île-de-France, qui sont chargées, pour le compte de l’État et des pouvoirs publics, de la mise en œuvre des moyens de surveillance et de l’information du public en cas de dépassement des seuils de pollution, ce qui est arrivé assez fréquemment depuis le début de l’année.
Depuis plusieurs années, le Laboratoire central de surveillance de la qualité de l’air vérifie que le réseau national est bien maillé et conforme à la directive européenne.
Les dernières expertises menées en 2011 et 2012 ont établi qu’il existait suffisamment de stations de mesure fixes en France, mais qu’il pourrait être utile de développer des stations de mesure mobiles.
Comme vous le savez, monsieur le sénateur, les stations fixes sont généralement situées sur le domaine public et sont donc soumises à autorisation de la collectivité territoriale concernée.
Vous évoquez la station d’Issy-les-Moulineaux, exploitée par Airparif depuis 1991. La ville d’Issy-les-Moulineaux a souhaité disposer des lieux en 2009, et la convention de mise à disposition du local n’a pas été reconduite par la communauté d’agglomération Arc de Seine, devenue Grand Paris Seine Ouest.
La communauté a lancé une procédure de contentieux à l’égard d’Airparif, qui s’est vu assigner pour occupation illégale par le tribunal administratif de Cergy et mis en demeure avec astreinte journalière. Airparif a donc décidé d’opter pour un autre emplacement.
D’autres communes des Hauts-de-Seine ont émis le souhait d’accueillir la station, comme Clamart, mais le choix final pourrait se situer dans le 15e arrondissement, à proximité d’Issy-les-Moulineaux, dans une configuration similaire.
La station d’Issy-les-Moulineaux sera fermée en 2013, et, dans l’attente d’une solution nouvelle, la surveillance de la qualité de l’air sera assurée dans cette zone grâce à la complémentarité entre les stations de mesure et la modélisation permettant d’évaluer la pollution en tout point du territoire.
Quant au financement des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air, il est régi par le code de l’environnement, qui prévoit un financement tripartite : subventions de l’État et des collectivités, contributions des industriels.
Le soutien de l’État a été constant. L’augmentation, depuis 2010, de la quotité de certains polluants de la TGAP – taxe générale sur les activités polluantes – que les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air peuvent récupérer en partie sous forme de dons des industriels, leur permet de voir leur budget s’accroître sensiblement.
Mais l’État ne peut en aucun cas imposer aux acteurs locaux ni leur adhésion aux associations agréées de surveillance de la qualité de l’air ni leur financement.
Je regrette profondément le retrait du conseil général des Hauts-de-Seine, département dense de la zone sensible de qualité de l’air en Île-de-France, alors que l’ensemble des autres départements franciliens contribuent au financement d’Airparif, qui remplit des missions de service public.
Je rappelle que, pour les Franciliens, la pollution atmosphérique dans leur région est un sujet de préoccupation majeur.
Je note que le département des Hauts-de-Seine a également supprimé sa subvention à Bruitparif, qui est un outil régional d’aide dans la mise en place des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit.
Soyez assuré, monsieur le sénateur, que je resterai très attentive à ce que la pérennité des moyens d’Airparif soit garantie, malgré la décision du conseil général des Hauts-de-Seine.

Je vous remercie de votre réponse très précise et très détaillée, madame la ministre. J’en profite pour saluer mon collègue Philippe Kaltenbach, maire de Clamart, qui a accepté l’installation d’une station de mesure Airparif dans sa commune.
En tant que statisticien de formation, je sais que, pour que des mesures soient véritablement pertinentes dans la durée, on ne peut pas se permettre de modifier un échantillonnage, même si le rôle des modélisations est extrêmement important.
Plus il y aura de stations de mesure, plus les mesures seront fines et précises et permettront une meilleure prévention et une alerte plus rapide de nos concitoyens.
Cela étant dit, il est inquiétant que des collectivités territoriales se désengagent de ce réseau de surveillance au motif que les informations qu’ils fournissent sont alarmantes pour des municipalités vantant la qualité de vie sur leur territoire.
Trois sources de financement, vous l’avez rappelé, contribuent donc au budget du réseau français : l’État, principalement, les collectivités locales et les industriels. En la matière, il me semblerait intéressant d’innover. Le réseau de surveillance de l’air en France, qui est de bonne qualité, est très loin d’atteindre la capacité, la précision et le niveau de développement du système analogue existant en Allemagne, lequel est beaucoup plus réactif.
En décembre dernier, lors de l’installation du comité pour la fiscalité écologique, vous constatiez que la France était avant-dernière en Europe en matière de fiscalité environnementale et qu’il était nécessaire, autant que faire se peut, d’établir un lien concret et direct entre l’affectation du produit de cette fiscalité et l’action environnementale.
Je pense qu’il serait intéressant, pour financer la surveillance de l’air, d’étudier deux sources nouvelles de financement répondant toutes les deux au principe du pollueur-payeur et ne créant pas de nouvel impôt. Il devrait être possible, en premier lieu, qu’une part de la TGAP soit reversée de manière fixe aux organismes français de contrôle de l’air, en second lieu, qu’une fraction de quelques centimes d’euros de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, l’ancienne TIPP, soit affectée au réseau de mesure de la qualité de l’air.
En tout cas, il faudra trouver une façon, un jour ou l’autre, de rendre obligatoire l’installation de capteurs de mesure de la qualité de l’air dans les communes sensibles ou très sensibles afin d’éviter que, dans les mois ou les semaines à venir, de nouvelles communes se désengagent du réseau de surveillance.

La parole est à M. Daniel Reiner, auteur de la question n° 335, adressée à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé.

Madame la ministre, ma question initiale, qui date de janvier 2013, visait à attirer votre attention sur les délais d’inscription de l’usine Solvay de Dombasle-sur-Meurthe sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, ou CAATA. Cette entreprise, située dans la vallée de la chimie de la Meurthe, est l’une des deux dernières soudières existant en France, la seconde se trouvant à quelques kilomètres de là.
Après un refus du tribunal administratif en 2007, cette inscription a été demandée le 1er octobre 2012 par la cour administrative d’appel de Nancy, au vu du nombre de salariés exposés à l’amiante et de la durée de leur exposition.
Je rappelle tout de même que, à ce jour, on dénombre dans cette entreprise quatre décès imputables à l’amiante et trente-huit salariés atteints de pathologies liées à leur exposition à ce minéral. L’utilisation de ce matériau n’a définitivement cessé qu’en 1997, après trente années de manipulation par des centaines de salariés.
À la suite de la décision de la cour administrative d’appel de Nancy, le ministère du travail et de l’emploi – pas le vôtre, donc, madame la ministre – a décidé de se pourvoir devant le Conseil d’État. Je ne vous cacherai pas, madame la ministre, que cette décision est apparue assez peu compréhensible aux yeux de la centaine de salariés concernés, alors même que l’entreprise elle-même – son dirigeant me l’avait fait savoir – n’avait pas souhaité faire appel de cette décision.
Depuis que je l’ai déposée, ma question a trouvé une réponse partielle puisqu’un arrêté de votre ministère, en date du 6 février 2013, a inscrit cette entreprise sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif CAATA. Pourtant, cet arrêté ne satisfait personne puisqu’il prend comme période de référence les années allant de 1966 à 1990, et non pas jusqu’à 1997, ce qui était demandé par les salariés, la cour d’appel de Nancy et la commission des accidents du travail et maladies professionnelles, sollicitée pour avis par le ministère.
Aussi, une question demeure : pourquoi l’arrêté ne prend-il pas en compte la totalité de la période, alors même que la commission des accidents du travail et maladies professionnelles le conseillait ? Cinquante salariés sont concernés pour ces sept années et, dans l’état actuel de l’arrêté, il leur sera impossible de profiter du dispositif de cessation anticipée d’activité.
On le sait, l’amiante provoque en France plus de 3 000 décès par an. Il importe, pour les 130 salariés de l’entreprise Solvay exposés à l’amiante de 1966 à 1997, que l’État leur accorde la retraite anticipée à laquelle ils ont droit, reconnaissant ainsi que l’emploi qu’ils ont occupé durant des dizaines d’années comportait un risque auquel ils ont été exposés sans protection.
Je souhaiterais que vous puissiez m’indiquer, madame la ministre, les mesures que vous entendez prendre pour reconnaître ce préjudice sur la totalité de la période d’exposition.
Monsieur le sénateur, l’établissement Solvay, situé à Dombasle-sur-Meurthe, a été inscrit sur la liste des entreprises qui ouvre droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité pour les travailleurs de l’amiante par un arrêté du 6 février 2013, paru au Journal officiel le 13 février 2013.
Vous me demandez, d’abord, pourquoi la période d’inscription retenue s’étend de 1966 à 1990 et non pas au-delà. La raison est la suivante : c’est en 1990 qu’a pris fin l’activité de confection de diaphragmes à base d’amiante, qui se déroulait dans le cadre d’une unité d’électrolyse destinée à la fabrication de chlore. Cette information n’a été portée à la connaissance du ministère du travail qu’après la tenue de la commission des accidents du travail et maladies professionnelles de la CNAMTS. C’est ce qui explique que le projet d’arrêté soumis à cette commission ne comportait pas, initialement, la limite de l’année 1990.
Par ailleurs, vous mentionnez le recours engagé par le ministère du travail contre l’arrêt de la cour d’appel administrative de Nancy.
Selon la jurisprudence du Conseil d’État, seuls les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l’amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté une part significative de leur activité peuvent être inscrits sur la liste ouvrant droit à cette allocation. Or il ressort des pièces du dossier que ces conditions n’étaient pas remplies dans l’établissement de Dombasle-sur-Meurthe. C’est pourquoi le ministère du travail s’est pourvu contre la décision de la cour administrative d’appel de Nancy. En effet, celle-ci a retenu une proportion de salariés exposés entre 9 % et 12 % du total des effectifs sur la période d’exposition, ce qui est bien inférieur au seuil de 25 % habituellement retenu par la jurisprudence.
Voilà, monsieur le sénateur, les raisons des décisions qui ont été prises. Je tiens cependant à vous réaffirmer la forte volonté du Gouvernement de faire en sorte que les victimes de l’amiante soient indemnisées, dans le respect des règles de droit définies et en fonction du préjudice subi.

Madame la ministre, je vous remercie de cette réponse précise, que je vais porter, naturellement, à la connaissance des intéressés.
Je comprends bien que la jurisprudence du Conseil d’État impose, en quelque sorte, au ministère de déposer ce recours. Néanmoins, ce dernier a été psychologiquement mal reçu par le personnel parce qu’il reportait dans le temps la prise de mesures difficiles, en particulier la réorganisation de l’entreprise.
Elle fut également mal comprise par l’encadrement de cette entreprise, qui, même s’il n’était pas directement concerné à l’époque, assume aujourd'hui la responsabilité liée à la présence d’amiante. Ces responsables craignaient en effet que le départ rapide des travailleurs touchés ne désorganise complètement leur entreprise. Il était donc nécessaire pour eux de prendre le temps de parer à cette désorganisation. Un accord a même été passé entre les responsables de l’entreprise et les syndicats, pour mener à bien, justement, cette opération. Ce recours a donc compliqué les choses.
J’en viens à la période de référence retenue. L’unité d’électrolyse, c’est vrai, a bien été fermée vers 1990. Il n’en demeure pas moins que des travailleurs ont continué à être exposés à l’amiante, que l’on trouvait ailleurs dans cette entreprise qui s’étend sur des dizaines d’hectares. Ce n’est qu’en 1997 que l’on a mis fin à l’utilisation d’amiante.
Je pense donc que les salariés ne comprendront pas que ces travailleurs-là ne soient pas traités comme les autres. Cela va créer une discrimination à l’intérieur de l’entreprise. Les syndicats vont, probablement, déposer un nouveau recours, en s’appuyant sur la décision de la commission des accidents du travail et maladies professionnelles, qui leur donnait raison et recommandait que soit prise en compte la période allant jusqu’à 1997.

La parole est à M. Philippe Bas, auteur de la question n° 339, adressée à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé.

Madame la ministre, ma question touche à un problème récurrent.
Nos associations d’aide à domicile au service des personnes âgées sont dans une situation très difficile. Elles bénéficient d’un tarif 1, 50 euro plus élevé que le tarif horaire proposé par la Caisse nationale d’assurance vieillesse – CNAV – et par ses correspondants régionaux pour la prise en charge de l’aide ménagère au bénéfice des personnes âgées les moins dépendantes.
Reste que, aujourd’hui, une grande partie de nos associations d’aide à domicile assument ces prestations sans que leurs coûts de revient soient couverts. Nous les avons incitées à se regrouper, ce qu’elles font, d’ailleurs. Elles économisent ainsi des frais de gestion, mais cela ne suffit pas.
Jusqu’alors, aucun fonds d’urgence n’a permis de régler le problème. Vous vous trouvez donc, madame la ministre, face à une alternative : soit vous arrivez à mobiliser des crédits nouveaux au titre de l’aide sociale de la CNAV et de la Mutualité sociale agricole, et vous pourrez alors augmenter le tarif horaire de nos associations pour qu’elles ne meurent pas ; soit vous ne pouvez pas le faire, dans les circonstances financières actuelles, mais il faudrait, alors, que vous puissiez autoriser les associations d’aide à domicile financées par l’assurance vieillesse au titre de l’aide sociale à percevoir la différence entre le coût de revient de la prestation et ce qui est pris en charge, au titre de l’aide ménagère, différence pouvant être acquittée par l’usager lui-même, qui ne demande pas mieux, dans la plupart des cas, que de le faire.
Vous ne pouvez pas à la fois refuser de financer le nécessaire et exclure que les associations se financent en obtenant l’appoint de la part des personnes âgées qu’elles assistent. Si vous adoptez cette posture de double refus, alors, nos associations d’aide à domicile, pour les plus fragiles d’entre elles, disparaîtront, avec le coût social que cela représente. Je pense non seulement au personnel que ces associations emploient, mais aussi et surtout à la difficulté que vous aurez à réaffirmer la priorité que, comme nous, j’en suis sûr, vous accordez au maintien à domicile de nos personnes âgées.
Voilà, madame la ministre, la question que je veux vous poser et l’inquiétude que je relaie.
Monsieur le sénateur, c’est incontestable, les associations d’aide à domicile rencontrent des difficultés. Tout élu local est confronté, sur son territoire, aux inquiétudes exprimées par ces associations qui sont notamment au service des personnes âgées, et dont le rôle doit être reconnu et salué. Si nous voulons favoriser le maintien à domicile de ces personnes et préserver ainsi leur autonomie le plus longtemps possible, nous devons agir.
C’est ce qu’a fait le Gouvernement en décidant de créer un fonds de restructuration de l’aide à domicile dans la loi de finances pour 2013. Ce fonds permettra de mobiliser 50 millions d’euros pour 2013 et 2014, qui s’ajouteront aux 50 millions d’euros versés en 2012.
Les arrêtés précisant la répartition des sommes allouées à ce fonds ont été publiés récemment. Les services ont jusqu’au 30 avril, pour adresser leur dossier de demande à l’agence régionale de santé, qui coordonne le travail administratif, en liaison avec l’ensemble des financeurs, en particulier les conseils généraux et les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail.
Le travail d’instruction des dossiers sera donc réalisé en concertation avec l’ensemble des acteurs, mais sous la responsabilité des agences régionales de santé.
Cette première action, importante et volontariste, se poursuivra par l’élaboration d’une stratégie de refondation de l’aide à domicile, afin de répondre, notamment, aux exigences de qualité, de professionnalisation et d’accessibilité financière pour les usagers, ainsi qu’aux exigences de bonne gestion des crédits mobilisés.
Nous allons conduire des expérimentations visant à déterminer un nouveau mode de tarification. Elles devraient permettre de mieux définir les prestations attendues et de fixer les modalités d’une contractualisation entre chaque conseil général et les opérateurs intervenant sur son territoire. L’idée est qu’une contractualisation soit mise en place dans chaque département à partir d’objectifs spécifiques, appuyés sur un schéma national, et dans un cadre pluriannuel.
Un groupe de travail sur les groupes iso-ressources 5 et 6 – GIR 5 et GIR 6 –, relevant actuellement des caisses de retraite et de la CNAV, devra également permettre de favoriser le recours à l’aide à domicile pour les personnes qui, encore largement autonomes, commencent néanmoins à la perdre, et de faciliter la transition en cas de passage au GIR 4.
Vous le voyez, monsieur le sénateur, le Gouvernement est pleinement conscient des préoccupations que vous relayez, et il a d’ores et déjà pris des mesures pour répondre à la situation à laquelle sont confrontées les associations d’aide à domicile.

Je vous remercie, madame la ministre, de votre réponse et de l'intérêt que vous portez aux associations d'aide à domicile, ainsi, bien sûr et avant tout, qu’aux personnes âgées qui bénéficient de leurs prestations.
Malheureusement, le fonds d'urgence de 50 millions d’euros, même renouvelé chaque année, ne s'est pas révélé jusqu'à présent à la hauteur des besoins. Je reste préoccupé, après votre réponse, des conditions de l'équilibre financier des associations.
Je vous ai demandé si vous pouviez envisager de desserrer cette contrainte – elle n’est d'ailleurs nullement légale – qui empêche de percevoir un complément de la part de la personne âgée elle-même lorsque le tarif, pour des raisons budgétaires et financières nationales, est bloqué à un niveau insuffisant.
Vous ne m'avez pas répondu, mais je ne doute pas que la réflexion du Gouvernement se poursuit. En tout cas, les conseillers généraux comme le Gouvernement et les agences régionales de santé, le conseil d'administration de la CNAV et celui de la Mutualité sociale agricole, ne peuvent pas laisser en l’état une situation qui ne cesse de se dégrader.
Les associations ont déjà pris un certain nombre de mesures de bonne gestion et d'économie. Aujourd'hui, les marges d'amélioration sont donc de plus en plus faibles, même s’il en reste sans doute quelques-unes dans tel ou tel département.
Quoi qu’il en soit, je puis vous assurer que la situation est actuellement extrêmement tendue dans le département de la Manche. Je ne doute pas que vous saurez obtenir du ministre délégué au budget les assouplissements nécessaires pour l’ensemble des départements français, car il doit, lui aussi, avoir conscience de cette difficulté.

La parole est à M. Claude Bérit-Débat, auteur de la question n° 315, adressée à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé.

Madame la ministre, il y a quelques semaines, vous dévoiliez les principales mesures du plan de lutte contre les déserts médicaux.
Ce plan est d’autant plus indispensable que la pénurie de soins concerne aujourd’hui 10 % de la population française. Ce chiffre, comme toute moyenne, renvoie cependant à des réalités fort différentes.
Ainsi, dans les territoires ruraux, la situation est extrêmement préoccupante, voire alarmante. C’est le cas, par exemple, dans mon département, la Dordogne, où 30 % de la population a plus de soixante ans. En outre, la Dordogne est le troisième département de France par sa superficie et la densité n’y est que de 46 habitants au kilomètre carré.
Cela vous laisse percevoir immédiatement les difficultés que rencontrent les Périgourdins en termes d’accès aux soins. Pour les soins de pédiatrie, de gynécologie ou encore d’ophtalmologie, un habitant sur trois se trouve dans un désert médical. En outre, dans un canton sur cinq, on ne trouve plus qu’une seule pharmacie, un canton sur cinq manque d’infirmiers et un canton sur dix est en déficit de médecins généralistes.

Nous sommes, de plus, confrontés à un manque de médecins assurant les gardes de nuit, et les services d’urgence, SAMU-SMUR, ne peuvent plus répondre aux besoins, faute de personnel.
La situation est donc déjà plus que difficile.
Malheureusement, elle ira en s’aggravant puisque les médecins généralistes qui officient sur notre territoire sont aujourd’hui âgés. Si rien n’est fait, un sur deux ne trouvera pas de remplaçant.
Les élus du territoire se mobilisent pour stopper l’hémorragie. En quelques années, dix maisons de santé ont été ouvertes sur le département. Des contrats locaux de santé ont été passés, notamment dans le nord du département, qui est le plus touché.
Cependant, cet investissement des collectivités ne suffit pas à inverser la tendance, et l’on peut dire que, inexorablement, le désert médical gagne du terrain en Dordogne.
Dans votre plan de lutte, vous évoquez, par exemple, la mise en place d’un revenu garanti pour 200 praticiens territoriaux en médecine générale, l’adaptation des hôpitaux de proximité ou bien encore la création d’un référent installation.
Si je salue ces annonces, je m’interroge toutefois sur leurs effets concrets dans le territoire que je représente. Pourriez-vous m’indiquer, madame la ministre, dans quelle mesure la Dordogne bénéficiera de ce plan afin que notre département ne soit plus le désert médical qu’il est en train de devenir ?
M. Jean Besson applaudit.
Monsieur le sénateur, dans de très nombreux territoires, l'attente de nos concitoyens est forte au regard de l’offre de soins, de la présence de médecins, d'infirmiers, de kinésithérapeutes, de pharmacies. Voilà pourquoi j'ai insisté, lorsque j'ai lancé le pacte territoire-santé, au mois de décembre dernier, sur la nécessité d’organiser une concertation au niveau de chaque territoire. Ainsi, nous pourrons déterminer la meilleure manière d'adapter les engagements du Gouvernement à chacun d’entre eux.
L'Agence régionale de santé d'Aquitaine a ainsi mené une concertation en Dordogne au mois de février dernier, en y associant l’ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire les professionnels de santé libéraux et hospitaliers, les ordres, l'université et, bien entendu, les collectivités territoriales, car c'est avec elles et en relation avec elles que le travail doit s'accomplir.
Un plan d’action sur l’ensemble des axes du pacte a été élaboré par l’Agence.
Ainsi, pour faciliter l’installation des jeunes médecins en Dordogne, l’ARS d’Aquitaine a développé un partenariat avec l’université de Bordeaux qui forme les futurs médecins. Il s’agit de communiquer fortement auprès des jeunes médecins généralistes et de définir un projet d’accompagnement de la filière de médecine générale tout au long du parcours de l’étudiant.
De plus, afin de répondre aux craintes d’isolement des jeunes médecins et pour optimiser le temps médical, ce qui correspond à une demande des professionnels, l’Agence a développé un partenariat avec l’ensemble des financeurs publics en Dordogne, en vue de mobiliser tous les moyens autour des pôles de santé. À ce jour, dix maisons de santé pluridisciplinaires fonctionnent dans le département de Dordogne.
Pour garantir l’accès aux soins urgents en moins de trente minutes, l’Agence va promouvoir en Dordogne le dispositif de médecin correspondant du SAMU, médecin généraliste libéral de premier recours prenant en charge des patients en situation d’urgence médicale grave.
Elle va aussi développer des projets d’expérimentation qui visent à renforcer la réponse à l’aide médicale urgente dans les zones situées à plus de quarante-cinq minutes d’un accès SMUR en mettant en place des dispositifs de télémédecine.
Enfin, concernant les hôpitaux de proximité, un travail s’est engagé sur les liens entre les établissements de proximité et le centre hospitalier de Périgueux, établissement de recours pour le territoire de santé que vous évoquez, monsieur le sénateur.
Des rapprochements sont en cours, notamment via la mise en place d’une direction commune entre les centres hospitaliers de Périgueux, de Lanmary et de Sarlat. Les hôpitaux participent aussi au déploiement des consultations avancées de médecins spécialistes, axe important pour l’accès aux soins.
Vous le constatez, monsieur le sénateur, la dynamique du pacte territoire-santé est engagée en Dordogne, comme ailleurs sur le territoire. Vous pouvez être assuré de ma détermination pour veiller à sa bonne mise en œuvre. Il y va de l'égalité d'accès aux soins sur l'ensemble du territoire. Grâce à la mobilisation de tous, nous pourrons arriver à répondre aux attentes de la population.

Je vous remercie, madame la ministre, de votre réponse.
Ma question était antérieure à la réflexion qui a été engagée en Aquitaine. Néanmoins, un certain nombre d’inquiétudes subsistent.
Certes, tous les départements ruraux ont les mêmes caractéristiques. Néanmoins, en Dordogne, la densité démographique est particulièrement basse eu égard à la superficie du département et à une population relativement peu nombreuse : la moyenne est, je l’ai dit, de 46 habitants au kilomètre carré, ce qui signifie que, par endroits, notamment dans le nord, la densité ne dépasse pas 10 habitants au kilomètre carré.
J’ai eu connaissance de la concertation menée avec la faculté de médecine de Bordeaux. Cependant, jusqu’à présent, les efforts sont restés vains. Vous le savez aussi bien que moi, madame la ministre, pour inciter un médecin généraliste à s’installer dans un département rural, l’environnement, qu’il soit social, culturel, économique, scolaire, etc., a une grande importance.
Les pôles de santé n’ont pas attendu le plan qui a été annoncé pour voir le jour. Ce sont les collectivités – conseil général, communes, intercommunalités – qui en ont financé la mise en place, avec quelquefois des difficultés pour trouver des personnes acceptant d’occuper les emplois créés. Pour ma part, je privilégie d’abord le fait de trouver des médecins, des infirmières, des chirurgiens-dentistes.
Je ne doute pas de votre détermination, madame la ministre, et je vous soutiens pleinement dans votre mission, mais je n’ai pas de vraies certitudes quant aux résultats en Dordogne, car le déficit y est très important.
J’ai évoqué tout à l’heure l’ophtalmologie. Il y a trois ophtalmologistes en Dordogne et il faut attendre six mois pour obtenir un rendez-vous ! Par ailleurs, seuls deux pédiatres officient à Périgueux. Les chiffres en témoignent, il s’agit bien d’un désert médical !
Quoi qu’il en soit, je compte beaucoup sur vous, madame la ministre.

La parole est à M. Jean Besson, auteur de la question n° 355, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale.

Ma question porte sur l’inadéquation des périodes de vacances scolaires.
Les modifications du calendrier scolaire triennal fixées par l’arrêté du 20 juillet 2009, sans concertation préalable avec les opérateurs du tourisme, ont retardé d’une semaine les vacances d’hiver et les vacances de printemps.
Dorénavant, les vacances de printemps débordent largement sur le mois de mai, c’est-à-dire qu’elles interviennent au moment où la quasi-totalité des stations de sport d’hiver sont fermées ou en passe de l’être. Monsieur le président, vous qui êtes sénateur de Haute-Savoie, vous connaissez bien le problème ! §
Moyennant quoi, en deux saisons, la fréquentation des stations pendant les vacances de Pâques a été divisée par deux. On estime que près de 35 000 emplois sont directement affectés par ce changement de calendrier.
Cette année, il est vrai, le bilan de la saison touristique en montagne a toutes les chances de s’avérer positif en raison, notamment, d’un niveau d’enneigement exceptionnel. En tant que président du comité régional de tourisme de Rhône-Alpes, je ne peux que m’en féliciter. Il est d’ailleurs opportun de rappeler que, en cette période de crise, l’industrie touristique reste, heureusement, l’un de nos meilleurs atouts économiques, qu’il est un pourvoyeur de devises et d’emplois. Rien qu’en Rhône-Alpes, le tourisme représente une consommation de plus de 10 milliards d’euros et 150 000 emplois !
Cette bonne nouvelle conjoncturelle ne saurait toutefois masquer les difficultés d’un secteur d’activité qui s’interroge sur son développement.
La réforme à venir des rythmes scolaires est une initiative heureuse du ministre de l’éducation nationale, qui va dans le sens de l’intérêt primordial de nos enfants. Je la soutiens sans réserve.
Cependant, je souhaite que cette réforme bienvenue soit aussi l’occasion de réfléchir à la définition de nouvelles dates de vacances scolaires, qui ne pénalisent pas les différents acteurs de la filière du tourisme, notamment des sports d’hiver.
Cette question revient régulièrement dans l’actualité, comme un serpent de mer, si j’ose dire s’agissant de montagne
Sourires.

Seule une concertation avec l’ensemble des parties prenantes tenant compte des nouvelles habitudes de vie de nos concitoyens, c’est-à-dire des parents et de leurs enfants, serait en mesure de répondre à cette difficulté.
Je souhaite donc savoir quelles sont les intentions du ministère de l’éducation en la matière ?

La parole est à Mme George Pau-Langevin, ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, chargée de la réussite éducative.
Monsieur le président, monsieur le sénateur Jean Besson, je tiens à vous présenter les excuses de M. Vincent Peillon, qui est retenu ce matin par la première réunion conjointe de l’ensemble des recteurs et des directions régionales des affaires culturelles, qui doit notamment traiter, en lien avec la ministre de la culture, Aurélie Filippetti, des parcours artistiques et culturels.
Nous avons bien entendu les interrogations et les inquiétudes des maires et des professionnels du tourisme quant aux conséquences d’une révision du calendrier scolaire sur l’activité économique.
Après consultation des différents acteurs du monde éducatif, le calendrier scolaire national de l’année 2013-2014 a été fixé par arrêté du 28 novembre 2012. La rentrée scolaire a été fixée au mardi 3 septembre 2013 et le début des vacances d’été au 5 juillet 2014. Les vacances de la Toussaint s’étendront du 19 octobre au 4 novembre 2013 et les vacances de Noël, du 21 décembre 2013 au 6 janvier 2014.
Pour l’année civile 2014, et en fonction du mécanisme d’alternance des zones académiques, les vacances d’hiver s’étendront du 15 février au 17 mars et les vacances de printemps, du 12 avril au 12 mai.
M. Jean Besson manifeste son insatisfaction.
Effectivement, monsieur le sénateur, au regard des préoccupations que vous exprimez, de telles dates peuvent sembler tardives.
M. Jean Besson acquiesce.
Ce calendrier est conforme à celui de 2012-2013, qui avait obtenu l’aval du Conseil supérieur de l’éducation. Le nombre de jours de vacances est inchangé. Les vacances de la Toussaint comptent désormais deux semaines complètes. Certes, à la Toussaint, il est rare qu’il y ait déjà de la neige !
Si M. le ministre de l’éducation nationale a souhaité établir ce calendrier pour la seule année scolaire 2013-2014, et non sur une base triennale, c’est pour pouvoir ouvrir, à partir de ce printemps, une réflexion approfondie sur les évolutions du calendrier scolaire, notamment à l’aune de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires.
Dans ce cadre, je tiens à vous rassurer totalement : les acteurs du tourisme et les représentants des collectivités locales en zone maritime ou de montagne seront évidemment consultés.
Nous sommes pleinement conscients des conséquences économiques qu’aura le rééquilibrage du calendrier dans ces régions spécifiques. Cependant, nous ne devons pas perdre de vue les priorités que sont le bien-être des élèves et l’organisation de la vie des familles.
Le travail accompli pour revoir l’organisation hebdomadaire des rythmes scolaires est une première étape. Cela souligne à quel point il est urgent de s’attaquer à ce qui est une spécificité française : le nombre annuel de journées scolarisées est de 144 par an, contre 187 en moyenne dans l’OCDE, ce qui contribue à surcharger considérablement les journées, au détriment de la qualité de l’apprentissage.
Cette réforme des rythmes témoigne de la nécessité de concertation avec l’ensemble des parties prenantes. Elle témoigne surtout des enjeux multiples du calendrier scolaire et de la nécessité de ne jamais perdre de vue l’objectif de réussite scolaire pour chaque enfant.

J’irai effectivement dans votre sens, monsieur le président. Je remercie Mme la ministre de sa réponse, mais, chacun le comprendra, je ne peux pas approuver les perspectives dont elle a fait état.
Je soutiens la réforme des rythmes scolaires ; c’est une très bonne idée d’avoir une demi-journée supplémentaire. En revanche, je ne peux pas suivre le Gouvernement sur le calendrier des vacances d’hiver et de printemps. Il faudrait concentrer les premières sur le mois de février – c’est techniquement possible puisqu’il y a tout de même quatre semaines – et les secondes sur la fin du mois de mars et le début du mois d’avril.
Cela n’a aucun sens de mettre les vacances de printemps à cheval sur la fin du mois d’avril et le début du mois de mai ! D’ailleurs, tout le monde reconnaît qu’il y a trop de jours fériés – qui se transforment souvent en autant de ponts – au mois de mai : le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, la Pentecôte…
En tout état de cause, nous, élus des départements alpins et pyrénéens, ne pouvons être qu’en désaccord avec de telles décisions.
Nous sommes effectivement confrontés à des impératifs contradictoires.
Nous avons évidemment à l’esprit les préoccupations spécifiques des élus des stations de montagne, mais il faut aussi tenir compte des multiples ponts du mois de mai et assurer aux enfants un nombre suffisant de jours de classe.
Nous allons mener une concertation qui visera précisément à essayer de concilier ces différents intérêts.
Quoi qu’il en soit, il faut aussi diversifier les plaisirs de la montagne : on peut également y passer des vacances très agréables au printemps ou en été.

M. le président. Madame la ministre, quitte à sortir un instant de mon rôle de président de séance, je vous dirai que M. Besson et moi-même sommes tout disposés à vous soumettre un certain nombre de propositions.
M. Jean Besson acquiesce.

La parole est à M. Jean Louis Masson, auteur de la question n° 402, transmise à M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

J’avais adressé cette question, qui concerne la réserve parlementaire, à M. le Premier ministre. On m’a téléphoné pour m’indiquer qu’elle était transmise au ministre chargé des relations avec le Parlement. Or je constate qu’il n’est pas là aujourd'hui. J’en déduis que c’est finalement Mme la ministre chargée de la réussite éducative qui va me répondre. Je suis tout de même un peu surpris, je l’avoue, par une telle désinvolture. Je ne vois pas bien le rapport entre la réussite éducative et la réserve parlementaire… Cela fait sans doute partie des mystères du Gouvernement !
Madame la ministre, les événements qui ont émaillé l’actualité de ces derniers jours – je pense en particulier à l’affaire Cahuzac – illustrent une nouvelle fois la nécessité de moraliser la vie publique.
Sur cette question de la morale dans la vie politique, un sujet fournit un exemple très probant : la réserve parlementaire. En l’occurrence, une réforme s’impose. Celle pour laquelle je milite depuis plus d’un an s’articule autour de trois axes : l’équité, tant dans la dotation aux différents parlementaires que dans la répartition territoriale ; la transparence, car, s’agissant d’argent public, nos concitoyens et nous-mêmes avons le droit de savoir ce qu’il en est exactement ; l’honnêteté, parce qu’il convient d’empêcher les dérives possibles.
J’avais interrogé M. le ministre de l’intérieur sur ce dernier point lors de la séance des questions orales du 5 février. Il m’avait répondu que les tribunaux judiciaires étaient compétents en la matière et que des poursuites pouvaient, le cas échéant, être engagées. D’ailleurs, j’ai appris depuis par la presse que cela avait été le cas dans deux dossiers au moins.
Je concentrerai mon propos sur l’équité et la transparence. Je m’appuierai notamment sur les révélations récentes de la presse, en particulier celles de l’émission Capital diffusée par M6 le 17 mars et d’un article paru dans le journal Le Parisien-Aujourd'hui en France le 5 avril.
Premier axe : l’équité.
Par le passé, il y avait, et c’était un scandale, des distorsions considérables. Certains profitaient du système, « s’empiffraient » littéralement de réserve parlementaire, tandis que d’autres devaient se contenter de quelques miettes…
Le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat ont annoncé, à grand renfort de publicité, que tous les parlementaires seraient dorénavant traités sur un même pied. Je m’étais réjoui dans la presse d’une telle annonce et j’avais félicité la nouvelle majorité de l’initiative ainsi prise.
Hélas ! M. le rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale a désavoué les propos de M. Bartolone et a reconnu sur M6 qu’il y avait toujours des parlementaires privilégiés pour profiter du système en recevant deux ou trois fois plus que les autres.
La presse et les parlementaires ont manifestement été « enfumés » lorsqu’on leur a fait croire que tout le monde serait désormais sur un pied d’égalité.
Deuxième axe : la transparence.
En la matière, je vous rappelle, madame la ministre, que le Gouvernement a l’obligation de communiquer aux membres de l’Assemblée nationale et du Sénat la liste de toutes les subventions allouées aux associations, y compris celles qui relèvent de la réserve parlementaire. Le gouvernement Fillon ne l’a pas toujours fait. Comme par hasard, l’utilisation de la principale subvention en cause a été pour le moins douteuse… D’ailleurs, elle fait l’objet d’une enquête judiciaire.
Quant à l’actuelle ministre de l’écologie, elle a vraiment traîné les pieds pour fournir un minimum d’informations sur le sujet. Pourtant, elle y est obligée par la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ; les personnes concernées ont dû saisir la Commission d’accès aux documents administratifs, la CADA. Mais la ministre continue de refuser la consultation des documents malgré les injonctions que la CADA lui a adressées !

Ces deux exemples démontrent la nécessité d’une réforme globale de la réserve parlementaire. Le Gouvernement doit présenter un projet de loi ou demander l’inscription à l’ordre du jour du Parlement d’une proposition de loi – j’en ai déposé une en ce sens – tendant à moraliser la réserve parlementaire.
Monsieur Masson, c’est effectivement moi qui suis chargée de représenter le Gouvernement pour vous répondre. Comme vous le savez, les ministres, au même titre d’ailleurs que les parlementaires, ne sont pas toujours maîtres de leur emploi du temps, et mon collègue Alain Vidalies ne pouvait pas être présent ce matin pour vous répondre personnellement.
Vous avez attiré l’attention du Gouvernement sur la réserve parlementaire. Au passage, je vous fais observer qu’il n’y a pas non plus de lien entre ce sujet et l’affaire Cahuzac, à laquelle vous avez néanmoins fait allusion.
Je ne dispose pas d’éléments très précis sur les différents aspects que vous avez évoqués. Je voudrais toutefois rappeler les règles et les principes qui s’appliquent en l’espèce.
Vous avez cité la nécessité de la transparence : des règles existent ; elles doivent être respectées. Si, dans tel ou tel cas particulier, elles ne l’ont pas été, il vous appartient, comme à nous tous d'ailleurs, de veiller à leur application.
Vous avez rappelé l’obligation de publier chaque année, en annexe au projet de loi de finances, la liste des subventions versées par l’État aux associations sur l’initiative du Gouvernement ou du Parlement. Cette liste est scrupuleusement renseignée ; elle intègre les subventions versées au titre de la réserve parlementaire. Il doit être normalement possible de vérifier que cette information est fiable et complète et, avec les ministres concernés, mon collègue Alain Vidalies veillera à ce que cela soit fait.
Vous avez également insisté sur l’accès aux documents administratifs. Là encore, des règles claires et rigoureuses sont fixées par la loi. La CADA assure leur respect et leur application, sous le contrôle du juge administratif, qui peut et doit même être saisi de tout manquement éventuel.
Je tiens à rappeler que l’ensemble des subventions attribuées au titre de la réserve parlementaire font l’objet d’amendements déposés par le Gouvernement sur proposition des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. C’est un élément d’information et de contrôle démocratique essentiel auquel il faut se référer.
Comme vous l’avez dit devant le ministre de l’intérieur lors de la séance de questions du 5 février dernier, des questions plus larges se posent sur l’attribution de la réserve et, plus fondamentalement, sur la rénovation des pratiques en la matière.
Au nom du Premier ministre, nous saluons, comme vous l’avez vous-même fait, l’effort de transparence et d’équité des présidents Jean-Pierre Bel et Claude Bartolone, qui ont souhaité que les crédits de la réserve soient répartis au prorata des effectifs des groupes parlementaires. Il reste à espérer qu’à l’intérieur des groupes parlementaires le même principe d’équité s’applique, mais, vous en conviendrez, nous sommes moins armés pour intervenir en ce domaine.
En tout cas, votre souci d’améliorer la transparence et l’équité dans l’emploi de la réserve parlementaire est partagé par les membres du Gouvernement.

Je suis vraiment stupéfait, et même scandalisé, madame la ministre ! À quoi bon poser des questions si c’est pour vous entendre nous répondre que le soleil brille quand il fait nuit ?
Je vous ai dit précisément que certains responsables avaient reconnu l’absence de toute égalité, notamment le rapporteur général du budget de l’Assemblée nationale, qui a affirmé toucher trois fois plus que les autres. Je n’entrerai pas dans le détail des problèmes qui se posent au Sénat, mais, il en va de même. Initialement, c’est vrai, madame la ministre, tout le monde devait avoir la même chose, et je m’en réjouissais. Mais l’égalité n’a pas été instaurée, et c’est un vrai scandale ! M. Bartolone et le président du Sénat se sont moqués des journalistes et de l’opinion en faisant croire qu’il y avait une justice alors qu’il n’y en a toujours pas !
S’agissant de l’autre problème que j’ai évoqué, madame la ministre, on est à la limite du mensonge. Dans ma question, je citais un exemple précis.
J’ai transmis par écrit au Gouvernement cette question, mais peut-être n’en avez-vous pas eu connaissance, le hasard vous ayant sans doute désignée, aucun autre membre du Gouvernement n’étant disponible, pour répondre à la question que j’ai adressée au Premier ministre… Si, au moins, vous avez lu cette question et si vous avez été un peu informée avant de venir ici, vous savez très bien que, contrairement à ce que vous avez dit, la subvention allouée à cette association au titre de la réserve parlementaire n’a pas été publiée. On l’a dissimulée, et une interrogation persiste donc.
Vous ne pouvez pas me répondre que toutes les subventions aux associations sont publiées. Elles devraient normalement l’être, madame la ministre, mais, là, il y a eu magouille, il y a eu entourloupe, et c’était bien l’objet de ma question. Pourquoi cette subvention a-t-elle été masquée ? Pourquoi n’a-t-elle pas, comme toutes les autres subventions aux associations, été publiée ?
Sur ces points, madame la ministre, vous n’avez pas répondu !

Madame la ministre, permettez-moi de vous remercier d’avoir représenté le Gouvernement à cette séance de questions orales.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures trente-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Jean-Pierre Bel.