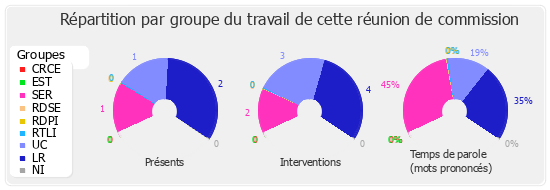Mission d'information sur les pesticides
Réunion du 15 mai 2012 : 1ère réunion
Sommaire
- Audition de mm. jean-paul cabanettes inspecteur général des ponts des eaux et des forêts et jacques février inspecteur général de la santé publique au conseil général de l'alimentation de l'agriculture et des espaces ruraux (voir le dossier)
- Audition de m. jean-françois lyphout président de l'association pour la promotion des préparations naturelles peu préoccupantes aspro-pnpp de m. hervé coves chargé de mission responsable des stations expérimentales aspro-pnpp et de m. guy kastler administrateur aspro-pnpp (voir le dossier)
- Audition de m. jean sabench président de la commission pesticides à la confédération paysanne et de mme suzy guichard de la confédération paysanne (voir le dossier)
- Audition de m. françois werner directeur du fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions fgti et de mme nathalie faussat responsable au fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions fgti (voir le dossier)
La réunion
Audition de Mm. Jean-Paul Cabanettes inspecteur général des ponts des eaux et des forêts et jacques février inspecteur général de la santé publique au conseil général de l'alimentation de l'agriculture et des espaces ruraux
Audition de Mm. Jean-Paul Cabanettes inspecteur général des ponts des eaux et des forêts et jacques février inspecteur général de la santé publique au conseil général de l'alimentation de l'agriculture et des espaces ruraux

Après les tumultes des semaines passés, nous reprenons nos auditions. Nous avons, messieurs, beaucoup de questions sur la vigilance post-autorisation de mise sur le marché (AMM) et sur la veille relative aux produits phytopharmaceutiques, ainsi que sur l'indépendance financière des bureaux d'études et des laboratoires travaillant pour l'industrie phytopharmaceutique.
inspecteur général des ponts, des eaux et des forêts au Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER). - La mission sur le suivi des produits phytopharmaceutiques après autorisation de mise en marché a été menée par trois personnes, qui appartiennent au ministère de l'agriculture. J'ai en effet travaillé avec M. Jacques Février, inspecteur général de la santé publique vétérinaire, et M. Dominique Fabre, inspecteur général de l'agriculture.
Le conseil général, qui est l'équivalent d'une inspection générale de ministère, exerce en outre une mission d'évaluation et de conseil des politiques, ainsi que de formation. Il n'est pas rattaché fonctionnellement à une direction générale : nous sommes saisis par le ministre de missions diverses. Notre lettre de mission, qui définit le périmètre des investigations, est annexée à notre rapport. Nous ne sommes pas toujours informés de ce qui se passe ensuite.
Ainsi, après les affaires liées au Mediator, nous avons été saisis par le ministre d'une évaluation relative aux produits phytosanitaire, indépendamment d'une autre mission sur les médicaments vétérinaires. Impliquant les trois corps d'inspection, la mission s'est déroulée de janvier à juin 2011. Elle ne concernait pas l'AMM mais le post-AMM.
Que se passe-t-il après l'autorisation des produits ? Lors de l'attribution de l'AMM, les ministères concernés (santé, environnement) peuvent demander à la société qui commercialise le produit de fournir des études complémentaires dans un délai donné ; les résultats serviront lors du renouvellement de l'autorisation.
Aux pétitionnaires. Ce ne sont pas toujours les industriels.
Un produit phytopharmaceutique comporte des substances actives qui doivent figurer sur la liste positive autorisée au niveau européen. L'inscription sur la liste peut être assortie de recommandations, que l'État membre qui délivre l'AMM reprend généralement : il faut que les substances actives soient autorisées pour que le produit reçoive une AMM. Il peut, en outre, demander des études complémentaires.
Le détenteur de l'AMM est dans l'obligation de signaler toute anomalie, incident de fabrication, de transport, incident toxicologique...
Ils en ont l'obligation.
Troisième source d'information : les suivis sur les pesticides réalisés par des opérateurs, comme ceux réalisés par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur la mortalité des animaux qui pourrait être liée aux pesticides. Quantité d'analyses sont également effectuées sur les eaux.
La difficulté réside précisément dans la remontée et l'analyse de cette masse d'informations dans un lieu où les alertes puissent être données et des décisions prises. Il faut trier entre les signaux, faibles ou redondants, sous différents formats.
Voilà les données sur lesquelles peuvent s'appuyer la vigilance et notre évaluation. Ces sources externes sont de très bonne qualité même si elles n'ont pas été bâties pour suivre l'AMM.
Pour les fruits et légumes aussi, les 2 000 à 3 000 analyses de résidus dirigées chaque année par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et la direction générale de l'alimentation (DGAL) sont d'un bon niveau méthodologique. L'enjeu est de tirer quelque chose de ce foisonnement.
Les plans de contrôle des deux services régaliens sont alimentés par leurs plans de surveillance : ils autorisent de cibler les contrôles là où les anomalies sont les plus vraisemblables. Le réseau des MSA, Phyt'attitude, procède à des enquêtes en cas d'accident. Son travail est de qualité ; toutefois, comme la procédure est volontaire, l'échantillon des incidents manque de représentativité.

Ces accidents demeurent un sujet tabou. Une récente décision de Justice vient de couronner l'action d'un agriculteur de Meurthe-et-Moselle, M. Dominique Marchal, que je connais bien, et qui s'est battu seul. Il a suivi un véritable parcours du combattant. Les agriculteurs sont mal protégés, car ils devraient se déguiser en cosmonautes dans leurs champs pour être vraiment à l'abri des pesticides. Il faut aller vite dans l'appréciation des risques auxquels ils sont exposés car leur vie peut basculer du jour au lendemain.

Qui fait les études après l'AMM ? L'objectivité en est-elle garantie ? Les signalements des anomalies sont-ils effectifs ?
Les études sont fournies par le pétitionnaire de l'AMM.
Les laboratoires capables de mener les études sont très peu nombreux (deux ou trois), et les sociétés privées ont des contrats avec eux. Cette situation est problématique. Sont-ils juges et parties ? Je ne le pense pas. Donnent-ils des garanties à cet égard ? Non, puisqu'ils ont eu des contrats privés ou européens. Peut-être faudrait-il déconnecter la commande de la société ?
L'on pourrait imaginer que la société pétitionnaire verse, pour le suivi de la molécule, une contribution à un tiers sur le modèle des anciens comptes spéciaux du Trésor.
Les produits peuvent être dangereux ! En général, les dossiers sont numérotés, mais il ne serait guère difficile à un spécialiste d'identifier le produit, même numéroté par la fiche signalétique.
Nous suggérons un contrôle de deuxième niveau. L'on peut envisager, en plus des études produites par le détenteur de l'AMM, des contrôles de deuxième rang par sondage, une investigation dans les sociétés pétitionnaires et dans les laboratoires pour vérifier que tous les moyens ont été mis en oeuvre et les résultats publiés. Le travail serait considérable, mais cette possibilité serait utile et fournirait des garanties supplémentaires. Produit-on toujours tous les essais effectués, ou se borne-t-on à présenter les dix requis ? Nous ne l'avons jamais su et il est actuellement difficile de le savoir.
Quant au signalement, depuis le 14 juin 2011, un règlement fixe les obligations en la matière et met clairement celui-ci à la charge du pétitionnaire. Dans le passé, ce signalement était mal organisé ; il convient donc de mieux l'organiser, et de le rendre systématique.
Tout incident constaté sur le produit doit être rapporté. L'obligation réglementaire est claire.
En codifiant les points de vigilance, en les détaillant. Les sociétés dont le siège est aux États-Unis d'Amérique ont une obligation de signalement à l'administration fédérale, y compris pour des incidents intervenus en France. Pourquoi ne pas faire de même ?
Écophyto aboutit à l'obligation d'un agrément des conseillers agricoles pour les produits phytosanitaires. Nous avons suggéré de conjuguer agrément et signalement, la clé étant la perte de l'agrément en cas d'absence de signalement. Nous avons de très importants progrès à accomplir quant au signalement.
Ce qui me frappe, par analogie avec les vétérinaires, qui prescrivent, c'est l'absence de responsables au niveau de l'usage des produits phytosanitaires commercialisés. Une fois que l'entreprise a montré patte blanche pour entrer sur le marché, les agriculteurs emploient des produits sans que personne ne soit responsable de l'opportunité du traitement.

L'agriculteur qui appose sa signature au bas du Certiphyto n'endosse-t-il pas seul la responsabilité ?
Cela n'est pas compris comme cela. En a-t-il d'ailleurs toutes les compétences ?
Il faut quelqu'un au-dessus pour prendre la responsabilité en toute connaissance des produits.
Voyez les vétérinaires, qui prescrivent en fonction de leurs compétences. Pour les produits phytosanitaires, l'on a besoin d'intervenants qui prescrivent le produit toxique et les quantités et l'on manque d'une responsabilité bien définie et identifiée.

Il y a bien la responsabilité civile, en cas de mauvais usage ou de mauvaises conditions de stockage, qui porteraient atteinte à la santé ou à l'environnement. Il y a aussi l'impact diffus, au fil du temps, lié à un usage normal. Mais qui contrôlera ?

Il y a eu une AMM ! Un distributeur, un agriculteur, peuvent-ils être responsables d'une molécule évaluée et autorisée ?
Quelqu'un signerait la prescription et serait donc sensible aux incidents qui apparaîtraient... Il serait plus apte à traiter et à relayer les signaux.

Le contre-exemple est le Mediator ! Les médecins ont tous signé leur ordonnance !
Tout le monde était dans la boucle.

Pour les produits phytosanitaires, le volet économique semble primer sur le volet santé.
Les substances actives relèvent de la Commission européenne ; les produits mis sur le marché relèvent des États membres. Quand le ministère de l'agriculture prend une décision sur le dossier du pétitionnaire, il prend l'avis des ministères chargés de la santé et de l'environnement. Dans le passé, il existait un comité d'homologation où siégeaient des représentants de chaque instance. Désormais, chacun donne son avis et l'on ne se rencontre qu'en cas de désaccord. Pour une modification d'usage ou un retrait d'AMM, la procédure serait parallèle. Il serait impensable de méconnaître l'impact sur la santé et l'environnement.

Alors pourquoi les agriculteurs ont-ils tant de mal à faire reconnaître le lien entre leurs maladies et les produits ?
Je n'ai pas la compétence scientifique pour vous répondre.

Certaines maladies se manifestent progressivement. Tous les agriculteurs ne sont pas malades et toutes les molécules ne sont pas toxiques. Il y a un tri à faire, on ne peut supprimer l'usage de toutes les molécules.

Certains effets apparaissent après vingt ans d'excès d'utilisation de produits phytosanitaires.
Quelles sont vos recommandations afin que l'on ne passe plus à côté de signalements ? Quel système d'information mettre en place ?
Au-delà de l'obligation de signalement, il faut responsabiliser les sociétés et récupérer les informations des réseaux extérieurs. Ce n'est pas le manque, mais la quantité d'information qui pose problème. Le savoir-faire pour la traiter s'est fortement accru depuis dix ans. Il est possible d'agréger les données. Nous suggérions de distinguer l'évaluateur et le décideur : que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) fasse l'évaluation et la veille, sur la faune sauvage, la santé, l'environnement. Les centres antipoison, par exemple, représentent des sources d'information très importantes non traitées actuellement.
L'on doit mettre en place un système d'information mécanique et dynamique, qui implique les opérateurs publics, les agences de l'eau, etc. Un minimum de traitement des données permettrait de faire apparaître les signaux collectés par ces opérateurs.
La veille scientifique et technique serait également mieux organisée, afin de minimiser le risque en utilisant les informations fournies dans les publications : la conjonction de présomptions garantit que les mailles du filet ne seront pas trop larges afin de minimiser le risque. Il y a aussi des informations judiciaires sur les contrefaçons, sur les importations illégales entre les mains des procureurs. Toutes ces données, traitées et regroupées, produiraient des recoupements.
On a créé un Observatoire des résidus des pesticides (ORP) mais au sein de l'ANSES, ce sont seulement trois agents qui réalisent des études, au demeurant très bonnes.
Cela ne suffit pas.
Je prône plus d'automatisation du dispositif, quitte à enquêter sur certains points.
Le site de l'ORP est rassurant mais, derrière, il n'y a que trois personnes.
Absolument. Le site de l'ORP est très bien fait, mais cet observatoire n'a pas été établi de manière suffisamment concertée pour que tous les intervenants s'y impliquent. La réponse passe moins par la structure que par la conjonction de la remontée des informations.

Les agriculteurs font confiance aux AMM qui sont supposées les mettre à l'abri du danger. Mais ils utilisent de moins en moins de produits, et à meilleur escient.
La formation s'est améliorée.
Je me rappelle avoir vu des viticulteurs traiter les vignes avec de l'arsénite de soude en janvier. Surtout, une meilleure formation a accru le niveau de sensibilité au risque. On sait aujourd'hui que le risque ne dépend pas toujours des quantités. Il faut faire la part des pollutions ponctuelles et celle des pollutions diffuses, issues d'un usage normal, strictement respectueux de la règlementation, mais avec des effets pervers sur l'environnement et sur la santé.
Le Roundup, à base de glyphosate, commence à poser un très sérieux problème car on ne pourra admettre de continuer à dépolluer les rivières à grand frais. Les coûts induits sont très importants, le dossier toxicologique de ce produit s'épaissit et, d'après mon expérience, il existe toujours des solutions alternatives si on s'en donne le temps. Supprimer un produit ne cause pas tant de difficultés que cela.

Des études ont montré qu'on pouvait supprimer 30% de ces produits sans que la production baisse.
L'application des produits phytosanitaires vise à traiter des parasites, comme un médicament pour les maladies. Mais avant de prendre un médicament, on réfléchit aux causes de la maladie, on voit si l'on peut faire autrement. Il faut recourir au raisonnement agronomique. Les prédateurs naturels des parasites peuvent faire le travail des produits.
On traite les symptômes sans s'attaquer aux causes. La lutte biologique a pourtant résolu des problèmes que la chimie ne savait pas traiter. Ainsi pour les parasites des tomates de la coopérative Saveol en Bretagne. On peut reposer les problèmes en faisant appel au savoir-faire de la science agronomique.

Dans la commercialisation d'un produit, l'aspect pratique domine généralement. Dans les collectivités territoriales, on essaie le désherbage manuel mais il provoque des pathologies musculo-squelettiques chez les agents municipaux !

Les conseillers des coopératives agricoles font-ils remonter les informations au ministère ?
Ils seront bientôt soumis à la certification du conseil. Leur agrément sera sans doute assorti d'une obligation de signalement, et ils ne seront pas des vendeurs.
Le conseil sera écrit.

Quid des produits phytopharmaceutiques utilisés par les particuliers ? Je l'ai vérifié : il n'y a pas de conseillers dans les jardineries ! Le dimanche, on a affaire à de jeunes étudiants non formés qui lisent la notice, pas plus.
Ces produits pour jardin font l'objet d'AMM également.
La société qui a mis le produit sur le marché. L'agrément concernera aussi le conseil donné aux particuliers et le conseil prodigué devra être écrit afin d'assurer sa traçabilité.
Audition de M. Jean-François Lyphout président de l'association pour la promotion des préparations naturelles peu préoccupantes aspro-pnpp de M. Hervé Coves chargé de mission responsable des stations expérimentales aspro-pnpp et de M. Guy Kastler administrateur aspro-pnpp
Audition de M. Jean-François Lyphout président de l'association pour la promotion des préparations naturelles peu préoccupantes aspro-pnpp de M. Hervé Coves chargé de mission responsable des stations expérimentales aspro-pnpp et de M. Guy Kastler administrateur aspro-pnpp

Soyez les bienvenus. Nous nous préoccupons de la santé des personnes en contact direct avec les pesticides. Nous avons entendu d'autres syndicats représentatifs du monde paysan. Quel est votre jugement sur l'utilisation des pesticides, sur le plan Écophyto 2018, sur Certiphyto ? Quelles sont vos recommandations ?
Depuis douze ans, nous réfléchissons au sujet des pesticides. Cela a commencé par les apiculteurs, je le suis moi-même, puis avec les paysans voisins. Nous avons discuté avec des médecins, des épidémiologistes, des spécialistes de l'environnement. Il s'agit de prendre conscience de la dangerosité de ces produits et de leur impact sur l'environnement.
Il faut réduire au maximum l'utilisation de ces produits. Il ne s'agit pas de stigmatiser ceux qui les emploient. Ils sont dans un circuit d'où il est difficile de sortir. Il faut donc les aider à en prendre conscience et à évoluer. Dans ce but, nous avons organisé, il y a deux ans, un colloque sur la réduction des pesticides, avec l'Institut national de la recherche agronomique (INRA). Vous le voyez avec les actes du colloque que je vous remets : « Pourquoi changer ? », puis « Comment changer ? », nous demandions-nous, en prônant le dialogue entre paysans et chercheurs. À la suite de ce colloque, nous avons édité une plaquette explicite : « Pesticides, on peut s'en passer ! » - j'aurais même dit qu'on doit s'en passer.
Nous sommes en accord avec les objectifs du règlement Écophyto. Réduire de 50 % les pesticides à l'horizon 2018, oui ; mais il a été ajouté : « si possible ». Ce bémol pose problème !
Réunir les commerçants et les producteurs de pesticides autour de la même table que les agriculteurs pose aussi problème. Pourquoi réfléchiraient-ils à la manière de réduire de 50 % leur chiffre d'affaires ? 50 % en 2018, c'est éminemment souhaitable mais l'on a fait + 3 % en 2011. L'on n'y parviendra donc qu'en changeant de méthode. Les agriculteurs ont déjà fait beaucoup d'efforts. Quant on entend « L'environnement, ça commence à bien faire ! » on s'interroge ! A noter qu'on prend comme référence les groupes d'agriculteurs gros utilisateurs de pesticides.
Dans Écophyto...
Il est regrettable que l'on n'ait pas pris comme point de référence des gens qui en utilisent moins.
Ils le doivent... et ça aide à obtenir un bon résultat. Il est impératif de devenir plus économe.
L'alternative aux pesticides, c'est l'agronomie, le bon sens paysan. On a industrialisé l'agriculture après la seconde guerre mondiale parce qu'il fallait nourrir les gens, mais on est allé trop loin et l'on a oublié des fondamentaux. Le sol n'est pas qu'un support où l'on amène les aliments. On a éliminé les haies. On fait de la monoculture. Il faut au contraire pratiquer les rotations de culture, remettre en place la vie du sol. L'azote chimique tue une partie des éléments vivants. L'humus donne un sol plus souple, plus humide. Il y a des semences sélectionnées pour tolérer un haut niveau d'intrants ; les semences paysannes peuvent avoir des rendements intéressants si on les utilise différemment. L'aspect bioclimatique est important, de même que la diversité au sein de la parcelle. La céréale associée à la luzerne réduit les besoins en apports chimiques, par exemple. La moutarde limite le travail de labour. Mais quand on ne produit pas que des céréales, on rencontre un problème de commercialisation des produits, il faut alors trouver des marchés, ce qui complexifie l'exploitation agricole.
Ce qui se passe autour de la parcelle importe aussi. Il faut faire en sorte que les prédateurs puissent vivre : 80 % vivent à côté et sont efficaces à 40 mètres de la limite. C'est difficile autour des très grandes parcelles. L'on n'a pas besoin de changement fondamental pour réduire de 30 %. Si l'on veut réellement aller à 50 % voire au-delà, il faut concevoir l'agriculture autrement.
Pour que le bio progresse nettement, il est indispensable de mener des recherches dans ce domaine, ce qui suppose une réorientation. Or, lors de la dernière réunion Écophyto tous les exemples cités venaient de l'agriculture bio. On peut développer celle-ci, tandis que l'agriculture conventionnelle utiliserait ses techniques pour réduire l'emploi de pesticides.
La France ne réalise pas totalement la politique européenne. Une bonne partie d'Écophyto 2018 c'est la transposition de la directive de 2009.
La nouvelle réglementation prévoit que l'autorisation donnée dans un pays de la zone vaut, sauf opposition, dans tous les autres pays. Quant à la surveillance biologique, loin d'avoir mesuré son renforcement, nous regrettons la disparition du dernier conseil neutre, les avis des services régionaux de la protection des végétaux, absolument pas liés au négoce des pesticides.
Oui, et il faut qu'ils soient diffusés. Cependant les services régionaux donnaient des conseils neutres. Les avis émanent maintenant d'autres services, il y a eu un changement d'organisation.
Cela peut l'être ! Le premier conseil est donné par les personnes qui font le négoce et la vente.
On a séparé, à juste titre, les fonctions de pharmacien et de médecin. Cela me paraît plus sain. Pour les produits phytosanitaires, négoce et conseil sont mêlés.
On nous dit que les services de l'État sont moins écoutés que ceux des fabricants ou vendeurs de pesticides.
Le Certiphyto est un programme positif. Tout dépend de la formation : qui la fait ? Qui intervient ? Dans une coopérative, on expliquait que pour éviter les pesticides, il fallait recourir aux OGM ! Le programme doit être plus encadré et, si possible, indépendant des organismes commerciaux.
Les lycées agricoles, malgré le manque de personnel, les chambres d'agriculture aussi, quand elles ne font pas un commerce de la formation. Cependant il est positif d'informer les gens.
Bien sûr, les progrès sont réels. Quand j'étais jeune, j'aidais durant l'été mon père, maraîcher du côté de Perpignan. Je portais short et sandales et nous utilisions des produits dont les dangers et les risques n'étaient pas suffisamment connus.

Aujourd'hui, l'agriculteur connaît-il les risques et n'y en a-t-il pas davantage qu'hier ?
Il est difficile de ne pas entendre certaines informations mais les faire siennes, les intégrer dans ses méthodes de travail, c'est autre chose. Les agriculteurs ne parlent jamais de ces questions entre eux. Ce sont les télévisions qui en parlent et les agents de la MSA, les techniciens.

N'est-il pas difficile de remettre en cause des pratiques encensées et enseignées pendant si longtemps ?
C'est un débat que nous avons eu lors du colloque que j'ai évoqué : attention à ne pas montrer du doigt les pratiques de certains ! Un changement culturel est nécessaire. Il n'est pas facile de changer, de travailler, de réfléchir autrement, de trouver les nouveaux débouchés rendus nécessaires par la rotation des cultures. On peut réduire de 30 % sans modifier profondément ses habitudes. Mais si l'on veut réduire davantage, il faut changer fondamentalement.
L'évaluation des produits phytosanitaires lors de l'AMM prend en compte uniquement les études fournies par l'industriel et non les résultats de la recherche publique. Ces études sont couvertes par le secret industriel, qui doit être levé pour que l'on ait accès aux données. Il est anormal d'avoir à saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. Pourquoi ce qui concerne la santé et l'environnement serait-il secret ? Or, au contraire des recherches publiques, ces études n'ont pas été publiées, partant, pas examinées par les pairs.
J'en viens à la question de la dose sans effet : pour les produits cancerogènes mutagènes, toxiques pour la reproduction, ou perturbateurs endocriniens, il n'y a pas de dose sans effet, pas de dose journalière admissible, donc pas de limite maximum de résidus - les trois points sur lesquels repose l'autorisation des pesticides. Les décisions sont politiques ou économiques pas scientifiques.
Les scientifiques montrent que des doses infimes déclenchent des effets indésirables au bout de dix ou quinze ans. C'est différent du cumul de doses. Nous demandons en conséquence que les produits ayant des effets probables et des effets possibles ne soient plus autorisés. S'il n'y a pas d'effets avérés actuellement, nous demandons que les produits ayant des effets probables et des effets possibles soient interdits, ainsi que les perturbateurs endocriniens. Le colloque sur les victimes des pesticides a été éloquent à cet égard. Il y a aussi l'effet cocktail que des chercheurs de l'INRA étudient sur des cellules humaines. On effectue les mêmes études toxicologiques que dans les années soixante : c'est la toxicologie de grand-papa, dit le professeur Narbonne ! Enfin, l'on ne prend pas en compte l'exposition des animaux ni la durée de vie.
Je vous ai apporté deux articles sur le lobbying. L'industrie chimique fait cohabiter dans des organisations comme The Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) ou The International Commission for Plant-Bee Relationships (I.C.P.B.R.) des chercheurs issus de son sein, quelques universitaires, des personnes issues des administrations...
Quelques-uns, et pas partout !
On organise un colloque d'une semaine, dont un jour de tourisme. Des repas conviviaux créent une ambiance préjudiciable à l'exercice serein du métier de chacun. Cependant, personne ne subit d'influence... Je vous laisse un article de quelqu'un qui travaillait il y a peu au bureau des intrants de la Direction générale de l'alimentation, qui dirigeait un groupe de la SETAC sur le monitoring environnemental des pesticides, qui travaillait pour l'I.C.P.B.R., qui est expert à l'Organisation européenne de protection des plantes, laquelle participe à l'élaboration des directives européennes sur l'évaluation des pesticides. Un tel cumul est choquant. Il n'est plus dans l'administration. Il est parti chez Dow Chemical. De même, quand un membre de l'ANSES est invité à une réunion afin de formuler des propositions à la Commission européenne sur l'évaluation de la mortalité des abeilles dans les essais sous tunnel, avec des industriels qui produisent les pesticides, cela nous interpelle. Nous estimons qu'il conviendrait de mettre fin à ce genre de choses.
C'est très bien ! Je ne pointe pas nommément telle ou telle personne, mais un système, reposant sur des pratiques peu claires.
Sur les questions de santé, nous demandons l'interdiction des produits classés cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques (CMR) et des perturbateurs endocriniens, ainsi que celle des insecticides systémiques en traitement de semence (Gaucho, Cruiser). La famille des néonécotinoïdes est extrêmement toxique pour les abeilles. Pensez qu'il suffit d'un gramme dans quatre cents camions-citernes de vingt-cinq tonnes, soit une file de camions de cinq kilomètres de long. Leur durée de vie dans les sols est très élevée, jusqu'à trois ans. On a interdit le Gaucho sur le maïs et le tournesol, mais il est utilisé sur 70 % des céréales, de sorte que, quand on plante ensuite du tournesol, le résidu dans le pollen est quasiment le même que s'il avait été traité. Les Italiens ont interdit tous ces produits. La mortalité des ruches a reculé en quatre ans de 37 % à 14 %, sans diminution de la production de maïs.
Il faut changer la politique agricole commune, et utiliser une partie de son financement pour soutenir et aider les gens qui prennent un risque économique afin de mieux traiter l'environnement et obtenir des bénéfices sur la santé. Cela accélérerait le changement.
Il convient de développer le bio, libérer les semences comme les préparations naturelles peu préoccupantes, et réorienter la recherche publique vers des modes de production agricole à bas niveau d'intrants.
Audition de M. Jean-François Lyphout président de l'association pour la promotion des préparations naturelles peu préoccupantes aspro-pnpp de M. Hervé Coves chargé de mission responsable des stations expérimentales aspro-pnpp et de M. Guy Kastler administrateur aspro-pnpp
Audition de M. Jean-François Lyphout président de l'association pour la promotion des préparations naturelles peu préoccupantes aspro-pnpp de M. Hervé Coves chargé de mission responsable des stations expérimentales aspro-pnpp et de M. Guy Kastler administrateur aspro-pnpp

Nous entendrons avec beaucoup d'intérêt votre point de vue sur la capacité des préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP) à être des alternatives de masse aux pesticides, pérennes et non dangereuses.
Notre association réunit des entreprises, des associations, des collectivités locales, dont un conseil général - bientôt deux - et deux conseils régionaux. Nous l'avons créée à la suite de la loi d'orientation agricole de janvier 2006, qui a considéré les PNPP comme des produits phytosanitaires. Devant le tollé, un amendement à la loi sur l'eau a été adopté, en décembre 2006, pour revenir sur cette disposition.
Le Grenelle I a autorisé les PNPP, le Grenelle II les a interdites. La commission mixte paritaire a supprimé la levée de l'interdiction autorisée par l'Assemblée nationale lors du vote de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMA).
Nous demandons un régime simplifié. Ce sont des produits qui n'ont jamais tué personne, mais leur utilisation est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 000 euros d'amende : mieux vaudrait cultiver du cannabis !
Il concerne le seul purin d'orties qui avait tout à coup toutes les vertus. Le ministère nous a dit qu'il s'agissait d'une mesure d'opportunité politique, ce produit étant très utilisé. Mais ce qui est autorisé en l'espèce n'a pas d'intérêt ; nous parlons, nous, de piquette d'ortie... Ce qui est inquiétant, c'est que, en 2010, le ministère a autorisé 74 produits qui avaient été retirés parce que trop toxiques ! Tandis que nous qui voulons travailler autrement sommes pénalisés.
Pour l'instant, non. Mais ce sont des produits inoffensifs, comme le vinaigre ou le sucre...
Je suis ingénieur à la chambre d'agriculture de la Corrèze. Je gère quatre stations expérimentales qui travaillent sur les petits fruits. S'agissant de productions considérées comme mineures, l'agropharmacie n'a pas intérêt à homologuer les PNPP.
Depuis 1999, j'ai pu constater l'efficacité de ces produits. Elle n'est certes pas comparable à celle des produits phytosanitaires. Si vous pulvérisez sur 10 000 pucerons du purin d'orties, il restera 10 000 pucerons ; mais si on utilise ce produit de façon précoce, lorsqu'arrivent quelques pucerons sur une parcelle, les prédateurs des pucerons, déjà attirés par le purin d'orties, dévoreront les pucerons. Le produit agit sur la composition en biodiversité des parcelles traitées. De même, le parfum de la floraison attire les insectes prédateurs qui mangent les pollinisateurs ; s'ils n'en trouvent pas, ils mangeront d'autres insectes... On aura le même résultat en pulvérisant un parfum floral sur une parcelle. Les matières fertilisantes donnent de la vigueur aux plantes pour se défendre des agressions extérieures.
Les protocoles normalisés actuels sont inadaptés à la mesure de l'efficacité des PNPP. On ne peut, par exemple, laisser de côté la globalité du système de production dans lequel elles sont utilisées.

Les tests d'inocuité sont peut-être inadaptés, mais il faut quand même évaluer celle-ci pour la santé de ceux qui les utilisent et de ceux qui les consomment...
Sans doute, mais il ne faut pas diaboliser les PNPP ! Beaucoup ont des usages alimentaires ou cosmétiques : la camomille, l'argile. On ne s'est jamais posé la question de leur toxicité. L'eau chaude est, par exemple, un excellent désherbant. Il y a des usages tellement triviaux que la nécessité de les évaluer ne s'est tout simplement pas imposée. L'immense majorité de ces produits est d'usage courant, on les trouve dans les épiceries !
Je suis membre de la Confédération paysanne et administrateur de l'Institut français d'agriculture biologique (IFAB), dont je vous recommande l'audition. Ce que nous avons défendu, ce sont des préparations naturelles dont l'utilisation est liée à des savoir-faire traditionnels, éprouvés depuis des décennies ou des siècles. La pomme de terre mangée crue est toxique : on ne va pas en interdire la consommation au prétexte qu'elle n'a pas été évaluée selon des procédures européennes ! Tout le monde sait comment la préparer, sauf peut-être les Inuits ! On ne peut pas évaluer les PNPP, issus de procédés à la portée de l'utilisateur final, comme on évalue les produits de l'industrie.
Hélas, le ministère exige leur inscription sur la liste européenne des substances actives autorisées. On retombe dans le phytosanitaire ! Et le coût d'établissement d'un dossier, rien qu'en France, c'est entre 40 000 et 200 000 euros. Sans compter que le protocole n'est pas adapté.
La réglementation européenne a changé en 2009 et ouvert deux nouvelles catégories, les substances à faible risque et les substances de base. Le problème est que le décret paru il y a seulement un mois vise les PNPP fabriquées avec des substances à faible risque - dont certaines peuvent être de synthèse ! La catégorie nécessite encore une AMM et le protocole demeure le même. Comme le coût par dossier est important et qu'il n'y a pas de retour sur investissement, aucune entreprise ne veut se lancer.
Les « substances de base » sont une catégorie plus intéressante, recouvrant les substances déjà autorisées par d'autres réglementations - c'est le cas du sucre ou de l'argile, par exemple. Elles sont inscrites sur une liste européenne et n'ont pas besoin d'AMM pour leur utilisation. Le 31 mai 2012, le futur ministre français sera à Bruxelles avec ses homologues ; il devra se prononcer sur la disparition de l'AMM pour la commercialisation. Si cette décision est adoptée, ce sera un progrès. Il faudrait aussi s'intéresser à l'utilité, facile à démontrer, plutôt qu'à l'efficacité.
Il faudrait aussi diminuer le coût administratif du dossier ; le temps de travail pour établir celui-ci est infini car l'administration demande toujours plus de preuves scientifiques : elle exige par exemple la dose admissible de sucre pour les abeilles... Quel scientifique a publié des recherches sur cette question ?
Les PNPP devraient faire l'objet d'un traitement différent au plan européen ; il faut les exclure de la liste des phytosanitaires. Si on ne demande plus d'AMM pour les substances de base, l'affaire sera réglée.
Les Allemands en utilisent 400, sur une liste hors réglementation européenne.
Sur le décret « purin d'ortie », l'ANSES n'a pas voulu se prononcer, elle a estimé de pas avoir les moyens de le faire. Mettre des experts sur le sucre ? Allons donc !
Nous connaissons encore mal les possibilités des PNPP hors des niches où elles sont employées. Mais ce sont des produits peu onéreux, qu'on peut faire soi-même. Aujourd'hui, 25 % de la population agricole est considérée comme pauvre : ce « don précieux de la nature » est exclu par la réglementation. Même à efficacité inférieure aux produits chimiques, la solution est intéressante. Et beaucoup de producteurs n'en ont pas d'autre.
La chimie ne marche pas toujours et elle coûte cher, de 3 000 à 8 000 euros par hectare et par an. Un producteur de fraises a récemment réduit ses engrais et produits phytosanitaires de moitié, il ne s'en porte pas plus mal. Les collectivités locales financent des solutions alternatives : le département de la Dordogne, par exemple, participe à hauteur de 40%.
C'est interdit, mais certaines collectivités se mouillent... Certaines solutions naturelles sont plus efficaces que la chimie. Et la fraise est plus rouge et plus sucrée !
Je suis horticulteur et n'utilise plus de produits chimiques depuis quinze ans. La chambre d'agriculture de Corrèze finance des pulvérisations d'ail sur les thrips (insecte ravageur), avec succès. Ce n'est pas un insecticide, les insectes ne sont pas tués mais repoussés ; mais lorsque l'on extermine les parasites, on tue aussi les auxiliaires et les parasites reviennent toujours.
Les viticulteurs achètent des produits pour pouvoir montrer la facture mais ne les utilisent pas, car ils emploient des PNPP plus efficaces !

L'usage des PNPP peut-il être étendu à toutes les cultures et comment ?
Oui, au maïs, à la vigne aussi.
Les gens n'osent plus dire qu'ils les utilisent mais ils le font. Et s'ils le font, c'est qu'elles ont quelque utilité !
J'en vends et j'attends le procès, ce qui permettra d'en parler ! Le problème, c'est la recherche ; comme il n'y a pas d'argent à gagner, il n'y a pas de financement. La chambre d'agriculture de Dordogne a organisé quatre formations sur les PNPP.
Elles soutiennent les expérimentations. La recherche fondamentale est encore lacunaire. Il reste beaucoup à faire pour comprendre les effets des PNPP, leurs moyens d'action sur les écosystèmes. On suspecte, mais on ne sait pas vraiment. Une PNPP peut avoir des effets insecticides... ou insectifuges.

Est-ce parce que les PNPP sont interdites que l'INRA ne s'y intéresse pas ?
Oui, car il faut que des sociétés privées suscitent les recherches et en financent une part - mais il n'y a pas de retour sur investissement.
Le peu qui se fait est public.
Des universitaires, des techniciens de chambres d'agriculture, travaillent avec nous, mais les protocoles restent calqués sur ceux des phytosanitaires. On fait des essais sous serre, ce qui n'est pas pertinent. Si l'expérience n'est pas reproductible, il n'y a pas de validation scientifique ! Certains chercheurs de l'INRA voudraient participer, mais ils sont tenus par le fonctionnement de leur institution et les protocoles officiels.
Ce qui bloque, c'est l'AMM. Quand les substances de base sont autorisées au plan européen, on a le droit de les utiliser en mélanges. Contre la carie du blé, les paysans bio savent quoi faire : très peu de sulfate de cuivre, 3 à 4 grammes par hectare, mélangé avec de la farine de moutarde ! Il existe un produit chimique breveté, qui coûte plus cher bien sûr. Comme le traitement est obligatoire et contrôlé, les agriculteurs en bio l'achètent, mais ne l'utilisent pas...
La solution est à portée de main. Je signale que la plupart des PNPP ne sont pas autorisées en bio. Ce qui fait que la TVA est à 19,6 %...
Profitons de l'expérience de terrain. Je n'ai pas de formation d'ingénieur, mais je découvre tous les jours de nouvelles choses. Il faudrait mieux communiquer. Les échanges et les retours d'expérience seraient utiles, d'autant que les PNPP sont utilisées sous des climats différents, dans des régions différentes, et selon des pratiques différentes.
Les thrips, devenus résistants, imposent de plus en plus de traitements. Mais on peut se passer de la chimie.
Dans l'horticulture, sur les jeunes plants, il ne faut pas de chimie. D'où l'usage de plus en plus fréquent des PNPP par les horticulteurs.
Je pense à certaines maladies cryptogamiques du framboisier. Ça marche, mais on ne sait pas pourquoi. Nous avons besoin de davantage de recherche fondamentale. L'effet est mesurable, mais les mécanismes à l'oeuvre sont inconnus.
Le problème du coût reste entier. Il n'y a pas d'économies d'échelle. L'université de Limoges s'est engagée à nous épauler, mais c'est insuffisant.

En résumé, vous demandez davantage de recherche et le droit d'utiliser les PNPP.
Nous souhaitons avoir le droit de choisir.
Il faut prendre en compte les conditions climatiques de chaque région, la pluviométrie : ce qui vaut ici fonctionnera moins bien ailleurs. On ne peut, comme les conseillers en produits phyto, prescrire de la même façon sur tout le territoire.
Je ne sais pas si elles interviennent toutes de la même façon. Chez nous, la chambre d'agriculture promeut Écophyto 2018 et a sensibilisé tous ses agents. Il y a des solutions concrètes, transposables et peu onéreuses. J'ajoute que les enfants jouent un rôle non négligeable, car un agriculteur n'aime pas entendre les siens l'accuser d'être un pollueur... Dans tous nos bulletins sanitaires, nous mettons en avant les solutions bio.
Des exploitations seront sauvées grâce à ces solutions, qui coûtent tellement moins cher !
Nous attendons les décisions européennes avec impatience !
Audition de M. François Werner directeur du fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions fgti et de Mme Nathalie Faussat responsable au fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions fgti
Audition de M. François Werner directeur du fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions fgti et de Mme Nathalie Faussat responsable au fonds de garantie des actes de terrorisme et autres infractions fgti

Des victimes de pesticides ont-elles déjà eu recours à vous ? Constatez-vous une évolution dans ce domaine ?
Le FGTI est responsable de l'indemnisation des victimes de terrorisme et d'infractions ; depuis 2008 lui a été adjoint un service d'aide au recouvrement pour les victimes d'infractions bénéficiant d'une décision de justice définitive ; nous nous retournons ensuite contre les auteurs. Pour être éligible à cette indemnisation, qui doit être intégrale, il faut d'abord que la victime soit décédée ou présente une incapacité permanente ou une incapacité temporaire supérieure à 30 jours ; il faut ensuite que l'événement en cause présente le caractère matériel d'une infraction - c'est une des difficultés dans le cas des pesticides. Il faut enfin que la commission d'indemnisation reconnaisse le lien entre l'infraction et le préjudice, ce qui est parfois compliqué. Ce dispositif est séparé de la procédure pénale ; il est souvent plus rapide à mettre en oeuvre.
Parfois, les événements sont complexes : dans beaucoup de cas, comme celui de l'accident du vol Rio-Paris, nous devons surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction pénale compétente se soit prononcée. Nous avons aussi eu à traiter des cas d'intoxication, le Mediator ou le saturnisme. Là, l'établissement du lien entre la maladie et le produit empoisonnant peut juridiquement passer par la voie de droit commun de la réparation du préjudice corporel.
L'amiante fait l'objet d'un fonds spécifique. La procédure de la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ne s'applique pas à ces dossiers. Quant aux pesticides, quelques demandes d'indemnisation sont en cours, qui se comptent sur les doigts d'une main ; nous allons prudemment, parce que nous ne disposons pas toujours de l'information.
C'est une difficulté. Pour démontrer l'existence matérielle de l'infraction, le juge civil est démuni. En l'absence de plainte, nous ne disposons pas de l'action récursoire contre les personnes qui seraient responsables.
Le cas échéant...
La procédure devant la CIVI n'est pas publique... Je vais rester prudent... Dans un cas, une multiplicité de produits est en cause... Je peux au moins vous dire cela !

Les victimes vont au pénal d'abord. Les demandes directes devant le Fonds de garantie sont rares.
De telles demandes ont toutes les chances d'être rejetées si elles ne s'appuient pas sur une enquête pénale. Mais, et c'est là tout l'intérêt de la procédure CIVI, s'il devient évident au cours de la procédure qu'il y a un lien entre l'infraction et le dommage subi par la victime, on n'attend pas l'épuisement des voies de recours pour statuer...

Les cas pendants ont-ils, ou peuvent-ils, inciter d'autres agriculteurs qui seraient dans la même situation à engager une procédure ?
Il y a cent CIVI en France, l'information n'est pas disponible en temps réel. Mais nous n'avons pas vu exploser le nombre de demandes.

Pourtant, les agriculteurs veulent voir reconnaître le lien entre certaines maladies et les pesticides...
Quelqu'un qui serait bien conseillé juridiquement n'irait pas directement devant une CIVI.

Dans une des affaires, le Fonds ne s'est-il pas opposé à la demande de la victime ?
Il est essentiel qu'il y ait une plainte, ne serait-ce que pour préserver nos propres capacités de recours ; et parce que le lien entre maladie et exposition aux pesticides est difficile à établir. Après, s'il y a une expertise... La décision ne nous appartient pas.

Il semble qu'il y ait assez peu de doutes sur le lien de cause à effet. Mais comment qualifier l'infraction ? En matière d'exposition aux pesticides, c'est nouveau. Nous parlons ici d'un cocktail bien connu, et depuis longtemps. Pourquoi aurait-il un effet sur telle personne et pas sur telle autre ?
Les produits en cause sont tous autorisés. Ce qui pourrait constituer une infraction, c'est le défaut d'information sur les produits.

C'est au civil que les actions peuvent prospérer. En matière de défaut d'information, il n'y a pas nécessairement infraction...
La difficulté est alors de retrouver le responsable final.
Nous n'indemnisons que les dommages à la personne, les préjudices à caractère patrimonial et à caractère extrapatrimonial, un éventuel préjudice d'agrément, selon les règles de droit commun d'indemnisation des préjudices corporels.
Dans les cas les moins graves, sous forme de capital ; sous forme de rente dans les cas les plus graves.
Les indemnisations totales versées pour une année s'élèvent à 270 millions d'euros.
Non. Mais nous ne remboursons pas les frais médicaux. Certaines indemnisations concernant des victimes très jeunes et très lourdement handicapées atteignent 6 à 7 millions d'euros.

Et c'est la plainte au pénal qui permet de faire la preuve de l'infraction ...
La CIVI peut réaliser des examens sur la situation de la personne, évaluer les préjudices. Mais l'expertise civile a ses limites. Seule la procédure pénale et les moyens d'expertise qu'elle mobilise valent pour établir le lien entre l'infraction et le préjudice. Une fois qu'il est établi, cependant, on l'a vu avec le saturnisme, les commissions d'indemnisation l'admettent assez facilement si les mêmes symptômes apparaissent chez des personnes exposées dans les mêmes conditions.