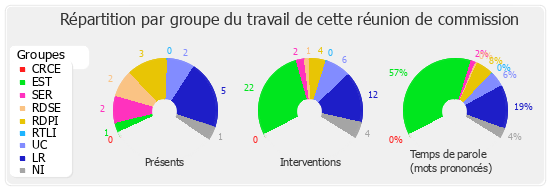Commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire
Réunion du 21 novembre 2012 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion
La commission procède à l'examen des amendements sur la proposition de loi n° 747 (2011-2012), présentée par Mme Marie-Christine Blandin et plusieurs de ses collègues, relative à la création de la Haute Autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte en matière de santé et d'environnement.

La discussion générale sur la proposition de loi de Mme Marie-Christine Blandin a eu lieu le 15 octobre dans l'hémicycle. Les débats reprendront cet après-midi avec l'examen des articles. Il nous faut donc nous prononcer sur les amendements déposés sur le texte. Je crois, monsieur le rapporteur, que vous avez aussi de nombreux amendements nouveaux à nous proposer.

D'abord un résumé des épisodes précédents : nous nous sommes déjà réunis pour étudier mes amendements au texte de la proposition de loi inscrite à l'ordre du jour dans le cadre de la niche du groupe écologiste. Je cherchais à adapter ce texte aux évolutions intervenues avec la loi Bertrand, ou loi Mediator. Car le texte de Mme Blandin était ancien ; il avait à l'époque reçu le soutien de M. Borloo, mais il fallait actualiser certaines dispositions, revoir le statut du lanceur d'alerte et apprécier les implications, lourdes, de la création d'une cellule d'alerte dans les entreprises.
Mes amendements avaient été adoptés, mais non le texte dans son ensemble, si bien que le débat en séance publique ne pouvait avoir lieu. C'est pourquoi je présente de nouveaux amendements. J'ai tenu compte des remarques des uns et des autres et travaillé en concertation avec les ministères de la Santé, de la Recherche, de l'Environnement et du Travail. Devant le manque d'enthousiasme suscité par la création d'une nouvelle autorité administrative indépendante, je propose d'y renoncer. D'autres dispositions sont de vraies avancées. Le gouvernement a proposé la création d'un registre des alertes au sein des agences. Le dispositif en entreprise est cohérent, conforme aux attentes des syndicats, que Mme Archimbaud, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales, a rencontrés. Nous étions au milieu du gué, le statut de lanceur d'alerte n'existait que dans le secteur du médicament. Nous l'étendons. Le texte constitue une avancée.

Je suis étonné par ces amendements qui modifient considérablement un texte... que notre commission a déjà rejeté. Il est dommage que la concertation ait eu lieu avec le gouvernement, mais pas avec les groupes politiques, en tout cas pas avec le mien. Le texte a considérablement changé : la Haute autorité est devenue une commission de la déontologie et des alertes, ses missions ont été revues à la baisse, et sa composition, désormais très classique, compte essentiellement des hauts fonctionnaires et non plus des professionnels ou des responsables associatifs. Cette instance dépourvue de budget s'apparente à une coquille vide. On crée une nouvelle commission Théodule, sans financement ni véritables pouvoirs.

Je partage cette analyse. De toute façon, à quoi servons-nous quand Mme Blandin explique dans les médias que tout est déjà décidé ? Arrêtons de créer des commissions Théodule, réaffirmons le rôle du Parlement et des commissions parlementaires. C'est une mauvaise politique de créer à tout bout de champ une commission pour faire plaisir à tel ou tel. Si encore on supprimait cinq commissions quand on en crée une... A quoi sert le Parlement s'il faut la bénédiction de l'exécutif pour voter un texte ? Nous rejetterons la proposition de loi, parce qu'il faut savoir dire stop. L'auteur de la proposition de loi a reçu la bénédiction de l'exécutif, mais elle n'a pas demandé la nôtre ! C'est une fumisterie, on amuse la galerie, mais on dévalue le travail parlementaire.

Ces deux interventions me surprennent. Le rapporteur a cherché à obtenir un accord dans un esprit de consensus. Il a écouté vos objections. Cela me semble de bonne méthode ! Comment lui reprocher de vouloir modifier le texte qu'en l'état vous rejetiez ? Avouez plutôt que le texte ne trouvera jamais grâce à vos yeux, quelque aménagement qu'on y apporte. Discuter avec le gouvernement me paraît de bonne méthode, positive pour tout le monde.
Qu'il y ait trop d'autorités administratives indépendantes, je l'admets. Ce texte vise, quant à lui, à mettre en place une expertise pluraliste, à protéger les lanceurs d'alerte, tout en évitant de créer une nouvelle autorité indépendante. Evitons les postures d'opposition. Mon groupe émettait des réserves, il est désormais satisfait. La consultation a associé le gouvernement, les groupes de la majorité susceptibles de soutenir le texte, puis notre commission.

Nos objections n'ont pas varié. Nous refusions la création d'une structure supplémentaire, or le texte ne change rien à cet égard. Il existe trois autorités, il aurait fallu les regrouper, à périmètre constant. La bonne méthode, c'est appliquer la loi. Celle de 2009 prévoyait un rapport pour apprécier l'utilité de créer une autorité de prévoyance et d'alerte. Pourquoi ce rapport n'a-t-il pas été établi ? Quel avenir aura cette structure croupion ?

Ces arguments m'étonnent. Comment ne pas travailler avec le gouvernement en amont, sur un tel sujet ?
Titre 1er

L'amendement n° DEVDUR-2 modifie la dénomination de la Haute autorité, qui devient une « commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d'environnement », dénomination plus adaptée au contenu de ses missions. Il ne s'agit pas d'une commission croupion puisqu'elle rassemblera les corps constitués. Mme la ministre précisera en séance sa composition. La création de la commission s'effectue à moyens constants.

Cet amendement répond à nos observations. Il s'agit d'éviter la création d'une nouvelle autorité chargée de l'expertise de l'expertise. La création de la commission s'effectue à moyens constants. Les objections du groupe RDSE tombent...
L'amendement n° DEVDUR-2 est adopté.
Article 1

L'amendement n°DEVDUR-3, comme les suivants, précise le rôle de la commission en matière d'expertise et d'alerte. La haute autorité est remplacée par une commission nationale de la déontologie, structure plus légère. Les agences n'y sont pas hostiles. L'amendement n°4 est dans le même esprit.
L'amendement n° DEVDUR-3 est adopté, ainsi que l'amendement n°DEVDUR-4.
J'en viens à l'amendement n° DEVDUR-5 : la commission sera consultée sur les codes de déontologie mis en place dans les établissements et organismes publics relevant des domaines de la santé et de l'environnement.
L'amendement n° DEVDUR-5 est adopté.
L'amendement n° DEVDUR-6 précise que la commission n'instruit pas elle-même les alertes au fond, mais les transmet aux ministres compétents, qui l'informent des suites données.

Cette transmission est-elle automatique ou bien dépend-elle de l'appréciation de la commission ?

Il s'agit là du travail normal de l'administration. Est-il nécessaire de l'inscrire dans la loi ?

Les lois inutiles affaiblissent celles qui sont nécessaires. Si tout le monde alerte tout le monde, dans quel monde vivrons-nous bientôt ! Il y a déjà des agences qui fonctionnent. Souvenons-nous du rapport de MM. Descours et Huriet : dès 1995, des agences de veille ont été créées, coiffées par une agence au niveau européen. Cependant, dès qu'elles émettent un avis, elles sont critiquées. Respectons l'architecture existante plutôt que de procéder à de nouvelles créations.
L'amendement n° DEVDUR-6 est adopté.
Les amendements de cohérence n°s DEVDUR-7 et DEVDUR-8 sont adoptés.

L'amendement n° DEVDUR-9 confie à la commission une mission de diffusion des bonnes pratiques et, surtout, de dialogue avec la société civile.

J'ai l'expérience du Haut conseil des biotechnologies créé en 2008, finalement sorti des fondamentaux que nous avions patiemment construits. Le comité scientifique émet des avis, le comité économique, social et éthique formule des recommandations. Nous devons écouter les scientifiques. Or à chaque fois que le conseil scientifique s'exprime, le comité économique et les politiques s'en mêlent. Que chacun reste à sa place !

Certains scientifiques sont aussi des militants et se comportent même en idéologues. La décision doit revenir in fine aux hommes politiques. Plus il y a d'avis analysant le déroulement de la recherche, mieux c'est.

Je me méfie d'un avis scientifique isolé. La collégialité permet d'éviter toute dérive. Revenons aux fondamentaux. Le rôle des politiques n'est pas l'expertise mais la décision. Ne diluons pas les responsabilités. Plus on crée d'agences dans différents domaines, plus l'on accroît l'angoisse des citoyens.

Ne créons pas des machines à ne rien faire. Ne cherchons pas vainement des certitudes. La science c'est le doute. Le principe de précaution peut être source d'inaction. M. Kouchner n'a-t-il pas suspendu la vaccination contre l'hépatite en raison de craintes, infondées, d'un lien avec la sclérose en plaques ? Il y a là un danger pour le progrès. Peut-être est-ce un progrès politique de créer des autorités, mais cela en vaut-il le coup ? La vie est pleine de doutes.

Cette proposition de loi vise uniquement à protéger les lanceurs d'alertes. Ne confondons pas les enjeux. Il n'est pas question ici du progrès ! Une société est démocratique quand le pouvoir politique fait des choix et rend des comptes. Les experts ne sont pas infaillibles. Des expertises multiples permettent d'apprécier si les alertes sont pertinentes.

La nouvelle commission ne dispose d'aucune compétence scientifique. La Haute autorité réunissait les représentants des différentes agences mais la nouvelle structure regroupe des « technocrates ». Elle sera inutile - un organisme fade, insipide et sans saveur. L'absence de scientifiques à son tour de table n'est qu'un des nombreux paradoxes de ce texte.
L'amendement n° DEVDUR-9 est adopté.
Article additionnel après l'article 1

L'amendement n° DEVDUR-10 illustre l'importance des travaux de concertation menés en amont avec le gouvernement, indépendamment de toute posture. Il prévoit que les établissements ayant une activité d'expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l'environnement tiennent un registre des alertes qui leur sont transmises. Et il en définit les conditions d'accès. Si nous avions pu établir une telle traçabilité dans le passé, elle nous aurait évité bien des crises.

Nous ne sommes pas dans une posture. Chacun a compris que la majorité souhaite faire aboutir une proposition de loi des Verts. Nous dénonçons cette finalité et ne prendrons pas part à la discussion ni aux votes.

La création d'un registre est une bonne chose. Une loi est-elle pour autant nécessaire ? Nous nous abstiendrons. Néanmoins cet amendement a une autre vertu, politique : les Verts estiment utile de discuter avec le gouvernement. C'est la première fois que l'on entend cela depuis le mois de mai !

Oui la majorité doit aider les Verts à faire voter un bon texte.
L'amendement n° DEVDUR-10 est adopté.
Article 2
L'amendement de cohérence n° DEVDUR 11 est adopté.

Les organisations interprofessionnelles représentatives des salariés et des employeurs au niveau national se voient reconnaître, par l'amendement n° DEVDUR-12, un droit de saisine de la commission.
L'amendement n° DEVDUR-12 est adopté.
L'amendement de cohérence n° DEVDUR-13 est adopté.
L'amendement n° DEVDUR-14 supprime la possibilité de saisine directe par des particuliers. La saisine reste réservée aux associations agréées, aux organisations professionnelles, ainsi qu'aux établissements publics ou d'enseignement supérieur, parce que nous ne souhaitons pas créer une usine à gaz ingérable, qui nécessiterait des moyens supplémentaires de l'État.
L'amendement n° DEVDUR-14 est adopté.
L'amendement de cohérence n° DEVDUR 15 est adopté.
Article 3

L'amendement n° DEVDUR-16 prévoit que des représentants du Conseil économique, social et environnemental siègent aux côtés des parlementaires, des membres du Conseil d'État et de la Cour de cassation et des personnalités qualifiées. Il ne s'agit pas d'une commission croupion.

Les Verts y siègent-ils de droit ?
L'amendement n° DEVDUR-16 est adopté.
Article 4

L'amendement n° DEVDUR-17 renvoie à un décret en Conseil d'État la composition et les modalités de fonctionnement de la commission. A la différence de M. Cornu, je pense que des lieux de dialogue, où l'ensemble des sensibilités sont représentées, sont nécessaires.
L'amendement n° DEVDUR-17 est adopté.
Article 5

Les membres de la commission et les personnes collaborant à ses travaux sont soumis à une obligation de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance. Ils devront, en outre, souscrire une déclaration publique d'intérêts, dont le champ est précisé par l'amendement n° DEVDUR-18.

Les liens d'intérêts sont gages de la compétence des experts, seuls les conflits d'intérêts sont répréhensibles.

Pensez-vous que cette commission, si elle était déjà installée, aurait pu régler la question de l'aéroport de Notre-Dame des Landes ?
L'amendement n° DEVDUR 18 est adopté.
Article 6
L'amendement de cohérence n° DEVDUR-19 est adopté.
Article 7

L'article 7 prévoit que la commission nationale établit chaque année un rapport, adressé au Parlement et au Gouvernement, qui évalue les suites données à ses avis et à ses alertes, et présente ses recommandations éventuelles. L'amendement n° DEVDUR-20 en précise le contenu et la publicité. La commission nationale ne possède pas en son sein d'expertise spécialisée mais fixe un cadre dans la transparence. Elle renforce l'efficacité du débat démocratique.
L'amendement n° DEVDUR-20 est adopté.
Article 8

L'amendement n°41 rectifié met sous la protection du Défenseur des droits les lanceurs d'alerte. Le groupe RDSE initialement opposé à la création d'une Haute autorité puis d'une commission souhaitait conserver la protection des lanceurs d'alerte. Nous avons reçu depuis des explications satisfaisantes.

Avis favorable car la mention du Défenseur des droits renforce la loi. Quant à la suppression de la référence à la Haute autorité de l'expertise, elle est satisfaite par les amendements que nous avons adoptés.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 41 rectifié sous réserve de la suppression du paragraphe II.

L'amendement n° DEVDUR-21 est rédactionnel. Je déplore l'absence de consensus. Il ne s'agit pas d'une posture politicienne. Les lieux nous manquent pour remonter les alertes de manière apaisée. Le seul canal aujourd'hui est le recours aux médias et au battage médiatique.

Nous sommes moins critiques sur les lanceurs d'alerte que sur la création d'une commission. Les alertes sont parfois nécessaires, mais doivent être utilisées avec prudence pour éviter la diffamation ou le discrédit, malveillants ou non. Si nous avions disposé d'un rapport, en application de la loi de 2009, pour définir les meilleures procédures possibles, nous aurions sans doute trouvé un consensus. Nous sommes d'accord sur le principe mais souhaitons des garanties : obligation de discrétion, sanction lourde en cas de manquements, etc. car les conséquences peuvent être graves.

Tel est l'objet de l'amendement ! L'existence d'une commission de déontologie, indépendante de l'État, consultative, composée de personnalités de la société civile, conforte les agences en validant les procédures et les règles déontologiques. Les agences elles-mêmes y sont favorables. Il s'agit d'une loi de modernisation sociale, d'un enjeu majeur de société, non d'une loi politicienne.
L'amendement n °DEVDUR-21 est adopté.
Article 9 à 14

La commission des affaires sociales a examiné la proposition de loi pour avis le 10 octobre dernier. Sa présidente et vous-même, monsieur le président, avez mis en application le protocole de concertation sociale et les partenaires sociaux ont tous été consultés. Nous avons pu en outre auditionner le Medef, la CFDT, la CFTC et la CGT. Nous avons concentré notre travail sur la partie entreprises, afin d'articuler la proposition de loi avec le code du travail. De l'avis des partenaires sociaux, la création d'une nouvelle cellule au sein des entreprises, parallèlement aux institutions représentatives du personnel existantes - CHSCT pour les entreprises de plus de 50 salariés, délégués du personnel pour les autres - paraissait beaucoup trop lourde.
Nos amendements sont tous rédigés dans le même état d'esprit : ils tendent à élargir les compétences des structures existantes, en y ajoutant l'alerte, l'information, la santé au travail, la santé publique et la santé environnementale. Les partenaires sociaux estiment que la proposition répond à une vraie demande pour plus de protection. La pression du chômage accroît le risque d'autocensure. Le filtre du CHSCT protège l'entreprise de la diffamation ou d'une volonté de nuire.

Il est vrai qu'on peut imaginer des actions visant à nuire, pour des raisons concurrentielles notamment. Il est donc important de commencer par traiter le problème au sein de l'entreprise.

Tous nos amendements poursuivent le même but, le n° 2 comme les suivants. A l'article 16, l'amendement n° 11 complètera l'article L. 1132-1 du code du travail pour ajouter à la liste des personnes ne pouvant être écartées d'un recrutement, sanctionnées ou licenciées, celles qui ont été à l'origine d'une alerte. L'alerte ayant été relayée par le CHSCT, elle a été filtrée.

Parmi tous ces amendements, je m'interroge sur l'amendement n° 9 : il va à l'encontre de l'esprit du texte. Toute personne peut saisir l'agence régionale de santé (ARS), dispose-t-il. Or, nous introduisons des amendements en vue d'instaurer un tri et refusons donc la saisine directe...

Dans les entreprises de moins de onze salariés qui n'ont pas de délégués du personnel, c'est l'ARS qui filtrera.

Une précision : la commission indépendante ne peut pas être saisie par les particuliers. En revanche, tout individu peut saisir l'ARS, ce qui est logique car l'ARS, c'est l'Etat.

J'ai fait toute ma carrière dans la pharmacie : que se passera-t-il si des salariés de l'entreprise émettent des doutes sur la formule ou les excipients d'un produit ? Va-t-on aller jusqu'à bloquer le processus de fabrication industriel ?

Le climat est souvent tendu et fragile dans une entreprise et certains salariés sont plus interventionnistes que d'autres. Soyons prudents. Sinon, nous avons un risque de dysfonctionnement majeur.

Le CHSCT filtrera les alertes dans les entreprises de plus de cinquante salariés. Ses règles de fonctionnement sont précises, il ne se réunit pas n'importe comment. Les alertes seront traitées de la même façon que celles qui concernent la santé au travail : la procédure est très cadrée.

L'alerte concerne-t-elle uniquement la mise en danger de la santé du travailleur ou peut-elle avoir un motif plus large ? Nous sommes ici dans un cas limite : a priori, la production d'une entreprise pharmaceutique a fait l'objet d'un agrément. Or, dans le cas des implants mammaires, ceux qui les fabriquaient savaient qu'ils étaient constitués de produits tendancieux, pour ne pas dire plus. Je suppose que l'entreprise avait obtenu un agrément. Faut-il préciser que l'alerte ne concerne que la mise en danger du personnel ou qu'elle peut dénoncer une formule qui aboutirait à l'arrêt de la production ? C'est un cas un peu difficile.

L'amendement n° 3 prévoit un encadrement des dispositions du titre II. D'autres articles, l'article 19 notamment, visent à éviter la dénonciation calomnieuse.

En effet, mais le temps d'appliquer l'amendement n° 3, les dégâts peuvent être déjà irréparables.

Notre collègue pose une question fondamentale ! Je ne mets pas en doute la bonne foi du rapporteur, mais des dérives sont à craindre. Le rapporteur nous parle d'apaisement et de consensus, mais la réalité est beaucoup plus conflictuelle. J'ai été rapporteur du projet de loi sur le principe de précaution. A l'époque de la vache folle et de l'affaire du sang contaminé, il fallait rassurer nos concitoyens. Mais de la précaution, nous sommes passés à l'inaction et il serait pertinent de réfléchir à un autre principe, le principe d'innovation. Si nous n'appliquons pas celui-ci, nous entrons dans le XXIème sur une seule jambe, celle du principe de précaution. Malgré ses bonnes intentions, je ne voterai pas ce texte, compte tenu des dérives possibles, face auxquelles le législateur sera impuissant.

Je propose que notre commission émette un avis favorable à l'ensemble des amendements présentés par la commission des affaires sociales.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n°1 à l'article 9, à l'amendement n°2 à l'article 10, à l'amendement n°3 à l'article 11, à l'amendement n°4 à l'article 13, à l'amendement n°5 à l'article 14, ainsi qu'aux amendements n°6, 7, 8 et 9 portant articles additionnels après l'article 14.
Article 15
L'amendement de cohérence n° DEVDUR-22 est adopté.
Article additionnel avant l'article 16
La commission émet un avis favorable à l'amendement n°10.
Article 16

L'amendement n° DEVDUR-23 tend à supprimer l'article 16 car ses dispositions figurent déjà dans le code de la santé publique, il n'est pas souhaitable de les inscrire dans le code pénal. L'amendement n° 11 inscrit dans le code du travail la protection des lanceurs d'alerte. Je me rallie à cette position et retire l'amendement n° DEVDUR-23.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 11 sous réserve d'une rectification.
Article 17

L'article 17 est fondamental, il étend la protection des lanceurs d'alerte. Dans mon amendement n° DEVDUR-24, je calque le dispositif sur celui qui figure dans la loi Médiator.
L'amendement n° DEVDUR-24 est adopté.
Article 18

L'article 18 est redondant. Mon amendement n° DEVDUR-25 le supprime.
L'amendement n° DEVDUR-25 est adopté.
Article 20
L'amendement de cohérence n° DEVDUR-26 est adopté.
Article 21

L'amendement n° DEVDUR-27 supprime un article redondant.
L'amendement n° DEVDUR-27 est adopté.
Article 22

Même chose avec l'amendement de suppression n° DEVDUR-28.
L'amendement n° DEVDUR-28 est adopté.
Intitulé de la proposition de loi

Nous vous proposons enfin, avec l'amendement n° DEVDUR-1, de modifier comme suit l'intitulé de la proposition de loi : « Proposition de loi relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte ».
L'amendement n° DEVDUR-1 est adopté.
Les avis sont repris dans le tableau ci-dessous.
La commission examine le rapport pour avis sur les crédits « transports routiers » de la mission « Écologie, développement et aménagement durables » du projet de loi de finances pour 2013.

Il me revient de vous présenter les crédits « routes » du projet de loi de finances pour 2013. Certains pourraient penser qu'il est paradoxal de confier les routes aux écologistes. Je voulais donc dire ici l'intérêt que j'ai trouvé à l'exercice, à la fois parce que nous avons évidemment besoin de routes, mais aussi parce que le budget routes, ce ne sont pas que des dépenses, mais aussi des recettes dont l'affectation vers le rééquilibrage modal est stratégique.
Quelques mots de contexte. Ce budget précède la redéfinition du SNIT. Nous en avons déjà largement évoqué les enjeux et les difficultés lors de l'audition de Frédéric Cuvillier et lors de notre débat sur les transports terrestres rapportés par Roland Ries. Nous devons parler des infrastructures elles-mêmes, de leur articulation en réseau, mais aussi de leurs usages et des outils dont nous disposons pour choisir les infrastructures et infléchir les usages qu'en font nos compatriotes. Nous devons réunir un très grand nombre d'informations et coordonner des actions d'échelle temporelle très variable, depuis les infrastructures elles-mêmes, qui demandent une prospective à long terme, jusqu'aux actions normatives, qui changent immédiatement certaines conditions du transport, en passant par les enjeux de moyen terme que représente le plus ou moins bon entretien des routes, par exemple.
Or, j'ai été surpris de ce que les services de l'Etat n'appréhendent pas mieux « l'économie générale » de la route. Nous manquons d'une vision stratégique de ce que coûtent et de ce que rapportent les routes dans leur ensemble, toutes collectivités publiques confondues.
Le Grenelle de l'environnement a fixé un cap, avec des objectifs quantitatifs de réduction des gaz à effet de serre et des objectifs qualitatifs sur le choix des infrastructures et la réorientation de la dépense publique. Je reconnais très volontiers, et vous constaterez que je ne fais pas de politique au sens étroit du terme, qu'il y a eu du bon avec le Grenelle de l'environnement : il y a même un « avant » et un « après » Grenelle, quoique l'impact en ait varié selon les domaines. Le président de la République vient de fixer un nouvel objectif très ambitieux : réduire de 40 % nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Cependant, le bilan carbone des transports s'alourdit, du fait de l'augmentation des déplacements : nous sommes encore loin du compte !
C'est dans ce contexte que j'ai souhaité aller au-delà d'une simple présentation des chiffres et apporter une contribution au débat que nous mènerons sur le SNIT.
D'abord sur « l'argent de la route », c'est-à-dire les crédits d'Etat que je vous présenterai, mais plus largement l'argent que nous prélevons sur la route, en particulier sur les concessionnaires autoroutiers et sur les transporteurs routiers. A quoi vont servir les crédits « routes » de ce projet de loi de finances ? Peut-on prélever davantage sur l'usage de la route, pour accélérer le report modal ?
Ensuite, sur la sélection des projets d'infrastructures et l'utilisation des outils incitatifs : les infrastructures sur lesquelles nous mettons des moyens sont-elles bien celles dont nous avons besoin ? Comment en décide-t-on ? Comment en débattrons-nous dans le cadre du SNIT ?
Enfin, utilise-t-on suffisamment les outils dont nous disposons pour infléchir les comportements, en particulier le levier du bonus/malus et les normes dites « environnementales » ?
D'abord, l'argent de la route, en particulier les grands chiffres de ce budget. Au sein du programme 203 « Infrastructures et services de transports », 731 millions sont consacrés au développement des infrastructures routières et 661 millions à l'entretien et à l'exploitation des 11 500 kilomètres du réseau routier national non concédé, dont 9 000 kilomètres de routes nationales. Ces chiffres sont satisfaisants, parce que la partie « entretien préventif et grosses réparations » progresse de près de 11 %, à 115 millions d'euros, qui vont servir à l'entretien courant, à des travaux d'amélioration de la sécurité et aux services, notamment l'information des usagers de la route. L'Etat limitera strictement l'augmentation de capacité du réseau routier au traitement des points de congestion, des problèmes de sécurité ou à des besoins d'intérêt local en limitant les impacts sur l'environnement : c'est conforme aux engagements du Grenelle de l'environnement. Il s'agit principalement d'élargissements de routes existantes, de déviations ou d'achèvement de rocades.
Autre point de satisfaction, les crédits de l'AFITF augmentent, du moins sur le papier : nous en avons débattu sur les transports terrestres, il faut que les 400 millions de l'écotaxe poids lourds soient au rendez-vous pour que la hausse soit effective.

Nous y serons tout aussi vigilants que vous et je n'oublie pas que, comme vous l'avez dit, le produit de la taxe pourrait être minoré par les reports de trafic sur les autoroutes, ce qui était l'un des objectifs de l'écotaxe poids lourds évoqués lors du Grenelle. Ces reports vont accroître les revenus des sociétés d'autoroute, ce qui rend légitime d'en récupérer une partie. Frédéric Cuvillier a annoncé une augmentation de la redevance domaniale de 200 millions d'euros, cela ne représentera qu'une faible ponction sur les bénéfices des autoroutes. Ces moyens supplémentaires devront être alloués aux alternatives à la route, en particulier aux trains d'équilibre du territoire (TET).
Les sociétés concessionnaires, privatisées en 2005 pour 15 milliards d'euros, ont dégagé l'an passé un résultat net cumulé de 1,94 milliard d'euros. Un tel rendement dans les infrastructures de transports à si brève échéance, c'est plutôt rare ! Sans porter aucun jugement de valeur, cette privatisation n'est-elle pas devenue si profitable qu'on puisse légitimement y voir une forme de captation de l'investissement public d'hier, voire d'aujourd'hui ?
Quoi qu'il en soit, nous devons être vigilants lorsque les sociétés concessionnaires proposent de prolonger la durée de leur concession en échange de travaux pour améliorer le service, pour respecter certaines normes environnementales, ou encore en échange de nouveaux segments et « petits bouts manquants » de voies, ce que le Conseil d'Etat a accepté dans le principe. Ces propositions sont habiles : l'Etat manque de moyens, les sociétés d'autoroutes en ont beaucoup, pourquoi ne pas prolonger un peu la bonne affaire, quitte à y consacrer une partie des bénéfices : c'est de la bonne gestion d'une affaire bien rentable... Est-ce dans l'intérêt général ? Je ne le pense pas, et je préfèrerais voir les autoroutes revenir dans le giron public, puisqu'elles sont une véritable « manne ». Comment en débattrons-nous ? Des questions se posent pour le transfert de nouveaux segments de routes à des sociétés concessionnaires, où l'intérêt pour la collectivité ne va pas de soi - je pense en particulier à l'A63 (ex RN 10) au sud de Bordeaux, à la RN 154 Orléans-Dreux, ou encore à la route centre Europe Atlantique (RCEA) entre Moulins et Mâcon. Je serai très attentif sur ce point.
Deuxième sujet : la sélection des projets d'infrastructures, et plus largement les choix qui président à l'allocation des ressources.
Le Grenelle de l'environnement a largement débattu des critères devant présider au choix d'infrastructures et à l'allocation des ressources publiques. La loi « Grenelle I » a énoncé et hiérarchisé six critères tenant aux émissions de gaz à effet de serre, aux perspectives de saturation et à la sécurité, à la performance environnementale, à l'accessibilité multimodale, au développement économique, à l'aménagement des territoires et enfin à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Cette nouvelle « ligne » préside-t-elle à la sélection des projets, à la répartition des ressources dont nous disposons ? A ma grande surprise, j'ai constaté que les nouveaux critères n'étaient pas véritablement intégrés. Pour instruire les dossiers, l'administration utilise toujours une instruction cadre de 2004, rédigée pour prendre en compte le rapport « Boiteux II » de 2001 ! Cette lenteur est décalée avec l'agenda politique du Grenelle et la demande sociale. L'administration m'a répondu que les services travaillaient à une « actualisation » de cette instruction, sans plus de précision. Le risque, c'est que cette grille de critères économiques, sociaux et environnementaux, ajustée au Grenelle de l'environnement, ne soit pas disponible pour la commission « Mobilité 21 », dont la commande politique est précisément de hiérarchiser les projets.
Je n'ai pas l'illusion qu'une grille parfaite existe, je sais bien qu'il faut toujours tenir compte de facteurs particuliers d'aménagement du territoire. Mais nous sommes en retard sur la stratégie d'ensemble et le défaut d'analyse ne peut que faire perdurer le choix « au doigt mouillé »... L'existence même de l'AFITF sanctuarise des crédits pour les infrastructures, c'est indispensable à la visibilité des investissements, mais nous devons y ajouter davantage d'analyse, pour préciser notre stratégie et mieux arbitrer entre les projets.
Voyez le 44 tonnes, exemple même où la stratégie d'ensemble n'est pas claire. On finance le report modal, mais on va autoriser les poids lourds de 44 tonnes sur 5 essieux à circuler sur nos routes jusqu'en 2019 : qu'est-ce qui aura le plus d'impact ? On aide les autoroutes ferroviaires mais des 44 tonnes vont traverser notre territoire du nord au sud : quel sera le bilan croisé de ces deux mesures, pour le report modal ? Et pour l'état de nos routes ? Ne risque-t-on pas que les 44 tonnes dégradent nos routes bien davantage qu'on ne pourra les réparer grâce aux moyens supplémentaires que nous consacrons aux « grosses réparations » ? Je ne fais que poser les questions, mais pour constater que ces calculs ne sont pas faits, faute d'une vision globale.
Le « bleu » budgétaire n'hésite pas à souligner l'« orientation résolument intermodale » de ce budget : est-ce véritablement le cas ? Pour le savoir, il faudrait comparer l'ensemble des mesures : les investissements, les actions spécifiques, bien sûr, mais aussi les actions incitatives et l'ensemble des normes qui ont une incidence sur l'usage des infrastructures. Je partage l'opinion exprimée par Rémy Pointereau sur les transports terrestres : les infrastructures de transports sont des équipements si utiles qu'on ne peut pas les regarder seulement en termes de dette, il faut considérer leur utilité très largement, bien au-delà de leur rentabilité à court terme.
Des changements d'ordre normatif peuvent modifier les conditions de rentabilité de grandes infrastructures. Je pense aux autoroutes ferroviaires, par exemple celle entre le Luxembourg et l'Espagne. Dès lors qu'une telle infrastructure existe, ne faut-il pas interdire ou rendre plus contraignante la traversée de notre territoire sur le même parcours ? La contrainte n'est-elle pas un moyen d'accélérer la mise en place des infrastructures que nous voulons ? Ici encore, je n'ai pas les réponses, mais je regrette que l'analyse présentée par l'Etat ne soit pas plus globale, qu'elle ne permette pas suffisamment de comparer ce qui se passe sur plusieurs plans, pour que nous puissions apprécier l'effet conjoint des investissements et des normes. C'est un débat important dans le cadre du SNIT, autant s'y préparer !
Autre sujet, qui mérite un chapitre à lui seul : le bonus-malus écologique automobile. L'Etat y a mis beaucoup de moyens : 1,2 milliard d'euros en cinq ans, à quoi s'ajoutent les 800 millions de la prime à la casse entre 2009 et 2010. Deux milliards, pour quels résultats ? Le taux d'émission de CO2 des véhicules neufs vendus sur notre territoire a beaucoup baissé. Mais la baisse est générale en Europe, y compris dans les pays qui n'ont pas de bonus-malus écologique. La comparaison des courbes montre que nous sommes allés un peu plus vite que d'autres pays, mais est-ce que cela valait les deux milliards d'euros d'argent public que nous y avons mis ? Ici encore, j'ai été surpris d'une certaine indigence du « bleu » budgétaire, pour constater ensuite, lors des auditions, que l'Etat manque d'évaluation précise du dispositif : les effets sont mesurés dans leur grande masse, avec une marge d'incertitude sur les causes, mais pas du tout à l'échelle micro, celle de la décision d'achat et de l'influence effective sur le comportement de l'acheteur. A partir de quel niveau un bonus est-il efficace ? L'Etat ne peut pas le dire, parce qu'il manque de sondages précis sur la question.
Ensuite, le bonus-malus est-il utile à l'industrie automobile française ?

Effectivement, on peut en douter ! Le mécanisme devrait inciter les constructeurs à produire des véhicules peu polluants. Mais nos constructeurs automobiles sont en retard, ce qui fait préférer des véhicules plus « propres » mais importés. Le bonus-malus, dans son calibrage, est-il adapté aux gammes de véhicules de nos constructeurs ? Nous ne le savons pas bien, ici encore faute d'analyse précise.
Finalement, je dois constater que nous n'avons pas une vision assez fine de cet outil auquel nous consacrons beaucoup de moyens. Je le déplore, parce que c'est seulement avec une idée précise du bon réglage et des effets, qu'on pourrait envisager des alternatives. Pour atténuer la pollution, par exemple, ne faudrait-il pas, au-delà des véhicules neufs, ouvrir le bonus aux véhicules d'occasion récents les moins polluants ? Ne doit-on pas différencier le mécanisme pour les véhicules diesel, sachant qu'ils polluent davantage l'atmosphère, du moins jusqu'à la norme Euro VI ? Pour le savoir, il faudrait disposer d'analyses bien plus précises.
Ces remarques valent pour bien d'autres mécanismes incitatifs, en particulier pour les tarifs autoroutiers, où la directive Eurovignette 3 permet d'aller bien plus loin qu'aujourd'hui dans la modulation en fonction de critères environnementaux. Même chose pour l'écotaxe poids lourds : faut-il, comme l'ont fait les Allemands, aider les routiers à moderniser leur flotte en y consacrant une partie des fonds collectés par l'écotaxe ?
Vous avez compris mon message : ce budget va dans le bon sens, je vous invite à lui donner un avis favorable ; cependant, nous devons aller bien plus loin dans l'analyse de notre action, pour lui donner plus d'efficacité - et nous devons le faire sans tarder puisque nous allons redéfinir le SNIT !

Je félicite le rapporteur et me réjouis de l'entendre défendre si bien les routes et les autoroutes, qu'il va jusqu'à qualifier de « manne » ! Ceci dit, notre débat d'aujourd'hui a tant de points communs avec celui sur les transports terrestres, qu'on aurait probablement mieux fait de les tenir le même jour.
Je crois que nous avons encore beaucoup à faire pour mieux relier les chefs-lieux de nos départements aux chefs-lieux de région.
Ensuite, sur le fret ferroviaire, il faut tenir compte de la distance et du produit transporté : ce n'est qu'à partir d'environ 700 kilomètres que le fret ferroviaire est efficace et c'est bien plus vrai pour des produits comme les céréales, faciles à transporter par rail, que pour d'autres marchandises. Or, quand vous regardez comment les choses se passent dans la réalité, vous constatez que beaucoup de fret se fait sur de petites distances, dans de petites zones de chalandise.

Effectivement, il est dommage d'avoir séparé les deux débats entre les transports routiers et terrestres, tant ils se recoupent.
Monsieur le rapporteur, tout le monde est d'accord pour renforcer le fret ferroviaire, nous le disons tous ! Cependant, je vous invite à regarder aussi du côté de la performance de nos entreprises de fret ; car si vous ne faites qu'aménager de nouvelles infrastructures sans que nos entreprises améliorent leur compétitivité, vous ne ferez qu'ouvrir un boulevard à la concurrence étrangère !
Nous avons créé le bonus-malus, j'étais circonspect dès le départ sur les arbitrages et je m'en étais ouvert au ministre de l'époque. L'idée est bonne, mais son efficacité dépend de nombreux facteurs. D'abord, le mécanisme devait être équilibré, entre le bonus et le malus. Or, les consommateurs sont allés du côté du bonus, c'est bien normal et c'est ce qu'il fallait mieux prévoir, comme j'en avais averti le ministre : les consommateurs adaptent leur comportement, c'est logique. Le mécanisme a donc été déséquilibré, depuis le début. Le Gouvernement actuel le renforce, mais je doute sérieusement que le bonus-malus s'équilibre enfin ! C'est la même chose pour l'écotaxe poids lourds : les routiers vont s'adapter et les recettes seront moindres que prévues.
Ensuite, je crois que le bonus-malus peut faire du mal à notre industrie automobile. A force de « malusser » les voitures puissantes, en particulier les voitures françaises, on décourage leur achat, avec tous les dégâts que cela entraîne pour nos constructeurs ! Pour avoir travaillé longtemps dans le secteur, je sais qu'il faut être très prudent avec les ventes d'automobiles, je sais aussi que des usines importantes sont en très grand danger. On peut se voiler la face, mais si des usines ferment parce que vous découragez l'achat des voitures qu'elles produisent, ne venez pas pleurer ensuite ! Je partage donc vos interrogations, Monsieur le rapporteur : il ne faut pas aller trop loin avec le bonus-malus, ou bien on peut faire le plus grand mal à nos constructeurs automobiles !

Vous prônez une approche globale, qui pourrait être contre ? Mais c'est bien plus compliqué que vous ne le supposez. Pour le fret, nous en débattons régulièrement au sein du conseil d'administration de la SNCF : les facteurs à prendre en compte sont si nombreux, que l'équation en devient aléatoire. Il y a la conjoncture : avec la crise économique, le fret ferroviaire a baissé partout, c'est un fait. Il y a la géographie et en particulier la localisation des industries : en Allemagne, elle est bien mieux répartie sur le territoire que chez nous, cela simplifie les choses et c'est ce qui, pour partie, a rendu possible le magnifique hub ferroviaire de Duisbourg, que nous ne reproduirons jamais en France ! Il y a encore les infrastructures existantes, le matériel roulant, les sillons, et bien sûr les distances opérées par le fret dans la réalité : en France, 70% du fret se fait sur moins de 30 kilomètres, vous devez en tenir compte ! Alors dans ce contexte, c'est vrai que nous ne savons pas mesurer l'effet global d'une mesure telle que l'autorisation du 44 tonnes.
Merci donc pour votre appel à plus de globalité, mais c'est bien ce que nous nous efforçons tous de faire depuis le Grenelle de l'environnement...

Votre propos était très intéressant, monsieur le rapporteur, c'est vrai que nous manquons de vision globale, que c'est un mal bien français dont nous souffrons depuis fort longtemps. Nous en sommes conscients et nous en parlons pour le fret ferroviaire, mais parce que la situation y est devenue catastrophique. Trop longtemps, on a laissé la SNCF décider seule, comme si c'était elle le véritable ministère des transports. Même chose pour les routes : trop de décisions ont été prises en dehors de toute considération pour l'économie dans son ensemble.
Je veux signaler un problème qui s'aggrave d'année en année : les collectivités locales, singulièrement les petites, n'ont plus les moyens d'entretenir leurs routes. Dans mon département, des maires me disent qu'ils vont devoir abandonner certaines voies, faute de pouvoir les entretenir : quel recul ! Nous devons trouver des solutions avant qu'il ne soit trop tard. Cela suppose des innovations de la part des entreprises de travaux publics, qui doivent s'adapter au contexte. Mais il faut également mieux répartir les moyens : les petites routes subissent les poids lourds, pourquoi ne pas réserver à leur entretien une partie de l'écotaxe poids lourds ? Ne peut-on pas imaginer un fonds de péréquation dédié, pour aider à intervenir là où c'est nécessaire ? Le passage des 44 tonnes aura des effets sur l'ensemble du réseau, même si l'on ne sait pas dire exactement lesquels ni où - mais nous devons nous tenir prêts, en particulier pour aider les communes et les départements, qui n'ont déjà plus les moyens d'entretenir correctement leur réseau !
Je vous rejoins également pour dire que nous avons besoin d'autoroutes ferroviaires : sans elles, il est inutile d'espérer un véritable report modal. Cependant, sur certains parcours, les voies actuelles sont déjà saturées, les sillons disponibles y sont si rares qu'on en refuse déjà aux TER : il est illusoire de penser y faire passer une autoroute ferroviaire ! Ce qui manque donc pour le ferroutage et pour le fret ferroviaire en général, c'est une véritable ambition de l'Etat, pour prendre ce problème à bras-le-corps.

Ce budget préserve l'essentiel et il va dans le bon sens. Alors que Lionel Jospin et même Jean-Pierre Raffarin avaient refusé de vendre les autoroutes, Dominique de Villepin a commis ce que je n'hésite pas à qualifier de faute politique majeure : celle de privatiser les autoroutes, au vil prix de 15 milliards d'euros dont 4 seulement sont allés au financement des infrastructures via l'AFITF, alors que la rente autoroutière était estimée à 32 milliards à l'horizon 2030 ! C'est cet argent qui nous manque aujourd'hui pour régénérer et développer nos réseaux : nous en sommes à rechercher des moyens de tous les côtés, alors qu'il nous faut de grandes ambitions ! L'écotaxe poids lourds est une très bonne mesure, dont nous espérons bien qu'elle rapportera ce qu'on en attend. Nous serons très attentifs à son utilisation, car c'est bien aux infrastructures de transports qu'elle doit servir, c'est bien en priorité au report modal que l'AFITF devra l'employer.

Une taxe est utile si elle est vertueuse : avec le bonus-malus, ce que l'on voit d'abord, c'est que la consommation moyenne des voitures a diminué par deux en dix ans ! L'écotaxe poids lourds produit des effets avant même d'être entrée en vigueur : dans ma région, un motoriste lance un programme de recherche pour améliorer les performances de ses moteurs, en prévision de l'écotaxe.
Le véhicule électrique représente également un enjeu important dont il faut parler : comment équipe-t-on les routes pour que le « plein électrique » y devienne facile ?

Nous nous répétons d'année en année en déplorant le recul du fret ferroviaire et les difficultés du report modal. Il n'y a en fait que deux moyens pour progresser : le cabotage maritime et le ferroviaire. Tant que les armateurs et les chargeurs ne trouveront pas d'intérêt à passer par nos ports, le trafic continuera à se faire par le Nord de l'Europe, y compris pour les marchandises à destination du sud de la France ! Nous avons besoin d'un effort continu pour améliorer l'attractivité de nos ports, ou bien nous perdons notre temps. Même chose pour le fret ferroviaire : la difficulté ne vient pas de ce que les deux-tiers du fret se font à courte distance, nous le savons bien, mais de ce que la SNCF a baissé les bras ! Il faut en faire beaucoup plus pour inciter les chargeurs à remettre les camions sur les trains, voilà la vérité ! C'est toute l'économie des transports qu'il nous faut changer...

Effectivement, le fret dépend directement des ports maritimes, qui sont à la base de toute la chaîne logistique. Je connais une entreprise qui a dû fermer à Châteauroux parce que sa logistique n'avait pas d'autre solution que Rotterdam, voilà où l'on en est dans notre pays !
Le fret ferroviaire n'est pas attractif parce qu'il est trop cher, c'est aussi simple que cela. Mais ne pensez pas que vous changerez les choses en le rendant obligatoire : nous n'avons pas les infrastructures ! Des calculs ont été faits pour l'axe Lille-Marseille : si l'on devait mettre tous les camions sur des trains, le trafic serait quasiment ininterrompu, ce qui est parfaitement impossible en l'état actuel de nos infrastructures... Avant d'envisager la moindre obligation, il nous faut d'abord plus de sillons, voire des lignes dédiées : nous en sommes très loin. Cela dit, nous avons également bien des progrès à faire en matière de compétitivité, car si nous devions ouvrir demain matin les infrastructures dont nous rêvons, ce serait quasiment au seul bénéfice de la concurrence étrangère !

Je remercie le rapporteur pour la qualité de son analyse. Nous savons bien que l'intermodalité dépend de facteurs nombreux et qu'elle est complexe à promouvoir. C'est ce que nous avions constaté par exemple à Hambourg, dans notre mission sur les ports maritimes : si les quatre cinquièmes du fret y transitent par le rail, c'est bien sûr parce que ce port hanséatique dispose d'une vaste plateforme multimodale, mais aussi parce que le fret ferroviaire bénéficie en Allemagne d'une organisation d'ensemble qui le rend plus régulier, plus sûr et moins cher que le transport routier !
Je m'interroge sur l'utilisation que vous suggérez de normes contraignantes en matière de ferroutage : d'autres pays européens ont-ils adopté de telles règles ?

Il y a déjà bien longtemps que nous demandons plus d'analyse et de vision d'ensemble sur les transports, c'est bien sûr nécessaire à la cohérence des politiques publiques.
Je rejoins Rémy Pointereau : nous avons des progrès à faire sur les liaisons au chef lieu du département ! Dans certains cas, les problèmes sont insolubles : comment fait-on dans un département comme l'Ardèche, qui n'a plus qu'une route nationale au sud du département, qui n'a quasiment plus de train et où le chef-lieu n'est plus relié au réseau routier national ? Notre réseau routier a été déclassé, nous en avons la charge, alors qu'à l'évidence il sert de délestage au réseau national de la vallée du Rhône : est-il bien normal que l'Etat se soit désengagé à ce point ? L'Ardèche démontre également qu'il y a des départements où le désenclavement passe nécessairement et principalement par la route.

Le bonus malus mobilise effectivement beaucoup de moyens alors qu'on s'en remet pour une grande partie aux aléas de la consommation : ne serait-il pas plus utile, avec le même argent public, de cibler plutôt les investissements ?
J'espère, ensuite, que l'aménagement du territoire figurera parmi les tout premiers critères du SNIT. Si le critère de la population l'emporte et si les métropoles captent tous les investissements, nos territoires ruraux continueront de s'appauvrir, sans perspective...

Je m'associe à ces propos : effectivement, l'aménagement du territoire doit être prioritaire dans le SNIT, ou bien nous manquons à tous nos devoirs. L'Etat se désengage des routes : il n'a plus que 9 000 kilomètres de routes nationales à entretenir et laisse tout le reste du réseau non autoroutier aux collectivités locales ! Dans certains cas, la route principale du département n'est même plus dans le réseau national : le département est censé l'entretenir, mais il n'en a pas les moyens et la région a trop d'engagements ailleurs pour l'y aider. Dans ces conditions, quel scandale de voir l'Etat refuser de s'engager davantage dans le plan de modernisation des itinéraires routiers (PDMI) !
Devant notre commission, le président de la SNCF s'est engagé à ne plus démonter de lignes, c'est une bonne chose ! Mais il faut aller plus loin, car des lignes qui ne sont quasiment plus utilisées sont parfois les seuls axes possibles pour développer le fret : il ne faut pas les démonter, mais bien les conforter, ne serait-ce que pour préserver l'avenir. Nous avons un choix historique devant nous : ou bien on maintient a minima le réseau existant, ce qui suppose de l'entretenir, ou bien on laisse mourir une partie du territoire national, c'est bien de cela qu'il s'agit. Nous avons saisi l'Etat sur les PDMI, il ne faut rien lâcher, c'est bien notre rôle à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire !

Je vous remercie les uns et les autres pour vos propos amènes, mais je tiens à vous rassurer : je reste pleinement écologiste et c'est en écologiste que je vous parle des routes ! C'est bien pourquoi j'ai insisté sur le report modal : ce budget en fait un maître-mot et mon objectif, c'est d'aller plus loin !
Je vous rejoins tout à fait, monsieur le Président, sur les enjeux d'aménagement du territoire : ils sont au coeur même du débat sur la mobilité. Nous avons effectivement un choix historique à faire et c'est bien toute la question du SNIT : comment passer d'un catalogue, à une stratégie ? Je ne vous ai pas dit autre chose : je constate que l'Etat manque de vision globale, alors que nous en avons le plus grand besoin pour définir la stratégie, alors que le débat sur le SNIT est en cours !
Madame Herviaux, les Suisses ont interdit aux poids lourds le transit dans les vallées alpines : les camions doivent monter sur les trains, c'est une obligation et c'est un exemple ; d'autres innovations réglementaires sont également possibles, il faut en débattre.
Je suis en désaccord avec M. Cornu sur le bonus-malus : la question n'est pas que le malus soit trop fort sur les voitures les plus polluantes que des constructeurs continuent de fabriquer, alors que c'est une impasse à moyen terme. Le problème, c'est que l'absence de vision stratégique nous empêche, avec cet outil, d'accompagner la nécessaire mutation environnementale de notre production automobile. Si nos constructeurs vendent moins de véhicules, c'est parce que leur gamme n'est peut-être pas assez compétitive sur les véhicules les moins polluants. Soit on nie cette réalité et les choses ne vont faire qu'empirer, soit on la reconnaît, et on aide alors nos constructeurs dans leur mutation environnementale, en réglant en particulier le problème du diesel. Cela dit, je suis d'accord pour dire que le bonus-malus devrait être à l'équilibre, il en serait plus efficace pour aider les changements. Vous l'avez donc compris : je ne renie rien de mon engagement écologiste !
La commission émet un avis favorable à l'adoption des crédits « routes » du projet de loi de finances pour 2013.