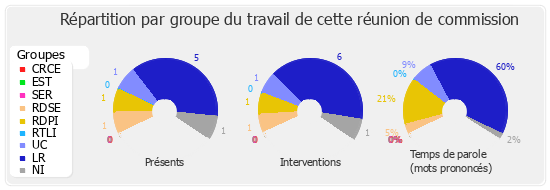Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation
Réunion du 3 avril 2013 : 2ème réunion
Sommaire
La réunion
Au cours d'une première séance tenue dans la matinée, la commission demande tout d'abord à se saisir pour avis du projet de loi n° 441 (2012-2013), adopté par l'Assemblée nationale, d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, et nomme M. Claude Haut rapporteur pour avis sur ce texte.
La commission entend ensuite une communication de M. Philippe Marini, président, sur les rencontres des parlementaires nationaux organisées à Bruxelles et Dublin dans le cadre du semestre européen.

Je soulignerai, pour commencer, qu'avec cette communication s'ouvre la « séquence européenne » qui se déroulera à la commission des finances et au Sénat au cours des semaines à venir.
Ainsi, la semaine prochaine, l'audition du directeur général du Trésor et du directeur du budget nous permettra d'aborder la question des conséquences des nouvelles règles de gouvernance budgétaire européennes sur nos procédures nationales. La semaine suivante, notre commission entendra Pierre Moscovici et Bernard Cazeneuve, respectivement ministre de l'économie et des finances et ministre délégué chargé du budget, venus présenter le projet de programme de stabilité avant sa transmission à la Commission européenne, au plus tard le 30 avril. L'examen du projet de programme de stabilité se poursuivra avec la présentation en commission, le 23 avril, du rapport du rapporteur général, François Marc, sur ce dernier. Enfin, le 24 avril, à l'issue d'une déclaration du Gouvernement portant sur le programme de stabilité, se tiendra un débat en séance. En application de la Constitution, cette déclaration peut également, si le Gouvernement le décide, faire l'objet d'un vote. Aussi, j'ai demandé, en conférence des présidents, qu'un tel vote ait lieu ; toutefois, ce point n'a pas encore été tranché par le Gouvernement.
Je tiens à rappeler que cette procédure avait été appliquée en 2011 ; le Sénat avait débattu puis voté sur la base d'une déclaration de Christine Lagarde et François Baroin, alors respectivement ministres de l'économie et du budget, portant sur le programme de stabilité. Enfin, au mois de juin, le Sénat avait adopté une résolution, proposée par la commission des finances, sur la « recommandation de recommandation » de la Commission européenne sur le programme de stabilité et le programme national de réforme de la France. J'espère que cet exercice pourra être renouvelé, en son entier, en 2013.
Cette séquence sénatoriale fait écho à la procédure engagée au niveau de l'Union européenne, connue sous le nom de Semestre européen.
L'idée du Semestre européen est que, pendant les six premiers mois de l'année, les Etats débattent de la situation de leurs économies et de leurs finances publiques de façon à dégager, autant que possible, des priorités communes et donc de permettre que les budgets et les politiques nationales soient élaborés de manière coordonnée.
Pour éviter que des Etats ne s'écartent de ces orientations communes, a été instituée la procédure de correction des déséquilibres macroéconomiques et le pacte de stabilité a été renforcé.
C'est dans ce cadre que les Etats, lors du Conseil européen des 14 et 15 mars dernier, ont validé les priorités de politique économique identifiées par la Commission européenne. Ces priorités sont formulées de manière vague afin que tout le monde puisse s'y retrouver ! Elles sont, pour mémoire, au nombre de cinq. Il s'agit de procéder à un assainissement budgétaire différencié propice à la croissance - mais qui pourrait s'y opposer ! -, de revenir à des pratiques normales en matière de prêt à l'économie, de promouvoir la croissance et la compétitivité pour aujourd'hui et pour demain, de lutter contre le chômage et prendre des mesures pour faire face aux retombées sociales de la crise et de moderniser l'administration publique.
Tenant compte de ces priorités, les Etats membres devront adresser, avant le 30 avril, leur programme de stabilité ou de convergence et leur programme national de réforme.
Enfin, sur la base de ces documents, la Commission formulera des remarques entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin, puis le Conseil de l'Union européenne adoptera des recommandations, aux alentours du début du mois de juillet, adressées à chacun des Etats.
Je tiens à souligner que, concernant le Sénat, l'examen des recommandations de la Commission et du Conseil sur le programme de stabilité et le programme national de réforme représente une séquence peut-être plus importante que celle portant sur l'élaboration du programme de stabilité de la France. En effet, ces recommandations influencent fortement l'élaboration du projet de budget de l'année à venir et des mesures de politique économique proposées par le Gouvernement.
J'en arrive maintenant à la question de l'association des parlements nationaux au déroulement du Semestre européen.
Cette procédure tend à acquérir une importance considérable, dans la mesure où les Etats membres seront, de plus en plus, tenus de mettre en oeuvre les recommandations adressées par leurs pairs. Le cadre mis en place par les règles de gouvernance européennes tendra progressivement à se resserrer sur les choix budgétaires et de politique économique des Etats.
S'agissant de la France, les principaux thèmes mis en avant depuis quelques mois par le Gouvernement sont issus des recommandations de juillet dernier : assouplissement du marché du travail, réduction des charges pesant sur le travail et basculement vers l'impôt de consommation et la fiscalité écologique, formation professionnelle, etc. Même s'il demeure beaucoup d'ambigüités à ce jour, il n'en reste pas moins que le Gouvernement est tenu de sembler, au moins, mettre en oeuvre ces recommandations.
Il est, en outre, indispensable de conserver une assise démocratique nationale alors que la gouvernance budgétaire européenne se fait de plus en plus intrusive ; personne au sein de notre commission ne niera, me semble-t-il, cette nécessité.
Les parlements nationaux restent souverains en matière budgétaire et fiscale, comme le parlement chypriote nous l'a récemment montré, au moins l'espace de quelques instants. Le bon fonctionnement de la coordination au niveau européen implique donc que les décideurs finaux, c'est-à-dire les parlements nationaux, participent aux discussions entre Etats.
Les problèmes rencontrés par les Etats sont largement communs et il est utile de connaître la manière dont les autres y répondent et, le cas échéant, de mettre en commun les bonnes pratiques.
Au niveau national, nous avons jusqu'ici focalisé notre implication sur le projet de programme de stabilité, avant sa transmission à Bruxelles, car ce document engage notre pays vis-à-vis de nos partenaires et, dans une certaine mesure, conditionne le contenu du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui sont discutés à l'automne. Il est donc essentiel que le Parlement soit consulté sur son contenu.
Comment apprécier les initiatives tendant à associer les parlements nationaux au Semestre européen ? Il en existe deux, à ce jour, qui se caractérisent par leur formalisme mais qui pourraient, toutefois, être porteuses d'espoirs.
S'agissant de la première initiative, le Parlement européen organise chaque année en janvier, à Bruxelles, la semaine interparlementaire sur le Semestre européen. Elle rassemble des parlementaires nationaux et des parlementaires européens.
Cette année, le Sénat y était représenté, le 29 janvier, par Richard Yung pour la commission des affaires européennes ainsi que par François Marc et moi-même pour la commission des finances.
Pour ma part, je trouve qu'il s'agit d'un exercice convenu et cadré. L'organisation et le déroulement des réunions sont phagocytés par le Parlement européen et la Commission européenne.
En outre, ces réunions ne sont ni opérationnelles, ni interactives. Cela s'explique à la fois par le trop grand nombre de participants - à cet égard, il est impossible de prendre la parole plus d'une fois - et par le fait que les thèmes de discussion sont trop généraux et insuffisamment préparés à l'avance.
Enfin, alors que le cadre budgétaire pluriannuel de l'Union européenne était en discussion, les débats ont souvent été accaparés par les Etats périphériques qui se sont livrés à une véritable « surenchère budgétaire », demandant l'accroissement des aides et investissements au profit de leur territoire.
Malgré tout, il faut reconnaître que ces réunions permettent de nouer des contacts, de développer des relations avec les parlementaires des autres Etats membres.
La deuxième initiative consiste en l'organisation, par le Parlement du pays qui assure la présidence tournante de l'Union européenne, de réunions des présidents de commissions des parlements nationaux.
Pour ma part, je me suis rendu les 24 et 25 février à Dublin pour la réunion des présidents des commissions des finances.
Il me semble que ces réunions constituent des forums utiles pour débattre des problèmes communs que nous rencontrons et échanger nos expériences. Je pense que notre collègue Jean Arthuis, qui avait participé à de telles réunions au cours de l'année dernière à Nicosie, pourra également nous faire part de son expérience et nous donner son avis sur leur déroulement. Je note, en tout cas, que la liberté d'esprit et de travail qui règne dans ces réunions est bien plus grande qu'à Bruxelles.
J'ai profité d'une session consacrée au rôle des parlements nationaux dans la gouvernance de l'Union économique et monétaire pour présenter à mes homologues le dispositif mis en place en France, consistant à transmettre au Parlement les projets de programme de stabilité avant leur transmission à la Commission, de façon à ce que celui-ci puisse débattre et voter sur ces projets.
J'ai également indiqué que nous avions adopté en 2011 une résolution européenne sur la base de « recommandation de recommandation » formulée par la Commission sur le programme de stabilité de la France.
Lors de ma participation aux différentes réunions interparlementaires, j'ai pu constater que les modalités d'examen par les parlements nationaux, notamment des programmes de stabilité ou de convergence, étaient très différentes selon les Etats. Aussi, je crois indispensable qu'il y ait une convergence des procédures afin d'assurer une participation effective des parlements nationaux à la gouvernance économique et budgétaire de l'Union.
Il me paraît important de nous arrêter quelques instants sur les initiatives à venir concernant l'association des parlements nationaux à la gouvernance européenne. Les réunions existantes vont, sans doute, être appelées à évoluer lorsque verra le jour la conférence prévue par l'article 13 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, qui doit associer le Parlement européen et les parlements nationaux, pour débattre des politiques budgétaires et de toutes les questions régies par le traité.
L'article 13 précité stipule que « le Parlement européen et les parlements nationaux des parties contractantes définissent ensemble l'organisation et la promotion d'une conférence réunissant les représentants des commissions concernées du Parlement européen et les représentants des commissions concernées des parlements nationaux afin de débattre des politiques budgétaires et d'autres questions régies par le présent traité ».
La Conférence des présidents des parlements des Etats membres de l'Union européenne s'est saisie de la question de la mise en oeuvre de l'article 13 du traité et travaille sur la forme que prendra la conférence réunissant le Parlement européen et les parlements nationaux. La discussion se poursuivra lors de la prochaine conférence des présidents du 21 au 24 avril à Nicosie.
À titre indicatif, les présidents des parlements des six Etats fondateurs préconisent que cette conférence soit organisée conjointement avec le Parlement européen mais présidée par l'Etat membre assurant la présidence tournante de l'UE.
Ils souhaitent qu'aient lieu au moins deux réunions par an dont une en juin, dans l'intervalle entre la publication par la Commission européenne de ses appréciations sur les programmes de stabilité et l'adoption, par le Conseil, de ses recommandations aux Etats.
Ils veulent également que cette conférence puisse entendre, à sa demande, les responsables des principales institutions européennes.
La conférence aurait vocation à produire une « contribution collective » sur l'évolution de l'Union économique et monétaire et à réagir aux documents émanant de la Commission européenne.
Peut-être s'agira-t-il de l'amorce d'un réel débat parlementaire européen. En effet, toute instance parlementaire ne commence à exister que dès lors qu'elle dispose d'un secrétariat, que ses débats font l'objet d'un compte-rendu et, surtout, qu'elle a la possibilité d'adopter un texte qui peut être amendé par ses membres.
Pour mémoire, je rappellerai que la résolution du Sénat du 20 novembre 2012 demande « que le contrôle de la supervision bancaire européenne soit une des missions explicites de la formation chargée de la zone euro au sein de la Conférence interparlementaire prévue à l'article 13 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire ou, à défaut, fasse l'objet d'une commission ad hoc de la Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires (COSAC) conformément à l'article 10 du protocole n° 1 annexé au Traité de Lisbonne ». Cette résolution, proposée par Richard Yung et examinée par la commission des finances, visait expressément à donner un contenu à cette conférence interparlementaire et à l'inviter à élargir son champ d'analyse au-delà des problématiques strictement budgétaires.
En conclusion, quelles évolutions pouvons-nous préconiser ? Tout d'abord, je pense que les réunions interparlementaires, si l'on veut qu'elles soient utiles et qu'elles ne perdent pas leur crédibilité, doivent cesser de consister essentiellement en une succession de propos vagues sur des thèmes, essentiellement techniques, assez éloignés des préoccupations de nos concitoyens.
Ensuite, ces réunions doivent être l'occasion de débattre des difficultés communes auxquelles sont confrontés les parlements dans leurs Etats respectifs et des solutions qu'ils mettent en oeuvre pour y remédier, en établissant une sorte de benchmarking. Il est nécessaire que les sujets abordés soient, en outre, concrets ; j'avais suggéré le thème de la fiscalité des multinationales de l'Internet, mais on peut en imaginer d'autres : la convergence fiscale, la résolution bancaire, etc.
C'est dans cet objectif de rendre la discussion entre Européens plus concrète et plus opérationnelle que j'ai proposé à Dublin que les réunions interparlementaires fassent désormais l'objet d'une organisation collégiale, notamment en ce qui concerne le choix des sujets traités.
Je m'apprête donc à faire parvenir aux présidents des commissions parlementaires des finances des États faisant partie de l'actuel trio de présidences, à savoir l'Irlande, la Lituanie et la Grèce, un courrier les invitant à s'inscrire dans une telle démarche.
Le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Gilles Carrez, qui était représenté à Dublin par notre collègue Valérie Rabault, est prêt à s'associer à cette initiative.
J'ai d'ores et déjà fait part de ce projet à M. Lynch, président de la commission du budget du Parlement irlandais, ainsi qu'à M. Glaveckas, vice-président de la commission des finances du Parlement lituanien.
Enfin, je propose de poursuivre deux objectifs : développer les relations entre Etats membres pour partager les bonnes pratiques, d'une part, et maintenir un lien entre les débats nationaux et les questions traitées à l'échelle européenne, de manière à éviter que les gouvernements ne disent à Bruxelles l'inverse de ce qu'ils font chez eux et à enrayer la déconnection entre les questions traitées au niveau européen et leur perception par les citoyens dans chacun des Etats membres, d'autre part.
Je m'efforcerai de promouvoir à nouveau ces idées les 15 et 16 septembre prochains à Vilnius, lors de la prochaine réunion des présidents de commission des finances.

Je remercie le président du caractère exhaustif de sa communication. Je souhaite revenir sur deux points. Tout d'abord, sur les rencontres réunissant les parlements nationaux, le Parlement européen et la Commission. Il est vrai que je retire également de mon déplacement à Bruxelles du mois de janvier le sentiment que la concertation et les débats au sein de ces instances sont difficiles à mettre en place. Cependant, je pense que nous ne sommes qu'au début d'un processus qui évoluera vers une plus grande association des parlements nationaux à la gouvernance économique et budgétaire, dès lors que ces derniers se seront eux-mêmes pleinement saisis de ces questions.
Dans cet esprit, je souhaite que la commission des finances du Sénat procède à l'audition de représentants des institutions européennes. Ainsi, nous avions programmé la venue d'Olli Rehn, commissaire en charge des affaires économiques et monétaires ; néanmoins, sa visite a été retardée par le déclenchement de la crise chypriote. Celui-ci pourrait venir devant notre commission au mois de mai ou juin. En outre, nous devrions être plus attentifs aux questions de politique monétaire, et notamment aux actions menées par la Banque centrale européenne ; c'est pourquoi nous avions souhaité rencontrer son président, Mario Draghi, et que nous réfléchissons actuellement selon quelles modalités nous pourrions prendre attache avec lui au cours des semaines à venir.
J'ai le sentiment que l'implication des parlements nationaux dans les nouvelles procédures de coordination européennes progressera.
Ensuite, j'ai noté votre pessimisme quant à la capacité du Gouvernement à mener à bien les objectifs qu'il s'est fixé, notamment dans le cadre des engagements qui ont été transmis à l'Union européenne. Vous avez indiqué que le « Gouvernement est tenu de sembler, au moins, mettre en oeuvre » les recommandations des institutions européennes. Je pense, quant à moi, que le Gouvernement, eu égard aux circonstances actuelles, réalise tous les efforts nécessaires à la réalisation des objectifs retenus ; j'en veux pour preuve les mesures fiscales et budgétaires qui ont été proposées et adoptées dans le cadre des collectifs budgétaires des mois de juillet et décembre de l'année dernière.
Aussi, je pense que la France participe pleinement à l'effort qui est demandé au niveau européen. Elle appliquera les règles européennes qu'elle a participé à instituer en matière budgétaire...

et le Gouvernement en tirera toutes les conséquences fiscales et budgétaires dans les mois à venir.

Je remercie le président de cette communication, ainsi que le rapporteur général des propos prometteurs qu'il vient de tenir.
S'agissant des instances de concertation des parlements nationaux des Etats membres, j'ai eu le privilège de représenter le président au mois de novembre de l'année dernière lors d'une réunion interparlementaire qui a eu lieu à Nicosie.
Le programme initialement prévu couvrait la journée entière. Seulement, l'ordre du jour était déjà épuisé à l'heure du déjeuner. De toute évidence, l'organisation de cette rencontre présentait d'importantes insuffisances. À bien des égards, la réunion est apparue comme une caricature de concertation politique.
Ma participation à cet exercice m'a, néanmoins, permis de prendre pleinement conscience des difficultés financières auxquelles Chypre était confrontée. Je me suis donc interrogé sur la gouvernance de la zone euro : comment Chypre a-t-elle pu être admise dans la zone euro ? Pourquoi le secteur bancaire chypriote n'a-t-il pas fait l'objet d'un contrôle approfondi ? J'ai été frappé par les lacunes de cette gouvernance.
Je pense que l'article 13 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance qu'évoquait le président présente une grande importance. Il me semble que la conférence dont cet article prévoit l'institution pourrait comprendre une commission de surveillance de la gouvernance de la zone euro. Elle serait composée de parlementaires des Etats membres de la zone euro et de parlementaires européens élus dans ces mêmes Etats. L'ensemble des pays de la zone euro sont solidaires et l'assistance financière est attribuée, non pas par les institutions européennes, mais par les Etats eux-mêmes. Ce sont bien ces derniers qui dotent en capital le Mécanisme européen de stabilité - qui préfigure peut-être une union budgétaire -, engageant de ce fait leurs finances publiques. Nous sommes donc cautions solidaires des dettes contractées en faveur des Etats recevant une assistance financière.
Il est, par conséquent, nécessaire de renforcer la gouvernance de la zone euro, qui pourrait reposer sur un gouvernement économique, financier et budgétaire dont le contrôle démocratique serait exercé par cette commission de surveillance.
Je me méfie de tous ces « zinzins » institués au niveau européen, comme la COSAC ou encore les réunions interparlementaires, qui ne sont rien de plus que des alibis démocratiques.
Je souhaite donc que le président et le rapporteur général puissent intervenir pour que la conférence prévue par l'article 13 précité n'aboutisse pas à une caricature de concertation.

C'est un enjeu tout à fait essentiel et j'intègrerai vos analyses, et notamment celles développées dans votre rapport sur l'avenir de la zone euro, dans la note que j'adresserai au président du Sénat dans la perspective de la Conférence des présidents des parlements des Etats membres de l'Union européenne qui doit avoir lieu à la fin du mois.
Je tiens toutefois à rappeler que la conférence qui doit être instituée en application de l'article 13 du traité réunira les parlements des vingt-cinq Etats signataires, et pas seulement ceux des Etats de la zone euro. Or, les Etats n'appartenant pas à la zone euro ont déjà montré leur propension à intervenir dans les débats internes à cette zone. Il s'agit d'un fait diplomatique qui, s'il est difficilement compréhensible, demeure relativement intangible.

Je ne peux qu'aller dans le sens des trois interventions précédentes. Je reviens des réunions interparlementaires qui ont eu lieu à Bruxelles, en janvier dernier, avec le même sentiment d'inefficacité s'agissant du fonctionnement des institutions internationales, en particulier européennes.
J'ai perçu qu'au cours de ces réunions, les parlementaires européens nous signifiaient que la réalité du contrôle budgétaire leur revenait, écartant de ce fait les parlements nationaux.
Je partage la critique formulée par le président à l'égard de la phraséologie européenne qui n'est, bien souvent, qu'une succession de lieux communs.
Il est indispensable que le Parlement français, et en particulier le Sénat, se saisisse du Semestre européen de manière à s'inscrire pleinement dans le processus de conception du budget. Cela passe par l'audition de responsables des institutions européennes, notamment des commissaires, mais aussi par un examen approfondi des recommandations de la Commission et du Conseil.
Il paraît, en outre, nécessaire que les sénateurs puissent rencontrer le président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, qui a déjà été auditionné par le Bundestag. La politique monétaire, comme la supervision bancaire et d'autres sujets majeurs, ne font pas l'objet d'investigations suffisantes au Sénat.
Enfin, il me semblerait utile que nous développions des contacts avec les membres des commissions des finances des parlements des grands Etats européens.

Je ne peux qu'abonder dans votre sens ; au cours de chacun des déplacements que j'ai effectués depuis un an, je me suis attaché établir des relations avec les présidents des commissions des finances italiens, britanniques, etc.
Je regrette toutefois que ce soit avec les parlementaires allemands qu'il est le plus difficile de tisser des liens. En particulier, le Bundesrat présente la particularité de ne pas être une assemblée permanente et ne dispose donc pas d'une réelle administration, ce qui complique les relations. Le Bundestag, quant à lui, estime que son interlocuteur naturel est l'Assemblée nationale, même s'il est arrivé que nous rencontrions certains de ses membres, notamment lors du déplacement du Bureau de notre commission à Berlin en 2011.
Je relève que le Bundestag ne participe pas systématiquement aux réunions interparlementaires européennes.

Je souhaiterais souligner que je ne suis pas très optimiste s'agissant de la situation financière de la France. Il me semble que les décisions qui ont été prises jusqu'à présent ne participent pas à un ajustement efficace de la situation budgétaire ; la priorité est donnée aux hausses d'impôts alors que les dépenses publiques continuent de croître, ce qui me paraît contreproductif.
Les 35 heures imposent le maintien du dispositif d'allègement des cotisations patronales sur les salaires inférieurs à 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) dont le coût dépasse 20 milliards d'euros. Aussi, le retour aux 39 heures permettrait de faire l'économie de ce dispositif. Or, une économie de 20 milliards d'euros serait bien utile au redressement des finances publiques !
En outre, il me semble impératif de ne pas augmenter les dépenses publiques. Le projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école montre que les choix du Gouvernement vont dans le sens contraire ; les mesures prévues par ce projet de loi pourraient coûter plusieurs milliards d'euros !
Enfin, je veux insister sur les dangers que font peser les programmes d'assistance financière européens pour les finances publiques françaises. Aujourd'hui, l'aide apportée a une incidence sur la dette publique à hauteur de 40 milliards d'euros ; je doute que la France puisse se le permettre.
Il est temps que l'actuel gouvernement change de politique et favorise le travail, que cela soit par une diminution de la fiscalité et par le retour aux 39 heures.

Hier, la commission des affaires européennes du Sénat a reçu Alain Lamassoure, président de la commission des budgets du Parlement européen ; celui-ci nous a livré une analyse très intéressante du budget européen.
S'agissant du rôle des parlements nationaux, je souhaite insister sur les faibles conséquences pratiques que peuvent avoir les résolutions adoptées par le Sénat. Mon expérience passée de président de la commission de l'économie me laisse penser qu'il s'agit, le plus souvent, de voeux pieux.
Mis à contribution des politiques d'austérité engagées par les Etats membres, le budget pluriannuel de l'Union européenne pour la période 2014-2020 a été abaissé de 3 % par rapport à la programmation précédente. En tant qu'Européen convaincu, je pense qu'il aurait été préférable de préserver le budget de l'Union. L'effort d'ajustement doit avant tout reposer sur les Etats membres, ces derniers devant s'attacher à diminuer leurs dépenses publiques...

Les dépenses de l'Union européenne sont également des dépenses publiques !

Européen convaincu, je reste persuadé que ce ne sont pas les économies réalisées dans le cadre du budget européen qui permettront d'assainir les finances publiques des Etats membres et que la préservation de celui-ci aurait favorisé l'intégration au sein de l'Union.

Les résolutions parlementaires ne me semblent pas constituer de simples voeux pieux. Je citerai l'exemple de celle portant sur les règles prudentielles dites « de Bâle III ». Plusieurs d'entre-nous ont, récemment, pu assister à une manifestation traitant des conséquences de l'entrée en vigueur de ces règles sur la distribution de crédit dans l'économie. Cette résolution, proposée par Richard Yung, avait permis à la commission des finances de mettre en évidence la nécessité de n'appliquer les règles dites « de Bâle III » que dès lors qu'elles le seraient aux Etats-Unis. Même si cette préconisation n'est, actuellement, pas suivie, l'évolution de la situation économique future mettra en évidence l'insuffisance du crédit et validera la position retenue par notre commission. Aussi, il est à espérer que les analyses menées par le Sénat seront prises en compte alors que les règles dites « de Bâle III » sont en voie de transposition dans la législation européenne.
N'ayant pas le temps de vous présenter la seconde partie de ma communication, relative à la situation de l'Irlande, de la Grèce et de Chypre, je vous ferai parvenir mes observations sur ce sujet par écrit.
Puis la commission procède à l'audition de M. Louis Gallois, commissaire général à l'investissement, sur la mise en oeuvre du programme d'investissements d'avenir.

Nous avons le plaisir d'accueillir Louis Gallois, qui a été nommé commissaire général à l'investissement en juin 2012 à la suite de René Ricol. Notre pratique est d'entendre, deux à trois fois par an, le commissaire général pour faire le point sur la consommation de l'enveloppe destinée aux investissements d'avenir. Nous vous avons déjà auditionné le 18 juillet 2012, mais vous devez maintenant disposer d'un recul plus important sur les opérations financées par le programme d'investissements d'avenir (PIA). Par ailleurs, nous vous avons entendu le 7 novembre dernier, mais dans un autre cadre puisqu'il s'agissait de votre rapport sur la compétitivité.
Notre rencontre aujourd'hui aura donc deux principaux thèmes. Il s'agit d'une part du PIA, composé d'une enveloppe de 35 milliards d'euros qui a été votée dans la première loi de finances rectificative pour 2010 et transférée à divers organismes gestionnaires, le principal étant l'Agence nationale de la recherche (ANR). Les sommes effectivement décaissées par ces organismes s'établissent quant à elles actuellement à environ 4 milliards d'euros. Il s'agit d'autre part de votre appréciation sur les suites données à votre rapport remarqué de novembre dernier, qui a été à l'origine du tournant de la politique économique du Gouvernement, avec le « pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi ».
Je vous remercie de me permettre m'exprimer à nouveau sur ces sujets, accompagné de Philippe Bouyoux, commissaire général adjoint.
Le PIA porte sur un total de 35 milliards d'euros. Au sein de cette enveloppe globale, 28 milliards d'euros ont été d'ores et déjà engagés. Le rythme d'engagement n'a pas été très rapide dans la période récente, parce que nous attendions que soit rendue publique la « feuille de route » du Gouvernement sur le haut débit, et parce qu'il était encore nécessaire de mettre en place trois sociétés d'accélération du transfert de technologies (SATT). Désormais, ce rythme pourra s'accélérer. Par ailleurs, nous ne cherchions pas particulièrement à accroître le rythme des engagements, parce qu'un volume important de crédits avait déjà été engagé mais non contractualisé. Nous avons mis l'accent sur la contractualisation : nous sommes passés, depuis juin 2012, de 12 milliards d'euros à 21 milliards d'euros de crédits contractualisés.
Nous avons décaissé à ce jour 4,5 milliards d'euros. Les versements portent sur les crédits consommables et sur les intérêts des crédits non consommables. Le volume non consommable est de l'ordre de 15 milliards d'euros. Le volume consommable est donc de l'ordre de 20 milliards d'euros. A partir de maintenant, nous allons décaisser environ 4 milliards d'euros chaque année, en 2013, 2014 et 2015. Après 2015, s'il n'y a pas de réabondement, il y aura une diminution des versements annuels.
Lorsque j'ai pris mes fonctions, mon objectif était de simplifier et d'accélérer. L'accélération, comme je vous l'ai dit, a été très forte sur la contractualisation des crédits engagés. S'agissant de la simplification, nous avons supprimé des étapes dans le processus, notamment certaines phases de présélection des programmes ou de discussion détaillée avec les lauréats. Cependant, de façon générale, il n'y a pas eu de remise en cause générale de la méthode définie par le rapport d'Alain Juppé et de Michel Rocard et par mon prédécesseur.
Le Gouvernement a procédé à un certain redéploiement de l'enveloppe non engagée, non consommée et disponible. En raison des enveloppes pré-affectées, la véritable souplesse portait sur environ 2,2 milliards d'euros. Ces crédits ont été redéployés et des changements d'enveloppes ont été opérés, tout en respectant le cadre législatif fixé en la matière. Le redéploiement a visé à mettre l'accent sur certaines priorités, comme la formation professionnelle (notamment pour mettre l'accent sur le lien entre formation initiale et formation continue), le numérique, les sciences du vivant et la transition énergétique.
Par ailleurs, le Premier ministre a retenu des dispositions permettant d'investir plus en « aval » de la chaîne d'innovations : nous avions créé un flot d'innovations en amont, et il fallait désormais assurer sa gestion en aval, c'est-à-dire la capacité de l'industrie à les appliquer, d'autant plus qu'il s'agit là d'une faiblesse française. Le Premier ministre a ainsi affecté 600 millions d'euros à un fonds géré par la Banque publique d'investissement (BPI) en faveur du capital-investissement, pour financer des petites et moyennes entreprises (PME) innovantes. Ces financements, normalement assurés par le marché, s'étaient en effet effondrés, passant d'un encours de 12 milliards d'euros de levées de fonds en 2007 à 6 milliards d'euros en 2012. Cet effondrement est notamment dû aux contraintes prudentielles des banques et, surtout, des assurances avec les normes dites « Solvabilité II ». Il s'agissait donc de compenser partiellement cette baisse.
S'agissant de la mise en oeuvre du « pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi », je rappelle que j'ai présenté mon rapport le 5 novembre 2012, que le Gouvernement a annoncé son pacte le 6 novembre et que j'ai été auditionné par vous-mêmes le 7 novembre. Ce qui compte désormais, ce n'est plus le rapport mais ce qui est mis en oeuvre par le Gouvernement.
Le commissariat général à l'investissement a été chargé d'assurer le suivi des 35 mesures contenues dans le pacte et dont la plus emblématique était le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE). Chaque mesure a un ministère de référence, en liaison avec lequel nous suivons sa mise en oeuvre. Nous tenons ensuite informés le Parlement et les partenaires sociaux, sur la base d'un tableau de suivi détaillé.
L'effet escompté du pacte ne vient pas d'une seule de ses mesures, mais bien de l'ensemble des mesures qu'il contient. Aucune des 35 mesures n'est suffisamment « transformante » pour assurer à elle seule l'évolution souhaitée. Par ailleurs, cela doit se faire dans le temps : par exemple, on ne peut pas augmenter du jour au lendemain le nombre d'apprentis. La reconquête de la compétitivité est une affaire de plusieurs années, surtout lorsque la croissance est nulle. Il est plus difficile de prendre un virage lorsque l'on n'avance pas. C'est toute la différence avec les réformes Hartz menées en Allemagne, dans un contexte où la croissance était à 2,5 % en Europe - et où, accessoirement, l'euro était entre 0,9 et 1 dollar.
Une dizaine de mesures seront effectivement mises en oeuvre au cours du premier semestre 2013, parmi lesquelles les plus importantes : le CICE, la création de la BPI, la garantie pour les financements de trésorerie accordés par les banques aux PME à hauteur de 500 millions d'euros.
Une dizaine d'autres mesures devraient être mises en oeuvre à la suite de travaux ou de négociations au cours du second semestre 2013. Enfin, une dizaine de mesures ne le seront qu'au premier semestre 2014, notamment parce qu'elles nécessitent le véhicule de la loi de finances.
Enfin, ce dispositif est complété par des mesures récemment décidées par le Gouvernement en matière de simplification et par les mesures qui suivront le rapport des députés Karine Berger et Dominique Lefebvre.
De façon générale, sur les six premiers mois, la dynamique est bonne. Mais c'est toujours le cas au moment du lancement de ce type d'initiatives : il faut surtout qu'au second semestre le pacte ne se dilue pas, que la dynamique ne se perde pas, qu'il n'y ait pas éparpillement des mesures.

Vous avez été membre du groupe d'experts européen présidé par Erkki Liikanen sur la réforme des banques. Quel est votre sentiment sur la réforme bancaire que le Sénat a récemment adoptée ? Par ailleurs, puisque nous parlons de compétitivité, ne faudrait-il pas prévoir des délais d'application pour les normes de Bâle III, notamment s'agissant des ratios de liquidité ?
J'ai en effet été membre du groupe Liikanen. Michel Barnier m'avait choisi en tant que président exécutif d'EADS, pour représenter les entreprises, de même qu'une membre belge représentait les épargnants.
J'ai eu rapidement le sentiment qu'un certain nombre de membres de la commission avaient décidé d'obtenir du rapport Liikanen une position en faveur d'une séparation nette entre les activités de marché et les activités de détail. C'était sans doute lié au rapport Vickers, pour ne pas créer de problèmes de compétitivité aux banques britanniques.
J'ai dès le départ été convaincu que la séparation était un danger majeur pour les banques françaises, qui, du reste, ne s'étaient pas mal comportées avant la crise, notamment au regard du contrôle des risques, sauf Dexia, et qui bénéficiaient d'une supervision qui a toujours bien fonctionné. L'économie française dispose d'un système bancaire qui offre tous les services que les entreprises peuvent demander.
Je suis donc rapidement devenu, au sein du groupe, le défenseur des banques universelles, alors que d'autres membres ont rejoint les positions, par exemple, des responsables de la Royal Bank of Scotland, de la Lloyds ou encore de la Deutsche Bank.
Le rapport est cependant équilibré ; je m'en différencie toutefois sur un point : la tenue de marché. Je suis heureux de voir que le projet de loi français isolait la partie qui me paraissait clairement spéculative et préservait la partie correspondant aux besoins des entreprises, notamment pour accéder au marché. C'est tout l'intérêt de la tenue de marché, qui permet d'apporter la liquidité pour les entreprises présentes sur les marchés.
Le danger de la séparation aurait été la mort de la banque d'investissement française. La seule ayant la taille critique suffisante pour vivre séparée est celle de BNP Paribas et, peut-être, de la Société Générale. Il en serait donc résulté un appauvrissement de l'offre de services aux entreprises, alors qu'aucune crise ne les avait frappées et qu'aucune preuve n'avait été apportée d'une aggravation du risque systémique. Le seul élément était l'idée de garantie implicite du contribuable sur ces activités, mais cela peut se traiter autrement, par exemple par des ratios prudentiels plus élevés pour les opérations de tenue de marché.

Merci pour ces éléments.
S'agissant du calendrier de décaissement du programme d'investissements d'avenir, vous avez mentionné le redéploiement de 2,2 milliards d'euros. La totalité de ce montant correspond-il à des redéploiements entre actions ? Quand les crédits seront-ils engagés par les organismes gestionnaires ?
Par ailleurs, le principe des investissements d'avenir est novateur dans le processus budgétaire, puisque l'on contourne les principes d'annualité et d'universalité. Réaliser beaucoup d'engagements de crédits sur quelques années favorise certes la cohérence, mais cela ne rend-il pas plus difficile de sélectionner les « bons » projets ? N'y a-t-il pas là un risque de rigidification de la dépense publique, étant donnée la durée moyenne des conventions ? Si un engagement est, au bout d'un certain temps, jugé non pertinent, comment faire marche arrière ?
Nous avons vu, dans l'histoire, que la sélection des projets par l'État n'aboutissait pas systématiquement à des succès, comme le Plan Calcul ou le Concorde...

L'État est-il vraiment à même de sélectionner les bons projets ? Et s'il y a 35 milliards d'euros et une quarantaine d'actions, n'y a-t-il pas un éparpillement des moyens ? Par ailleurs, le « stock » de lauréats potentiels aux appels d'offre du PIA n'est pas infini. Le commissariat général à l'investissement a-t-il constaté, au fil des sélections, une diminution de la qualité des projets ?
Nous nous sommes également interrogés sur l'impact des investissements d'avenir sur les dépenses de recherche et développement des entreprises et sur la croissance, alors que, selon le précédent gouvernement, « les dépenses financées par l'emprunt national augmenteraient la croissance de près de + 0,3 % de PIB par an sur la décennie » : en voyez-vous des premiers éléments de confirmation ?
D'un point de vue budgétaire, les dotations non consommables, de 15 milliards d'euros au taux de 3,413 %, correspondent à des décaissements annuels d'un peu plus de 500 millions d'euros. Ce dispositif vient semble-t-il du fait que le précédent Président de la République souhaitait afficher en 2010 des montants de dépenses élevés (15 milliards d'euros plutôt que le montant, plus modeste, de 500 millions d'euros par an). Toutefois, ne serait-il pas plus simple et plus lisible de transformer ces 15 milliards d'euros en crédits de paiement du budget de l'Etat d'environ 500 millions d'euros par an ?
Vous avez mentionné le chiffre de 4 milliards d'euros de décaissements par an de 2013 à 2015 : cette dynamique ne devrait-elle pas être prolongée au-delà ?
Enfin, sur le CICE et l'ensemble du « pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi », pouvez-vous nous donner votre appréciation sur la mise en oeuvre de vos préconisations ? Je pense notamment aux points sur lesquels notre commission s'était interrogée dans le cas du CICE, notamment l'orientation suffisante ou non vers l'industrie, mais aussi le seuil fixé à 2,5 SMIC, qui aurait pu être différent pour tendre davantage vers la compétitivité ou, au contraire, l'emploi.
Les redéploiements sont mis en oeuvre. Les opérateurs (l'ADEME, la Caisse des dépôts ou la Banque publique d'investissement par exemple) les ont engagés. Le commissariat fait fonctionner les nouvelles enveloppes.
Concernant le principe de l'annualité budgétaire, nous y dérogeons mais est-ce un mal ? Les investissements d'avenir ont permis d'adopter une vision pluriannuelle. Nous avons un débat avec la Cour des comptes sur ce sujet, mais nous tiendrons bon sur cette ligne. L'Etat s'engage sur plusieurs années, tout comme ceux qui profitent de son soutien à l'investissement.
Nous ne cherchons pas à aller très vite sur les engagements. A ce jour, près de 15 milliards d'euros ont été engagés au profit des universités, essentiellement sous forme non consommable. En revanche, nous allons très vite sur les contractualisations : on est passé de 12 à 15 milliards d'euros. Je sais que le sénateur Jean Arthuis m'interroge sur la vitesse de contractualisation s'agissant du très haut débit. J'espère que nous allons aller plus vite dans ce domaine. Le Gouvernement a fixé le 28 février 2013 sa « feuille de route » et elle sera précisée en avril. Nous pourrons alors avancer, ce qui est une demande assez générale des élus et des collectivités territoriales.
A propos de la rigidification, l'Etat ne peut heureusement pas faire marche arrière. Cela introduirait une instabilité inacceptable pour le bénéficiaire de son aide.
Sur la sélection des bons candidats, on a favorisé autant que possible le recours à des jurys. Par exemple, sur les pôles d'excellence, le jury a « retoqué » Saclay qui représente 15 % de la recherche française. Ce pôle a ainsi dû revoir sa gouvernance et ses procédures de décision. Les jurys ont plutôt bien travaillé, même si des erreurs sont toujours possibles.
Pour revenir un instant sur le Concorde, je veux dire qu'il n'y aurait pas eu Airbus sans ce projet. Des échecs peuvent parfois être porteurs d'avenir. Certes le plan Calcul est moins probant, mais le programme nucléaire constitue un formidable succès. L'Etat peut faire des choix utiles.
Y a-t-il un éparpillement des investissements d'avenir ? Il arrive que de petits projets grandissent. C'est notamment le cas dans le numérique où, si l'on excepte quelques entreprises de premier rang, comme Dassault Systèmes, les entreprises sont essentiellement des start up.
Concernant le risque d'épuisement du « stock » de bons candidats, nous choisirions d'autres projets si par miracle une nouvelle enveloppe était libérée. Je pense en particulier aux initiatives d'excellence (IDEX) : il n'en existe actuellement que huit et il en faudrait certainement plus (dans le Nord ou dans l'Est).
Si nous avions un nouveau programme il faudrait aussi aller davantage vers l'aval, vers l'appareil productif.
En matière de dépenses de recherche et développement, on verra l'impact des investissements d'avenir. D'ores et déjà nous commençons à l'évaluer et on observe un certain nombre de déblocages dans la recherche appliquée ainsi que dans le domaine de l'innovation. Je suis beaucoup plus sceptique sur l'impact réel et mesurable sur la croissance. L'impact de 0,3 point de croissance par an pendant dix ans me paraît très optimiste, car il correspondrait à une augmentation du produit intérieur brut (PIB) de 3,5 % en fin de période, ce qui, compte tenu des dépenses prévues au titre du PIA, correspondrait à un taux de retour sur investissement peu réaliste.
Il faut rester mesuré s'agissant de l'impact de ces investissements sur la croissance.
L'activité à venir du commissariat consistera à suivre les décisions prises et à être capable d'arrêter les opérations qui ne marchent pas. Dans ce but nous sommes en train de nous reconfigurer.
A propos d'une rebudgétisation des dotations non consommables, je veux dire que ces dotations ont été prises en compte dans le déficit budgétaire de 2010, bien que tel n'ait alors pas été le cas dans le déficit public au sens maastrichtien du terme.
Alors que les universités disposent des dotations non consommables de manière illimitée dans le temps, l'Etat n'est quant à lui engagé que pour dix ans. Cette différence pose pour l'avenir un problème de contractualisation.
En ce qui concerne l'éventualité d'une augmentation de l'enveloppe des investissements d'avenir, c'est une question qu'il faut poser au Gouvernement.
Pour le CICE, l'instruction fiscale est sortie et elle fait quarante-cinq pages, ce qui est, paraît-il, court.
J'avais proposé que le CICE bénéficie aux salaires jusqu'à 3,5 fois le SMIC, afin de le concentrer le plus possible sur l'industrie. Certains économistes prônaient un ratio bien plus bas, afin de privilégier l'impact sur l'emploi. Le Gouvernement a choisi un équilibre en fixant la barre à 2,5 fois le SMIC.
La mesure va porter essentiellement sur les services mais elle aura aussi un effet sur la compétitivité. En Allemagne, l'évolution des salaires dans l'industrie n'a pas été fondamentalement différente de celle constatée en France. Ce qui a caractérisé l'Allemagne, c'est l'effondrement des salaires dans les services : 2 millions de salariés gagnent moins de 4 euros de l'heure et 8 millions de salariés sont situés en deçà du niveau du SMIC français. Ces salariés travaillent dans les services ou dans l'agriculture. Je ne propose pas un alignement du système français sur son voisin allemand. Mais, quand on baisse le coût du travail dans les services, on crée un effet de compétitivité globale qui bénéficie aussi à l'industrie.

Le Gouvernement a publié, le 28 février dernier, sa « feuille de route » sur le numérique. Le déploiement des nouveaux réseaux représenterait plus de 20 milliards d'euros d'investissement au cours des 10 prochaines années, dont 3 milliards dans le cas de l'Etat. Ces 3 milliards seront-ils financés par le programme d'investissements d'avenir ?

La forte baisse du capital-investissement, dont l'encours de levées de fonds est passé de 12 milliards d'euros en 2007 à 6 milliards d'euros en 2012, pourra-t-elle être compensée par les 600 millions d'euros de moyens supplémentaires mis à la disposition de la BPI ? Faut-il reporter l'application de Bâle III ? Est-il pertinent de financer une partie de la formation professionnelle par les investissements d'avenir, alors que les 32 milliards d'euros qu'elle coûte chaque année ne sont pas toujours employés efficacement ? Quelle est la part respective de l'industrie et des services dans les créances du CICE ? Pouvez-vous faire un point sur les financements accordés au titre des investissements d'avenir sur le site de Saclay ?

La loi de finances du 31 décembre 1936 a instauré le Fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACÉ), qui a financé l'électrification des zones rurales grâce à la péréquation. Pourquoi ne fait-on pas la même chose pour le très haut débit ? On pourrait financer ce fonds en augmentant les abonnements des particuliers, par exemple de 2 euros.

Dans le cas du très haut débit, certains travaux sont actuellement bloqués, faute de financement. L'Etat doit aider les entreprises à financer non seulement la recherche-développement, mais aussi l'industrialisation. Le CICE présente d'importantes limites : il est trop complexe pour être réellement efficace ; il constitue, dans le cas de l'année 2013, une augmentation dissimulée du déficit de l'Etat et du déficit public pour environ 10 milliards d'euros (la comptabilité budgétaire et la comptabilité nationale ne prenant pas en compte la créance contractée par les entreprises vis-à-vis de l'Etat) ; et son montant en régime de croisière, de 20 milliards d'euros, demeure insuffisant.

Quel est le bilan des sociétés d'accélération du transfert de technologie (SATT) ? Existe-t-il des plafonds pour les dépenses de fonctionnement des fonds de maturation ?

Il a été envisagé, à l'été 2012, de financer par le programme d'investissements d'avenir certaines dépenses des hôpitaux. Avez-vous été consulté à ce sujet ? Ce projet est-il abandonné ?

Le Gouvernement refuse de retarder la mise en oeuvre de Bâle III. Pourquoi ? Le CICE doit être financé pour 10 milliards d'euros par des mesures nouvelles sur les recettes, et pour 10 milliards d'euros par de moindres dépenses. En quoi ces dernières consisteront-elles ? Le refus du Gouvernement de soutenir la recherche au sujet des organismes génétiquement modifiés (OGM) est économiquement regrettable. Dans le cas du haut débit, le désert est promis à nos zones pavillonnaires.

Certains pays développent l'enseignement sur Internet. Le programme d'investissements d'avenir finance-t-il des projets en ce domaine ?

La proposition de notre collègue François Fortassin de financer le très haut débit dans les zones rurales par un fonds sur le modèle du FACÉ est simple et de bon sens. Le CICE est trop compliqué ; il aurait été plus efficace de réduire les cotisations patronales.

Le programme d'investissements d'avenir finance-t-il la recherche dans le domaine de la robotique et des microprocesseurs ?
Sur les 20 milliards d'euros prévus pour le très haut débit, seule une partie correspondra à des financements publics. 57 % des foyers seront couverts par le fonctionnement naturel du marché, le programme d'investissements d'avenir ne finançant que 300 millions d'euros de prêts non bonifiés. Les « réseaux d'initiative publique » (RIP) desserviront les 43 % de foyers restants. Les frais d'accès à ces réseaux seront partiellement financés par 3 milliards d'euros de prêts aux collectivités territoriales, en provenance des fonds d'épargne. Une subvention d'équilibre de 6 milliards d'euros sera financée pour moitié (3 milliards) par l'Etat, dont 0,9 milliard par le programme d'investissements d'avenir, les 3 milliards restants l'étant par les collectivités territoriales.
Les 600 millions d'euros attribués à la BPI pour le capital-investissement n'empêcheront pas la diminution globale de ces financements. J'espère toutefois que ces 600 millions d'euros correspondront, grâce à un effet de levier, à des financements de 2 milliards d'euros au total.
Dans le cas de la formation professionnelle, le programme d'investissements d'avenir ne finance que des opérations pilote.
Sur les 20 milliards d'euros de CICE, environ 4 milliards bénéficient à l'industrie au sens strict. Le chiffre est un peu supérieur si l'on prend également en compte les services liés. J'ajouterai que le CICE me paraît simple, en particulier comparé au crédit d'impôt recherche (CIR), qui pourtant a été très bien accepté par les entreprises.
Dans le cas du site de Saclay, il faut distinguer l'initiative d'excellence (IDEX) Paris-Saclay, qui s'est vu attribuer 950 millions d'euros de dotation non consommable, et l'opération du plateau de Saclay, bénéficiant d'un milliard d'euros de dotation consommable et de 850 millions d'euros de dotation non consommable.
Je considère, comme le sénateur Jean Arthuis, qu'il faut davantage aider les entreprises en aval de la recherche-développement. Je le trouve toutefois sévère quand il affirme que les 20 milliards d'euros du CICE représentent un effort modeste en faveur de la compétitivité : cela correspond tout de même à un point de produit intérieur brut (PIB).

Il est possible de réduire certains prélèvements obligatoires si on en augmente d'autres !
Sur les 10 milliards d'euros d'économies de dépenses, je ne puis répondre : il conviendra d'interroger le Gouvernement.
En réponse au sénateur Philippe Adnot, j'indiquerai que les SATT qui ont démarré démarrent bien. Celles qui ont le mieux démarré sont celles qui partaient d'une structure préexistante. Il n'y a pas de plafond fixé aux dépenses de fonctionnement. Si les salaires des SATT doivent être, d'une manière générale, plus élevés que ceux auxquels les universités sont habituées, il y a probablement eu quelques abus.
En réponse au sénateur Philippe Dallier, je confirme que la proposition de faire financer les hôpitaux par les investissements d'avenir a heureusement été abandonnée, conformément aux préconisations du commissariat général à l'investissement.
Comme le sénateur Francis Delattre, je considère qu'il faudrait repousser la mise en oeuvre de Bâle III. Mais j'en parle d'autant mieux que personne ne me demande mon avis !

Il est d'autant plus important que votre avis figure au compte-rendu de notre réunion !
Monsieur Delattre, vous avez évoqué les accords de Bâle III, qui concernent les banques. Mais la directive « Solvabilité II », qui concerne les assurances, est au moins aussi importante, et pose un problème analogue. J'estime comme vous que le « principe de précaution » est appliqué de manière trop restrictive, dans le cas des OGM, mais aussi du gaz de schiste et des nanotechnologies. Ca fait beaucoup de sujets sur lesquels on ne peut faire avancer la science ! En voulant refuser tout risque, on prend celui du déclin !
Des projets existent en matière d'e-université. Nous allons participer à un programme du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Depuis quelques années se développent les « massive online open courses » (MOOC, cours de masse en ligne et ouverts), qui ont fait l'objet d'un accord entre le MIT et Harvard, qui ont créé une « université hors sol » : je pense que d'ici à 5 ans, il sera possible d'être diplômé d'Harvard sans avoir jamais mis les pieds aux Etats-Unis. Il me semble que promouvoir ce type de projet entre dans la vocation des investissements d'avenir, même si l'ampleur des crédits pouvant être mobilisés est limitée.
S'agissant de la baisse des charges, le CICE présente en effet un avantage pour le déficit budgétaire 2013. Mais je pense que la baisse des charges pour les entreprises viendra en son heure, parce qu'il n'est pas normal de faire porter sur les salaires des prestations telles, par exemple, que les prestations familiales.
Enfin, pour la robotique, certaines opérations exemplaires sont financées dans le cadre des financements filières. Cela ne suffira pas pour résoudre le problème de la robotique en France, qui est capital : nous disposons de 32 000 robots en France, contre 62 000 en Italie et 150 000 en Allemagne. Certes la taille de notre tissu industriel est différente, mais nous sommes sous-équipés en robots, d'autant plus que notre parc est plus ancien. S'agissant de la recherche sur les microprocesseurs, je crois que la société STMicroelectronics n'a pas à se plaindre du PIA : nous faisons notre devoir en la matière.