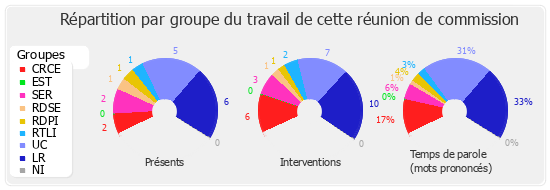Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
Réunion du 13 mars 2019 à 9h00
Sommaire
- Parcoursup
- Audition de m. paul hébert directeur-adjoint à la direction de la conformité de la cnil mme émilie seruga-cau cheffe du service des affaires régaliennes et des collectivités territoriales et mme tiphaine havel conseillère pour les questions institutionnelles et parlementaires (voir le dossier)
- Frais différenciés d'inscription à l'université pour les étrangers extra-communautaires
- Audition de m. charles personnaz auteur du rapport renforcer l'action de la france dans la protection du patrimoine du moyen-orient et le soutien au réseau éducatif des communautés chrétiennes de la région (voir le dossier)
La réunion
Parcoursup
Audition de M. Paul Hébert directeur-adjoint à la direction de la conformité de la cnil Mme émilie Seruga-cau cheffe du service des affaires régaliennes et des collectivités territoriales et Mme Tiphaine Havel conseillère pour les questions institutionnelles et parlementaires

Nous sommes heureux d'accueillir M. Paul Hébert, Mme Émilie Seruga-Cau et Mme Tiphaine Havel, représentants de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Soyez les bienvenus. Votre présidente aurait souhaité être des nôtres, mais elle a été retenue par d'autres travaux. Nous l'auditionnerons prochainement sur des sujets plus larges.
Vous connaissez déjà certains de nos collègues, en particulier M. Loïc Hervé et Mme Sylvie Robert, membres du collège de la CNIL. J'ai également souhaité associer à nos travaux Mme Sophie Joissains qui a été rapporteure, pour la commission des lois, du projet de loi relatif à la protection des données personnelles, devenu depuis, la loi du 20 juin 2018. Elle n'a pas pu se libérer ce matin, et vous prie de bien vouloir l'en excuser. M. Laurent Lafon se fera son porte-parole.
Cette audition s'inscrit dans notre travail de suivi des lois que nous adoptons, en l'occurrence celle du 8 mars 2018, dite Orientation et réussite des étudiants (ORE). Avec cette loi, les traitements automatisés des données personnelles des candidats à l'entrée des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur se sont généralisés dans tous les établissements de l'enseignement supérieur public.
Certes, conformément à l'objectif de la loi, ces traitements ne sont pas « exclusivement automatisés », car des commissions d'examen des voeux interviennent dans le processus de décision, y apportant une dimension humaine. Cependant, les questions de transparence de ces traitements automatisés, que nous appelons par facilité algorithmes locaux, posent question. Si la loi ORE a prévu une information ex post des candidats, elle a dédouané les établissements de leur obligation de publier ex ante une information générale sur les critères pris en compte dans l'examen des dossiers des candidats. Les attendus nationaux ou locaux apportent parfois une information mais, dans la plupart des formations, les critères retenus pour évaluer les candidatures ne sont pas rendus publics.
À peine trois mois après la promulgation de la loi ORE, le 25 mai 2018, le RGPD entrait en vigueur. À cette occasion, le Sénat a réexaminé la question de la transparence des algorithmes locaux et, à l'initiative de Mme Sophie Joissains, notre assemblée a supprimé l'exception Parcoursup sur la non-publication ex ante pour revenir à un régime de droit commun.
Nous aurions aimé vous entendre sur les changements opérés par l'entrée en vigueur du Règlement général de protection des données (RGPD), notamment au regard des dispositions de la loi ORE. Et, d'une manière générale, quelle appréciation la CNIL porte-t-elle sur le dispositif Parcoursup ? Enfin, le Gouvernement prépare un décret qui prescrit, pour tous les établissements participant à Parcoursup, l'affichage sur la plateforme des critères généraux d'examen des voeux. Ce projet de décret a été présenté lundi matin au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser).
La CNIL conduit une action d'accompagnement du dispositif de Parcoursup. Elle a rendu deux avis sur le sujet. L'un a été formulé en urgence, avant le vote de la loi ORE, pour faciliter le recueil des voeux. L'autre, plus structurant, a été rendu le 22 mars 2018 et portait sur le dispositif, une fois la loi ORE adoptée. Cet avis ne portait pas directement sur les traitements locaux, mais des éléments de rappel sur leur mise en oeuvre figurent dans la délibération. L'avis ayant été rendu avant l'entrée en application du RGPD, le 25 mai 2018, il obéit à une logique qui découle de l'ancienne loi. À la suite de cet avis, la CNIL a été sollicitée par des établissements d'enseignement supérieur qui s'interrogeaient sur leurs obligations au regard du RGPD. C'est pourquoi une foire aux questions a été mise en place pour répondre aux remontées du terrain. La CNIL y précise que les établissements locaux sont des responsables de traitement au sens du règlement européen.
Le dispositif Parcoursup autorise les établissements à recourir à un algorithme, sans les y contraindre. L'article 10 de la loi Informatique et libertés, dans sa rédaction antérieure à la loi RGPD du 20 juin, interdisait toute prise de décision entièrement automatisée. Mais désormais l'article 22 du RGPD donne une marge de manoeuvre aux États membres. En France, le principe de l'interdiction des décisions entièrement automatisées n'a pas été levé, mais plusieurs exceptions sont désormais prévues.
Avant le RGPD, le 5° du I de l'article 39 de la loi Informatique et libertés garantissait la transparence en assurant un droit d'accès aux données. Selon la CNIL, ce droit devait permettre aux personnes de comprendre la logique qui sous-tend l'algorithme, chacun devant pouvoir disposer des éléments utiles pour comprendre l'application du traitement automatisé à sa candidature, qu'il s'agisse des critères utilisés, de leur pondération et de leur hiérarchisation dans la décision finale.
Avant le RGPD, des dispositions spécifiques figuraient également dans le code des relations entre le public et l'administration (CRPA), prévoyant notamment que les administrations recourant à un traitement algorithmique pour prendre des décisions individualisées devaient fournir toutes les informations nécessaires à l'intéressé.
À cela s'ajoute l'article L. 612-3 du code de l'éducation faisant obligation aux établissements d'informer les candidats de la possibilité, s'ils en font la demande, de se voir communiquer les informations relatives aux critères d'examen de leur candidature ainsi que des motifs pédagogiques justifiant la décision. Dans sa délibération du 22 mars 2018, la CNIL a indiqué que cette disposition du code de l'éducation ne dérogeait pas à la loi Informatique et libertés ni au RGPD, précisant qu'il s'agissait d'une strate spécifique pouvant être mobilisée indépendamment du fait que le traitement soit automatisé ou pas. Ce point figure dans la huitième question de la foire aux questions publiée sur le site de la CNIL.
Autre difficulté, les articles 12, 13 et 15 du RGPD rattachent l'obligation de transparence à l'article 22 qui vise uniquement les traitements entièrement automatisés. Dès lors que Parcoursup a été conçu pour ne jamais être entièrement automatisé, la CNIL ne peut rien imposer en matière de transparence. D'où l'intérêt de sa recommandation sur l'article L. 612-3 du code de l'éducation, parfaitement conforme à l'avis du G29 qui indique que la transparence en matière de profilage doit être recommandée et réalisée.

Le sujet est particulièrement technique. Comment peut-on être certain qu'une formation n'a pas eu recours à un traitement entièrement automatisé des données de ses candidats ? La CNIL a-t-elle d'ores et déjà diligenté des contrôles dans les établissements ? La CNIL a-t-elle eu à instruire des plaintes relatives au fonctionnement de Parcoursup ? Vous l'avez évoqué mais pouvez-vous nous confirmer que l'article L. 612-3 du code de l'éducation est parfaitement conforme aux nouvelles dispositions issues du RGPD ? Même si le dispositif général de Parcoursup n'est pas juridiquement infondé, la CNIL n'a-t-elle pas quelques recommandations à faire aux établissements pour améliorer la transparence des traitements automatisés mis en oeuvre, qui restent très opaques pour les candidats et ne facilitent pas la prise de décision éclairée ?
Par construction, et compte tenu de l'existence de commissions des voeux qui préservent l'intervention humaine, les traitements mis en place par les établissements ne doivent pas être entièrement automatisés. La CNIL y veille, mais sans avoir de certitude à 100 % de l'application de cette politique sur le terrain. À ce jour, la CNIL a surtout développé une démarche d'accompagnement pour répondre au flot de questions que le RGPD a soulevé. Le contrôle des établissements n'a pas encore été mis en oeuvre.
Nous n'avons reçu qu'une seule plainte au sujet de Parcoursup et qui ne porte pas sur la transparence du dispositif.
Un traitement entièrement automatisé serait contraire aux dispositions de la loi ORE et à l'obligation d'instituer des commissions des voeux. Aucun contrôle n'a été diligenté pour le moment car la CNIL a offert d'accompagner le ministère et les établissements dans la mise en conformité de leurs traitements : une analyse d'impact globale est en cours en coordination avec le ministère en concertation avec les établissements. Il aurait été délicat de mener en parallèle des contrôles qui auraient éventuellement débouché sur des sanctions.
L'article L. 612-3 du code de l'éducation n'est pas contraire aux dispositions du RGPD, ni à la loi Informatique et libertés. Il s'agit d'une disposition spécifique parfaitement autorisée par l'article 22 du RGPD qui permet une marge de manoeuvre nationale. En tout état de cause, les mesures prévues par l'article L. 612-3 ont vocation à s'appliquer. Le candidat pourra obtenir des informations dont il n'aurait pas forcément bénéficié en se fondant sur les mesures de transparence du RGPD, dès lors que le traitement n'est pas entièrement automatisé.
Dans sa foire aux questions, la CNIL distingue deux niveaux de transparence. L'un consiste à publier les critères généraux pris en compte par les établissements au titre de certaines filières. Dans cette perspective, la CNIL a encouragé la publication du code-source de l'algorithme de la plateforme Parcoursup. L'autre intervient après l'examen des candidatures, la CNIL encourageant un retour circonstancié sur les décisions prises, afin que les candidats puissent comprendre pourquoi leur candidature a été écartée.
Nous n'avons pas connaissance dans le détail des projets soumis au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (Cneser) pour préciser les critères généraux d'examen des voeux des candidats. La CNIL s'est prononcée sur le dispositif Parcoursup dans son ensemble. Dès lors que d'autres dispositions réglementaires interviennent, qui ne touchent pas au traitement automatisé, son avis n'est pas requis.

Je donne la parole à Laurent Lafon qui est porteur des questions de Mme Sophie Joissains.

Le moment venu, la CNIL aura-t-elle les moyens suffisants pour contrôler les établissements ?
Quel regard portez-vous sur le contentieux en cours qui touche l'université des Antilles ?
Vous avez recommandé de publier les critères généraux d'examen des candidatures. Qu'entendez-vous lorsque vous recommandez une transparence en matière de pondération ? Dans quelle mesure cette pondération est-elle un critère effectif ?
En 2018, la CNIL a effectué 310 contrôles. Il est clair qu'elle n'a pas les moyens de contrôler l'ensemble des traitements mis en place par les établissements.
Le tribunal administratif de la Guadeloupe a effectivement rendu un jugement le 4 février dernier. Cela ne relève pas de la compétence de la CNIL. Le tribunal administratif a annulé la décision par laquelle le président de l'Université des Antilles a refusé de communiquer à l'Union nationale des étudiants de France (Unef) les procédés algorithmiques utilisés dans le cadre de Parcoursup. Le tribunal a suivi les conclusions du rapporteur public et enjoint à l'université des Antilles de communiquer les documents demandés dans un délai d'un mois.
Ce jugement est intervenu à la suite d'une décision de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), le 10 janvier 2019, portant un avis défavorable sur la demande de communication des procédés algorithmiques utilisés par l'outil d'aide à la décision de Parcoursup. Dans une décision rendue le 21 janvier 2019, le Défenseur des droits recommandait au ministère de l'Enseignement supérieur de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir la transparence de la procédure, pour éviter toute discrimination dans le traitement des candidatures.
Le tribunal a considéré que la communication des procédés algorithmiques à un candidat ou leur publication relevait d'un régime dérogatoire au droit commun institué par le CRPA. Dans la mesure où le code de l'éducation prévoit ce régime dérogatoire au cinquième alinéa de son article L. 612-3, la décision du tribunal est incontestable.
Le jugement indique toutefois que ces dispositions n'écartent pas celles relatives à la publicité de la décision qui figurent à l'article L. 311-1 du CRPA, à l'inverse de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui avait considéré que des tiers ne pouvaient pas avoir accès à ces informations par un autre biais que celui de la publication en ligne par l'administration.
Enfin, le tribunal administratif a estimé que la communication des éléments à l'Unef ne portait pas atteinte au secret des délibérations des équipes pédagogiques, puisque seuls les critères sont communiqués, mais pas l'appréciation de la commission sur les mérites des candidats.
Le jugement du tribunal administratif ne fait référence ni au RGPD, ni à la CNIL ; seules les conclusions du rapporteur public mentionnent l'article 22 du RGPD ainsi qu'un extrait de la délibération de la CNIL du 22 mars 2018.
Nous sommes dans l'attente du pourvoi formé contre ce jugement. L'enjeu n'est pas tant dans l'articulation des différentes dispositions que dans le lien de conséquence établi par le tribunal entre la communication des éléments à un tiers et l'obligation de publicité faite à une administration, alors même que l'avis de la CADA allait dans un sens opposé.
En ce qui concerne les critères de pondération, nous souhaitons la plus grande transparence possible, tout en ayant conscience qu'on ne peut rien imposer aux établissements. La CNIL ne peut que leur recommander de faciliter l'accès aux informations relatives au traitement des candidatures, notamment pour ce qui est des critères d'application de l'algorithme aux situations individuelles.

Notre commission est un ardent défenseur des moyens alloués à la CNIL. Preuve en est, la commission des finances avait envisagé de réduire de 400 000 euros les crédits alloués à la CNIL, au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) et nous avons réussi à supprimer la mesure.

Justifier l'impossibilité d'établir une totale transparence par le fait que tout n'est pas automatisé n'est pas satisfaisant. On contourne ainsi les contrôles, ce qui est regrettable. Il semble que les étudiants ne vous sollicitent pas à titre individuel, mais que c'est plutôt le fait des établissements. Le chiffre de 310 contrôles en 2018 est bien faible. Les recommandations ne suffisent pas. Où est l'étude d'impact qui contribuera à faire évoluer Parcoursup dans l'année 2, l'année 3 intervenant après la mise en place du nouveau bac ? Le système risque de s'alourdir. Dans nos académies, l'absence de transparence est une difficulté qu'on nous relaie souvent.

Le Parlement doit de plus en plus renforcer sa mission d'évaluation des politiques publiques. La Cour des comptes et la CNIL nous apportent des éclairages utiles. Dans l'administration centrale des ministères, le travail d'évaluation est de moins en moins réalisé - et c'est une litote. Sur Parcoursup, le Défenseur des droits et la CADA nous en ont beaucoup plus appris que la communication ministérielle.
Naïvement, je croyais que le RGPD clarifiait le dispositif. Vous nous avez montré que nous nous retrouvions au contraire face à un maquis juridique, avec des dispositifs changeants qui encouragent une précarité du droit et favorisent l'incompréhension des usagers du service public.
S'agissant de la CADA, elle m'avait donné un avis sur la communicabilité des algorithmes locaux rigoureusement à l'opposé de ce que vous nous avez expliqué. Sa doctrine est pour le moins changeante.
À partir de quand considère-t-on qu'un traitement est automatisé ? Suffit-il qu'une commission valide les résultats d'un algorithme pour considérer que le traitement a été humanisé ? Par quelle valeur ajoutée un jury pourrait-il faire en sorte que le traitement ne soit pas automatisé ?

Des articles récents se font l'écho du lobbying intense que certaines entreprises mettent en oeuvre aux États-Unis contre le RGPD. Nous souhaiterions entendre votre présidente sur ces sujets.

Vous avez mentionné la réunion du Cneser, lundi dernier, sur les dispositions d'un décret en cours d'élaboration obligeant les établissements à préciser sur la plateforme les critères d'évaluation pour chaque candidature. La CNIL pourrait-elle préconiser de préciser rigoureusement les critères généraux d'examen des candidatures ?
La meilleure protection des données est encore de n'en transmettre aucune. Le nom, prénom, adresse et âge ne sont pas fournis, mais le lycée d'origine figure dans le dossier de candidature. Si le candidat postule à une formation en internat, il est obligé de préciser ces éléments pour faciliter le choix de son affectation. N'est-ce pas là une limite à l'anonymisation de Parcoursup ?

La réforme du lycée favorise une plus grande autonomie des élèves, c'est-à-dire une meilleure compréhension des choix de leur orientation. La transparence des critères s'inscrit dans cette logique. La politique du Gouvernement est pour le moins incohérente.
Comment les données très sensibles qui sont transmises lors de la procédure Parcoursup peuvent-elles être complètement protégées ? Peut-on être certain que les géants du web, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft (les Gafam) n'y auront pas accès ? Des inquiétudes se font jour au sujet des données traitées par l'éducation nationale. Elles représentent une manne pour ceux qui voudraient en faire une utilisation commerciale.

Vous avez mentionné le Défenseur des droits qui doit juger du caractère discriminatoire du dispositif. Il a indiqué que la mention du lycée d'origine dans les dossiers risquait de favoriser les pratiques discriminatoires. L'anonymisation ne prend pas en compte cet élément. Quel regard portez-vous sur cette question ?

Cet échange montre la complexité des rapports qui arrivent à la CNIL, mais aussi la nécessité de mieux contrôler l'application des textes que nous votons. Il est intéressant de constater qu'un an après, les questions que nous portons au sein de la CNIL, et particulièrement la transparence, sont encore vectrices de doutes et de questionnement, malgré l'arsenal juridique dont nous disposons. La CNIL devrait se remettre au travail sur Parcoursup, à la faveur d'une saisine particulière sur tel ou tel domaine. Des effets discriminatoires ont conduit à la saisine du Défenseur des droits. Il faut plus de contrôle.

Le renforcement des moyens de contrôle du Parlement est inscrit dans le cadre d'une réforme institutionnelle à venir.
Je remercie votre commission pour son soutien dans la défense de notre budget, à la fin de l'année dernière. Nous avons obtenu 15 ETP. La diminution de nos crédits ne nous aurait pas permis de développer notre accompagnement aux collectivités territoriales, action prioritaire de ce premier semestre, avec la préparation d'un guide dédié qui sortira d'ici l'été.
Nous devons faire des choix. Il est essentiel que la CNIL développe l'accompagnement des acteurs, mais il faut aussi qu'elle sécurise la chaîne répressive à laquelle les contrôles sont étroitement liés. Nous diligentons d'une part des contrôles annuels par secteur, et d'autre part des contrôles sur signalement à partir de différents vecteurs, dont les réseaux sociaux. Le faible chiffre de 310 contrôles en 2018 s'explique par le système de carottage auquel nous recourons pour identifier les secteurs prioritaires.
Enfin, nous devons aussi promouvoir le modèle européen à l'échelle internationale. Des lobbies sont à l'oeuvre et nous devons porter avec force la voix de la France au sein du concert des CNIL européennes, comme le fait notre présidente, en ce moment même, à Bruxelles.

Il faut effectivement rappeler le rôle moteur de la France au sein du G29, et celui d'Isabelle Falque-Perrotin, l'ancienne présidente de la CNIL, dans le soutien au RGPD.
Nous n'avons pas été sollicités par les étudiants sur l'exercice de leurs droits. Seuls les établissements et le ministère nous ont posé des questions.
La CNIL a publiquement indiqué que pour les traitements déclarés antérieurement au 25 mai 2018, date de l'entrée en vigueur du RGPD, les établissements disposaient d'un délai de trois ans, sauf en cas de modification substantielle du traitement requérant un nouvel examen par la CNIL.
L'étude d'impact est en cours de réalisation. Une analyse d'impact se structure en quatre parties et consiste en une analyse juridique et technique des risques pesant sur les personnes concernées. Le ministère a décidé de s'occuper de tout ce qui correspond au socle commun du dispositif Parcoursup, pour que les établissements n'aient plus qu'à l'adapter au regard de leurs spécificités locales. Les établissements ne sécurisent par exemple pas tous de la même manière les données qu'ils collectent. Constitution du socle commun, passage en revue par les établissements de leurs risques en interne... tout cela explique que l'analyse d'impact prenne du temps.
Traitement automatisé il y a, indéniablement, mais la question est de savoir s'il l'est entièrement. Le RGPD repose largement sur cette nuance. Le 5° du I de l'article 39 de la loi Informatique et libertés ne distinguait pas le traitement entièrement automatisé du traitement qui ne l'est que partiellement. Cette distinction est désormais faite, et le dispositif a de toute façon été conçu, au moins au niveau législatif, pour que le traitement ne soit jamais entièrement automatisé avec notamment l'examen par la commission des voeux. En pratique, certes, tout dépendra de l'implication de chaque commission, mais cet examen doit avoir lieu. Les commissions ne relèveront peut-être rien de particulier dans 90 % des cas, mais leur seule existence témoigne de ce que le traitement n'est pas entièrement automatisé.
La CADA a rendu trois avis : deux sont accessibles dans les conclusions du rapporteur public, et un a été publié en janvier 2019. Je ne suis pas certaine qu'ils soient contradictoires ; sans doute faudrait-il interroger la CADA à ce sujet.
Nous sommes plutôt dans des procédés de pseudo-anonymisation car, dès lors qu'un lien peut être fait avec d'autres informations relatives à l'identité des personnes, les dispositions de la loi Informatique et libertés et du RGPD s'appliquent.
L'analyse d'impact fait figurer tous les risques - usage de serveurs à l'étranger, recours aux Gafam, etc. - et donc les mesures de sécurité associées.
La question de la prise en compte du lycée d'origine n'entre pas vraiment dans le coeur des compétences de la CNIL. Je dirai simplement que lorsqu'il est question de données sensibles, les mesures adéquates doivent être prises pour adapter le niveau de risque.

Merci beaucoup. Nous aurons sans doute l'occasion de prolonger ces réflexions avec la présidente de la CNIL et le président de la CADA.

Le 19 novembre dernier, le Premier ministre a annoncé, dans le cadre de son plan d'attractivité « Bienvenue en France », l'augmentation des droits d'inscription à l'université pour les étudiants étrangers extra-communautaires dès septembre prochain. Nous avons été nombreux à évoquer cette question lors de l'examen de la loi ORE - la ministre nous avait alors renvoyés à un débat ultérieur - et à avoir été alertés sur les problèmes qu'elle soulève, que ce soit dans le cadre de nos groupes d'amitié ou via des ambassadeurs, des présidents d'université ou des étudiants. Si nous ne sommes pas tous d'accord sur le principe de la différenciation des droits d'inscription, nous aimerions en tout cas pouvoir en débattre. Bref, ce que nous contestons, c'est la méthode employée par le Gouvernement.
C'est pourquoi j'ai demandé à nos collègues Claude Kern et Stéphane Piednoir d'étudier en détail le plan « Bienvenue en France » et de nous faire des propositions. Le sujet n'a d'ailleurs pas quitté l'actualité puisque ce lundi 11 mars, le Cneser a examiné et rejeté massivement les projets de décret et d'arrêté de la ministre fixant les nouveaux droits d'inscription.

Le 19 novembre dernier, à l'occasion des rencontres universitaires de la francophonie, le Premier ministre a en effet dévoilé la stratégie d'attractivité de la France pour les étudiants internationaux, baptisée « Bienvenue en France », ou « Choose France ». De ces annonces, nous n'avons retenu que celle concernant l'augmentation des frais d'inscription à l'université des étudiants extracommunautaires, tant elle a suscité d'émoi - émoi qui ne faiblit pas, voire prend de l'ampleur. D'où le cycle d'auditions souhaité par notre présidente, qui vous était ouvert, chers collègues. Nous remercions particulièrement Claudine Lepage, Jacques Grosperrin et Pierre Ouzoulias pour leur participation et leurs questions pertinentes.
Notre pays a accueilli 343 000 étudiants étrangers en 2017, soit une hausse de 19 % sur les cinq précédentes années. Cela peut sembler beaucoup mais, rapporté à l'augmentation mondiale, qui atteint 23 % sur cinq ans, c'est peu. C'est peu également par comparaison avec certains de nos concurrents, particulièrement dynamiques sur le marché de la mobilité estudiantine internationale : sur la même période, l'Arabie saoudite a connu une progression des effectifs accueillis sur son sol de 170 %, la Turquie de 180 % et les Pays-Bas de 200 %. Et cela va s'amplifier car, d'ici à 2025, le nombre d'étudiants en mobilité diplômante dans le monde devrait doubler pour passer de 4,6 à 9 millions. Le Président de la République a fixé, pour la France, un objectif de 500 000 étudiants pour 2027, soit une hausse de 45 % par rapport à 2017. Cela reste faible par rapport à la mobilité mondiale.
De cette faible dynamique française, il résulte mécaniquement une baisse de la part des étudiants mondiaux accueillis dans notre pays. La France est ainsi passée il y a deux ans de la troisième à la quatrième place mondiale, derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Elle reste encore pour l'instant la première destination non anglophone, à égalité avec l'Allemagne, mais pourrait être prochainement devancée par l'Allemagne, le Canada, la Russie, et passer à la septième voire à la huitième place du classement mondial des destinations étudiantes.
Les étudiants que nous accueillons sont originaires à 25 % d'Europe, à 16 % d'Asie et d'Océanie, à 9 % du continent américain, mais presque la moitié des étudiants, à savoir 45 %, sont originaires d'Afrique, et un quart d'Afrique du Nord. La France dispose ainsi d'une « clientèle » traditionnelle plus ou moins captive, liée à notre histoire coloniale et à la francophonie.

La France avait tendance à s'endormir sur ses lauriers. Il devenait urgent de définir une vraie politique d'attractivité globale, pour accueillir plus, mieux, et au-delà de notre clientèle traditionnelle, notamment en direction de l'Asie - un étudiant sur deux dans le monde vient de ce continent. Le discours du Président de la République du 20 mars 2018 a posé les jalons d'une nouvelle approche avec le plan « Bienvenue en France » et l'objectif des 500 000 étudiants accueillis en 2027.
Ce plan se décline en six axes et s'appuie sur un fonds d'amorçage doté de 10 millions d'euros en 2019. Le premier axe concerne la politique de visas, avec une priorité aux étudiants internationaux et la poursuite du développement des guichets uniques, qui fonctionnent particulièrement bien sur les sites des universités. Deuxième axe : développer les cursus en anglais et les cours de français langue étrangère pour les non francophones. À l'heure actuelle, 237 établissements proposent des modules en anglais, ce qui représente près de 1 300 programmes ; le Gouvernement veut aller plus loin encore. Le troisième axe prévoit la création d'un label qualité d'accueil des étudiants internationaux, délivré par Campus France ; 200 établissements sont déjà intéressés. Le quatrième axe, celui qui a suscité le plus de commentaires, concerne l'augmentation des frais d'inscription ainsi que les bourses et exonérations qui en sont le corollaire. Le cinquième axe consiste en la poursuite du développement de formations françaises à l'étranger - c'est une tendance longue, qui s'amplifie ; le ministère des affaires étrangères prévoit un fonds d'amorçage de 5 millions d'euros pour 2019, qui sera complété par l'Agence française de développement, sur les cinq années suivantes, à hauteur de 20 millions d'euros. Sixième et dernier axe : une campagne mondiale de promotion des études en France, qui sera conduite par Campus France à compter de septembre prochain pour un montant de 300 000 euros ; les cibles seront l'Afrique francophone, les grands pays émergents et l'Afrique anglophone, avec une priorité donnée aux mobilités en master et en doctorat.
La première mesure du quatrième volet prévoit donc la différenciation des frais d'inscription pour les étudiants extracommunautaires, applicable dès septembre prochain. Ne seront concernés que les nouveaux arrivants - soit un tiers des 343 000 étudiants étrangers - en mobilité individuelle - près de 25 % sont en mobilité organisée dans le cadre d'une convention entre établissements. Les montants retenus pour les nouveaux droits sont de 2 770 euros en licence, et 3 770 euros pour les autres cycles, soit environ un tiers du coût réel moyen d'une année d'enseignement supérieur public en France - qui coûte environ 10 000 euros -, tout en restant en deçà du coût réel des formations les moins coûteuses. C'est une vraie rupture dans notre modèle théorique de quasi-gratuité des études supérieures en France pour tous les étudiants. De très nombreux pays pratiquent déjà des frais différenciés : la Belgique - qui réclame 3 000 euros en licence, 6 000 euros en master -, l'Allemagne dans certains Länder, les Pays-Bas, le Sénégal, ou encore l'Afrique du sud. Les pays qui se rapprochent le plus du cas de figure français sont le Danemark et la Suède, qui sont passés d'une quasi-gratuité universelle à une différenciation des droits pour les étudiants étrangers.
Les raisons qui peuvent justifier cette différenciation sont multiples. D'abord, les étudiants étrangers ne sont pas redevables de l'impôt en France, alors que les universités sont financées à 75 % ou 80 % par de l'argent public. Ensuite, cela permet de faire participer les étudiants qui en ont les moyens au vrai coût de la formation. En outre, des frais plus proches du coût réel de la formation envoient un signal prix indicatif de la qualité des formations à un certain public étudiant, notamment l'asiatique. Enfin, ces droits constituent une ressource propre pour des établissements en quête de nouvelles sources de financement. En régime plein, c'est-à-dire dans trois ou quatre ans, à nombre d'inscrits inchangé, et sans prise en compte d'éventuelles exonérations supplémentaires décidées par les établissements, nous l'évaluons à 350 millions d'euros. L'an dernier, los de l'examen de la loi ORE, le Sénat avait voté l'amendement de M. Paccaud permettant aux établissements de fixer librement leur politique de droits d'inscription à l'égard des étudiants extracommunautaires. Sur le fond, nous demeurons favorables à la différenciation des droits.
Pour éviter un trop fort effet d'éviction des étudiants étrangers n'ayant pas les ressources suffisantes pour s'acquitter de ces nouveaux droits, le Gouvernement a annoncé le triplement des bourses offertes aux étudiants étrangers. Le Premier ministre a comptabilisé dans son calcul les 7 000 bourses du Gouvernement français distribuées par le ministère des affaires étrangères, les 8 000 bourses d'exonération créées dans le cadre de la réforme, portées à 14 000 et également portées par le ministère des affaires étrangères, et enfin 6 000 exonérations qui seraient octroyées par les établissements. Le budget de l'État destiné aux bourses n'augmentant pas pour autant, la réforme devra se faire à coût constant.
Les établissements pourront exonérer certains étudiants de leur propre chef, dans la limite de 10 % de leurs effectifs, ce qui ne devrait pas être bloquant pour l'année 2019-2020 si tous les étudiants extracommunautaires devaient être exonérés. En revanche, en 2020, une dizaine d'établissements devraient être empêchés de décider une exonération totale. À ce jour, 17 universités ont déjà annoncé leur volonté d'exonérer tous leurs étudiants extracommunautaires dès 2019.

Toute augmentation des droits entraîne un risque d'éviction, nous le savons. Certains étudiants risquent d'être découragés de déposer leur candidature, par crainte, réelle ou supposée, de ne pouvoir s'acquitter du coût des études. La Suède et le Danemark ont ainsi connu une forte baisse du nombre d'étudiants internationaux accueillis la première année, respectivement de 30 % et de 35 %, mais avec un effet de rattrapage progressif.
La Cour des comptes estime que cette éviction pourrait, dans un scénario d'augmentation forte des droits d'inscription, atteindre 40 %, compte tenu de l'origine géographique des étudiants qui se dirigent actuellement vers la France. Les chiffres ne sont pas encore définitifs, mais on observe déjà une diminution de 2,4 % du nombre de candidatures recueillies sur le site « Etudes en France » pour l'entrée en L1, dans un contexte toutefois où la croissance de la mobilité étudiante internationale est chaque année comprise entre 5 % et 8 %... On observe un retrait beaucoup plus sévère du nombre de candidatures aux niveaux L2 à M2 - de l'ordre de 22 % au 22 février par rapport à la même date l'an dernier selon des chiffres provisoires-, mais les dernières annonces relatives aux exonérations supplémentaires peuvent faire espérer à la clôture, fin mars, une baisse de l'ordre de 15 % à 18 %. Il ne s'agit toutefois que de candidatures et rien n'indique que le nombre d'inscrits sera moindre que l'an dernier : en effet, en moyenne, seule une candidature sur dix se transforme en inscription définitive.
Il est certain que l'annonce très brutale de la décision du Premier ministre, qui n'a pas fait l'objet de concertation au-delà du cadre interministériel et que la plupart de nos partenaires ont découverte dans la presse, a été mal ressentie des candidats aux études en France. En témoignent les baisses drastiques de candidatures en provenance de certains pays - de 55 % pour le Brésil, 41 % pour l'Algérie et la Guinée, 28 % pour la Tunisie, 27 % pour l'Égypte, selon les chiffres provisoires - mais aussi les montées au créneau de nombreux ambassadeurs de pays étrangers et particulièrement de la zone francophone pour lesquels les études en France sont un débouché naturel d'une partie de leurs étudiants. À l'inverse, certaines nationalités progressent de manière significative par rapport à l'an dernier : la Chine, de 33 %, l'Indonésie, de 21 %, et l'Inde, de 10 %.
Devant la bronca suscitée par cette annonce brutale, cinq experts ont été mandatés par le Gouvernement pour faire de nouvelles propositions. Ils ont remis leur rapport le 18 février dernier et préconisé l'exonération des doctorants - les doctorants étrangers représentent plus de 40 % de nos doctorants -, l'augmentation, de 10 000 à 14 000, des exonérations à la main du ministère des affaires étrangères, avec une priorité donnée à l'Afrique pour 10 000 de ces exonérations, et la possibilité pour les universités d'exonérer partiellement les étudiants des frais d'inscription. Ces propositions ont été retenues par la ministre de l'enseignement supérieur dans les projets de décret et d'arrêté qu'elle a soumis au Cneser lundi dernier.
Les universités, prises de court elles aussi, n'ont pas eu le temps de réexaminer leur stratégie internationale ni, a fortiori, de définir une nouvelle politique d'exonération. Bien souvent, elles ont donc annoncé l'exonération d'office de tous les étudiants étrangers à la rentrée prochaine. L'apport de recettes supplémentaires au budget des universités sera donc vraisemblablement proche de zéro en 2019.
Nous sommes résolument favorables tant à la définition d'une stratégie d'attractivité en direction des étudiants internationaux qu'à l'instauration de droits différenciés. Mais ce sujet aurait mérité plus de temps de réflexion et l'inscription dans un cadre plus large. Les droits d'inscription dans le supérieur sont fixés chaque année par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en vertu d'un texte qui date de 1951 ; la question de leur nature - taxe ou redevance - n'est toujours pas tranchée et tant le Parlement que les établissements sont exclus de leur fixation. Il pourrait être intéressant de réfléchir à la fixation d'une fourchette de droits d'inscription au sein de laquelle les établissements auraient l'autonomie de fixer les droits qui s'appliqueraient à leurs étudiants. En outre, le dispositif français des bourses à l'international est terriblement complexe et probablement insuffisant. Une remise à plat globale est nécessaire et il aurait été judicieux qu'une telle réforme constitue un volet à part entière du plan « Bienvenue en France ». Il faut enfin que les établissements élaborent progressivement de véritables politiques d'attractivité articulées à la politique nationale d'attractivité et aux politiques d'attractivité des collectivités territoriales.
Tous ces chantiers demandent du temps. C'est pourquoi nous préconisons le report de la mesure relative aux frais différenciés à septembre 2020.

Merci à nos deux rapporteurs pour leurs précisions. Nous auditionnerons Mme Frédérique Vidal le 27 mars. J'aurais aimé la recevoir plus tôt, mais il était important que nous prenions une position rapidement.

Quid des étudiants extracommunautaires qui effectuent leur scolarité dans le réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) ? Ils ont reçu la même formation que les enfants français, mais l'investissement pour les familles est lourd, ils ne bénéficient d'aucune bourse, et après dix ans dans notre système, il serait discriminatoire de les traiter différemment pour entrer dans l'enseignement supérieur français. Ne peut-on envisager une exception pour ces étudiants ? Ce serait juste, cela renforcerait l'attractivité des établissements de l'AEFE et nous rapprocherait de l'objectif, fixé par le Président de la République, du doublement des effectifs de notre réseau...

Je félicite nos collègues pour leur excellente communication. Le groupe Les indépendants - République et territoires est plutôt favorable au rapprochement des frais d'inscription déboursés par les étudiants extracommunautaires du coût réel supporté par les établissements et, à travers l'impôt, par les contribuables. Vous l'avez indiqué, les exonérations sont nombreuses. Pour éviter l'effet d'éviction à court terme, il conviendrait d'augmenter le nombre de bourses au mérite, en particulier les dispositifs de soutien aux étudiants issus de la francophonie, et d'exclure de la hausse des frais d'inscription les titulaires d'un bac français et les doctorants, car ces derniers représentent 40 % des effectifs des écoles doctorales et il serait difficile de se priver de ces talents. C'est envisagé, semble-t-il.
Je ne conteste pas l'idée d'un report à 2020, mais vaut-il mieux mener une concertation au risque de ne jamais aboutir, ou annoncer un plan, qui pourra éventuellement faire l'objet de modifications à l'issue du débat qu'il aura suscité ? Constructive, je pense qu'il vaut mieux réfléchir et proposer de telles modifications, plutôt que de s'opposer.

Je me joins aux remerciements adressés à nos deux collègues. J'ai beaucoup apprécié l'esprit avec lequel MM. Piednoir et Kern ont mené les auditions ; le dialogue que nous avons eu avec la Cour des comptes ou la Conférence des présidents d'université (CPU), par exemple, montre que la qualité de nos travaux est reconnue à l'extérieur et que nos interlocuteurs ont confiance dans l'usage que nous faisons des informations qu'ils nous donnent - et qui sont parfois hautement confidentielles.
Bon nombre des représentants des institutions que nous avons rencontrés étaient très heureux de pouvoir parler du dispositif, car il n'y a, semble-t-il, guère qu'avec la commission de la culture du Sénat qu'ils peuvent le faire... Le sentiment que l'on a eu, un peu effrayant, est que le dispositif envisagé procède d'un bricolage assez autoritaire, imposé dans des délais contraints, et qu'il ne permettra pas d'atteindre les objectifs fixés. Le report est donc une mesure de bon sens.
Sur le fond, il manque une réflexion de base, quasiment philosophique : que représente aujourd'hui pour la France l'accueil d'étudiants étrangers ? Ma vision est sans doute un peu générale, utopique, voire idyllique : l'accueil d'étudiants étrangers participe du rayonnement de la pensée française et de notre influence économique. Sous ce rapport, cette politique ne mérite-t-elle pas quelques moyens ? L'idée économique de faire payer les étudiants étrangers pour développer l'accueil d'autres étudiants étrangers me semble un peu simpliste. Les autres pays, qui reçoivent des flux d'étudiants internationaux croissants, consacrent à cette politique d'énormes moyens, notamment pour accueillir ceux des étudiants étrangers qui ne pourront plus venir en France.
Sur les cursus en anglais, je vous demande sincèrement de réfléchir. Aux Pays-Bas, il est à craindre que très prochainement, tout se fera en anglais. Or la langue est fondamentale dans l'identité d'un pays, et les étudiants qui viennent en France viennent aussi pour suivre un enseignement en français.

Je rejoins M. Ouzoulias. C'est le Premier ministre qui avait annoncé cette mesure, considérant qu'il fallait renforcer la politique d'attractivité de notre pays. Mais élaborer une nouvelle stratégie exige une réflexion de fond, on ne peut se contenter d'augmenter les frais de scolarité ou de simplifier les règles de visa. Derrière ces sujets se posent des questions diplomatiques, ainsi que d'attractivité des établissements et des formations. Et la réflexion demande du temps. Reporter la mise en oeuvre de la décision à 2020 était une des demandes que nous avons faites, avec la CPU et d'autres acteurs, car cette question n'est pas anecdotique : donnons-nous les moyens de l'aborder au fond.
Pourquoi les parlementaires se mêleraient-ils de sujets qui relèvent du règlement, entend-on parfois... Parce que les conséquences pour notre politique d'enseignement supérieur sont considérables ! Et puisqu'ils touchent au logement universitaire, à la mobilité ou à l'accès à l'alimentation, il aurait aussi fallu mettre dans la boucle les collectivités territoriales.
J'étais au Cneser lundi matin. J'ai entendu l'ensemble des acteurs regretter unanimement - c'est la première fois - que le temps de la réflexion n'ait pas été pris. Les universités ne savent pas sur quels critères décider de nouvelles exonérations pour la rentrée prochaine ; elles vont donc devoir bricoler, ce qui les place dans une position très délicate. Les problèmes ne surgiront qu'en 2020, voire en 2021 : miser là-dessus, de la part du Gouvernement, est assez machiavélique. Mais que pouvons-nous faire pour nous y opposer, chers collègues ? Rien, les décrets vont sortir, hélas ! Nous aurons simplement la satisfaction d'avoir, au Sénat, anticipé les choses, une fois de plus.

Je voudrais à mon tour remercier nos collègues pour leur excellente communication. Pardonnez-moi de prêcher pour ma paroisse, mais ne peut-on étendre ce rapport aux outre-mer ? J'ignore si les rapporteurs ont eu le temps de se pencher sur leur cas, mais je rappelle que nous avons des universités partout, en Amérique du Sud, dans l'Océan pacifique, dans l'Océan indien et dans la Caraïbe, et la situation n'est pas la même partout.
Nos établissements ultramarins attirent de très nombreux étudiants dans leur zone géographique, souvent francophones - d'Haïti par exemple, pour l'université de Guyane, dont j'ai été directeur de la formation continue. Ils sont parfois en situation irrégulière, ce qui conduit les établissements à traiter au cas par cas avec les services de la préfecture et de la police aux frontières. Or ces étudiants réussissent souvent bien, certains deviennent parfois même ingénieurs au centre spatial. Je propose par conséquent de compléter votre enquête en envoyant un questionnaire aux présidents des universités ultramarines. L'augmentation des frais d'inscription des étudiants étrangers - qui représentent 30 % de nos effectifs - a provoqué des manifestations. Je suis à votre disposition pour servir de relais avec les acteurs locaux.
Une touche d'humour pour finir. Je viens de lire dans un cahier de doléances versé au Grand débat national la demande suivante : « la vente pure et simple des DOM-TOM qui coûtent trop cher à la France » !

Nos collègues ont réussi à bien débroussailler le sujet dans un délai particulièrement contraint.
Cette question en comporte deux : d'une part le financement, question toujours sensible dans l'enseignement supérieur, et d'autre part l'application de directives nationales par des universités autonomes... Il y a manifestement eu un problème de méthode, plus que de fond, dans la démarche du Gouvernement. Si notre amendement à la loi ORE avait été voté, nos n'en serions pas là, car il reportait la responsabilité d'une telle décision sur les conseils d'administration des universités...
Soyons prudents sur les chiffres, notamment ceux de cette année. Les inscriptions ne sont pas terminées, et beaucoup se font dans les tout derniers jours.
L'intervention de Mme Mélot me fait penser qu'il ne faudrait pas que la position de notre commission paraisse ambiguë, ni que l'idée d'un report soit comprise comme un enterrement, à terme, de la réforme. Les rapporteurs peuvent-ils nous confirmer qu'ils proposent un report de l'application de la décision, et non de la décision elle-même ?

Je félicite à mon tour nos deux collègues. J'aurais aimé, comme notre présidente, avoir l'avis de la ministre...

J'ai fait partie de ceux qui défendaient l'augmentation des droits d'inscription, compte tenu de ce qui se pratique à l'étranger - l'Australie nous est ainsi passée devant - et sous réserve que les conditions de travail des étudiants suivent l'augmentation des frais.
Aujourd'hui, je m'interroge. Les doctorants, qu'il est question d'exonérer, sont peut-être nombreux, mais ils n'auraient apporté que 4 ou 5 millions d'euros. Il aurait été plus utile de prendre le temps de la réflexion. Je m'interroge aussi sur les motivations du Gouvernement. Le Premier ministre sera confronté, au Havre, aux conséquences difficiles d'une telle décision, que les exonérations ou le cas par cas n'atténueront pas entièrement. Bref, j'aurais préféré une solution plus globale, prise avec le temps de la réflexion, associant davantage le Parlement, et je crains que cette décision ne dissimule autre chose.

Je m'associe aux remerciements adressés à nos collègues.
« Bienvenue en France » : le titre, sympathique, ressemble à un message publicitaire. Mais la réalité est tout autre, et il n'y a même pas eu d'étude d'impact !
Pourriez-vous nous donner des précisions sur les conséquences envisagées de la mesure, à savoir la chute du nombre d'inscription dans certains pays, et l'augmentation dans d'autres ?
Vous avez dit qu'une candidature sur dix se transformait en inscription définitive : pourquoi ? S'agit-il de problèmes de visa ? De logement ?
Je partage entièrement les propos de Mme Robert et de M. Ouzoulias. Comment, en outre, expliquer l'objectif de 500 000 étudiants étrangers aux Français ? En matière de formation, nous le savons bien, les objectifs quantitatifs sont hautement contestables - voyez le taux de réussite en premier cycle depuis qu'on a fixé celui du baccalauréat...

Si le Premier ministre était havrais, le Gouvernement n'aurait pas pris une telle décision, parce que la jeune université du Havre, grand port maritime ouvert sur le monde, s'est constituée autour d'une faculté des affaires internationales et accueille de nombreux étudiants étrangers. Elle a même été complétée par un premier cycle délocalisé de Sciences Po Paris orienté vers l'Asie. Cette décision sera peut-être fatale à des jeunes universités semblables à celle du Havre !
Le rapport examine-t-il le problème spécifique des étudiants en médecine ? Je ne vous en ferai pas le reproche dans le cas contraire, car il était déjà bien éclairant. Nous allons au-devant d'années calamiteuses en termes de démographie médicale - même en tenant compte de la suppression du numerus clausus, puisqu'il faut une dizaine d'années au bas mot pour former un médecin. Une piste de solution pourrait être d'accueillir de jeunes étudiants étrangers - de façon spécifique certes, sans en rabattre sur la qualité de la formation.

Les pays du Golfe déroulent le tapis rouge aux étudiants, notamment maghrébins. Peut-on évaluer l'effet sur les flux d'étudiants de telles initiatives ?

Faut-il lancer une concertation ? Nous le croyons. Le moment qui a suivi le vote de la loi ORE y était propice. Malheureusement, le Gouvernement, avec les remous suscités par ce texte, ne l'a pas souhaité. D'où le bricolage actuel, perçu comme une mesure budgétaire d'urgence : l'enseignement supérieur aurait besoin d'un milliard d'euros de financement supplémentaire, et les mesures envisagées rapporteraient 350 millions d'euros en année pleine. Mais c'est oublier tout le reste, la réflexion sur les programmes spécifiques, les études de santé, le logement des étudiants... Nous sommes bien sûr très favorables à passer de 343 000 à 500 000 étudiants, mais la CPU nous a dit que certains étudiants étrangers dormaient dans leur voiture ! Où les logera-t-on ?
Si, madame Robert, nous avons un pouvoir : celui d'alerter, et de mettre le Gouvernement devant ses responsabilités, et de ce point de vue, notre communication n'est peut-être pas neutre.
Nous souhaitons bel et bien un report de l'application de la décision, mais avec des amodiations.
Le ratio nombre de candidatures sur inscriptions dépend du nombre de places offertes, tout simplement. La volatilité des candidatures d'un continent à un autre résulte des différences de sensibilité au signal prix : les étudiants asiatiques, par exemple, y sont plus sensibles.
Je suis d'accord que les objectifs quantitatifs ne sont pas une solution : les 80 % d'une classe d'âge au bac, on ne s'en remet toujours pas...

Il n'est malheureusement pas prévu, pour l'instant, que les étudiants étrangers ayant suivi leur scolarité dans un établissement de l'AEFE bénéficient d'une exonération.
M. Ouzoulias a raison, il faut préserver l'enseignement en français ; c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les étudiants asiatiques se rendent en France.
Nous n'avons hélas, monsieur Karam, pas eu la possibilité de nous rendre en outre-mer. L'université de Guyane accueille 30 % d'étudiants étrangers, contre en moyenne 10 % en métropole.
Nous aussi, monsieur Grosperrin, aurions aimé auditionner Mme la ministre. Nous la recevrons le 27 mars, date qui correspondra probablement, hélas, à la parution du décret et des arrêtés.
Nous n'avons pas eu le temps de nous pencher sur les études médicales ; le projet de loi santé qui sera examiné prochainement sera l'occasion d'évoquer cet aspect.
En effet, monsieur Assouline, le risque de détournement des étudiants maghrébins vers l'Arabie saoudite et la Turquie est réel, mais nous n'avons pas la possibilité de le mesurer. Nous estimons en revanche que 40 % des étudiants africains francophones qui se déplacent demandent des destinations anglophones...

Il est en effet dommage que la dynamique née de la loi ORE n'ait pas été prolongée. Nous tâcherons d'aider la ministre à prolonger la réflexion pour aboutir à une réforme cohérente et efficace. Les propositions que vous faites résument parfaitement les échanges que j'ai eus avec le président de la commission des relations internationales et européennes de la CPU : la CPU n'est, en toute hypothèse, pas opposée à la différenciation des frais d'inscription, mais demande du temps pour que les établissements puissent se retourner. Tâchons également de ne pas dégrader nos relations avec les autres pays de la francophonie. Réaffirmer les principes de la loi ORE, pour lui donner une meilleure applicabilité, reste possible.
Madame Billon, l'objectif de 500 000 étudiants peut paraître ambitieux en effet, mais l'envie de France est réelle dans un contexte de Brexit et compte tenu de l'hostilité que suscite le président Trump ; nous l'avons entendons partout, jusqu'en Inde ! C'est donc un objectif intéressant, sous réserve bien sûr de dégager les moyens de bien accueillir ces étudiants. La différenciation des droits d'inscription fait en tout cas partie des sujets que l'on doit aborder sans tabous.
Je résumerai donc par écrit à Mme la ministre, dans la perspective de notre réunion du 27 mars, la position que nous avons prise aujourd'hui.

Je ne m'oppose nullement à une concertation, je disais simplement qu'il vaut mieux qu'un plan la précède, car se borner pour toute réforme à ouvrir une concertation ne garantit pas qu'une décision sera prise à son issue.
Audition de M. Charles Personnaz auteur du rapport renforcer l'action de la france dans la protection du patrimoine du moyen-orient et le soutien au réseau éducatif des communautés chrétiennes de la région
Audition de M. Charles Personnaz auteur du rapport renforcer l'action de la france dans la protection du patrimoine du moyen-orient et le soutien au réseau éducatif des communautés chrétiennes de la région

Nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous ce matin l'historien Charles Personnaz, ancien chargé de mission pour le patrimoine et la culture de l'OEuvre d'Orient et aujourd'hui rapporteur extérieur à la Cour des comptes. Il vient nous présenter le rapport qu'il a rédigé, à la demande du Président de la République, sur le soutien de la France dans les domaines du patrimoine et de l'éducation aux communautés chrétiennes orientales et autres communautés vulnérables du Moyen-Orient.
Il faut dire que les chrétiens d'Orient et de nombreuses autres communautés, à l'image des yézidis, sont aujourd'hui particulièrement menacés dans cette région, alors même qu'ils y ont toujours été présents et font partie intégrante de sa culture. Compte tenu de la présence ancienne de notre pays dans cette région, des liens forts que nous entretenons avec elle, mais aussi de notre mission universaliste, la France a indéniablement un rôle à jouer pour venir en aide à ces communautés, à leur patrimoine et à leur culture.
Nous avons déjà eu l'occasion d'aborder une partie de ces questions la semaine dernière en auditionnant Bariza Khiari en sa qualité de vice-présidente de l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit, l'Aliph.
Nous sommes très désireux de vous entendre présenter la synthèse de votre rapport, qui devrait pouvoir éclairer l'action que pourra mener notre commission.
Ce rapport m'a été confié en juin dernier par le Président de la République, à la suite de son choix de poursuivre plusieurs orientations, exprimées notamment lors de sa visite de l'exposition consacrée aux chrétiens d'Orient : la défense de ces communautés, celle de la francophonie qu'elles portent, mais aussi l'idée que la culture et l'éducation sont cruciales quand on veut bâtir paix et stabilité.
Je me suis intéressé, d'une part, au patrimoine de ces communautés vulnérables, ainsi qu'au patrimoine juif, même si cette communauté a presque totalement disparu de la région en dehors d'Israël, et, d'autre part, au rôle des écoles chrétiennes, où 400 000 élèves suivent leur scolarité en français ou apprennent notre langue. J'ai donc essayé de joindre ces deux sujets - culture et éducation -, car ils posent tous deux une question de citoyenneté des membres de ces communautés. Le patrimoine incarne en effet leur intégration bimillénaire dans cette région ; par l'éducation, elles rendent un service public à l'ensemble des sociétés du monde arabe, en accueillant chrétiens et musulmans - ces derniers représentent en moyenne 60 % des élèves -, filles et garçons, élites et populations vulnérables, tout en portant une grande attention au handicap et à l'insertion professionnelle.
J'ai voulu aborder la question de la laïcité : comment aider ces communautés en dépit de ce principe ? Je ne dirais pas, comme Gambetta, que la laïcité n'est pas un article d'exportation, mais plutôt que ces écoles pratiquent une forme de laïcité en accueillant tout le monde et en distinguant le civil du religieux.
On m'a aussi demandé si une telle approche ne risquait pas de constituer une instrumentalisation des minorités. Nous ne sommes plus du tout à la période mandataire, même si la France doit conserver ses liens historiques avec ces communautés. Nous n'oublions pas pour autant le reste de la population : la France parle à tout le monde, mais cela n'empêche pas d'avoir des liens privilégiés avec certains.
Le patrimoine en question est immense. Il est matériel et immatériel ; il rassemble monuments, manuscrits, objets d'art et objets liturgiques, ainsi qu'une tradition intellectuelle.
J'en ai dressé un état des lieux, en faisant une distinction entre les zones où il est le plus menacé - zones de guerre, en Irak et en Syrie, où Daech a commis des destructions symboliques et où, surtout, pillages et trafics s'avèrent encore plus destructeurs - et celles où ce patrimoine est menacé par la faiblesse des administrations et par l'urbanisation galopante. L'Égypte et la Jordanie manifestent un fort intérêt pour ce patrimoine ; c'est moins le cas dans d'autres pays. En Turquie, on rencontre de grandes difficultés : l'État tantôt participe lui-même à la destruction de ce patrimoine, comme à Diyarbakir, ville pourtant inscrite au patrimoine mondial, tantôt laisse faire la destruction opérée par le temps depuis la disparition de ces communautés il y a un siècle.
J'ai également fait le panorama des actions menées par la France, qui a une tradition ancienne d'études orientales, qui s'exprime par le biais de l'Institut français d'études anatoliennes, l'Institut français d'archéologie orientale, l'Institut français du Proche-Orient, ou encore l'École biblique et archéologique française de Jérusalem, ainsi que dans ses missions archéologiques. Les destructions opérées par Daech ont suscité une prise de conscience et la création de l'Aliph.
Pour aller plus loin, il faut s'appuyer sur ce qui a été fait par les autorités publiques et par certaines associations, comme l'OEuvre d'Orient. Grâce à une aide de 60 000 euros octroyée par le Sénat, cette dernière a pu créer, au Liban, un centre de restauration des manuscrits. C'est en partant de cette base que j'ai pu formuler quelques propositions.
J'estime important, tout d'abord, de manifester en France l'importance de ce patrimoine à partir des oeuvres que nous conservons. Le Louvre doit être à la tête de ce mouvement : ses départements possèdent bien des éléments de ce patrimoine, mais ils sont un peu trop dispersés et ne sont pas assez valorisés. Le succès de l'exposition « Chrétiens d'Orient » montre l'intérêt du public. Le Louvre aurait beaucoup à gagner d'une meilleure exploitation de ses collections.
Il faut, par ailleurs, s'appuyer sur les instruments existants, en premier lieu l'Aliph, qui pourrait prendre en charge la restauration de certains sites en Irak, en Syrie et en Turquie dont j'ai dressé la liste. Un appel d'offres a déjà été lancé par l'Aliph pour la restauration de deux églises de Mossoul. C'est un début ; j'espère que la liste de sites concernés sera en mesure de s'allonger.
Un autre acteur est essentiel, du moins en dehors des zones de guerre : l'Agence française de développement, qui veut renforcer son rôle en matière de culture et d'éducation. J'ai là aussi dressé une liste de projets structurants que l'Agence française de développement (AFD) pourrait accompagner, tels que l'inscription au patrimoine mondial des sites coptes de la route de la Sainte Famille, en Égypte.

C'est un projet auquel le ministre égyptien des antiquités est très sensible.
J'ai enfin constaté que, si l'on trouvait au Moyen-Orient des conservateurs, on y manquait cruellement de restaurateurs d'oeuvres d'art. C'est pourquoi je propose la création, à Beyrouth, d'un institut de formation aux métiers de la restauration, dans le cadre d'un accord prévoyant la délivrance de diplômes conjoints par l'Institut national du patrimoine, en France, et l'ensemble des universités libanaises.
Nous pouvons aussi participer aux inventaires. Bien du patrimoine a été perdu irrémédiablement, pendant les guerres, parce que nous n'en connaissions pas le détail. Il faut mener un travail de recollement de manière à mieux connaître le patrimoine existant, à identifier le patrimoine manquant et à prévenir certaines destructions en cas de nouvelle déflagration. Je propose qu'un chargé de mission soit nommé sur cette question. Il serait utile de commencer par les icônes, objets aisément victimes de trafic ; ce travail pourrait être mené en lien avec l'Office central de répression du trafic des biens culturels.
J'en viens à l'éducation. Le réseau des écoles chrétiennes et francophones est répandu dans toute la région ; il est très ancien. Les congrégations françaises, très présentes dès le XIXe siècle, ont été rejointes au tournant du siècle par la Mission laïque française, ce qui a conduit à une émulation enrichissante. Les principes français d'éducation se retrouvent dans ses écoles : l'attachement à la langue française comme vecteur d'ouverture au monde et d'apprentissage de l'esprit critique ; le sens de la responsabilité sociale ; la neutralité religieuse ; enfin, la promotion de la femme et l'attention aux plus faibles. Ce réseau dense couvre les bastions de la francophonie que sont le Liban et les grandes villes d'Égypte, mais il va plus loin encore.
Il y a en revanche une vraie urgence : tous, sur le terrain, font le constat d'un abandon de ces écoles par la France. Elles ne reçoivent plus de subventions directes comme par le passé. On se demande ce qui motive encore les acteurs de ce réseau, hormis une foi ardente dans la culture française. Les générations changent : on ne sait pas si, demain, les parents ne se tourneront pas plutôt vers les écoles anglophones, qui sont mieux soutenues. Nous sommes en tout état de cause à un moment clé : l'influence de la France est en jeu, car c'est dans ces écoles que sont formés les gens qui tissent des liens avec notre pays. Allemands, Italiens, Japonais et Chinois sont eux aussi toujours plus présents. Nous avons pour nous l'ancienneté et la passion, mais tout cela est de plus en plus fragile.
Des menaces politiques pèsent également sur ces écoles. Au Liban, une loi a augmenté de 45 % les charges salariales pesant sur les écoles privées. En Égypte, des décrets menacent les écoles bilingues francophones. En Israël et dans les territoires palestiniens, on craint la remise en cause de la protection exercée par la France sur certaines écoles de congrégations, issue des traités conclus par l'Empire ottoman et repris par Israël.
Ces écoles sont de différents types. Certaines, au Liban ou en Égypte, sont très intégrées au système français ; d'autres, bilingues, sont intégrées au système étranger, mais sont tout de même proches des standards français ; d'autres, enfin, sont plus lointaines : elles portent le français sans avoir les moyens de se mettre dans les clous des labels français. Il ne faut pas les laisser de côté : elles portent une francophonie, certes fragile, mais toujours active.
Je préconise que la France porte ces sujets, politiquement, auprès des autorités compétentes de chaque pays. L'éducation est souvent le socle de ces relations bilatérales ; il importe qu'elle ne soit pas remise en cause.
J'ai fait le constat de deux besoins majeurs : d'une part, un besoin de formation des professeurs et des cadres ; d'autre part, le besoin de voir des Français. Autrefois, des religieux ou des coopérants visitaient régulièrement ces établissements ; aujourd'hui, on n'en voit plus. Le Quai d'Orsay définit de manière très large les « zones rouges » où tout déplacement est formellement déconseillé. Il ne faut pas se leurrer : c'est une question financière. Il faut que la France dépense un peu d'argent - seulement deux millions d'euros annuels, dont la moitié serait apportée par l'État, l'autre par le secteur privé -pour soutenir la formation des professeurs et l'envoi de volontaires.
Je propose donc la création d'un fonds public-privé, auquel abonderaient l'État ou l'AFD ; les collectivités territoriales et certaines fondations ou associations pourraient également être impliquées. Si l'on avait cette capacité, on répondrait largement à la problématique qui est devant nous. Je connais l'état de nos finances publiques : je ne préconise donc pas un grand soir où nous déverserions des millions sur le Moyen-Orient !
En prolongement de mon rapport, je fais actuellement le tour des ministères concernés. Ceux de l'éducation nationale et de la culture sont très intéressés. C'est plus compliqué au Quai d'Orsay : faute de moyens, sans doute, on s'y montre plus hésitant. J'essaie de lever ces doutes ; votre aide sera précieuse en ce domaine.
Nous avons une bonne occasion de progresser : en octobre prochain, la France accueille une conférence internationale sur les minorités du Moyen-Orient. Le Gouvernement pourrait faire certaines annonces à cette occasion.

Il est bon que le Président de la République se soit saisi de ce sujet, mais il faudrait que votre excellent rapport soit suivi d'effets !
Concernant le patrimoine, je suis intéressée par votre proposition de création d'un centre régional de formation aux métiers du patrimoine et de la restauration. Le Président de la République devait se rendre au Liban, mais ce déplacement a été annulé. Est-il à nouveau prévu qu'il s'y rende ? Comment l'AFD a-t-elle accueilli vos préconisations sur sa participation à la mise en valeur du patrimoine ?
Quant à l'éducation, comment progresser sur ces sujets dans le cadre diplomatique ? Les accords commerciaux et de coopération signés avec chaque pays peuvent-ils assurer la sécurité juridique de ces établissements ?

Tout est encore très fragile, à vous entendre. Dans le cadre de la révision de la loi de 1905 prévue par M. Macron, des oppositions aux recommandations de votre rapport risquent-elles de s'exprimer ? L'aspect paradoxal du soutien apporté par la France à des écoles confessionnelles étrangères pourrait être dénoncé par certains.
Lors de son voyage en Égypte, le Président de la République a annoncé la tenue, à Paris, d'une conférence internationale sur les chrétiens d'Orient. Est-elle maintenue, malgré la chute de Daech, ou bien a-t-elle perdu de sa pertinence ?

Archéologue, j'ai beaucoup travaillé dans cette région, et j'ai plaisir à constater que vous avez consulté tous les chercheurs qui y sont impliqués.
L'implication du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche est elle aussi cruciale, car il y a un risque de perte de savoir. Dans certaines niches scientifiques, comme l'étude de langues rares, on risque de ne plus avoir de chercheurs en capacité de travailler sur ces sujets. Il faudrait articuler la politique que vous préconisez avec une ambition nationale pour la recherche, au-delà des choix de chaque université. Lors de son déplacement actuel en Éthiopie, M. Macron doit visiter plusieurs églises anciennes sur lesquelles travaille l'une de mes collègues du CNRS, Mme Marie-Laure Derat. Ce type de recherches s'inscrit dans un temps très long. On a besoin de les structurer par une politique nationale de consolidation des postes.
Quant à la laïcité, j'ai noté qu'au Kurdistan syrien libéré, dans un village peuplé de chrétiens syriaques, on a célébré pour la première fois en Orient un mariage laïque. Il est important de défendre la laïcité dans une région où, même en Israël, la possibilité de se marier entre communautés religieuses différentes n'existe pas - il faut aller à Chypre - ; certes, il ne faut pas exporter telle quelle la loi de 1905, mais plutôt défendre les chrétiens, ainsi que les athées, qui sont invisibles.

Ils font l'objet de persécutions méconnues : comme ils n'ont pas de monuments, quand on les supprime, il ne reste rien d'eux.

Vous avez évoqué les congrégations françaises et la nécessité de faire venir dans cette région des enseignants, or j'ai l'impression que la tendance, pour les chrétiens d'Orient, est plutôt à l'exil. Par ailleurs, les étudiants issus de ces écoles ont-ils la possibilité de venir continuer leurs études en France ? L'installation d'un centre de formation, en Irak ou ailleurs, serait un symbole puissant du soutien de la France à ces populations.

Pouvez-vous nous éclairer sur la situation du patrimoine en Israël et en Palestine ? La situation particulière de Jérusalem mérite d'être évoquée, d'autant que notre commission vient de s'y rendre. Quel patrimoine risque d'y être détruit ?
Concernant le projet de centre de formation de restaurateurs à Beyrouth, la remise de mon rapport à la Présidence de la République, en octobre dernier, a été suivie d'une mission de l'Institut national du patrimoine au Liban, en novembre. Le voyage présidentiel a été annulé faute de gouvernement libanais, mais il devrait se tenir à moyen terme. Je m'engagerai pour que soit annoncée à cette occasion la création de ce centre, qui prolongerait diverses initiatives, dont la création d'un centre de restauration des mosaïques à Byblos, auxquelles les Libanais sont favorables. Il faut un partage de charges entre France et Liban. L'université Saint-Joseph est assez favorable à notre démarche : il y a une demande. En outre, la reconstruction de la Syrie viendra en son temps, et les Libanais veulent se tenir prêts pour cette éventualité. C'est un travail de long terme : il faut cinq ans pour former un restaurateur.
J'ai rencontré des directeurs régionaux de l'AFD pour la rédaction du rapport. L'organisation de cette agence est compliquée, mais ses dirigeants sont intéressés par le patrimoine. Au Liban ou en Égypte, les choses peuvent avancer. De tels projets ne sont pas dans l'ADN de l'AFD, qui préfère construire des routes ou des barrages ! Néanmoins, s'ils sont portés politiquement, ils peuvent être pris en charge par l'Agence.
En matière d'accords de coopération, la France s'est engagée très fortement pour aider le Liban. Nous sommes donc en droit d'affirmer, en tant que contributeur, qu'il n'est pas normal que leur principal actif, à savoir leur éducation, soit détruit. De même, en Égypte, l'éducation fait partie des sujets de discussion importants.
Quant à Israël et aux territoires palestiniens, la protection traditionnellement apportée par la France à diverses institutions a été remise en cause par un accord en cours de négociation entre Israël et le Saint-Siège, mais on va dans le bon sens. La France est montée au créneau. J'ai présenté mon rapport à Mgr Gallagher, secrétaire du Vatican pour les relations avec les États : selon lui, les Israéliens acceptent désormais que la protection de la France soit maintenue.
La question de la laïcité m'a évidemment été posée. J'avais en tête les mots du patriarche chaldéen, Mgr Sako, selon qui l'Orient a besoin de la laïcité, à condition qu'elle ne soit pas antireligieuse.
Ces écoles chrétiennes, tout comme la Mission laïque de France, participent de l'éducation à une citoyenneté qui inclut toutes les composantes des sociétés arabes, y compris les chrétiens et les yézidis, mais aussi ceux qui ne professent aucune religion. En France, l'école privée sous contrat ne remet pas en cause la laïcité. J'estime donc que la France peut aider ses établissements sans remettre en cause la laïcité, suivant un axe classique de notre diplomatie dans cette région. La Mission laïque française rencontre d'ailleurs les mêmes problématiques que les écoles confessionnelles.
À ma connaissance, la conférence de Paris sur les chrétiens d'Orient est maintenue. La situation de ses populations n'est pas directement arrangée par la chute militaire de Daech ; les questions de reconstruction se posent de manière aiguë. En Syrie, quand la guerre faisait rage, on survivait au quotidien ; aujourd'hui, l'avenir est bouché et le désespoir s'installe. On a donc besoin de l'attention de la communauté internationale sur ces questions. Dans une relation ô combien abîmée avec la Syrie, l'éducation et le patrimoine peuvent être un moyen de retisser des liens avec une société civile qui reste francophile. En attendant, le Liban est un intermédiaire utile.
J'ai présenté mon rapport au cabinet de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sans structuration de la recherche sur ces sujets en France, aucun lien durable ne pourra s'établir avec ces communautés. Quant aux langues rares, le maintien de l'Elcoa, l'École des langues et civilisations de l'Orient ancien, me semble crucial. Des inquiétudes se sont exprimées à ce sujet : le ministère est prêt à faire figurer noir sur blanc son maintien dans la convention qui lie l'État à l'Institut catholique ; sinon, il faudra créer une telle unité d'enseignement dans une université publique.
Je rejoins vos propos, monsieur Ouzoulias, sur le mariage civil. L'archevêque latin de Beyrouth est presque le seul à le défendre !
Le rôle des archéologues français et de toutes les missions de recherche est important. On sent l'implication pleine et entière de ces chercheurs, leur connaissance de la région, mais aussi leur inquiétude face à l'amenuisement des crédits et aux difficultés qu'ils rencontrent. Nos concurrents européens, américains et japonais font mieux. Les « zones rouges » sont très gênantes. Les Italiens et les Britanniques ont repris les fouilles dans le sud de l'Irak. Un projet archéologique à Nadjaf a été approuvé par la commission des fouilles du Quai d'Orsay, mais les fouilles n'ont pu commencer du fait du coût prohibitif des mesures de sécurité requises.
Et ils y font un travail de bonne qualité !
J'en viens à la question de l'accueil des étudiants. Le réseau des écoles primaires et secondaires francophones est extrêmement développé, mais on relève une grande faiblesse en matière d'enseignement supérieur. L'université Saint-Joseph de Beyrouth reste très attachée au français, alors qu'elle ne reçoit de la France que 200 000 euros par an ; il demeure aussi quelques sections francophones dans les universités égyptiennes. Le Président de la République souhaite relancer le projet d'université française d'Égypte, mais il semble fragile.
Dès lors, que deviennent les élèves des écoles francophones ? Ils rencontrent des difficultés de visas s'ils souhaitent venir étudier en France et se tournent donc souvent vers les universités anglaises ou américaines. Il restera toujours quelque chose de leur éducation, mais on a parfois l'impression d'un investissement perdu. L'Agence universitaire de la francophonie est très consciente du sujet. C'est surtout par le développement de filières francophones au sein des universités locales qu'on fera progresser ce maillage, plutôt qu'en créant des établissements ex nihilo. C'est plus à notre portée, financièrement, et c'est plus intégré à la vie sociale et économique locale.
Quant aux symboles, la création du centre de formation des restaurateurs en serait un, tout comme la restauration de certains monuments ou l'accompagnement de projets locaux. Je pense aussi à la reconstruction du mémorial consacré au génocide arménien de Deir ez-Zor, construit en 1928, sous le mandat français, et détruit par Daech en 2014.
Enfin, Jérusalem, où mènent tous les chemins d'Orient ! Plusieurs questions patrimoniales m'ont été posées pendant ma mission. L'accès à Gaza pour des fouilles archéologiques est toujours problématique : la France a investi 400 000 euros dans les fouilles de Saint-Hilarion, monument historique de premier ordre, mais nos archéologues ne peuvent pas se rendre sur place. Le British Council a pris le relais et nous travaillons ensemble par Skype, mais reconnaissons que ce n'est pas idéal ! Les conditions de sécurité ne sont pourtant pas si mauvaises en dehors des moments de tension. Il y a une autocensure de la France sur cette question qui me paraît préjudiciable.
Quant au patrimoine appartenant à la France à Jérusalem, tel le Tombeau des rois, une restauration a été entreprise, mais il faudrait inscrire au budget du consulat une ligne d'entretien courant, afin qu'on ne soit pas contraint, dans trente ans, de prendre en charge des investissements massifs pour la rénovation du site. C'est un problème classique pour les monuments historiques.
On constate par ailleurs que l'archéologie est éminemment politique à Jérusalem, notamment dans la vieille ville. L'Autorité des antiquités d'Israël mène souvent des fouilles dans un but politique précis...
à savoir l'exhumation de l'histoire juive ancienne, au détriment des autres couches archéologiques, qui sont détruites à cette occasion. Une association israélienne d'archéologues se bat contre de telles fouilles.
Je préconise pour ma part la réunion d'un comité scientifique international, dans un cadre scientifique, et non politique, qui proposerait un code de bonne conduite opposable pour les fouilles dans la vieille ville de Jérusalem. L'Union européenne pourrait en prendre l'initiative ; ce serait plus habile que d'en faire assumer la responsabilité à un seul pays, d'autant que le Quai d'Orsay se montre prudent sur un sujet si sensible. Il faut sortir l'archéologie du champ politique, autant que possible.

Je vous remercie pour ce rapport passionnant ; nous avons la volonté de vous aider. Nous auditionnerons bientôt M. Jean-Luc Martinez, président-directeur du Louvre, qui a accompagné le Président de la République en Égypte. Une délégation de parlementaires égyptiens nous rendra également visite en juin ; beaucoup d'entre eux sont francophones, du fait de leur passage par ces écoles chrétiennes.
La réunion est close à 12 h 20.