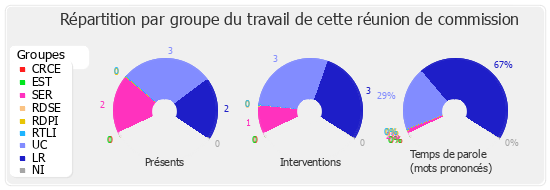Mission d'information Lutte contre la précarisation et la paupérisation
Réunion du 9 février 2021 à 14h35
Sommaire
- Mesure et évolution de la précarité et de la pauvreté
- Audition de mme valérie albouy cheffe du département des ressources et conditions de vie des ménages de l'insee mm. patrick aubert sous-directeur de l'observation de la solidarité de la drees et sébastien grobon adjoint au chef de mission analyse économique de la dares (voir le dossier)
- Constats de terrain concernant la pauvreté et la précarité et leur évolution en temps réel
La réunion
Mesure et évolution de la précarité et de la pauvreté
Audition de Mme Valérie Albouy cheffe du département des ressources et conditions de vie des ménages de l'insee Mm. Patrick Aubert sous-directeur de l'observation de la solidarité de la drees et sébastien grobon adjoint au chef de mission analyse économique de la dares

Nous entamons notre cycle d'auditions en accueillant aujourd'hui Mme Valérie Albouy, cheffe du département des ressources et conditions de vie des ménages de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), et MM. Patrick Aubert, sous-directeur de l'Observation de la solidarité de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), et Sébastien Grobon, adjoint au chef de mission analyse économique de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares).
Cette audition est importante, car elle nous permettra de disposer d'un état des lieux solide, notamment sur la statistique et l'actualisation des données. Nous attendons que vous nous éclairiez sur la définition des phénomènes de précarisation et de paupérisation et sur les moyens d'en mesurer les effets à court et à long terme. Nous nous interrogeons aussi sur l'évolution de la situation depuis le début de la crise, dont les conséquences pour la réalité quotidienne des Français risquent de se faire sentir dans un avenir très proche.
Nous aimerions que vous nous précisiez quels outils de mesure vous avez mis en place, mais aussi quels constats vous dressez en matière de précarisation et de paupérisation d'une partie des Français. Après vos interventions liminaires s'ensuivra un échange au cours duquel Mme le rapporteur et les différents membres de la mission vous interrogeront.
Je reviendrai tout d'abord sur les manières d'après lesquelles la statistique publique définit et mesure la pauvreté. L'Insee se fonde sur différentes mesures, dont la principale, la pauvreté monétaire, est relative et repose sur les revenus. Il s'agit d'une approche relativement large, car elle prend en compte les revenus d'activité ou de remplacement et les revenus du patrimoine, ainsi que les prestations sociales, en déduisant les impôts directs. Cette donnée est calculée pour le ménage, qui regroupe toutes les personnes vivant ensemble. Autrement dit, tous ceux qui appartiennent au même ménage ont le même niveau de vie.
Ce revenu est ensuite divisé en unités de consommation, facteur d'échelle qui dépend à la fois du nombre de personnes qui vivent sur ce revenu et des économies réalisées en raison de ce regroupement au sein du même logement. Par exemple, pour un couple, le revenu est divisé par 1,5. Ce calcul aboutit à un concept de niveau de vie du ménage qui permet de comparer les revenus de ménages de taille différente. Sont définies comme étant pauvres les personnes qui ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté fixé à 60 % du niveau de vie médian, qui partage la population en deux - seuil relativement arbitraire qui est privilégié dans toute l'Europe. L'Insee publie aussi des données selon un taux à 40 %, 50 % ou 70 % du revenu médian. La pauvreté monétaire s'est établie en 2018 en France métropolitaine à 14,8 % - ce taux devrait baisser légèrement à 14,5 % en 2019, d'après les chiffres provisoires - et, dans les départements d'outre-mer (DOM), elle a atteint 30 % à 80 % selon que l'on applique le seuil de pauvreté nationale, ou 16 % à 42 % avec des seuils locaux propres à chaque territoire.
Il existe d'autres indicateurs que la pauvreté monétaire, dont la pauvreté en conditions de vie, qui repose sur l'existence de privations matérielles, à savoir les difficultés budgétaires, les restrictions de consommation ou les retards de paiement que rencontrent certains ménages au quotidien. Cet indicateur est mesuré à partir d'enquêtes réalisées auprès des ménages. La France s'est dotée en 2004 d'un indicateur français fondé sur l'existence de 27 privations possibles. L'Europe s'en est inspirée en 2009, mais de façon beaucoup plus restrictive, en ne retenant que 9 privations, avant d'allonger cette liste en 2017 à 13 privations. La pauvreté en conditions de vie est plus utile pour décrire les difficultés matérielles que rencontre une partie de la population sur une longue période - elle est un peu moins adaptée pour décrire les évolutions à court terme.
Je laisse la parole à Patrick Aubert pour évoquer le troisième indicateur, la pauvreté subjective, qui est calculé par le ministère des affaires sociales.
sous-directeur de l'Observation de la solidarité de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees). - En parallèle de ces indicateurs, la Drees essaie de suivre la pauvreté subjective définie par les personnes elles-mêmes. Cette mesure statistique est bien sûr moins fiable, mais elle permet de se rapprocher au plus près de la sensation des personnes pauvres qui s'autoproclament comme telles. Ainsi 4 % des personnes dont les revenus les classent parmi les 20 % les plus aisés se déclarent pauvres !
Cet indicateur est intéressant dans la mesure où il indique la subjectivité du sentiment de pauvreté et l'importance de certains facteurs, notamment ceux qui sont liés à l'emploi ou au chômage, ou de l'appartenance à une catégorie socioprofessionnelle. À revenu égal, les employés et les ouvriers ont tendance à s'estimer plus pauvres qu'ils sont, quand d'autres se sentent déclassés par rapport à leurs parents.
De la même façon, si les deux tiers des pauvres sont définis ainsi en fonction de leur revenu, l'autre tiers est identifié comme tel en raison des difficultés matérielles que les individus déclarent au quotidien. Cela est bien compréhensible pour de jeunes primo-accédants à la propriété par exemple.
Concernant la pauvreté monétaire, nous disposons d'une mesure de très bonne qualité, qui est fondée sur les données de l'administration fiscale et des caisses versant les prestations sociales. En contrepartie, cette mesure est, par rapport à d'autres indicateurs sociaux, disponible tardivement, à n+2, et provisoirement à l'automne n+1 - c'est la limite de cet exercice. Dans le contexte actuel, la Drees a récemment mis en place un tableau de bord du suivi des effectifs des bénéficiaires des prestations de solidarité, qui s'apparente plus à un indicateur en temps réel.
Il est assez compliqué de mettre en place des indicateurs rapides et fiables pour la précarité et la pauvreté, car, sur les 14 % à 15 % des Français qui se situent sous le seuil de pauvreté, nombreux sont ceux qui s'en approchent. À ce jour, je n'identifie aucune source véritable permettant de mesurer en temps réel la pauvreté en France.
Autre limite, les chiffres qui remontent de la France métropolitaine et des DOM ne sont pas issus du même dispositif. Contrairement à ce que l'on entend, l'Insee dispose de nombreuses ressources sur les DOM grâce à des enquêtes spécifiques, mais il est vrai que la qualité des données laisse parfois à désirer. Nous travaillons à améliorer la situation.
Dans le questionnaire que vous m'avez adressé, vous m'interrogez sur les indicateurs permettant de mesurer la précarité et la précarisation de l'emploi. J'entends la précarité comme un état de pauvreté durable.
Concernant la trajectoire des personnes, je vais vous faire part des données en notre possession, qui datent de 2016 : 70 % des personnes pauvres le restent l'année suivante, contre 63 % en 2008. La persistance de la pauvreté a donc significativement augmenté en France. En outre, on constate une règle « 4/4/2 » : sur 10 personnes pauvres une année, 4 vont rester durablement pauvres, 2 vont sortir durablement de la pauvreté, et 4 vont connaître des périodes d'alternance durant les quatre années suivantes. En somme, à un horizon de quatre ans, 20 % des personnes pauvres sortent durablement de la pauvreté.
Pour ce qui est de la précarisation, c'est-à-dire l'entrée dans la pauvreté, fort heureusement, le risque de devenir pauvre une année donnée n'est que de 3 %. Toutefois, ce chiffre peut être plus élevé pour certaines catégories de la population, telles que les personnes peu diplômées, les agriculteurs, les artisans ou les commerçants.
Enfin, vous avez souhaité savoir comment la pauvreté avait évolué au cours des vingt dernières années. De 2008 à 2011, la pauvreté a augmenté assez fortement, passant de 13,2 % à 14,6 %. Après une baisse les deux années suivantes, puis une stabilisation à un point supérieur au niveau de 2008, et ce jusqu'en 2017, l'année 2018 a enregistré une augmentation très marquée du taux de pauvreté, de 14,1 % à 14,8 %, en partie en raison d'une mesure de diminution des allocations logement, la baisse des loyers concomitante n'étant pas prise en compte dans le calcul. Pour 2019, la baisse devrait être de 0,3 point grâce à la revalorisation exceptionnelle de la prime d'activité - les chiffres sont provisoires.
Avant de préciser les catégories de la population qui ont vu leur situation se dégrader, je tiens à signaler que les risques d'être pauvre sont tout à fait différents d'un individu à un autre : sont concernés 35 % à 40 % des familles monoparentales et des chômeurs, 20 % à 30 % des familles nombreuses - avec trois enfants ou plus -, et de nombreux indépendants. On observe depuis une vingtaine d'années une augmentation de la pauvreté au sein des familles monoparentales, chez les personnes seules de moins de 65 ans, et dans les familles nombreuses. Ce phénomène touche également, dans une moindre mesure, les chômeurs - 38 % contre 35 % auparavant. Évidemment, il faut tenir compte des revenus du conjoint, ce qui permet à certains chômeurs d'échapper à la pauvreté. Mais lorsque le chômeur représente la seule source de revenus, le taux de pauvreté atteint les 50 %.
Je ne m'attarderai pas sur les chiffres, que je tiens à votre disposition, et m'en tiendrai aux actions possibles et aux moyens disponibles. La Drees n'a pas mis en place de dispositif généraliste au sujet de la pauvreté, car le principal producteur en la matière, c'est l'Insee. Néanmoins, nous avons instauré depuis 2001 des dispositifs de suivi et d'observation de certaines populations parmi les plus précaires et bénéficiaires des minima sociaux. Cela nous permet d'objectiver les constats : les bénéficiaires, âgés de 20 à 60 ans, des minima sociaux d'activité, à savoir le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou l'allocation de solidarité spécifique (ASS), ont une ancienneté moyenne de 5,3 ans dans les minima sociaux. Sur dix ans, un bénéficiaire donné se retrouve plus de six ans dans les minima sociaux... Nous voulons aller plus loin en réalisant des enquêtes auprès de ces bénéficiaires pour mieux rendre compte des différents phénomènes, telles les privations matérielles ou autres, et qui sont évalués par l'Insee sur l'ensemble de la population.
Une focalisation sur les politiques publiques ou les prestations sociales nous permet d'effectuer des micro-simulations, en partenariat avec l'Insee notamment via le modèle Ines, sur un échantillon représentatif de la population. Nous pouvons ainsi simuler l'effet des prestations et des réformes, et décomposer les différentes aides. C'est en réalisant périodiquement cette analyse que l'on peut savoir que le taux de pauvreté monétaire, de l'ordre de 14 %, avoisine plutôt les 22 % ou 23 % avant redistribution, et attribuer la part de cet écart aux minima sociaux, à la prime d'activité ou encore aux prestations familiales. Ces dernières sont parfois oubliées alors qu'elles sont très importantes pour les familles nombreuses ou monoparentales, particulièrement touchées par la pauvreté.
Autre indicateur, l'intensité de la pauvreté permet de voir, parmi les personnes pauvres, si elles sont proches ou pas du taux de pauvreté. L'intensité de la pauvreté se définit comme la distance entre la médiane du niveau de vie des personnes pauvres, c'est-à-dire le revenu qui partage les personnes pauvres en deux moitiés, et le taux de pauvreté. Sans les aides, on aboutirait à un niveau de vie médian des personnes pauvres inférieur de 40 % au seuil de pauvreté. Avec l'ensemble des prestations, on se rapproche des 20 %.
Le dernier outil utilisé concerne les populations les plus précaires, notamment toutes celles qui sont difficiles à cerner dans les dispositifs statistiques : personnes sans domicile ou accueillies dans des hébergements sociaux. Nous sommes en plein dans l'actualité, car la Drees vient de lancer son enquête, comme elle le fait tous les quatre ans, auprès de l'ensemble des centres d'hébergement pour avoir une description assez complète des personnes qui sont invisibles dans les ménages ordinaires, à savoir tous les sans-abri. Cette étude nous permettra de connaître un peu plus, d'ici à la fin de 2020 ou au début de 2021, les profils sociodémographiques de ces personnes et leurs évolutions.
Comme vous l'a expliqué Valérie Albouy, le système statistique a ses limites pour mesurer les évolutions très récentes. De nombreuses réflexions sont en cours, sans prétendre obtenir la même richesse d'informations qu'avec les outils statistiques permanents, mais au moins pour avancer sur le sujet. La partie du travail la plus simple a consisté à mettre en place, depuis le début de la crise en mars, le suivi mensuel de toutes les prestations de solidarité, ce qui n'est pas effectué en temps normal compte tenu du caractère structurel de la pauvreté. Il s'agit principalement des prestations versées par les caisses de sécurité sociale, la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), Pôle emploi, etc. Nous avons décidé d'enrichir progressivement ce suivi en évaluant d'autres aides comme celles qui seront versées aux étudiants, tel le repas à un euro.
La question est de savoir quel serait l'indicateur pertinent pour analyser la population la plus précaire. Ainsi, le champ de l'aide alimentaire demeure, à la différence des logements destinés aux personnes sans domicile fixe, peu étudié. Nous avions, la semaine dernière, une réunion avec les associations pour réfléchir à la mise en place d'un suivi qualitatif et quantitatif des bénéficiaires de l'aide alimentaire, afin d'objectiver l'évolution de leur profil. De nombreux acteurs associatifs évoquent à cet égard le recours récent à leurs services de la part de petits commerçants, d'indépendants et d'entrepreneurs affectés par la crise, mais nous ne disposons pas encore de données sur ce phénomène.
Je souhaiterais, pour ma part, évoquer les perspectives en lien avec le marché du travail. Nous travaillons notamment sur le concept de travailleur pauvre, soit une personne en emploi, mais dont le niveau de vie se situe sous le seuil de pauvreté. Il n'existe pas d'indicateur établi pour analyser cette population, car l'emploi relève d'une notion individuelle alors que le niveau de vie concerne le ménage, ce qui les rend difficiles à articuler.
Le phénomène des travailleurs pauvres ne se limite pas au niveau de salaire ; il est également la conséquence d'un temps de travail insuffisant puisque le salaire horaire minimum fixe un plancher de rémunération. La prime d'activité, récemment revalorisée, permet de suivre partiellement son évolution.
Le sujet concerne, en outre, les conditions de travail et le fait d'exercer un emploi instable, voire menacé. La Dares réalise un suivi des risques psychosociaux intéressant pour montrer leur évolution. Les enquêtes périodiques menées tous les trois ou quatre ans nous permettent de disposer d'éléments structurels. La dernière enquête, menée en 2016, indique ainsi qu'un quart des salariés craint pour l'avenir de son emploi. Cette proportion a augmenté de sept points depuis 2005, surtout après la crise de 2008. Le sentiment d'inquiétude quant à l'emploi est majoritairement exprimé par les ouvriers, notamment non qualifiés.
Nous observons également un développement des formes atypiques de travail. Les contrats à durée déterminée (CDD) ont connu une croissance soutenue entre les années 1980 et 2000, puis plus limitée ensuite. En 2017, neuf embauches sur dix se font en CDD, contre huit sur dix en 1997. À partir des années 2000, les contrats très courts se sont multipliés, entrainant une réduction de la durée moyenne des CDD. Ainsi, en 2017, un tiers des CDD était conclu pour moins d'une journée, en particulier dans les secteurs de la restauration et de l'audiovisuel. Le mode d'utilisation des CDD a donc évolué vers davantage de roulement de personnel dans les entreprises, conduisant à une segmentation du marché du travail entre les emplois stables et les contrats précaires. Avec la crise sanitaire, les premiers ajustements sur l'emploi ont été les non-renouvellements de CDD, tandis que la politique de financement de l'activité partielle soutenait les emplois plus durables.
Enfin, le temps partiel a considérablement augmenté sur une longue période, passant d'un vingtième des emplois en 1960 à un cinquième en 2015. Cette évolution s'explique par le développement du travail des femmes, mais aussi par le recours renforcé au sous-emploi, vecteur d'instabilité.
Au-delà du type de contrat et de la précarité de l'emploi exercé, les changements opérationnels subis sans concertation peuvent dégrader les conditions de travail et nuire à la santé psychologique des salariés.
Une évaluation quantitative rigoureuse des politiques de l'emploi n'est pas simple d'un point de vue méthodologique. Il faut anticiper sa mise en oeuvre et s'en donner les moyens, comme ce fut le cas pour la garantie jeunes. La Dares a également évalué, sur des publics définis, les résultats obtenus par les dispositifs des contrats aidés, des emplois francs et de l'insertion par l'activité économique (IAE). Ainsi, la garantie jeunes, qui s'adresse aux jeunes sans emploi ni formation et propose un accompagnement intensif, montre un effet sur l'emploi durable. De même, l'IAE, destinée aux personnes les plus éloignées du marché du travail, permet, pour certains publics - travailleurs âgés, femmes, personnes un peu plus qualifiées - un infléchissement de la trajectoire d'emploi.

Merci de vos interventions. Nous démarrons nos auditions avec vous pour déterminer de quoi et de qui nous parlons, même si la réponse à ces questions n'apparaît pas aisée. La précarisation et la pauvreté relèvent de deux concepts différents. La précarisation peut être définie comme une forte incertitude pesant sur le fait de conserver ou de retrouver un niveau de vie acceptable, cette dernière notion variant elle-même en fonction des territoires.
Qu'est-ce, en revanche, que la pauvreté et qui concerne-t-elle ? Le rapport d'analyse de l'Insee fait état d'indices - le coefficient de Gini, le ratio S80/S20 ou le rapport interdécile D9/D1 - que vous n'avez pas mentionnés. Selon l'Insee, les inégalités et la pauvreté auraient reculé en 2019, mais je ne suis pas certaine que les acteurs de terrain aient la même analyse... Parmi les paramètres pris en compte pour évaluer la pauvreté ne figurent ni le prix du paquet de tabac, qui a considérablement augmenté, ni le chèque énergie. Ne faudrait-il pas les actualiser ?
Enfin, comment vos administrations sont-elles sollicitées ou associées aux décisions de politiques publiques relatives, par exemple, aux minima sociaux ou à l'AAH ?
Dans le rapport d'analyse, vous trouverez également le taux de pauvreté à 14,5 %. Les autres indicateurs que vous évoquez mesurent les inégalités en fonction de la distribution des ressources au sein de la population. Ainsi, le coefficient de Gini porte sur les inégalités globales dans un pays et non spécifiquement sur la pauvreté.
La pauvreté touche les personnes qui perçoivent le moins de ressources. La pauvreté monétaire est calculée en fonction des revenus, mais elle ne définit pas des niveaux de vie équivalents, même si nous retraitons les revenus des ménages pour pouvoir les comparer en fonction de leur situation. Évidemment, avec le même revenu, les conditions de vie peuvent être très différentes du fait des dépenses. Par exemple, le fait d'être primo-accédant à la propriété, d'avoir besoin de deux voitures ou de faire garder des enfants en bas âge modifie à la baisse le niveau de vie et donc l'aisance. À cet égard, votre remarque sur le paquet de tabac et le chèque énergie est très intéressante. Nous avons donc développé des indicateurs portant sur les conditions de vie qui prennent en compte, par exemple, les privations consenties par les ménages. Aucun indicateur n'est cependant parfait, raison pour laquelle il est nécessaire de les croiser. À niveau de revenus égal, certains ménages - les propriétaires de leur logement notamment - vont être plus à l'aise.
L'augmentation du taux de pauvreté présentée en 2018 prenait en compte la réduction des aides au logement, mais pas la baisse concomitante des loyers dans le secteur social. Si nous étudions essentiellement les revenus des ménages, nous mesurons aussi les dépenses de consommation. La prise en compte d'aides en nature comme le chèque énergie est plus complexe. Nous fondons nos travaux sur la définition européenne des revenus qui n'intègre pas de tels dispositifs, même si nous en évaluons l'effet redistributif.
L'Insee n'est pas sollicité en amont des décisions de politique publique, mais il participe à de nombreux comités d'évaluation et demeure à l'écoute des demandes sociales. Cette année, nous avons ainsi travaillé sur la mesure de la grande pauvreté en définissant un indicateur qui pourrait en permettre le chiffrage. De fait, au printemps dernier, nous avons pu observer une demande en ce sens. Il faut ensuite du temps pour créer un tel indicateur.
Il faut rester prudent : l'indicateur parfait n'existe pas, notamment parce qu'il y a des prestations en nature. Nous calculons des variantes au revenu, tenant compte des dépenses pré-engagées ou de l'application d'un loyer fictif aux propriétaires. Les indicateurs de référence, même imparfaits, demeurent donc satisfaisants. Il apparaît, en outre, nécessaire de disposer de données objectives. Selon le baromètre établi par la Drees, 90 % des Français estiment que la pauvreté a augmenté ces dernières années et va poursuivre sa croissance : cette opinion subjective, pour intéressante qu'elle soit, bien que faussée par le pessimisme général, n'est évidemment pas suffisante pour mesurer un phénomène.
Notre souci de croiser différents indicateurs et sources est constant. Quand un élément n'est pas suffisamment traité par nos analyses - les personnes sans domicile fixe par exemple -, nous lançons un travail d'enquête spécifique.

Je vous remercie pour ces éléments d'information. J'ai été marqué par votre démonstration du « 4/4/2 ». Seuls 20 % des personnes en situation de pauvreté en sortiraient durablement sur une période de quatre ans ! Vous avez évoqué la sensibilité du taux de pauvreté aux différents instruments de redistribution, qui permettent de passer de 22 % à 14 %. Il faut donc piloter au plus près ces politiques. Quels sont les véritables discriminants ? Comment entre-t-on et sort-on de la pauvreté ?
J'aimerais en savoir davantage sur les travailleurs indépendants. Nous sommes tous marqués par le témoignage de personnes qui ont une certaine maturité professionnelle, ont choisi d'être indépendants, mais dont l'activité s'est effondrée avec la crise. Disposez-vous d'éléments chiffrés ?

Vous avez insisté à juste titre sur la nécessité de différencier le niveau de vie et le niveau de pauvreté ressentie. On pourrait ainsi opposer la situation du locataire d'un logement de bonne qualité, à loyer modéré et aux charges limitées, dans le parc social, et celle du locataire d'un bien en mauvais état, dans le parc privé. Lorsqu'ils doivent déterminer le quotient social, les communes et les départements prennent en compte le reste à vivre, c'est-à-dire le revenu diminué des dépenses obligatoires. Travaillez-vous sur cet indicateur au niveau national ?
Je vous transmettrai un graphique qui retrace l'évolution du premier décile des personnes dont le niveau de vie est le plus faible, depuis 2008. Il prend en compte, d'une part, le revenu avant le versement des prestations sociales et le prélèvement des impôts, et, d'autre part, le revenu après redistribution. La courbe montre très clairement que le premier décile diminue après 2008, sous l'effet de la crise, mais qu'il ne remonte jamais, même à long terme. En revanche, la redistribution joue son rôle et corrige cet effet.
Ce qui reste inquiétant, c'est que le niveau de vie avant redistribution décroche sans jamais remonter. L'Insee et la Drees disposent, grâce à ce graphique, d'un outil de micro-simulation fin qui confirme que la redistribution bien ciblée est un levier qui fonctionne. Peut-être faudrait-il des politiques plus structurelles pour améliorer la situation des gens ? Je ne saurais me prononcer sur ce point.
Quant au niveau de vie, il se calcule au sein du ménage ou de la famille, de sorte qu'il peut ne pas prendre en compte la situation d'un chômeur qui n'a pas de revenu, mais dont l'entourage travaille. Les facteurs de fragilité touchent surtout les adultes qui vivent seuls, avec ou sans enfant. Dans le cas où ils perdraient leur travail, ils n'auront personne sur qui compter, d'où un risque accru pour eux d'entrer en pauvreté.
Pour sortir de la pauvreté, il faut accéder à un emploi durable. Le monde du travail ne peut plus se caractériser par une opposition binaire entre ceux qui ont un emploi et ceux qui n'en ont pas. Le nerf de la guerre, c'est de pouvoir travailler toute l'année. Ce qui importe, c'est le volume d'emploi.
En ce qui concerne les indépendants, nous travaillons à partir des données fiscales et des prestations versées par les caisses. Le partage entre revenus personnels et revenus professionnels n'est pas simple à opérer. L'appréciation peut être plus pertinente sur un champ temporel plus long.
L'impact de la crise sur le revenu des indépendants est difficile à évaluer, car nous manquons d'indicateurs. Pour les salariés, nous pouvons nous baser sur la déclaration sociale nominative (DSN), qui est mensuelle. Pour les indépendants, la déclaration d'impôts reste annuelle. Les indicateurs ne permettent pas d'identifier précisément les revenus professionnels. Il serait souhaitable de pouvoir disposer d'autres sources.
Pour le reste à vivre, nous suivons les dépenses, dites « pré-engagées », de logement et les charges. Nous travaillons aussi sur les données micro-économiques au niveau individuel et nous menons des études lourdes qui combinent ces résultats avec les données sur la consommation. Nous réalisons ces études tous les quatre à cinq ans.
Au-delà des revenus, il faut prendre en compte les charges des ménages, ce qui n'est pas forcément évident.
Les études les plus récentes sont celles de la Drees.

Vous avez cité comme exemples de gens touchés par la pauvreté, une femme qui vit seule avec ses enfants, une personne qui vit en centre d'hébergement, ou bien une personne sans domicile. Ne faudrait-il pas distinguer davantage les situations, entre celle d'une personne seule qui travaille et touche le smic, et celle d'une mère seule avec ses deux enfants ? Certaines personnes refusent d'aller travailler, car cela leur rapporterait moins que de toucher des aides tout en restant au foyer. Une femme seule avec deux enfants touche 1 700 euros par mois. Le budget de la sécurité sociale est de 500 milliards d'euros, ce qui montre combien notre système social est avantageux.
De manière globale, si l'on ne prend en compte que les aides, le système des prestations sociales n'a aucun effet désincitatif. Les aides donnent un revenu à ceux qui n'en ont pas, mais ne désincitent pas à reprendre une activité. La Drees travaille sur des barèmes pour lutter contre les trappes à inactivité. La courbe n'est pas parfaitement lisse, mais il est toujours plus avantageux d'avoir un revenu professionnel auquel s'ajoutent la prime d'activité et les prestations familiales, quand bien même l'on perdrait le RSA.
Pour autant, les discussions sur le revenu universel d'activité restent intéressantes dans la mesure où certains cas sont discutables, notamment ceux des personnes qui bénéficient de l'AAH et pour lesquelles l'accès à l'emploi est plus difficile.
Les freins à l'emploi ne sont pas que monétaires. Ils tiennent aussi à la nécessité de devoir chercher un mode de garde ou acheter une voiture. Les facteurs à prendre en compte sont différents selon les personnes, et il faut étudier chaque situation.
Même si le débat sur le revenu universel d'activité a toute sa place, le système socio-fiscal fonctionne bien et les aides n'ont pas d'effet désincitatif.
Les freins à l'emploi sont multiples. La reprise d'activité dépend aussi de facteurs complexes comme la santé mentale. Les périodes longues de chômage finissent par affecter la motivation et l'estime de soi. Il faut prévoir un accompagnement transversal pour aider les personnes à sortir de la pauvreté. Plus longtemps elles resteront éloignées de l'emploi, plus cet accompagnement sera coûteux.

Vous avez structuré la présentation des informations par typologie de familles. Y a-t-il des évolutions différenciées par territoire, par exemple entre l'urbain et le rural ?
L'Insee procède en menant une grande enquête sociale à partir des données administratives de 100 000 personnes. Nous pouvons ensuite produire un tableau exhaustif en exploitant les données fiscales et les prestations qui donnent une idée précise de la localisation des poches de pauvreté. Ces dernières sont concentrées dans les centres-villes. Nos études peuvent documenter les niveaux de vie à un niveau géographique très fin, à l'échelle des quartiers, notamment. Je pourrai vous fournir les références des publications sur le sujet.

Je vous remercie tous pour cette première audition, riche en échanges et en contributions.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
Constats de terrain concernant la pauvreté et la précarité et leur évolution en temps réel
Audition de M. Thierry Couvert-leroy délégué national « lutte contre les exclusions » de la croix-rouge française Mme Isabelle Bouyer déléguée nationale d'atd quart monde et M. Daniel Verger responsable du département études recherches et statistiques du secours catholique

Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir les représentants de plusieurs associations : ATD Quart Monde, la Croix-Rouge française et le Secours catholique - je dois excuser le Secours populaire qui n'a pas pu envoyer de représentant. Il était important pour nous de les recevoir dès le début de nos travaux, parce que les associations sont en première ligne et connaissent particulièrement bien la situation sur le terrain et ses évolutions.
Je vous remercie de nous accueillir. Depuis des mois, nous enchainons les auditions de ce type et je dois dire que je ne comprends pas bien pourquoi les mesures qui ont été prises oublient complètement l'accompagnement structurel des personnes les plus pauvres.
Quelques mots sur les personnes avec lesquelles nous cheminons : 2,2 millions de personnes sont dans une situation d'extrême pauvreté en France, c'est-à-dire qu'elles perçoivent moins de 40 % du revenu médian, soit 694 euros par mois. Ce chiffre est évidemment énorme !
Ces personnes très pauvres sont oubliées, je le disais, car les mesures qui sont prises ne sont pas structurelles : accorder 150 euros à une famille est un simple pansement dans la période que nous traversons.
Depuis plus de soixante ans, ATD Quart Monde s'appuie notamment sur des groupes de parole pour réfléchir à nos actions et organise des universités populaires qui permettent de partir des véritables expériences de vie de chacune et de chacun. Que nous apprennent ces groupes de parole ? Dans cette période d'urgence, où un véritable fossé s'est creusé, chaque personne a été amenée à agir. Ainsi, pour assurer l'éducation à domicile, les gens ont dû se battre pour que leurs enfants soient connectés, suivent les cours, etc. Cette période oblige les gens à se battre, que ce soit pour se nourrir, contre l'endettement ou pour le logement. Habituellement, beaucoup de ces personnes avaient des activités parallèles qu'elles ont perdues à cause de la pandémie et elles ont dû faire appel à l'aide alimentaire.
La pandémie a vraiment eu un impact très fort sur les personnes les plus pauvres et il faut saluer leur très grand courage, notamment lorsqu'il s'agit de subvenir aux besoins des enfants. Une maman, militante à ATD Quart Monde, nous disait un jour : « D'abord, je me bats et je fais manger les enfants. La suite, c'est après, car en ce moment, une seule chose compte, c'est de manger ! » Vous comprenez donc l'urgence !
La grande pauvreté est une insécurité permanente, une impossibilité de se projeter et d'assumer ses responsabilités, notamment vis-à-vis de sa famille.
Nous le répétons depuis longtemps : on ne peut pas vivre avec le revenu de solidarité active (RSA). La Cour des comptes a lancé des travaux pour évaluer cette politique, elle nous a invités avec une autre association à participer à ce comité et c'est ce constat qui ressort en premier.
À notre sens, les mesures qui sont prises devraient permettre d'accéder à des droits, elles ne devraient pas seulement combler des manques. Faire appel à l'aide alimentaire est une honte, une humiliation pour les demandeurs. Résister et survivre, c'est un combat quotidien. Alors que nous institutionnalisons l'aide alimentaire, ces personnes ont en fait besoin d'un soutien structurel de long terme.
Durant cette période, nous avons constaté une amplification des difficultés pour accéder à un logement. Le rapport que la fondation Abbé Pierre a récemment publié l'a montré, des millions de personnes sont mal logées. Accéder à un logement quand on a très peu de ressources est quasiment impossible aujourd'hui. C'est un véritable défi !
Nous constatons que les inégalités s'accroissent et que les plus touchés sont les jeunes. Nous devrions nous battre pour leur donner toutes les chances de se former et de trouver un emploi. L'Observatoire des inégalités a montré qu'un jeune sur dix entre 18 et 29 ans est en situation de pauvreté, principalement des personnes peu diplômées à la recherche d'un emploi. La baisse d'activité économique liée à la crise sanitaire touche cette population de plein fouet et aggrave un phénomène qui existait déjà.
En 2018, au moment de la présentation de la stratégie de lutte contre la pauvreté, une mesure paraissait intéressante : l'État devait garantir la formation et l'accompagnement de tous les jeunes entre 16 et 18 ans. Quand on interroge les missions locales deux ans après, on constate qu'elles manquent de personnel formé pour aller vers les jeunes qui ont décroché. En fait, certains jeunes restent « invisibles », parce qu'ils ont complètement décroché. Pour nous, le point crucial est d'aller vers ces jeunes et de les rencontrer, en prenant le temps et en allant à leur rythme. Tant que des moyens adaptés ne seront pas mis sur ce point, nous oublierons toujours un pan entier de la population.
Il nous semble essentiel de repenser les politiques publiques à partir des personnes les plus oubliées.
Parmi les principales difficultés que nous avons recensées, il y a aussi l'accès aux soins. Dans cette période de crise sanitaire, beaucoup de personnes ont dû renoncer à être soignées.
Vous nous interrogez aussi, dans le questionnaire que vous nous avez transmis, sur la manière de prévenir le basculement dans la pauvreté. Pour nous, comme pour de nombreuses associations, la première chose à faire est de relever le niveau du RSA - nous ne cessons de le répéter, c'est un choix politique majeur. Il devrait être a minima de 850 euros pour permettre de vivre dignement, c'est-à-dire se loger, se nourrir, se vêtir et avoir un peu de loisirs - pour nous, la culture fait partie des besoins de base. Rien ne prouve qu'une telle mesure désinciterait au travail. Toutes les études que nous avons menées montrent que les gens veulent travailler, être utiles et reconnus.
D'ailleurs, l'expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée prouve très clairement qu'il est possible d'avancer à partir du moment où il existe une solidarité territoriale et qu'on repense les politiques publiques à partir des besoins des gens qui sont les plus éloignés de l'emploi et avec eux.
Pour prévenir le basculement dans la pauvreté, il faut aussi un logement décent avec un espace de vie pour chacun. Le confinement a montré l'importance de cette question. Pour cela, il faut rénover les habitats insalubres et faire respecter la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU). Il faut aussi avoir un emploi digne ou au moins, notamment pour les jeunes, des propositions de formation qui correspondent aux choix des personnes.
Enfin, il est important que les services publics - éducation, santé, assurance chômage, retraite, etc. - soient accessibles et de qualité, parce que, lorsque les services publics dysfonctionnent, ce sont toujours les plus pauvres qui en souffrent le plus.
Dernier point, l'élaboration des politiques publiques doit s'appuyer sur la participation des personnes très pauvres ; c'est à partir de leurs expériences concrètes que nous pourrons être les plus efficaces et utiles.
Je souhaite tout d'abord vous remercier de nous donner la parole. J'appartiens à la direction des métiers et des opérations de la Croix-Rouge, je suis aussi délégué national « lutter contre les exclusions » et j'ai préparé cette audition avec plusieurs de mes collègues, mais je ne pourrai peut-être pas répondre à toutes vos questions et je me permettrai alors de vous apporter nos réponses plus tard.
Depuis des années, le seuil de pauvreté était sur une sorte de plateau et nous espérions que les choses allaient s'améliorer, mais les perspectives ont été sérieusement bousculées. Ainsi, nous avons observé une intensification de la grande pauvreté et nous devons être attentifs à cette évolution.
Une stratégie de lutte contre la pauvreté a été annoncée en 2018, elle était accompagnée d'un diagnostic quelque peu effrayant : il faut six générations pour sortir de la pauvreté ! Nous avons alors tous été amenés à nous interroger sur ce que la République pouvait faire.
Même si l'exercice est toujours délicat, je voudrais distinguer trois publics. Pour les jeunes qui bénéficient de mesures de protection au titre de l'aide sociale à l'enfance : la question de la sortie du dispositif se pose clairement, même dans cette période d'état d'urgence qui prévoit des dispositions transitoires. Les résultats obtenus à la suite de la stratégie de lutte contre la pauvreté sont assez décevants à cet égard. Les deux autres publics que je voudrais citer sont les familles monoparentales, de plus en plus nombreuses et souvent en grande précarité financière, et les migrants.
Lors du premier confinement, nous avons observé qu'un certain nombre de familles n'étaient tout simplement pas en mesure de se nourrir, quand la cantine ne fonctionnait plus. Et on voit aujourd'hui de nombreux étudiants faire la queue pour obtenir une aide alimentaire. Ainsi, nombre de Français souffrent, de nos jours, de la faim !
Le confinement a aussi montré que de nombreuses personnes rencontraient de grandes difficultés pour conduire sereinement l'éducation de leurs enfants. Même si le deuxième confinement a permis d'organiser les choses autrement, l'impact de cette période est très fort sur les familles.
Durant la crise sanitaire, l'État a décidé de mobiliser 200 000 places d'hébergement d'urgence, ce qui montre bien, s'il en était besoin, l'importance de la question du logement dans notre pays.
Je crois que nous devons aussi être très attentifs à la situation de la jeunesse - je devrais plutôt dire « des jeunesses », tant les situations sont variées - et à celle des populations en outre-mer, où les tensions sont fortes.
Avec le confinement, nous avons observé de manière concrète que l'isolement avait un impact important sur les situations de précarité. La Croix-Rouge avait mis en place un numéro d'appel, les gens pouvaient demander à ce quelqu'un leur apporte leurs courses, que ce soit des médicaments ou de la nourriture : pour un tiers des personnes, le panier était gratuit, parce qu'elles ne pouvaient pas payer.
L'isolement a aussi mis en avant les questions de santé psychologique.
De manière générale, nous avons constaté une aggravation de la crise, puisque nos maraudes ont rencontré 86 % de personnes en plus, alors même que, je le disais, le nombre de places d'hébergement avait été augmenté. Nous avons ainsi rencontré 22 000 personnes à la rue, dont 6 000 enfants, un chiffre glaçant dans un pays comme le nôtre. La question de l'accès aux soins de ces personnes se pose évidemment de manière prégnante - le développement des équipes mobiles constitue une réponse intéressante.
Comme cela a été dit précédemment, il est important de mettre en place des actions qui vont vers les personnes les plus précaires, parce qu'un certain nombre d'entre elles sont « invisibles » et n'ont pas recours aux différents dispositifs qui existent. En fait, elles sont souvent fatiguées de se battre perpétuellement pour obtenir leurs droits.
Cela souligne l'importance de l'accompagnement et de la vigilance à avoir quant aux phénomènes de dépression. Encore une fois, la santé psychique est un élément très important à prendre en compte.
S'il ne m'appartient pas de définir le niveau du « revenu décent », il me semble néanmoins nécessaire de nous interroger sur la question de la solvabilité des personnes, car il est difficile de faire de la prévention à destination de gens n'ayant pas les ressources financières leur permettant de vivre décemment.
Permettez-moi d'aborder les dispositifs nécessaires pour lutter contre la fracture numérique, qui s'avère complexe. Cette lutte implique effectivement d'offrir un accès à internet, mais aussi de faire un travail de compréhension de l'outil numérique : notre expérience du premier confinement nous a montré que la capacité à l'utiliser n'allait pas de soi.
Enfin, en matière de stratégie vaccinale, je voudrais attirer votre attention sur le risque que les personnes les plus précaires et les plus pauvres soient oubliées.
Mon propos sera évidemment en consonance avec les interventions de mes deux collègues, mais aussi avec ce qui a été évoqué par l'Insee et la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) avec lesquels nous travaillons beaucoup. Par ailleurs, je suis responsable, au sein du Secours catholique, d'études et de recherches. Nous avons 65 000 bénévoles sur le terrain, mais nous cherchons aussi à avoir une analyse quantitative et statistique des évolutions de la pauvreté, symbolisée par le rapport intitulé État de la pauvreté en France 2020, envoyé notamment aux sénateurs.
Ce rapport montre que la pauvreté évolue d'année en année. La crise du covid-19 est un accélérateur des dynamiques et des inégalités tout en révélant des phénomènes déjà en cours. Dans notre rapport, nous avons finement analysé le budget des ménages dix ans après une étude similaire. Le revenu des ménages étudiés est resté stable, voire a très légèrement baissé en parité de pouvoir d'achat. Il s'agit donc de l'une des rares catégories ayant vu son niveau de pouvoir d'achat stagner ou très légèrement baisser. Par ailleurs, un quart des personnes accompagnées ayant des ressources ne disposent que d'un reste à vivre de 4 euros par jour. Notre analyse a consisté à prendre en compte l'ensemble des ressources et des dépenses, en particulier les dépenses incompressibles, puis à calculer le reste à vivre. De plus, il s'agit d'unités de consommation, ce qui représente un peu plus d'une personne.
Ce montant quotidien permet donc d'autant moins de vivre qu'il doit permettre de subvenir aux dépenses d'alimentation, d'habillement, de loisirs ou de voyage. Cela représente une charge mentale énorme pour les familles se retrouvant dans cette situation.
C'est l'illustration du fait que l'on ne peut pas vivre avec un RSA ou avec les aides minimales : même en serrant au maximum le budget, il y a toujours un moment où cela coince. De fait, les familles sont amenées à choisir entre faire appel à l'aide alimentaire - c'était déjà le cas d'une grande partie des personnes interrogées dans notre dernier rapport - ou se retrouver en situation d'impayé, en particulier pour les loyers. Le choix est donc de renoncer aux soins, à payer son loyer à temps ou à se nourrir. Dans tous les cas, on parie sur l'aide alimentaire pour se nourrir. Cette situation n'honore pas la France et doit nous révolter ; néanmoins, elle était antérieure à la crise sanitaire qui l'a largement aggravée.
Parmi les évolutions majeures que nous avons constatées depuis quelques années, le pourcentage de familles monoparentales reste très élevé, s'établissant autour de 27 % des personnes accueillies par le Secours catholique. Ce pourcentage est trois fois plus élevé que ce que ces familles représentent dans la population française et leur indice de fragilité est de 3. Elles ont certes été repérées depuis longtemps et font l'objet d'une attention particulière du fait de leur forte fragilité potentielle, mais en période de crise, elles se voient fortement atteintes.
Par ailleurs, nous observons une augmentation constante de la part d'étrangers dans les personnes que nous recevons. Les personnes de nationalité étrangère approchent le seuil de 50 % des personnes reçues par le Secours catholique - elles l'atteindront vraisemblablement dans les chiffres de 2020. Cela représente une augmentation très significative par rapport à l'an 2000 qui en comptait quelque 20 %. La proportion des étrangers n'augmentant pas en France, il s'agit bien du signe des difficultés d'intégration socio-économiques, et parfois d'intégration complète, des personnes de nationalité étrangère. En analysant plus finement, on repère qu'il faut dix ans de présence à un étranger pour rejoindre la situation des personnes de nationalité française.
Le niveau de pauvreté reste extrêmement élevé puisque, parmi les personnes accueillies par le Secours catholique, le niveau de vie médian est de 537 euros par mois, soit la moitié du seuil de pauvreté ou 30 % du niveau de vie médian national. Ce chiffre est en partie dû à l'augmentation régulière du nombre de personnes sans ressources, du moins régulières, qui représentent quelque 23 % des ménages que nous accueillons. Il s'agit, en large partie, de personnes de nationalité étrangère qui ne sont pas, contrairement à l'image véhiculée par les médias, des jeunes hommes seuls, mais souvent des familles - c'est-à-dire beaucoup d'enfants - vivant en hôtel ou dans des logements précaires.
Cela me conduit à aborder la question de la discrimination sur le logement, qui est extrêmement forte selon la situation de nationalité. Quelque 81 % des étrangers sans papiers sont en logement précaire ou instable. Il y a donc un vrai enjeu de mal-logement et du fait d'être ballotté d'un lieu à un autre, ce qui est tout à fait contreproductif en termes d'intégration. Je rappelle qu'il y a, uniquement pour l'Île-de-France, environ 30 000 nuitées quotidiennes payées par les services sociaux. Cette situation, majeure en termes quantitatifs, a tendance à augmenter. Nous saluons l'effort fait, à cause de la crise, pour ouvrir de nouvelles places.
La question du non-recours est bien connue, mais souvent peu documentée. Selon nos chiffres, un tiers de personnes ayant droit au RSA ne le touchent pas. Ce chiffre est en augmentation de 10 % par rapport à 2010, ce qui traduit une aggravation inquiétante du phénomène.
Selon une enquête réalisée auprès d'environ 1 000 personnes durant l'été dernier et le confinement, ce dernier a constitué un coup de massue et grandement fragilisé les revenus et la recherche d'un emploi, notamment pour les personnes vivant de la récupération. Il a également conduit à une certaine forme solidarité, au fait de se reposer très fortement sur l'entraide familiale ainsi que sur les initiatives de solidarité qui se sont développées au niveau local. Ces dernières, au premier chef desquelles la solidarité d'extrême proximité, ont fait office des bouées de sauvetage.
Subsiste néanmoins une très grande inquiétude quant à l'avenir, pas seulement sanitaire, mais aussi en termes de revenus ou de logement. Nous observons ainsi une augmentation très forte des personnes repliées sur elles-mêmes et cassées par la crise. Notons néanmoins que, en parallèle, une grande proportion de réponses mettait en avant résilience et capacité à rebondir.
Nous observons un double phénomène qui peut paraître étonnant. Nous accueillons de nouveaux publics comme les étudiants, les jeunes et des personnes indépendantes ou ayant un statut intérimaire qui souffrent beaucoup d'un point de vue économique. Ces nouveaux publics font très souvent appel à l'aide alimentaire, qui s'est accrue de 25 à 40 %. Mais, d'un autre côté, les situations de repli sur soi et de renfermement, en particulier en milieu rural, nous obligent à aller beaucoup plus fort dans l'« aller vers ». L'enjeu est de résister à cette forme d'hibernation en gardant ou en recréant les liens auprès des personnes qui se sont isolées par accablement ou comme résistance aux événements.
En ce qui concerne les mesures que nous suggérons, nous avons proposé, dans un rapport récent, l'instauration d'un revenu minimum garanti. Nous mettons en avant l'aspect tout à fait contreproductif des sanctions à l'encontre des allocataires du RSA. S'il y a matière à débat à ce sujet, il nous semble néanmoins que, plus on plonge les personnes dans l'insécurité - qu'elle soit financière ou quant à leur avenir -, plus est aggravée leur charge mentale et inhibée leur capacité d'initiative.
La meilleure façon d'aider les personnes est de les mettre en confiance et de les accompagner dans une relation de confiance et non de culpabilité ou de menace. D'ailleurs, beaucoup de travailleurs sociaux expriment leur souffrance de devoir ainsi sanctionner des personnes tout en sachant qu'ils les plongent dans la misère.
Il nous semble temps de mettre en place des mesures structurelles comme réponse à une crise structurelle amenée à durer et qui ne soient pas uniquement des primes ponctuelles. Nous appelons ainsi à la création d'un revenu minimum garanti, c'est-à-dire un RSA suffisamment amélioré pour qu'on en change le nom. Nous avons défini quatre orientations majeures.
Premièrement, pour sortir de la misère, la hausse du revenu à niveau décent de 50 % du niveau de vie médian. L'indexation sur le niveau de vie médian me semble essentielle, car elle marque l'appartenance à la société et le fait de garder le contact avec elle, notamment dans cet aspect de revenu.
Deuxièmement, il s'agit d'élargir ce revenu minimum garanti aux jeunes, qui subissent tout particulièrement les conséquences de la crise. Comme première étape, il s'agit de viser les jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance (ASE), étant donné que leurs contacts avec leur famille sont inexistants ou très appauvris.
Troisièmement, il faudrait élargir ce revenu aux étrangers en situation régulière, à qui il faut actuellement cinq ans pour avoir accès au RSA, ce qui est beaucoup trop long pour les familles.
Quatrièmement, il faut travailler à la simplification des démarches. On parle souvent de l'automaticité des droits, mais le fait qu'un tiers des personnes ne recourent pas au RSA devrait nous scandaliser. Cela montre l'absence d'une politique digne de ce nom pour lutter contre ce non-recours. À ce titre, ce n'est pas la dématérialisation qui va nous aider. Elle est utile et permet d'accélérer certaines choses, mais, dans la réalité, elle éloigne les publics les plus fragiles de l'accès aux droits. En permettant le retrait des services publics et des organismes de protection sociale des territoires, elle rend beaucoup plus difficile l'approche de ces personnes.
Il y a là un vrai enjeu qui pouvait être incarné par les espaces France Services (EFS) qui se mettent néanmoins trop lentement en place ou avec trop peu de moyens.

Je me permets de dire que l'objectif de cette mission d'information est aussi de remercier les bénévoles sur le terrain qui, au-delà du temps donné, ont une charge émotionnelle forte. En ce qui concerne les enjeux de statistique, vous avez dit, monsieur Verger, que vous travaillez avec l'Insee, la Dares et la Drees. Néanmoins, l'enjeu de nos rencontres est la double vision technique des chiffres et de terrain. Vous retrouvez-vous dans les statistiques ou des divergences d'approches existent-elles entre ces deux prismes ?
En ce qui concerne l'enjeu de sortie de la pauvreté ou de la grande pauvreté, la représentante de l'Insee énonçait le fait qu'il fallait « marcher sur les deux jambes » que sont le principe de redistribution et celui d'accès à l'emploi. Partagez-vous cette vision ?
En matière de rôle des associations et des pouvoirs publics, le représentant de la Drees disait qu'un des champs insuffisamment étudiés était celui de l'aide alimentaire. Comment voyez-vous les choses à cet égard et peut-on avoir une approche plus pointue ?
Vous avez parlé de nouvelles populations, notamment des jeunes. Je précise qu'une autre mission d'information du Sénat traite de la situation des jeunes, nous n'irons donc peut-être pas très avant dans ce sujet. Néanmoins, il existe aujourd'hui des dispositifs à leur destination, comme le plan « 1 jeune, 1 solution » ou le fait que l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) puisse suivre la scolarisation et accompagner l'accès au milieu professionnel des jeunes de 16 à 18 ans. Voyez-vous, sur le terrain, les effets de ces dispositifs et vous semblent-ils pertinents ?
Vous avez évoqué, monsieur Couvert-Leroy, la présence plus marquée des indépendants dans les populations que vous pouviez rencontrer. Que recouvre ce champ-là ?
Nous sommes nombreux, au Sénat, à siéger au sein des équipes pluridisciplinaires RSA qui rencontrent les allocataires et prennent, il est vrai, un certain nombre de décisions. Permettez-moi de dire que, même si la sanction peut être difficile, l'approche est souvent très humaine. Vous êtes tous favorables à une augmentation du RSA. Y-a-t-il, en parallèle, des discussions sur le montant du SMIC et sur son écart avec le montant du RSA ? Enfin, quel est votre point de vue quant à la suppression totale des contreparties au RSA ?
La statistique et le terrain sont très complémentaires et le travail de l'Insee et de la Drees pour repérer les évolutions de la pauvreté est très important. Nous-mêmes sommes également en train, avec des équipes locales, de créer un baromètre pour pointer les évolutions au niveau chaque territoire, de façon à compléter l'analyse annuelle du rapport intitulé État de la pauvreté. Il manque surtout, dans les statistiques officielles, les personnes sans-papiers et celles qui sont en statut instable. Notre rapport tente de rendre plus visible cette catégorie qui ne l'est pas et qui est, néanmoins, extrêmement appauvrie et extrêmement précaire.
En matière de redistribution et d'accès à l'emploi, il y a effectivement « deux jambes ». Nous en incarnons une par notre demande d'un revenu minimum le plus garanti possible. D'un autre côté, l'initiative Territoires zéro chômeur de longue durée (TZCLD) lancée par ATD Quart Monde - à laquelle nous contribuons - montre bien l'importance des propositions autour de l'emploi. C'est en effet tout l'enjeu de l'insertion par l'activité économique.
Aujourd'hui, deux idées coexistent : d'une part celle d'un revenu de base, voire universel et, d'autre part, la garantie à l'emploi, pour laquelle la mobilisation des territoires et le soutien de l'État sont importants. Ces deux jambes sont donc complémentaires dans le sens où il est vain de demander à une personne d'être active dans sa formation ou dans sa recherche d'emploi s'il n'y en a pas dans la région. Certes, les secteurs de l'écologie, de l'accompagnement des personnes ou, plus concrètement, la rénovation des 700 000 logements par an sont demandeurs de main d'oeuvre. Il nous faut donc accompagner les personnes vers ces créations d'emplois.
L'aide alimentaire est un enjeu extrêmement important et reste la deuxième demande des personnes qui viennent au Secours catholique, alors que nous faisons moins d'aide alimentaire qu'il y a quelques décennies. Avec la crise, nous avons mobilisé des sommes conséquentes pour proposer des chèques services qui ont l'avantage, au contraire de l'aide alimentaire qui laisse peu de choix, de laisser la liberté de l'achat. Nous avons eu des difficultés à faire accepter ce chèque service par les enseignes et, même si cela s'est progressivement résolu, il nous faut continuer à travailler pour venir à bout de toute réticence.
Il s'agit, enfin, de faire la promotion de la solidarité alimentaire de territoire, d'organiser des circuits courts, des jardins partagés, de l'alimentation en commun, des cuisines collectives. Autant d'initiatives qu'il nous semble extrêmement important de soutenir. Toutefois, l'accès digne à l'alimentation est certainement le champ le plus important à promouvoir et nous pouvons faire beaucoup plus et beaucoup mieux que la simple aide alimentaire basique.
Pour les jeunes, il faut vraiment trouver des solutions. De nombreuses mesures ont été annoncées, mais leur impact est assez peu visible. La garantie jeunes universelle est une idée séduisante : elle constitue un vrai progrès si elle est mise en place comme cela a été proposé par le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse (COJ). Je pense notamment à son caractère de « droit ouvert ». Il faut prévoir un accompagnement avec les missions locales, qui ont besoin d'être aidées et considérablement renforcées si l'on veut changer d'échelle. Passer de 100 000 à 200 000 jeunes constitue une amélioration, mais nous sommes très loin du compte : il faut pouvoir en accompagner 700 000 à 900 000 pour avoir un impact décisif sur l'appauvrissement des jeunes.
En ce qui concerne le RSA et le revenu minimum garanti, il faut rappeler que l'accompagnement - un accompagnement de qualité, humain et positif - est nécessaire. La menace de la sanction est contre-productive, car elle fait peser une épée de Damoclès là où il devrait y avoir du lien et de l'accompagnement. Les personnes souhaitent avoir accès à un emploi, être socialement et économiquement reconnues. Il ne faut pas penser que certains se contenteraient d'un revenu minimum parce qu'ils ont d'autres problèmes sociaux ou de santé à régler : ils veulent être actifs dans la société et être reconnus pour cela, quitte à connaître des situations de précarité qui peuvent tout de même représenter une avancée pour eux. C'est le cas des indépendants qui sont largement des autoentrepreneurs, comme les livreurs. Pour ces métiers, la difficulté vient de l'absence de protection sociale et de reconnaissance du lien avec l'employeur. Pour autant, l'utilité de ces métiers peut être grande. C'est cette catégorie sociale que nous voyons se précariser.
En matière de statistiques, la difficulté vient de la « désynchronie ». Les statistiques robustes reposent sur des analyses : c'est pourquoi les derniers chiffres sur la pauvreté datent d'il y a deux ans. Cela ne permet pas d'être réactif. Nous voyons que la situation est en train de s'aggraver : quels pourraient être les indicateurs de cette tendance ? La statistique publique ne nous permettra de mesurer les impacts du covid en 2020 et 2021 qu'en 2023.
Que l'on soit un grand ou un petit réseau, comment structure-t-on nos observations sociales ? Nos bénévoles doivent remplir des statistiques, mais nous savons bien que les chiffres sont toujours minorés. Nos acteurs n'en voient pas toujours l'intérêt concret. L'étude sur le sans-abrisme date de 2012, par exemple. La ministre du logement nous a promis de travailler avec l'Insee sur ce sujet. En attendant, nos évaluations sont faites « à la louche ». Les Nuits de la solidarité ne nous donnent que des images parcellaires de la situation, et non une photo d'ensemble.
Pour moi, les « deux jambes », ce sont la redistribution et le droit à l'accompagnement, afin que ceux qui le souhaitent puissent y accéder pour trouver leur place dans la société.
Comment envisage-t-on l'autonomie des jeunes ? Être autonome à 18 ans est une injonction. Notre système est construit sur la solidarité familiale : quand on ne peut pas y avoir recours, cela rend les choses plus compliquées. On ne peut que saluer les différents dispositifs que le Gouvernement met en place : « 1 jeune, 1 solution », une généralisation de la garantie jeunes. Il manque l'« aller vers », c'est-à-dire aller vers tous les jeunes qui ne s'inscrivent pas forcément dans cette démarche.
Nous sommes en train de réfléchir à la question de l'aide alimentaire, qui doit être retravaillée pour mieux répondre aux attentes et ne pas être réduite à une simple distribution alimentaire. Nous avons mis en place, par exemple, des espaces bébés-parents, qui sont des lieux de distribution alimentaire pour les jeunes enfants, mais où l'on offre aussi un soutien à la parentalité.
Je ne reparlerai pas des statistiques : la très grande pauvreté est là et les gens ne s'en sortent pas...
Il faut partir de la notion de revenu convenable d'existence : c'est dans la Constitution, et nous ne devrions pas avoir à batailler depuis tant d'années pour que toutes les personnes à partir de 18 ans puissent y avoir accès. C'est une terrible discrimination par l'âge : les 18-24 ans n'ont pas la possibilité d'avoir un tel revenu. Avoir accès à un revenu convenable d'existence, qui serait de 850 ou 900 euros, permettrait à ces jeunes de prendre une forme d'autonomie, de se projeter, de ne plus dépendre de la famille. Actuellement, si un jeune a un petit boulot pendant quelques semaines et qu'il dépend encore du foyer familial, son revenu est déduit du RSA familial : c'est la raison pour laquelle la réforme du RSA est indispensable. Cette situation empêche toute possibilité d'émancipation et de projection, et l'imprévisibilité conduit ces personnes à être en permanence dans l'urgence.
Vous avez évoqué les droits et devoirs liés au RSA : nous parlons, pour notre part, d'inconditionnalité. Les administrations exigent des allocataires qu'ils rendent compte ; les sanctions qui tombent sont extrêmement difficiles puisqu'elles plongent ces allocataires dans la grande pauvreté et encouragent le non-recours. Car, à un moment donné, les gens baissent les bras et n'ont plus recours au RSA en raison des contraintes, de l'intrusion dans la vie privée. La loi prévoit que le dispositif doit permettre de faire sortir des personnes de la pauvreté, mais aujourd'hui, avec un RSA, on ne sort pas de la pauvreté !
S'agissant des territoires zéro chômeur, nous pensons qu'il faut continuer l'expérimentation, pour analyser ce qui s'y joue réellement. Ce dispositif a été pensé à partir de l'entreprise solidaire Travailler et apprendre ensemble d'ATD Quart Monde à Noisy-le-Grand. Proposer un CDI permet une stabilisation de la situation : les gens peuvent recommencer à se soigner, récupérer leurs enfants quand ils ont été placés en raison de difficultés de logement, retrouver une utilité sociale, etc. C'est un cercle vertueux. Il faut penser la solidarité dans notre société, et faire place à chacun.
Pour revenir aux jeunes, je voudrais faire remarquer que les intentions peuvent être là, avec la garantie par l'État d'une formation, d'un accompagnement, pour tous les jeunes de 16 à 18 ans. C'est ce que nous souhaitons pour permettre aux jeunes de s'ancrer dans la vie sociale et professionnelle. Ce programme a été annoncé depuis deux ans ; des fonds y ont été dédiés. Il faut former des professionnels pour « aller vers » des personnes qui sont vraiment invisibles. Dans les Hauts-de-France, aucune formation à cette fin n'a été prévue dans le programme national de formation des missions locales pour 2021 et le programme régional de formation est interdit aux mineurs, alors que les missions locales doivent permettre à un maximum de jeunes d'obtenir une formation...
Les jeunes doivent avoir l'espoir de faire un métier qu'ils auront choisi. Il ne faut pas penser à la place des gens, ce qui signifie qu'il faut nouer une relation de confiance avec eux, qui ne se décrète pas. Je suis issue du monde du travail social : tant qu'on ne donnera pas aux professionnels le temps de nouer des relations et de bâtir des projets, on ne s'en sortira pas !
J'ai évoqué « l'institutionnalisation » de l'aide alimentaire. ATD Quart Monde et d'autres associations ont été invitées régulièrement depuis un an par la direction générale de la cohésion sociale pour faire le point, évoquer les urgences absolues, etc. La période que nous vivons a été qualifiée de « crise humanitaire ». Mais l'institutionnalisation de l'aide alimentaire est une hérésie : cela signifie que nous prenons définitivement acte qu'en France des millions de gens meurent de faim et sont obligés de se battre pour se nourrir ou nourrir leur famille. Imaginer l'aide alimentaire comme une fin en soi et une solution pour lutter contre la pauvreté est - je le redis - une hérésie !
J'y insiste, il faut plutôt penser à un revenu convenable d'existence. Les associations sont toutes d'accord, mais nous ne savons pas comme nous faire entendre. Nous participons à des auditions quasiment tous les jours... Soyons courageux, et faisons en sorte que les gens cessent de ne pas vivre et de ne pas se loger, même si je sais qu'il n'y a pas assez de logements en France.

Vous avez assez peu évoqué la politique du logement. Des efforts importants ont été faits, notamment pour la mise à l'abri dans le cadre du confinement.
Nous avons des lois en France - je pense notamment à la loi SRU. Arrêtons de nous battre pour de nouvelles lois et faisons appliquer celles qui existent ! Nous avons tout ce qu'il faut en France. Ce sont des choix politiques ; les constats, on les fait et on les refait depuis toujours.
Merci tout de même de nous entendre ! Vous pouvez être audacieux dans vos propositions parce que l'opinion publique - et je crois aussi les décideurs - a pris conscience qu'il fallait vraiment faire quelque chose en ce moment. C'est pour vous une opportunité, mais aussi peut-être une responsabilité.
Sur les mesures à prendre, peut-être pas, mais beaucoup estiment qu'on ne peut pas continuer comme avant.
Avoir aujourd'hui 8 millions de personnes qui font appel à l'aide alimentaire, c'est un indicateur majeur de l'échec de la lutte contre la pauvreté en France.
On peut améliorer les actions menées pour faciliter l'accès à l'alimentation, mais l'objectif principal est de faire que les gens n'aient plus besoin d'aide alimentaire ! Pour cela, il n'y a pas 36 solutions : il faut assurer un revenu digne en faisant en sorte que chacun ait soit un emploi, y compris au travers de mécanismes de type « garantie à l'emploi », soit, pour ceux qui n'ont pas ou pas encore d'emploi, un revenu de remplacement suffisant permettant de couvrir les besoins essentiels.
Des efforts ont été faits sur l'hébergement. Dans certains territoires, de nombreuses personnes ont été logées. L'hiver est traditionnellement une période de mobilisation, le covid n'explique pas tout. On constate une mobilisation et un vrai effort d'ouverture de places. En revanche, sur le logement, nous n'y sommes pas du tout ! Des engagements ont été pris, mais il ne se passe pas en réalité pas grand-chose. Une rénovation énergétique des bâtiments permettrait, à la fois, d'avoir des logements plus nombreux, mieux protégés du froid, plus écologiques et créerait de l'emploi : pourtant, nous ne parvenons pas à mettre en oeuvre un plan qui soit à la hauteur des enjeux...
Sur le logement, il y a donc encore énormément à faire, mais, sur l'hébergement, la mobilisation a globalement porté ses fruits, ce qui montre qu'il est possible d'arriver à l'objectif politique de zéro SDF.

Effectivement, il s'agit plutôt d'hébergement d'urgence que de logement. Or seul le logement donne de la perspective et permet de travailler dans la durée sur d'autres sujets.
Nous savons que 30 000 places ne sont pas pérennes : pour ces 30 000 personnes, nous avons quelques mois pour trouver des solutions. Il faut poursuivre les efforts pour aboutir à des solutions de logement et non de mise à l'abri.

Madame Bouyer, vous avez parlé à plusieurs reprises de la formation des jeunes. Qu'est-ce qui les empêche de savoir où aller ? Est-ce parce qu'ils ne sont pas décidés ou pas accompagnés ? Est-ce parce que les formations ne sont pas adaptées ? La formation, c'est le nerf de la guerre.
Quelles solutions préconisez-vous ?
Les travailleurs sociaux dans les missions locales suivent un trop grand nombre de jeunes, ils ont donc peu de temps à leur consacrer pour comprendre les aspirations des jeunes. Lorsqu'il a visité le Centre de promotion familiale de Noisy-le-Grand en 2018, le Président Emmanuel Macron a notamment rencontré des jeunes : l'un d'entre eux lui a expliqué qu'un professeur l'avait orienté vers l'horticulture alors qu'il voulait faire de la vente. Si l'orientation est mal « goupillée » dès le départ, les jeunes baissent les bras : il leur faut un suivi personnalisé avec un adulte qui va les soutenir. Au Haut Conseil du travail social, où j'ai siégé trois ans en tant que représentante du mouvement ATD Quart Monde, nous avons beaucoup évoqué la question du temps nécessaire pour l'accompagnement.
Donnons-nous les moyens d'« aller vers » et de nouer une relation pour accompagner le jeune dans son projet. Il est très difficile de choisir un métier. De nombreux abandons s'expliquent par une mauvaise orientation ou un accompagnement insuffisant... Dans chaque centre de formation d'apprentis (CFA), il faudrait un poste de travailleur social pour assurer le lien avec les jeunes en difficulté : ceux-ci veulent être accompagnés, car ils savent que l'orientation est très compliquée. Cela exige du temps et des moyens humains.
Merci de nous avoir donné ce temps d'explication et de conviction.
La situation actuelle n'est pas acceptable tant pour les personnes concernées que pour notre pays. On ne peut pas être fier de vivre dans un pays dans lequel 8 millions de personnes ont besoin d'aide alimentaire et 15 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, dans une très grande misère en termes non seulement de revenus, mais aussi de considération. Nous pouvons changer cela !

Merci de votre présence. Je m'associe aux propos de Mme Puissat, qui a apporté sa reconnaissance et ses remerciements à l'ensemble des bénévoles de vos associations qui sont sur le terrain tous les jours.
Les bénévoles sont aussi des personnes qui connaissent des situations de vie très difficiles.

Nous concluons ainsi notre première journée d'auditions, avant de poursuivre notre travail qui durera plusieurs mois.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
La réunion est close à 17 h 35.