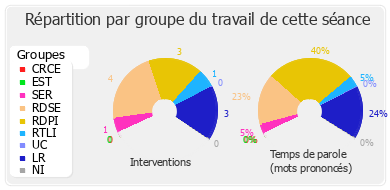Séance en hémicycle du 23 juin 2014 à 21h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à dix-huit heures quinze, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Jean-Pierre Raffarin.

La séance est reprise.

M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 23 juin 2014, qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution, le Conseil d’État a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le dernier alinéa du II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts (plafonnement de la contribution économique territoriale) (2014-413 QPC).
Le texte de cette décision de renvoi est disponible à la direction de la séance.
Acte est donné de cette communication.

L’ordre du jour appelle le débat préalable à la réunion du Conseil européen des 26 et 27 juin 2014.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de m’accueillir au sein de la Haute Assemblée pour ce débat préalable à la réunion du Conseil européen des 26 et 27 juin prochains, afin d’évoquer les priorités que le Président de la République défendra au nom de la France à cette occasion.
Cette réunion des chefs d’État et de gouvernement revêt une importance exceptionnelle. Au lendemain des élections européennes, et alors que vont être installées de nouvelles institutions européennes, l’Europe a en effet besoin pour les cinq prochaines années d’une feuille de route claire, qui lui permette de renouer durablement avec la croissance, de réaliser de grands projets communs dans des domaines d’avenir et de retrouver la confiance des citoyens partout sur le continent.
Pour cela, l’Union européenne doit fonctionner de façon plus simple, moins opaque, en se concentrant sur quelques grandes priorités, avec des objectifs d’efficacité et de résultats. Tel est le mandat qui doit être donné au prochain président de la Commission européenne, lequel sera désigné à l’occasion de ce Conseil européen.
Dans cet état d’esprit, la France défendra principalement quatre grandes priorités, qui devront être au cœur de la feuille de route de la prochaine Commission européenne et que nous mettrons évidemment au centre des débats du Conseil européen.
La première des priorités, c’est le soutien à la croissance, à l’emploi et au financement de l’économie réelle.
Beaucoup a été fait depuis la crise de 2008, et en particulier depuis deux ans, pour assurer l’intégrité de la zone euro, enrayer la spéculation, sortir l’Europe de la récession. Les deux premiers piliers de l’union bancaire – la supervision et la résolution – ont été adoptés et doivent encore être complétés par une garantie commune des dépôts.
L’Union européenne est désormais sortie de la récession, mais les conséquences sociales de la crise, d’abord en termes d’emploi, frappent encore durement nos concitoyens. Il nous faut donc aujourd’hui aller plus loin.
La Banque centrale européenne a abaissé ses taux à plusieurs reprises et mis en œuvre des mesures non conventionnelles pour accroître le financement de l’économie. Il nous faut donc consolider la reprise, développer le potentiel de croissance de l’Europe, renforcer sa base industrielle et d’innovation, accroître le financement de l’économie réelle, qu’il s’agisse des grands projets structurants ou du tissu de nos petites et moyennes entreprises.
La mise en œuvre de cette priorité implique de passer à une nouvelle étape du pacte de croissance défendu par le Président de la République en juin 2012. Cela suppose d’abord une coordination des politiques économiques au sein de la zone euro. Ces politiques doivent désormais être tournées principalement vers la croissance, qui est la première priorité. Cela suppose aussi que l’on utilise toutes les flexibilités du pacte de stabilité et de croissance, en tenant compte des réformes engagées et de la nécessité de conforter la reprise. C’est encore la meilleure garantie d’atteindre les objectifs de réduction de la dette, laquelle est évidemment un impératif que nous devons tous nous assigner.
Nous devons également avoir une véritable stratégie d’investissement. Il nous faut pour cela mobiliser immédiatement les instruments existants et accélérer la mise en œuvre des programmes engagés au titre du budget européen, qu’il s’agisse des fonds structurels, du mécanisme pour l’interconnexion en Europe ou du programme Horizon 2020.
Nous proposons en outre de renforcer l’utilisation des capacités de la Banque européenne d’investissement, en l’incitant à financer des projets d’une façon plus audacieuse, plus difficile peut-être, plus risquée, et en augmentant les moyens de sa filiale, le Fonds européen d’investissement, destiné aux petites et moyennes entreprises.
La phase pilote des project bonds, qui a été engagée par la Banque européenne d’investissement, doit elle aussi déboucher sur un recours beaucoup plus large à ces mécanismes d’emprunt et de financement qui permettent tant de développer des réseaux numériques que de financer des infrastructures, comme c’est déjà le cas dans plusieurs pays de l’Union européenne.
Nous pensons également qu’il est utile de réfléchir à la mise en place d’un instrument permettant d’orienter davantage les flux de l’épargne privée, abondante en Europe, vers le financement des entreprises. Il faut aussi engager une révision des règles prudentielles et comptables, aujourd'hui inadaptées, et faire en sorte qu’un nouvel instrument d’investissement européen puisse voir le jour.
Par ailleurs, l’Europe doit se doter d’une véritable politique industrielle, à laquelle les politiques de concurrence, fiscales et commerciales doivent concourir afin de permettre l’émergence de champions européens. Cette politique industrielle doit aujourd'hui pouvoir se développer dans le secteur du numérique, dans le cadre de l’Agenda numérique pour l’Europe, ainsi que dans celui de l’énergie. J’y reviendrai.
Sur tous ces sujets, nous savons pouvoir compter sur une très grande convergence de vues avec l’Italie, qui prendra la présidence du conseil de l’Union européenne à compter du 1er juillet prochain. La présidence italienne entend faire du Conseil européen d’octobre celui de l’économie réelle.
Nous devons aussi simplifier les procédures et la gouvernance de l’Union européenne.
Tout d’abord, nous proposons que, au sein de la zone euro, il y ait désormais un président stable de l’Eurogroupe. Le Président de la République l’a dit, l’Europe doit être plus claire et plus lisible, pour être plus efficace et plus accessible. Parmi les règles existantes, celles qui font peser des charges disproportionnées sur les entreprises et sur les citoyens européens doivent être identifiées et réduites, en portant une attention toute particulière aux PME. Ce Conseil européen doit également permettre de franchir un pas dans la voie de la simplification à l’échelle européenne.
La deuxième grande priorité, c’est l’affirmation d’une ambition sociale, en particulier en direction de la jeunesse.
La politique de l’emploi doit donner résolument la priorité à la jeunesse en Europe. Nous ne pouvons pas accepter que, dans plusieurs pays de l’Union européenne, le taux de chômage des jeunes reste supérieur à 25 %.
La prochaine conférence pour l’emploi des jeunes, qui se tiendra sous présidence italienne, sera bien sûr un rendez-vous important. Elle sera l’occasion de faire le bilan des actions qui ont été menées jusqu’ici. Nous devons faire en sorte que la « garantie jeunesse » soit effective partout en Europe et qu’elle soit prolongée au-delà de 2015, avec les moyens financiers adéquats. Vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, un fonds de 6 milliards d’euros a été attribué à cette politique pour les années 2014-2015. Nous souhaitons que la « garantie jeunesse » soit pérennisée et amplifiée.
Pour assurer la plus grande efficacité possible, de nouveaux champs d’action doivent être définis : je pense notamment à tout ce qui concerne l’apprentissage, la formation tout au long de la vie, l’alternance, mais aussi l’accompagnement des jeunes qui créent et qui innovent. En effet, quand un jeune crée son emploi ou une entreprise, c’est évidemment aussi une chance pour l’économie européenne.
Nous devons par ailleurs contribuer à la mobilité des jeunes à l’échelle du continent, en particulier faire travailler en réseau les agences européennes pour l’emploi et jouer la carte du transfrontalier, comme nous l’avons déjà fait avec l’Allemagne par le biais de l’agence de Kehl.
L’ambition sociale, c’est aussi la dimension sociale de l’union économique et monétaire. Nous proposons la création d’un Eurogroupe social, des avancées nécessaires vers la convergence fiscale et sociale au sein de la zone euro, le renforcement de la lutte contre le dumping social, auquel votre assemblée a déjà contribué en adoptant notamment une législation renforcée sur le détachement des travailleurs, et la perspective d’un salaire minimum dans tous les pays de l’Union européenne, et d’abord dans ceux de la zone euro.
La troisième priorité, c’est la définition d’une véritable politique énergétique et climatique européenne.
L’objectif est clair : nous devons parvenir en octobre prochain à un accord sur le cadre européen 2020-2030. Les positions des États membres étant encore divergentes à ce stade, il nous faut étudier l’ensemble des moyens qui permettront de prendre en compte les spécificités nationales tout en visant l’objectif commun de réduire de 40 % nos émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 et de porter à 27 % au minimum la part des énergies renouvelables.
Dans cette perspective, nous souhaitons que, dès le Conseil européen de cette semaine, le débat puisse s’engager sur la base des propositions de la Commission européenne. C’est absolument indispensable si nous voulons que l’Union européenne présente un front uni lors de la COP 21, la conférence Paris Climat, qui se tiendra à Paris à la fin de l’année 2015 et à laquelle toutes les grandes puissances dans le monde se préparent, la Chine et les États-Unis ayant déjà indiqué leur intention d’y formuler des propositions nouvelles.
Les deux dimensions du débat – politique énergétique et lutte contre le changement climatique – sont donc pour nous indissociables.
La première concerne les moyens de réduire la dépendance énergétique européenne, notamment à la lumière des événements d’Ukraine. La stratégie de réduction de la dépendance énergétique présentée par la Commission le 28 mai dernier s’inspire très largement des propositions du Premier ministre polonais, Donald Tusk, et du Président de la République.
Cette stratégie comporte des solutions de très court terme pour l’hiver 2014-2015, telles que l’évaluation des risques de rupture de l’approvisionnement en gaz et l’établissement, en conséquence, de plans d’urgence, voire de mécanismes de secours, mais aussi de moyen et long terme, telles que la diversification des sources d’approvisionnement en énergie, la modernisation des infrastructures énergétiques, l’achèvement du marché intérieur de l’énergie, la mise en œuvre de politiques d’efficacité énergétique pour réaliser des économies d’énergie.
Les conclusions du Conseil européen devraient prévoir le renforcement à court terme des mécanismes de solidarité et d’urgence à partir d’une évaluation des risques et une analyse des mesures de moyen et long terme, sur la base des propositions de la Commission.
Toutes ces mesures visent à rendre l’Europe plus efficace en matière énergétique afin de réduire sa dépendance. Elles renforcent la validité des propositions faites dans le cadre du paquet énergie-climat pour 2030. C’est la deuxième dimension des discussions qui auront lieu.
À cet égard, le Conseil européen de juin devrait tendre à définir avec soin le cadre de négociation en vue d’une décision finale sur les objectifs retenus par l’Union à l’horizon 2030 lors du Conseil européen d’octobre 2014.
Rappelons que cela est indispensable à la fois au plan interne, afin de créer un cadre stable et prévisible pour nos entreprises et de les amener ainsi à investir dans les technologies à faible émission de carbone, et au plan international, pour envoyer un signal positif et créer une dynamique vertueuse de prise d’engagements en vue de la COP 21, que j’évoquais à l’instant.
Le quatrième objectif est de renforcer l’espace de liberté, de sécurité, de justice et de bâtir une véritable politique d’immigration commune. Le Conseil européen de juin fixera les orientations du programme post-Stockholm, c’est-à-dire les priorités des cinq prochaines années dans ce domaine.
Nous souhaitons, à cet égard, que plusieurs objectifs puissent être réaffirmés : la garantie des droits à l’intérieur de nos frontières, la protection à nos frontières extérieures et la régulation des flux migratoires.
La liberté de circulation est un acquis, une liberté fondamentale qui touche à l’esprit même de la construction européenne. Elle ne saurait être remise en cause, mais, pour la préserver, il nous faut lutter avec détermination contre les abus et les fraudes dont elle peut faire l’objet. Nous devons aussi mieux faire fonctionner les outils, notamment ceux de l’espace Schengen, qui constituent des contreparties à la suppression des contrôles aux frontières intérieures. Une protection efficace de nos frontières extérieures communes est à cet égard une priorité absolue.
La lutte contre l’immigration irrégulière est essentielle, et le Conseil européen devra délivrer un message fort concernant la situation en Méditerranée. Dans cette perspective, nous devons mener, en relation avec les autorités des États tiers, un combat plus déterminé contre la traite des êtres humains et les activités des passeurs, et donner plus de crédibilité à la politique des retours, dans le respect de la dignité des personnes, en nous assurant notamment de la bonne mise en œuvre des accords de réadmission.
Pour la mise en œuvre de la surveillance des frontières, nous réaffirmerons l’équilibre entre responsabilité et solidarité : la responsabilité des États membres qui assurent en premier lieu le contrôle et la surveillance des frontières extérieures communes, en se dotant de moyens de contrôle efficaces ; la solidarité que nous devons aux États qui sont en première ligne, en particulier l’Italie. Frontex, l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, est l’un des outils majeurs de cette politique et doit progressivement prendre le relais de l’opération Mare Nostrum. Frontex doit renforcer ses activités opérationnelles, mieux échanger les informations avec Europol, améliorer sa réactivité. Il nous faut donc travailler à la mise en place d’un système européen de gardes-frontières.
Enfin, nous devons également mieux réguler l’immigration régulière, qui joue un rôle important, y compris en termes de rayonnement économique, commercial et culturel de l’Europe. Nous souhaitons insister sur le lien entre politique des visas et attractivité de nos territoires, comme l’a d’ailleurs fait Laurent Fabius dans son discours aux assises du tourisme, jeudi dernier.
C’est aussi en favorisant les mobilités, comme celles des étudiants, que l’Union œuvrera à normaliser les flux migratoires et à développer des échanges qui, en contribuant au développement des pays d’origine, favoriseront la stabilisation des populations.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, à ces quatre priorités s’ajoute celle que constitue l’affirmation du rôle international de l’Europe en tant qu’acteur global de la mondialisation, c'est-à-dire de son action extérieure, de sa politique de sécurité et de défense commune, des valeurs et des principes qu’elle entend défendre dans ses relations commerciales internationales.
À cet égard, je voudrais évoquer la situation en Ukraine, sujet qui sera évidemment abordé lors du Conseil européen.
Le plus urgent est d’obtenir un cessez-le-feu et une amélioration de la situation sur le terrain. Cependant, une telle désescalade ne pourra intervenir qu’à condition que tous les acteurs s’engagent pleinement dans la négociation : c’est le sens des contacts de haut niveau que le Président de la République et la Chancelière Angela Merkel ont eus avec MM. Poutine et Porochenko, une première rencontre entre les Présidents russe et ukrainien s’étant tenue lors des cérémonies du soixante-dixième anniversaire du Débarquement.
L’appel à la cessation des hostilités et à la négociation a encore été au cœur de l’entretien conjoint qu’ont eu cette semaine le Président de la République, la Chancelière allemande et le Président russe. Le plan en quatorze points annoncé par le Président ukrainien le 20 juin, assorti d’un cessez-le-feu unilatéral d’une semaine, constitue une chance pour mettre fin aux tensions. La Russie doit désormais impérativement démobiliser ses troupes à la frontière et user de son influence auprès des séparatistes pour qu’ils déposent les armes.
L’Union européenne est pleinement mobilisée pour apporter son soutien à l’Ukraine et fournira une aide de 11, 175 milliards d’euros sur la période 2014-2020. Par ailleurs, le volet commercial de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine sera signé le 27 juin, en marge de ce Conseil européen.
Le conseil Affaires étrangères qui se tient aujourd'hui à Luxembourg a été largement consacré à la situation en Ukraine. Une première phase des discussions, en présence du ministre ukrainien des affaires étrangères, M. Klimkine, a permis de montrer notre soutien unanime au plan de paix proposé par M. Porochenko.
La seconde phase des discussions a permis de dresser les premiers contours de la mission de politique de sécurité et de défense commune civile qui pourrait être lancée pour aider l’Ukraine à réformer son secteur de la sécurité civile. Elle a également reflété notre volonté commune de rester fidèles à la position que nous avons adoptée depuis le début de la crise : nous avons su faire preuve de fermeté lorsque c’était nécessaire en adoptant, au niveau européen, un certain nombre de sanctions qui ont eu une efficacité incontestable, mais nous avons toujours estimé que la priorité devait être donnée au dialogue, à la recherche d’une solution politique, aussi bien entre l’Ukraine et la Russie qu’entre les différentes composantes de la société ukrainienne.
Mesdames, messieurs les sénateurs, telles sont les questions que je voulais évoquer en ouverture de ce débat préalable au prochain Conseil européen. L’enjeu est de sauver le projet européen, plus indispensable que jamais, de lui redonner sa force, sa cohérence et sa capacité d’entraînement, de le réconcilier avec les citoyens européens : voilà l’ambition qui guidera la France et ses partenaires lors du Conseil européen des 26 et 27 juin. §

J’indique au Sénat que la conférence des présidents a décidé d’attribuer un temps de parole de huit minutes aux porte-parole de chaque groupe politique et de cinq minutes à la réunion des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe.
La commission des finances et la commission des affaires européennes interviendront ensuite durant huit minutes chacune.
Le Gouvernement répondra aux orateurs et aux commissions, puis nous aurons une série de questions, avec réponse immédiate du Gouvernement ou de la commission des affaires européennes.
Dans la suite du débat, la parole est à M. André Gattolin, pour le groupe écologiste.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le moins que l’on puisse dire, c’est que le programme du prochain Conseil européen sera, une fois de plus, très chargé ! L’ordre du jour officiel comporte plusieurs dossiers lourds, auxquels il convient d’ajouter d’autres questions non moins sensibles, même si elles ne sont pas inscrites au programme.
Cette réunion sera, rappelons-le, la première rencontre officielle des chefs d’État et de gouvernement depuis les élections du 25 mai dernier. C’est donc en réalité de la stratégie et des politiques des institutions européennes dans leur ensemble et pour les cinq années à venir qu’il s’agira.
Une double question se pose : d’une part, celle du choix des personnes qui seront amenées à – espérons-le – incarner l’Europe ; d’autre part, celle de l’organisation, de la répartition des tâches et des responsabilités, et donc des priorités dont cette nouvelle répartition sera la traduction concrète.
On aurait tort de sous-estimer ce dernier aspect, qui touche à ce qui a finalement été l’une des plus grandes faiblesses de la Commission sortante. Faute de volonté politique et d’ambition réelle, celle-ci s’est très tôt enfermée dans des dossiers extrêmement techniques, souvent particulièrement sectoriels et précis, dont le traitement parfois assez catastrophique a eu des conséquences désastreuses sur l’appréhension par l’opinion de l’ensemble des dossiers européens.
En l’absence d’orientations fortes, de commissaires et de représentants un tant soit peu charismatiques et dotés d’une véritable vision, c’est à travers un effet d’entropie propre à la Commission européenne depuis maintenant une vingtaine d’années que nous avons vu la très organisée direction générale de la concurrence prendre la main sur un grand nombre de questions stratégiques durant la présidence de M. Barroso. Si cette promotion acharnée de la concurrence a parfois sa logique, elle traduit aussi un incroyable dogmatisme, et il est à l’évidence aujourd’hui dangereux de soumettre l’avenir de l’Europe à la mise en œuvre de cette politique. Cela ne peut continuer ainsi !
Si nous voulons que la Commission européenne mette en place des politiques audacieuses, nous devons la doter de structures qui soient à la hauteur de la tâche et propres à mieux donner la priorité à ce qui fera le futur de nos concitoyens.
C’est particulièrement vrai en matière industrielle. Certes, le portefeuille de l’industrie existe déjà au sein de la Commission ; il est même détenu par l’un de ses vice-présidents, mais le poids relatif du commissaire à l’industrie par rapport à d’autres membres du collège est sans commune mesure avec l’importance de ce secteur ! Qu’attendons-nous alors pour renfoncer ses services et ses attributions, pour les mettre davantage en lien avec des compétences déjà attribuées qui rejoignent les siennes, telles que l’énergie, le climat, la recherche et l’innovation ? Qu’attendons-nous pour nous doter d’une Commission stratège, comme nous voudrions avoir un État stratège au niveau national ?
Des personnalités aussi diverses que Michel Barnier ou Pierre Moscovici ne disent pas autre chose. Dès lors que le constat est aussi largement partagé, il serait difficilement compréhensible que la France ne pousse pas en faveur de l’adoption de semblables solutions.
Revenons-en au détail de l’ordre du jour de ce Conseil européen. Je laisserai de côté les questions purement économiques, que d’autres évoqueront sans doute. Parlons un instant des affaires intérieures : justice, liberté, sécurité.
Il s’agit d’un chapitre essentiel, ne serait-ce qu’en raison de la volonté affichée du nouveau gouvernement italien, lequel prendra très prochainement la présidence du Conseil de l’Union européenne, d’avancer dans ce domaine.
Il est cependant à craindre que la question ne soit abordée, une fois de plus, que sous l’angle de la lutte contre le terrorisme, de l’immigration irrégulière, de la situation en Méditerranée, qui ne constituent pourtant qu’une partie du problème.
La question de l’espace de liberté, de justice et de sécurité en Europe renvoie aussi à celle, pour le moins centrale, de la citoyenneté européenne. Comme vous le savez, est citoyen européen toute personne disposant de la citoyenneté d’un des vingt-huit pays membres de l’Union. Même si les critères d’acquisition de la nationalité varient encore étrangement d’un État à un autre, ce principe ouvre à chacun de nombreux droits.
Or, depuis quelques années, ces droits sont tout simplement à vendre… Poussés par la crise et un sens parfois absurde des priorités, plusieurs États ont cherché à mettre en place ou ont effectivement lancé des programmes visant à attirer de riches investisseurs, souvent sans être trop regardants sur l’origine de leur richesse, en leur octroyant un permis de séjour, voire la nationalité du pays – et donc une citoyenneté qui, de fait, vaut pour l’Union tout entière –, en échange de quelques faveurs financières.
Vous vous souvenez sans doute du cas de Malte, qui, récemment, voulait vendre la nationalité maltaise contre 650 000 euros. Cet État a ensuite ajouté une condition supplémentaire : il faut désormais avoir résidé au préalable un an sur son territoire. Cependant, ce cas n’est pas unique, puisque le Portugal, l’Espagne, la Grèce ont également mis en place des programmes de ce genre. Ces pays ne proposent certes pas d’acquérir la nationalité, mais ils n’en vendent pas moins chèrement un droit de séjour sur le sol de l’Union, sans que nous trouvions à y redire. L’Irlande, la Lettonie se trouvent également dans cette situation et, dernièrement, les Pays-Bas étudiaient cette possibilité, chaque pays fixant un tarif plus ou moins élevé, compris entre 72 000 euros et plus de 1 million d’euros ! Si l’on comprend bien quel intérêt peuvent y trouver de riches Chinois ou Russes – ce sont, comme par hasard, les deux nationalités les plus représentées parmi les postulants –, on voit mal, en revanche, ce que l’Union pourrait tirer d’un tel marché de dupes…
Si nous prenons au sérieux la question de la citoyenneté européenne, nous devons d’urgence mettre fin à ces dérives, dont les conséquences sont bien plus qu’anecdotiques. Pourriez-vous nous dire, monsieur le secrétaire d’État, si le Président de la République envisage d’aborder ce problème lors du prochain Conseil ?
Je conclurai mon intervention en évoquant les questions climatiques et énergétiques, autre point important de l’ordre du jour de ce Conseil. Parce qu’il y a urgence, parce que les politiques des États membres en la matière divergent, parce que les ressources naturelles ou les inquiétudes des uns les poussent à privilégier des sources d’énergie comme les gaz de schiste, par exemple, que les autres rejettent en raison de leur dangerosité pour l’environnement et le climat, il s’agit d’un dossier éminemment sensible, sur lequel nous peinons à avancer ces derniers mois.
Précisément parce que c’est un dossier sensible, il est difficile de se mettre d’accord. Peut-on pour autant accepter que l’Union, tout en feignant de laisser aux États le choix de développer ou non ces énergies, se mette déjà à les financer via le programme Horizon 2020 ?
Auteur d’un rapport sur ce programme pour notre assemblée, j’avais notamment pointé les difficultés relatives au fléchage des fonds : trop précis, celui-ci risque de vite devenir obsolète et d’attiser les désaccords entre États ; trop flou, il risque de donner lieu à certaines dérives. Ces dérives, nous les voyons désormais, puisque, selon plusieurs articles de presse récents, l’Union finance discrètement l’exploitation des gaz de schiste – jusqu’à 133 millions d’euros ! – dans le cadre d’un programme destiné en principe à promouvoir l’innovation et la protection de l’environnement. Entre nous, il ne s’agit plus là de politique, mais véritablement d’alchimie, une alchimie douteuse qui transforme des crédits verts en carbone. Manifestement, quand la porte est fermée, certains trouvent toujours une fenêtre ouverte…
Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous indiquer quelle sera la position de la France sur ce sujet, et plus largement sur les ambitions européennes en matière de climat ? La tenue de la COP 21, dont vous avez déjà amplement parlé, est un enjeu majeur pour notre pays, pour l’Europe, pour notre planète. Comme vous l’avez vous-même souligné, il est absolument essentiel de ne pas découpler enjeux énergétiques et enjeux climatiques. §

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le prochain Conseil européen verra certainement la poursuite de la négociation pour le choix du nouveau président de la Commission européenne. Permettez-moi de souligner combien cette étape est importante : pour la première fois, le choix du président de la Commission devra respecter strictement les résultats des élections au Parlement européen. C’est un gage de démocratie, alors que l’on reproche souvent à la construction européenne de se faire loin des peuples.
En conséquence, nous demandons au Gouvernement de négocier dans le respect du résultat du scrutin. Agir autrement serait nourrir les partis extrémistes, populistes et anti-européens. Or, monsieur le secrétaire d'État, c’est bien la droite et le centre droit européens du Parti populaire européen, le PPE, et eux seuls, qui ont remporté les élections européennes, et notre candidat est Jean-Claude Juncker. Dès lors, nous demandons que ce choix des électeurs soit respecté dans les négociations intergouvernementales.
Cela signifie aussi qu’il faut maintenir le cap choisi, notamment en matière économique et financière, ce qui nous amène à l’un des points importants de l’ordre du jour du prochain Conseil européen : le semestre européen.
Ce processus de réglage coordonné des politiques macroéconomiques des États membres commence à être rodé, au moins en ce qui concerne son calendrier et son interconnexion avec les budgets nationaux. Cependant, il semble qu’il faille maintenant se l’approprier pleinement ; c’est le cas en particulier pour le Gouvernement français, qui paraît un peu rétif à écouter les avis divergents sur sa politique économique.
Au préalable, permettez-moi de souligner que, depuis un an, la zone euro dans son ensemble est en voie de stabilisation. L’Irlande et l’Espagne sont sorties des programmes de soutien ; le Portugal est en train d’en sortir ; Chypre a réalisé de bons progrès, ainsi que la Grèce, même si sa situation demeure encore bien fragile. Les risques sur les dettes souveraines sont donc moins pressants et, globalement, le redémarrage de la croissance est là, même s’il reste modeste. Réjouissons-nous : c’est le résultat de la politique menée jusqu’à présent.
Nous le constatons, les efforts consentis, collectivement et par certains pays – je pense notamment à l’Espagne –, commencent à porter leurs fruits. Ce début de consolidation européenne sera renforcé avec la mise en place de l’union bancaire dans les tout prochains mois.
Néanmoins, nous devons rester prudents. Le chômage continue d’être élevé, de même que les déficits publics et l’endettement, qui se situent à des niveaux historiquement hauts dans certains pays, dont la France. Ce n’est donc vraiment pas le moment de relâcher nos efforts, ce n’est pas le moment de contester le pacte de stabilité et de croissance. À cet égard, je tiens à saluer les propos de M. Benoît Cœuré, membre du directoire de la Banque centrale européenne, qui a affirmé très clairement, il y a quarante-huit heures, que modifier le pacte de stabilité et de croissance porterait atteinte à sa crédibilité et qu’il fallait se garder de renouveler les erreurs de 2003.
Nous ne comprenons donc pas bien ce qu’a voulu dire le Président de la République lorsque, sous le choc des résultats des dernières élections européennes, il a parlé de « réorienter l’Europe ». Avant de demander aux autres de changer, ne devons-nous pas commencer par nous adapter et prendre notre part du fardeau ? En effet, dans un contexte européen de convalescence, la France fait malheureusement de plus en plus figure de mauvais élève. Elle est placée sous surveillance, et la solidité de l’assainissement de ses finances suscite des interrogations de toutes parts.
Monsieur le secrétaire d'État, il est peut-être temps de se rendre à l’évidence. Ce n’est pas un modeste sénateur de l’opposition qui vous le dit. La Commission européenne, le Fonds monétaire international, l’Organisation de coopération et de développement économiques, le Haut Conseil des finances publiques, la Cour des comptes : désormais, les analyses de toutes les institutions, nationales et internationales, convergent…
En résumé, toutes ces institutions estiment que les hypothèses macroéconomiques que vous retenez sont optimistes, que ce soit en matière de croissance ou d’inflation. Toutes estiment que la baisse des dépenses publiques que vous annoncez est mal documentée et sera vraisemblablement insuffisante pour redresser nos comptes et financer les nouvelles dépenses que vous envisagez. Au-delà d’une formulation très diplomatique, toutes donnent à penser que si, sur le papier, votre présentation des comptes publics paraît cohérente, la réalisation ne suit pas.
Nous pensons aussi que le premier carburant de la croissance, ce sont des finances publiques stables. C’est être de mauvaise foi que de dire que cela signifie l’austérité. Il s’agit au contraire de transformer notre modèle économique et d’ajuster nos dépenses à notre richesse. Je le dis souvent sous forme de boutade : chaque époque a sa vérité, et les richesses d’aujourd'hui ne permettent plus d’engager les dépenses d’hier ; vous l’aurez deviné, je pense essentiellement aux dépenses sociales.
Dans cette perspective, il faut s’engager dans la voie des réformes structurelles : celle de la fiscalité, celle du marché du travail, celle de l’amélioration de l’efficacité de la dépense publique. Comme la France a obtenu un délai de deux ans pour revenir à l’équilibre des comptes publics, il serait judicieux d’utiliser pleinement ce délai et de profiter de la période actuelle de taux d’intérêts bas, car elle est susceptible de ne pas durer. Je rappelle que le service des seuls intérêts de notre dette publique nous coûte 45 milliards d'euros chaque année. Je vous laisse imaginer ce qu’il adviendrait si par malheur les taux d’intérêts devaient remonter…
Il est temps de passer aux travaux pratiques, avec courage et détermination. Il est temps d’agir vite, et je le dis sans acrimonie, tant notre pays est historiquement plus prompt à la révolution et à la contestation qu’à la réforme ; en conséquence, la tâche est difficile.
Monsieur le secrétaire d'État, il nous paraît impératif de respecter scrupuleusement nos engagements à l’égard de nos partenaires européens. Ce doit être notre objectif primordial. Il y va de notre crédibilité à leurs yeux, ainsi qu’à ceux des marchés financiers. Il y va également de la cohésion même de l’Union européenne, parce que la France est la deuxième économie de la zone euro.
Le prochain débat sur le projet de loi de finances rectificative nous permettra de savoir comment vous comptez compenser le dérapage de nos finances publiques en 2014. Sachez que nous serons vigilants. D'ores et déjà, toutes nos inquiétudes portent sur l’échéance de 2015 et sur le respect d’une trajectoire de redressement qui semble de jour en jour plus compromise. §

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, « coordonner pour concrétiser », c’est le sens du semestre européen. Les injonctions de la Commission européenne sont claires ; où en est-on de leur mise en application ? Placée sous mécanisme d’alerte, la France fait l’objet d’un bilan approfondi et d’une surveillance particulière en raison de ses déséquilibres macroéconomiques chroniques. Si les mesures prévues par le Gouvernement sont globalement conformes aux recommandations pour 2013, leur mise en œuvre est dramatiquement insuffisante.
La Commission européenne doute, comme la Cour des comptes, de notre capacité à atteindre l’objectif de ramener notre déficit public à 3 % du PIB à l’horizon 2015. Elle met en cause la politique que nous menons et souligne notre déficit de croissance. À ses yeux, la pression fiscale demeure beaucoup trop élevée, le ratio impôt/PIB étant de 45, 9 %. C’est pourquoi elle insiste sur la nécessité de baisser les taux nominaux de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés, préconise le renforcement de l’efficacité de la TVA et s’inquiète du maintien en 2015 de la surtaxe sur les grandes entreprises au niveau extravagant de 38, 1 %.
Le coût du travail en France reste l’un des plus élevés de l’Union, et l’importance des charges fiscales sur le travail réduit la rentabilité des entreprises. Les PME peinent à atteindre la taille adéquate pour pouvoir exporter et innover. Des enquêtes internationales alertent sur la détérioration de l’environnement des entreprises en France, et le choc de simplification apparaît notoirement insuffisant. Quelles suites sont données au rapport dont l’auteur est devenu secrétaire d’État chargé de la réforme de l’État et de la simplification ?
La Commission européenne pointe des distorsions dans la structure des salaires et l’absence de flexibilité de ces derniers, dans un marché du travail beaucoup trop segmenté et en voie de détérioration. Elle estime que le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE, ne profite pas aux entreprises qui exportent et manque par conséquent un objectif essentiel.
Dans quelle mesure les conclusions des assises de la fiscalité, saluées par le Conseil, sont-elles mises en œuvre par le Gouvernement ? Le rapport de la mission commune d’information sénatoriale sur la réalité de l’impact sur l’emploi des exonérations de cotisations sociales accordées aux entreprises sera remis sous peu : quel accueil le Gouvernement lui réservera-t-il ?
Lors de sa déclaration de politique générale devant le Parlement, le Premier ministre a pris de très importants engagements au travers du pacte de responsabilité. Or, dans son architecture actuelle, ce pacte ne permet pas de réduire la dépense publique de 50 milliards d’euros. En réalité, il tend à fiscaliser une large part de la protection sociale, à hauteur de 30 milliards d’euros, en finançant à recettes constantes les baisses de charges annoncées. Il ne propose donc que 20 milliards d’économies nettes en trois ans, c’est-à-dire moins de 7 milliards d’euros de réduction du déficit public chaque année : c’est très nettement insuffisant ! De plus, les collectivités territoriales et les administrations de la sécurité sociale seront également mises à contribution. Dès lors, l’économie nette de 20 milliards d’euros sur trois ans pour le budget de l’État devient très difficile à retracer.
La Commission européenne attend de notre pays une véritable réforme administrative visant à simplifier les échelons et à éliminer les chevauchements de compétences. Dans son récent rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, la Cour des comptes doute de la faisabilité du pacte s’il ne s’accompagne pas d’une importante baisse des effectifs des collectivités territoriales et des administrations de la sécurité sociale. Elle fixe un objectif de 30 000 postes en moins par an. Allez-vous mettre en œuvre ces préconisations, comme cela est nécessaire pour faire baisser une dépense publique dramatiquement élevée ?
Le projet de loi de finances rectificative sera discuté au Sénat le 7 juillet prochain. Vous devez mettre en place des instruments budgétaires en phase avec nos engagements européens : un service public rénové, un marché du travail fluidifié et des retraites alignées sur la moyenne européenne.
Monsieur le secrétaire d’État, votre poste, extrêmement important au regard de ce que devrait être la place de la France dans l’Union européenne, va être très difficile à tenir si vous maintenez les positions que vous défendiez en tant que premier secrétaire du parti socialiste, lorsque vous exigiez le maintien de la retraite à 60 ans et l’embauche de 60 000 enseignants, fût-ce à effectif de la fonction publique globalement constant : c’est là l’exact contre-pied des recommandations de la Commission européenne.
Ce qui me rend perplexe, c’est la schizophrénie française : vous savez que si vous persistez dans cette quasi-inertie au regard des engagements pris par la France, notre pays risque, ultime humiliation, d’être placé sous protocole !
Les engagements pris à l’égard de l’Union ne sont pas le seul motif devant nous pousser à entreprendre des réformes structurelles vitales pour la France : c’est dans notre propre intérêt !
Depuis mai 2012, notre endettement est passé de 1 700 milliards à 1 890 milliards d’euros et nous comptons 370 000 chômeurs de plus ; en outre, seulement 320 000 logements neufs ont été construits, au lieu des 500 000 annoncés.
L’économie est étouffée par l’impôt. Vous expliquez avoir augmenté les impôts de 30 milliards d’euros comme le gouvernement Fillon. Je vais tenter, en recourant à une allégorie que vous trouverez peut-être audacieuse, de vous faire comprendre comment les Français ressentent la situation. Imaginez une voiture avec deux chauffeurs qui se relaient ; vous êtes le second. Des gendarmes vous arrêtent pour avoir roulé à 150 kilomètres à l’heure sur une route où la vitesse est limitée à 90 kilomètres à l’heure. Votre prédécesseur admet avoir roulé, pour sa part, à 120 kilomètres à l’heure : on va lui retirer six points, mais vous, vous allez perdre votre permis de conduire. La situation est analogue en matière de fiscalité et de charges pénalisant notre économie.
Le Premier ministre a raison de baisser les charges et les impôts, mais pourquoi étaler ces mesures dans le temps ? Coupez tout de suite dans les dépenses ! Mettez en œuvre le programme présenté par M. Valls lorsqu’il était candidat à la primaire socialiste : il allait jusqu’à demander la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune et des 35 heures.
Il me semble enfin difficile de ne pas vous interroger, monsieur le secrétaire d’État, sur le contentieux entre BNP Paribas et les États-Unis. Je rappelle que le règlement européen 2271/96 interdit aux entreprises et aux personnes physiques de faire droit aux injonctions américaines contraires au droit international en matière d’extraterritorialité. Allez-vous faire appliquer le droit européen, afin que l’Europe se fasse respecter en tant que puissance internationale ? §

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, les 26 et 27 juin se tiendra donc le premier Conseil européen depuis les élections européennes du 25 mai, dont les résultats ont été marqués par une très forte abstention – même si celle-ci fut moins importante que ne l’annonçaient les sondages, elle témoigne d’un grand désintérêt et d’un fatalisme certain des citoyens à l’égard de l’Europe – et par la percée des partis populistes europhobes, qui reflète le malaise sociétal dans lequel l’Europe s’est enlisée ces dernières années.
Avec un taux de participation à peine supérieur à 43 %, les deux grands partis que sont le PPE et le PSE obtiennent respectivement 29, 43 % et 25, 43 % des voix. Il n’y a donc pas de quoi pavoiser, car ils devront s’accommoder de la nouvelle donne tenant au fait que les partis populistes et d’extrême droite rassemblent environ 20 % des voix.
Il faut tout de même noter une nette progression du groupe de la gauche unitaire européenne, qui passe de trente-deux à cinquante-deux membres, issus de quatorze pays différents, la parité y étant exactement respectée, comme au sein du groupe CRC du Sénat. C’est encore trop peu, mais cela permettra sans doute de faire mieux entendre, au Parlement européen, l’aspiration à une Europe fondée sur la solidarité et la coopération.
Au contraire, les populistes d’extrême droite promeuvent des remèdes simplistes pour des problèmes complexes, et leurs thèses s’imposent avec une telle agressivité qu’elles vont marquer la vie politique pour les années à venir.
Le verdict des urnes laisse encore subsister quelques inconnues, et le futur président de la Commission devra trouver des alliés ou des partenaires pour gouverner.
Comme l’écrivait une journaliste d’El Pais, « Il y a de l’écho dans l’histoire. […] Comme l’a montré le XXe siècle européen, les grandes crises, quand elles sont combattues au moyen de certaines recettes économiques, poussent la démocratie à se retourner contre la démocratie. »
La crise du capitalisme, l’austérité imposée aux plus faibles sont bien à l’origine de ces deux phénomènes que sont l’abstention massive et le vote en faveur de l’extrême droite. Car la crise, on le sait bien, ce n’est pas pour tout le monde : ainsi, même avec des profits en baisse de 8 % en 2013, les entreprises du CAC 40 ont augmenté de 8 % les dividendes distribués ! Alors que nos grandes entreprises accumulent des retards d’investissements considérables, 85 % des profits partent en dividendes…
Nous retrouvons cette même façon de penser au sein de l’Union. S’il fallait encore un exemple de cette déconnexion des instances européennes des préoccupations des citoyens, il suffirait de regarder l’ordre du jour du prochain Conseil européen, notamment les conclusions du semestre européen : rien ne change ! Comment est-il possible de préconiser, encore et toujours, plus d’austérité, quand les peuples souffrent ?
Ainsi, la lecture des recommandations de la Commission concernant le programme national de réforme pour la France de 2014 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la France pour 2014 ne peut que laisser pantois. Comment l’Europe peut-elle espérer relancer l’économie du continent en renforçant encore l’austérité ? Ces recommandations, qui s’apparentent en fait à des consignes à appliquer, nous enseignent quelles seront les orientations pour le prochain budget, et même pour le collectif budgétaire à venir. Il est ainsi clairement signifié à notre pays que des efforts additionnels devront être inscrits dans la prochaine loi de finances rectificative pour 2014.
Je dois avouer que je m’interroge de plus en plus sur le rôle que nous jouons dans cet hémicycle, d’ailleurs toujours plus désert lorsque le débat porte sur l’Union européenne… Le Conseil européen définit les objectifs pour notre pays, le Gouvernement les applique avec le zèle que nous lui connaissons, et pour notre part nous nous contentons de les commenter.
C’est pourtant le candidat Hollande qui tenait les propos suivants : « Je veux réorienter la construction européenne. Je défendrai une association pleine et entière des parlements nationaux et européen à ces décisions. » Mais, dans la réalité, le Conseil européen assène qu’« il est donc nécessaire de préciser encore la stratégie de réduction des dépenses en intensifiant l'examen des dépenses qui est en cours et en redéfinissant, le cas échéant, la portée de l'action des pouvoirs publics ». Le Conseil européen insiste également fortement sur l’importance du projet de loi relatif à l’organisation territoriale de notre pays. Selon lui, ce texte devrait permettre « de simplifier les divers échelons administratifs, de créer de nouvelles synergies, d’obtenir de nouveaux gains d’efficacité et de réaliser des économies supplémentaires en fusionnant ou en supprimant des échelons ».
Si certains d’entre nous avaient encore quelques doutes sur les raisons du revirement présidentiel et gouvernemental concernant la suppression des départements et la diminution considérable du nombre d’élus régionaux, le Conseil européen nous rappelle fort à propos ce qui l’inspire…
La réforme des collectivités territoriales ne répond en effet qu’à une application aveugle des recommandations du Conseil. Ainsi, le Gouvernement français va intensifier le contrôle des dépenses des collectivités territoriales, plafonner l’augmentation annuelle de leurs recettes fiscales, tout en mettant en œuvre de façon rigoureuse la réduction des dotations, comme on le lui demande. Voilà le programme dicté par l’Europe pour nos collectivités ! Est-ce de cette Europe-là que les citoyens veulent ? Je ne le crois pas.
De plus, comment peut-on imaginer un seul instant qu’il sera possible de réaliser des économies en supprimant les assemblées départementales et une région sur deux ? Même l’agence de notation Moody’s annonce que cette réforme sera sans effet sur la dépense publique. Certes, il est nécessaire d’adapter nos services publics aux nouveaux besoins des administrés, mais cela ne veut pas dire les éloigner toujours plus des populations. Devant cette recentralisation, devant l’affirmation de métropoles hyperintégrées, il nous faut exiger que ces choix, qui engagent l’avenir des conseils départementaux, des conseils régionaux, des communes et des intercommunalités, soient non pas imposés par une recommandation du Conseil européen, mais débattus et tranchés souverainement par le vote des citoyens concernés. Ce dont la France et l’Europe ont besoin, c’est avant tout d’un renouveau démocratique !
D’autres recommandations sont tout aussi inquiétantes pour le devenir de notre système social. En effet, le Conseil européen préconise de prendre de nouvelles mesures pour « réduire de façon sensible l’augmentation des dépenses en matière de sécurité sociale, en fixant des objectifs plus ambitieux pour les dépenses annuelles dans le domaine des soins de santé ».
Nous connaissons pourtant les grandes difficultés que rencontrent nombre de nos concitoyens pour accéder aux soins. Est-il opportun de continuer à limiter et à diminuer le remboursement des médicaments, de poursuivre le démantèlement du système public de soins hospitaliers ?
Comme si tout cela n’était pas encore suffisant, on invoque la nécessité d’une nouvelle réforme des retraites, concernant notamment les régimes spéciaux. Les allocations familiales, l’aide au logement, les indemnités chômage seront-elles aussi revues à la baisse, afin de paupériser davantage encore les populations fragiles ? Non, la solidarité n’est vraiment pas un des axes de développement de l’Europe, et c’est tout à fait regrettable.
Ainsi, le Conseil européen estime que le SMIC français permet « un pouvoir d’achat parmi les plus élevés au sein de l’Union » : sous-entend-il qu’il est bien trop élevé, sachant qu’il invite à le faire évoluer de façon à renforcer la compétitivité et la création d’emplois, ou encore à étendre les dérogations au salaire minimum ?
Le Conseil européen continue de considérer le travail comme un coût à réduire, mais ne s’intéresse guère à l’augmentation du coût du capital, qui gangrène l’économie européenne. Là se trouve pourtant le nœud du problème. Le Conseil demande que soient encore accrues les exonérations de cotisations sociales patronales, alors que nous avons déjà observé que ces exonérations n’avaient aucun effet sur l’emploi. Depuis des décennies, la même politique est appliquée, mais pour quel résultat, hormis une diminution sans fin des ressources de l’État, qui contribue à l’aggravation du déficit de nos comptes publics ?
En revanche, on sent le Conseil bien moins motivé pour négocier un accord sur la taxation des transactions financières, dont la conclusion se fait attendre. On estime que les recettes annuelles seraient de l’ordre de 30 milliards à 35 milliards d’euros, soit entre 0, 4 % et 0, 5 % du PIB des États membres concernés : cela ne représente donc pas un niveau de taxation insupportable, tandis que cette taxe constituerait un outil intéressant de lutte contre la spéculation et un moyen de faire contribuer le secteur financier à la reconstruction des économies et au renflouement des finances publiques des États la mettant en place. Mais les opposants sont nombreux et les États très divisés.
Afin d’éviter une fragmentation du marché intérieur des services financiers, ainsi que des phénomènes de double imposition ou de double non-imposition, il nous apparaît urgent d’avancer concrètement sur ce dossier.
Cependant, l’accord intervenu le 5 mai dernier entre dix ministres des finances de l’Union européenne est très inquiétant, dans la mesure où il réduit considérablement le périmètre d’application de la taxe. Monsieur le secrétaire d’État, pourrez-vous nous préciser quelle est aujourd’hui la position du Gouvernement sur ce sujet ?
Les citoyens européens rejettent cette Europe qui laisse un grand nombre d’entre eux sur le bord de la route. Pour relancer la dynamique européenne, il est impératif de répondre clairement aux inquiétudes exprimées récemment. Les résultats des dernières élections sont un signal d’alarme fort, et l’Europe devrait tout mettre en œuvre pour en tenir compte, mais je constate amèrement que telle n’est pas l’orientation retenue pour la prochaine réunion du Conseil européen. Sans doute estime-t-on que l’Europe a maintenant cinq ans devant elle jusqu’aux prochaines échéances électorales…
Imposer toujours plus d’austérité aux populations européennes ne mènera nulle part. Il y a urgence à agir avec les forces politiques, syndicales, citoyennes, pour bâtir un projet progressiste porteur d’avenir, d’espoir, entièrement fondé sur le respect de l’humain ! §

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le 25 mai dernier, les citoyens de l’Union européenne étaient appelés aux urnes pour élire un nouveau Parlement européen. Finalement, peu d’entre eux se sont déplacés, notamment en France, et les partis europhobes ont réalisé une percée importante en Pologne, au Danemark, en Autriche, en Hongrie, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.
Les Français, pour leur part, ont placé en tête la liste du Front national. C’est symboliquement contrariant que la liste qui préconise la destruction de l’Europe en tant qu’institution soit en tête, mais, politiquement, il n’est pas encore écrit que les listes europhobes parviennent à modifier sensiblement l’équilibre du Parlement européen.
Cela étant, ce vote ne traduit pas une volonté des Français de sortir de l’Europe. Pour reprendre une formulation un peu galvaudée, nous devons « tirer les leçons de ce scrutin ». Force est de constater que les fameuses « leçons à tirer » ne sont pas les mêmes pour tous.
La crise économique, la précarité et l’inquiétude socioéconomiques de nos concitoyens favorisent à la fois l’abstention et un vote contestataire. En outre, l’insécurité économique engendre une crispation identitaire, habilement orchestrée par ces mouvements extrêmes. Dès lors, aux yeux des pourfendeurs de l’Europe, la réponse aux difficultés sociales et économiques résiderait dans la sortie de l’euro et la déconstruction européenne, avec le rétablissement des frontières nationales.
Le groupe socialiste du Sénat conteste vigoureusement l’idée qu’il faille revenir sur les grandes réalisations européennes telles que la libre circulation ou la monnaie unique, mais il continue à demander une réorientation de l’Europe, ainsi qu’une modification de sa gouvernance.
Pour que cette demande de réorientation soit crédible, nous devons prendre nos responsabilités. Trop souvent, depuis trop longtemps, nous n’avons pas su ni voulu parler d’Europe, et cette responsabilité est aussi celle de nos grands médias. Parfois, certaines mesures, impopulaires, ont été mises, à tort, sur le dos de l’Europe. A contrario, quand il s’agissait d’initiatives européennes, nous avons choisi de les mettre à notre seul crédit politique.
Le mot « Europe », récemment encore porteur de rêve, synonyme de progrès et de liberté, est désormais entaché de suspicion. L’urgence exige de redonner en priorité du sens, de la lisibilité et de la hauteur de vue à l’action européenne. Dans cette perspective, trois dossiers seraient de nature à « raccrocher les wagons ».
Le premier nécessite de régler, dans des délais acceptables, les questions liées au dumping fiscal.
Le deuxième dossier concerne l’âme de l’Europe, en résistant, pour reprendre les propos du pape François, « à la mondialisation de l’indifférence ».

Absolument !
Le troisième dossier, le plus important, est relatif à l’abandon des politiques de rigueur et à la relance de la croissance et de l’emploi.
Notre crédibilité est en jeu et notre responsabilité immense.
Le premier dossier porte donc sur l’harmonisation fiscale, du moins l’imposition des profits là où ils sont réalisés. Nous devons être à l’offensive face à cette exigence. Il est absolument impossible de justifier notre fiscalité, tant sur les ménages que sur les entreprises, si nous ne combattons pas parallèlement les stratégies d’évitement élaborées notamment par les nouveaux géants du numérique, dont les plus connus sont Amazon, Google, Facebook.
Le consentement à l’impôt est une nécessité démocratique. Or l’optimisation fiscale pratiquée par ces groupes contribue à l’érosion de ce consentement, d’une part, et à la destruction d’emplois, d’autre part. Il s’agit d’une problématique sensible autant en France et au Royaume-Uni qu’en Allemagne. Nous savons que, le 11 juin dernier, la Commission a ouvert une enquête sur les pratiques fiscales de l’Irlande, du Luxembourg et des Pays-Bas. Monsieur le secrétaire d’État, quelles sont les avancées de l’Union européenne sur cette question et quel rôle entend jouer notre pays pour accélérer le processus ?
La commission des finances du Sénat a été très active sur la question de l’équité fiscale numérique. Si je souhaite y revenir aujourd’hui, c’est parce que, depuis six mois, le Parlement travaille sur une proposition de loi visant à encadrer les conditions de la vente à distance des livres, dont je suis rapporteur. Le dispositif que nous avons élaboré vise à rétablir des conditions de concurrence plus équitables entre les librairies indépendantes et le géant de la vente à distance. Cette proposition de loi, qui devrait normalement être adoptée jeudi matin, est soutenue à l’unanimité par tous les groupes politiques de l’Assemblée nationale et du Sénat. Or la Commission européenne, sur un aspect au moins du dispositif voté, a émis un avis que nous contestons. La commission des affaires culturelles du Sénat, forte de cette double unanimité, a décidé de passer outre, et nous espérons que la Commission européenne sera sensible à nos arguments.
Le deuxième dossier sur lequel nous devons parler haut et clair concerne l’exigence d’une nouvelle approche de la politique européenne de l’asile qui soit en conformité avec les droits de l’homme et l’ensemble des valeurs et des principes des démocraties occidentales.
Je rappelle que nous avions déposé, en 2010, une proposition de résolution visant le déclenchement de l’octroi de la protection temporaire en faveur des réfugiés afghans. Quels sont les engagements que peut d’ores et déjà prendre l’Union européenne en termes de déclenchement de la protection temporaire, monsieur le secrétaire d’État ?
Le traitement en urgence des réfugiés, la mise en place â contretemps des mesures nécessaires ne sont pas compatibles avec l’esprit de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Il nous faut anticiper, dès maintenant, un afflux éventuel de réfugiés irakiens.
Outre la protection temporaire souvent engagée tardivement, l’Union européenne pèche aussi en matière de réinstallation, une autre solution pour les réfugiés. En 2013, l’Union européenne, avec vingt États, n’a réinstallé que 5 500 réfugiés, quand les États-Unis en réinstallaient 50 000, l’Australie 6 000 et le Canada 7 000. Monsieur le secrétaire d’État, que comptez-vous proposer pour améliorer cette situation ?
Ne cédons pas au cynisme, à l’indifférence, à l’impuissance mise en scène et rappelons à nos concitoyens – j’emprunte ces mots à la maire de Lampedusa – qu’« aucun d’entre nous n’aurait le courage de monter à bord de ces bateaux, en laissant tout derrière soi » et que cette folle odyssée, en mer ou en camion, a sans doute des raisons impérieuses.
L’Europe est une oasis de paix, mais, à nos portes, des pays s’enfoncent dans des guerres civiles aux atrocités sans nom. Notre politique de l’asile doit s’adapter et ne pas se laisser instrumentaliser, amoindrir ou dénaturer par les crispations identitaires honteusement orchestrées par des partis qui se nourrissent de la détresse pour distiller la haine et la défiance.
Ce n’est pas être une « âme sensible » que de veiller à ce que la lutte contre l’immigration irrégulière n’entame pas le droit d’asile. Je suis persuadée que nos concitoyens attendent de l’Europe qu’elle les rende fiers, qu’elle soit porteuse, dans ses actes, de valeurs.
L’opération Mare nostrum, lancée par l’Italie et en partie financée par l’Europe, a permis de sauver des milliers de vies. Monsieur le secrétaire d’État, que compte faire l’Europe aujourd’hui pour que ce programme conjugue sauvetage en mer et respect du droit d’asile ?
Le troisième dossier que nous devons reprendre concerne les règles de calcul du déficit public et la règle des 3 % fixée par le traité de Maastricht. Beaucoup de voix, et pas seulement en France, s’élèvent pour demander une révision de la procédure budgétaire européenne. Ce qui fait figure d’exception aujourd’hui doit devenir la règle demain, pour un rééquilibrage entre lutte contre les déficits publics et promotion de la croissance. À cette fin, il nous paraît fondamental d’exclure les dépenses d’investissement d’avenir et les contributions au budget européen du calcul du déficit. Nous devons également réfléchir à en exclure le coût des réformes structurelles, notamment celles qui sont recommandées par la Commission européenne elle-même. Le ministre allemand de l’économie vient de s’y déclarer favorable, et la future présidence italienne du Conseil de l’Union européenne devrait prendre une initiative en ce sens. Même le FMI appelle à un assouplissement de ces critères.
Nous avons besoin de retrouver le chemin de la croissance. Le gouvernement français, avec le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE, et le pacte de responsabilité effectif à partir de 2015, a mis en place des dispositifs de soutien au pouvoir d’achat, à la compétitivité, et à la croissance. Les dernières décisions de la Banque centrale européenne s’inscrivent également dans cette perspective. Pourriez-vous nous préciser, monsieur le secrétaire d’État, l’état de la réflexion sur la règle de calcul ?
Après avoir exposé trois défis qui doivent trouver des réponses précises et rapides si l’on veut enrayer la désaffection européenne, je veux maintenant saluer la mise en place de la garantie jeunesse, qui a constitué une priorité dans l’agenda du Gouvernement. Je me félicite également de la recapitalisation de la Banque européenne d’investissement, qui lui permettra de jouer son rôle de levier économique : elle a surtout le mérite d’avoir tenu bon, depuis deux ans, dans les échanges avec les autres États européens, sur la nécessité de doter l’Europe d’un volet social.
J’aimerais conclure sur la garantie jeunesse. Il s’agit du premier programme opérationnel dans le cadre de l’emploi des jeunes. La France recevra une enveloppe importante, destinée aux régions où le taux de chômage des jeunes dépasse 25 %. La jeunesse française est fortement touchée par le chômage et l’Europe ne la fait plus rêver, à la différence de la génération précédente. La prise en compte de cette population et de ses difficultés économiques est essentielle pour rebâtir un lien de confiance. Le 11 juillet se tiendra le sommet européen pour l’emploi des jeunes. Pouvez-vous d’ores et déjà nous éclairer sur les propositions que la France y défendra ?
Règles budgétaires rénovées, justice fiscale et sociale, humanisme de la politique d’asile constituent donc pour le groupe socialiste du Sénat les trois piliers d’une nouvelle gouvernance de l’Union européenne.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Chevènement, pour le groupe du RDSE.
Applaudissements sur les travées du RDSE.
Sourires.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le Conseil européen des 26 et 27 juin va se voir soumettre, en vertu du traité sur la stabilité, la cohérence et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, dit TSCG, et dans le cadre procédural du semestre européen, une série de recommandations par pays visant à guider les États membres dans leurs politiques budgétaires et de réformes dites « structurelles ».
J’ai lu soigneusement les recommandations concernant non seulement la France, mais aussi l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni. C’est un programme d’assainissement à perte de vue, engagé simultanément dans tous les pays européens. Il s’agit en effet de ramener non seulement le déficit budgétaire « structurel », objectif de moyen terme, à 0, 5 % du PIB, mais aussi le niveau d’endettement à 60 % du PIB.
Dans ce cadre contraint, l’Allemagne ne peut absolument pas jouer son rôle de locomotive de la croissance européenne. Si les recommandations qui lui sont adressées mentionnent « l’amélioration des conditions propices à une hausse de la demande interne », leur portée est immédiatement circonscrite « à la réduction des taux élevés d’imposition et de cotisation de sécurité sociale, en particulier pour les bas salaires ». Cette suggestion est franchement dérisoire, quand on lit dans le paragraphe précédent que l’Allemagne doit préserver une position budgétaire saine, afin que le taux d’endettement de l’État, actuellement de 85 % du PIB, reste sur une trajectoire descendante durable, jusqu’à 60 % du PIB. Ce n’est pas avec ce genre de recommandation qu’on fera repartir la croissance européenne !
Pour la France, c’est une mise à la diète généralisée : efforts d’économies budgétaires accrus, plafonnement des retraites, rationalisation des allocations familiales, réduction des aides au logement et, curieusement, réforme territoriale, comme si celle-ci pouvait permettre de dégager des économies propres à réduire le déficit budgétaire à 3 % du PIB en 2015 ! Cet objectif est évidemment hors d’atteinte, quand on sait que le déficit sera de 4, 1 % du PIB en 2014, du fait d’un tassement des rentrées fiscales de 14 milliards d’euros par rapport aux prévisions.
Viennent ensuite, parmi les recommandations, la réduction du coût du travail, la remise en cause du crédit d’impôt recherche que j’avais créé jadis, la déréglementation des professions dites réglementées, l’ouverture des services à la concurrence, la hausse des tarifs du gaz et de l’électricité, la réduction des niches fiscales et l’élimination des seuils, la suppression des subventions au diesel, la réforme du système d’indemnisation du chômage, j’en passe et des meilleures. Ultime et cocasse recommandation : faire en sorte que le gestionnaire unique des infrastructures des chemins de fer soit bel et bien indépendant par rapport à la SNCF.
On croit rêver, monsieur le secrétaire d’État ! Sur quelle planète vivent donc les technocrates de la Commission européenne ? Celle-ci n’hésite même pas à outrepasser ses compétences en préconisant la réforme du système d’éducation, compétence nationale s’il en est. Bonjour la subsidiarité !
Nous assistons à la mise en tutelle généralisée de la démocratie républicaine. La Commission préconise ainsi les fusions des collectivités locales, éclairant d’un jour inédit les motivations d’une réforme territoriale dont nous avions jusqu’ici quelque peine à percevoir la logique.
La Commission européenne, dans sa proposition au Conseil européen, va même jusqu’à critiquer les règles européennes en dénonçant, à la page 5 du document concernant la France, l’absence de ciblage du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi sur les entreprises exportatrices, seules en mesure d’aider la France à retrouver sa compétitivité. Or on sait que ce sont les institutions européennes elles-mêmes qui, au nom de la concurrence, imposent une règle de non-discrimination entre les entreprises, handicapant ainsi toute politique industrielle.
Ce qui frappe dans la lecture de ces considérants, c’est le resserrement du « cadenassage » de nos choix politiques. Le 5 mars 2014 intervenait, en vertu du TSCG de 2012, la présentation par la Commission du bilan concernant la France ; le 7 mai, la France présentait son programme national de réformes ; le 2 juin était publié le projet de recommandation de la Commission au Conseil du 26 et 27 juin 2014 concernant la France.
Vous entendez, mes chers collègues, ce « cliquetis de chaînes » que j’avais annoncé lors de la ratification du TSCG le 20 octobre 2012. Que restera-t-il, après la réunion du Conseil des 26 et 27 juin, de la liberté de vote du budget par le Parlement ? Et que reste-t-il déjà de la liberté de la France de s’organiser comme bon lui semble en tous domaines, y compris l’éducation ou l’administration des collectivités locales ? Où est passé l’article III de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui rappelle que « le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation » ? Que fait-on de l’article 3 de notre Constitution, qui rappelle que c’est au peuple qu’appartient la souveraineté ? Chacun d’entre nous peut ressentir que notre République n’est plus vraiment libre de ses décisions.
Monsieur le secrétaire d’État, nous ressentons aussi le poids de la doxa économique qui sous-tend la logique de ces recommandations. Tandis que les États-Unis revoient à la baisse leurs prévisions de croissance de 2, 8 % à 2 % pour 2014, dans la zone euro, la faiblesse des crédits bancaires et des taux d’inflation – 0, 5 % en rythme annuel, en mai – fait peser, je cite Mme Lagarde, directrice du FMI, dans une interview du 16 juin au Handelsblatt, « de graves menaces pour la reprise européenne ».
L’évolution de la situation en Ukraine et en Irak comporte des risques de récession accrus, notamment à travers les prix du gaz et du pétrole. L’euro a retrouvé un cours de 1, 36 dollar, supérieur de près de 20 % à son cours de lancement. Bonjour la compétitivité !
Si Mme Yelleen, présidente du Federal Reserve Board, promet, quant à elle, une politique monétaire accommodante, que fait de son côté la BCE ? Mme Lagarde n’a pas hésité à braver le conformisme ambiant en déclarant : « Si l’inflation devait rester obstinément faible, alors nous espérerions certainement que la BCE prenne des mesures d’assouplissement quantitatif par le biais d’achat d’obligations souveraines. » Quelle audace !
Nous attendons, monsieur le secrétaire d’État, que le Conseil européen, détenteur de la légitimité démocratique, se saisisse pleinement de la gravité de la situation économique. Le vice-chancelier allemand, M. Sigmar Gabriel, s’est prononcé récemment pour « davantage de souplesse budgétaire à l’égard des pays qui paient le coût des réformes imposées ».
Il est temps d’engager une autre politique sur le plan européen, en commençant par faire baisser la parité de l’euro et en allongeant d’un ou deux ans les objectifs de retour aux critères du pacte de stabilité. Les sociaux-démocrates sont au pouvoir en Allemagne. Ils doivent aussi prendre leurs responsabilités pour mettre la monnaie au service de l’économie et desserrer le carcan des disciplines que l’ordolibéralisme allemand veut imposer au reste de l’Europe au mépris d’une situation sociale qui n’a jamais été aussi dégradée : 23 millions de chômeurs dans les pays de la seule zone euro ! Un peu d’inflation supplémentaire est parfaitement tolérable. La BCE doit cesser de combattre, tel Don Quichotte, les dangers imaginaires que ses statuts lui commandent de terrasser. Il y a longtemps que c’est chose faite. Il est temps d’affronter les problèmes réels !
Avant de conclure, j’aimerais dire quelques mots de l’Ukraine, car la situation qui y prévaut amènera sans doute le Conseil à se saisir de la question.
M. Porochenko propose la paix mais il fait la guerre ! À ce jour, il n’a pas ouvert le processus de négociations auquel il s’était engagé. Or il faut bien négocier avec ceux contre lesquels on se bat. Il est facile d’excommunier l’adversaire en lançant contre lui une opération dite « antiterroriste ».
La Russie a facilité la tenue de l’élection présidentielle ukrainienne du 25 mai, je ne vous l’apprends pas !

Le Président de la République française et la Chancelière de la République fédérale d’Allemagne ont appelé, le 10 mai, au « lancement d’un processus de réforme constitutionnel aussitôt après les élections du 25 mai, comprenant un calendrier court, un processus de consultation inclusif impliquant toutes les parties tenantes concernées et les principaux domaines couverts par le processus », notamment la compétence des autorités régionales.
La France a toujours déclaré ne pas vouloir placer l’Ukraine devant un choix impossible entre l’Europe et la Russie. Or un accord d’association doit être signé entre l’Union européenne et l’Ukraine le 27 juin. La France n’a pas à distinguer entre les bons Ukrainiens et les mauvais, entre ceux qui seraient à l’Est ou à l’Ouest, entre les uniates de Lviv et les russophones de Donetsk ! Elle ne connaît que les Ukrainiens ! Est-il toutefois concevable de signer un accord d’association avec un pays dont le Président persisterait à refuser d’ouvrir le dialogue avec les régions russophones de l’Est ?

Certes ! Mais par des gens qui voulaient la paix, y compris à l’Est !
La semaine dernière, l’opération dite « antiterroriste » s’est soldée par 200 morts. Le commissaire bruxellois chargé du dossier aurait déclaré que les mesures prises par le Président Porochenko constituaient une « violence proportionnée » et, par conséquent, acceptable. Or je constate qu’il y a déjà eu trois fois plus de morts du côté des militants russophones dits « séparatistes » qu’il n’y en avait eus du côté des militants de Maïdan.

Le Président Porochenko a été élu pour faire la paix. Tant qu’une négociation n’aura pas été engagée, il me paraîtrait normal de suspendre la conclusion de l’accord d’association, d’autant que 11 milliards d’euros ont déjà été promis à l’Ukraine par l’Union européenne.
Selon le commissaire Oettinger, la Grèce ne serait à côté de l’Ukraine qu’une « bagatelle ». Toutefois, l’accord d’association ne peut en aucune manière valoir promesse d’adhésion à l’Union européenne, comme je l’entends dire par M. Olli Rehn, par exemple. Celle-ci ferait mieux de se préoccuper des problèmes qui se posent au Sud, en Méditerranée et en Afrique plutôt que de vouloir toujours reculer sa frontière orientale. Le Conseil européen doit reprendre le contrôle de la politique européenne de voisinage, qui a été laissé dès le départ à des incapables négociant séparément avec la Russie et avec l’Ukraine. Une certaine russophobie est de mise dans certains cercles, comme si l’on voulait construire l’Europe contre la Russie, au nom de je ne sais quelle idéologie.
La Russie fait partie de l’Europe ! En l’oubliant, l’Union européenne se mettrait définitivement à la remorque d’intérêts qui ne sont pas les siens. Non, une nouvelle guerre froide n’est ni de l’intérêt de la France ni de l’intérêt bien compris de l’Europe et encore moins de l’Ukraine !
Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur plusieurs travées de l’UMP et de l’UDI-UC.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, comme l’orateur précédent, je voudrais rappeler que le tout prochain Conseil européen marquera la conclusion du semestre européen et verra l’adoption par les États de recommandations par pays, sur la base des propositions de la Commission européenne publiées le 2 juin dernier. Que faut-il retenir de cette « recommandation de recommandation », pour reprendre le jargon bruxellois, concernant le programme national de réforme et le programme de stabilité de la France pour 2014 ?
Il est important de savoir comment le Gouvernement réagit aux observations de la Commission européenne. Il est également important de savoir s’il envisage d’en contester certains aspects et si les vingt-sept autres États suivront la Commission ou préféreront un assouplissement de la discipline commune, comme nous le laissent entendre les sociaux-démocrates. Nous allons bien voir s’il ne s’agit là que de paroles…
Tout d’abord, je note que la Commission européenne retient une prévision de déficit de la France de 3, 4 % du produit intérieur brut en 2015, alors que l’objectif retenu dans le programme de stabilité est de 3 % du PIB.
Ensuite, je relève que la Commission pointe du doigt le niveau de détail insuffisant des mesures d’ajustement, ce qui ne permet pas de « garantir de façon crédible la correction du déficit excessif pour 2015 ». Ainsi, l’horrible austérité dont parlent quelques-uns ne ferait pas l’objet de mesures suffisamment étayées et documentées !
Pour ma part, je crains qu’une fois de plus nous n’ayons affaire au phénomène d’opacité – que nous connaissons bien – de la politique budgétaire de ce gouvernement. Par exemple, pour la Commission européenne, comme pour l’ensemble des observateurs de notre vie politique nationale, les mesures d’économie annoncées par le Gouvernement, qui font tant réagir ici ou là, notamment dans une certaine partie de nos hémicycles, ne sont pas suffisamment précisées et détaillées pour être crédibles. Cette opacité, mes chers collègues, me semble aggravée par l’utilisation de la notion de « solde structurel ». Permettez-moi de m’arrêter quelques instants sur cette notion, qui n’est, à mon sens, qu’un nouveau et moderne rideau de fumée.
Bien entendu, il n’est pas illégitime de raisonner en termes de solde structurel. Nous sommes d’ailleurs tenus de le faire puisque nous avons transposé en droit interne le TSCG. Toutefois, s’il fallait désormais résumer le débat sur le redressement de nos finances publiques à l’énoncé de variables macroéconomiques abstraites et au développement de raisonnements complexes en termes de croissance potentielle et d’économies par rapport à une tendance – laquelle n’est d’ailleurs même pas explicitée par le Gouvernement –, il est tout à fait clair que nous ne serions compris de personne et que nous nous rendrions complices d’un vrai recul démocratique. Or, aujourd’hui – je l’observe avec peine –, le Gouvernement se dispense de plus en plus de nous dire sur quelles hypothèses, sur quelles mesures il se fonde pour justifier la trajectoire qu’il nous propose. Il se contente de nous demander de lui faire confiance, appliquant le principe qui eut au demeurant souvent cours en matière européenne : « Circulez, il n’y a rien à voir ! »

Je vous le dis, mes chers collègues, les comptes publics et leur redressement demandent évidemment bien plus qu’un acte de foi.
D’autres sujets continuent de prêter à interrogation : quelles sont les marges de manœuvre réelles du Gouvernement pour rétablir les comptes publics à court terme ? Comme le souligne la Commission européenne, « les réformes structurelles définies dans le programme de stabilité ne prendront effet qu’à moyen terme », notamment en ce qui concerne les collectivités territoriales. Or le Président de la République et son gouvernement nous promettent un miracle de cette réforme territoriale. Il serait donc essentiel que ce gouvernement dévoile enfin une stratégie crédible et détaillée pour 2015, date à laquelle le retour sous le seuil des 3 % est espéré, et pour 2016-2017, période prévue pour atteindre l’objectif à moyen terme.
Plus généralement, faute de réformes ambitieuses et structurantes autrement qu’en paroles, la Commission européenne estime que « la viabilité à long terme des finances publiques est également préoccupante ». Que cela veut-il dire en termes concrets ? Tout simplement que nos financements sur les marchés ne seront pas toujours obtenus à des conditions aussi favorables qu’aujourd’hui. La dette continuera par exemple d’augmenter en dépit de la progression de l’objectif à moyen terme. Cela me conduit à une autre question, monsieur le secrétaire d’État : quels sont, en matière de viabilité à long terme des finances publiques, les projets du Gouvernement ? En effet, même en écoutant attentivement vos collègues, le secrétaire d’État au budget, Christian Eckert, et le ministre des finances, Michel Sapin, lors des auditions répétées et copieuses que la commission des finances a tenues, je n’ai pas le sentiment que nous ayons entendu des réponses crédibles.
Selon la Commission européenne, même les axes forts de la politique économique gouvernementale sont lacunaires. Par exemple, s’agissant de la réduction du coût du travail, la Commission indique que cette dernière, qui devrait s’élever à 30 milliards d’euros – 20 milliards d’euros pour le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, 10 milliards d’euros pour le pacte de responsabilité –, « ne comblerait qu’à moitié le fossé entre la France et la moyenne de la zone euro en termes de cotisations sociales patronales ».
Je rappelle que, dans le cadre du bilan approfondi des déséquilibres macroéconomiques, la Commission européenne a pointé du doigt la détérioration de notre balance commerciale et la compétitivité insuffisante de l’économie, en soulignant notre manque de compétitivité-coût et de compétitivité hors prix.
Alors que la Commission européenne nous avait habitués à une expression plutôt modérée, elle fait preuve, en 2014, selon ma lecture, d’une sévérité accrue à l’égard de la France, ce qui ne peut que susciter de sérieux doutes et des inquiétudes légitimes quant à la viabilité de la trajectoire budgétaire et économique que le Gouvernement propose.
Après ces différentes interrogations, je voudrais conclure mon propos par plusieurs questions : quelle est la position du Gouvernement dans le débat sur l’assouplissement des règles de stabilité budgétaire en Europe ? Monsieur le secrétaire d'État, s’agit-il de simples déclarations dominicales de sa part ou bien pense-t-il que la France peut vraiment desserrer la contrainte ? Si elle le fait, à quel prix ? Qui faut-il croire : ceux qui nous disent rechercher 50 milliards d'euros d’économie ou ceux qui laissent entendre que ces 50 milliards d’euros sont destinés à rassurer les comptables de Bruxelles, mais qu’il ne faut certainement pas réaliser un tel effort car cela pénaliserait excessivement la croissance ?
À dire une chose et à ne pas la faire, à dire une chose et son contraire, on prend des risques croissants, qui sont tout simplement, en la matière, des risques pour la crédibilité de notre pays, déjà, hélas, bien critiqué et affaibli, au point que beaucoup le considèrent aujourd'hui comme l’homme malade de l’Europe !
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.

La parole est à M. le président de la commission des affaires européennes.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous sommes tous très attachés à la tenue de ce débat préalable, qui est l’occasion d’avoir un échange avec le Gouvernement à la veille d’une échéance européenne importante. C’est également un rendez-vous qui nous permet de débattre de l’ensemble des questions relatives à la construction européenne. Au mois de mars dernier, en raison de la suspension de nos travaux, nous avions été obligés d’avoir ce débat en commission. Nous nous retrouvons aujourd’hui en séance publique, ce dont je me félicite ; je remercie la conférence des présidents de cette décision ainsi que M. le secrétaire d’État de sa disponibilité. Dans le passé, en effet, il avait été question de nous reléguer dans le « petit hémicycle ». J’espère que ce temps est révolu.
Nous débattons au lendemain d’élections européennes qui ont montré la défiance croissante de nos concitoyens à l’égard de la construction européenne. Ce constat peut malheureusement être fait dans beaucoup d’États membres. Il est donc urgent d’agir pour répondre aux attentes des peuples, combattre les populismes et rétablir un climat de confiance.
Le Conseil européen a la responsabilité de proposer un candidat à la fonction de président de la Commission européenne. Celui-ci sera ensuite élu par le Parlement européen. C’est une grande innovation du traité de Lisbonne que je veux saluer. Le Conseil européen doit respecter la volonté des citoyens qui s’est exprimée dans les urnes. C’est une exigence démocratique. Au-delà, il faudra bien entendu discuter de l’orientation des politiques européennes. Quelle Europe voulons-nous ? Quel projet devra porter la prochaine Commission ? Voilà les questions essentielles sur lesquelles je reviendrai.
Malheureusement, la situation en Ukraine continue de nous préoccuper. Notre collègue Chevènement y a fait allusion, et je partage son opinion sur plusieurs points qu’il a évoqués. C’est bien la stabilité et la sécurité de notre continent qui est en cause. Les élections du 25 mai marquent un tournant important. Les nouvelles autorités ukrainiennes ont désormais la légitimité pour agir. Quel est l’enjeu ? Il faut non seulement préserver l’unité de l’Ukraine, mais aussi respecter sa diversité. Pour cela, il faut aller vers une plus grande décentralisation – j’utilise ce terme pour ne pas en employer un autre…

Il faut travailler à réunir les conditions d’un dialogue apaisé avec la Russie. Ce dialogue est indispensable. Les tensions demeurent mais des signaux positifs ont été donnés. Un tournant s’est produit le 6 juin lors des cérémonies de commémoration du débarquement. Sous l’égide du Président Hollande, une amorce de dialogue a eu lieu entre le Président Poutine et le Président Porochenko. Le Président Poutine a également établi un contact avec le Président Obama. Il faut poursuivre dans la voie du dialogue, car la confrontation ne peut mener qu’à une impasse.
Ce Conseil européen conclura le semestre européen 2014, que la plupart des orateurs ont évoqué, en adoptant les recommandations par pays. Il est important de rappeler que si la Commission a formulé des propositions, c’est le Conseil qui adoptera les recommandations. La Commission européenne a estimé que le programme de stabilité transmis par la France était conforme à la recommandation qu’elle avait formulée. La politique de notre gouvernement va donc dans le bon sens. Il s’agit bien de réussir l’indispensable assainissement budgétaire tout en favorisant les conditions d’un retour de la croissance.
Certains collègues ont fait du « France bashing », notamment M. le président de la commission des finances, en indiquant que nous serions le malade de l’Europe.

Je le conteste ! Quoi qu’il en soit, nous n’avons pas à parler de notre pays de cette manière.
On le voit bien, l’austérité ne peut tenir lieu de politique. Le chômage, tout particulièrement celui des jeunes, atteint aujourd’hui des niveaux insupportables dans beaucoup trop d’États membres. Il faut donc mener des politiques ambitieuses sur le plan européen en faveur de la croissance et de l’emploi. La France, je le souligne, porte ce message depuis juin 2012.

De plus en plus d’États membres partagent son point de vue, mon cher collègue. La France et l’Italie ont des analyses convergentes sur cette question.

La présidence italienne qui va débuter est donc une opportunité forte de réorienter les politiques européennes.
Par ailleurs, le Conseil européen se prononcera sur les perspectives des politiques européennes en matière de liberté, de sécurité et de justice. Nous avons examiné cette question, au sein de la commission des affaires européennes, sur le rapport de notre collègue Sophie Joissains. Il y a encore beaucoup à faire pour construire un véritable espace européen. Les drames survenus en Méditerranée, Bariza Khiari y a fait allusion, sont là pour nous rappeler l’urgence de mettre en place une politique européenne d’immigration. Une solidarité concrète entre les États membres doit s’exprimer, et la préconisation du Sénat de créer un corps de gardes-frontières européen demeure plus que jamais d’actualité. Une approche globale doit permettre d’offrir un cadre pour la migration légale et renforcer la coopération avec les pays d’origine et de transit. Il faut aussi réduire les grandes disparités en Europe en matière d’asile. De même, la mise en place de bureaux européens des visas serait source d’efficacité et de simplification.
La coopération policière doit par ailleurs être renforcée pour mieux lutter contre la criminalité organisée et le terrorisme. Une délégation de notre commission a visité Europol, dont le siège est à La Haye et qui vient tout juste d’être réformée. Elle a apprécié le travail effectué. Le rôle de cette agence doit être approfondi.
Nous avons soutenu la création d’un parquet européen, mais nous nous sommes opposés au texte de la Commission qui prévoyait une formule très centralisée et, en fait, totalement irréaliste. Les parlements nationaux ont adressé un « carton jaune » à la Commission au titre de la subsidiarité, et cela n’a pas été sans résultat. La négociation au Conseil évolue dans le sens que nous souhaitions, à savoir un parquet européen, certes, mais collégial et décentralisé.
Je veux en outre insister sur la protection des données. Nous avons adopté des résolutions européennes sur la réforme de Mme Reding ; j’en étais le rapporteur. Le marché mondial des données personnelles représente sans doute des trilliards d’euros. Notre collègue Catherine Morin-Desailly nous a alertés sur le risque que l’Union européenne ne devienne une « colonie du monde numérique » ; l’expression me semble excellente. La protection des droits des personnes doit aussi constituer une priorité. L’affaire Snowden nous le rappelle, et avec quelle force ! Pourtant, on voit bien que les blocages persistent sur le texte de la Commission. Monsieur le secrétaire d’État, nous demandons au Gouvernement de défendre les positions que le Sénat a exprimées dans cette négociation
Enfin, le Conseil européen doit débattre du climat et de l’énergie. Une décision finale devrait être prise en octobre sur le cadre à retenir dans ces deux domaines à l’horizon de 2030. Le sommet des Nations unies sur le climat se tiendra en septembre ; c’est une échéance extrêmement importante.
La crise ukrainienne, que nous avons déjà évoquée, interpelle l’Union européenne sur le défi de la sécurité énergétique. Nous devons rassembler nos forces. L’Union européenne doit réduire sa dépendance à l’égard des importations d’énergie. Elle doit aussi renforcer les mécanismes d’urgence et de solidarité existants. Les risques de rupture de l’approvisionnement en gaz naturel doivent être réduits. Au-delà, chacun peut constater la nécessité d’avancer vers une intégration accrue. À la recherche de nouveaux moteurs pour sa croissance, l’Europe doit développer une politique énergétique ambitieuse. La fiscalité peut, à cet égard, jouer un rôle important. Notre collègue Bernadette Bourzai a travaillé sur cette question au sein de notre commission et nous fera des propositions mercredi prochain.
Je ne puis terminer mon intervention sans adresser quelques mots à M. le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, dont c’est le premier débat préalable au Conseil européen dans notre hémicycle, ainsi qu’à l’ensemble de nos collègues, puisque ce débat est le dernier de la mandature, des élections sénatoriales ayant lieu au mois de septembre et le prochain Conseil européen au mois d’octobre. En tant que président, je tiens à remercier les membres de la commission des affaires européennes et, au-delà, tous les sénateurs qui, en s’intéressant à l’Europe et en débattant avec le Gouvernement, la font avancer.
Applaudissements.
Je veux avant toute chose remercier M. Sutour, président de la commission des affaires européennes, d’avoir permis que ce débat puisse se tenir en séance publique, à un moment si important pour la vie du Sénat, comme il vient de le rappeler.
M. Gattolin a insisté sur l’importance toute particulière de cette réunion du Conseil européen et a mentionné de nombreux points, dont celui de la citoyenneté européenne. Il faut effectivement réconcilier les citoyens avec le projet européen. Je ne crois pas que le résultat des élections européennes mette en cause l’adhésion à l’idée européenne, à l’idée de coopération entre les nations, au projet de paix, de démocratie, de solidarité entre nos nations. Ce résultat, en revanche, en raison de l’abstention, du vote extrémiste et anti-européen dans plusieurs pays, comme l’a également souligné Mme Bariza Khiari, met certainement en cause le fonctionnement de l’Union européenne et les effets de notre action commune, en particulier face à la crise.
Nous avons tous conscience de la nécessité des changements qui doivent être apportés par les chefs d’État et de gouvernement, qui se réuniront pour désigner le prochain président de la Commission européenne et fixer la feuille de route des cinq années à venir.
M. Gattolin a notamment souligné combien il était nécessaire que la prochaine Commission européenne, qui devrait se structurer en pôles, comme nous le proposons, indique clairement que priorité est donnée à la mise en place d’une véritable politique industrielle à travers des règles de concurrence, de commerce et de fiscalité de nature à permettre l’émergence de véritables projets industriels et de véritables champions européens.
M. Gattolin a également souhaité m’interroger sur la politique européenne en matière de gaz de schiste. Comme vous le savez, monsieur le sénateur, en France, deux raisons majeures nous ont incités à interdire non pas l’exploitation, mais la technique de fracturation hydraulique, jusqu’à présent la seule connue pour exploiter ces gaz.
Tout d’abord, les impacts environnementaux de cette technique ne font aucun doute, qu’il s’agisse des volumes d’eau nécessaires, de l’injection de produits chimiques dans les nappes phréatiques, des risques de fuite de méthane dans ces mêmes nappes ou dans l’atmosphère. C’est la raison pour laquelle la France a interdit par la loi l’utilisation de cette technique sur l’ensemble de son territoire.
Ensuite, sur le plan économique, aucune étude n’a pu démontrer que l’exploitation des gaz de schiste serait rentable pour l’Europe dans son ensemble. Au contraire, il est aujourd’hui avéré que la situation américaine ne peut en aucun cas être reproduite en Europe, en raison non seulement d’un nombre moindre de gisements, mais aussi de conditions géologiques et de densité de population différentes.
Même si, comme vous le savez, nous n’avons pas la possibilité, au niveau communautaire, de remettre en cause la souveraineté de chaque État dans le choix de son bouquet énergétique – principe auquel nous sommes nous-mêmes attachés –, nous veillons à ce que la politique énergétique de l’Union européenne repose sur une diversification, sur une économie moins carbonée, sur l’efficacité énergétique et sur la montée en puissance des énergies renouvelables. Nous considérons également que le nucléaire est l’un des atouts de ce bouquet énergétique. C’est la raison pour laquelle le projet de loi sur la transition énergétique, qui vient d’être présenté en conseil des ministres, lui réserve une part importante à l’avenir. J’examinerai toutefois avec beaucoup d’attention la question de l’utilisation du programme Horizon 2020, dont l’objectif essentiel en matière énergétique est bien de contribuer à l’innovation, à la moindre émission de gaz à effet de serre et donc aux technologies durables.
M. Bizet a insisté, comme d’autres orateurs, sur la nécessité de respecter la logique du résultat de l’élection européenne. La France partage cette position : c’est à la formation politique européenne arrivée en tête, à savoir le parti populaire européen, qu’il revient de proposer son candidat à la présidence de la Commission, comme l’a souligné le Président de la République. Toutefois, monsieur le sénateur, vous conviendrez qu’il faut aussi tenir compte de l’équilibre qui s’est manifesté à l’occasion de cette élection européenne : aucune formation politique ne détient la majorité absolue à elle seule. Il faut donc aujourd’hui rassembler les Européens, en tenant compte de l’ensemble des opinions qui se sont exprimées, et faire en sorte que le nouveau président de la Commission européenne puisse lui-même rassembler une majorité au sein du Parlement européen pour que la feuille de route sur laquelle il sera investi lui permette de relever les défis communs, c’est-à-dire ceux de la croissance, de l’emploi, du dynamisme nécessaire de l’économie européenne et de sa cohésion sociale.
Le Président de la République a donc réuni samedi dernier à l’Élysée neuf chefs d’État et de gouvernement, qui sont convenus à la fois de soutenir la candidature de M. Juncker et de mandater le futur président de la Commission européenne afin de fixer une nouvelle orientation politique à l’Europe, celle de la croissance et non de l’austérité, qui ne fait qu’aggraver les risques de récession.
M. le président de la commission des finances s’exclame.
Plusieurs orateurs – M. Bizet, ainsi que MM. de Montesquiou, Chevènement et Marini – ont souhaité revenir sur les recommandations par pays de la Commission européenne dans le cadre de l’examen du semestre européen, en particulier concernant le projet de recommandation adressé par la Commission à la France après examen du programme de stabilité et du programme national de réformes.
Ce projet de recommandation, nous l’avons dit, nous paraît équilibré. La Commission valide d’ailleurs la stratégie économique du Gouvernement, puisqu’elle considère que notre programme de stabilité va dans la bonne direction et qu’il « répond globalement » à sa recommandation du 5 mars dernier.
De même, notre programme national de réformes permettra, selon la Commission, de résorber nos déséquilibres macroéconomiques. Nos stratégies économiques, détaillées dans le pacte de responsabilité et de solidarité, visent à trouver le meilleur équilibre entre la réduction des déficits – par la maîtrise de la dépense –, l’accompagnement du retour de la croissance – par une diminution des prélèvements obligatoires – et les réformes de fond qui permettront d’améliorer la compétitivité, la croissance de long terme et l’emploi.
La Commission ne remet donc pas en cause notre capacité à tenir nos objectifs de réduction des déficits publics. Elle souligne au contraire le caractère adapté et ambitieux du plan d’économies du Gouvernement. Les précisions qu’elle demande pour 2014 et pour 2015 figurent dans le projet de loi de finances rectificative et dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative qui ont été présentés en conseil des ministres les 11 et 18 juin dernier et qui seront examinés par le Parlement à partir de cette semaine. Ces deux textes détaillent les mesures nouvelles d’économies permettant de sécuriser notre objectif de finances publiques pour 2014, avec notamment plus de 4 milliards d’euros d’économies supplémentaires par rapport aux prévisions de l’automne dernier.
La Commission tient également compte de l’agenda de réformes structurelles engagées : allégement du coût du travail pour faciliter à la fois l’embauche et l’investissement, réforme du marché du travail pour améliorer le dialogue social, lutte contre les rentes abusives dans certains secteurs, choc de simplification, réforme de notre organisation territoriale, … Si M. Chevènement a rappelé à juste titre que cette dernière ne produirait d’effets qu’à moyen et long terme, elle n’en est pas moins absolument nécessaire pour des raisons d’efficacité de l’organisation de la puissance publique, y compris vis-à-vis des acteurs économiques.
L’enjeu réside désormais dans la bonne mise en œuvre de ces recommandations autour des trois piliers de notre stratégie économique : réduction de notre déficit structurel pour atteindre les 3 % de déficit total en 2015 et baisse de notre ratio de dette, car nous ne souhaitons pas que soit mise en cause notre souveraineté financière – si les taux d’intérêt sont bas, comme cela a été rappelé par plusieurs orateurs, c’est en raison de la solidité et du sérieux de la gestion de nos finances publiques –, baisse du chômage, en particulier celui des jeunes et des seniors, et amélioration de la compétitivité des entreprises avec le plan de 30 milliards d’euros d’allégement de charges au profit des entreprises, lequel s’élève à 40 milliards d’euros si l’on y ajoute l’ensemble des mesures fiscales.
M. de Montesquiou a profité de ce débat pour faire un certain nombre de remarques sur le pacte de responsabilité et de solidarité, ce qui n’entre pas, à proprement parler, dans le champ de la discussion du Conseil européen. Toutefois, je peux en convenir, tout est lié.
Au final, je retiendrai de votre intervention, monsieur le sénateur, que vous souhaitez que le pacte de responsabilité aille à la fois plus loin et plus vite. Vous en reconnaissez la bonne orientation
M. Aymeri de Montesquiou opine
Plutôt que de nous mettre en cause mutuellement pour des dépassements de vitesse quelque peu excessifs en termes de prélèvements, reconnaissons qu’aucun gouvernement n’avait adopté de mesures aussi fortes…
… en matière de baisse de fiscalité des entreprises, de soutien aux ménages modestes et d’encouragement à des réformes structurelles, qui vont permettre d’accroître la compétitivité de notre économie.
Vous le savez, nous avons eu à faire face à une situation extrêmement difficile au lendemain de la crise de 2008.
En 2011, le déficit annuel atteignait 5, 2 % du PIB. Ramené à 4, 8 % en 2012, il aura été de 4, 3 % en 2013. Notre objectif est de le porter à 3, 8 % en 2014. Un effort considérable a été demandé à nos concitoyens depuis que nous sommes aux responsabilités. Or si nous partageons l’objectif de réussite de ce pacte de responsabilité et de solidarité, nous devons ensemble dire à nos partenaires européens que la France est en train de se réformer, de se donner les moyens d’être un des acteurs du retour de la croissance en Europe et qu’elle le fait non seulement pour elle-même, pour nos concitoyens et pour nos entreprises, mais aussi pour contribuer à sortir l’Europe de la crise.
Monsieur de Montesquiou, vous m’avez également interrogé sur la situation de BNP Paribas, au regard du risque de sanction de la part des États-Unis. Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Laurent Fabius, s’est exprimé avec la plus grande clarté sur ce point. S’il y a eu faute ou infraction, il est tout à fait normal qu’une entreprise s’expose à des sanctions. Encore faut-il que celles-ci soient proportionnées et raisonnables. Or, de toute évidence, les chiffres évoqués il y a quelques semaines ne l’étaient pas. C’est la raison pour laquelle nous avons indiqué, avec la plus grande clarté, qu’au moment où nous discutons d’un partenariat commercial transatlantique, qui ne peut être fondé que sur la réciprocité, il ne peut être question d’accepter que l’avenir de l’une des plus grandes entreprises de notre pays, de l’une des plus grandes banques européennes puisse être mis en danger dans son rôle même, celui du financement de l’économie.
Nous avons fait savoir à notre partenaire, les États-Unis, que nous ferons preuve de la plus grande vigilance dans nos relations.
M. Billout est lui aussi intervenu sur les recommandations par pays pour déclarer qu’il n’accepterait pas que soient imposées à travers ces dernières des politiques de restriction sociale, de remise en cause des droits à l’assurance maladie ou des droits à la retraite. Sachez, monsieur le sénateur, qu’il n’en est pas question ! La Commission européenne n’a d’ailleurs pas le pouvoir d’imposer de telles restrictions à un pays comme la France.
Je l’ai dit, nous considérons que ces recommandations ne mettent pas en cause la politique qui est la nôtre. Nous soutenons, à la fois au plan national et au plan européen, que l’on ne sortira pas de la crise par des politiques d’austérité, par des politiques restrictives. Sur ce point, nous nous rejoignons. Il nous faut à la fois régler nos problèmes d’endettement – comme je l’ai indiqué, il y va de notre souveraineté – et soutenir l’activité.
Vous m’avez également interrogé sur la taxe sur les transactions financières.
Une étape décisive dans la mise en œuvre de la taxe sur les transactions financières vient d’être franchie lors du Conseil Ecofin du 6 mai dernier. L’accord, passé à dix États membres, est ambitieux. Nous parlions de cette taxe depuis une dizaine d’années, sinon plus ; elle devient désormais une réalité.
Tout d’abord, un calendrier a été fixé : un texte sera adopté avant la fin de l’année, en vue d’une mise en œuvre de la taxe avant le 1er janvier 2016.
Ensuite, le champ d’application de la taxe concernera non pas seulement les actions, ce qui ne posait pas de problèmes, mais aussi un certain nombre de produits dérivés. L’assiette a donc été élargie. Si l’on en juge par les réactions très négatives que cette décision du Conseil Ecofin a suscitées chez les États membres qui ne veulent pas prendre part à cette coopération renforcée – je pense en particulier au pays abritant la plus grande place financière de l’Union européenne –, il me semble que l’on a la confirmation qu’il s’agit bien là d’une percée.
Cette taxation sur les transactions financières internationales, dont la mise en œuvre vient de connaître une première étape, sera donc un outil de régulation et de redistribution, qui permettra de financer des politiques aussi bien européennes que de solidarité internationale.
Mme Khiari a insisté à son tour sur la nécessité d’abandonner les politiques d’austérité et de donner la priorité à la croissance et à l’emploi. Elle a également appelé à une nécessaire harmonisation fiscale à l’échelle européenne et mentionné en particulier les règles qui devaient s’appliquer aux grandes entreprises multinationales, dans le domaine du numérique par exemple.
Depuis son entrée en fonction, le Gouvernement agit de manière très déterminée sur le plan européen pour lutter contre l’évasion et la fraude fiscales. C’est dans cet esprit que la France, aux côtés du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de l’Espagne et de l’Italie, a demandé au printemps 2013 la mise en place d’un projet multilatéral d’échanges de renseignements, de type FATCA, ou Foreign Account Tax Compliance Act, qui puisse s’étendre ensuite aux autres États membres.
Depuis lors, de nettes avancées ont été obtenues. Le Conseil européen du 22 mai 2013 a endossé le mandat de négociation pour réviser les accords sur la fiscalité conclus entre l’Union européenne et cinq pays tiers : la Suisse, Saint-Marin, l’Andorre, Monaco et le Liechtenstein. Le Conseil européen de mars 2014 a appelé à la conclusion de ces négociations avant la fin de l’année. Des progrès ont d’ailleurs été enregistrés récemment, puisque ces pays semblent désormais prêts à accepter non seulement les amendements à la directive sur l’épargne, mais également l’échange automatique de données fiscales.
Nous avons également obtenu, grâce à une pression assez insistante, que l’Autriche et le Luxembourg lèvent leur réticence et n’usent pas de leur droit de veto pour la réforme de la directive sur la fiscalité de l’épargne. Ce faisant, ils permettent la coopération administrative, qui était jusqu’à présent bloquée. Ce texte a donc été adopté lors du Conseil européen du 24 mars, après six ans de négociations.
En outre, les ministres européens des finances ont adopté, lors du Conseil Ecofin qui s’est tenu vendredi dernier, une disposition renforçant la législation européenne de lutte contre l’optimisation fiscale pratiquée par certaines entreprises pour échapper à l’impôt, en France en particulier et en Europe en général. La directive européenne dite « mère-filiale » sera modifiée en conséquence et transposée dans les législations nationales d’ici au 31 décembre 2015.
Forte de ces avancées, l’Union européenne sera d’autant plus fondée à promouvoir, dans les instances internationales, la généralisation de l’échange automatique d’informations.
Vous avez également insisté, madame la sénatrice, sur la garantie jeunesse. Je tiens à vous informer que mon homologue italien m’a fait savoir cette semaine que la conférence sur l’emploi des jeunes, qui devait se tenir à Turin le 11 juillet prochain, serait non pas annulée mais reportée, pour pouvoir se tenir en présence des instances européennes nouvellement désignées. La conférence pourrait s’en trouver plus opérationnelle et donner lieu à un prolongement des réflexions, au-delà du seul bilan de la mise en œuvre de la garantie jeunesse, sur l’apprentissage, la formation en alternance, le soutien aux jeunes créateurs et à la mobilité des jeunes. La lutte contre le chômage des jeunes est plus que jamais une priorité absolue.
Enfin, plusieurs orateurs – M. Chevènement et M. le président de la commission des affaires européennes, notamment – ont souhaité revenir sur la situation en Ukraine.
Cette situation a commencé à évoluer avec la rencontre entre le Président Poutine et le Président Porochenko, qui a eu lieu le 6 juin dernier en Normandie, sur l’initiative de la France. Une dynamique positive de négociation a alors été enclenchée. La situation demeure néanmoins très préoccupante et instable dans l’est de l’Ukraine, en particulier dans le Donbass.
Nous attendons donc de la Russie qu’elle use de son influence auprès des séparatistes et nous appelons Kiev à faire usage de la force de manière proportionnée. La priorité, c’est la mise en place effective du cessez-le-feu, auquel a appelé le Président ukrainien, qui implique l’octroi de gages par chacune des parties : pour Kiev, l’appel au cessez-le-feu ; pour Moscou, de manière concomitante, l’appel à l’arrêt des attaques des séparatistes. Les deux parties doivent également s’engager à renforcer le contrôle des frontières, et la Russie doit retirer sa décision d’autoriser le recours à la force en Ukraine.
M. Chevènement l’a rappelé, le règlement durable de la crise passera non seulement par le dialogue entre la Russie et l’Ukraine, mais aussi par un dialogue interne à l’Ukraine, indispensable pour permettre d’engager un processus de réconciliation nationale. Ce processus a débuté le 14 mai dernier, avec la tenue de tables rondes inclusives. Malheureusement, il a été arrêté, c’est un fait, après l’élection de M. Porochenko, le 25 mai dernier.
Notre position est claire : ce processus de dialogue national doit reprendre et viser à une réforme institutionnelle, laquelle sera l’un des éléments de la stabilité du pays et devra se faire dans le respect de toutes les composantes de la population ukrainienne.
La France, vous le savez, est convaincue que son rôle, qui est aussi celui de l’Union européenne, est d’aider à l’émergence de relations de bon voisinage entre l’Union européenne et la Russie, ainsi qu’entre la Russie et l’Ukraine.
Je vois, monsieur le président, que vous m’invitez à conclure
Sourires.
; je veux donc remercier, encore une fois, les orateurs pour leurs interventions et leur indiquer que je me tiens à leur disposition pour la phase de débat à laquelle il est de coutume que le secrétaire d’État chargé des affaires européennes soit invité.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Nous allons maintenant procéder au débat interactif et spontané, dont la durée a été fixée à une heure par la conférence des présidents.
Chaque sénateur peut intervenir pendant deux minutes au maximum. S’ils sont sollicités, la commission des affaires européennes ou le Gouvernement pourront répondre.
La parole est à Mme Colette Mélot.

Je souhaite profiter de l’occasion qui m’est offerte pour aborder la question de la crise ukrainienne et de la relation entre l’Union européenne et la Russie. Ce sujet a déjà été évoqué, mais je souhaiterais qu’il puisse être approfondi.
Cette relation doit être, me semble-t-il, dépassionnée et objective.
Pour comprendre la position russe, il importe de se remémorer le discours du Président Poutine, tenu en 2007, dans lequel il déclarait que « la Russie a été et restera une grande puissance ». Depuis lors, il n’a cessé de créer les conditions lui permettant d’afficher aux yeux du monde une Russie indépendante et indispensable au règlement des crises internationales.
Jusqu’à la crise ukrainienne, nous pouvions penser que les relations entre l’Union européenne et la Russie reposaient sur le consensus, sachant que, parallèlement, la Russie continue de souhaiter bâtir son projet d’union douanière avec la Biélorussie, le Kazakhstan et à terme, peut-être, l’Arménie. Cependant, la géopolitique nous rappelle que l’Ukraine est, pour la Russie, un enjeu politique majeur. C’est une fenêtre non seulement sur l’Europe, mais aussi sur la mer Noire ; c’est une zone tampon de l’influence russe en Europe, à proximité des « conflits gelés », comme en Transnistrie, en Abkhazie et en Ossétie du Sud. Enfin, l’Ukraine est un pays de transit pour 60 % du gaz russe acheminé en Europe.
Dès lors, la vision occidentale des événements et la gestion de ces derniers par les responsables européens peuvent nous laisser dubitatifs. L’accord d’association entre l’Ukraine et l’Union européenne fut, dans un premier temps, la partie émergée de l’iceberg. En toile de fond, une crise politique intérieure a provoqué des manifestations, de la violence et un état de quasi-guerre civile.
Aujourd’hui, force est de constater que la Russie a annexé la Crimée.
Cette crise doit nous conduire à nous interroger sur la capacité de l’Union européenne à être une puissance diplomatique et militaire à même d’aider à résoudre les difficultés financières, énergétiques et économiques de l’Ukraine, sans parler de celles liées au maintien de son intégrité territoriale.
Dans ce dossier, nos amis allemands ont semblé prendre le leadership européen. Dès lors, monsieur le secrétaire d’État, ma question est triple : où en est le dialogue entre l’Union européenne et la Russie ? Dans quelle mesure la France entend-elle y participer ? Enfin, comment la France peut-elle affirmer son amitié à l’Ukraine sans altérer ses relations avec la Russie ?
Madame la sénatrice, je vous remercie de cette question très importante, qui a trait à la situation en Ukraine.
Je l’ai indiqué il y a un instant, depuis le début de cette crise, la France déploie tous ses efforts – vous n’êtes d’ailleurs pas sans savoir que le Président de la République française et la Chancelière allemande ont eu des contacts avec le Président Poutine et le Président Porochenko pas plus tard qu’à la fin de la semaine dernière – pour que l’intégrité et la souveraineté de l’Ukraine soient respectées. La France ne reconnaît d’ailleurs pas l’annexion de la Crimée.
Nous avons également fait en sorte que l’Union européenne reste unie – même si, au départ, les positions des différents États membres n’étaient pas spontanément les mêmes – et adopte une ligne de fermeté, laquelle est allée jusqu’à l’adoption de sanctions visant un certain nombre de personnalités et d’entités. En parallèle, nous avons toujours affirmé que l’objectif était de parvenir à une solution diplomatique, politique et négociée.
L’accord d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine, lequel résulte de la volonté de l’Ukraine de nouer un partenariat avec l’Union et de l’envie de l’Union de contribuer, au titre du partenariat oriental, dans le cadre de sa politique de voisinage, à la stabilité, au développement et à la démocratisation de l’Ukraine, ne doit pas être un élément de confrontation avec la Russie.
Nous ne demandons pas à l’Ukraine de choisir entre son voisin européen et son voisin russe. L’Ukraine doit pouvoir vivre en paix à l’avenir et entretenir de bonnes relations, aussi bien politiques qu’économiques, avec l’Union européenne et la Russie. C’est pourquoi nous avons demandé que soient examinées les conséquences de l’accord d’association, dans son volet commercial, sur l’économie ukrainienne comme sur l’économie russe.
Nous enjoignons – c’est tout le sens des efforts déployés par le Président de la République et ses partenaires européens – l’Ukraine et la Russie à rétablir, par la voie du dialogue politique, des relations pacifiques, y compris dans le domaine économique, notamment sur la question de l’approvisionnement gazier, qui soient de nature à profiter aux deux pays.

La Banque centrale européenne a récemment annoncé un relâchement très significatif de sa politique monétaire. Le Japon et les États-Unis avaient fait de même auparavant, avec des résultats peu opérants, qui ont eu pour effet de fragiliser le bilan des banques centrales tout en permettant, en réalité, aux opérateurs financiers de disposer de moyens pour se livrer à plus de spéculation financière et de financer les pays émergents. D’ailleurs, lorsque la Réserve fédérale américaine a annoncé un petit changement de sa politique, les effets sur ces pays ont été immédiatement visibles.
Avoir une politique moins laxiste permettrait de voir l’euro devenir, petit à petit, une monnaie de référence mondiale, ce qui éviterait des désagréments tels que ceux que rencontre aujourd’hui la BNP.
Le changement de politique de la BCE impose plus de détermination et de cohérence dans notre politique de redressement de l’économie et de l’industrie. Il faut absolument renforcer l’intérêt de l’investissement en France, dès lors que des moyens financiers nouveaux existent.
En outre, à l’heure des échanges automatiques d’informations, peut-on accepter une Union européenne à vingt-huit membres où la mobilité pour les personnes physiques et les entreprises est gérée par vingt-sept conventions fiscales ? Cette situation n’est favorable ni à la mobilité ni à l’efficacité des échanges automatiques d’informations.
Enfin, à la veille de la désignation de la nouvelle Commission européenne, la mise en place, dans la zone euro, d’un projet de grands travaux profitant des taux actuels de la BCE est absolument indispensable. Ce projet doit être engagé par la zone euro dans son ensemble, pour répondre aux enjeux ayant trait à l’avenir de l’Union européenne. En effet, des investissements en matière d’énergie, de transports ou de logements sont indispensables pour assurer la compétitivité future de la zone euro.
Une telle politique de grands travaux au niveau européen doit être le pendant des politiques d’ajustement budgétaire des États membres. Elle est indispensable non seulement pour soutenir la croissance, mais également pour permettre à la puissance publique européenne de prendre toute sa place alors que les États membres n’ont plus suffisamment de forces pour y parvenir seuls.
Comment s’assurer que la nouvelle Commission européenne mette cette politique de grands travaux en œuvre au moment où la BCE lui en donne les moyens ? Si nous ne le faisons pas, l’argent aujourd'hui mis à disposition de la BCE quittera l’Europe, ce qui nous affaiblira encore plus.
Monsieur le sénateur, vous avez souligné à juste titre l’importance des décisions que la Banque centrale européenne a annoncées le 5 juin dernier. Mario Draghi a en effet rendu public un paquet de mesures d’assouplissement monétaire d’une ampleur sans précédent. Il s’agit de dispositions à la fois conventionnelles, comme la baisse de plusieurs taux directeurs, et non conventionnelles, comme l’octroi de liquidités aux banques conditionné au financement de l’économie.
Nous avons salué une telle politique monétaire, qui répond à la fois au risque de déflation pointé par M. Chevènement – sans doute la Banque centrale européenne, qui avait fixé un objectif d’inflation de 2 %, constate-t-elle que l’inflation est aujourd'hui beaucoup plus basse dans la zone euro – et à un problème de liquidités des banques ou, plus exactement, de transmission de la politique monétaire à l’économie réelle, dans une phase où la croissance en zone euro a besoin d’être consolidée.
C’est donc une politique qui apporte un soutien bienvenu à la croissance en Europe et en France, d’autant que le niveau de l’euro, à nos yeux trop élevé, a un peu baissé après les annonces de la BCE. Cette politique favorisera également notre compétitivité et notre commerce extérieur.
L’action de la Banque centrale européenne sert ainsi les efforts de réorientation des politiques européennes vers plus de croissance et d’emploi. Cependant, elle doit s’accompagner d’autres dispositions. À cet égard, vous avez raison de souligner que nous devons avoir des mesures de soutien à l’investissement dans des grands projets communs ; je l’ai moi-même indiqué.
Dans les domaines de l’énergie, avec le financement des interconnexions, du numérique, en particulier avec l’équipement en fibre optique, ou des économies vertes, nous voulons davantage utiliser les instruments du cadre financier pluriannuel de la Banque européenne d’investissements. Je pense notamment à la mobilisation de l’épargne, comme je le soulignais précédemment.

Ce débat préalable à la réunion du Conseil européen intervient à un moment opportun, puisque l’actualité nous rappelle régulièrement les limites actuelles de la politique européenne de sécurité et de justice. Bien évidemment, je n’oublie pas la liberté, notamment la liberté de circulation, qui est aussi un acquis essentiel de l’Europe, mais prenons les choses comme elles sont et reconnaissons que, ce qui nous préoccupe aujourd’hui, ce sont davantage les conséquences que le principe en lui-même.
Je mentionnerai deux conséquences qui, bien qu’indiscutablement distinctes, trouvent leurs causes dans ce qui peut être considéré aujourd’hui comme une défaillance de l’Europe à contrôler efficacement à la fois ses frontières extérieures et la circulation sur son territoire.
La première est l’incapacité à gérer les flux migratoires, notamment lorsqu’ils sont exceptionnels, comme c’est encore le cas dans certaines zones méditerranéennes depuis l’éclatement des « printemps arabes ».
La seconde conséquence est l’incapacité à gérer la circulation d’individus dits « à risque », se déplaçant de manière préoccupante dans l’espace européen ; nous l’avons constaté encore récemment. Des ressortissants européens partent combattre à l’étranger, par exemple en Syrie ou au Mali, ou rejoignent des camps d’entraînement pour perpétrer un certain nombre d’actes à leur retour sur le sol européen.
Nous sommes aujourd’hui dans une phase décisive. Je dis cela parce que le programme de Stockholm est en voie d’achèvement, mais également parce que les événements que j’ai évoqués démontrent malheureusement que beaucoup d’actions restent encore à mener pour renforcer notre sécurité au niveau européen.
Les solutions, nous les connaissons, et elles font consensus : d’abord, une simplification, une consolidation et une application effective des textes existants ; ensuite, une augmentation du budget consacré par l’Union à la sécurité de ses frontières, qui représente actuellement seulement 0, 4 % du budget que les États-Unis dédient au même objectif ; enfin, un renforcement des échanges d’informations au niveau du recueil des données personnelles des passagers aériens, du système d’information Schengen et de l’agence Europol.
La question du devoir de réciprocité lorsqu’un des pays membres est défaillant se pose également, à la condition, désormais admise, d’être solidaires des pays les plus exposés. Je pense notamment à l’Italie, qui, du fait de sa situation géographique, supporte des flux migratoires récurrents à Lampedusa.
Les pistes, nous les connaissons ; pour la plupart, nous les approuvons. Mais, aujourd’hui, et en vue de la réunion du Conseil européen, il est indispensable que le Gouvernement puisse nous éclairer sur les positions et les propositions qu’il entend défendre dans l’intérêt de la France sur tous ces sujets.
Monsieur le sénateur, vous soulignez à juste titre l’importance qu’auront les débats du Conseil européen sur l’espace de sécurité, de liberté et de justice, ainsi que sur l’adoption du programme post-Stockholm, en particulier s’agissant de la politique de migration et de la lutte contre le terrorisme, même s’il n’y a pas forcément de lien direct entre les deux sujets.
En matière de migration, vous avez raison, on ne peut pas laisser l’Italie ou d’autres pays de la rive nord de la Méditerranée, nos voisins du sud, seuls face aux drames qui se jouent dans cette zone. La Méditerranée ne devant pas être un cimetière à ciel ouvert, l’Italie et d’autres pays ont donc pris des mesures – je pense notamment à l’opération Mare nostrum – pour venir au secours des personnes qui se retrouvent sur des bateaux.
Nous devons à la fois assurer la sécurité de nos frontières extérieures et éviter de créer un appel d’air. C’est pourquoi la réponse doit être européenne. En particulier, la montée en puissance de l’agence Frontex doit permettre, en lien avec une politique de stabilité vis-à-vis des pays de la rive sud de la Méditerranée, une mise en œuvre réelle des dispositions de retour, la conclusion d’accords avec les pays de provenance et une intensification de la lutte contre les filières et les réseaux de trafic d’êtres humains. C’est cette approche d’ensemble qui doit nous permettre de consolider l’espace Schengen, à la fois un espace de liberté de circulation et un acquis pour les citoyens, tout en assurant mieux ensemble la protection des frontières extérieures de l’Europe.
L’autre volet de la problématique migratoire, ce sont les migrations régulières, qui doivent également être bien organisées.
J’en viens à la lutte contre le terrorisme. Je vous rejoins totalement : nous devons adopter des mesures de contrôle renforcé, en particulier un PNR européen, ou Passenger name record, un système de contrôle des voyageurs du transport aérien, et rendre les échanges d’informations des fichiers des différents services beaucoup plus opérationnels qu’aujourd'hui.
La situation internationale – je pense notamment à la Syrie ou à l’Irak – ne peut que nous renforcer dans cette détermination. Vous le savez, les ministres de l’intérieur, sur l’initiative notamment de Bernard Cazeneuve, ont pris des décisions en la matière ; elles seront confirmées lors du Conseil européen.
L’Europe doit s’organiser de manière beaucoup plus opérationnelle et ferme dans la lutte coordonnée contre le terrorisme.

Monsieur le secrétaire d’État, vous avez bien fait d’évoquer l’Ukraine, qui est une question essentielle. En cette matière, il me semble nécessaire de faire preuve de bon sens et de réalisme.
D’un côté, on considère que la doctrine Monroe est tout à fait normale aux Amériques ; de l’autre, on ne s’émeut guère de l’installation en Tchéquie de fusées dirigées vers nul autre pays que la Russie… On ne proteste pas non plus contre la volonté de faire entrer la Moldavie et la Géorgie dans l’OTAN. J’ai l’impression que nous sous-traitons la politique étrangère européenne aux États-Unis. Nous nous laissons totalement guider par les Américains quant à nos positions en Ukraine.
Lorsque Mme Victoria Nuland dit « Fuck Europe », …

… est-ce que Mme Ashton proteste ? Lorsqu’il y a une conversation entre le ministre des affaires étrangères Paet et Mme Ashton avec quelques interrogations sur ce qui se passe en réalité sur la place Maïdan de Kiev, on n’en fait pas état !
J’ai vraiment l’impression que nous sommes aux ordres des Américains. Je ne fais pas preuve d’un anti-américanisme de principe, mais je veux souligner que, vis-à-vis de l’Ukraine, nous avons une position qui n’est pas européenne.
Nous sommes incapables de nous substituer aux Russes, parce que l’économie ukrainienne est totalement imbriquée avec celle de la Russie. Je comprends parfaitement les aspirations d’indépendance de l’Ukraine vis-à-vis de la Russie, mais il y a une réalité des faits. Et ce ne sont pas les 2 milliards que l’Union européenne donnera tous les ans à l’Ukraine qui résoudront le problème ! Comment réglera-t-on la question du gaz ? Prendra-t-on en compte à un moment quelconque l’hétérogénéité dans ce pays, où tout le monde ou presque parle russe et ukrainien ?
J’ai l’impression que nous subissons totalement le diktat américain s’agissant d’une sphère qui devrait être uniquement européenne. M. Snowden nous a d’ailleurs révélé des faits démontrant que le comportement des Américains vis-à-vis des divers pays européens était inacceptable. Pourtant, nous avons murmuré quelques protestations au lieu d’affirmer avec force que de telles pratiques n’étaient pas acceptables !
Monsieur le sénateur, je le répète, tous les efforts qui ont été déployés par la diplomatie française depuis le début de la crise ukrainienne visent à faire émerger une position commune des Européens et à aboutir à une résolution politique du conflit entre l’Ukraine et la Russie.
L’Ukraine est un pays indépendant. Elle a fait le choix de la démocratisation, d’un accord d’association avec l’Union européenne. Dans le même temps, elle doit avoir des relations de bon voisinage avec la Russie, y compris sur le plan économique.
Vous m’interrogez sur les rapports entre l’Ukraine et la Russie au sujet du gaz. Vous le savez, l’Ukraine a accumulé une dette considérable vis-à-vis de Gazprom ; elle devra l’honorer progressivement.
Il est dans l’intérêt de la Russie, de l’Ukraine et de l’Union européenne qu’un accord équitable soit trouvé. C’est ce à quoi œuvre, de manière totalement indépendante de quelque autre partie, la Commission européenne dans ses discussions avec la Russie et l’Ukraine ; nous ne sommes sous la tutelle ni des États-Unis ni de qui que ce soit d’autre !
En outre, et je l’ai déjà indiqué, nous sommes également favorables à des consultations trilatérales entre l’Union européenne, l’Ukraine et la Russie sur les implications de l’accord d’association vis-à-vis de l’économie russe. Nous ne souhaitons pas opposer les bonnes relations que l’Ukraine souhaite établir avec l’Union européenne à celles qu’il nous faut évidemment maintenir, ne serait-ce qu’au nom de la stabilité internationale et de la paix, avec la Russie, un grand voisin, de surcroît membre du Conseil de sécurité de l’ONU. Aussi, tous nos efforts concernent, je l’ai évoqué, les relations entre la Russie et l’Ukraine.
Nous sommes également très attentifs à ce que toutes les composantes de la population à l’intérieur de l’Ukraine, y compris les populations russophones de l’Est, soient prises en compte. Mais cela suppose tout de même que nous rappelions un certain nombre de principes : le respect de la souveraineté et de l’intégrité de l’Ukraine, l’arrêt et la condamnation des actes violents des séparatistes et la mise en œuvre effective du cessez-le-feu. C’est le sens de tous les efforts déployés par le Président de la République.

Le paquet climat-énergie 2020 fera l’objet d’une discussion importante lors du Conseil européen des 26 et 27 juin. À cette occasion, le président Herman Van Rompuy présentera un état des lieux global reprenant les analyses de chaque État membre.
Monsieur le secrétaire d’État, j’ai deux séries de questions à vous poser.
La première est la suivante : quelle feuille de route la France a-t-elle adressée à la Commission européenne ? Quels efforts cette dernière compte-t-elle réaliser ? Quel en sera le coût ? Quelle répartition sera choisie pour atteindre l’objectif de réduction des gaz à effet de serre ?
Par ailleurs, vous avez évoqué la pertinence du choix effectué voilà quelques décennies en faveur de l’énergie nucléaire. Devons-nous aller plus loin dans les énergies décarbonnées ? Si oui, comment cela est-ce possible sans nuire à la compétitivité de nos entreprises ? En effet, les choix qui seront faits en la matière seront lourds de conséquences, qu’il s’agisse des coûts ou des infrastructures de réseaux, en France et même en Europe, comme on l’a vu au travers d’un rapport que j’ai eu l’occasion de rendre au nom de la commission des affaires européennes sur la coopération énergétique franco-allemande. Réduire trop vite et trop fort la part du nucléaire dans notre mix énergétique présente un double risque : une flambée des prix et une hausse des émissions polluantes. En ce domaine, précisément, l’exemple de l’Allemagne n’est pas à suivre.
Ma seconde série de questions est donc très claire : comment assurerez-vous l’harmonisation de notre bouquet énergétique national avec les orientations de la Commission européenne et les choix de nos partenaires ? Quels seront votre calendrier, votre méthode et vos objectifs ?
Monsieur le sénateur, vous le savez, nous attachons la plus grande importance à ce que le Conseil européen de juin approuve les objectifs proposés par la Commission européenne pour le paquet énergie-climat, de telle sorte qu’une décision puisse être prise lors du Conseil européen d’octobre.
Nous faisons nôtres les propositions de la Commission : réduire de 40 % les gaz à effet de serre à l’horizon de 2030 et porter à 27 % la part des énergies renouvelables dans l’Union européenne. Dans le projet de loi de programmation sur la transition énergétique, qui a été présenté en conseil des ministres et sera bientôt débattu au Parlement, nous allons même au-delà pour ce qui concerne les énergies renouvelables.
Si nous pouvons nous fixer de tels objectifs, c’est parce que nous disposons d’un bouquet énergétique adossé sur une forte composante d’énergie nucléaire pour ce qui concerne l’électricité. De notre point de vue, cette composante doit maintenant être plafonnée. Cependant, la filière nucléaire continuera à jouer un rôle absolument majeur, puisqu’elle représentera à l’avenir 50 % de notre bouquet énergétique pour la production d’électricité.
Une telle situation nous permet, peut-être plus que d’autres, de développer les énergies renouvelables, qui sont toujours soumises au problème de l’intermittence. Je pense au solaire, à l’éolien et aux énergies hydroliennes, qui sont très prometteuses, et pour lesquelles la DCNS déploie des technologies de pointe.
Nous estimons donc que notre projet de loi de programmation sur la transition énergétique est totalement en cohérence avec les objectifs de l’Union européenne. Il nous permettra de réussir cette transition, qui doit se traduire par une montée en puissance des énergies renouvelables, une baisse des émissions de CO2, sans que les coûts des entreprises et des ménages augmentent. À cet égard, l’efficacité énergétique constitue, vous le savez, la meilleure des réponses. Elle passe par un renforcement de nos actions pour ce qui concerne le bâti, les procédés industriels et les transports.
Nous voulons que, grâce aux indications qui devront être fixées très tôt par la Commission, le Conseil européen et chacun des États membres, l’ensemble des acteurs économiques puissent se préparer à la transition énergétique.
Nous consommerons moins d’énergie ; nous consommerons une énergie plus renouvelable ; et nous développerons des technologies créatrices d’emplois, qui feront de l’Europe un continent pionnier en ce domaine, au moment où tous les pays, y compris les pays émergents, sur tous les continents, s’efforcent d’effectuer une telle transition.
Telle est la ligne de notre politique en la matière.

Personne ne demande plus la parole ?...
Nous en avons terminé avec le débat préalable à la réunion du Conseil européen des 26 et 27 juin 2014.

Par lettre en date de ce jour, le Gouvernement a demandé de compléter l’ordre du jour du jeudi 26 juin matin par l’inscription de la suite de l’examen de la proposition de loi relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques.
En conséquence, l’ordre du jour du jeudi 26 juin s’établit comme suit :
À 9 heures 30 :
- Deuxième lecture de la proposition de loi tendant à encadrer les conditions de la vente à distance des livres et habilitant le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition ;
- Suite de la proposition de loi relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques.
De 15 heures à 15 heures 45 :
- Questions cribles thématiques sur la pollution de l’air.
À 16 heures et le soir :
- Suite du projet de loi tendant à renforcer l’efficacité des sanctions pénales.
Acte est donné de cette communication.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mardi 24 juin 2014 :
À 14 heures 30 :
1. Projet de loi autorisant l’adhésion de la France à l’accord portant création de la Facilité africaine de soutien juridique (n° 403, 2013–2014) ;
Rapport de Mme Hélène Conway-Mouret, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 629, 2013-2014) ;
Texte de la commission (n° 630, 2013-2014).
2. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie portant sur l’application de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (n° 702, 2012-2013) ;
Rapport de MM. René Beaumont et Christian Cambon, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 624, 2013-2014) ;
Texte de la commission (n° 626, 2013-2014).
3. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et au statut de leurs forces (n° 701, 2012-2013) ;
Rapport de M. René Beaumont, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 627, 2013-2014) ;
Texte de la commission (n° 628, 2013-2014).
4. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kosovo relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier et de son protocole d’application (n° 699, 2012-2013) ;
Rapport de MM. René Beaumont et Christian Cambon, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 624, 2013-2014) ;
Texte de la commission (n° 625, 2013-2014).
5. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées ;
Rapport de Mme Claire-Lise Campion, rapporteur pour le Sénat (n° 631, 2013-2014) ;
Texte de la commission mixte paritaire (n° 632, 2013-2014).
Le soir :
6. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, tendant à renforcer l’efficacité des sanctions pénales (n° 596, 2013-2014) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Michel, fait au nom de la commission des lois (n° 641, tomes I et II, 2013-2014) ;
Texte de la commission (n° 642, 2013-2014).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mardi 24 juin 2014, à zéro heure cinq.