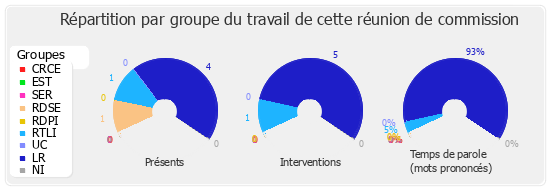Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
Réunion du 2 octobre 2012 : 1ère réunion
Sommaire
- Relations transatlantiques
- Audition de mme alexandra de hoop scheffer directrice de german marshall fund of the united states - france (voir le dossier)
- Convention du travail maritime de l'organisation internationale du travail
- Projet de loi de finances pour 2013
- Nomination d'un rapporteur (voir le dossier)
- Organismes extraparlementaires
- Questions diverses (voir le dossier)
La réunion
La commission auditionne Mme Alexandra de Hoop Scheffer, directrice du German Marshall Fund of the United States - France, sur les relations transatlantiques.

Mme Alexandra de Hoop Scheffer, que nous avons le plaisir d'accueillir, dirige le bureau français du German Marshall Fund of the United States (GMF), institution américaine, fondée en 1972 et sans affiliation partisane, dont l'objectif est de promouvoir le dialogue et de contribuer au renforcement de la coopération sur les grands enjeux transatlantiques et internationaux. Seul think tank américain présent en France au travers de son bureau parisien, le GMF vient de publier un rapport très intéressant sur les relations transatlantiques.
Avant d'en diriger le bureau parisien, Mme Alexandra de Hoop Scheffer a travaillé à la direction de la prospective du quai d'Orsay et pour le ministère de la défense. Elle a aussi été conseillère auprès du SACEUR, le commandant suprême des forces alliées en Europe, l'amiral américain James Stavridis, qui est aussi le commandant des forces américaines en Europe.
Mme Alexandra de Hoop Scheffer est une spécialiste reconnue de la politique étrangère et de la défense des Etats-Unis. Elle mène de nombreuses activités de recherche et d'enseignement donnant lieu à la publication d'un grand nombre d'articles ou d'études.
Nous souhaiterions vous entendre en particulier sur le bilan du mandat de Barack Obama et les évolutions possibles dans la perspective des prochaines élections présidentielles - ici, il serait élu à la quasi-unanimité. Que faut-il penser du bilan de Barack Obama en matière de politique étrangère et de défense ? Comment expliquer l'absence de ces questions dans la campagne présidentielle, et faut-il s'attendre à des évolutions en cas de victoire des républicains ? Après une période assez interventionniste, assiste-t-on à un mouvement vers plus d'isolationnisme, comme cela a souvent été le cas ?
Pourriez-vous aussi nous éclairer sur la nouvelle stratégie américaine de recentrage sur l'Asie Pacifique et sur l'appel lancé aux Européens afin qu'ils assurent leur propre sécurité ? Je note toutefois que si, l'an dernier, l'opinion américaine souhaitait ce mouvement vers l'Asie Pacifique, elle se prononce désormais fortement en faveur d'un recentrage sur l'Europe.
Les Etats-Unis considèrent-ils la Chine comme le principal enjeu, voire comme une menace, et l'Asie comme une source potentielle de tensions à la lumière notamment des récents événements en mer de Chine ? Que faut-il penser de l'approche américaine à l'égard du Proche et du Moyen-Orient ? Après le discours du Caire, et malgré les espoirs suscités par le printemps arabe, comment expliquer l'échec américain dans le dossier israélo-palestinien ? Les Etats-Unis pourront-ils résister longtemps aux pressions israéliennes en faveur d'éventuelles frappes préventives contre l'Iran ? Enfin, qu'en est-il de la réduction du budget de la défense que nous avons cependant jugée mineure dans la mesure où, si l'on en retranche les dépenses liées aux opérations Afghanistan, il reste en augmentation ? Quelles sont ses conséquences possibles pour l'OTAN et les Européens, par exemple en ce qui concerne le stationnement des forces américaines en Europe ou les industries de défense, sujet qui nous importe beaucoup ?
Je vous remercie, Monsieur le Président, de cette présentation et d'avoir bien voulu me donner cette opportunité d'aborder avec la Commission le sujet des relations transatlantiques et de la politique étrangère américaine dans une optique à la fois de bilan du premier mandat du président Barack Obama et d'exercice prospectif, dans le contexte des prochaines élections américaines.
Comme vous l'avez annoncé dans votre propos introductif, le German Marshall Fund of the United States (GMF) vient de publier son rapport annuel Transatlantic Trends, une étude qui s'appuie sur des sondages d'opinion effectués aux Etats-Unis, dans douze pays de l'Union européenne, en Russie et en Turquie. Ces regards croisés des opinions américaines et européennes sur les questions économiques, sociales et géopolitiques offrent une grille de lecture des grandes tendances qui marquent les relations transatlantiques. Le rapport de cette année revient en particulier sur le bilan du premier mandat du Président Barack Obama et sur les enjeux internationaux qui ont marqué l'année 2012, dans un contexte où l'effet Obama perdure en Europe, et ce tout particulièrement en France. Permettez-moi de me servir de quelques tendances fortes qui se dégagent de ce rapport sur l'état de la relation transatlantique et les questions de politique étrangère, pour introduire les points que vous avez soulevés dans vos questions.
Tout d'abord, le rapport envoie un signal rassurant quant à l'état des relations transatlantiques, dont la solidité n'est pas affectée par le « rééquilibrage » stratégique des Etats-Unis vers l'Asie. La crise économique et les crises géopolitiques semblent avoir renforcé les liens entre les deux côtés de l'Atlantique : les opinions publiques souhaitent le renforcement d'une coopération fondée sur des valeurs et des intérêts communs - c'est le cas pour trois quarts des Français interrogés. Américains et Européens espèrent aussi un leadership fort des Etats-Unis et de l'Union européenne dans les affaires internationales, ce qui était moins le cas pendant les années Bush.
A l'approche des élections américaines, les Européens continuent d'approuver la politique étrangère de Barack Obama (sur des sujets comme l'Afghanistan, l'Iran ou la Russie), malgré des résultats en baisse depuis la première année de son mandat. Ils sont 71 % - une proportion stable par rapport à 2011 - à approuver sa politique de lutte contre le terrorisme.
Surtout, l'on observe une convergence croissante des opinions américaine et européenne sur l'ensemble des grands dossiers de politique étrangère.
S'il existe une adhésion très large au principe de la « responsabilité de protéger », l'opinion publique transatlantique s'oppose majoritairement à l'idée d'une intervention militaire en Syrie (défavorable à 59 % pour l'Union Européenne, et à 55 % aux États-Unis). De même, si les Américains se déclarent plus en faveur (18 %) que les Européens (7 % en moyenne, et 10 % en France) d'une option militaire afin d'empêcher l'Iran d'obtenir la bombe nucléaire en cas d'échec de toutes les autres options non-militaires, le recours à des sanctions économiques reste pour les Etats-Unis l'instrument privilégié (32 %) tandis que les Européens privilégient eux les incitations économiques (34 %). Un exemple particulièrement intéressant de cette convergence croissante : 53 % des Européens se disent favorables au retrait total des troupes d'Afghanistan, un chiffre qui atteint les 44 % aux Etats-Unis, alors qu'il n'était que de 35 % en 2011.
Une importante majorité des Européens interrogés (58 %) continue de considérer l'OTAN comme essentielle pour leur sécurité nationale (dont 60 % des Français). Une majorité d'Américains partage cet avis (56 %), bien que le partage des tâches et du financement de l'Alliance continue de faire débat, et que le soutien de l'opinion publique envers l'OTAN ait diminué aux États-Unis de 6 points depuis 2011.
On remarque enfin que seulement 32 % des Américains et 39 % des Européens (38 % des Français) souhaitent une baisse des dépenses militaires. En revanche, lorsque l'on demande aux Européens si le rééquilibrage américain en faveur de l'Asie justifie une augmentation des dépenses militaires de leurs pays, ils répondent majoritairement par la négative. Ces grandes tendances transatlantiques permettent de saisir le contexte du bilan de Barack Obama en matière de politique étrangère et de défense.
1 - Un bilan de la politique étrangère de Barack Obama
Le fil conducteur du premier mandat de Barack Obama a été exprimé de façon particulièrement claire lorsque, le 1er décembre 2009, tout en annonçant le déploiement de 30 000 militaires supplémentaires en Afghanistan, il a déclaré : « la nation que je tiens le plus à bâtir est la nôtre ». La tension constante entre urgences intérieures et défis extérieurs explique pour une large part les orientations et les réorientations de la politique du président américain.
L'économie est plus que jamais une question de sécurité nationale, la dette publique constituant, selon les mots de l'ancien secrétaire à la défense, Robert Gates, dans ses discours d'adieu de 2011, la plus grave menace pour le pays - la dette américaine dépasse les 16 000 milliards de dollars en 2012. La priorité donnée à la réduction des dépenses publiques a beaucoup pesé sur la décision de retirer les troupes américaines d'Irak ou sur l'accélération de la phase de transition en Afghanistan. Il s'agit de gérer l'urgence et les conséquences de la crise économique et financière qui exigent une forte concentration de l'action publique sur les problèmes intérieurs et une réduction concomitante des budgets consacrés à l'action extérieure, tout en veillant à ne pas soustraire les Etats-Unis de leurs responsabilités internationales. Réduire les engagements militaires américains à court et moyen terme pour reconstruire une Amérique économiquement plus forte sur le long terme, tel est le fondement de la politique actuelle.
Rattrapé par le printemps arabe et confronté au refus de coopération de gouvernements auxquels il a tendu la main et à l'émergence de puissances déployant des stratégies de blocage au sein du conseil de sécurité de l'ONU, Barack Obama est très vite revenu à une posture plus pragmatique qu'en 2008. Tout comme il a surestimé sa capacité à « changer Washington », il a aussi surestimé sa capacité à changer l'attitude de certains acteurs de la scène internationale et à modifier l'image des Etats-Unis dans le monde. Ses premières décisions doivent être analysées au prisme de cette volonté de changement.
Or l'héritage de Bush a continué à peser de manière significative sur la vision que l'opinion publique, en particulier au Moyen-Orient, porte sur les Etats-Unis. Paradoxalement, alors que le début de son mandat avait été marqué par le discours du Caire appelant à la réconciliation avec le monde arabo-musulman, il s'achève sur des manifestations partout dans le monde qui, sous prétexte de manifester contre un film islamophobe, remettent en cause l'hégémonie américaine et dénoncent l'échec de sa diplomatie au Proche et au Moyen-Orient.
Conscient des limites des moyens et de l'influence des Etats-Unis dans le monde dès sa campagne de 2008, Obama l'est encore plus à la fin de son mandat. Cette posture réaliste est, en période d'élections, dénoncée par les républicains et les commentateurs néoconservateurs comme décliniste. A l'inverse, Mitt Romney se présente comme le candidat du renouveau du leadership américain, mais peine à convaincre une Amérique moins interventionniste, fatiguée par plus de dix années de « guerre contre le terrorisme ».
En réalité, la politique étrangère d'Obama se conçoit et se déploie dans un double contexte contraignant : la première contrainte, géopolitique, résulte de la guerre en Irak et, surtout, de ses implications durables pour le soft power américain, ayant renforcé l'anti-américanisme partout dans le monde et en particulier dans la région du Moyen-Orient. La seconde est d'ordre économique : les Etats-Unis n'ont plus les moyens d'une politique étrangère ambitieuse. Lorsque Mitt Romney déclare qu'il remontera la base du budget de la défense à un minimum de 4 % du PIB, c'est impossible ; cela représenterait une augmentation d'environ 2 000 milliards de dollars sur les dix prochaines années par rapport au plan d'Obama. La dernière fois que la base du budget de la défense américain représentait 4 % du PIB, c'était en 1992. A noter que même sous G.W. Bush, la base du budget de défense (excluant les opérations en Irak et en Afghanistan) représentait en moyenne 3,3% du PIB américain. Enfin, la réduction du budget de la défense préconisée par l'administration Obama est à relativiser, représentant une baisse de seulement 1,6 % du budget de base du Pentagone sur les cinq années à venir. Ainsi, Barack Obama ne propose pas de réductions nettes du budget militaire américain, mais simplement un ralentissement du rythme de la hausse des dépenses, ainsi qu'une revue à la baisse des objectifs stratégiques. Dorénavant, l'objectif du Pentagone ne sera plus que de gagner deux guerres simultanées (win-win), mais de gagner un front tout en restant capable de contenir un autre adversaire sur un second front (win-spoil) et en menant un nombre limité d'opérations.
La plupart des initiatives prises par l'administration Obama dès la première année de son mandat, se sont soldées par des échecs stratégiques : le partenariat avec la Chine ; la relance des relations avec la Russie - le reset - ; les ouvertures envers le régime iranien ; la politique au Proche-Orient ; la politique contradictoire du renfort et du retrait militaires en Afghanistan ; enfin le discours d'ouverture envers le monde musulman s'est traduit par une politique du tâtonnement et sélective. Les limites de ces ouvertures diplomatiques résident dans la fragilité même d'une politique qui parie sur la coopération de l'autre. Or, face au refus de ces pays à coopérer, Barack Obama a très vite mis de côté la teneur progressiste de son programme de campagne en adoptant une politique beaucoup plus ferme à l'égard de l'Iran et de la Corée du Nord, mais aussi vis-à-vis de la Chine et de la Russie. En Chine, l'époque de la « coopération pragmatique » et de la « réassurance stratégique » entamée par Obama en 2009, est révolue. Le refus de la Chine à agir de manière responsable dans sa région et au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, les tensions en 2010-2011 entre la Chine, le Japon, les Philippines, la Corée du Sud et le Vietnam, ont contribué au durcissement de la politique américaine. Au Proche-Orient, alors que Barack Obama avait présenté la résolution du conflit israélo-palestinien par une solution à deux Etats comme l'un des grands objectifs de sa première année de présidence, il a dû abandonner dès la fin de l'année 2010 l'idée d'obtenir un gel de la colonisation israélienne en Cisjordanie afin de relancer les négociations, se heurtant au refus catégorique d'Israël.
Le paradoxe de la politique étrangère de Barack Obama est qu'il a poursuivi en grande partie la politique du second mandat de son prédécesseur, y compris en renforçant la lutte contre le terrorisme et le recours aux drones et obtient en fin de compte parfois plus de soutien dans le camp républicain qu'au sein de sa base électorale. C'est le cas pour le renfort militaire (surge) en Afghanistan ; le renforcement des sanctions contre l'Iran ; la ratification des traités de libre-échange avec la Corée du Sud et la Colombie négociés par les républicains.
2 - Le rééquilibrage de la politique étrangère américaine et l'avenir du leadership des Etats-Unis
Toute la politique étrangère et de défense de l'administration Obama tient en un mot : le rééquilibrage. Ce rééquilibrage, initialement désigné d'après la métaphore sportive de « pivot », est appelé à se poursuivre. Il porte tout d'abord sur les priorités géostratégiques, l'accent étant clairement mis sur l'Asie Pacifique et non plus sur l'Europe, ce qui n'est pas nouveau en soi.
Rééquilibrage, également, des instruments de la politique étrangère, en sortant du tout militaire pour privilégier la diplomatie, l'aide au développement, la formation de forces étrangères, les sanctions économiques ou le recours aux drones au lieu de déployer de larges contingents à l'étranger. Sur l'Iran par exemple, malgré la forte pression du premier ministre israélien, Barack Obama donne la priorité à la diplomatie, dans une optique de double prévention, à la fois d'un Iran nucléaire et de frappes militaires israéliennes.
Par ce rééquilibrage, Obama redéfinit le leadership américain. La Libye en a été l'illustration, même si l'expression de « leading from behind », autre expression malheureuse reprise par la presse, ne traduit qu'imparfaitement la réalité. Dans des situations de conflit où leurs intérêts vitaux ne sont pas en cause, les Etats-Unis ne prennent pas le leadership des opérations militaires, mais le délèguent, voire le transfèrent à leurs partenaires. A l'heure des réductions budgétaires, leadership et partenariats vont de pair et ce de manière croissante : pour Obama, le vrai leadership doit créer les conditions et les coalitions pour que les autres contribuent au règlement des crises : c'est grâce à des partenariats solides partout dans le monde que les Etats-Unis pourront maintenir leur leadership.
Le président Obama l'a bien compris, le leadership des Etats-Unis n'est plus un acquis et sera de plus en plus contesté et concurrencé, mais il sera aussi de plus en plus nécessaire et dépendant d'autant plus d'alliances solides et renouvelées. Une réflexion plus large sur l'avenir du leadership des Etats-Unis d'ici 2030 est d'ailleurs actuellement menée par le National Intelligence Council, dans le cadre de la préparation du rapport Global Trends 2030. La volonté de « maintenir » le leadership américain, et non plus de l'imposer, est devenue un principe fondateur de la politique étrangère et de défense de l'administration Obama. En témoigne l'intitulé, Sustaining the United States Global Leadership, donné à la nouvelle stratégie de défense exposée en janvier dernier. A l'inverse, Mitt Romney, qui réaffirme l'idée du « siècle américain », promet le retour d'un leadership fort et plus ferme. Or, la conception de Mitt Romney ne prend pas en compte ce qui est sans doute le plus grand défi stratégique pour les Etats-Unis mais aussi leurs alliés européens, à savoir qu'ils seront économiquement de plus en plus dépendants d'Etats (en premier lieu la Chine) qui risqueraient de leur poser des menaces d'ordre sécuritaire. C'est pour cette raison que les solutions simples du passé, comme l'endiguement, ne seront plus possibles. La communauté transatlantique devra donc développer de nouvelles solutions stratégiques lui permettant de bénéficier des relations économiques avec tous les Etats, y compris des potentiels adversaires, tout en empêchant ces rivaux de menacer ses intérêts sécuritaires, y compris en faisant jouer le rapport de forces entre alliés.
3 - La place de la politique étrangère dans la campagne présidentielle américaine
Certes, les élections ne se jouent pas sur les questions de politique étrangère, mais sur les enjeux socio-économiques internes aux Etats-Unis, prioritaires pour les Américains (chômage, emploi, etc.). Mais cela ne signifie pas pour autant que les questions de politique étrangère soient complètement absentes de la campagne électorale.
Quelques sujets internationaux ont marqués la campagne de 2012 :
Le thème du déclin des Etats-Unis. Romney reproche à Obama d'avoir contribué à affaiblir le leadership des Etats-Unis (en déléguant à la France et au Royaume-Uni en Libye ; en tendant la main naïvement à l'Iran, la Syrie, la Corée du Nord, la Chine et la Russie en début de mandat ; en s'excusant trop, notamment auprès des pays du Moyen-Orient et Afrique du Nord pour les erreurs du passé). Il s'est d'ailleurs servi du thème de son ouvrage Pas de repentance : les raisons de la grandeur de l'Amérique, (2010), pour formuler ses principales critiques envers Obama.
Le budget de la défense que Romney souhaiterait ramener à 4 % du PIB s'il est réélu, accusant Obama de mettre en péril la sécurité nationale en incluant des coupes dans le budget de défense dans son plan de réduction de la dette publique.
Le dossier nucléaire iranien au travers des pressions que le Premier ministre israélien a exercé auprès d'Obama et de sa proximité affichée avec Romney. Les pressions israéliennes à propos de l'Iran rappellent celles de 2008 et sont représentatives d'un phénomène de conjoncture plus directement lié à la période électorale américaine caractérisée par une certaine fragilité du leadership américain à un moment où chaque décision prise par le président sortant est amplifiée politiquement et peut jouer contre sa réélection si elle est perçue négativement par l'opinion américaine. De même, la façon dont la Chine teste la volonté de réengagement des Etats-Unis en Asie et en Mer de Chine, et la décision du Président russe de réactiver les tensions russo-américaines en interdisant l'action de l'USAID dans son pays à partir du 1er octobre 2012, sont à la fois des défis au leadership américain et des signaux adressés à Washington pour la période qui suivra.
L'appropriation des questions de politique étrangère par le parti démocrate est notable dans cette campagne. Alors que les républicains avaient traditionnellement l'initiative sur les sujets de sécurité et défense internationales, les démocrates se sont réapproprié ces thèmes, et font désormais valoir leur approche et savoir-faire, en mettant en avant la fermeté de leur approche de la lutte contre le terrorisme culminant dans la mort de Ben Laden, principal succès du mandat de Barack Obama et qu'il n'hésite pas à rappeler dans chacun de ses discours de politique étrangère.
Romney souffre d'un lourd handicap : l'héritage de G.W. Bush duquel il est difficilement dissociable, en particulier parce qu'il s'est entouré d'anciens conseillers de G.W. Bush dans son équipe de campagne, dont beaucoup ont oeuvré à l'intervention en Irak de 2003. L'ancien président Bill Clinton a d'ailleurs tout particulièrement insisté sur ce point à la Convention démocrate de Charlotte, en Caroline du Nord : si Romney est élu, les Etats-Unis reviennent quatre années en arrière. Ainsi, bien qu'ils tentent d'utiliser les évènements au Moyen-Orient et la question de l'Iran nucléaire pour attaquer la politique d'Obama, les Républicains ne souhaitent pas particulièrement entrer dans un débat sur les questions de politique étrangère, n'ayant pas de politique cohérente et unifiée à offrir. La tonalité néoconservatrice de ses postures est en décalage avec une Amérique peu disposée à entrer dans une nouvelle ère d'interventionnisme.
Par ailleurs, je ne soutiens pas la thèse d'un retour à l'isolationnisme. En revanche, la politique étrangère américaine devrait être plus prudente et plus consciente de ses limites, à la fois en termes de moyens et de capacité à peser sur les événements, même si là encore des surprises stratégiques peuvent toujours survenir, obligeant les Etats-Unis à devoir se réengager, y compris de manière prépondérante, dans le cas où leurs intérêts vitaux seraient en jeu. A ce titre, il convient de ne pas perdre de vue les risques actuels en mer de Chine.
4 - Les implications du rééquilibrage américain vers l'Asie pour l'Europe
Le rééquilibrage vers l'Asie s'est fait sans l'Europe mais non contre l'Europe, même si, en février 2012, la secrétaire d'Etat Hillary Clinton a annoncé une baisse de 18 % des dépenses du Département d'Etat affecté à l'Europe, l'Eurasie et à l'Asie centrale, au profit de régions où les priorités sont plus urgentes et ce en priorité en Asie.
Cela n'est pas nouveau car, lorsque j'étais à la direction de la Prospective du Quai d'Orsay et que j'interrogeais mes interlocuteurs américains au département d'Etat sur le temps de travail quotidien qu'ils consacraient à l'Europe, celui-ci était très faible, consacrant leur temps davantage à la Turquie, la Russie, aux Balkans et au Caucase qu'à l'Europe occidentale. Barack Obama est sans doute le président américain qui l'a signifiée de la façon la plus nette.
Dans la mesure où il fait l'objet d'un consensus bipartisan, ce rééquilibrage devrait se poursuivre quel que soit le résultat des élections. Les Etats-Unis continueront à accorder une grande importance à la prévention d'une éventuelle confrontation avec la Chine. Ils ont d'ores et déjà commencé à renforcer les liens avec les pays de la région - le Japon, l'Australie, les Philippines, le Vietnam et Singapour - et à s'investir davantage dans les organisations régionales, de façon à contrebalancer l'influence de la puissance chinoise. Il s'agit ainsi d'un double rééquilibrage : des ressources militaires américaines d'autres régions vers l'Asie d'une part et rééquilibrage au sein de la région Asie-Pacifique, en réduisant la concentration des forces en Asie du Nord-Est pour les distribuer au travers de toute la région. Ainsi, l'annonce du rééquilibrage vers l'Asie s'accompagne de la décision de retirer deux brigades stationnées en Allemagne et de compenser par des unités américaines rotatives pour des exercices et des missions de formation.
Mais, le rééquilibrage des Etats-Unis vers l'Asie ne s'accompagne pas d'une vision stratégique cohérente et bien définie pour l'instant, elle s'affinera dans les quatre années à venir ; les initiatives demeurent symboliques, comme le déploiement de 2 500 Marines en Australie ou le nouvel investissement dans les organisations régionales asiatiques. La politique étrangère du prochain président des Etats-Unis sera jugée en grande partie en fonction de sa manière de gérer sa relation avec la Chine, sachant que les pays de l'ASEAN et l'Australie ne veulent pas choisir entre les Etats-Unis et la Chine (la Chine est le partenaire commercial le plus important de l'Australie) et rejettent une approche sur-militarisée de la région.
Quelles implications cela pourrait-il avoir pour l'Europe ? Washington attend des Européens qu'ils clarifient leurs intérêts en Asie pour entamer un dialogue et une coopération transatlantique plus que nécessaire sur les questions de sécurité maritime et de coopération économique dans la région. On peut dire que le rééquilibrage américain vers l'Asie est en partie dépendant de la capacité de l'UE à acquérir une plus grande autonomie stratégique, à s'occuper de ses voisinages est-européen, méditerranéen et nord-africain et à réfléchir collectivement à sa politique étrangère et de défense. Or, la Libye montre que les Européens n'ont pas de vision commune des crises. L'intervention militaire en Libye est un précurseur de tendances futures: les Etats-Unis ne prendront pas le leadership d'opérations militaires qu'ils estiment relever des intérêts européens avant les leurs, tandis que les Européens resteront dépendants des Etats-Unis pour pallier leurs déficiences capacitaires ; la Libye pourrait ainsi être le nouveau modèle et non l'exception pour le partenariat stratégique Etats-Unis-UE. De même, la phase de transition et le retrait des troupes d'Afghanistan devraient être l'occasion de réfléchir à la nature et l'étendue même de la mission FIAS et aux missions futures l'OTAN de manière générale.
Certes, Washington continuera à accorder une place secondaire à l'UE dans sa vision stratégique du monde, mais continuera à se tourner vers elle ponctuellement pour formuler et coordonner des réponses face à des enjeux sécuritaires qui rassemblent les Européens autour d'une position commune (sanctions contre l'Iran et la Syrie par exemple). Les menaces sont multidimensionnelles et globales : le Sahel, l'Iran et le Caucase présentent des menaces immédiates ; les crises potentielles sont nombreuses (Inde-Pakistan, Taiwan et Chine) ; les défis économiques et politiques (contraintes financières et volonté politique) limitent l'action extérieure ; tandis que les potentiels « vides » ne permettent pas d'anticiper les évolutions de l'ordre international, avec le risque que les pays occidentaux continuent à perdre leur capacité et leur volonté de façonner l'ordre international, alors que les puissances émergentes ne proposent pour l'instant aucune alternative.
Or, les Etats-Unis souhaitent une UE plus forte et unie à un moment où elle est concentrée sur la gestion de la crise et divisée sur les questions de politique étrangère et de défense. Le paradoxe est le suivant : le partenariat transatlantique est plus que jamais nécessaire pour répondre aux défis internationaux - et les récentes opérations militaires devraient être porteuses de leçons apprises -, mais il est aussi devenu de plus en plus insuffisant pour Washington qui cherche à élargir ses partenariats extra-européens à l'OTAN et en Asie.
Un consensus est dorénavant partagé des deux côtés de l'Atlantique autour d'une coopération sélective comme format de coopération transatlantique : celle-ci se fait de manière ad hoc et à géométrie variable (whatever works) avec de plus en plus une volonté d'inclure des alliés régionaux pour apporter plus de légitimité et « désoccidentaliser » les décisions politiques. Le format importe peu pour Washington, du moment que la coalition formée donne des résultats. En même temps, l'administration Obama se rend compte qu'elle ne peut pas toujours déléguer à d'autres sur un certain nombre de dossiers, notamment au Moyen-Orient où les tentatives de régionalisation de la gestion des crises par le biais du relais turc ont échoué.
Le rééquilibrage des Etats-Unis vers l'Asie implique aussi un rôle moins prédominant des Etats-Unis au sein de l'OTAN ; comme le souligne les travaux préparatifs du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, cela devrait permettre aux Européens de renforcer leur poids politique face aux Etats-Unis au sein de l'Alliance. Mais cette évolution ne pourra avoir lieu que si elle s'appuie sur des contributions financières et militaires crédibles. Les concepts de « smart defense » et de « force connectées » sont devenus au sein de l'OTAN des formules qui doivent permettre d'optimiser la mise en commun des capacités de défense transatlantiques et tirer les leçons de Libye, mais ces initiatives doivent s'appuyer sur un recours équilibré aux industries de défense américaines et européennes. Au terme du partage géographique des rôles clairement indiqué dans la nouvelle stratégie de défense américaine énoncée début janvier 2012, les Etats-Unis sont dans un moment d'infléchissement stratégique : après une décennie de « guerre contre le terrorisme » et d'opérations de contre-insurrection en Irak et en Afghanistan, maintenant est venu le moment de se refocaliser sur les défis sécuritaires post-Irak et post-Afghanistan, en se concentrant sur l'Asie-Pacifique et la sécurité de la région du Golfe au Moyen-Orient. Dans cette optique, le cas de la Libye n'a donc rien d'exceptionnel ; il est plutôt annonciateur de cette nouvelle répartition. Toutefois, les Etats-Unis continueront à intervenir de manière ponctuelle et limitée dans la Corne de l'Afrique (Somalie) et au Sahel pour lutter contre le terrorisme.

Les Américains viennent d'annoncer qu'ils apporteraient leur aide au Mali, ce qui va dans ce sens.
Tout à fait.
5 - L'impasse du Proche-Orient ; la problématique iranienne
Au Proche-Orient, l'administration Obama reconnaît son échec, alors même que le président s'y est personnellement impliqué. Cet échec s'est très vite manifesté par un double contournement de la politique américaine : d'une part, par le Premier ministre israélien qui n'hésite pas à instrumentaliser le Congrès - le plus pro-israélien de toute l'histoire américaine - contre le président Obama, pour en faire un instrument de pression et de blocage potentiel de l'action du président, et, d'autre part, celui du Président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui a recouru directement au Conseil de sécurité des Nations unies pour réclamer le statut d'Etat membre de l'ONU et aujourd'hui d'Etat non-membre.
La marge de manoeuvre du président américain s'est rapidement trouvée réduite. Netanyahu n'est-il pas parvenu à ce que le dossier iranien éclipse quasiment le conflit israélo-palestinien au sein de l'Assemblée générale des Nations unies ? On est ici loin de la smart diplomacy promue par l'administration Obama en début de mandat : Hillary Clinton avait dès 2009, tenté de lier les dossiers israélo-palestinien et iranien : si Netanyahu reprenait les négociations de paix, alors il pourrait bénéficier du soutien des pays arabes face à l'Iran. Barack Obama se démarquait de son prédécesseur, en adoptant une approche holistique des crises de la région du Moyen-Orient, au détriment d'une lecture compartimentée des dossiers. La nomination de George Mitchell comme envoyé spécial au Proche-Orient semblait alors confirmer cet infléchissement. Mais les négociations diplomatiques que le diplomate espérait entamer, n'ont jamais eu lieu.
Exiger des Israéliens un gel des colonisations dès le discours du Caire, sans obtenir de garanties préalables de leur part à ce sujet, a été une erreur politique de Barack Obama et qui au lieu de restaurer la crédibilité américaine sur ce dossier, l'a érodée. Dès novembre 2009, la secrétaire d'Etat américaine estime que l'arrêt de la construction des colonies n'a jamais été une précondition. Le veto américain de février 2011 pour bloquer un projet de résolution (soutenue par 14 membres du Conseil de sécurité de l'ONU) dénonçant la politique de colonisation d'Israël, a contribué à isoler les Etats-Unis et à les distancier de leurs alliés les plus proches (France, Grande-Bretagne et Allemagne).
Si Obama avait présenté la reprise des pourparlers de paix comme le point de départ du déblocage d'un bon nombre de dossiers dans la région, c'est finalement le « printemps arabe » qui rappelle la nécessité d'apporter une réponse à ce conflit. Or, là aussi, si, pour Obama, l'objectif était de crédibiliser son propos plus large de soutien des révoltes arabes et de proclamer la volonté des Etats-Unis d'un « reset » de leur politique au Proche-Orient, en appelant à la création d'un Etat palestinien sur la base des frontières de 1967 (même si cette posture n'était pas nouvelle en soi, car déjà soutenue par ses prédécesseurs), l'échec de la politique américaine est très fortement ressenti au sein de l'opinion arabo-musulmane qui continue de porter une vision très majoritairement négative sur le leadership des Etats-Unis dans la région. Selon un sondage du Gallup, seulement 20 % des adultes interrogés dans douze pays de la région approuvent la politique de Barack Obama, ce chiffre n'ayant cessé de baisser depuis 2009.
Sur l'Iran, Barack Obama a clairement signifié qu'il ne tolérerait pas un Iran doté de l'arme nucléaire et agirait, y compris par la force militaire si nécessaire, pour prévenir un tel scénario, et par là-même ne pratique pas une politique d'endiguement, mais une politique de prévention, je dirai même de double prévention, d'un Iran nucléaire et d'éventuelles frappes préventives israéliennes. La réalité de la détérioration de la relation personnelle entre Obama et Netanyahu, les pressions du Congrès et les promesses déçues, font souvent oublier que l'administration Obama a accru son aide militaire à Israël chaque année depuis 2009, fournissant près de 10 milliards de dollars sur trois années - soit un cinquième du budget de la défense israélienne - et renforcé la coopération dans domaine de la défense.
Aux Etats-Unis, l'électorat juif, traditionnellement démocrate, n'est pas affecté par les questions de politique étrangère : les derniers sondages montrent qu'entre 65 %-70 % des Juifs aux Etats-Unis voteront pour Obama, contre 25-30 % pour Mitt Romney, sachant que ce qui les préoccupe en premier lieu, est la situation économique, la réforme de l'assurance santé et le projet de loi sur l'avortement, bien avant l'état des relations Etats-Unis-Israël et le conflit israélo-palestinien sur lequel les juifs américains portent des avis partagés.
6 - Une sélectivité inévitable face aux révoltes arabes
Lorsque l'on examine la politique américaine face aux révoltes arabes, l'on est loin du discours du Caire de juin 2009. Mais qui aurait pu respecter les principes qu'il énonçait ? La politique américaine dans la région est nécessairement sélective, et il est impossible de concilier soutien à la démocratie et stabilité régionale. Aussi, l'administration Obama a-t-elle oscillé entre trois politiques différentes, selon le degré d'urgence de la situation, l'importance des intérêts stratégiques des Etats-Unis dans le pays concerné et la place stratégique de ce dernier dans la région : l'accompagnement des révoltes en Tunisie, en Egypte et en Libye - dans ces cas, c'est l'escalade de la violence qui finit par contraindre l'administration américaine à durcir ses positions et actions au dernier moment, lorsque la fin du régime en place s'avère inéluctable (la fin du régime d'Assad en Syrie a, à cet effet, été surestimée) ; l'incitation aux réformes politiques auprès de leurs alliés du Golfe (« diplomatie du haut-parleur ») couplée d'un soutien rhétorique aux revendications des mouvements contestataires ; et, enfin, la consolidation des alliances militaires avec les pays du Golfe, en dépit par exemple de la répression violente des mouvements de protestation au Bahreïn, par le gouvernement de Manama, avec l'appui militaire de l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et du Koweït. La politique américaine de régionalisation de la gestion des crises (par le Qatar et l'Arabie saoudite en Syrie) à défaut d'une internationalisation de toute manière bloquée au Conseil de sécurité de l'ONU, comporte d'énormes risques de déstabilisation durable de la région, les relais régionaux agissant en faveur de leurs propres intérêts politiques et stratégiques. L'échec de la diplomatie régionale est vivement critiqué y compris au sein du parti démocrate et du milieu des intellectuels de gauche : l'administration Obama est critiquée pour ne pas avoir compris les dynamiques des relations israélo-américaines ou de la question israélo-palestinienne ; pour n'avoir pas su ménager ses alliés dans la région, en particulier l'Arabie saoudite qui connaît la crise la plus grave dans sa relation avec les Etats-Unis ; pour avoir sous-estimé le conflit en Libye et l'ampleur de la reconstruction. Les dynamiques régionales s'autonomisent de l'influence américaine et la diplomatie des Etats-Unis tente de réagir en coulisses ou en soutien à ses alliés européens quand la diplomatie du haut-parleur appelant au regime change ne suffit plus (Libye, Syrie). La stratégie dite du « leading from behind » tant critiquée à Washington pendant la phase des opérations militaires en Libye, a un bel avenir.

Alors que le reset devait être une priorité, l'attitude du Congrès et les propos inquiétants de Mitt Romney contribuent aux tensions avec la Russie. Cette situation va-telle perdurer ou se calmera-t-elle après les élections ?
Dans le contexte que vous avez décrit d'un Congrès insaisissable et de groupes de pression divers, les Etats-Unis pourront-ils résister durablement aux pressions israéliennes en faveur de frappes préventives contre l'Iran ?

Le basculement de la stratégie américaine a des incidences directes sur les réflexions que nous menons dans le cadre du Livre blanc français. Nombre d'experts nous ont indiqué que les Américains se concentreraient désormais sur un seul front stratégique, l'Asie, et que leur effort en Libye, s'il nous a semblé représenter un minimum, constituerait plutôt un maximum par rapport à ce qui nous attendait. Partagez-vous ces avis ? A-t-on conscience que les deux seules puissances européennes à maintenir un effort de défense, le Royaume-Uni et la France, sont incapables de mener une opération majeure sans le soutien américain ?

Comment expliquer l'échec de Barack Obama dans le dossier israélo-palestinien, alors que 70 % du vote juif lui est favorable ? Comment améliorer l'image des Etats-Unis et, partant, de l'Occident, auprès de l'opinion arabo-musulmane ?

Ce désastre d'image n'est-il pas essentiellement dû à des raisons de politique intérieure ? Quelle est la politique américaine en matière de lutte contre la drogue à ses portes, en Colombie ou au Mexique ? Enfin, quelle est l'attitude américaine sur l'adhésion de la Turquie à l'Europe ?
Il y a peu encore, l'amélioration des relations entre la Russie et les Etats-Unis était perçue comme un des grands succès de la politique étrangère de Barack Obama, donnant lieu à des accords stratégiques, mais qui a peiné à trouver une dynamique et les dernières élections russes rendent toute perspective d'amélioration encore plus compliquée. L'administration Obama, qui pensait avoir franchi une étape, est confrontée à un retour en arrière. Au départ, l'objectif de l'administration américaine était d'élargir la coopération avec la Russie sur plusieurs dossiers comme l'énergie, l'Afghanistan, la prolifération nucléaire, et lutte contre le terrorisme. En parallèle, Obama n'a pas insisté sur la question des droits de l'Homme ou de la démocratie en Russie.
Or, quatre ans après, il y a beaucoup plus de sujets de tension que de coopération entre les Etats-Unis et la Russie : le bouclier anti-missile, l'application de sanctions vis-à-vis de l'Iran, l'intervention en Libye et enfin le conflit en Syrie ont fortement refroidi ces tentatives de rapprochement. Tous ces évènements ont souligné de graves différences d'intérêt, mais révèlent aussi des ambitions internationales parfois opposées (comme l'avaient révélé le cas du Kosovo ou l'invasion en Géorgie dans le passé). Aujourd'hui, les relations Etats-Unis - Russie se cristallisent donc autour de ces points de désaccord et non plus autour de projets communs.
De façon générale, l'administration américaine a tendu la main à des pays comme la Chine, l'Iran ou la Russie, mais sans assurance de coopération en retour. Ce que j'appelle le « pari de la coopération » ne se traduit pas systématiquement par une réelle coopération.
Il me semble essentiel de comprendre que du fait des élections américaines, Israël, la Chine, la Russie durcissent leurs discours pour faire monter les enchères, mais le nuanceront en cas de réélection du président Obama. D'ailleurs, le recours à des frappes contre l'Iran ne fait pas consensus au sein de la classe dirigeante israélienne.
Quant à l'électorat juif, comme je l'ai souligné, son vote est avant tout motivé par les questions socio-économiques et traditionnellement démocrate, même si on peut constater qu'une proportion croissante des lobbies pro-israéliens, naguère pro-démocrates à une écrasante majorité, s'éloignent de plus en plus des orientations politiques des juifs américains. Toutefois, malgré un moindre soutien qu'en 2008, le vote juif reste en grande partie acquis au président sortant, d'autant que la vision néoconservatrice que Mitt Romney porte sur le monde, décrivant la Russie comme l'ennemi public n°1 par exemple, ne rassure pas les électeurs juifs.
Concernant la réorientation de la stratégie américaine vers l'Asie et ses implications pour l'Europe, je connais bien les travaux de cette commission sur le Livre blanc de la défense. J'ai contribué modestement, quand j'étais au Quai d'Orsay, aux travaux préparatifs portant sur l'avenir de la puissance américaine. L'idée du leadership from behind en Libye traduit très mal la réalité de la contribution américaine : sans la capacité militaire des Etats-Unis, l'Europe n'aurait jamais pu mener à bien l'opération militaire en Libye. Le moteur franco-britannique en matière de défense a certes été décisif, mais il n'est pas optimal et a rapidement montré ses fragilités. L'Allemagne ne faisait pas partie de la coalition. Comment anticiper une réponse européenne plus collective et solide ? Des interventions similaires à celle de la Libye sont difficilement envisageables sans l'aide des Etats-Unis. Washington demande à l'UE de renforcer ses capacités de défense au pire moment, alors que du fait de la crise, tous les pays réduisent leur budget de défense. Or, la crise ne doit pas servir de prétexte pour ne pas avoir une réflexion de fond sur ces sujets. Et c'est un des enjeux du Livre blanc, à savoir proposer des scénarios de coopération en cas de futures interventions comme en Libye, dans un contexte où la posture stratégique américaine a clairement changé, Obama apportant un correctif à la doctrine Powell des années 1990: les Etats-Unis n'emploieront pas leur force militaire massive lorsqu'ils rejoignent une coalition de pays pour lesquels l'enjeu stratégique de la situation et de l'intervention militaire est jugé plus important que pour Washington.

La Grande-Bretagne et l'Allemagne sont associées à la rédaction du Livre blanc.
En effet, et c'est une excellente initiative. J'en viens aux relations entre les Etats-Unis, l'Europe et la Turquie. En 2009, le président Obama avait fait part de son souhait de voir la Turquie intégrer l'Union européenne, reprenant à son compte la position suivie depuis longtemps par les Etats-Unis vis-à-vis de la Turquie, alliée traditionnelle et membre de l'OTAN. Mais il l'a fait à un moment où les négociations d'adhésion de la Turquie stagnaient et où une certaine fatigue se fait sentir sur l'élargissement de l'UE. Il a néanmoins compris rapidement qu'il ne fallait plus aborder publiquement ce sujet avec ses homologues européens, comme cela avait pu être le cas sous Clinton et Bush. Barack Obama a en quelque sorte intériorisé les lignes rouges des Européens, comme sur d'autres dossiers (Afghanistan).
M. Obama a également essayé, en vain, d'utiliser la Turquie comme un relais de sa politique et des intérêts américains au Moyen-Orient. Dès le début de son administration, Obama a envisagé la Turquie comme la passerelle pour les Etats-Unis vers le Moyen-Orient et le premier ministre Erdogan serait le dirigeant qui pourrait l'aider à réaliser sa grande vision : réduire la posture des Etats-Unis au Moyen-Orient, engager l'Iran et la Syrie, et négocier une paix israélo-arabe complète. On lui reproche aujourd'hui d'avoir trop compté sur la Turquie pour faire avancer ses intérêts stratégiques dans la région, tout comme on lui reproche de trop déléguer à l'Arabie saoudite et au Qatar pour régler la question syrienne.

Bachar al-Assad reproche aux Etats-Unis d'abord et aux Français ensuite d'armer l'opposition syrienne.

Pendant longtemps, l'Amérique du Sud a été la chasse gardée des Etats-Unis, mais leur position a évolué, notamment sur le Brésil. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Vous avez sans doute raison de penser que le président Obama va gagner les élections, mais un grave événement de politique étrangère ne pourrait-il pas l'empêcher d'être réélu ?

La coopération économique entre l'Amérique du Nord et l'Europe ne risque-t-elle pas de souffrir des conséquences de la crise financière due aux subprimes et du refus des Etats-Unis d'adopter les règles européennes de Bâle III ? Accepteront-ils de taxer les mouvements financiers et de lutter contre l'évasion fiscale alors que certains Etats américains sont de véritables paradis fiscaux ?

Les Etats-Unis sont de plus en plus intéressés par le pétrole du Golfe de Guinée et ils ont installé de grandes oreilles à Sao Tome et Principe. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Dès le début du mandat d'Obama, l'Amérique du Sud a eu le sentiment, comme l'Europe, d'être négligée par les Etats-Unis qui ne s'intéressaient qu'au retrait d'Irak, à l'Afghanistan et de plus en plus à l'Asie-Pacifique. Rapidement après son arrivée à la Maison blanche, Obama se voit critiqué pour avoir négligé ses relations avec ses alliés traditionnels en Europe pour privilégier ses relations avec les pays émergents- le Brésil et l'Inde sont présentés comme des « partenaires naturels » des Etats-Unis. L'administration Obama considère que l'Inde, la Chine et le Brésil sont des puissances non pas émergentes mais qui ont déjà émergé. C'est pour cette raison qu'en décembre 2009, il choisit de négocier avec ces pays (Brésil, Afrique du Sud, Inde et Chine) l'accord de Copenhague sur le changement climatique, en excluant ses alliés européens, de manière injuste, car la mise sur l'agenda international et l'accord n'auraient pas été possibles sans les efforts européens. En accompagnant l'ascension économique de ces puissances, l'administration Obama essaie de les intégrer, les « socialiser » aux normes internationales définies par les Etats-Unis, pour les inciter à jouer les mêmes règles du jeu et afin de prévenir tout comportement futur qui pourrait être hostile aux intérêts américains. La tâche est compliquée, car la plupart de ces Etats, y compris le Brésil, ont leur propre vision des relations régionales et mondiales. A Rabat, le German Marshall Fund of the United States a lancé en septembre un nouveau programme intitulé « Dialogues Atlantiques », afin d'associer au dialogue transatlantique, des pays d'Afrique et du Moyen-Orient et d'Amérique du Sud, dont le poids démographique et économique compte et pèse de plus en plus sur les enjeux internationaux. Ce type d'initiative permet de créer des dialogues complémentaires aux canaux officiaux et de mieux comprendre les attentes de chacun. L'intérêt des Etats-Unis pour l'Amérique du Sud s'est aussi réaffirmé face à l'ampleur croissante des investissements chinois et iraniens dans la région : les Etats-Unis veulent donc reprendre pied dans cet hémisphère qui a été leur chasse gardée pendant des décennies.
Concernant un scénario cauchemar pour Barack Obama, sur la scène internationale, ce serait évidemment une attaque israélienne contre l'Iran. Le Premier ministre israélien le sait parfaitement et en joue pour déstabiliser le Président des États-Unis. Aux Etats-Unis, Barack Obama est défavorisé par un taux de chômage de 8 %. En revanche, il bénéficie d'un capital sympathie bien plus élevé que Mitt Romney et sa politique étrangère reste approuvée par une majorité des Américains. Les débats télévisés permettront aux deux candidats de marquer leurs différences. M. Romney semble assez doué pour ce type d'exercice, qui n'a, historiquement jamais été déterminant, sauf peut-être celui qui vit s'affronter Kennedy et Nixon.
En ce qui concerne les accords de Bâle III, aux Etats-Unis, les banques ne cessent de retarder l'adoption des normes de Bâle III, ce qui créé des tensions avec leurs partenaires européens. La Fed a repoussé la publication de son projet de réglementation. La réforme financière américaine est loin d'être achevée et des progrès devront être réalisés d'ici la fin de l'année.
Enfin, l'intérêt américain pour l'Afrique, notamment pour le Golfe de Guinée, est, en plus de la lutte contre les réseaux terroristes liés à Al-Qaida, dû à la présence de ressources naturelles importantes, notamment de pétrole. La sécurisation de ses approvisionnements pétroliers justifie donc ce regain d'intérêt des Etats-Unis pour l'Afrique. Dans les années à venir, Washington vise à rééquilibrer la provenance géographique de ses importations pétrolières pour être moins dépendant du Moyen-Orient, avec l'objectif d'importer 25 % de son pétrole d'Afrique en 2015 (contre 15 % aujourd'hui). Comme en Amérique du Sud, les Etats-Unis veulent réinvestir cette région où les Chinois sont de plus en plus présents. L'intérêt américain pour l'Afrique ne va donc cesser de croître en raison des ressources naturelles ; la création de l'African Command s'inscrit dans cette logique, sa fonction principale étant de former des forces africaines pour maintenir la paix et la sécurité sur leur continent.

La perception négative aux Etats-Unis des prémices d'alliance entre BAE et EADS ne me semble pas justifiée.

Malgré l'idée de pénétrer le marché américain et de devenir le n° 1 mondial, l'idée n'est pas de s'attaquer à la puissance américaine. Je vous remercie, Madame la directrice, pour la qualité de votre intervention et de vos réponses.
La commission examine le rapport de M. André Trillard et le texte proposé par la commission pour le projet de loi n° 376 (2011-2012) autorisant la ratification de la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail.

Monsieur le président, mes chers collègues, vous savez que l'Organisation internationale du travail (O.I.T.) a été fondée en 1919. Ses statuts ont été élaborés par la Commission de la législation internationale du travail, créée par la Conférence de la Paix, qui avait conclu le traité de Versailles mettant fin à la Première Guerre mondiale. La création de l'OIT découlait de l'idée que la paix durable et universelle à laquelle aspiraient les pays vainqueurs ne pouvait être assurée que par une meilleure justice sociale.
La France siégeait parmi les neuf pays composant la Commission ayant élaboré les statuts de l'OIT. Celle-ci est organisée de façon tripartite : ses organes exécutifs sont composés de représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs.
Le Bureau international du travail (B.I.T), secrétariat permanent de l'OIT, s'installa à Genève en 1920, et le Français Albert Thomas en fut le premier directeur général. L'OIT compte aujourd'hui 185 Etats membres et fait partie du système des Nations unies. L'ONU regroupe 193 membres, soit 8 de plus que l'OIT.
J'en viens maintenant à la convention qui nous est soumise aujourd'hui, adoptée à l'unanimité des membres de l'OIT en février 2006 à Genève.
Ce texte vise à substituer un texte unique et cohérent à 37 conventions adoptées de 1920 à 1996 et qui touchaient, à divers titres, au travail maritime.
Les deux premières conventions adoptées en 1920 portaient ainsi sur l'âge minimum requis pour embarquer et les indemnités de chômage en cas de naufrage.
La convention de 2006 a d'ores et déjà rempli les deux conditions préalables à son entrée en vigueur : sa ratification par 30 pays, représentant au moins 33 % du total de la jauge brute de la flotte marchande mondiale. Je précise qu'au 1er juillet 2012, la flotte marchande mondiale représentait près de 1 milliard de jauge brute, réparti en près de 48 000 navires de plus de 300 unités de jauge (chiffre minimum pour être considéré comme un navire de commerce).
Au sein de la flotte marchande mondiale, la Grèce arrive au 1er rang et la France au 25ème. Parmi les pays européens, la Grèce occupe également la 1ère place et la France la 8ème. Vous trouverez le détail de cette répartition dans mon rapport écrit.
S'agissant des personnels employés à bord des navires de commerce, auxquels s'applique le présent texte, ils sont estimés par l'OIT à 1,2 million. Les Français sont près de 14 000, répartis sur 299 navires.
La présente convention est particulièrement opportune, car le développement en volume de la flotte marchande internationale s'est accompagné d'une forte concurrence entre armateurs, qui a pesé sur les prix, et donc sur les conditions d'emploi des gens de mer. Le texte fixe des normes minimales en matière d'heures de travail et de repos, d'hébergement, de protection sanitaire, de soins médicaux et de sécurité sociale.
Il introduit la notion de « certification nationale », qui oblige chaque Etat l'ayant ratifié à ce que les navires battant son pavillon satisfassent aux critères de « travail décent » détaillés dans la convention, mais également que l'autorité de l'Etat du port puisse contrôler les navires. Par ailleurs, une procédure permet de recueillir les plaintes éventuelles, à bord comme à terre.
L'OIT a ainsi estimé que : « le système d'inspection et de certification du travail maritime est une grande avancée qui permet de faire face aux graves situations découlant de l'internationalisation des navires, et de l'incapacité de certains pays à veiller à ce que leurs navires répondent aux normes internationales de qualité. »
Une commission tripartite spéciale réunit des représentants des gouvernements des Etats ayant ratifié la convention et des représentants des armateurs et des gens de mer désignés par le conseil d'administration du B.I.T.. Mais cette instance peut également associer à ses délibérations, sans droit de vote, des représentants des gouvernements n'ayant pas ratifié la convention. Je précise qu'au 25 septembre 2012, 31 Etats, représentant 60 % de la jauge brute de la flotte marchande mondiale, ont ratifié la convention. Parmi les Etats ayant une flotte commerciale significative et qui ont ratifié, on relève la présence de Chypre, du Libéria, des Philippines, de la Pologne, de la Russie et de Singapour.
La possibilité pour les Etats n'ayant pas ratifié de participer aux discussions sur les normes applicables aux gens de mer témoigne d'un pragmatisme positif, puisqu'elle leur permet de connaître l'évolution des normes retenues par les Etats engagés par leur respect, et les implique de ce fait même. Il serait évidemment préférable, dans un monde idéal, que tous les Etats possédant une flotte marchande d'importance ratifient la présente convention, mais nous ne vivons pas dans un tel monde.
En conclusion, je vous suggère d'adopter le présent texte qui représente une réelle avancée pour les conditions de travail des gens de mer. Il convient donc que la France, par sa ratification, puisse participer aux travaux de la Commission tripartite chargée de suivre l'application concrète de ce texte.
Je vous propose également que son examen en séance publique se fasse en forme simplifiée.

Oui, en février 2009.
Puis la commission adopte le présent texte ainsi que son examen en forme simplifiée.
La commission procède à la nomination d'un rapporteur pour avis sur le projet de loi de finances pour 2013 :
Jeanny Lorgeoux est désigné rapporteur pour avis du programme 144 « Environnement et prospective » (Mission Défense), en remplacement de M. Didier Boulaud.
Puis la commission procède à la nomination d'un rapporteur pour avis sur le contrat d'objectifs et de performances de France Expertise Internationale.
Jacques Berthou est désigné rapporteur pour avis sur le contrat d'objectifs et de performances de France Expertise Internationale.
La commission a décidé de proposer :
la candidature de M. Jeanny Lorgeoux pour siéger comme membre titulaire au sein du conseil d'administration de l'Institut des hautes études de la défense nationale.
la candidature de Mme Kalliopi Ango Ela pour siéger au sein du conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Jean-Claude Peyronnet est désigné vice-président de la commission, en remplacement de M. Didier Boulaud.

Daniel Reiner, vice-président de la commission, sera mis à contribution pendant les quelques jours durant lesquels je m'absenterai en octobre.
Je vous indique également que M. Michel Boutant pourrait devenir membre de la délégation parlementaire au renseignement, en remplacement de M. Didier Boulaud ; M. Daniel Reiner membre titulaire et M. Jacques Berthou membre suppléant de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN ; et moi-même, si M. le Président du Sénat propose ma candidature, membre de la commission de vérification des fonds spéciaux, en remplacement de M. Didier Boulaud.