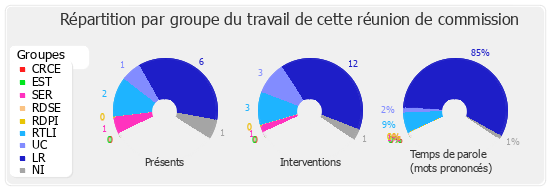Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
Réunion du 13 mai 2015 à 9h30
Sommaire
La réunion

Placer les activités des services de renseignement dans un cadre défini par le législateur constitue une marque de maturité pour une démocratie. L'appareil de renseignement des Etats a souvent été, à l'origine, établi hors du droit, car destiné par nature à fonctionner dans la clandestinité.
La démarche entreprise est donc ambitieuse.
C'est une démarche engagée de longue date. Le Livre blanc de 2008 et plusieurs rapports parlementaires, dont ceux de la DPR, appelaient à son élaboration. Il s'agit donc d'une démarche ancienne, dont les attentats terroristes du mois de janvier 2015 ont accéléré la mise en oeuvre sans en avoir été à l'origine.
Effectuer cette démarche a longtemps été considéré comme impliquant un risque, celui d'affaiblir les capacités des services. Or, ce risque n'est pas avéré si l'on procède avec précaution et il doit être confronté à l'incertitude juridique qui pèse sur les modes d'action des services de renseignement qui ont besoin pour agir d'un cadre légal, plus encore sans doute quand les menaces se concrétisent et sont susceptibles d'affecter directement nos concitoyens. Je ne reviens pas sur cet aspect que les ministres de l'intérieur et de la défense nationale ont développé hier lors de leur audition, si ce n'est pour souligner que les menaces s'amplifient mais évoluent aussi dans leurs modes d'action, ce qui rend nécessaire le recours par les services à de nouvelles technologies.
Légiférer, asseoir la légitimité des services, mieux faire comprendre leurs missions, ce n'est donc pas de mon point de vue les affaiblir, mais les renforcer.
Mais au-delà du principe, légiférer n'est pas chose facile, car le législateur doit à la fois veiller à la protection de la vie privée et des libertés individuelles garanties par la Constitution et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et renforcer l'efficacité des services. Il faut aussi préserver la discrétion des modes d'actions et l'anonymat des agents qu'exigent l'efficacité des services de renseignement et la sécurité des personnels qui les servent.
Tout sera donc question d'équilibre dans les procédures mises en oeuvre, un équilibre entre les deux exigences de sécurité et de liberté.
S'agissant de la protection des droits, la question s'est posée de la nécessité d'une intervention du juge judiciaire. Il semble toutefois que, s'agissant de mesures de police administrative qui n'entraînent pas de placement en détention, l'intervention du juge administratif - ici le Conseil d'Etat - soit conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et cohérente avec l'organisation des deux ordres de juridiction. L'important est que le projet de loi crée une voie de recours pour les citoyens.
Il faut aussi prendre conscience que la mise en place d'une telle organisation ne sera efficace que si les différents acteurs du système disposent des moyens de le faire fonctionner. J'ai interrogé les ministres sur ce point, ils m'ont assuré qu'ils travaillaient à l'évaluation des moyens nécessaires et seraient en mesure de répondre à mes questions sur le coût de cette réforme lors du débat en séance publique.
Jusqu'à maintenant, le législateur n'était intervenu que ponctuellement pour définir le cadre d'emploi de certaines techniques comme les interceptions de sécurité en 1991, la réquisition des données de connexion en 2006 puis en 2013 de géolocalisation ou pour instaurer une forme particulière de contrôle parlementaire, avec la création en 2007 de la délégation parlementaire au renseignement. La France s'est donc dotée d'une législation morcelée et reste dépourvue d'un cadre général.
Ce projet de loi n'est exceptionnel que parce qu'il est le premier du genre dans notre pays, et qu'il met fin à une exception. En revanche, ce n'est pas une loi d'exception.
Le Parlement est donc saisi d'un projet de loi qui a pour ambition de donner un cadre juridique unifié et clair aux activités des services de renseignement. Ce texte est nécessaire pour répondre à l'évolution des menaces et servir les intérêts de notre pays.
Encore faut-il que l'usage des nouvelles techniques de renseignement s'inscrive dans un cadre légal qui le limite et garantisse la protection contre les atteintes abusives à la vie privée et aux libertés. L'obligation de vigilance pour le législateur est d'autant plus grande que le Président de la République a décidé de saisir le Conseil constitutionnel du texte qui sera issu des travaux du Parlement.
Le projet de loi instaure un régime d'autorisation préalable du Premier ministre après avis et sous le contrôle d'une autorité administrative indépendante, la CNCTR, dont il définit la composition, les règles de déontologie et de fonctionnement ainsi que les missions. Il pose les règles de traçabilité de l'usage des techniques de recueil de renseignement autorisées et fixe la durée de conservation des données collectées. Si la décision revient au Premier ministre, l'avis de la CNCTR sera fortement prescriptif.
Le projet de loi prévoit un régime spécifique d'autorisation et de contrôle pour les mesures de surveillance internationale.
Il institue enfin un recours devant le Conseil d'Etat, ouvert à toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, ainsi qu'à l'autorité administrative indépendante, tout en prévoyant des règles de procédure dérogatoires destinées à préserver le secret de la défense nationale.
Le projet de loi contient en outre d'autres dispositions, notamment afin d'assurer une meilleure protection de l'anonymat des agents ainsi que leur protection pénale, d'étendre le droit de communication de TRACFIN, de conforter les moyens d'information de la délégation parlementaire au renseignement.
En regroupant nombre de ces dispositions dans un nouveau livre VIII du code de la sécurité intérieure, le projet de loi définit une architecture générale cohérente et lisible, même s'il n'est pas la loi-cadre qu'espéraient certains.
Les défenseurs des droits de l'homme sont naturellement sensibles à ce texte et ils ont raison, mais ils devraient également se réjouir de voir se mettre en place un cadre légal pour des activités dans un domaine non encore saisi par le droit.
Le projet de loi a d'ores et déjà posé les principes de l'équilibre à trouver entre protection des droits et efficacité des services. Le travail du Sénat consistera donc à parfaire le projet de loi en veillant tout particulièrement au renforcement des garanties, à l'efficacité des services, à la dimension internationale de leurs activités, à la préservation du secret de la défense nationale dans la mise en oeuvre de ses dispositions et au renforcement de la légitimité et de l'efficacité des instances de contrôle. Au terme de mon analyse, je vous présenterai un certain nombre d'amendements. Je pense que nous pourrons donner un avis favorable à son adoption par le Sénat.
Ma première préoccupation a été de vérifier la prise en compte des intérêts fondamentaux de la nation dans la définition des missions et des finalités des services de renseignement. J'ai constaté que la rédaction de l'article L. 811-3, relatif aux finalités permettant aux services spécialisés de renseignement de recourir aux techniques mentionnées au titre V dans l'exercice de leurs missions, gagnerait à être précisée.
Ma seconde préoccupation a été de parfaire la conciliation entre protection des libertés et efficacité opérationnelle. La difficulté pour le législateur dans cette quête d'un équilibre idéal est de vouloir tout inscrire dans la loi, jusqu'au moindre détail. Le Sénat devra s'efforcer de clarifier et de simplifier autant que d'ajouter. J'ai donc limité mes propositions à quelques aspects pour essayer :
- d'éclaircir le pouvoir d'autorisation du Premier ministre et notamment la nature de la délégation qu'il fait à six de ces collaborateurs. Je souhaite obtenir des réponses du Gouvernement sur l'étendue et le contenu de ces délégations, savoir si les délégués exerceront cette compétence à plein temps, s'il s'agira de membres du cabinet ou d'une autre structure, s'ils seront spécialisés et comment. Il s'agit d'une responsabilité d'Etat, il faut donc être très vigilant à ne pas mettre en place une structure trop distante du Premier ministre, qui assume la responsabilité politique ;
- de redimensionner la CNCTR, qui me paraît trop nombreuse pour fonctionner avec efficacité ;
- de conforter la légitimité de son président en déposant avec le président de la Commission des lois, notre collègue Philippe Bas, une proposition de loi organique qui soumettra la nomination à la procédure d'avis de la commission parlementaire compétente en application de l'article 13 de la Constitution et qui viendra en discussion commune avec le projet de loi. Cet avis nous semble nécessaire car le président de la CNCTR disposera de grands pouvoirs et d'une capacité d'influence considérable, il faudra donc une personnalité disposant de grandes qualités de compétence et d'éthique ;
- de revenir à une durée raisonnable de conservation des correspondances interceptées ;
- de limiter un angle mort dans la capacité d'agir des services, lié à l'interdiction absolue de procéder à la mise en place de certains dispositifs lorsque les personnes visées appartiennent à des professions protégées, même en cas de menaces imminentes. Je crains que cela ne fournisse des couvertures faciles pour des agents étrangers, des terroristes ou des criminels ;
- d'assurer une meilleure protection du secret de la défense nationale en limitant les habilitations ès-qualité par la loi sans vérification préalable de la vulnérabilité des personnes concernées ;
- de rendre plus intelligibles les dispositions relatives à certaines techniques telles que les sondes mises en place sur les réseaux et les « IMSI-catcher » (fausses antennes relais permettant de capter toutes les communications dans un certain rayon).
Enfin, ma troisième préoccupation a été d'actualiser la rédaction des dispositions relatives à la délégation parlementaire au renseignement pour tenir compte du projet de loi et lui donner les moyens nécessaires à sa mission.
Enfin, je voudrais conclure en soulignant que l'efficacité de la réforme dépendra des moyens budgétaires et financiers alloués et de la résistance à certaines tendances bureaucratiques. Il s'agit d'une question essentielle.

Lors de l'audition des ministres de l'intérieur et de la défense, les discussions ont principalement porté sur la protection des libertés individuelles. En abordant cette question, le Sénat est bien dans son rôle, d'autant que le diable se niche comme toujours dans les détails. Un texte n'est pas fait seulement pour le Gouvernement en place ; il est donc nécessaire que la loi soit très précise. Je me suis moi-même interrogé sur la troisième finalité permettant la mise en oeuvre des techniques de renseignement : la défense des intérêts fondamentaux en matière d'économie. La formulation retenue me paraît en effet très large. Par ailleurs, il ne faut pas que les dispositions relatives à l'urgence absolue ou à l'urgence opérationnelle soient mises en oeuvre systématiquement.

Cette loi pose des problèmes de principe et des problèmes opérationnels. Dans la première catégorie se situe la question de l'équilibre entre liberté et sécurité. L'ensemble des justifications données par les deux ministres se rapporte à la menace terroriste. Mais ce texte s'applique à tous les aspects de notre vie en société, bien au-delà de la seule question du terrorisme ! Par ailleurs, on a tendance en France à légiférer plutôt qu'à prévoir les moyens nécessaires. Ainsi, dans les attentats terroristes que nous avons subis ou dans ceux que nous avons évités de justesse, ce n'est pas une absence d'identification du suspect qui était en cause, mais plutôt un relâchement de la surveillance exercée sur lui. En ce qui concerne l'aspect opérationnel, il ne s'agit pas seulement du fait que c'est au juge administratif, et non au juge judiciaire, que la protection des libertés est confiée par le texte. Le point important est que ce contrôle juridictionnel ne sera exercé désormais qu'a posteriori, dans un domaine qui touche pourtant à la surveillance des citoyens. En outre, le recours que ceux-ci pourront exercer sera filtré par une autorité administrative indépendante.
Par ailleurs, le projet de loi offre aux services de renseignement des outils actuellement autorisés dans le seul cadre d'une enquête judiciaire menée par un juge. Une chose me choque particulièrement : l'insuffisance des dispositions relatives à la protection des professions protégées. Le Premier ministre pourra décider lui-même de placer sous surveillance un parlementaire. C'est un vrai problème du point de vue de la séparation des pouvoirs !
Le ministre de l'intérieur affirme que ce texte est très différent du Patriot Act. Pourtant, il comporte - et il y a des aspects techniques que nous ne sommes pas en mesure de comprendre totalement - la possibilité de mettre en place des « boites noires » qui vont faire de la « pêche au chalut » et recueillir des données sur des personnes qui n'auront qu'une proximité géographique avec les véritables cibles des services. Quant aux algorithmes, nous sommes dans l'incapacité de les comprendre et par conséquent de savoir précisément ce qui sera considéré comme un comportement suspect : un parlementaire qui effectue de nombreux déplacements sera-t-il concerné ?
Pour conclure, je pense que ce projet de loi est nécessaire pour rendre légal ce qui est aujourd'hui « a-légal », mais qu'il doit être examiné avec la plus grande vigilance.

Je regrette que nous n'ayons pas pu prendre connaissance des amendements plus tôt. Cette loi n'est pas une loi d'opportunité déposée en réponse aux attentats de janvier. En tant que membre de la DPR, je participe à sa préparation depuis plusieurs années. N'oublions pas que la menace terroriste est aujourd'hui universelle : elle touche tous les continents ! Pourquoi cette loi ? Il s'agit de donner un cadre légal à certaines pratiques. À titre d'exemple, l'IMSI catcher a été utilisé à Dammartin lors de la traque des frères Kouachi. Il faut également souligner que les dispositions du droit positif issues de la loi du 10 juillet 1991 sont aujourd'hui dépassées par la technique : ainsi, l'usage du téléphone portable et de l'internet se sont généralisés. Ce texte vise également à apporter une protection aux agents de la communauté de renseignement qui, en l'absence de dispositif légal encadrant leurs activités, peuvent se retrouver dans des situations difficiles. En ce qui concerne les libertés, il faut faire confiance au Gouvernement et à nos services de renseignement. En outre, le projet de loi prévoit pour la CNCTR des prérogatives très étendues par rapport à celles de l'actuelle commission nationale des interceptions de sécurité.

Le texte prévoit que les membres de la CNCTR seront soumis à certaines incompatibilités, dont l'exercice d'un mandat électif : cela risque de compliquer la nomination des membres parlementaires. Par ailleurs, quelle est la position du rapporteur sur les dispositions relatives aux lanceurs d'alerte ? Des directeurs ont exprimé la crainte qu'elles ne nuisent au respect du principe hiérarchique au sein de leur service. Certains lanceurs d'alerte sont simplement des agents déçus de ne pas avoir eu la promotion qu'ils convoitaient !
Pour ma part, je trouve positif que le texte s'applique au renseignement économique car la France était très en retard sur ce sujet.
Enfin, l'ambassadeur d'Australie nous a indiqué qu'en proportion, autant d'Australiens partaient faire le Djihad que de Français. Ce n'est donc pas un problème lié à la laïcité à la française.

Cette loi est un texte important : il aurait été préférable de disposer des amendements du rapporteur à l'avance. Ne serait-il pas possible d'avoir un temps pour examiner ces amendements ? De manière générale, je souligne qu'il est plus difficile d'obtenir un consensus lorsqu'il n'y a qu'un rapporteur et non pas deux, un pour la majorité, un pour l'opposition.

Tout le monde est d'accord pour que la France se dote de davantage d'outils pour lutter contre le terrorisme. Toutefois, il y a pour cela d'autres moyens que ce type de dispositions. Par ailleurs, les finalités visées par le texte vont bien au-delà de la seule menace terroriste. Plus on tire sur la pelote, plus on s'inquiète ! Il est très difficile pour nous de bien comprendre les techniques de renseignement. Ainsi, je n'ai pu obtenir d'indications sur les volumes de données concernés par les techniques d'interception. Nous ne pouvons pas nous contenter de faire confiance aux ministres. Je pense que les amendements de la commission vont aller dans le bon sens mais je m'en tiendrai à un avis négatif de précaution !

Ce texte est novateur et comble une lacune importante. C'est un texte équilibré. Il est certes perfectible, mais en unissant nos intelligences, nous parviendrons bien à l'améliorer !

Il sera difficile de modifier ce texte sans créer de déséquilibre au détriment de la liberté d'un côté ou de l'efficacité de l'autre. Concernant le champ d'investigation des services, il pourrait être plus resserré, mais il pourrait aussi être élargi, par exemple en ajoutant l'évasion fiscale. Il est vrai que la question des professions protégées est également importante. Enfin, je m'interroge sur l'accès aux données recueillies : le texte prévoit ainsi que les personnes peuvent accéder à toutes les données qui les concernent !

Je m'interroge pour ma part sur les six personnes à qui sera délégué le pouvoir d'autorisation des interventions. Il faudrait que l'un de ces délégataires ait vraiment la responsabilité !

Mes chers collègues, nous sommes contraints par les délais. Toutefois, je pourrai me rendre disponible avant la réunion de la commission des lois pour vous rencontrer. Les amendements seront déposés mais je pourrai expliquer la position de l'ensemble des groupes de la commission.
En ce qui concerne les garanties apportées par le texte, s'il est vrai qu'une personne souhaitant faire un recours sera obligée de saisir au préalable la CNCTR, elle pourra ensuite, si celle-ci ne donne pas suite, saisir directement le Conseil d'Etat. En tout état de cause, un contrôle juridictionnel a priori des services ne serait pas une bonne chose. Il convient par ailleurs de rappeler que les « boites noires » ne concerneront pas le contenu des messages, mais seulement les données de connexion. En revanche, s'agissant des professions protégées, il est vrai que la protection prévue par le texte n'est pas totale. Il conviendra de continuer à réfléchir à ce sujet. En ce qui concerne les lanceurs d'alerte, je n'ai pas perçu, lors des auditions, d'opposition frontale des services.
Enfin, je suis d'accord avec Michel Boutant pour dire que ce texte constitue l'aboutissement d'un long travail.

La protection des parlementaires constitue un sujet important. Toutefois, il ne peut être envisagé de conférer à la CNCTR la prérogative de donner un avis conforme : ce serait anticonstitutionnel.

Certes il d'agit d'un sujet important mais il ne faudrait pas donner l'impression que nous cherchons à nous exonérer...
EXAMEN DES AMENDEMENTS

Le groupe socialiste sera représenté par Michel Boutant à la réunion préalable à l'examen des amendements par la commission des lois proposée par le rapporteur. Il pourra donner un avis circonstancié sur ces amendements. A ce stade, nous ne prendrons pas part au vote.

Je suis surpris par le tour que prennent nos débats. Il ne peut y avoir de seconde réunion de commission !

Il ne s'agira que d'une réunion d'information qui ne se substituera en aucun cas à la présente réunion de commission.

Le groupe CRC ne prendra pas non plus part aux votes.
Les amendements 1 à 9 sont adoptés.

Le nombre de six personnes désignées par le Premier ministre n'a-t-il pas été déterminé en fonction de la charge de travail anticipée ? Un total de 6 000 autorisations annuelles a été évoqué lors de l'audition des ministres, soit 20 par jour. Comment la CNCTR va-t-elle pouvoir donner autant d'avis ?

Le ministre nous a dit qu'il répondrait de manière plus précise sur ce point en séance publique. Mais ce n'est pas parce que la CNCTR est une grosse structure qu'il faut que les délégués du Premier ministre soient nombreux.
L'amendement n° 10 est adopté, ainsi que les amendements n° 11 et n° 12.

L'amendement n° 13 est une disposition importante. Il obligera les services à exploiter rapidement les interceptions.
L'amendement n° 13 est adopté.

Je crois que, paradoxalement, les membres de la CNCTR seront plus efficaces à 9 qu'à 13. Il s'agit ici d'une AAI chargée d'un travail d'analyse de la proportionnalité des atteintes à la liberté, qui s'accommodera fort bien d'un nombre de membres réduit. Elle construira une grille d'analyse qui lui permettra de répondre rapidement aux demandes d'avis. Avec 13 membres, on dilue au contraire les responsabilités et on empêche la commission d'acquérir la compétence nécessaire.
L'amendement n° 14 est adopté, ainsi que les amendements n° 15 à n° 19.

N'ayons pas d'interrogations excessives sur la géolocalisation. Il faut savoir que tous les bateaux sont identifiés par leur balise GPS, y compris le nom de leur propriétaire.
L'amendement n° 20 est adopté, ainsi que les amendements n° 21 à n° 23.
Rappelons que l'habilitation secret défense est limitée au sujet dont on a à connaître dans le cadre de son activité. Seuls les parlementaires peuvent être habilités de manière générale.
L'amendement n° 24 est adopté, ainsi que les amendements n° 25 à n° 27 et n° 29

Nous donnons mandat à M. Jean-Pierre Raffarin pour défendre tous les amendements que nous venons d'adopter devant la commission des lois, puis redéposer au nom de notre commission ceux qui n'auront pas été retenus.
- Présidence de M. Jean-Pierre Raffarin, président -
La commission examine le rapport de M. Xavier Pintat ainsi que le texte proposé par la commission sur la proposition de loi n° 277 (2014-2015) relative au renforcement de la protection des installations civiles abritant des matières nucléaires.

Depuis 1996, les installations nucléaires civiles françaises ont été l'objet d'une quinzaine d'intrusions ou tentatives d'intrusion, de la part de militants anti-nucléaires. Ces intrusions n'ont, à aucun moment, remis en cause la sûreté des installations. Ce n'était d'ailleurs pas leur objectif puisqu'il s'agissait d'actions militantes à visée contestataire, dans le but de créer un fort impact médiatique.
Le 18 mars 2014, en particulier, une soixantaine de militants se sont introduits de force, employant des moyens violents, jusqu'au sommet du dôme d'un réacteur et sur le toit de la piscine de stockage de la centrale nucléaire de Fessenheim. À l'issue de la procédure judiciaire alors intentée, le tribunal correctionnel de Colmar a condamné du chef de violation de domicile, en septembre dernier, cinquante-cinq militants, dont trois seulement étaient présents au tribunal, à des peines de deux mois de prison avec sursis.
Ce type de sanction n'est pas suffisamment dissuasif pour éviter que ne se multiplient des intrusions spectaculaires, du type de celles qui ont émaillé l'actualité de ces dernières années.
C'est tout l'enjeu de cette proposition de loi, dont le Sénat est saisi en première lecture, après son adoption par l'Assemblée nationale le 5 février dernier. Ce texte, déposé à l'initiative de notre collègue, député du Loiret, Claude de Ganay a été modifié par la commission de la défense de l'Assemblée nationale, en concertation avec le Gouvernement, et par consensus entre les groupes socialiste et UMP. Il vise à renforcer la protection de sites caractérisés tant par leur importance en termes économiques que par leur sensibilité en termes de sécurité, puisque des matières radioactives y sont entreposées.
Par ailleurs, ce texte prévoit la présentation par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sur les enjeux soulevés par les survols d'installations sensibles par des drones.
L'article premier renforce les sanctions pénales applicables aux auteurs d'intrusion dans des installations abritant des matières nucléaires. Il s'agit de prévoir des peines suffisamment dissuasives pour réduire le nombre d'intrusions.
Pourquoi est-ce nécessaire ? Parce que les actions des militants anti-nucléaires, même si elles ne présentent pas de danger direct en termes de sûreté, mobilisent néanmoins d'importants moyens humains. Elles font courir des risques non seulement au personnel des installations, aux forces de sécurité qui y sont déployées, mais aussi aux militants eux-mêmes. Les moyens mobilisés pour répondre aux intrusions sont alors détournés de leur vocation principale, qui est de défendre les installations contre le risque terroriste.
La protection des installations nucléaires d'EDF est assurée par des forces spécialisées de la gendarmerie nationale, les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie (PSPG), qui comptent 882 hommes et femmes, formés par le Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) ; elles sont des unités antiterroristes. En cas de menace, les PSPG sont le premier maillon de la chaîne avant l'intervention de la gendarmerie du département et du GIGN.
Les sites du CEA et d'Areva sont protégés par des services internes de sécurité, les formations locales de sécurité (FLS), qui représentent un effectif de 1 300 agents. Pour les sites non militaires du CEA, et pour les sites d'Areva, c'est le RAID, unité de la police nationale, qui constitue le dernier maillon de la chaîne d'intervention.
La vocation première de ce dispositif est de répondre à la menace terroriste. Toute intrusion est donc présumée terroriste avant que sa nature ne soit établie de façon certaine. Les forces de sécurité sont déployées prioritairement autour des périmètres les plus sensibles des installations, qu'ils doivent protéger d'une action susceptible d'être fulgurante. C'est pourquoi leur action peut paraître inadaptée, en cas d'intrusion de militants antinucléaires. Ces actions militantes, si elles se multipliaient, risqueraient donc de réduire la vigilance vis-à-vis du risque terroriste, qui n'est pas un risque théorique, comme l'ont montré les attaques perpétrées en janvier dernier à Paris et en région parisienne.
Les intrusions militantes se distinguent bien évidemment des actions terroristes par leurs objectifs, leurs moyens et leurs conséquences potentielles. Ces deux types de menaces appellent des réponses distinctes, adaptées et proportionnées aux risques qu'elles font respectivement courir. Néanmoins, il n'est pas nécessairement facile de distinguer rapidement ces deux types d'action sur le terrain. En effet, un ou plusieurs terroristes pourraient, demain, prendre l'apparence de militants anti-nucléaires ou infiltrer des organisations militantes.
Le droit pénal actuel est inadapté pour répondre à ces intrusions récurrentes.
Des délits spécifiques sont prévus par le code de la défense, afin de protéger l'intégrité des matières nucléaires.
Le code pénal permet, par ailleurs, de réprimer le fait d'exposer autrui à un risque immédiat ou celui de mettre en péril la santé de l'homme ou le milieu naturel. Il sanctionne les destructions et dégradations et réprime évidemment le terrorisme.
Par ailleurs, des régimes de protection spécifiques existent pour les zones militaires (article 413-5 du code pénal) et pour les sites intéressant la défense nationale (article 413-7 du code pénal).
Mais aucun de ces régimes de sanctions pénales ne permet de réprimer de façon satisfaisante les intrusions militantes commises dans les installations nucléaires. En conséquence, le juge pénal est amené à retenir des qualifications juridiques inadaptées, telles que la violation de domicile (article 226-4 du code pénal). La Cour de cassation a validé cette approche, à propos de l'intrusion commise en décembre 2011 dans la centrale de Nogent-sur-Seine. Elle a considéré que les lieux où les militants s'étaient introduits constituaient bien, pour EDF, un domicile au sens du droit pénal. Dans ce cas, les militants ont été condamnés pour dégradation en réunion et violation de domicile, à six mois d'emprisonnement avec sursis.
Les affaires jugées à ce jour n'ont conduit qu'à des peines de prison avec sursis de l'ordre de 2 à 6 mois (lorsque l'intrusion était accompagnée de dégradations), et à des amendes ou frais de procédure de l'ordre de 1 000 à 3 000 euros.
Que prévoit, par conséquent, cette proposition de loi ? Rappelons tout d'abord que l'article 55 de la loi de programmation militaire a autorisé le Gouvernement à insérer par ordonnance dans le code de la défense et le code général des collectivités territoriales des dispositions visant à renforcer la protection des installations nucléaires. Sur le fondement de cette habilitation, le Gouvernement a permis aux préfets de réglementer la circulation et le stationnement autour des installations. Le Gouvernement a considéré, en revanche, que, s'agissant de dispositions pénales créant une nouvelle infraction, il était préférable de recourir à la procédure parlementaire plutôt que de légiférer par ordonnance.
Le texte proposé par l'Assemblée nationale prévoit un dispositif échelonné de peines, à partir d'une peine de base qui est une peine d'emprisonnement d'un an et une amende de 15 000 euros, identique à celle prévue pour introduction sans autorisation en zone militaire ou pour violation de domicile ; cette peine est susceptible d'être aggravée en fonction des circonstances (lorsque l'infraction est accompagnée de destructions, commise en réunion, avec usage d'une arme ou en bande organisée...).
Par ailleurs, des peines complémentaires sont prévues, applicables non seulement aux personnes physiques, mais aussi aux personnes morales, ce qui permettra de sanctionner l'instigateur de l'action, par des amendes susceptibles d'être très élevées (leur taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques).
Le texte qui nous est proposé est issu d'échanges avec le Gouvernement. J'ai pu vérifier son caractère consensuel lors de mes auditions. Il permet de répondre aux actes d'intrusion de façon spécifique, adaptée et proportionnée. Il réduira le doute des forces de sécurité, quant aux intentions réellement malveillantes des intrus, étant donné le risque encouru, ce qui permettra aux dispositifs de sécurité existant de rester focalisés sur leur mission première. Avec l'adoption de ces dispositions, l'Etat aura pris les mesures qui sont de son ressort, et pourra alors légitimement demander aux opérateurs d'accélérer leurs investissements pour la protection physique passive des installations.
Enfin, et surtout, ce dispositif ne prive en aucun cas les militants antinucléaires de leur liberté d'expression et de manifestation, qui pourra s'exercer dans les conditions légales à l'extérieur des sites.
C'est pourquoi je vous proposerai d'adopter ces dispositions sans modification.
J'en viens à l'article 2 de la proposition de loi, qui prévoit que le Gouvernement dépose au Parlement, avant le 30 septembre 2015, un rapport sur la question des drones.
Une quarantaine de survols distincts par des drones, non revendiqués, ont été répertoriés, au-dessus de dix-neuf sites abritant des matières nucléaires, depuis septembre dernier. Six centrales nucléaires ont notamment été survolées de façon simultanée le 31 octobre 2014. La base militaire de l'Ile-Longue a été survolée les 26 et 27 janvier derniers. Tous sites confondus, 67 survols illégaux ont été recensés. Ces survols n'ont pas présenté de menace directe. Ils pourraient relever de plusieurs actions distinctes et d'objectifs différents. Sur un nombre non négligeable de survols, des recoupements ont été effectués ; ils correspondraient au passage autorisé d'aéronefs au-dessus de 1 000 mètres.
Toutefois, ce phénomène ne doit pas être minimisé et appelle une réflexion sur une nouvelle dimension de la sécurité aérienne, du fait de l'usage croissant de drones civils, professionnels ou de loisirs. La détection des petits drones employés, volant à basse altitude, nécessite des investissements particuliers.
À la suite de ces survols, une démarche interministérielle a été décidée, en vue d'identifier les adaptations juridiques, techniques et capacitaires requises. À l'initiative de la commission de la défense de l'Assemblée nationale, cet article 2 vise donc à ce que le Parlement soit pleinement associé à cette démarche.
En conclusion, cette proposition de loi ne prétend pas apporter de réponse à l'ensemble des enjeux soulevés par la multiplication des intrusions et survols d'installations sensibles. Ces phénomènes nécessiteront des investissements pour la protection physique des installations, ainsi qu'une réflexion sur le statut et les moyens des forces chargées de veiller à leur sécurité, et sa conformité avec le droit européen. Par ailleurs, le statut juridique des drones devra probablement être précisé, notamment celui de la formation - et de l'information - de leurs pilotes, sans porter atteinte au développement économique de cette filière, en pleine expansion. Les intrusions aériennes requièrent des évolutions des systèmes d'alerte et de détection, ainsi que des moyens de neutralisation. Au-delà de la question des intrusions et des survols, l'évolution des menaces doit amener à prendre en compte aussi les problématiques de cybersécurité, dans le prolongement des dispositions de la loi de programmation militaire à ce sujet. Une réflexion sur un éventuel renforcement des liens entre sûreté et sécurité nucléaire pourrait également être entreprise, sans empiéter sur le caractère régalien de la conduite de la politique de sécurité nucléaire.
Cette proposition de loi devra probablement être complétée par un autre texte, notamment sur le statut des personnels de sécurité et sur le régime juridique des drones. Néanmoins, le dispositif soumis aujourd'hui à notre examen est nécessaire et son adoption est urgente. C'est pourquoi je vous propose que nous l'adoptions sans modification, afin qu'il puisse entrer rapidement en vigueur.

L'urgence de cette proposition de loi est réelle. Je suis favorable à la proposition du rapporteur, qui est d'adopter ce texte conformément à sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale. La quasi-totalité des amendements du groupe écologiste cherchent à protéger les militants auteurs d'intrusions. Or un terroriste pourrait profiter de ces intrusions. Il est donc nécessaire de renforcer les sanctions.
Comme l'a indiqué le rapporteur, le CEA a attiré notre attention sur la spécificité de la gestion de ses personnels de sécurité, qui déroge au code du travail. Le CEA aurait souhaité profiter de cette proposition de loi pour institutionnaliser ce fonctionnement dérogatoire. Le rapporteur, qui a rencontré les responsables du CEA, nous propose d'envisager une nouvelle proposition de loi, qui pourra aussi tenir compte des conclusions du futur rapport du SGDSN sur la menace que représentent les drones.
Je suis favorable à ce que cette nouvelle proposition de loi soit déposée et inscrite à l'ordre du jour aussi rapidement que possible.

Le groupe socialiste approuve cette proposition de loi même s'il mesure les limites de sa portée. Il est impossible de ne pas réagir aux événements récents, s'agissant notamment des survols. Nous attendons beaucoup du travail conduit actuellement par le SGDSN et espérons qu'il aboutira à des propositions efficaces. Nous souhaitons également adopter ce texte dans sa rédaction actuelle, afin qu'il puisse entrer immédiatement en application.

Je remercie le rapporteur pour son travail diligent et argumenté, même si je n'en partage pas les conclusions.
J'espère que personne ne pense que les sanctions prévues par cette proposition de loi sont susceptibles de dissuader des terroristes. Si la proposition de loi portait sur une augmentation des protocoles de sécurité, je n'y serais pas opposé. Nous n'avons pas une vision naïve du sujet. Je suis favorable à ce que la sécurité des centrales nucléaires soit au même niveau que celle des installations militaires.
De facto, nous avons plutôt l'impression qu'il s'agit de criminaliser les lanceurs d'alerte qui viennent démontrer l'ineffectivité de cette sécurité.
Le sujet des drones est également crucial. Certes, le SGDSN travaille, mais nous tardons énormément. Le texte ne va pas au fond du sujet. À la limite, il permet d'exonérer les exploitants de leurs propres responsabilités, car les coûts de la sécurité nucléaire sont exorbitants et que personne ne souhaite les prendre en charge.
C'est pourquoi nous pensons que cette proposition de loi n'est pas à la hauteur des enjeux.

Ce n'est pas la première fois que nous abordons cette question. Des mesures de sécurité supplémentaires ont-elles été prises pour répondre aux survols d'installations par des drones ? Ces survols posent des problèmes de prévention et de sécurité, qui dépassent la seule question de la répression des intrusions. Il est nécessaire de pouvoir identifier d'où viennent ces drones et d'être en mesure de les neutraliser. Nous demeurons dans une ambiguïté.

Nous sommes l'un des seuls pays au monde à avoir voté une loi sur la sécurité et la transparence dans le domaine nucléaire, puis sur le stockage des déchets nucléaires. Cette proposition de loi me satisfait. Sur les drones, une surveillance adaptée est actuellement à l'étude. Les réponses qui seront apportées nous permettront de compléter le texte examiné aujourd'hui par un autre texte.

Nos enceintes nucléaires doivent demeurer étanches. L'enceinte du débat politique est ailleurs.

Le dispositif envisagé pour consolider le statut des forces de sécurité intervenant sur les sites n'est pas stabilisé. Le CEA est concerné ; Areva aussi. Le bien-fondé de la mesure doit être examiné avec les organisations syndicales. La conformité au droit européen doit être vérifiée. Une seconde proposition de loi pourrait donc traiter de ce sujet et de celui des drones, comme l'a proposé Jacques Gautier.
Le plus grand danger pourrait provenir, à mon avis, d'une intrusion physique plutôt que d'un drone. C'est pourquoi l'urgence de cette proposition de loi est réelle.
Que les terroristes ne soient pas dissuadés par les sanctions prévues par cette proposition de loi, c'est une évidence, mais les autres intrus le seront. Par conséquent, la menace sera plus clairement identifiable.
Les juges sanctionnent aujourd'hui les intrus pour violation de domicile, ce qui aboutit à des peines insuffisamment dissuasives.
S'agissant des drones, les travaux du SGDSN progressent rapidement. Des projets de recherche sont lancés ; des essais doivent être réalisés. Les délais devraient être tenus. Ce travail se fait en synergie avec d'autre pays.
Quant aux lanceurs d'alerte, ils sont d'autant plus efficaces qu'ils sont eux-mêmes dans une situation juridique claire, plutôt que dans une situation d'illégalité.
EXAMEN DES AMENDEMENTS

Je vous propose d'examiner conjointement les neuf amendements du groupe écologiste. Compte tenu des positions exprimées, je comprends qu'en dehors du groupe écologiste, les autres groupes politiques y sont défavorables.

Nous respectons les opinions de chacun et répondrons en détail à chaque amendement lors de la séance publique. Les amendements n° 1 à 6 sont contraires à l'objet même de la proposition de loi. L'amendement n° 1 est un amendement de suppression. Les cinq suivants restreignent le champ d'application du texte, avec pour effet d'en limiter considérablement la portée. Si elle approuve ce texte, la commission ne peut y être que défavorable.
L'amendement n° 7 vise à informer les élus lors du passage sur leurs territoires de convois transportant des matières nucléaires. Or la confidentialité est essentielle à la sécurité de ce type de transport. Cet amendement ne me paraît donc pas acceptable.
L'amendement n° 8 vise à sanctionner les opérateurs qui ne respecteraient pas les avis de l'ASN. Un régime de sanctions existe déjà et son renforcement est prévu dans le cadre du projet de loi relatif à la transition énergétique. Ce projet de loi habilite le Gouvernement à réformer, simplifier le régime de sanctions existant et à doter l'ASN du pouvoir de prononcer des astreintes et sanctions pécuniaires.
Enfin, l'amendement n° 9 élargit l'objet du rapport demandé au Gouvernement. Or le développement de l'usage des drones constitue une problématique de sécurité à part entière, qui appelle une réflexion d'ordre juridique et technique. Un groupe de travail a été constitué par le Gouvernement. Ce groupe de travail avance rapidement. Il faut qu'il puisse nous soumettre ses propositions dans de brefs délais, d'ici à l'automne. Je vous propose donc, là encore, de ne pas adopter cet amendement.
Les amendements n° 1 à 9 ne sont pas adoptés.
Les articles 1 et 2 sont adoptés sans modification.
L'ensemble de la proposition de loi est adoptée sans modification.

Nous devons, comme chaque année, nous livrer à l'exercice - important -de l'application des lois. Ce n'est pas le tout de voter des dispositions législatives, encore faut-il les mettre en application. Alors, où en sommes-nous ?
Comme vous le savez fort bien, l'essentiel de l'activité législative de la commission consiste en l'examen de projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation de traités ou accords internationaux.
Ainsi, au cours de la session parlementaire 2013-2014, le Sénat a adopté 22 accords internationaux relevant de la compétence de la commission.
Certains de ces accords n'ont pas encore été examinés par l'Assemblée nationale et les lois n'ont donc pas toutes été promulguées, mais cela n'affecte pas notre décompte, puisque dans tous les cas, ces conventions et accords ne sont pas pris en compte dans le contrôle de la mise en application des lois.
Contrastant avec la session précédente où aucune loi n'avait été promulguée, deux lois ont été promulguées au cours de la session 2013-2014 :
- la loi du 18 décembre 2013 de programmation militaire (2014-2019) ;
- et la loi du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale.
Ces deux lois de programmation quinquennale d'initiative gouvernementale ont constitué deux rendez-vous législatifs importants.
Outre les deux lois évoquées, la commission s'est saisie pour avis de la loi du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires.
A la date du 31 mars 2015, puisque nous prenons en compte les textes d'application publiés jusqu'à cette date, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées suivait l'application de cinq lois adoptées jusqu'au 30 septembre 2014 et applicables à des degrés divers.
Comment ces lois sont-elles appliquées ?
La commission a plusieurs motifs de satisfaction.
En premier lieu, la loi d'orientation sur le développement, qui nécessitait plusieurs mesures d'application, est devenue totalement applicable moins de six mois après sa promulgation.
En deuxième lieu, et contrairement au précédent bilan d'application des lois, la commission n'a plus de loi qui soit « totalement inapplicable ». Une des mesures règlementaires que nous attendions depuis trois ans pour permettre l'application, au moins partielle, de la loi du 28 juillet 2011 tendant à faciliter l'utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure vient d'être prise sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat du 16 mars 2015 portant amélioration et simplification des règles de gestion de la réserve militaire. Je vous rappelle à cet égard que feu la Commission sénatoriale pour le contrôle et l'application des lois avait déposé, en juillet 2014, un rapport d'information rédigé par notre ancien collègue, M. Marcel-Pierre Cléach sur le bilan d'application de cette loi, qui confortait l'analyse de notre commission en rappelant que « l'absence des décrets d'application d'une loi censée garantir la continuité de la vie nationale » trois ans après sa promulgation était « une situation tout à fait anormale » et qui préconisait que les décrets d'application soient publiés dans les plus brefs délais. Ce décret prend une importance particulière dans le cadre de l'opération « Sentinelle » puisque le nombre de réservistes doit être augmenté de manière significative. Il était temps que le Gouvernement s'en rende compte ! Je souligne d'ailleurs le rapport très instructif du Gouvernement sur l'état de la réserve, reçu par la commission en novembre 2014. Je m'en félicite. Il reste pourtant du travail pour améliorer la part de la réserve militaire, comme les travaux passés de notre commission l'ont bien montré (Rapport d'information de 2010 de M. Michel Boutant et de Mme Joëlle Garriaud-Maylam « Pour une réserve nationale »).
En troisième lieu, la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 dont nous examinerons prochainement l'actualisation, est applicable à hauteur de 94 % avec vingt mesures règlementaires prises au 31 mars 2015. J'attire votre attention sur les trois derniers décrets en Conseil d'Etat publiés le 29 mars 2015 relatifs à la lutte contre la cybercriminalité. La récente attaque dont a été victime TV5 Monde en souligne toute la nécessité, s'il en était encore besoin. J'ajoute que la commission a bien reçu, en juin 2014, le rapport sur l'exécution de la loi de programmation militaire préalablement au débat d'orientation budgétaire prévu par l'article 10, ainsi que les deux bilans semestriels détaillés de l'article 8, respectivement en juin et en octobre 2014. Le ministre de la défense est venu lui-même, en son temps, nous présenter ces documents.
En quatrième lieu, un rapport global sur la mise en application de cette loi a été déposé au Parlement, le 28 juillet 2014, soit sept mois après sa promulgation. Je vous rappelle mes chers collègues, que c'est l'article 67 de la loi de 2004 de simplification du droit qui prévoit qu'« A l'issue d'un délai de six mois suivant la date d'entrée en vigueur d'une loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en application de cette loi ». En dépit de ce mois de retard, la commission en prend acte avec satisfaction, d'autant qu'il a été précédé par l'envoi à la commission, en juin 2014, d'un rapport du ministère de la défense intitulé « Rapport du ministère de la défense relatif à l'entrée en programmation 2014-2019 ». Ce document très complet, qui faisait l'objet d'une diffusion restreinte, vous a été distribué en son temps
Toutefois la commission a un regret à exprimer, celui de ne pas avoir reçu le rapport d'application pour la loi d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, qui aurait dû être transmis au Sénat au plus tard le 7 janvier 2015. C'est d'autant plus regrettable que tous les textes d'application attendus ont été pris dans un délai de moins de six mois après la promulgation. Le Gouvernement a donc manqué une occasion de faire un bon bilan de son action ! Nous lui signalerons naturellement.
En conclusion, mes chers collègues, je vous invite à vous référer à la note qui vous a été distribuée pour de plus amples informations sur le contrôle de la mise en application des lois adoptées par notre commission.
Toutes les commissions dressent en ce moment le bilan d'application des lois dans leur secteur de compétence et un document d'ensemble sera publié pour en rendre compte. Cet important travail de contrôle continue, en dépit de la suppression, en novembre 2014, de la commission sénatoriale ad hoc, puisque comme vous le savez, le Bureau du Sénat a préféré conforter les compétences des commissions permanentes en matière de contrôle de l'application des lois et renoncer à disposer d'une commission d'application des lois.
La réunion est levée à 12 h 10.