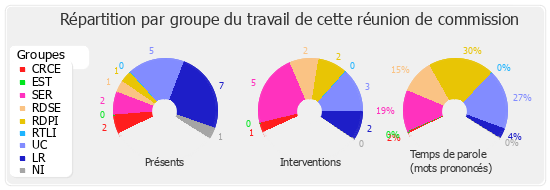Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale
Réunion du 1er mars 2016 à 18h05
Sommaire
La réunion
La commission procède à des auditions sur le projet de loi constitutionnelle n° 395 (2015-2016), adoptée par l'Assemblée nationale, de protection de la Nation.
Elle entend tout d'abord M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, et M. Christian Vigouroux, président de la section de l'intérieur du Conseil d'État.

Avec M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, et M. Christian Vigouroux, président de la section de l'intérieur du Conseil d'État, nous inaugurons la série d'auditions consacrées au projet de loi constitutionnelle de protection de la nation. Certes, nous ne leur demanderons pas de se prononcer sur la rédaction retenue par l'Assemblée nationale, même si elle diffère beaucoup de celle du Gouvernement, car il n'appartient pas au Conseil d'État de rendre un avis sur un texte adopté par une assemblée parlementaire. Du reste, pour un projet de loi constitutionnelle, le Sénat a les mêmes pouvoirs que l'Assemblée nationale, et le texte, une fois voté conforme par les deux chambres, doit être adopté en Congrès, à la majorité des trois cinquièmes - ou par référendum.
Quelle est la position du Conseil d'État sur le texte de cette révision constitutionnelle ?
Il est inusité pour moi d'évoquer un avis du Conseil d'État, non pas devant la première assemblée saisie, mais devant la seconde à se pencher sur le texte. En l'espèce, le Conseil d'État a émis un avis sur la déchéance de la nationalité française et sur la constitutionnalisation de l'état d'urgence, qui font chacune l'objet de l'un des deux articles du projet de loi constitutionnelle.
Il a estimé que le principe de la déchéance de la nationalité française pour des binationaux condamnés pour des faits de terrorisme devait être inscrit dans la Constitution, eu égard au risque d'inconstitutionnalité qui pèserait sur une loi ordinaire. Le Conseil constitutionnel a été saisi à deux reprises d'un dispositif de déchéance de la nationalité française pour des binationaux ayant acquis la nationalité française et condamnés pour des faits de terrorisme. Il a considéré qu'au regard de la procédure de déchéance de la nationalité française, la circonstance que l'intéressé soit né français ou ait acquis la nationalité française ne constituait pas une distinction pertinente. Dès lors, on ne pouvait déchoir de la nationalité française que des personnes l'ayant acquise depuis peu. Ouvrir la déchéance à l'ensemble des binationaux crée un risque, non pas au regard du principe d'égalité, puisque ceux-ci, ne risquant pas de devenir apatrides, ne sont pas dans la même situation que les personnes n'ayant que la nationalité française, et que les personnes nées françaises y seraient traitées exactement comme celles ayant acquis cette nationalité, mais parce que cela pourrait heurter un principe fondamental reconnu par les lois de la République qui interdirait de priver les personnes nées françaises de leur nationalité. Un tel principe fondamental n'a pas été consacré à ce jour, mais nous avons cru devoir signaler ce risque au Gouvernement et au Parlement.
La nationalité française est, dès la naissance, un élément constitutif de la personne, et confère à son titulaire des droits fondamentaux. L'en priver par une loi ordinaire pourrait être considéré comme une atteinte excessive et disproportionnée à ces droits, ce qui serait donc inconstitutionnel, notamment au regard de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Nous avons donc conclu qu'une révision constitutionnelle était souhaitable, pour des raisons de sécurité juridique, si le Gouvernement souhaitait mettre en oeuvre une procédure de déchéance de nationalité. Cela dit, celle-ci n'est contraire à aucun engagement international de la France, non plus qu'au droit de l'Union européenne. Pour autant, certaines précautions doivent être prises. En effet, la déchéance de la nationalité française prive la personne considérée de la citoyenneté européenne. Nous devons donc faire référence au droit de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est déjà prononcée sur des règles nationales prises en la matière et la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) pourrait être amenée à contrôler les mesures individuelles. De ce point de vue, le retrait de la qualité de citoyen de l'Union européenne devra répondre à un motif d'intérêt général et respecter le principe de proportionnalité - ce qui sera le cas s'il résulte d'une condamnation pour des crimes portant une atteinte grave à la vie de la Nation. L'expulsion du territoire national qui résulterait de la déchéance pourrait être considérée comme une atteinte excessive à sa vie privée ou familiale, protégée par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. En résumé, il n'y a pas d'obstacle de principe du point de vue du droit européen, sous réserve de faire valoir des motifs suffisamment graves.

Merci pour cet exposé très clair. J'en retiens que le Conseil d'État n'a pas identifié de principe fondamental reconnu par les lois de la République s'opposant à la déchéance de nationalité pour des citoyens nés français et qu'il n'existe pas d'obstacle de principe issu des conventions européennes, à la condition d'un motif grave - vous n'avez pas parlé de délit mais de crime. Le Conseil d'État s'est-il interrogé sur la possibilité d'étendre la déchéance à des personnes qu'elle rendrait apatrides ?

Quelle est votre position sur l'introduction des délits dans ces dispositions ? Peuvent-ils constituer un motif assez grave ? Par ailleurs, M. Badinter a estimé qu'une révision constitutionnelle n'est point nécessaire et qu'une modification des articles 23 à 25 du code civil suffirait. Qu'en pensez-vous ?

L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme peut-il interdire d'expulser un binational ? Que risquerait la France à le faire ?

L'article 16 de la Déclaration de 1789 figurait dans la Constitution de 1791, avant d'être, longtemps après, ressuscité par le Conseil constitutionnel... Il n'a pas à l'époque empêché la déchéance de nationalité, même si celle-ci n'était pas distinguée de la dégradation civique. Ce qui ne fut pas un problème pour le constituant de 1791 le serait-il pour celui de 1958 ?

Je salue l'évolution de nos moeurs politiques : il n'y a pas si longtemps, nous ne pouvions disposer des avis du Conseil d'État lorsque nous débattions d'un texte... Et voilà que le vice-président du Conseil d'État et le président de la section de l'intérieur du Conseil d'État viennent s'exprimer devant notre commission des lois ! Je m'en réjouis.

Quelles conséquences tirer du fait que l'apatridie serait contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? Autre interrogation, si une disposition similaire était mise en oeuvre dans un autre pays, que se passerait-il ?

Si un autre pays choisit d'appliquer la déchéance de nationalité à l'un de ses ressortissants, condamné pour terrorisme, qui aurait aussi la nationalité française, la France devra-t-elle accueillir cette personne ?

Le Conseil d'État me semble anticiper une décision que pourrait prendre le Conseil constitutionnel à propos d'une loi ordinaire, ou un jugement de la CJUE ou de la CEDH. Mais y a-t-il vraiment un risque que le Conseil constitutionnel consacre l'existence d'un tel principe fondamental reconnu par les lois de la République ? Il faudrait pour cela que la législation ait été constante, et qu'un droit fondamental soit mis en cause. La jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les articles du code civil en question semble indiquer que le risque est faible...
Rien ne s'oppose, dans nos engagements internationaux, à ce que nous puissions déchoir de leur nationalité des personnes condamnées qui ne seraient pas binationales. La convention de 1961 de l'ONU prévoit expressément ce cas de figure pour les motifs dont nous parlons ici. Et l'effet sur la citoyenneté européenne de la personne concernée serait-il bien réel ? Celle-ci n'est définie que de manière superficielle et ne comporte que des attributs limités.
Faut-il inclure ces dispositions concernant la déchéance de nationalité dans l'article 34 de la Constitution comme une habilitation du législateur à légiférer ? Pour l'heure, le texte les insère sous le tiret relatif à la nationalité et non dans celui qui porte sur la légalité des délits et des peines. Du coup, la décision de retirer la nationalité serait administrative, au lieu d'être prise par un juge. Qu'en pensez-vous ?

S'il y a un principe fondamental reconnu par les lois de la République s'opposant à la déchéance de nationalité pour des citoyens nés français, ou si celle-ci est contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, une révision constitutionnelle est nécessaire. Mais les révisions précédentes ont-elles modifié de telles normes ? Nous nous gardons bien de toucher aux textes fondateurs - la Déclaration des droits de l'homme n'a jamais été révisée ! - dont la valeur est supérieure à celles des constitutions successives. Le problème de conventionalité soulevé par le Conseil d'État n'est pas à négliger : la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être mise en échec par une disposition constitutionnelle nationale.

Vous partez du constat que la situation des binationaux est différente de celle des personnes n'ayant que la nationalité française. Comment la reconnaissance de cette différence peut-elle être compatible avec le principe d'égalité, dès lors qu'elle justifie une différence de traitement ? Il n'y a dès lors pas égalité entre les Français sur ce point !

Oui, l'extension aux délits doit être empêchée. Longtemps maire de Roubaix, j'ai été membre, avec Marceau Long, du Haut Conseil à l'intégration. Tout le monde comprendrait que la loi pénale prévoie une déchéance civique. Faire remonter cet interdit au niveau constitutionnel, par peur des recours, aura des conséquences en cascade. Déjà, l'Algérie révise sa propre constitution afin d'interdire aux binationaux l'accès à la fonction publique ou aux mandats électifs. Le Conseil d'État a tracé une ligne juridique claire et renvoyé le Gouvernement à ses responsabilités. Mais M. Badinter a dit qu'une loi suffisait, et il me semble que cela respecterait mieux la volonté du constituant de 1958, qui n'a pas fait par hasard de l'article 34 un bloc relatif à la nationalité.

Les révisions constitutionnelles se multiplient. Voilà au moins la dixième à laquelle je participe depuis que je suis parlementaire ! Cela ne change-t-il pas l'esprit de la Constitution de 1958 ? Celle-ci organisait un parlementarisme rationalisé en délimitant un partage des domaines entre la loi et le règlement, sans fixer elle-même de règles de fond - hormis peut-être en matière de finances publiques. La novation qui nous est proposée restreint la liberté du législateur.

L'article 2 semble n'être qu'une habilitation donnée au législateur. Les principes constitutionnels et les garanties seront-ils conservés ? L'Assemblée nationale ayant ajouté les délits, quelle sera la marge de manoeuvre d'une loi ordinaire portant sur la déchéance de nationalité ?
Pour donner son avis sur un projet de loi, le Conseil d'État analyse la totalité de la jurisprudence, européenne et nationale, déjà cristallisée. Mais il ne s'arrête pas là. Le droit doit être considéré comme un instrument vivant et évolutif, et nous devons nous montrer capables d'anticipation. La jurisprudence évolue chaque jour ! Si le principe fondamental reconnu par les lois de la République que j'ai évoqué n'est pas aujourd'hui consacré, il est fort possible qu'il le soit, à l'avenir, par le Conseil constitutionnel car, hors une loi d'avril 1848, notre législation de comporte aucune disposition permettant de déchoir de sa nationalité française une personne née française. C'est ce risque que nous avons souligné, tout en déclarant conformes au principe d'égalité les dispositions proposées.
De même, on peut déduire de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen une interdiction de déchoir de sa nationalité française une personne née française, car cela lui ferait perdre des attributs essentiels de son identité. Certes, pendant la Révolution française, cet article n'a pas empêché de prononcer des dégradations civiques. La Constitution de 1791, cependant, n'était pas républicaine mais monarchique ! Surtout, le droit constitutionnel tel que nous le pratiquons depuis 1958 est un droit vivant, et la démarche des juges constitutionnels est tout sauf originaliste. La doctrine du juge Scalia de la Cour suprême américaine, récemment décédé, ne fait école ni en Europe ni en France...
Notre analyse nous a conduits à circonscrire les motifs pour lesquels la déchéance de nationalité pouvait être prononcée. Nous avons retenu les crimes graves, quand les questions du Gouvernement évoquaient aussi les délits. Cette restriction nous semble nécessaire pour respecter le principe de proportionnalité, notamment au regard du droit européen.
Dans la question qui nous était posée, l'apatridie était exclue. Ce problème est donc absent de notre avis. La convention de l'ONU de 1961 a pour finalité d'éviter les situations d'apatridie et la convention du Conseil de l'Europe de 1997 les exclut absolument. Je rappelle cependant que, si la France a signé ces textes, elle ne les a pas ratifiés.
Faut-il une révision constitutionnelle ? Ce n'est pas nécessaire au regard du principe d'égalité. Mais le Conseil d'État a considéré qu'il y aurait un risque suffisamment sérieux à s'en dispenser.
L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme non plus que son article 3 n'ont d'effet direct empêchant la déchéance de nationalité. Mais ils imposent que l'éloignement du territoire, qui en est la conséquence, soit effectué dans le respect de certains principes : on ne peut pas exposer une personne à des risques de traitements inhumains ou dégradants, ou porter une atteinte excessive à sa vie privée ou familiale.
Le risque constitutionnel existe, même s'il ne peut être démontré avec certitude. Il y a aussi un risque conventionnel au regard du droit de l'Union européenne si le motif de la déchéance n'est pas suffisamment grave.
Il y a dans le droit français une différence très claire entre les binationaux et les personnes qui n'ont que la nationalité française, car leur situation n'est pas la même face à une mesure de déchéance.
Je me garderai bien d'établir une relation de cause à effet entre les débats au Parlement français et l'évolution de la législation algérienne, qui répond à sa logique propre.
Certes, les révisions constitutionnelles se multiplient. C'est aussi que notre loi fondamentale ne se contente plus de proclamer des principes et des droits mais les protège effectivement, ce qui rend parfois nécessaire de surmonter des verrous constitutionnels. Sans doute, on ne déroge pas expressément à la Déclaration des droits de 1789 ou au Préambule de 1946. Mais la création d'un article 53-1, par exemple, pour permettre l'application de la convention de Schengen ne déroge-t-elle pas implicitement à ce Préambule ? L'introduction dans la Constitution de l'accord de Nouméa, ou du principe de parité, n'est-elle pas un moyen de déroger à la Déclaration de 1789 ? C'est ce que le doyen Vedel appelait le « lit de justice constitutionnel », qui permet de faire évoluer le cadre constitutionnel au nom d'objectifs auxquels le constituant est attaché.

Il y a néanmoins peu de cas de révisions préventives de la Constitution. À chaque fois, la révision a été faite parce que le Conseil constitutionnel faisait obstacle à une loi...
Certaines révisions sont préventives, mais certes consécutives à une décision du Conseil constitutionnel - je songe à la nécessité de modifier notre texte fondamental pour assurer la conformité aux traités...
Le texte du Gouvernement ajoutait un article 3-1 à la Constitution. Nous avons estimé que ces dispositions n'avaient pas leur place dans un titre sur la souveraineté et qu'il valait mieux les insérer dans l'article 34, qui est un article de compétences. Il est vrai que cela reviendrait à y inscrire une habilitation pour le législateur.
L'article 25 du code civil pouvait-il suffire ? Il dispose que « l'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'État, être déchu de la nationalité française ». Il suffirait donc, en apparence, d'en supprimer les mots « qui a acquis la qualité de Français ». Mais les problèmes évoqués par M. le vice-président demeureraient. La suspicion spécifique contre les Français d'acquisition remonte à la première guerre mondiale. D'où la limitation de l'article 25 à cette catégorie. Même si les conventions de 1961 et de 1997 qui excluent l'apatridie - hors cas de fraude - n'ont pas été ratifiées, elles doivent être respectées. Du reste, l'arrêt Beghal a été pris au visa des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et sa rédaction témoigne que le Conseil d'État s'est enquis de la situation de l'intéressé au regard de la nationalité algérienne.

Aurions-nous l'obligation d'accueillir un binational déchu de son autre nationalité ?
Oui, dans ce cas, la France a l'obligation d'accueillir et de protéger cette personne - comme tous ses ressortissants. Si deux États souhaitent appliquer la déchéance de nationalité à une même personne, qui serait donc binationale, celui qui entamerait la procédure après l'autre devrait nécessairement y renoncer.
La commission entend ensuite M. Bertrand Louvel, premier président de la Cour de cassation.

Monsieur le premier président, nous souhaitions vous entendre, avant de délibérer sur le projet de loi constitutionnelle, sur la protection des libertés individuelles, puisque le texte constitutionnalise l'état d'urgence, et sur la déchéance de nationalité, au coeur des attributs de la citoyenneté et de l'identité.
Cet échange utile ne vous amènera pas sur le terrain de la discussion du projet de loi constitutionnelle - vous êtes soucieux de la séparation des pouvoirs, nous aussi.
Je suis honoré de votre invitation. Je ne me prononcerai bien sûr pas sur l'opportunité d'inscrire dans la Constitution l'état d'urgence et la déchéance de nationalité, qui ne justifie pas l'expression publique du premier président de la Cour de cassation.
En revanche, il me revient d'aborder les incidences d'ordre juridictionnel de l'article 1er du projet de loi constitutionnelle dans le contexte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En effet, celle-ci, si le pouvoir constituant l'approuve, continuera de s'imposer au législateur ordinaire appelé à fixer les mesures de police administrative pouvant être prises pendant l'état d'urgence. À cet égard, la conférence des premiers présidents des cours judiciaires, réunie le 1er février à la Cour de cassation, a constaté l'affaiblissement du rôle constitutionnel de l'autorité judiciaire en tant que gardienne de la liberté individuelle et a émis le voeu que le constituant la reconnaisse effectivement comme le garant de cette liberté dans toutes ses composantes, au-delà de la seule protection contre la détention arbitraire.
En 1958, deux textes s'appuient et s'éclairent réciproquement : la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, signée par le Général de Gaulle, qui encadre la rédaction de la nouvelle Constitution selon, notamment, le principe suivant : « L'autorité judiciaire doit demeurer indépendante pour être à même d'assurer le respect des libertés essentielles telles qu'elles sont définies par le Préambule de la Constitution de 1946 et par la Déclaration des droits de l'homme à laquelle il se réfère » ; la Constitution du 4 octobre 1958, qui applique cette prescription en affirmant dès ses premiers mots sa conformité à la loi constitutionnelle du 3 juin, proclame à l'article 64 l'indépendance de la magistrature et, à l'article 66, fait de l'autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle.
L'étude des travaux préparatoires de l'été 1958 montre que l'attribution de la garde des libertés à l'autorité judiciaire par la loi du 3 juin 1958 n'est pas discutée. La rédaction tendant à inclure les juridictions administratives dans l'autorité judiciaire n'est pas retenue, et Michel Debré résume : « La magistrature de droit commun est celle dont la Constitution doit se préoccuper car c'est elle qui assure le règlement des litiges, en particulier et fondamentalement la procédure pénale ».
La garde de la liberté individuelle, au sens pluriel que lui donne la loi du 3 juin, est donc finalement confiée à l'ordre judiciaire seul. Le Général de Gaulle le confirme dans son discours de présentation du projet de Constitution, le 4 septembre, place de la République, indiquant qu'il a été fait en sorte que « l'autorité judiciaire soit assurée d'indépendance et puisse ainsi rester la garante des libertés de chacun ». Il traduit exactement le lien entre l'indépendance du juge et les libertés plurielles confiées à sa garde.
Pendant quarante ans, le Conseil constitutionnel n'a pas touché à cette architecture. Il a rattaché à la liberté individuelle celle d'aller et venir, l'intimité de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et la liberté du mariage.
À partir de 1998, adoptant la démarche d'un arrêt précurseur du Conseil d'État de 1987, le Conseil constitutionnel tire conséquence du singulier dans l'expression « liberté individuelle », opérant une subtile distinction entre la protection contre la détention arbitraire, exclusivement rattachée à l'article 66 de la Constitution et au monopole de l'autorité judiciaire, et les autres composantes de la liberté individuelle, reliées à la seule Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et détachées du monopole judiciaire. Pourtant, précisément, la loi constitutionnelle du 3 juin reliait expressément la Déclaration des droits de l'homme à la compétence judiciaire.
Dans sa décision du 19 février 2016 relative aux perquisitions administratives, le Conseil constitutionnel énonce que ces mesures « n'ont pas à être placées sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire ». On constate le repli par rapport à l'intention du constituant de 1958. À l'occasion de l'adoption de la loi sur l'état d'urgence, cette interprétation a permis que les mesures de perquisitions de jour et de nuit, d'assignations à résidence et d'astreintes à domicile soient soumises au contrôle du seul juge administratif.
Au-delà de l'état d'urgence, on s'interroge sur la portée de la décision du 19 février dernier. Ne comporte-t-elle pas en germe la compétence du juge administratif pour autoriser une saisie non pénale, au cours d'une perquisition elle-même non subordonnée à autorisation judiciaire préalable ? Cela pourrait remettre en cause toute la jurisprudence antérieure du Conseil constitutionnel, qui avait consacré la compétence judiciaire pour autoriser des saisies à la demande d'autorités administratives, en raison du caractère intrusif de ces mesures...
Mon propos n'est pas de critiquer l'ordre administratif en tant que défenseur des libertés. Ce débat existe, en raison du double rôle du juge administratif dans l'organisation de l'État, conseil et juge, et de la finalité de sa mission orientée vers la primauté de l'intérêt général. Ce n'est pas mon débat. Le Conseil d'État a risqué courageusement son existence en 1962 en rendant l'arrêt Canal...
Néanmoins, je soutiens la reconstitution d'un bloc de compétence en matière de liberté individuelle, entre les mains du juge judiciaire.
La première raison tient à la cohérence constitutionnelle. La volonté du constituant de 1958 était parfaitement nette. L'indépendance du juge judiciaire lui est constitutionnellement reconnue pour assurer la garde des libertés. C'est cette fonction qui légitime son indépendance. Il n'est pas question à ce jour de limiter l'indépendance de l'autorité judiciaire, bien au contraire. Les projets constitutionnels vont dans le sens du renforcement de cette indépendance - je songe aux dispositions concernant le Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est un mouvement général en Europe. Mais ne distancie-t-on pas l'autorité judiciaire de son assise, de sa spécificité, pour la rapprocher du profil d'une autorité administrative indépendante - ce que suggère la jurisprudence du Conseil d'État concernant le contrôle des actes du Conseil supérieur de la magistrature ?
Le système juridictionnel français a profondément évolué au regard de ce qu'envisageait le constituant de 1958. Le juge constitutionnel est devenu le défenseur en première ligne des droits fondamentaux garantis par la Constitution. C'est lui qui définit le contenu des droits fondamentaux et qui contrôle la conformité des lois à ce contenu, et la question prioritaire de constitutionnalité est venue consacrer sa légitimité dans ce domaine.
En ce qui concerne la protection juridictionnelle des droits individuels dans les affaires particulières, l'opportunité d'effectuer un choix clarificateur s'offre au pouvoir constituant à l'occasion de la réforme constitutionnelle en cours : soit ratifier l'évolution jurisprudentielle qui partage la garde de la liberté individuelle entre deux ordres juridictionnels, soit revenir aux sources de la Vème République.
La deuxième raison tient à la logique de l'état d'urgence. Le juge judiciaire est garant des libertés en période de paix civile. La période de crise justifie une législation spéciale afin que les services administratifs agissent plus rapidement dans leur lutte contre les menaces qui pèsent sur l'ordre public. Or, c'est précisément quand la vigilance du juge naturel des libertés doit être particulièrement en éveil que l'on s'affranchit de son contrôle ! Ne se produit-il pas ici une rupture de logique ? L'intervention du juge judiciaire dans le mécanisme de l'état d'urgence est juridiquement compatible avec les pouvoirs d'action d'office imposés par les circonstances. On comprend que la loi, conformément à la possibilité ouverte par l'article 66 de la Constitution, déroge au régime ordinaire de l'autorisation judiciaire a priori. Cela ne justifie pas pour autant que le contrôle du juge judiciaire sur cette action ne puisse s'exercer a posteriori avec toute sa vigilance. Le juge judiciaire en a la pratique, à travers les multiples techniques restrictives des libertés que comportent le droit pénal et la procédure pénale, mais aussi à travers le référé civil. Ce sont ce savoir-faire et cette expérience éprouvée dont il n'est pas logique de se priver au moment même où l'on en a le plus besoin.
La troisième raison de la constitution d'un bloc de compétence judiciaire en matière de libertés tient aux difficultés juridiques qui résulteront de la double compétence juridictionnelle, dans les hypothèses où la phase administrative des mesures de l'état d'urgence évoluera en phase judiciaire, en cas de mise en évidence d'un crime ou d'un délit commis ou en préparation.
Beaucoup de renseignements peuvent être traités dès l'origine sur un plan administratif ou judiciaire, grâce au champ large de certaines infractions, comme l'association de malfaiteurs ou l'apologie du terrorisme, mais le traitement judiciaire devient incontournable à partir d'un certain degré d'indices ou de soupçons. Nous sommes alors en présence d'une succession d'actes relevant de la police administrative et donc normalement du contrôle du juge administratif, puis de la police judiciaire, relevant du juge judiciaire. Ce dernier devient-il alors compétent pour apprécier la régularité de l'ensemble, y compris la phase administrative ? Peut-il utiliser dans la procédure judiciaire des éléments recueillis dans la phase administrative ? A-t-il compétence pour réparer les dommages causés au cours de la perquisition administrative ? Ou bien chaque juge dans chacun des deux ordres conserve-t-il sa compétence et son exclusivité au nom de la séparation des pouvoirs ? En l'état, la loi et la jurisprudence entretiennent sur le sujet un débat très complexe.
Comme de nombreuses situations sont susceptibles d'être concernées par cette problématique, la constitution d'un bloc de compétence, selon une technique législative désormais habituelle, résoudrait aisément la difficulté. Cela a été le cas pour la rétention des étrangers. Les difficultés pratiques considérables connues pendant des années ont été résolues par la désignation d'un juge unique. Pourquoi ne pas en décider ainsi pour l'état d'urgence ?
La quatrième raison, qui n'est pas la moindre, tient à la lisibilité, à la simplification du dispositif juridictionnel pour nos concitoyens. La justice est rendue au nom du peuple français. Son fonctionnement doit donc lui être accessible, intellectuellement aussi bien que matériellement. Nous répondons, juges et législateurs, de la clarté du droit et des procédures. La délibération des premiers présidents que j'évoquais a attiré l'attention sur la complexité de notre organisation juridictionnelle pour nos concitoyens. L'idée qu'il puisse y avoir dualité de juges pour intervenir dans le contrôle de perquisitions ou de saisies introduit dans l'opinion publique des interrogations légitimes, qu'un bloc de compétence dissiperait. Comment comprendre qu'il existe deux ordres juridictionnels distincts pour remplir la même fonction de protecteur des libertés, avec les mêmes garanties d'indépendance et d'impartialité ? Tout esprit rationnel est fondé à s'interroger. La confusion des genres et des rôles ne peut qu'interroger la permanence de ce système dualiste.
Je suis favorable à un retour à la logique institutionnelle d'origine de la Vème République et à ce que le concept de liberté individuelle de l'article 66 de la Constitution soit précisé, de façon à éclairer la compétence du juge qui sera appelé à intervenir pour l'application du nouvel article 36-1 relatif à l'état d'urgence.

Le rôle de l'administration d'agir et de juger est enraciné dans notre tradition depuis la Révolution française. Il ne date pas de la Vème République. La décision d'un préfet est examinée par la juridiction administrative alors même qu'elle peut avoir un impact sur l'exercice des libertés.
Cette réflexion ne prive pas pour autant d'intérêt votre idée d'encourager à une évolution. Le Sénat se reconnaît une vocation d'institution protectrice des libertés individuelles. Nous avons toujours, et encore tout récemment, à l'occasion de la loi sur le renseignement ou de la prorogation de l'état d'urgence, veillé à préserver l'intervention du juge judiciaire, et même son monopole. Aller plus loin suscitera nécessairement le débat entre nous.

Je suis très sensible à votre présence ici et à la clarté, j'ose même dire la force tranquille, de votre exposé.
Sénateur depuis très peu de temps, j'ai un simple commentaire à formuler : si l'on parlait de défense nationale, tous les dignitaires du Sénat batailleraient en faveur d'un investissement pluriannuel qui la renforce. L'autorité judiciaire manque de capacité à mobiliser de tels investissements.
Ayons un objectif pragmatique et essayons de nous aligner sur le standard européen. La sécurisation du statut du parquet n'a jamais passé l'obstacle de la révision constitutionnelle. Étrange ! Il serait à mon sens prioritaire de régler cette question.
Je suis en revanche moins en accord avec vous quant à un retour à la plénitude de compétence du juge judiciaire sur les libertés individuelles.

Le propos du premier président de la Cour de cassation, public et ouvert à la mémoire, marquera. Il me paraît aller loin dans la remise en cause de notre ordre juridique. La loi de 1790 a consacré la séparation de l'administratif et du judiciaire. Monsieur le premier président, si l'on suit votre raisonnement, énoncé avec talent, il faudra fixer une autre limite... Vous ne dites pas laquelle.
Les fondements de votre prise de position sont fragiles. Vous présentez la rédaction de l'article 66 comme un accident, une inadvertance, en feignant de considérer que le pouvoir constituant était l'Assemblée nationale quand elle a voté la loi de délégation des pouvoirs constituants - dans l'ambiance que chacun a en mémoire... Les libertés individuelles sont certes mentionnées dans la loi d'habilitation, mais tirer de trois mots de cette loi une volonté du pouvoir constituant est fragile en droit. La rédaction de l'article 66, finalement au singulier - « la liberté individuelle » -, ne doit rien au hasard.
Vous englobez plusieurs concepts différents : la liberté individuelle, celle d'aller et venir et ses compléments ; les libertés publiques, consubstantielles à l'existence du juge administratif ; et la protection des droits - droit à un procès équitable par exemple.
Soulever à nouveau ce débat est judicieux. Le Conseil constitutionnel a dressé une limite entre les mesures privatives de liberté, compétence de l'autorité judiciaire, et les mesures restrictives de liberté, relevant des libertés publiques, donc du pouvoir de la police et de l'administration, sous le contrôle du juge administratif. Il ne s'agit pas d'une spécificité française. Cela se retrouve dans un grand nombre de pays d'Europe, et ailleurs.
Quelles sont les conséquences ultimes de votre raisonnement ? Quels actes doivent être soustraits du pouvoir du juge administratif ? Où se situerait la nouvelle limite ? Le raisonnement que vous défendez est extensible à tous les actes de police administrative.

Je ne tire pas de votre propos, monsieur le premier président, les mêmes conclusions que M. Richard. Je ne suis ni conseiller d'État, je n'ai jamais cherché à l'être, ni magistrat judiciaire. Votre exposé a le mérite de poser des questions fondamentales. Le Sénat, défenseur des libertés, est témoin d'évolutions législatives qui posent de plus en plus problème. Je l'ai évoqué lors de l'examen de la loi relative au renseignement.
Il existera toujours des débats sur l'interprétation de la Constitution de 1958. Mais la réalité est que, après la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, pratiquement rien n'a bougé pendant quarante ans. On peut donc penser que certaines interprétations récentes ne sont pas conformes à l'esprit initial des constituants.
Personne ne remet en cause la séparation des pouvoirs. Mais le législateur adopte des projets de loi gouvernementaux qui donnent au juge administratif le contrôle essentiel des libertés individuelles : cela pose un problème de fond. On constate en outre une complexification évidente, qui est une mauvaise chose. Il est temps de mettre fin à cette évolution ou, au moins, de ne pas persévérer dans cette voie. Les dispositions proposées par le Gouvernement devraient poser question à ceux qui, dans les années 2010, jugeaient scandaleuse une rétention de quatre heures... S'ils ont oublié leurs propos de l'époque, je me ferai un plaisir de les leur rappeler dans le débat public.

L'énonciation de principes généraux était beaucoup plus simple en 1958, sans contrôle de constitutionnalité systématique. Maintenant, la promulgation de la loi ne signe pas la fin du contrôle de constitutionnalité. N'est-ce pas ce qui explique le glissement de l'interprétation du Conseil constitutionnel concernant l'article 66 ?
La rédaction actuelle de l'article 2 du projet de loi de révision constitutionnelle autorise-t-elle à considérer la déchéance de nationalité comme une peine complémentaire, et non comme une décision administrative ? Pose-t-elle des difficultés quant au respect des conventions et du droit européen ?

Je mesure le péril à entrer dans cette discussion passionnante. Elle sera plus pertinente lors de la discussion du projet de loi réformant la procédure pénale.
Monsieur le premier président, vous avez rappelé le glorieux arrêt Canal du Conseil d'État. Vous auriez aussi pu citer le premier président Touffait, qui a admonesté et chassé du palais ceux qui n'avaient rien à y faire, pour garantir l'indépendance de la justice judiciaire. Actuellement, la distinction entre l'administratif et le judiciaire n'est pas aussi tranchée qu'on le dit. L'article 111-5 du code pénal autorise le juge pénal à se prononcer sur la légalité de mesures prises dans le cadre d'une opération administrative. Le juge judiciaire n'a pas défense absolue de se préoccuper de mesures administratives.
Le considérant de la dernière décision du Conseil constitutionnel relatif aux saisies montre une évolution. À nous de voir quelles garanties mettre en place pour que ces saisies soient légales.
Il restera deux ordres de juridiction, et tant mieux pour les libertés, si chacun joue son rôle. L'article 66, c'est l'habeas corpus. Je suis sensible à l'argumentation de notre collègue Alain Richard, mais il a fait attention à ne pas évoquer les travaux préparatoires, qui expliquent la volonté du constituant et montrent une interprétation de l'article 66 plus large qu'actuellement. C'est à nous, constituant, de fixer les règles, y compris dans la loi de procédure pénale. La liberté individuelle est déjà un champ assez large. Sans révolution, le Parlement doit parler et dire les choses. Les juges judiciaires prennent rarement la parole. Quand ils le font, on ne peut pas ne pas l'entendre. Au constituant de trancher. S'il laisse subsister le flou, il s'en remet au Conseil constitutionnel.
La rétention de quatre heures est-elle une mesure privative de liberté, une peine ou une mesure anodine ? Les temps changent et il est normal d'évoluer, mais les mesures doivent être qualifiées.
Monsieur le premier président, votre exposé était passionnant, mais vous n'avez rien proposé comme mesure précise à laquelle nous puissions répondre.

À Orléans, où j'habite, un attentat a été déjoué, deux personnes interpellées. Des autorités administratives, la presse, et d'autres, en ont conclu que l'état d'urgence était très utile. Or ces interpellations sont dues à une enquête longue et minutieuse du parquet anti-terroriste, qui n'a rien à voir avec l'état d'urgence. Je le dis pour répondre à ceux qui pensent que l'état d'urgence serait l'alpha et l'omega.
J'ai beaucoup d'intérêt intellectuel pour votre discours, mais une question reste posée : si vous souhaitez changer la répartition entre judiciaire et administratif, il faut dire où et comment situer la limite.

Nos collègues délivrent leurs convictions argumentées, menant à une question sous-jacente : puisque vous prenez une position publique, de quelle manière suggérez-vous de redécouper les compétences ?
Une anecdote : un mot du projet de loi constitutionnelle de juin 1958 n'a pas franchi la barrière de la commission des lois de l'Assemblée nationale de l'époque, celui de « pouvoir » judiciaire. M. Teitgen s'y était opposé, dénonçant le risque de gouvernement des juges, qui se seraient saisis du contrôle de constitutionnalité. Avec le terme « autorité », les députés ont maintenu le rôle de gardien des libertés.
Quelle proposition faisons-nous ? Ma réponse est simple : ajouter trois « s » supplémentaires au deuxième alinéa de l'article 66 pour écrire « les libertés individuelles ». Vous rétabliriez l'esprit de 1958 et la jurisprudence du Conseil constitutionnel pendant quarante ans, en restaurant la liberté individuelle dans toutes ses composantes : le droit de ne pas être détenu arbitrairement, le secret de la correspondance, l'inviolabilité du domicile et la liberté d'aller et de venir. Ce sont les libertés qu'un individu peut exercer seul, sans rapport à la société, à la différence des libertés collectives, exercées ensemble, liberté d'expression, de culte, de réunion ou de manifestation.
Je n'ai nullement demandé une remise en cause de la séparation des pouvoirs, mais la création d'un bloc de compétence au profit du juge le plus qualifié pour cela, comme pour le droit des étrangers.

Merci de la clarté et de la fermeté de votre exposé stimulant.
La réunion est levée à 20 h 25