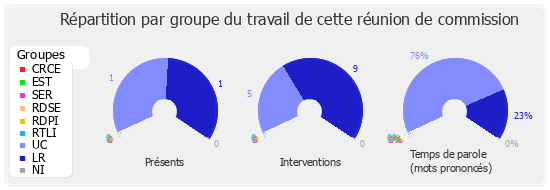Commission des affaires européennes
Réunion du 28 avril 2011 : 1ère réunion
Sommaire
- Modernisation des marchés publics proposition de résolution de m. simon sutour (voir le dossier)
- Économie finances et fiscalité (voir le dossier)
- Application du principe de subsidiarité à l'harmonisation des taux de tva proposition de résolution de m. jean bizet (voir le dossier)
- Élargissement (voir le dossier)
- La situation de la « macédoine » communication de m. jean-françois humbert (voir le dossier)
- La situation au kosovo communication de m. jean-françois humbert (voir le dossier)
- La situation à chypre communication de m. denis badré (voir le dossier)
La réunion

J'en viens au premier point de notre ordre du jour. Après l'audition de Michel Barnier en janvier, nous avions retenu trois thèmes sur lesquels il nous paraissait plus particulièrement utile de prendre position :
- tout d'abord les concessions de service, sujet que nous avons déjà examiné,
- ensuite, le détachement des travailleurs, sujet sur lequel nous nous sommes déjà également prononcés,
- enfin, les marchés publics, que nous allons examiner aujourd'hui.

Très technique, la législation de la commande publique n'en a pas moins des conséquences immédiates et quotidiennes sur les services et l'organisation de nos collectivités territoriales, de l'État et plus généralement des services publics. Or, la Commission européenne fait montre depuis six mois d'une volonté de légiférer sur la plupart des aspects de cette matière. Il m'a donc semblé que notre commission ne pouvait pas rester à l'écart de ses réflexions.
Il y a un peu plus d'un mois, je vous présentais une proposition de résolution relative aux concessions de service public, qui est devenue depuis résolution du Sénat. Ce texte était le premier volet de notre réaction aux nombreuses initiatives en cours et annoncées de la Commission européenne en matière de commande publique.
L'actualité est en effet riche.
En octobre 2010, la Commission européenne publiait un Livre vert sur le développement des marchés publics électroniques. Toujours en octobre 2010, la Commission publiait sa communication intitulée « Vers un acte pour le marché unique » et présentée par Michel Barnier. Deux de ses 50 propositions concernaient directement la commande publique au sens large. Ainsi, la proposition n° 18 prévoit que « la Commission adoptera en 2011 une initiative législative sur les concessions de services ». C'est cette proposition qui a motivé notre première résolution européenne de mars que j'évoquais à l'instant.
Sa proposition n° 17 concerne directement notre réunion d'aujourd'hui. Elle dispose qu' « après l'évaluation en cours de la législation européenne des marchés publics, et sur la base d'une large consultation, la Commission fera au plus tard en 2012 des propositions législatives visant à simplifier et à moderniser les règles européennes pour rendre plus fluide l'attribution des marchés, et à permettre un meilleur usage des marchés publics en soutien à d'autres politiques. » La Commission européenne souhaite accroître la part des achats publics transfrontières (1,5 % en 2009) et faire de la commande publique un vecteur d'appui important pour, par exemple, l'innovation, la protection de l'environnement ou l'emploi qui sont au coeur de la stratégie UE-2020.
La Commission européenne n'a pas tardé à mettre en oeuvre cet engagement n° 17, puisque dès le 27 janvier 2011, elle publiait son Livre vert sur la modernisation de la politique de l'Union européenne en matière de marchés publics. C'est sur ce document, qui prépare les futures initiatives de la Commission, que je vous propose de réagir.
Avant de vous présenter le Livre vert, je ferai un bref rappel du droit communautaire applicable aux marchés publics.
La dernière grande réforme de la législation communautaire relative aux marchés publics remonte à 20004. Deux directives du 30 avril 2004 ont en effet refondu plusieurs textes. Ces deux directives ont eu pour objectif affiché :
- de clarifier et de simplifier les règles européennes en vigueur ;
- de permettre aux autorités adjudicatrices de recourir aux nouvelles technologies pour gérer les appels d'offre (publicité, soumission et examen des offres, enchères électroniques...) ;
- de prendre en considération des critères sociaux et environnementaux lors de l'attribution des marchés.
Elles se sont appuyées le plus souvent sur la jurisprudence de la Cour de justice européenne. Elles mettent aussi en oeuvre les règles internationales applicables aux marchés publics, en particulier celles définies dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Elles détaillent les procédures à la disposition des autorités adjudicatrices selon les types et l'objet des marchés.
Ces directives ne s'appliquent pas à tous les marchés publics. N'en relèvent pas ou seulement partiellement :
- les marchés dont le montant est inférieur aux seuils d'application des directives «marchés publics» ;
- certains marchés de services dont le montant dépasse les seuils d'application de ces directives.
Par ailleurs, les concessions de services n'entrent pas dans le champ de ces directives, à la différence des concessions de travaux.
Toutefois, le fait que ces directives ne s'appliquent pas à certains marchés ne signifie pas que le droit communautaire leur soit étranger. La Cour de justice européenne a confirmé dans sa jurisprudence que les règles du marché intérieur s'appliquaient également aux marchés qui ne relèvent pas du champ d'application des directives «marchés publics» pourvu qu'ils présentent un intérêt transfrontalier.
Il faut enfin mentionner la directive du 11 décembre 2007 dite « recours » qui exige des autorités publiques qu'elles attendent un certain nombre de jours (« délai de suspension ») avant de conclure un marché public. La directive cherche également à combattre l'attribution illégale de marchés publics de gré à gré. Les tribunaux nationaux sont habilités à rendre sans effet ces marchés s'ils ont été conclus illégalement, sans transparence et en l'absence de toute procédure de mise en concurrence préalable.
J'en viens à présent au Livre vert sur les marchés publics présenté en janvier dernier.
Ce document passe en revue une série de problèmes et d'interrogations sur l'efficacité, la précision et les lacunes des directives en vigueur. Comme tout livre vert, il n'avance pas de solutions définitives, mais dessine des pistes de réflexion auxquelles chaque partie intéressée peut réagir. Au total, ce Livre vert formule 114 questions. Il balaie donc à peu près tous les thèmes. Je ne les passerai pas tous en revue, mais j'insisterai sur quelques points importants qu'il nous semble devoir soit soutenir, soit repousser à ce stade précoce de la discussion communautaire.
Les objectifs énoncés par la Commission européenne sont clairs. Il s'agit de soutenir la stratégie UE-2020. Cela passe par plus de simplicité et l'utilisation des marchés publics en soutien à d'autres politiques. Toutefois, la Commission est consciente que ces deux objectifs peuvent être contradictoires. La simplicité n'est pas facile à concilier avec la poursuite d'une multiplicité de priorités.
Quels arbitrages devons-nous retenir pour notre part ?
Tout d'abord, il faut se poser la question de la nécessité d'une révision des directives de 2004. Sur ce point, le Livre vert n'avance pas d'arguments très précis. Et pour cause, puisque la Commission européenne mène en ce moment même une évaluation exhaustive de l'impact et du rapport coût-efficacité de la politique de l'Union en matière de marchés publics. Cette étude ne devrait être disponible que cet été. Le Livre vert lance donc des pistes sans les étayer réellement.
Pour ma part, je n'ai pas constaté dans notre pays une demande forte de révision des règles des marchés publics. Au contraire, il semble y avoir une demande de stabilité après de nombreuses modifications du code des marchés publics. Souvent remanié, ce code commence seulement à être pleinement assimilé par ses utilisateurs quotidiens.
Il ne semble donc pas opportun de bouleverser à nouveau les règles du jeu. C'est le premier point qu'il me semble devoir souligner. Il faut préserver une certaine stabilité. Surtout si on ne constate aucun dysfonctionnement majeur.
Comme je le dis souvent, le mieux est parfois l'ennemi du bien.
Faut-il pour autant ne rien changer ? Sans doute pas. Mais ce souci de stabilité relative doit guider absolument notre réflexion. On peut en déduire deux axes d'action.
Le premier est qu'aucune modification des directives de 2004 ne devra entraîner une complexité supplémentaire. La simplicité doit être le maître mot.
Le second axe est qu'il faut laisser plus de liberté aux autorités adjudicatrices. Elles sont responsables de leurs achats, dans le respect bien entendu des grands principes des traités (égalité, transparence, non discrimination). Une future révision des directives « Marchés publics » devra donc ne pas ajouter des règles aux règles, mais élargir la palette d'outils à la disposition des autorités adjudicatrices. Celles-ci resteraient libres de les utiliser ou pas.
Ces préalables posés, plusieurs pistes avancées par le Livre vert méritent d'être soutenues.
La première, la plus importante, est l'idée d'étendre très largement la faculté pour les autorités adjudicatrices de recourir à la procédure dite négociée avec publication préalable d'un avis de marché.
Sans vous rappeler dans le détail toutes les procédures d'attribution des marchés existantes, je citerai simplement les appels d'offre ouverts ou restreints, le dialogue compétitif, les concours et les procédures négociés avec ou sans publication préalable. Les procédures négociées sont définies par la directive de 2004 comme les procédures dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs consultent les opérateurs économiques de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.
Selon les directives en vigueur, les cas dans lesquelles il peut être recouru à cette procédure sont très limités.
Or, l'expérience des marchés publics montre que souvent, les procédures ouvertes ou restreintes classiques ne sont pas optimales. Les candidats sont peu nombreux, surtout sur des marchés oligopolistiques. Le recours à la négociation permettrait d'obtenir des offres bien plus intéressantes et adaptés aux besoins.
Au surplus, la récente réforme de notre code des marchés publics en 2006 a montré le succès des MAPA (marchés à procédure adaptée). Ces marchés, dont les modalités sont librement décidées par les autorités adjudicatrices, peuvent être passés pour des marchés inférieurs aux seuils communautaires. Ces MAPA sont très appréciés par nos collectivités.
En étendant le champ des procédures négociées au niveau communautaire, on irait dans ce sens d'une responsabilisation et d'une plus grande liberté des acheteurs publics.
Toutefois, il faut être conscient que ces procédures plus souples offrent peut-être moins de garanties que des procédures très encadrées au regard du respect des grands principes des traités, voire de la lutte contre le favoritisme ou la corruption. Pour ces raisons, il me semble qu'il serait plus sage de laisser à chaque État membre une option de retrait ou de « opting out », s'il estime que ses autorités adjudicatrices ne sont pas assez matures pour maîtriser cet outil nouveau. Les 27 États membres ne sont pas tous au même niveau. Je n'en dirai pas plus...
Parmi les autres pistes du Livre vert que nous pouvons soutenir, il y a le relèvement de certains seuils communautaires, en particulier pour les marchés de biens ou de services. Un bémol néanmoins, puisque ces seuils sont calés sur ceux définis dans le cadre de nos engagements internationaux à l'OMC. Leur révision ne sera donc pas facile. De même, il serait intéressant d'imaginer des procédures simplifiées pour l'achat de biens et de services commerciaux, c'est-à-dire de biens standardisés disponibles aisément sur le marché et dont le prix et la qualité sont semblables partout.
Un autre thème important est celui du soutien aux PME. Ces entreprises continuent à avoir du mal à répondre à certains appels d'offre en raison de la complexité des phases de sélection des candidats et d'attribution. Le Livre vert évoque de nombreuses pistes. Il ne me semble pas pertinent de réserver un pourcentage des marchés aux PME. Ce serait une source supplémentaire de complexité. En revanche, un allègement des charges administratives encouragerait plus de PME à soumissionner. Une idée serait d'inverser les phases d'attribution des marchés et de sélection des candidats. Les PME ne devraient fournir l'intégralité des documents que si elles ont été retenues.
Incidemment, je pense qu'en aidant les PME, on peut encourager indirectement des fournisseurs locaux. Cet angle pour favoriser nos entreprises locales me semble assez habile et ne braquera pas la Commission européenne qui fronce les sourcils dès qu'on lui parle de proximité.
Le dernier thème fort du Livre vert est l'utilisation des marchés publics en soutien des politiques sociales ou environnementales. Là encore, sur le principe, nous pouvons être d'accord. Mais les modalités doivent préserver les libertés des autorités adjudicatrices. Les directives doivent permettre aux autorités d'orienter les marchés publics vers la poursuite de ces objectifs si elles le souhaitent. Mais elles ne doivent pas les obliger à le faire. Il faut rester ferme et refuser de se voir prescrire « quoi acheter ».
Il paraît aussi préférable de prendre en compte ces objectifs dans la phase d'attribution des marchés uniquement, quitte à imaginer un troisième critère à côté du prix le plus bas et de l'offre économiquement la plus avantageuse. Dans la phase de sélection des candidats, il y a en revanche un vrai risque d'alourdissement des charges administratives pour les entreprises et pour les autorités adjudicatrices.
Je terminerai en évoquant les deux points qui méritent à l'inverse de fortes réserves de notre assemblée.
Le premier concerne les coopérations public-public. Brièvement, il s'agit de toutes les coopérations et mutualisations que des personnes publiques mettent en place entre elles. Cela vise notamment les coopérations entre communes. La Commission européenne a été tentée de soumettre ces coopérations aux règles de la commande publique. Toutefois, comme l'analyse très bien un rapport de notre délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, la jurisprudence récente de la Cour de justice de l'Union a remis en cause cette analyse en autorisant des autorités publiques à coopérer entre elles en dehors des règles de la commande publique. Cette jurisprudence est encore très récente et toutes ces virtualités ne sont pas encore clairement cernées.
Or, on perçoit chez la Commission européenne la tentation de circonscrire cette jurisprudence. Le Livre vert suggère donc d'élaborer un cadre qui délimiterait ce qui relève ou non de la coopération public-public.
L'Association des maires de France que j'ai consultée y est farouchement opposée, estimant qu'un Livre vert sur les marchés publics n'est pas le lieu pour discuter de la coopération public-public. La position de principe est en effet que cette coopération n'a rien à voir avec la commande publique et qu'il faut tirer profit au maximum de la jurisprudence de la Cour avant de vouloir stabiliser les choses.
Je vous propose donc de souscrire à cette stratégie. De la même façon, il faut poser des garde-fous pour dissuader la Commission européenne d'étendre aux concessions de services certaines règles des marchés publics. La loi Sapin est un bon équilibre qu'il faut préserver.
Enfin, s'agissant de la corruption et du favoritisme, le Livre vert suggère d'étoffer le dispositif législatif. Sans s'y opposer, je crois utile de mentionner dans la résolution que la législation française est déjà très complète. Mais peut-être cette proposition vise-t-elle d'autres États membres.
Pour ces raisons, je vous propose d'adopter la proposition de résolution qui vous a été transmise avant-hier. Nous nous situons très en amont du processus législatif communautaire. Il s'agit d'influencer ses lignes directrices, sachant que nous aurons à en connaître de nouveau lorsque la Commission présentera ses initiatives législatives.

Il est très important de soutenir nos PME, car notre tissu économique n'est pas assez équilibré. Par ailleurs, les maires sont demandeurs de plus de liberté pour négocier certains contrats. La souplesse est importante car la formule de l'appel d'offre classique n'est pas toujours la mieux adaptée.

La principale logique qui anime la proposition de résolution est de ne pas cadenasser plus l'action de nos collectivités territoriales. Je crois vraiment que l'expérience des MAPA démontre la maturité de nos autorités adjudicatrices.

Nous avons intérêt, sur ces sujets, à coordonner nos positions avec l'Association des maires de France pour peser sur la Commission européenne. Ce Livre vert va globalement dans le bon sens et contient de nombreuses pistes intéressantes.
À l'issue de ce débat, la commission a conclu à l'unanimité au dépôt de la proposition de résolution suivante :

Le 1er décembre dernier, la Commission européenne a lancé une vaste consultation publique (« Livre vert ») sur le système de la TVA en vue d'une simplification et d'une amélioration de ce système. La consultation est ouverte jusqu'à la fin du mois de mai 2011.C'est la raison pour laquelle il m'a semblé opportun d'ouvrir le débat sur la question des taux réduits, et d'une manière plus générale sur la liberté pour les États membres de fixer les taux quand certaines conditions sont réunies.
Dans son Livre vert, la Commission européenne estime nécessaire de parvenir à un système plus simple, plus moderne et plus efficace pour la collecte d'une ressource fiscale majeure des États membres (en moyenne 21,4 % du total des rentrées fiscales, soit 862 milliards d'euros).
La Commission a articulé son Livre vert autour de 33 questions qui portent sur les fondements du système comme sur les problèmes spécifiques ; elle envisage d'harmoniser les taux et de limiter la possibilité d'établir des taux réduits pour certains services ou produits. Ce dernier aspect de la position de la Commission me paraît critiquable. Je crois que le problème n'est pas bien posé.
Les règles actuelles concernant les taux réduits sont issues de la directive TVA de 2006 modifiée en 2009.
La directive de 2006 permet aux États membres d'appliquer un ou deux taux réduits d'un minimum de 5 % aux biens et services énumérés dans une liste limitative figurant en annexe de la directive. Pour les autres activités ne figurant pas dans la liste, il est possible de demander des dérogations.
Il faut rappeler qu'en janvier 2006, le Conseil avait donné mandat à la Commission de présenter un rapport sur l'impact des taux réduits appliqués à certains services fournis localement en termes d'emploi, de croissance économique et de bon fonctionnement du marché intérieur.
C'est ce rapport qui a débouché sur la directive de 2009 autorisant l'application facultative de taux réduit sur la valeur ajoutée pour certains services à forte intensité de main-d'oeuvre fournis au niveau local, et pour lesquels il n'existe pas de risque de concurrence déloyale entre les prestataires de services dans les différents États membres. C'est dans cette liste de services qu'a été placée la restauration, à la demande de la France.
Je crois que cette question, à la lumière du traité de Lisbonne, devrait désormais être examinée dans une optique de subsidiarité.
En effet, dès lors que le recours aux taux réduits ne crée pas de dysfonctionnement dans le marché intérieur et qu'il n'y a pas de risque de distorsion de concurrence, il n'est pas nécessaire de tendre vers l'harmonisation des taux de TVA.
Au contraire, il conviendrait d'envisager alors la possibilité de recourir à une pleine application du principe de subsidiarité.
Si, en règle générale, l'harmonisation de la TVA concourt au bon fonctionnement du marché unique, en revanche, chaque fois que la taxation des biens et services n'entraîne aucune distorsion significative du marché intérieur, la décision devrait être du ressort de chaque État membre. Par exemple, comment justifier qu'il faille une décision européenne pour modifier le taux de TVA applicable à la coiffure ? Personne ne change d'État membre pour se faire coiffer.
Aujourd'hui, la question se pose avec acuité pour la filière équine pour laquelle la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % au titre des opérations portant sur les produits d'origine agricole et pour les gains perçus par les propriétaires à l'occasion de courses hippiques, et même au taux très réduit de 2,1 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie à des personnes non assujetties à la TVA.
La doctrine administrative française compte les équidés parmi les animaux de boucherie et de charcuterie parce qu'ils sont des produits d'origine agricole. Cela a pour conséquence que les opérations de monte et de saillie, les activités d'entraînement, de prise en pension et d'enseignement de l'équitation, s'analysent comme des opérations portant sur des produits agricoles, qu'il s'agisse de ventes pour la boucherie ou pour l'hippodrome.
Depuis 2007, la Commission veut contraindre la France à modifier son taux, mais les représentants français rappellent que la quasi-totalité des chevaux est destinée in fine à l'abattage pour la boucherie ou à l'équarrissage, et qu'à ce titre, ils relèvent bien du taux réduit, que l'élevage des animaux est une activité agricole et que toutes les opérations d'entraînement et de vente s'insèrent dans la filière agricole.
Selon l'avis du Conseil économique et social de 2010 présenté par M. Jacky Lebrun (« Les enjeux et les perspectives de la filière équine en France »), la filière équine représenterait 75 000 emplois en France, dont la moitié liée aux courses ; la plupart des 55 000 entreprises qui y concourent sont de très petite taille et elles génèrent 12 milliards de chiffre d'affaires (dont 10 pour les courses). Il ne fait aucun doute que le passage à un taux plus élevé de TVA aurait un effet déstabilisant.
Toutefois, le 3 mars dernier, dans l'arrêt C41/09 Commission contre Pays-Bas, la Cour de justice de l'Union européenne a condamné les Pays-Bas en raison de leur taux réduit de TVA appliqué aux livraisons, importations et acquisitions de chevaux. La Commission a également engagé des procédures à l'encontre de l'Allemagne, l'Autriche, l'Irlande et la France. La Commission estime qu'il n'est pas possible « à un État membre d'appliquer un taux réduit à l'ensemble des livraisons de chevaux vivants, et ce, quelle que soit la destination de ceux-ci ». Pour la Commission, le taux réduit ne saurait concerner que les animaux destinés à la consommation.
La filière équine illustre la divergence existant entre la Commission et les États membres en matière de taux réduit de TVA et la position intransigeante de la Commission menace de fait certaines filières économiques fragiles alors même que la concurrence n'est pas faussée par l'application d'un taux réduit.
La Commission des Finances du Sénat, que j'ai consultée, m'a répondu par la voix de son Président qu'elle était sensible à la problématique de la subsidiarité. Toutefois la Commission des Finances constate un écart important entre le taux réduit et le taux normal et serait favorable, dans certains cas, à un taux intermédiaire. Ce n'est pas contradictoire avec l'approche que je vous propose, qui consiste à laisser plus de souplesse aux États membres lorsqu'il n'y a pas de risque d'atteinte au marché intérieur.
Ce que je vous propose, Chers Collègues, c'est donc de réaffirmer le principe de subsidiarité en matière de fixation des taux de TVA, quel que soit le montant de ces taux, chaque fois qu'il n'y pas de distorsion de concurrence possible. C'est le sens de la proposition de résolution que je vous demande d'adopter.

Je saisis cette occasion pour rappeler mon intérêt pour la filière équine et ma connaissance de ce secteur, mais je demande que l'on garde en mémoire le difficile débat sur les taux réduits et en particulier celui sur le taux réduit pour la restauration ; il convient d'être prudent et de ne pas ouvrir la boîte de Pandore dans la mesure où ce type de débat a toujours pour conséquence d'encourager les très nombreux secteurs, qui aspirent à un taux réduit, à faire valoir leurs revendications alors même qu'aujourd'hui la conjoncture économique comme les esprits poussent plutôt vers une augmentation des taux de TVA. Sous la pression de la crise, beaucoup de pays européens ont relevé leurs taux. Dans un pareil contexte, il faut bien voir que plus on augmente le taux normal de TVA, plus on creuse l'écart avec le taux réduit, rendant relativement intolérable le taux normal et plus désirable le taux réduit. C'est pour cela que la commission des finances du Sénat plaide depuis longtemps pour la création d'un taux intermédiaire autour de 12 %.
Par ailleurs, je souhaite que la résolution marque très clairement que c'est seulement dans les cas où il n'y a pas de risque de distorsion que le principe de subsidiarité doit s'appliquer, car l'harmonisation obtenue au sujet de la TVA est dans l'ensemble positive.

Je remarque que nous faisons référence à un taux intermédiaire, mais que nous n'en parlons pas dans le corps de la résolution et je suggère que nous introduisions cette notion.

Je voudrais apporter deux précisions. Tout d'abord, dans le cas de la filière équine, il ne s'agit pas d'introduire un nouveau taux réduit, mais de maintenir le régime en vigueur. Ensuite, dans les cas où la subsidiarité peut jouer, il s'agit de donner plus de latitude aux États membres, y compris pour l'utilisation d'un taux intermédiaire éventuel.
À l'issue de ce débat, la commission a conclu au dépôt de la proposition de résolution suivante :
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu le Livre vert de la Commission européenne intitulé « Vers un système de TVA plus simple, plus robuste et plus efficace » du 1er décembre 2010, instaurant une consultation publique sur la réforme de la TVA,
juge que cette initiative est nécessaire et qu'elle doit déboucher sur une plus grande simplicité et une plus grande souplesse du système de TVA en matière de taux réduits ;
observe que, pour certaines activités, l'application de taux différents de TVA aux activités d'une filière économique n'entraîne pas une distorsion de concurrence significative entre les prestataires des différents États membres, rendant alors inutile une harmonisation des taux ;
estime que c'est à bon droit que dans le cas particulier de la filière équine, la France ne partage pas l'analyse de la Commission européenne qui tend à priver la filière équine du bénéfice de l'application d'un taux réduit, voire d'un taux intermédiaire de TVA, au motif que tous les chevaux ne sont pas destinés de manière générale ou habituelle à la consommation ;
considère au contraire que le taux réduit de TVA doit continuer à s'appliquer à l'ensemble de la filière équine tant à la livraison des équidés qu'aux activités qui s'y rattachent ;
rappelle que la réglementation européenne sur la sécurité alimentaire s'applique à tous les détenteurs de chevaux et que l'élevage de chevaux constitue une activité agricole, quelle que soit la destination de l'animal ;
estime que chaque fois que des taux différents de TVA ne peuvent pas être un facteur de distorsion significative de la concurrence au sein du marché unique européen, il convient d'appliquer le principe de subsidiarité ;

Nous changeons totalement de sujet pour le troisième point de notre ordre du jour : nous poursuivons notre suivi de l'élargissement vers les pays des Balkans, en examinant aujourd'hui la situation de l'Ancienne République Yougoslave de Macédoine.
Je donne la parole à Jean-François Humbert qui m'a indiqué qu'il profiterait de l'occasion pour faire une brève mise au point concernant la situation au Kosovo.

Le groupe interparlementaire France - Balkans occidentaux s'est rendu la semaine passée à Skopje pour y rencontrer pendant trois jours responsables politiques et acteurs internationaux. Avec nos collègues Marie-Thérèse Bruguière et Jean-Pierre Michel, nous souhaitions connaître la situation du pays, indépendant depuis 1991, mais beaucoup moins médiatisé que la Serbie, le Kosovo ou la Bosnie-Herzégovine. Comme vous pouvez le noter, mon propos liminaire ne cite pas expressément le nom du pays visité. Je reviens, en effet, d'un pays qui, aux yeux de l'Union européenne, n'a pas réellement de nom.
Le constat est abrupt mais l'appellation « République de Macédoine », le nom constitutionnel retenu lors de l'accession à l'indépendance, n'est, en effet, pas admise au sein des institutions communautaires. Le dernier rapport de progrès de l'Union européenne est, à cet égard, un terrible révélateur : même l'adjectif « macédonien » n'est pas une seule fois cité. Le principe de solidarité avec la Grèce, qui récuse à Skopje le droit de conserver le nom initialement retenu, pousse les 26 autres États de l'Union européenne à ne reconnaître qu'une dénomination technocratique : l'ancienne République yougoslave de Macédoine. C'est sous ce nom, considéré à l'époque comme provisoire, que Skopje devient membre des Nations unies, un médiateur étant nommé en 1994 pour résoudre le conflit.
La querelle avec Athènes sur le nom dure désormais depuis vingt ans. Elle se cristallisait au départ sur plusieurs points :
- le nom de Macédoine considéré comme une usurpation du patrimoine hellénique ;
- le risque que le nouvel État ainsi dénommé favorise l'émergence d'un mouvement sécessionniste dans la région grecque de Macédoine, alors même qu'Athènes ne reconnait pas de minorité macédonienne sur son propre territoire ;
- le drapeau choisi par les autorités en 1991 comprenait le soleil dit de Vergina, symbole de la dynastie macédonienne, figurant aussi sur les tombeaux de Philippe II et Alexandre le Grand.
L'opposition grecque s'est traduite en 1994 et 1995 par un blocus de l'économie macédonienne, littéralement asphyxiée, privée de livraisons de pétrole, alors même que Skopje subissait le contrecoup de l'embargo visant alors Belgrade. Un accord signé le 13 septembre 1995 entre la Grèce et l'ARYM a mis fin au blocus en échange d'une modification par Skopje de sa Constitution et de son drapeau.
L'accord précise qu'Athènes ne s'oppose pas à l'adhésion de l'ARYM à d'autres organisations internationales. Skopje signe ainsi dès 2001 un accord de stabilisation et d'association avec l'Union européenne et accède au statut de candidat en 2005.
Le sommet de l'OTAN à Bucarest en 2008 va néanmoins troubler cette dynamique. La Grèce, pour partie contrariée par l'ouverture en 2007 d'un aéroport « Alexandre le Grand » à Skopje, s'oppose ainsi à l'adhésion de l'ARYM à l'Organisation atlantique, alors même que l'Albanie et la Croatie l'intègrent. La déclaration finale du Sommet indique que l'adhésion de la « Macédoine » ne sera possible que lorsqu'une solution acceptable sur le nom aura été trouvée. Le Conseil européen du 8 décembre 2009 relie quant à lui l'ouverture effective des négociations d'adhésion au règlement de la question du nom. José Manuel Barroso a rappelé cette position lors de sa venue à Skopje le 9 avril dernier.
Ce blocage appelle plusieurs réflexions.
Alors que les rapports de progrès publiés par la Commission en 2009 et 2010 recommandent l'ouverture de négociations, un problème bilatéral empêche celle-ci, mettant l'Union européenne dans une position inconfortable à l'heure où elle demande à Skopje d'aller plus loin en matière de réformes politiques et économiques.
Si l'on peut concevoir que le principe de solidarité s'impose aux États membres, force est de constater que celui-ci aboutit à une impasse. Et cela alors même que les États-Unis, la Russie ou la Chine, comme 160 autres États ont reconnu le nom constitutionnel de « République de Macédoine ». En dépit de la médiation entreprise par les Nations unies depuis 1994, cette question est donc purement européenne. Il appartient à l'Union d'imposer une voie médiane, distinguant, par exemple, l'ouverture des négociations techniques du règlement politique de la question du nom.
Il convient de préciser que les discussions entre les deux États n'achoppent pas seulement sur le nom du pays mais aussi sur ces déclinaisons : l'adjectif « macédonien » n'est, ainsi, pas admis par Athènes. De la sorte, la Grèce ne reconnaît pas de citoyenneté macédonienne ou de langue macédonienne. A ce sujet, la Grèce souhaite que le nom de la langue en anglais ne soit pas le « macedonian », mais le « makedonski », soit la traduction slave du mot.
La violation manifeste de l'accord de 1995 renforce l'intransigeance du gouvernement nationaliste au pouvoir à Skopje sur la question. La fermeté sur ce problème constitue un réel argument électoral comme l'ont souligné le scrutin de juin 2008 et la campagne qui s'ouvre aujourd'hui, les prochaines élections étant prévues le 5 juin prochain. Il appartient néanmoins aux Macédoniens de progresser sur la voie du compromis, indépendamment du coût électoral d'une telle avancée. La proposition grecque d'assortir le nom de République de Macédoine d'une précision géographique - République de Macédoine du Nord ou République de Macédoine - Skopje par exemple - peut apparaître comme une solution si les Grecs renoncent dans le même temps à leurs revendications concernant les déclinaisons. Cette solution médiane est avancée par l'opposition sociale-démocrate au gouvernement actuel. Elle s'appuie sur l'assouplissement d'Athènes sur la question depuis l'arrivée au pouvoir de M. Papandreou.
La question du nom pourrait apparaître absurde pour ne pas dire ridicule, si elle ne touchait pas directement à la question de l'identité macédonienne, dans un pays ayant connu il y a moins de dix ans des émeutes interethniques de grande ampleur entre la composante macédonienne et l'importante minorité albanaise, soit 25 % de la population. L'accord-cadre d'Ohrid du 13 août 2001 signé entre les parties sous les auspices de la communauté internationale est venu mettre un terme à ces violences. Il débouche sur la modification de la constitution en vue de renforcer la représentation de la minorité albanaise. L'usage de l'albanais est ainsi autorisé pour les documents officiels, seul le gouvernement s'exprimant uniquement en macédonien, sauf dans les zones albanaises expressément désignées par l'accord-cadre. L'albanais devient la seconde langue officielle dans les territoires où la minorité représente au moins 20 % de la population, l'État s'engageant dans ces régions à financer l'enseignement en langue albanaise. Aux mesures en faveur de la décentralisation, s'ajoute la nécessité pour l'État d'assurer une représentation proportionnelle des minorités dans la fonction publique, l'armée et la police. Au plan institutionnel, le système de double majorité, dit « système Badinter », s'applique pour les textes intéressant les minorités. Dans ce cadre, pour être adoptée, une loi doit bénéficier du vote de la majorité des députés ainsi que celui de la majorité des groupes représentant les minorités à l'Assemblée. Par ailleurs, toute formation gouvernementale accueille en son sein des membres de la communauté albanaise.
Si cet accord a mis fin au conflit et tente de mettre en place les fondements d'un état multiethnique, il n'est pas pour autant une garantie comme en témoigne le repli identitaire des deux communautés, paradoxalement renforcé par l'accord d'Ohrid. La communauté albanaise observe à cet égard les avancées de Tirana sur la voie européenne et atlantique, plus rapides désormais que celles enregistrées par Skopje. Il conviendra de suivre l'attitude de cette communauté, sensibilisée pour partie aux arguments du mouvement panalbanais Vetvendosje, implanté au Kosovo, et encore marquée par le conflit de 2001, comme en témoigne l'importance en son sein des mouvements d'anciens combattants. Les échauffourées observées à l'occasion des travaux pharaoniques de réhabilitation du centre de Skopje - le projet Skopje 2014 - sont venus souligner la prégnance de la question identitaire. Des affrontements ont en effet opposé jeunes des communautés albanaise et macédonienne autour d'un projet de musée national et de restauration d'une église. L'opération urbanistique Skopje 2014, en référence à la date d'achèvement prévue des travaux, ne fait pas l'unanimité tant en raison de son coût - 200 millions d'euros - que de son caractère historiciste, pour ne pas dire nationaliste.
Le blocage de l'ouverture des négociations n'est pas, non plus, sans susciter une certaine frustration à l'égard de l'Union européenne. La « Macédoine » est en train de perdre son avance sur les autres anciennes républiques yougoslaves sur la voie de l'adhésion. Néanmoins, si les rapports de progrès recommandent l'ouverture des négociations, un certain nombre de réserves pèsent sur la candidature macédonienne.
La tendance à la politisation de l'appareil d'État constitue, à cet égard, un des principaux motifs d'inquiétude. Des réformes doivent être entreprises ou poursuivies dans les domaines de l'administration et de la justice. Le recrutement dans la fonction publique semble par trop soumis à des considérations politiques, comme les carrières du reste. On relèvera ainsi que 75 % des effectifs du département ministériel consacré aux affaires européennes ont changé en un an, au gré des luttes d'influence. Cette absence de cohérence n'est pas sans incidence sur la mise en oeuvre effective des mesures d'adaptation de la législation macédonienne à l'acquis communautaire.
Par ailleurs, si les dispositions législatives nationales sont conformes aux textes de référence en matière de lutte contre la corruption, on observe des faiblesses en ce qui concerne le financement des partis politiques ou le délit de trafic d'influence. La corruption demeure une forte préoccupation. Certains y voient un indice du poids pris par les formations politiques dans le fonctionnement de l'État. Ces partis rassemblent l'élite locale, au détriment d'ailleurs de l'État. Un permanent du VMRO-DPMNE, le parti majoritaire, perçoit ainsi une rémunération de plus de 1000 euros là où un fonctionnaire gagne autour de 300 euros.
Dans un contexte économique difficile, où le taux de chômage dépasse les 30 %, l'État demeure le premier employeur, rétribuant 35 % de la population active. Une telle situation n'est pas sans conséquence en matière politique, des pressions ayant été observées lors des scrutins de 2008 et 2009 sur les fonctionnaires en vue de voter pour le bon candidat s'ils souhaitaient conserver leur emploi. Les élections de 2008 ont par ailleurs donné lieu à des manifestations de violence au sein des bureaux de vote et à un certain nombre d'opérations nuisant à la sincérité du scrutin. Les listes électorales non actualisées ou incluant des enfants ont ainsi été mises en causes.
Les élections anticipées du 5 juin prochain vont ainsi avoir valeur de test, José Manuel Barroso ayant rappelé lors de sa visite à Skopje que des élections ne respectant pas les standards internationaux contreviendraient aux critères de Copenhague et pourraient ainsi remettre en cause la recommandation positive de la Commission sur l'ouverture des négociations.
Ce scrutin vient mettre un terme au boycott par l'opposition des séances du parlement depuis décembre 2010, en raison de l'ouverture d'une enquête judiciaire contre une chaîne de télévision jugée proche de l'opposition. Le propriétaire de cette chaîne de télévision mais aussi de différents journaux et treize de ses collaborateurs sont emprisonnés ou placés en résidence surveillée pour fraude fiscale.
Au-delà de cette affaire, la Macédoine est caractérisée par une très faible indépendance des médias à l'égard du pouvoir politique. L'autorité de régulation audiovisuelle n'a ainsi pas été en mesure de garantir un égal accès des partis aux médias en 2008 et 2009. De façon générale, les contrats publicitaires passés par l'État constituent la principale manne financière du secteur.
A l'occasion de son déplacement, José Manuel Barroso a annoncé la mise en place d'un dispositif de consultations semestrielles à haut niveau afin d'évaluer l'avancée des réformes. Il conviendra de suivre précisément le résultat de ce dialogue à haut niveau tant il permettra de mesurer, au-delà des effets d'annonce du gouvernement macédonien, la réalité de l'adaptation du pays aux normes mais aussi à l'esprit communautaire. Nous en sommes encore loin.

La question du nom ne doit pas être sous-estimée côté grec. En s'opposant au nom constitutionnel choisi par les autorités macédoniennes, Athènes entend ancrer Philippe II et Alexandre le Grand dans le patrimoine hellénique. Le Conseil de l'Europe a, à cet égard, un rôle particulier à jouer, puisqu'il réunit en son sein la Grèce, l'ARYM et l'Albanie. Il est un espace de dialogue plus que nécessaire dans le contexte actuel.
Au-delà de ce sujet, les problèmes rencontrés par ce petit pays pour consolider son régime démocratique sont également traités par le Conseil de l'Europe par l'intermédiaire de la commission de suivi de l'Assemblée parlementaire. Le scrutin du 5 juin devrait, quant à lui, être l'objet d'une mission d'observation.

Dans le cadre de son déplacement dans la région, le groupe interparlementaire s'est également rendu au Kosovo afin de rencontrer les responsables politiques locaux, cinq mois après les dernières élections législatives.
Notre collègue Marie-Thérèse Bruguière et l'ambassadeur de France au Kosovo nous avaient présenté, le 16 février dernier, la situation politique locale. La seule nouveauté consiste en l'élection d'une femme à la présidence de la République. L'élection du milliardaire Beghjet Pacolli par le Parlement kosovar le 22 février dernier, a, en effet, été invalidée faute de quorum, les deux partis d'opposition, l'AAK et la LDK refusant de participer au scrutin. Mme Atifete Jahjaga, 36 ans, général de la police kosovare et inconnue du grand public, a été élue à la présidence le 7 avril après un accord entre les partis politiques négocié par l'ambassadeur américain au Kosovo.
Cette élection semble mettre fin à la crise politique qui dure depuis près d'un an au sein du pays. Elle devrait être suivie dans les prochains mois d'une réforme des institutions en vue de présidentialiser le régime. Nous avons noté avec intérêt que la Présidente de la République était entourée de conseillers dont une large partie n'a pas participé au conflit de 1999 et n'appartiennent pas aux partis traditionnels. Cette rupture avec les logiques d'après-guerre n'est pas sans intérêt pour un pays qui souhaite donner une image moderne, européenne et multiethnique, de lui-même.
La situation à Pristina ne doit pas, cependant, occulter la réalité du nord du pays ou celle des enclaves serbes. Si la plupart des responsables d'origine serbe rencontrés ne militent pas pour une partition du pays, s'ils semblent faire avec le statut du pays sans l'accepter - douze députés serbes soutiennent ainsi le gouvernement de l'ancien commandant de l'UCK, Hashim Thaçi -, nous n'avons pas pour autant senti une envie tangible de mieux vivre ensemble, comme en témoigne, par exemple, l'absence d'enseignement bilingue.
Si le nord se caractérise par l'absence d'institution kosovare proprement dite et une administration serbe de facto, les enclaves sont dans une situation particulière puisqu'elles perçoivent des financements, certes modestes, du gouvernement kosovar et voient, dans le même temps, la plupart de leurs services publics - écoles, hôpitaux - en large partie financés par Belgrade.
Les négociations entre la Serbie et le Kosovo qui se sont ouvertes à Bruxelles le 8 mars dernier sous l'égide de l'Union européenne pourraient peut-être permettre de dépasser ce mode de fonctionnement, par le biais d'une coopération technique dans plusieurs domaines. S'il ne s'agit pas d'aborder le statut du Kosovo au cours de ces réunions, les questions liées à l'état-civil, au cadastre, aux douanes, à l'électricité, aux télécommunications ou encore au survol du territoire seront traitées.
L'une des principales demandes du gouvernement, partagée par la minorité serbe, consiste en une libéralisation du régime des visas pour entrer dans l'Union européenne. A l'heure actuelle, le Kosovo est le seul territoire issu de l'ex-Yougoslavie qui ne bénéficie pas de ce régime allégé. Cette situation pénalise grandement la population, qu'elle soit d'origine albanaise ou d'origine serbe. Elle est, par ailleurs, un frein considérable au développement du pays et participe du renforcement de son enclavement.
Une libéralisation ne constitue pas un risque considérable pour l'Union européenne, d'autant qu'elle possède avec EULEX un instrument capable de surveiller, sur place, la circulation des individus. Je rappelle qu'EULEX constitue la plus grande mission civile déployée dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne.
Cette libéralisation renforcerait par ailleurs la légitimité de la présence sur place de l'Union européenne. L'importance des moyens accordés à la mission, son extrême visibilité - 1300 véhicules pour près de 3000 agents, dont 1200 locaux environ - contrastent, en effet, à l'heure actuelle, avec la faiblesse des résultats enregistrés.

Je tiens au préalable à souligner l'utilité de ces déplacements en « Macédoine » et au Kosovo dans le cadre de nos travaux sur le processus d'élargissement de l'Union européenne.
Le Kosovo est - avec la Biélorussie, mais pour d'autres raisons - le seul pays européen qui ne soit pas membre du Conseil de l'Europe, faute de reconnaissance de la part de tous les États y adhérant. Les problèmes rencontrés par le Kosovo recoupent pourtant les missions du Conseil de l'Europe qu'il s'agisse de la promotion de l'État de droit ou de la protection des minorités.
Comme dans le Caucase, la question des minorités dans les Balkans semble être sans fin, à moins de procéder à d'énièmes mouvements de populations, soit une purification ethnique de facto.
Au Kosovo s'ajoute le problème de la corruption et des trafics en tous genres. Le rapport du Sénateur suisse Dick Marty sur le trafic d'organes pendant la guerre de 1999, présenté devant l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en janvier dernier, est venu nous le rappeler. Ce type de rapport n'est pas destiné à stigmatiser un pays mais plus à condamner l'instrumentalisation de ces jeunes États par les mafias. Nous devons être extrêmement vigilants à ce sujet, afin de permettre au Kosovo d'emprunter la voie de la modération et de la modernisation.
J'ai, par ailleurs, pu rencontrer il y a quelques semaines le président serbe Boris Tadic, en visite à Paris. Son ouverture au dialogue et sa position résolument pro-européenne constitue un réel espoir pour la région. Il convient de soutenir ses efforts.

Concernant le rapport dit « Marty » cité par notre collègue, des suites sur le terrain lui seront données. La mission EULEX que nous avons pu rencontrer la semaine dernière y travaille déjà.
Un débat devrait, par ailleurs, avoir lieu dans les prochaines semaines au Conseil de sécurité des Nations unies, la Russie appuyant la demande serbe d'une enquête internationale sur le sujet, refusant que les investigations soient menées par EULEX.

Le succès d'une telle enquête passe surtout par la protection durable des témoins.

Après la Macédoine, nous contournons la Grèce pour aller jusqu'à Chypre. Denis Badré s'est rendu dans ce pays au titre du Conseil de l'Europe et il a souhaité nous faire part de son analyse.

Je me suis rendu avec deux de nos collègues députés, Mme Marietta Karamanli et M. Jean-Claude Mignon membres de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, sur l'île de Chypre du 3 au 6 mars dernier afin d'effectuer un état des lieux de la situation du pays, trente-sept ans après le début de l'occupation du Nord de son territoire par l'armée turque.
Petit pays, peu peuplé, Chypre bénéficie d'une situation géostratégique idéale. L'occupation de son territoire par les Lusignan, les Vénitiens, les Ottomans puis les Britanniques en témoigne. Chypre n'a acquis son indépendance qu'en 1960. La Constitution adoptée dans la foulée de la décolonisation prévoit alors la mise en place d'institutions censées garantir les droits de la communauté turcophone de l'île. Celle-ci, qui ne représentait pourtant à l'époque 18 % de la population, se voit ainsi accordée 30 %, des sièges au Parlement et au Gouvernement. Elle était appuyée dans ses revendications par la Grande-Bretagne. La loi fondamentale octroie, en outre, le statut d'État garant de l'équilibre constitutionnel à la Grèce, à la Turquie et à la Grande-Bretagne. L'envoi d'une force d'interposition des Nations unies dès 1964 souligne néanmoins que ces avantages constitutionnels n'ont pas permis d'empêcher les affrontements communautaires sur le terrain.
Dix ans plus tard, en 1974, l'armée turque envahit le territoire chypriote afin de répondre à la tentative de coup d'État appuyée par les colonels au pouvoir à Athènes et destinée à réaliser l'Enosis, l'union de Chypre avec la Grèce. La Turquie justifie notamment son intervention en invoquant son statut d'État garant. Depuis cette date, le pays est divisé en deux zones : au Sud, la République de Chypre, membre de l'Union européenne, seule autorité reconnue par la communauté internationale ; au Nord, la République turque de Chypre-Nord (RTCN), autoproclamée en 1983 et qui n'est reconnue que par la Turquie. La RTCN couvre un peu plus de 37 % du territoire de l'île. La séparation entre les deux entités est matérialisée par une ligne de démarcation, la fameuse ligne verte, tenue par la Force des Nations unies chargée du maintien de la paix à Chypre (UNFICYP), soit un véritable no man's land comprenant notamment l'ancien aéroport de Nicosie et représentant 2,6 % de la surface de l'île. Un grand nombre d'espèces menacées peuvent désormais y vivre en paix, dont 200 à 300 mouflons ! La force des Nations unies est composée à l'heure actuelle de 927 hommes provenant de 20 pays différents.
Cette division de l'île s'est consolidée par le biais d'importants mouvements de populations, allant de l'exil pour les membres de chacune des communautés à l'implantation, avec l'appui d'Ankara, de familles turques venant d'Anatolie au nord du pays, sur les propriétés des Chypriotes grecs ayant quitté la région. On estime à 119 000 personnes le nombre de Turcs ainsi installés, soit plus que le nombre de Chypriotes turcs initialement installés sur l'île.
Le Conseil de sécurité des Nations unies a, dès 1974, demandé le retrait sans délai de tous les soldats étrangers présents, visant bien évidemment les turcs mais aussi les britanniques, dont les bases militaires représentent 2,8 % du territoire chypriote, sur lequel ils exercent leur pleine souveraineté. Ces demandes réitérées sont restées lettre morte, les Nations unies échouant, dans le même temps, à réunifier politiquement l'île.
En avril 2004, à la veille de l'adhésion à l'Union européenne, la communauté grecque a largement rejeté par referendum - 75 % des voix - le plan Annan qui préconisait la création d'une fédération assez souple, à l'image de ce qui a été instauré en Bosnie-Herzégovine. Ce projet accordait une large autonomie à chacune des deux entités. Le rejet de la partie grecque s'explique par sa crainte de voir légitimée l'existence de la RTCN au sein de cette structure assez lâche et d'entériner, de la sorte, un partage implicite de l'île. La complexité du système proposé n'a pas également oeuvré en faveur de son adoption, en dépit du vote favorable de la communauté turque (plus de 65 % des voix).
L'Union européenne a, elle-même, échoué dans ses tentatives de conciliation dans le cadre des négociations avec la Turquie. Ankara ne reconnaît toujours pas la république de Chypre telle que constituée. Par ailleurs, la Turquie ne respecte pas le Protocole d'Ankara, cet accord de libre échange entre la Turquie et l'Union européenne signé en 2005, et aux termes duquel les navires et avions chypriotes comme tous les autres vaisseaux européens, devraient pouvoir avoir accès aux ports et aéroports turcs.
Je m'interroge, par ailleurs, sur les intentions de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, dont je le rappelle, je suis membre, lorsqu'elle a accueilli en son sein, une représentation de la RTCN alors même qu'elle n'est pas reconnue internationalement. Cette représentation est censée compenser l'absence de Chypriotes turcs au sein de la délégation de la République de Chypre. Le risque est grand de mettre sur un pied d'égalité une démocratie et un État autoproclamé comme tel mais dont l'existence n'est garantie que par la présence d'une armée étrangère. Cette position de l'Assemblée peut, en outre, apparaître contradictoire avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme qui a indiqué le 1er mars 2010 dans l'arrêt Demopoulos, que le contrôle global que la Turquie exerçait sur la partie nord du territoire impliquait qu'elle était responsable des politiques et des actes de la RTCN.
La division politique a conduit Chypre à se développer dans deux sens contraires. L'acquis communautaire ne s'applique, ainsi, pas au nord du pays. Si la République de Chypre a construit son modèle économique sur le tourisme, la RTCN, sous embargo international, demeure tributaire des subsides turcs. Un quart du budget national, 635 millions d'euros, est ainsi financé par la Turquie. Sa stratégie de développement n'est pas sans laisser songeur puisqu'elle mise essentiellement sur les salles de jeux, une quarantaine de casinos attirant des touristes venant de Turquie, où les salles de jeux sont interdites, mais aussi du Moyen-Orient et du Royaume-Uni.
L'accord du 8 juillet 2006 signé entre les deux communautés ouvre, dans le même temps, la voie à des négociations directes. Cet accord comporte des engagements en faveur de la réunification de l'île et signe le refus de maintenir le statu quo. Il instaure des comités techniques sur la vie quotidienne placés sous l'égide des Nations unies. Les pourparlers ont été relancés depuis 2008, sous l'impulsion notable du président chypriote Demetris Christofias. Les négociations se sont d'ores et déjà traduites par la levée des barrages de la rue Ledra qui traversaient jusqu'alors la capitale du pays Nicosie, véritable Berlin méditerranéen.
Les deux parties s'entendent sur la nécessité de créer une Fédération. Les principaux points d'achoppement concernent la présence de 35 000 soldats turcs, le statut d'État garant détenu par la Turquie ou la question de la propriété foncière des réfugiés. Rappelons dans ce domaine que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme et de la Cour de justice européenne réaffirme que les biens spoliés continuent à appartenir aux propriétaires originels.
La relative indifférence dans laquelle se déroule ces négociations ne lasse pas d'inquiéter tant on ne sent pas de la part de la communauté internationale une réelle ambition en la matière. Si je peux comprendre que le rejet du plan Annan ait pu constituer une réelle déception, l'exemple bosnien tend néanmoins à prouver que la solution préconisée à l'époque ne constituait en aucune manière une garantie pour l'avenir. Le droit de veto ou le recours aux votes par des majorités séparés ont clairement montré leurs limites. La réunification de l'île devra s'effectuer sur des fondements juridiques plus adaptés que ceux de 1960, permettant de tisser des liens concrets entre les deux communautés. Elle passera notamment par la création d'une fonction publique fédérale et l'installation d'une Cour suprême, qui dépasserait les intérêts communautaires.
La question chypriote ne peut pas être passée sous silence sous prétexte de l'échec de 2004. Elle demeure urgente en ce qui concerne le respect des valeurs fondamentales. Le nord de l'île s'apparente par de nombreux côtés à une zone de non-droit, comme en témoigne la fermeture de la ville de Famagouste pour raisons militaires ou les violences subies par la communauté orthodoxe à l'occasion des dernières fêtes de fin d'année. Celles-ci s'ajoutent aux atteintes répétées au patrimoine religieux constatées dans la région. Deux membres polonais du Parlement européen venus constater les difficultés rencontrées par les orthodoxes ont d'ailleurs été arrêtés le 12 mars dernier par l'armée d'occupation turque avant d'être relâchés quelques heures plus tard, après intervention du gouvernement chypriote et de la présidence du Parlement européen.
L'Union européenne dispose pourtant, au travers des négociations d'adhésion avec la Turquie, d'un formidable levier d'intervention. Il importe que ce pays comprenne que la voie de l'adhésion passe obligatoirement par celle de la reconnaissance de Chypre. L'Union européenne a manqué une occasion importante lors de l'ouverture des négociations d'adhésion en 2005, en n'imposant pas comme préalable un calendrier d'évacuation et un engagement de non intervention dans les affaires intérieures de l'île. Elle n'a pas su profiter, dans le même temps, de l'affaiblissement des militaires et du nationalisme en Turquie après l'arrivée au pouvoir de l'AKP. Malheureusement, le gouvernement Erdogan envisage désormais l'île de Chypre comme un exutoire pour l'armée.
L'Union européenne ne peut s'accommoder de voir un de ses États membres partiellement occupé et victime d'un nettoyage ethnique implicite. Aucune menace ne pèse sur Chypre qui justifie la présence de 35 000 soldats étrangers sur son territoire. Après tout, la Russie a bien quitté les États baltes et la France, pour reprendre le bon mot d'un spécialiste de la question chypriote, Jean-François Drevet, n'occupe pas la Wallonie pour défendre la communauté francophone.
Au sein de l'Union européenne, le Royaume-Uni, a un rôle particulier à jouer, au regard, notamment, de ses positions militaire et constitutionnelle. Le souhait britannique de maintien des bases militaires a, par moments, semblé contradictoire avec la nécessité de réunifier l'île. Il convient de repenser cette stratégie, tant, me semble-t-il, les objectifs militaires britanniques ne m'apparaissent pas incompatibles avec le rétablissement du droit sur l'ensemble du territoire chypriote.
L'appartenance à l'Union européenne écarte, par ailleurs, tout recours excessif aux dérogations comme le prévoyait le plan Annan. Les limitations en matière de droits de propriété et de résidence seraient en effet contraires au respect des quatre libertés de circulation. L'adoption de l'euro par la République de Chypre évite, par ailleurs, tout débat sur le choix de la monnaie au moment de la réunification. L'acquis communautaire constitue, en outre, le cadre pour l'harmonisation des législations.
Au sein du processus de réunification, la question économique n'est pas anecdotique. Le développement séparé ne peut être, à long terme, une solution pour la partie nord de l'île. Le revenu par habitant des Chypriotes turcs qui atteignait 90 % de celui des Chypriotes grecs en 1960 est, aujourd'hui, tombé à moins du tiers. Le soutien de la communauté chypriote turque au processus de réunification se justifie aussi par l'opportunité économique qu'il représente.
A cet égard, je souhaite attirer votre attention sur les manifestations qui ont régulièrement lieu dans le nord de l'île depuis la fin janvier, notamment à Nicosie. Elles dénoncent en effet l'austérité imposée par Ankara et sont l'occasion d'exprimer une certaine lassitude à l'égard de l'occupation turque. La présence de drapeaux chypriotes grecs comme les slogans appelant au départ de la Turquie illustrent assez bien l'aspiration de la communauté turque à une réunification rapide. Ces manifestations ont d'ailleurs débouché sur le remplacement du représentant turc auprès de la RTCN.
Le rapprochement observé depuis près d'un an entre la Grèce et la Turquie peut constituer une opportunité en vue d'accélérer les négociations, quand bien même les deux pays considèrent que cette question est d'ordre international et non simplement bilatéral. Le Conseil de l'Europe et l'Union européenne doivent profiter de ce moment particulier pour réaffirmer leur ambition en faveur du rétablissement de l'État de droit sur l'ensemble de l'île. La Turquie aurait, je le répète, beaucoup à gagner à voir cette question se régler tant cette occupation parasite son souhait de démontrer son adéquation aux valeurs européennes. Ankara qui préside actuellement le Comité des ministres et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe aurait d'ores et déjà dû effectuer un geste allant en ce sens.
Je tiens à insister sur le caractère urgent de cette réunification, tant les jeunes générations, notamment côté grec, se résignent devant cette situation. L'exception devient en quelque sorte une norme, l'état de fait dépasse le droit. Le conflit a déterminé des positions qui se consolident avec les années sans qu'un règlement pacifique ne soit proposé. On est là à rebours de tout ce qui constitue le projet européen.

Cette communication vient nous rappeler l'importance du travail qui reste à accomplir sur certains sujets de la part des autorités turques avant d'accéder à l'Union européenne. L'Union européenne et le Conseil de l'Europe ont tous deux, d'ailleurs, un rôle à jouer dans le règlement de cette question.

Je suis heureux que ce sujet soit inscrit à l'ordre du jour de notre commission. L'histoire de Chypre est, malheureusement, celle de l'application de la morale du Loup et de l'Agneau de Jean de la Fontaine : « La raison du plus fort est toujours la meilleure ». Que représentent 800 000 Chypriotes face à la puissance turque ? Pourtant, comment accepter un tel déni des droits de l'Homme au sein même de l'Union européenne ?
J'ai pu, à l'occasion de deux déplacements récents sur l'île, l'un en novembre 2009 avec Pierre Lellouche, alors secrétaire d'État aux affaires européennes, et l'autre il y a quelques semaines avec nos collègues Jean-Patrick Courtois et Marc Massion, mesurer l'absence d'avancée tangible dans le processus de négociation.
L'île de Chypre a d'abord été grecque avant d'être occupée par les Ottomans. Une partie des Chypriotes turcs sont, à cet égard, issus des conversions à la religion musulmane observée à l'occasion de cette occupation. La colonisation de la partie nord de l'île entreprise depuis 1974 répond à une toute autre logique. 50 000 Chypriotes turcs, sur 110 000 présents en 1974, ont quitté l'île depuis la division du pays. Face au manque de perspectives économiques en zone Nord, ils ont préféré migrer vers le Canada, les États-Unis ou la Grande-Bretagne.
Les colons qui se sont installés, venus d'Anatolie, n'ont pas le même mode de vie que les Chypriotes turcs, au plan religieux notamment. A un islam ouvert aux autres composantes religieuses de l'île - des orthodoxes aux maronites - a succédé une pratique plus rigoureuse. C'est dans ce contexte que doivent être envisagées les exactions commises contre les églises dans la partie nord de l'île, transformées en étables pour certaines ou dépecées de leurs mosaïques pour d'autres. Les violences perpétrées par les forces turques dans l'église Saint Sinesios à Rizokarpaso, à l'occasion des dernières fêtes de Noël, s'inscrivent également dans ce cadre.
La contestation des Chypriotes turcs à l'égard d'Ankara ces dernières semaines constitue, à cet égard, une manifestation d'humeur à l'égard des colons, désormais majoritaires. La situation économique difficile de la partie nord de l'île, qui bénéficie pourtant des meilleures terres, contribue à ce mouvement. Le contraste avec le sud, véritable Suisse du Moyen-Orient, est d'autant plus ressenti que les Chypriotes turcs peuvent circuler dans cette partie de l'île, certains demandant même le passeport chypriote.
Je ne suis pas très optimiste sur les négociations en cours. Dans le Nord de l'île, on observe une tentative réelle d'effacer les traces de la culture grecque. Famagouste et sa déclinaison moderne Varoshia demeurent des villes fantômes. M. Derviþ Eroðlu, candidat des colons turcs, plus réservé sur le dialogue entre les deux parties, a succédé à Mehmet Talat, qui avait véritablement oeuvré en faveur d'une relance des discussions après l'échec du plan Annan. Le gouvernement Erdogan ne fait pas non plus montre d`empressement à régler cette question.
La position de la Turquie à Chypre vient s'ajouter aux problèmes rencontrés par la minorité kurde sur son territoire et les difficultés autour de la reconnaissance du génocide arménien. Il est nécessaire de prendre tous ses éléments en compte dans le cadre de la candidature turque à l'Union européenne.

J'ai regretté, avec beaucoup de collègues, la virulence des attaques du Premier ministre turc contre la France lors de son intervention devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 13 avril dernier.

Avec nos collègues Josette Durrieu et Jacques Blanc, nous avons rappelé, avant-hier, au président de la commission d'harmonisation avec l'Union européenne de la Grande Assemblée nationale de Turquie, ainsi qu'à l'ambassadeur de Turquie en France, que nous avons été désagréablement surpris des propos de M. Erdogan tenus à Strasbourg.
Je relaierai auprès de l'ambassadeur de Turquie les conclusions de notre collègue Denis Badré sur la situation à Chypre. Cet état de fait ne peut indéfiniment perdurer. Comment accepter qu'il y ait, au sein de l'Union européenne, un État en partie occupé ? Naturellement, le problème est complexe et difficile. Mais l'on ne peut se résigner au statu quo.