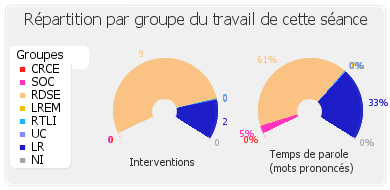Séance en hémicycle du 3 novembre 2010 à 22h00
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt-deux heures, sous la présidence de M. Bernard Frimat.

La séance est reprise.

J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de réforme des collectivités territoriales est parvenue à l’adoption d’un texte commun.

L’ordre du jour appelle le débat sur les effectifs de la fonction publique, organisé à la demande de la commission des finances, par anticipation sur l’examen du projet de loi de finances.
La parole est à M. le président de la commission des finances.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je remercie la conférence des présidents et le Gouvernement d’avoir accepté que nous débattions dès cette semaine de plusieurs thèmes qui devraient normalement être discutés dans le cadre de la première partie du projet de loi de finances pour 2011.
Ce débat sur les effectifs de la fonction publique nous permet d’anticiper sur l’examen des articles qui concernent les différents plafonds d’emplois sur lesquels le Parlement est appelé à voter.
Je rappellerai d’abord la teneur de ces dispositions, avant de procéder à quelques observations qui seront, successivement, de forme et de fond.
Commençons par les éléments qui figurent au sein du projet de loi de finances pour 2011.
L’article 47, article « d’équilibre », fixe notamment le plafond d’autorisation des emplois rémunérés de l’État. Ce plafond s’établit à 1 975 023 équivalents temps plein travaillé.
L’article 52 présente la déclinaison de ce plafond par mission budgétaire. Il prend la forme d’un tableau synthétique, conçu pour être amendé le cas échéant. Ce tableau fait apparaître que les plus importants employeurs de l’État sont, dans l’ordre : l’éducation nationale, la défense, l’intérieur et le pôle budget-économie. À eux seuls, les cinq ministères correspondant représentent 84 % des effectifs de l’État.
L’article 53 du projet de loi de finances fixe le plafond d’emplois des 584 opérateurs de l’État, conformément aux dispositions introduites sur l’initiative de notre ancien collègue Michel Charasse et applicables depuis 2009. Au total, il s’agit de 365 909 équivalents temps plein, soit l’équivalent de 18, 5 % des effectifs de l’État. Plus des trois quarts de ces postes concernent la recherche et l’enseignement supérieur.
Enfin, l’article 54 fixe le plafond d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière, conformément à des dispositions introduites sur l’initiative conjointe de notre ancien collègue Michel Charasse et de notre collègue Adrien Gouteyron, et appliquées, la première fois, pour l’exercice 2010. Ce sont là 3 411 emplois.
Ces éléments appellent plusieurs séries de commentaires.
Je ferai tout d’abord des remarques d’ordre méthodologique, car les plafonds d’emplois fixés en loi de finances initiale, tels que je viens de les mentionner, prêtent à la critique.
En premier lieu, ces plafonds offrent une vision incomplète de l’emploi public national. Ainsi, par exemple, près de 98 000 agents des établissements scolaires, n’étant formellement rémunérés ni par l’État ni par ses opérateurs, se trouvent encore en dehors de tout plafond d’emplois.
En outre, les opérateurs conservent la faculté de recruter sur leurs ressources propres, hors plafond, des emplois non permanents. À ce titre, en 2011, les opérateurs de la recherche et de l’enseignement supérieur devraient disposer de près de 26 900 équivalents temps plein.
En deuxième lieu, l’unité de mesure étant différente pour chaque plafond, la comparaison entre eux s’avère approximative.
Je rappelle que les emplois de l’État sont mesurés en équivalents temps plein travaillé, ou ETPT, que les emplois des opérateurs de l’État sont seulement décomptés en équivalents temps plein « simple », ou ETP, et que le plafond relatif aux établissements à autonomie financière ne vise que des « emplois », sans correction, et ne concerne que les agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
En dernier lieu, ces plafonds sont l’objet de corrections techniques, d’une année sur l’autre, qui nuisent à la pertinence des comparaisons dans le temps. Par exemple, pour 2011, le plafond d’emplois du ministère de l’éducation nationale se trouve « techniquement » majoré de quelque 20 359 équivalents temps plein travaillé, soit plus de 2 % du plafond prévu pour le ministère. Cet ordre de grandeur laisse, convenons-en, dubitatif.
Il est prévu de supprimer 16 000 emplois à la rentrée prochaine. Ces constats nous rendent perplexes à propos de nos votes antérieurs. Monsieur le secrétaire d’État, peut-être pourrez-vous apaiser nos préoccupations sur ce point.
J’en viens au fond : sous ces importantes réserves liées au décompte, on constate que l’effort de diminution des effectifs de l’État se poursuit.
Le plafond d’emplois de l’État inscrit pour 2011 représente en effet, par rapport à celui de 2010, une réduction des effectifs à hauteur de 44 775 équivalents temps plein travaillé, soit 2, 2 %. Cette diminution s’explique principalement par la reconduction de la règle de non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux.
En cinq ans, le plafond d’emplois de l’État aura été abaissé de plus de 376 000 équivalents temps plein travaillé, soit 16 %. Entre fin 2007 et fin 2010, donc en trois ans, près de 100 000 postes auront été supprimés. Un effort équivalent – encore près de 100 000 suppressions – est prévu dans le cadre de la programmation triennale pour 2011-2013.

On doit noter que cette diminution des effectifs de l’État n’est pas compensée par des créations à due concurrence chez les opérateurs. Au contraire, à périmètre constant et hors secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche, une diminution de 1, 8 % de l’emploi sous plafond des opérateurs est prévue pour 2011.
Les suppressions de postes ne conduisent pas davantage à une perte de qualité du service rendu – ce point est très important. Le taux moyen de non-remplacement des fonctionnaires est bien de 50 %, mais la règle est adaptée pour chaque ministère, en fonction des priorités de l’action publique. Ainsi, 400 emplois seront créés au ministère de la justice, et aucune suppression de postes n’est programmée pour l’enseignement supérieur et la recherche.
J’ajoute que cette politique porte progressivement ses fruits sur le plan financier.
En 2009, la suppression de 100 000 postes par rapport à 2007 a induit une économie budgétaire brute de 860 millions d’euros. Pour 2010, l’économie est estimée à 890 millions d’euros et, de 2011 à 2013, à près de 3 milliards d’euros.
Ce faisant, les dépenses de personnel de l’État diminueront, entre 2010 et 2011, de 1, 3 % en volume. La masse salariale s’établit à 81, 1 milliards d’euros, soit une augmentation de 0, 6 % en valeur, mais une diminution de 0, 9 % en volume.
Cependant, ces économies sont absorbées par les mesures profitant aux agents... En 2011, les suppressions de postes engendreront 807 millions d’euros d’économies, mais 1, 43 milliard d’euros sera versé aux agents, dont plus de 930 millions pour les mesures dites « catégorielles », au sens large, et 190 millions pour l’effet en année pleine de la revalorisation du point d’indice intervenue en 2010.
Les conditions de cette stabilisation, à l’horizon de 2013, paraissent claires, sous l’aspect technique, mais elles sont évidemment délicates à mener au plan social : il faudrait geler le point d’indice, et limiter les mesures catégorielles.
En outre, les fonctionnaires non remplacés deviennent des pensionnés de l’État. Les gains obtenus en matière d’évolution des rémunérations sont donc repris par la dynamique de l’évolution des pensions, qui croissent de plus d’un milliard d’euros par an.
Pour conclure, je voudrais souligner que la maîtrise des effectifs de l’État accompagne les évolutions structurelles en cours, notamment le partage des compétences avec les opérateurs et les collectivités territoriales. Les suppressions de postes s’inscrivent non seulement dans une démarche d’économies nécessaires, mais aussi dans la recherche d’une plus grande efficacité du fonctionnement des services et une modernisation de la gestion des ressources humaines.
Cette modernisation repose sur trois axes : une approche centrée sur les métiers, la mobilité des agents et l’intéressement aux gains de productivité.
La politique de l’État, en matière de fonction publique, ne se résume donc pas à des suppressions : elle poursuit, in fine, un objectif qualitatif.

Comme nous l’avons vu ce matin en commission avec l’examen des crédits de la recherche, les choix budgétaires, même quand les temps sont difficiles, ne sont par forcément aveugles.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, après 100 000 postes supprimés depuis 2007, ce sont 100 000 nouveaux postes qui sont appelés à disparaître sur la période 2011-2013.

Un chiffre rond, comme un slogan publicitaire ! Une aberration alors que nous ne sommes pas sortis de la crise et qu’il faudrait au contraire soutenir l’emploi et la consommation !

Pour 2011, vous choisissez de supprimer 31 638 équivalents temps plein travaillé.
À manier la purge sans discernement, vous réincarnez peut-être Diafoirus, mais vous mettez surtout à mal des pans entiers de service public !
Cela n’a malheureusement rien d’étonnant, puisqu’il s’agit, une fois de plus, de stigmatiser la fonction publique, que vous résumez à une dépense excessive, d’où l’application constante du « raboter plus pour économiser plus » !
Dans son rapport d’information de juillet 2010 pour le débat d’orientation des finances publiques pour 2011, Philippe Marini est on ne peut plus explicite, puisqu’il intitule un passage « Les dépenses de personnels : un gisement à exploiter ? ». Une source d’économies potentielles, voilà à quoi vous réduisez la fonction publique !
Alors vous décentralisez, vous externalisez, vous privatisez... Tout est bon ! Qu’on en juge par le désastreux exemple de Pôle emploi, où vous avez fait appel à des opérateurs privés de placement peu concluants mais fort onéreux.
Votre conduite de la RGPP, la révision générale des politiques publiques, tourne systématiquement à la réduction générale des effectifs. Un tout récent rapport d’information sénatorial de Mme la rapporteure spéciale de la mission « Administration générale et territoriale de l’État », intitulé « La RGPP dans les préfectures : pour la délivrance des titres, la qualité du service public est-elle en péril ? », s’avère ainsi très éclairant.
L’objectif pour la période 2009-2011 est de supprimer 2 107 emplois équivalents temps plein travaillé, portant sur trois métiers : la délivrance des titres d’identité, le contrôle de légalité et la gestion des fonctions support.
Je m’attarderai un instant sur le premier métier, pour déplorer une dégradation flagrante des délais de délivrance des titres d’identité. Le passeport biométrique était censé être réalisé en une semaine, contre deux à trois pour son ancêtre, le passeport électronique. En pratique, dans le département de la Seine-Saint-Denis, ces délais ont souvent atteint deux à trois mois.
De manière générale, le constat du rapport est sans appel : dans les préfectures, la RGPP conduit à des résultats qualifiés de « décevants, et même préoccupants » – page 63. Au point que le pari consistant à compenser les réductions de postes par des efforts de productivité, via une organisation plus performante des services et un recours accru aux nouvelles technologies, est « en passe d’être perdu » – page 61. D’où la préconisation, que je ne peux que soutenir, de « faire une pause » dans la RGPP et de ne pas mettre en œuvre une troisième vague de suppressions d’emplois prévue après 2011.

Revenons aux 31 638 postes promis à disparition pour 2011.
Faute de temps, je ne citerai que deux domaines qui m’inquiètent particulièrement, la sécurité et l’éducation.
La sécurité, censée être la priorité du Président de la République, n’est pas épargnée, malgré un bilan catastrophique en ce qui concerne les violences aux personnes, qui demeurent, elles, en hausse constante. Depuis le début de la RGPP, près de 5 000 équivalents temps plein ont disparu dans la police nationale. §La vague 2011-2013 devrait déboucher sur 3 000 à 5 000 nouvelles suppressions de postes, ce qui pourrait ramener les effectifs au niveau de 1997. Or les missions de la police vont croissant, avec, par exemple, la mise en place des unités territoriales de quartier, les UTEQ. Résultat : en lieu et place des cent UTEQ prévues pour fin 2009, une trentaine d’unités seulement ont été créées. Fort heureusement, elles ont changé de nom et s’appelleront désormais des brigades spéciales de terrain, ce qui leur conférera à n’en pas douter une plus grande efficacité !

Tout cela manque de cohérence. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, le préfet de police a indiqué aux maires, lors d’une réunion, que le département comptait cinq cents policiers supplémentaires.
Dans le commissariat de Neuilly-sur-Marne et le bureau de police de Neuilly-Plaisance, nous n’avons pas vu l’ombre d’un nouveau policier. Et j’ai pu constater lors d’une récente visite que, la nuit, pour couvrir une population de 50 000 habitants, il y avait une permanence de huit policiers seulement, auxquels on peut à la rigueur ajouter la BAC si elle est disponible, et une autre voiture… Et pourtant ce département n’est pas sans connaître quelques problèmes en matière de sécurité.
Dans l’éducation nationale, 16 000 suppressions sont programmées, autant qu’en 2010. Depuis la rentrée 2007, ce ministère a déjà perdu 50 000 postes. Quel acharnement ! En juin, des documents internes incitaient les académies à « mobiliser les gisements d’efficience visant à respecter la contrainte du non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux pour la période 2011-2013, sans dégrader les performances globales ».
Cette langue de bois dogmatique tourne au non-sens. On connaît les « leviers » utilisés, tous préjudiciables, de l’augmentation du nombre d’élèves par classe à la suppression d’options, en passant par le recours aux non-titulaires pour les remplacements, la suppression de postes d’enseignants dans les réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté, les RASED, spécialisés contre l’échec scolaire, ou la diminution de la scolarisation des enfants de deux ans en maternelle. Tout à l’heure, j’évoquais auprès du ministre du budget la situation de Neuilly-sur-Marne : sur une classe d’âge, c’est-à-dire six cents enfants, nous en scolarisions auparavant la moitié. Désormais, nous avons besoin de trois cents places en crèche, soit cinq établissements, ce qui représente une centaine d’emplois au total. Et après, vous reprochez aux collectivités territoriales de trop embaucher ! Mais c’est par votre faute puisque vous n’accueillez plus les enfants de deux à trois ans !
M. Roland Courteau opine.

Je pourrais citer de nombreux exemples.
La situation est déjà très tendue dans l’éducation nationale et de nombreux remplacements ne sont pas assurés. Les heures supplémentaires ont explosé ; la Cour des comptes a noté leur coût croissant : 140 millions d’euros de plus en 2009 ! Des inspecteurs généraux, dans un rapport sur la préparation de la rentrée 2010, révèlent que les rectorats multiplient les recours à des vacataires pour boucher les trous – pardonnez-moi l’expression, mais c’est exactement cela –, et que ces recours ont bondi de 31 % par rapport à l’année 2008-2009… Il s’agit d’une inadmissible gestion à la petite semaine !
Le 25 janvier dernier, je croyais pourtant avoir entendu M. Sarkozy affirmer sur TF1 : « Je suis tout à fait prêt à envisager la titularisation progressive des contractuels. »

Le Gouvernement disposait pourtant du projet de loi sur le dialogue social dans la fonction publique. Dans un texte qui comporte désormais « diverses dispositions relatives à la fonction publique », des mesures concernant les non-titulaires auraient très bien pu trouver leur place. Vous avez bien trouvé de la place pour les dispositions relatives aux infirmières et aux infirmiers !
N’oublions pas qu’en dix ans la part des non-titulaires est passée de 14, 4 % à 16, 5 % dans l’ensemble de la fonction publique, ce qui représente tout de même 872 600 agents au 31 décembre 2008. Si l’on inclut les médecins hospitaliers, les ouvriers de l’État et les contrats aidés, leur nombre avoisinerait plutôt 1, 2 million. Or beaucoup d’entre eux occupent des emplois permanents, ce qui justifie leur titularisation, comme le prévoient les statuts des trois fonctions publiques, et non l’octroi de cette bizarrerie que vous avez créée contre le statut, le CDI de droit public.

Monsieur le secrétaire d’État, vous avez une nouvelle marotte, insistante, celle de reprocher aux collectivités territoriales de trop embaucher. Le 12 juillet, sur France 2, le Président de la République a ainsi fustigé « la politique d’augmentation du nombre de fonctionnaires » dans les collectivités et affirmé sa volonté que celles-ci « prennent la même règle que l’État », à savoir le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite.
Comme la libre administration des collectivités ne vous donne pas le pouvoir d’imposer le « un sur deux », vous dégainez l’arme budgétaire en gelant le concours de l’État au fonctionnement des collectivités territoriales sur la période 2011-2013. Et vous faites savoir que ce concours financier pourrait par la suite être modulé afin de soutenir en priorité les collectivités qui auraient la gestion la plus vertueuse. Extraordinaire ! Autrement dit, c’est le règne annoncé de l’arbitraire ! Car appliquer aux collectivités un bonus-malus en fonction de leur vertu budgétaire supposerait déjà que l’on soit en mesure d’établir un critère incontestable de bonne gestion.
M. Georges Tron, secrétaire d'État. J’en ai un, mais il est très personnel !
Sourires.

Et que penser d’un État qui a transféré des emplois par milliers – plus de 100 000 ! – et se mêle de donner des leçons ?
Une enquête réalisée par le Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT, en avril 2009, indique ainsi que, « sur 100 agents présents dans les régions, 61 avaient été transférés entre fin 2005 et fin 2008 et 12 avaient été recrutés pour faire face aux besoins liés aux transferts ».
Je sais que vous allez brandir des chiffres hors transferts, mais je veux vous parler d’un phénomène plus sournois, celui des transferts que je qualifierais volontiers de dissimulés.
La méthode est habile : l’État se déleste de certaines de ses tâches, obligeant les collectivités à prendre le relais sans leur octroyer les moyens nécessaires, puis accuse ces mêmes collectivités de pallier ses défaillances en embauchant ! C’est ce que je viens de souligner, notamment, à propos de l’accueil des enfants de deux à trois ans que l’État n’assume plus, obligeant les collectivités locales à prendre le relais.
Moins de fonctionnaires d’État, donc… Mieux payés, osez-vous prétendre ! Ce n’est pas ce que constatent les organisations syndicales, qui ont claqué la porte des négociations salariales de juin dernier.

Comment ne pas les comprendre ? En effet, il n’y a rien à négocier quand vous gelez le point d’indice, au moins pour l’année 2011, alors que c’est le seul élément qui profite à tous les agents et entre dans le calcul de leur retraite. Et le même scénario se profile pour 2012 et 2013, puisque les plafonds de crédits des missions figurant à l’article 6 du projet de loi de programmation n’intègrent aucune revalorisation du point.
Les syndicats considèrent que la perte de pouvoir d’achat est de l’ordre de 9 % depuis l’an 2000. Monsieur le secrétaire d’État, vous affirmez pour votre part régulièrement qu’il n’en est rien et que des chiffres bien connus prouvent le contraire. Puis-je profiter de l’occasion qui m’est offerte pour vous demander communication de ces fameux chiffres ?
Je ne manquerai pas de vous les communiquer !

J’ai posé à ce sujet une question écrite à M. Woerth en février dernier ; elle reste toujours sans réponse.
Ce qui est certain, c’est que la réforme des retraites qui vient d’être votée ne fera qu’empirer la situation salariale des agents en raison de l’augmentation de leur taux de cotisation vieillesse, même lissée sur dix ans. J’ai eu l’occasion de le démontrer : une augmentation de 0, 26 % chaque année correspond certes à une augmentation de seulement 6 euros par mois, comme vous vous plaisez à le dire, mais, au bout de dix ans, cela revient à 60 euros par mois, soit 720 euros par an.
Monsieur le secrétaire d’État, en conclusion du débat sur la réforme des retraites, vous affirmiez ici-même : « Celle-ci participera au grand chantier de modernisation de la fonction publique. »
Modernisation ? Après la convergence, c’est donc le nouveau masque que vous mettez sur ce qui n’est que régression !
J’ai déjà cité la perte de pouvoir d’achat occasionnée par la hausse de cotisation, mais s’y ajoutent le recul de l’âge de départ, y compris pour les catégories actives, le recul de l’âge du taux plein, la réforme du minimum garanti au détriment des plus petites pensions, ainsi que la fin du départ anticipé pour les parents de trois enfants ayant effectué quinze années de services effectifs.
Depuis que nous avons instauré dans cet hémicycle un débat sur les effectifs de la fonction publique, je n’en comprends toujours pas la finalité. À quoi bon débattre quand vous ne fonctionnez qu’au rabot, quelles que soient les conséquences néfastes sur les conditions de travail des agents et la qualité du service rendu. Vous avez fait du « un sur deux » l’alpha et l’oméga de votre politique, jusqu’à l’absurde. C’est cette gestion irraisonnée des ressources humaines que dénonce d’ailleurs la Cour des comptes dans un rapport publié en décembre dernier, dressant un état des lieux des effectifs de l’État entre 1998 et 2008. La Cour constate le « recours à des mesures à caractère général, essentiellement quantitatives et d’application uniforme ». Elle déplore que « d’un outil, la norme [soit] devenue progressivement un objectif » et que l’ajustement des effectifs « ne s’opère pas avant tout au regard d’une analyse – qui souvent reste à faire – des besoins correspondant aux missions, mais en fonction, presque exclusivement, de considérations démographiques et de contraintes macro-économiques ».
C’est pourquoi il serait grand temps de revenir sur ce dogme du sarkozysme qui, à l’instar du bouclier fiscal, a fait long feu !

Pour conclure, je crains que cet aveuglement ne soit le révélateur d’un malentendu fondamental sur le rôle de l’État. Vous vous acharnez à soumettre la fonction publique à des normes comptables, à en éteindre les spécificités, à la traiter comme n’importe quelle entreprise privée soumise au rendement.

M. Jacques Mahéas. Dans cette dérive, vous oubliez qu’elle incarne l’intérêt général, ce qui fait sa grandeur et la rend, par essence, inconciliable avec le marketing.
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste – Mmes Josiane Mathon-Poinat et Anne-Marie Escoffier applaudissent également.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ouvrir un débat sur les effectifs de la fonction publique à quelques jours seulement de l’examen des crédits pour 2011 de la mission « Fonction publique » relève à double titre de l’exercice d’équilibriste : il s’agit en effet de parer au risque de redondance et de ne pas déflorer le sujet spécifique de l’évolution des effectifs et du financement des carrières des agents publics.
Je m’en tiendrai donc aujourd’hui au seul aspect qualitatif de la fonction publique, un aspect auquel sont, au demeurant, particulièrement attachés les Français puisque, au-delà de la fonction publique en tant que telle, ils accordent au « service public » des vertus presque magiques.
Il est d’ailleurs paradoxal de constater dans nos bourgs ruraux, mais aussi dans nos banlieues dites « difficiles », la demande pressante de « plus de service public », …

… c’est-à-dire souvent de « plus de service au public », et les critiques parfois virulentes formulées à l’égard des fonctionnaires et agents de la fonction publique.
Je veux rendre justice à ces personnels et souligner combien, dans leur ensemble, ils ont un sens aigu du devoir au service de la collectivité, alors même que les conditions d’exercice de leurs fonctions, multiples et diverses, se sont modifiées et complexifiées.
On ne peut, à cet égard, que se féliciter du long travail de réflexion qui a été conduit sur la notion de « métier », une notion rejetée pendant de nombreuses années par l’ensemble des partenaires et aujourd’hui entrée, presque naturellement, dans le vocabulaire ordinaire de la fonction publique. Il était temps, en effet, d’admettre que le service public exige des compétences, des talents, des savoir-faire qui s’inscrivent pleinement dans des « métiers » particuliers plus que dans des « corps », voire des « cadres d’emplois », ce qui était déjà, à mon sens, un vrai progrès. Les métiers de la fonction publique sont une petite révolution à travers ce qu’ils emportent de reconnaissance de la spécificité d’un « art » particulier au service d’autrui.
On devrait pouvoir aussi se féliciter des dispositions de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique en ce qu’elles ouvraient enfin les portes entre les trois fonctions publiques, jusque-là solidement cloisonnées. L’objectif premier était bien de donner une véritable flexibilité, une véritable souplesse, de nouvelles possibilités de déroulement de carrière à des fonctionnaires, par force quelque peu statiques. Il serait intéressant de pouvoir mesurer aujourd’hui, un an après la promulgation de cette loi, quels en ont été les effets concrets.
J’ai en effet tendance à craindre que son application ne soit contrariée par la mise en œuvre concomitante de la révision générale des politiques publiques, …

… cette RGPP dont je voudrais souligner le dévoiement.
Je ferai un bref point d’histoire pour rappeler que la RGPP est le pur produit de la LOLF, une LOLF qui fut adoptée unanimement parce qu’elle était regardée par tous comme un outil moderne, efficace, transparent, de gestion du budget de l’État.

Mais cet outil est venu bousculer l’organisation des administrations de l’État, qui ont dû se restructurer pour répondre aux nouvelles obligations des « programmes », des « missions », des « budgets opérationnels de programme »…
La RGPP est apparue comme le deuxième étage d’une immense fusée, porteuse en son socle d’un arsenal complexe de déconcentration et de décentralisation. D’où la place prépondérante donnée au préfet de région, avec ses directions techniques satellites, et l’espace réduit à la sécurité et à la gestion de crise accordé au préfet de département. D’où, aussi, la réflexion traduite dans la loi de 2005 de l’acte II de la décentralisation.
Alors que cette révision générale des politiques publiques, dont on oublie trop souvent qu’elle s’applique à toute la fonction publique, c’est-à-dire également à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière, aurait dû conduire à une réflexion de fond sur les structures, mais aussi sur leur fonctionnement, leurs méthodes, elle s’est cristallisée sur la réduction des effectifs.

La réduction des effectifs est désormais un leitmotiv, qui gomme tous les autres aspects de cette révision. Il en est fait une application systématique, et cela est rappelé avec force dans les lettres de cadrage aux administrations de l’État. Chacune de ces dernières a beau tenter de justifier ses besoins, la machine infernale est en marche et n’accepte que de maigres dérogations au principe intangible du non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite.
Loin de moi l’idée de défendre à tout prix l’augmentation des effectifs, ou même leur maintien ; loin de moi de ne pas admettre l’absolue nécessité de réduire le déficit de l’État.

Mais n’existe-t-il pas d’autres voies, encore inexplorées, qui permettraient aux services de l’État de s’organiser pour le meilleur bénéfice de tous, usagers et administrés autant que personnels de l’État ?
S’est-on suffisamment demandé quelles étaient les raisons de ces sorties intempestives de la fonction publique ? Je pense ici, notamment, à certains départs anticipés de policiers ayant choisi la retraite plutôt que de poursuivre leur activité dans des conditions qu’ils jugeaient probablement insupportables
S’est-on interrogé sur la perte de mémoire administrative, sur la rupture de la chaîne de transmission, sur la nécessité de recruter un jour, plus tard, massivement, pour rendre à la fonction publique sa juste efficacité ?
La rigidité excessive du concept d’efficience, arrivé avec la LOLF, ruine les efforts de certaines administrations pour se maintenir à un niveau d’activité raisonnable, convenable au regard de leurs missions. Il n’est que de penser à la justice, à l’éducation nationale ou à la police, que j’évoquais il y a un instant.
La même rigidité s’applique aujourd'hui à la fonction publique hospitalière et nombre de services hospitaliers s’inquiètent des directives économiques données aux agences régionales de santé pour gérer au plus près leurs budgets, trop souvent au détriment des patients.
S’agissant, enfin, de la fonction publique territoriale, je voudrais m’inscrire en faux contre cette idée selon laquelle les collectivités territoriales auraient créé des emplois sans compter, …

… emplois qui mettraient maintenant leurs budgets en difficulté.
La décentralisation de 1982 avait conduit, dans les premières années, à des excès, qui ont depuis été reconnus par tous. Il est clair que les collectivités se sont assagies à cet égard, car les exécutifs locaux ont bien perçu les difficultés auxquelles les exposerait une gestion non maîtrisée de leurs effectifs. Les dernières fortes augmentations enregistrées sont consécutives au transfert de compétences en matière d’éducation et de routes.

Tout juste faut-il admettre que la quasi-généralisation des intercommunalités a suscité des créations d’emplois, à l’instar de la mise en place des pays, qui n’ont pas su rester des lieux de réflexion et se sont transformés en structures consommatrices de moyens.
S’agissant donc, globalement, des effectifs des fonctions publiques, et sans méconnaître les efforts collectifs qui doivent être consentis par l’ensemble des acteurs publics, il me paraîtrait dangereux de vouloir à toute force entrer dans une stratégie d’économies, une stratégie qui ignorerait l’intérêt général, qui ne se préoccuperait pas de la dignité du travail des agents publics et qui, sans raison ni mesure, sacrifierait une génération d’administrés et d’administrations.

Mme Anne-Marie Escoffier. Je suis sûre que le Gouvernement ne le veut pas et je forme le vœu, avec l’ensemble des membres du groupe du RDSE, qu’il trouvera les voies et raisons de la sagesse.
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, depuis qu’ils ont été instaurés, voilà quelques années, ces débats sans vote et sans décisions à la clé restent un peu stériles puisqu’ils sont déconnectés de toute mesure concrète. Néanmoins, nous y participons, …

… contribuant ainsi à apporter une réflexion sans doute différente. Mais force est de constater, au fil des années, que nos interventions restent lettres mortes, nos remarques, pourtant pertinentes, toujours ignorées et que vous continuez à tracer le sillon de votre politique plutôt antisociale.
Curiosité notable cette année, mais pas anodine, qui détourne le sujet de cet échange : avancer le débat sur les effectifs de la fonction publique, hors du contexte du projet de loi de finances, témoigne de votre souhait de masquer cette problématique.

Quoi qu’il en soit, nous vous rappellerons ici quelques réalités et démontrerons à quel point votre politique, en plus d’être inefficace au regard de la qualité des services rendus aux usagers, est socialement injuste pour les agents eux-mêmes.
En préambule, rappelons que le Gouvernement s’est engagé auprès de l’Union européenne à réduire son déficit public. De fait, il propose un budget de rigueur qui, s’il était voté et appliqué, entérinerait la baisse la plus importante jamais réalisée par un gouvernement français. Ainsi, des économies représentant 7 milliards d’euros sont attendues dès 2011. « Tous les acteurs de la dépense publique vont être concernés », a expliqué François Baroin.
En conséquence, une fois de plus, le non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux dans la fonction publique continuera, avec, à la clé, 31 638 suppressions de postes en 2011.
L’éducation nationale est toujours le ministère le plus touché, avec 16 000 suppressions de postes. Sont également concernés les ministères de l’intérieur, de l’écologie, de l’agriculture et du travail, devant ceux de l’économie, des affaires étrangères et de la culture.
Depuis 2008, le Gouvernement s’acharne donc dans sa politique de suppression de postes, mais pour quels résultats ?
Dans un récent rapport, la Cour des comptes a montré que cette réduction des effectifs était inefficace tant du point de vue de la réduction des dépenses publiques que de celui du bon fonctionnement des services.
Le Président de la République avait défendu cette politique de suppression de postes en arguant qu’elle devait s’accompagner d’une augmentation des salaires pour les fonctionnaires restants.
Prenons le cas de l’éducation nationale : les suppressions de postes sont censées avoir dégagé 396 millions d’euros d’économies en 2009, mais les personnels n’ont pas touché la moitié de cette somme sous forme d’augmentations. Seule une enveloppe de 138 millions d’euros leur a été redistribuée, soit un taux de rétrocession inférieur à 35 %.
Or, dans le même temps, le projet de loi de finances pour 2011 préconise le gel du point d’indice. Les observations de la Cour des comptes laissent d’ailleurs penser que ce gel se poursuivra dans les prochaines années puisqu’on peut lire dans le même rapport que « le gel du point d’indice jusqu’à fin 2013 semble techniquement nécessaire, ainsi que le strict plafonnement des enveloppes de mesures catégorielles ». Idée également relayée, hélas ! par la commission Attali, qui préconise aussi « de réduire les dépenses publiques en gelant le point d’indice des fonctionnaires pendant trois ans et en étendant la règle du non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite ».
Nous sommes très modérés par rapport à cela !

À cela s’ajoute la récente réforme des retraites qui, si elle était appliquée – on peut espérer qu’elle ne le sera pas ! – conduirait à une augmentation des cotisations de retraite et donc à une baisse du revenu des fonctionnaires.
Finalement, les promesses du Président de la République d’améliorer le traitement des fonctionnaires n’ont donc pas été tenues. Au contraire, au cours de ces dernières années, les fonctionnaires ont vu s’amplifier la baisse de leur niveau de vie.
Et que constate-t-on sur le terrain ? Dans certains secteurs, la fonction publique souffre de terribles carences en personnel.
Ainsi, dans l’éducation nationale, on ne compte plus le nombre de classes fermées ou surchargées. Dans les collectivités territoriales, les administrations doivent de plus en plus souvent faire appel à des contrats à durée déterminée pour pouvoir assurer leurs missions, ce qui entraîne des coûts supplémentaires. Quant à la nouvelle structure Pôle emploi, elle fait appel à des prestataires extérieurs pour pouvoir remplir ses missions, engendrant ainsi également des dépenses qui n’ont pas lieu d’être.
Sachant que tout cela s’accompagne de la baisse des budgets et du non-respect des compensations, les services publics n’arrivent plus à exercer leurs missions et les premières victimes de cette politique sont les usagers.
De surcroît, alors même qu’on invoque la rigueur pour justifier cette politique, celle-ci est en fait génératrice de coûts différés. Ce n’est pas parce qu’il y a moins de professeurs, moins de médecins ou moins de conseillers à Pôle emploi que nos concitoyens n’auront plus besoin d’éducation, de soins ou d’emplois. Le mauvais traitement de ces situations ne fait qu’aggraver les problèmes et rend leur résolution plus difficile et plus chère.
L’inadéquation de vos mesures aux besoins réels est criante.
Prenons, par exemple, le cas de la Réunion, département cher à ma collègue et amie Gélita Hoarau. L’application mécanique de cette politique de suppression de postes y est lourde de conséquences et contribuera, dans de nombreux domaines, à accentuer le retard que ce département ultramarin accuse déjà par rapport aux départements métropolitains.
En effet, la pression démographique y est plus forte que dans n’importe quel autre département de toute la République : la Réunion compte aujourd’hui 800 000 habitants et, dans quinze ans, elle en comptera 200 000 de plus. Comment, dans de telles conditions, envisager la diminution du nombre de fonctionnaires sans dégrader profondément le service public ?
De plus, alors que la Réunion accuse un retard scolaire reconnu par tous, de nombreux postes vont être supprimés dans l’éducation nationale, accentuant ainsi le problème.
Enfin, bien que ce département connaisse un taux de chômage particulièrement élevé, la fermeture de l’accès à la fonction publique empêchera l’accès à l’emploi d’un grand nombre de jeunes.
Dès lors, comment ne pas faire le constat de l’échec de la RGPP et de la politique du Gouvernement à l’égard de la fonction publique ?
Les réductions des dépenses publiques auxquelles vous semblez tant tenir sont moindres que celles qui étaient escomptées, mais desservent surtout, en définitive, les fonctionnaires et les usagers. En effet, les fonctionnaires doivent exercer leur travail dans des conditions détériorées du fait du manque de moyens et d’effectifs. Ces carences se reportent ensuite sur les citoyens, qui doivent faire face à une offre publique dégradée, marquée par de nombreux dysfonctionnements qu’il faudra bien, hélas ! payer un jour.
Sous couvert de pragmatisme, vous menez, monsieur le secrétaire d'État, une politique dogmatique à la fois antisociale et économiquement dangereuse. Il est donc plus que temps de changer de cap !
Puisse cette énième discussion mettre un terme à votre vision entrepreneuriale des services publics, pour ne pas dire votre aspiration à des services publics a minima ! Souhaitons en tout cas que soit envisagé un véritable débat constructif sur les missions de l’État, un État assurant l’égal accès des citoyens aux services publics et répondant enfin aux besoins de la population. Il est temps de réfléchir à un service public rénové dans une optique tripartite : État, fonctionnaires, usagers.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – Mme Anne-Marie Escoffier applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'état, mes chers collègues, depuis plusieurs années, nous avons coutume de débattre préalablement au débat budgétaire des effectifs dans la fonction publique. Je me réjouis que cet usage perdure, eu égard à l’importance que revêt le rôle de chacun des agents de la fonction publique pour le fonctionnement de l’État, de nos collectivités territoriales et de nos hôpitaux.
Nous abordons ainsi aujourd’hui de nouveau la spécificité de la fonction publique au travers des « effectifs ». Vous venez, monsieur le secrétaire d'État, de publier le rapport annuel 2009-2010 sur l’état de la fonction publique. À cette occasion, vous avez rappelé que l’emploi public, toutes fonctions publiques confondues, se stabilisait pour la première fois depuis 1980.
La fonction publique territoriale demeure la première créatrice d’emplois, avec 69 000 emplois, y compris 54 500 emplois transférés dans le prolongement de l’acte II de la décentralisation. La fonction publique hospitalière voit, elle, ses effectifs augmenter de 10 000 agents. Quant à la fonction publique de l’État, elle enregistre une diminution de 77 000 agents, se décomposant comme suit : 86 000 agents en moins dans les ministères, avant transfert aux collectivités au titre de la décentralisation, et 9 000 agents en plus dans les établissements.
Deux sujets essentiels ont été, ces deux dernières années, au cœur de nos discussions législatives : la mobilité et les parcours professionnels, qui ont donné lieu à la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique et la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
La loi du 3 août 2009 permet aux agents de diversifier et de valoriser leur parcours et aux administrations de recruter les compétences dont elles ont besoin. La généralisation de l’entretien professionnel annuel concourt à renforcer la prise en compte de l’expérience et des compétences acquises au cours de la carrière.
Quant à la loi du 5 juillet 2010, elle est directement issue de l’accord historique de Bercy, signé par six des huit organisations syndicales en juin 2008. Cette loi doit donner lieu très prochainement à des décrets d’application répondant à des objectifs précis : renforcer la légitimité des acteurs ; promouvoir de nouvelles pratiques de dialogue par la négociation ; renforcer le rôle des organes consultatifs et améliorer leur fonctionnement ; enfin, renforcer les garanties de carrière des agents investis de mandats syndicaux.
Vous avez également souhaité, monsieur le secrétaire d'État, travailler sur d’autres aspects fondamentaux de la gestion des ressources humaines de la fonction publique. Je tiens à saluer, au nom de mes collègues du groupe UMP, l’ensemble des mesures que vous avez prises en faveur du pouvoir d’achat des fonctionnaires et qui introduisent une nouvelle politique de rémunération, fondée sur la performance.

Monsieur le secrétaire d'État, j’aimerais que vous nous parliez plus précisément de l’ensemble de ces dispositifs, essentiels pour la carrière des agents publics.
Concernant le volet salarial, le groupe UMP souhaiterait savoir si, dès lors qu’il s’agit d’obtenir la stabilisation des dépenses salariales, le gel du point d’indice de la fonction publique est certain pour les trois prochaines années, comme le suggère la Cour des comptes.
S’agissant des effectifs, la Grande-Bretagne entreprend aujourd'hui une politique beaucoup plus massive que celle de la France puisqu’elle vise à la suppression de plus de 500 000 emplois publics. La France sera-t-elle contrainte de suivre cet exemple ?
Le Gouvernement a tenu les engagements pris par le Président de la République de ne pas remplacer le départ en retraite d’un fonctionnaire sur deux. Le budget pluriannuel prévoit encore des suppressions de postes chez les fonctionnaires d’État, mais qu’en est-il des opérateurs de service public ?
Enfin, monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous donner des indications quant à l’évolution des effectifs dans les autres fonctions publiques, notamment la fonction publique territoriale ?
Malgré ces quelques interrogations, qui appellent des précisions, le groupe UMP soutiendra vigoureusement les orientations et décisions prises par le Gouvernement en vue de la modernisation de nos services publics et l’accompagnement des carrières des agents des trois fonctions publiques.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – M. le président de la commission des finances applaudit également.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens avant tout à remercier chacun de ceux qui ont bien voulu participer à ce débat. Nous sommes en effet peu nombreux à nous intéresser vraiment à la question de la fonction publique. Or, je le dis très sincèrement, il importe, quelles que soient nos divergences de vues – j’ai bien entendu vos critiques, madame Mathon-Poinat –, que nous puissions débattre de temps à autre de ce sujet qui n’a rien d’anodin. Cela nous donne en tout cas l’occasion de mesurer les évolutions.
Vous me permettrez donc de vous faire part à mon tour, avec franchise, de mes convictions et d’insister sur les quelques points à propos desquels mon analyse diffère de celle de certains d’entre vous.
Je commencerai par quelques réflexions globales, avant de vous apporter des réponses plus ponctuelles.
Je crois d’abord qu’il faut se garder d’adhérer à l’idée selon laquelle la fonction publique française serait aujourd'hui en train de dépérir, de s’appauvrir. Les chiffres – et il s’agit de statistiques incontestables – suffisent à montrer que ce n’est pas le cas : à la fin de l’année 2008, la fonction publique comptait environ 5 300 000 agents, soit à peu près 1 400 000 de plus qu’en 1980 !
Plus précisément, depuis cette date, la fonction publique de l’État a vu ses effectifs augmenter de 10, 8 %, la fonction publique territoriale, de 78 % et la fonction publique hospitalière, de 36, 5 %.
Bien sûr, on pourra toujours me rétorquer que cette appréciation de l’évolution des effectifs part de trop loin en arrière. Il n’empêche que ces chiffres invalident totalement l’idée selon laquelle la France serait aujourd'hui un pays sous-administré et qu’ils permettent de relativiser quelque peu la façon dont a parfois été présentée la politique du non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite.
Mais je veux bien entendre l’objection : quelle est donc l’évolution si l’on prend un point de comparaison plus récent ? Entre 2000 et 2008, la fonction publique a vu ses effectifs croître de 540 000 agents, dont 340 000 agents dans les collectivités territoriales, et ce hors transfert de compétences.
J’insiste sur ce dernier point, monsieur Mahéas, puisque c’est une question qui vous préoccupe : ce sont bien, hors transfert de compétences, 340 000 agents supplémentaires qui ont été recrutés par les collectivités territoriales entre 2000 et 2008 !
Mais si, et je les tiens à votre disposition ! Je complète même mon propos : au titre des transferts de compétences, ce sont 115 000 à 120 000 postes qui ont été créés dans la fonction publique territoriale.
Cela étant, et quelles que soient les politiques menées en matière de réduction des effectifs depuis la fin de l’année 2008, on assiste globalement à une quasi-stabilisation des effectifs par rapport à l’année 2007. C’est une première ! Je veux souligner ici que c’est évidemment en grande partie grâce à la politique concernant la fonction publique de l’État qu’une telle stabilisation a pu se produire.
L’État a en effet décidé non seulement de freiner la hausse de ses effectifs, mais aussi de les réduire en engageant une démarche volontariste et courageuse. Grâce à cette politique, les effectifs de l’État se sont établis, en 2008, à 2, 4 millions d’agents. Pour autant, là encore, nous sommes loin d’être dans une situation de pauvreté accentuée.
La révision générale des politiques publiques, qui consiste à analyser méthodiquement les missions, les procédures, les résultats attendus et les moyens mobilisés pour y parvenir, a été au cœur de la politique que nous menons pour contrôler, dans un premier temps, puis réduire, dans un second temps, les effectifs de l’État.
Contrairement à ce que j’ai entendu ici ou là, cette démarche fait suite à différentes procédures qui ont été mises en place au cours de la dernière décennie, comme les stratégies ministérielles de réforme, les SMR, lancées en 2003 par Eric Woerth et les audits organisés par Jean-François Copé lorsqu’il était ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.
Selon des processus d’identification bien précis, des marges de productivité ont été repérées, ce qui a permis à l’État de se fixer l’objectif ambitieux de réduire les effectifs.
M. Georges Tron, secrétaire d'État. Au total, entre 2007 et 2011, plus de 100 000 départs en retraite n’auront pas été remplacés. Cela représente – je le précise, car nous sommes évidemment tous, à commencer par M. le président de la commission des finances, sensibles à la question de la maîtrise des comptes publics –, sur la base d’une carrière complète suivie d’une retraite, une économie comprise entre 130 milliards et 150 milliards d’euros, à raison d’un coût global par agent de l’ordre de 1, 3 million à 1, 5 million d’euros.
M. Jacques Mahéas fait une moue dubitative.
Pour répondre directement aux questions qui m’ont été posées sur le sens de ces économies, je puis vous dire que le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite ne découle pas d’une pure logique comptable. En vérité, cette démarche procède d’une réflexion approfondie, engagée voilà un certain temps.
La RGPP nous a permis de dégager des marges de productivité. L’État peut déléguer des missions très peu stratégiques ou y renoncer. En effet, pourquoi des agents publics devraient-ils se charger du gardiennage ou de l’entretien des bâtiments, par exemple ? Il s’agit d’un vrai sujet sur lequel j’ai eu l’occasion de travailler alors que j’occupais d’autres fonctions. Il y a différentes façons de procéder pour se dégager de missions qui ne relèvent pas de l’essence même du service public.
Par ailleurs, des réflexions ont été menées par les ministères afin de mieux utiliser les compétences des agents. Ainsi, en réduisant le nombre de transferts des détenus grâce à la généralisation de la visioconférence, nous avons permis à des gendarmes et des policiers de se recentrer sur des missions essentielles telles que le maintien de l’ordre, suscitant de fait des économies en termes d’emplois.
Puisqu’on évoque régulièrement la réduction des effectifs de la police ou de la gendarmerie, j’indique que ne sont concernés que les emplois liés au support logistique, en aucun cas ceux qui se trouvent au cœur des missions de ces deux corps. C'est la raison pour laquelle est dépourvue de fondement la critique selon laquelle la mission de service public qu’est le maintien de l’ordre est appauvrie.
Au ministère du budget, des gains de productivité ont aussi pu être dégagés avec, notamment, les opérations de télépaiement des impôts et la fusion de la direction des impôts et de la direction du Trésor.
Vous le voyez, mesdames, messieurs les sénateurs, la RGPP est bien une démarche rationnelle et approfondie.
Plusieurs d’entre vous, notamment le président Arthuis et M. Mahéas, se sont inquiétés du fait que la qualité de l’offre éducative pouvait être remise en cause.
Pour ma part, je suis intimement convaincu que la qualité de l’offre éducative ne dépend pas de la quantité de moyens mobilisés. Du reste, si cette vision comptable était juste, on en aurait vérifié le bien-fondé il y a belle lurette par des effets concrets. Or tel n’est pas le cas, comme l’attestent, là encore, monsieur Mahéas, quelques chiffres.
Depuis 1990, le nombre d’enseignants a augmenté de plus de 45 000, alors que, dans le même temps, le nombre d’élèves a diminué de plus de 600 000 !
Je vous ferai d’abord observer que, si nous obéissions à la logique comptable que vous avez décrite, nous ne pourrions pas constater de tels chiffres. (
Mais enfin, monsieur Mahéas, vous ne pouvez pas faire la moue chaque fois que je vous livre des chiffres ! Vous les avez demandés, je vous les donne !
Mais il est une autre conséquence que l’on peut tirer de cette évolution divergente des effectifs des enseignants et de ceux des élèves. Et là encore, je tiens à votre disposition – avec le ministère de l’éducation nationale – des chiffres directement issus des statistiques élaborées selon la méthode de comparaison internationale PISA. Ces chiffres, qui mettent en regard la compétitivité française avec celle des principaux pays à économie comparable, démontrent que l’augmentation du nombre d’enseignants n’aboutit pas à de meilleurs résultats.
Cela signifie que l’on est tout à fait en mesure de découpler l’augmentation du nombre d’enseignants et la performance du système scolaire et éducatif.
Aujourd'hui, le véritable enjeu est d’adapter les moyens pour les concentrer là où ils sont utiles. C’est ce que fait le Gouvernement depuis 2007.
Par ailleurs, il faut en finir avec l’idée selon laquelle le non-remplacement serait une démarche automatique, alors qu’elle est élaborée en lien avec les différents ministères. À ce titre, sa souplesse est trop souvent ignorée. Dans l’enseignement supérieur, par exemple, cette mesure ne s’applique pas sur la période 2009-2011. Je peux également citer le cas de la justice : environ 400 emplois sont créés au ministère de la justice.
Bien entendu, cette réflexion ne devait pas oublier les opérateurs de l’État, ainsi que je l’avais déjà souligné lorsque j’étais député. Je rappelle que, depuis 2009, les opérateurs sont soumis à des plafonds d’emplois, décomptés en ETP, comme vous l’avez justement relevé, monsieur le président Arthuis. Une diminution de 2 600 emplois leur sera imposée cette année. Cela correspond à une norme de l’ordre de 1, 8 %, à peu près comparable à celle que l’on applique dans les administrations centrales, c’est-à-dire au non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite.
Autrement dit, la question importante des opérateurs trouve aujourd’hui une réponse. Ainsi, je le précise à l’intention de M. Lefèvre, à partir de l’année 2011, la règle du « un sur deux » s’appliquera de manière très stricte aux opérateurs.
J’ajoute que l’on appliquera les mêmes critères concernant l’immobilier, et c’est une question que j’ai suivie avec une attention toute particulière. Comme vous le savez, nous avons appliqué une norme issue des réflexions du Conseil pour l’immobilier de l’État, norme qui veut qu’une surface de 12 mètres carrés soit dédiée à chaque agent public. Jusqu’à présent, nous n’avions pas appliqué cette règle aux opérateurs. Ce sera dorénavant le cas.
Je reviens maintenant à une observation d’ordre plus général. Il faut arrêter de penser que nous sommes les seuls au monde à réduire nos effectifs, comme je l’ai entendu dans plusieurs interventions. J’observe que tous les pays européens se sont engagés dans une voie similaire, parfois de façon plus brutale, y compris dans des pays où la gauche est au pouvoir, comme le Portugal ou l’Autriche. D’ailleurs, nous savons que les critères qui ont été appliqués dans ces pays-là ont abouti à des coupes beaucoup plus claires.
À ce sujet, monsieur Lefèvre, vous m’avez demandé si l’État français envisageait de pratiquer des réductions aussi drastiques d’effectifs qu’en Grande-Bretagne, où il est question de supprimer 500 000 postes d’agents publics. Vous auriez d’ailleurs pu également citer la Grèce.
Quoi qu'il en soit, la réponse est négative : la France ne suivra pas cet exemple…
…car nous ne sommes pas dans la même situation.
Sans entrer dans le détail, je rappelle que la situation budgétaire et financière de la Grande-Bretagne est bien plus dégradée que la nôtre : l’impact de la récession y est beaucoup plus fort, le déficit dépassant 11, 5 % du PIB, contre 7, 5 % en France en 2009.
Il faut également préciser que le périmètre n’est pas le même puisque la suppression des 500 000 emplois en Grande-Bretagne concerne à la fois la fonction publique d’État et les collectivités, alors que seule la fonction publique d’État est concernée dans notre pays, et ce jusqu’en 2013. À cette date, le total des suppressions de postes réalisées en France depuis mai 2007 s’élèvera à peu près 200 000.
S’agissant toujours de la règle du « un sur deux », je rappelle que les agents publics bénéficient de plus de la moitié des économies qu’elle génère. Cela se traduit pour eux par une amélioration de leur pouvoir d’achat.
Je voudrais d’ailleurs dire à M. Mahéas, à Mme Escoffier et à Mme Mathon-Poinat que la description qu’ils font de l’application du « un sur deux » est tout à fait incomplète et que leur raisonnement est, de ce fait, contradictoire.
En effet, vous nous accusez de réduire de façon beaucoup trop drastique les effectifs de la fonction publique en pratiquant cette règle et vous nous expliquez que cette réduction ne vise qu’à des économies budgétaires. Or des études réalisées par des organismes que l’on ne peut pas soupçonner d’être à la solde du Gouvernement – je fais allusion, en particulier, à la Cour des comptes – montre que, en 2010, le retour catégoriel du « un sur deux » représente non pas 50 %, mais 73 % des économies réalisées.
En d’autres termes, le retour catégoriel permet aujourd’hui de dégager, sur le milliard d’euros potentiellement économisé, 650 millions à 700 millions d’euros pour améliorer le sort des agents.
L’éducation nationale en fournit une parfaite illustration.
La mastérisation, qui correspond à une demande récurrente de tous les syndicats de l’éducation nationale, coûte 200 millions d’euros. Or, mesdames, messieurs les sénateurs, ces 200 millions d’euros sont puisés directement dans le retour catégoriel du « un sur deux ».
La prime d’installation des professeurs des écoles représente à peu près 45 millions d’euros. Là encore, ces fonds sont puisés directement dans le retour catégoriel du « un sur deux ». C’est également le cas de la prime pour les proviseurs, qui coûte, quant à elle, 25 millions d’euros.
Par conséquent, on ne peut pas dire à la fois que la réduction des emplois publics est terriblement brutale et qu’elle ne profite pas aux agents.
Des économies sont en réalité générées sur le long terme – 130 milliards d’euros, comme je l’ai rappelé tout à l’heure – tandis que, dans l’immédiat, nous avons en outre la capacité de verser aux agents des gratifications grâce à d’importants retours catégoriels.
La vraie question qui va se poser – elle est d’ailleurs posée par la Cour des comptes – est de savoir si, oui ou non, nous ne devons pas faire preuve de beaucoup plus de rigueur dans la façon dont nous appliquons le retour catégoriel du « un sur deux ». Lorsque vous lisez attentivement le rapport de la Cour des comptes – j’ai eu un débat hier à ce sujet avec le président Cahuzac, à l’Assemblée nationale, en commission des finances élargie –, vous vous apercevez que le véritable enjeu est le suivant : ne faudra-t-il pas, demain, atteindre le taux de 50 %, puis celui de 25 % ou de 20 % ?
C’est en tout cas, selon la Cour des comptes, l’une des conditions pour que soit stabilisée la masse salariale. La logique de la Cour des comptes et de son président, ancien président de la commission des finances de l’Assemblée nationale, est donc, de loin, beaucoup plus rigoureuse que celle que le Gouvernement suit lui-même.
J’aimerais, monsieur Mahéas, que vous m’expliquiez au passage comment on peut à la fois critiquer les positions du Gouvernement sans critiquer celles, beaucoup plus dures, de la Cour des comptes.
Je souhaite également faire litière de cette idée fausse selon laquelle la RéATE, c'est-à-dire la réforme de l’administration territoriale de l’État, servirait à supprimer des postes. C’est totalement inexact ! En réalité, cette réforme est avant tout organisationnelle et vise à rendre les services de l’État en région et dans les départements plus performants et plus lisibles pour les Français. Le fait de réduire le nombre de directions, le fait d’imprimer une nouvelle culture chez des agents qui étaient habitués à une appartenance verticale, et qui dorénavant appartiennent à des structures pluriministérielles, constituent autant d’évolutions positives.
Je le dis avec force : il ne s’agit, en aucun cas, d’amplifier le mouvement de non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Je me rends suffisamment en province pour mesurer toutes les difficultés de mise en œuvre de la RéATE. Ces difficultés existent notamment parce qu’il faut trouver un point d’équilibre entre la région et le département. La région devient le pilote de l’administration déconcentrée. Disons-le franchement : elle a un peu tendance à prendre les départements pour quantité négligeable. Or le département est par définition l’administration de proximité.
Je suis d’ailleurs extrêmement sensible à la façon dont les préfets et les élus que je rencontre régulièrement me font part de leurs inquiétudes à cet égard. Je les transmets directement au Premier ministre puisque c’est auprès de lui qu’est placée la cellule qui supervise la mise en œuvre de la RéATE.
Si la Cour des comptes émet un certain nombre de critiques sur la gestion par le Gouvernement des effectifs de l’État et de sa masse salariale, elle propose des réponses qui ne me choquent en rien. J’en citerai quelques-unes, que vous avez vous-mêmes évoquées.
La Cour évoque d’abord la nécessité de geler le point d’indice de la fonction publique sur la période 2011-2013.
Vous me pardonnerez, mesdames, messieurs les sénateurs de l’opposition, d’insister quelque peu sur ce point, car il me paraît mériter certaines précisions. Je vous demande simplement, non pas de m’épargner la critique – des critiques, au-delà du grand plaisir que j’ai toujours à me trouver au Sénat, j’en ai essuyé beaucoup, dans cet hémicycle, au cours des dernières semaines ! §–, mais de faire preuve de cohérence.
La Cour des comptes évoque donc très clairement la nécessité de geler le point d’indice de la fonction publique sur la période 2011-2013. Or, en conséquence des accords de 2008 que nous avons signés avec les organisations syndicales, le Gouvernement a décidé de faire, en 2010, l’inverse de ce qui se fait dans tous les pays qui nous entourent : nous avons en effet augmenté de 0, 5 % le point d’indice dans la fonction publique et nous avons décidé de geler ce point d’indice ultérieurement, pour une année.
Ça n’empêche pas, monsieur Mahéas, le pouvoir d’achat des agents de la fonction publique d’augmenter puisqu’il est complété, comme vous le savez, par le GVT et par les mesures catégorielles qui atteignent un montant significatif : 650 millions d’euros, je le rappelle.
Nous avons mis également en place, en application des accords signés en 2008 avec les organisations syndicales, la garantie individuelle de pouvoir d’achat, ou GIPA. Cette dernière concerne 140 000 agents de l’État, pour un montant de 120 millions d’euros, et permet, de fait, de disposer d’une garantie de stabilisation du pouvoir d’achat de la fonction publique.
Par conséquent, quand je constate que la Cour des comptes recommande une austérité gouvernementale au regard de la masse salariale bien plus forte que celle que nous menons, je me permets de vous interroger pour savoir si tout cela ne mérite pas une réflexion éventuellement un peu plus nuancée de votre part.
Monsieur Lefèvre, vous m’avez interrogé sur l’évolution des effectifs dans la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale.
S’agissant des hôpitaux, j’entends trop souvent dire que l’on diminue les capacités d’accueil et de soins. Cela ne correspond pas à la réalité. La vérité, c’est qu’entre 2000 et 2008 les effectifs de la fonction publique hospitalière ont crû de 146 000 personnes. Et cette augmentation se poursuit alors même que la santé de nos concitoyens s’améliore, l’ensemble des paramètres d’évaluation l’attestent.
Les projets de réductions d’effectifs, évoqués ici ou là, concernent des établissements qui ont recruté au-delà de leurs capacités budgétaires. On ne peut que se féliciter qu’une logique de saine gestion reprenne le dessus.
Cela dit, n’ayons pas d’illusions, la tendance nationale reste à la hausse : 10 000 recrutements supplémentaires ont été effectués entre 2007 et 2008.
Concernant la fonction publique territoriale, sur laquelle M. Mahéas m’a également interrogé, je le répète, entre 2000 et 2008, en neutralisant les effets des transferts, la croissance nette des effectifs a été de 340 000 agents, soit une augmentation de 24 % et, entre 2007 et 2008, 70 000 personnels ont été recrutés ou transférés. Par conséquent, les accusations selon lesquelles nous tenterions d’imposer à la fonction publique territoriale les critères appliqués à l’État sont infondées.
Monsieur Mahéas, vous avez indiqué, avec l’amabilité qui vous caractérise et dont je vous sais infiniment gré, qu’il était difficile d’évaluer l’effort qui pourrait être demandé aux collectivités territoriales.
Comme vous, je suis maire et président d’une communauté d’agglomération. J’ai en outre, en tant que député, été en contact avec de nombreux maires. Je le demeure dans mes fonctions actuelles.
M. Georges Tron, secrétaire d'État. Fort de ces expériences et de ces contacts, je pense, à titre tout à fait personnel, qu’il existe un critère très simple pour procéder à cette évaluation : s’agissant des effectifs, ce pourrait être celui des dépenses de personnel rapportées aux dépenses de fonctionnement. Dans la mesure où l’État dégage, dans son budget, 55 milliards d’euros…
M. Jacques Mahéas proteste.
Monsieur Mahéas, vous me posez une question, permettez que j’y réponde ! Vous me demandez s’il existe un critère. Je vous en propose un. Je ne vous dis pas qu’il faut le retenir. Je vous dis : voilà comment, moi, dans un débat ouvert et sympathique, j’estime que l’on peut mesurer si, oui ou non, les collectivités territoriales accomplissent un effort comparable à celui que l’État s’impose dans le domaine de la maîtrise des effectifs. Il s’agit de rapporter les dépenses de personnel à l’ensemble des dépenses de fonctionnement.
Il n’y a pas en France une collectivité qui ne soit en situation d’effectuer ce calcul. Nous disposons donc d’un critère permettant de mesurer très concrètement cet effort. Tout comme vous, monsieur Mahéas, je suis maire d’une ville de grande banlieue, dans l’Essonne plus précisément, qui n’est pas un département particulièrement facile. Je peux donc vous dire en pleine connaissance de cause que tous les maires de la grande couronne, comme ceux de la petite couronne ou de zones rurales ont les yeux rivés sur ce critère.
Si l’État considère qu’il est important de maîtriser l’embauche dans les collectivités territoriales, je ne vois pas pourquoi celles-ci ne pourraient pas admettre que ce critère est bon.
Mais cette nouvelle conception de l’emploi public ne serait rien sans une modernisation en profondeur de la gestion des ressources humaines. La GRH doit développer notre capacité de gestion prévisionnelle et de gestion coordonnée. C’est la raison pour laquelle – et je réponds ainsi indirectement à M. Lefèvre – nous avons mis en place des dispositifs nouveaux depuis plusieurs années. Je citerai trois exemples.
Tout d’abord, les conférences de gestion prévisionnelle des ressources humaines réunissent chaque année les ministères à la DGAFP – direction générale de l’administration et de la fonction publique – pour qu’ils présentent leur plan ministériel, leurs projets de recrutements, de formation, de promotion interne. Chaque ministère dispose ainsi d’outils adaptés lui permettant de prévoir les recrutements et la formation de ses agents.
Ensuite, la gestion des ressources humaines s’appuie sur des outils modernes, tel le répertoire interministériel des métiers de l’État, qui permet non seulement aux agents de préparer leurs mobilités, mais également aux candidats à des emplois de la fonction publique de choisir la filière vers laquelle ils veulent s’orienter.
Enfin, sachez qu’une école de la GRH a été mise en place par la DGAFP. Elle permet de former les gestionnaires des ressources humaines des ministères et des opérateurs afin de développer une doctrine commune de gestion, ce qui, comme vous pouvez l’imaginer, est un facteur très favorable pour la mobilité.
Je voudrais maintenant aborder certains points qui me tiennent à cœur.
Concernant l’éducation nationale, je cite de nouveau deux chiffres qui me paraissent particulièrement parlants : depuis 1990, le nombre d’enseignants a augmenté de plus de 45 000, alors que, dans le même temps, le nombre d’élèves a diminué de plus de 600 000.
Ce constat me conduit à faire plusieurs remarques.
Pourquoi devons-nous continuer dans la voie que nous avons choisie ? Tout simplement, parce que la charge de l’intérêt de la dette représente désormais le premier poste de dépense budgétaire devant l’éducation nationale, hors pensions.
On ne peut donc pas le regretter et, dans le même temps, protester lorsque des mesures courageuses de redressement des finances publiques sont prises.
Pour votre information, sachez que la suppression de 16 000 postes permettra d’économiser 16 milliards d’euros sur quarante ans. Voilà une bonne raison de continuer ! Je me rappelle d’ailleurs que le Sénat s’était penché, il y a quelques années, sur la question de l’affectation des emplois dans l’éducation nationale. Cela avait donné lieu à un rapport, signé par Adrien Gouteyron, si ma mémoire est bonne, qui soulevait des questions fondamentales.
L’éducation nationale compte 12 millions d’élèves et 1 250 000 agents, qui ne sont évidemment pas tous enseignants puisque ceux-ci sont au nombre de 800 000. Une véritable réflexion doit être menée pour savoir si tous ces agents sont utilisés au mieux de leurs compétences.
Je signale que l’éducation nationale accapare aujourd’hui à elle seule 90 % des heures supplémentaires que l’État dispense. Cela représente un montant de 1, 4 milliard d’euros, après une augmentation de 140 millions d’euros en 2009.
En outre, les enseignants eux-mêmes souhaitent être mieux payés – à cet égard, le chiffre que je viens de citer est évocateur – et mieux considérés. Or 50 % des économies qui sont réalisées sont réinjectées au profit des enseignants. En conséquence, près de 200 000 d’entre eux perçoivent entre 60 euros et 260 euros nets de plus sur leur fiche de paie chaque mois depuis la rentrée.
Vous le voyez, cette politique de réduction des effectifs dans l’éducation nationale s’accompagne d’une revalorisation évidente de la rémunération.
Concernant la question des agents des établissements scolaires qui se trouvent en dehors de tout plafond d’emplois, question qui a été évoquée par le président Arthuis, il faut bien mesurer qu’un grand chemin a été parcouru depuis 2008, année de la mise en œuvre effective de la LOLF.
Les collèges et les lycées reçoivent en effet des dotations de l’État grâce auxquelles ils peuvent rémunérer directement un certain nombre de collaborateurs. En général, vous l’avez très justement souligné, monsieur le président, ce sont des emplois aidés. Ces établissements, qui sont très nombreux puisqu’on en compte à peu près 8 000, sont en général de petite taille. On parle d’une dizaine de collaborateurs en moyenne par établissement ; cela représente à peu près 80 000 à 85 000 agents sur le territoire national.
Compte tenu de la taille des établissements, il me semble assez peu réaliste de leur fixer un plafond d’emplois individualisé. En outre, les recrutements qu’ils effectuent sont déjà soumis à un encadrement sous la forme des crédits votés, puis délégués par les académies. Il existe donc d’ores et déjà des garde-fous.
En revanche, monsieur le président de la commission, je suis tout à fait d’accord avec vous pour dire que le Parlement devrait être mieux informé de l’évolution de ces emplois. Afin d’améliorer l’information des parlementaires, un état des recrutements par type d’emplois et par académie pourrait être introduit dans chaque rapport annuel de performances.
Pour vous montrer, madame Mathon-Poinat, que ces débats peuvent être fructueux, je vous indique que je ferai rapidement part de cette suggestion au Premier ministre.
Monsieur Mahéas, je voudrais vous donner des chiffres précis sur différents points que vous avez soulevés.
Je ne vais pas revenir sur les contractuels de l’éducation nationale, mais vous savez comme moi que, celui qui a limité les vacations à 200 heures par an, c’est Lionel Jospin.
Vous m’avez interrogé sur le pouvoir d’achat des fonctionnaires et vous avez affirmé qu’aucun chiffre n’existait en ce domaine. Je vais vous prouver le contraire immédiatement puisque j’ai sous les yeux le tableau retraçant l’évolution sur les dix dernières années. Je vous le remettrai d’ailleurs à la fin de mon intervention.
Entre 1999 et 2009, il n’y a pas une année où l’augmentation de la RMPP – rémunération moyenne du personnel en place – en euros courants n’ait été supérieure à 2, 5 %, et cela en intégrant le fait que la revalorisation du point d’indice a toujours été égale à 0, 5 %, sauf en 2003, seule année blanche durant cette période. En 2003, la RMPP brute n’en a pas moins augmenté de 3, 7 %.
Il est donc faux d’affirmer que la politique du Gouvernement vise à réduire le pouvoir d’achat des fonctionnaires. J’y insiste, car c’est un sujet dont nous discutons depuis des mois avec les organisations syndicales. Je comprends que vous le répétiez, je ferais sans doute la même chose si je siégeais sur vos travées, mais ce n’est pas vrai ! Pourquoi ? Parce que la rémunération dans la fonction publique n’est pas assise sur le seul point d’indice et qu’il faut également tenir compte du GVT et des mesures catégorielles. Si vous combinez ces différents éléments, vous vous apercevrez que la rémunération des fonctionnaires augmente.
Je tiens à le dire ici avec force : le pouvoir d’achat des agents de la fonction publique augmente de façon constante.
Tout comme Mme Mathon-Poinat, vous avez évoqué le projet de loi portant réforme des retraites, qui, je l’espère, contrairement à vous, madame la sénatrice, deviendra bientôt une loi. L’augmentation du taux de cotisation prévue par ce texte est extrêmement mesurée puisqu’elle s’étalera sur dix ans, à raison d’environ 0, 27 % par an. L’ensemble des mesures catégorielles, plus le GVT, plus la GIPA permettront de l’absorber facilement.
Monsieur le président de la commission, vous avez soulevé la question de la maîtrise des effectifs pour les opérateurs de l’État. Sachez que les règles transversales de réduction de 1, 5 % des emplois publics et des moyens de fonctionnement seront appliquées pour la première fois en 2011. Je le répète, cela représentera une baisse de 2 600 emplois à périmètre constant.
Madame Escoffier, vous avez évoqué la loi relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Il s’avère que j’étais hier devant la commission des finances et la commission des lois de l’Assemblée nationale et que je leur ai délivré un certain nombre d’informations à ce sujet dans le cadre de l’examen du volet « dépenses » du projet de budget pour 2011.
De vraies plateformes « ressources humaines » ont été créées dans toutes les régions, ainsi qu’une bourse interministérielle régionale de l’emploi public.
Nous sommes en train de faire le point, avec la DGAFP, sur les différents outils qui ont été mis en place par la loi de 2009. Je serai sans doute en mesure de dresser un bilan précis d’ici à la fin de l’année.
En attendant, je veux être sincère avec vous, quelques-uns de ces outils ne marchent pas bien. Il s’agit de certaines formes de subventions qui ne sont pas utilisées par les agents. Je pense que nous serons prochainement en mesure de corriger ces dysfonctionnements.
Mesdames, messieurs les sénateurs, quelle que soit la façon dont vous appréhendez la politique du Gouvernement, et je comprends parfaitement les critiques qui peuvent être émises, nous ne sommes pas dans une logique de « rabot », contrairement à ce qui a été dit.
M. Georges Tron, secrétaire d'État. Nous ne cherchons pas à appliquer le même modèle à toutes les fonctions publiques. Nous faisons en sorte d’ajuster le mieux possible les dispositifs à chaque situation tout en ayant présent à l’esprit le fait qu’il faut retrouver la maîtrise de nos comptes publics.
Applaudissementssur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.

Monsieur le président, je souhaiterais répondre brièvement à M. le secrétaire d'État.

Monsieur le secrétaire d’État, je me permets d’intervenir à nouveau, car vous m’avez cité à de nombreuses reprises et vous m’avez demandé de m’expliquer. Soit dit par parenthèse, je vous remercie de m’avoir fait parvenir le tableau retraçant l’évolution des rémunérations, comme vous me l’aviez promis. Je note qu’il a pour source l’INSEE.
Selon vous, rapporter les dépenses de personnel aux dépenses de fonctionnement serait le meilleur moyen de savoir si une municipalité est bien ou mal gérée. Permettez-moi de vous faire remarquer que tout dépend de ce que celle-ci décide de faire en gestion directe.

Vous le savez fort bien, si la commune s’occupe elle-même du ramassage des ordures ménagères ou possède un grand nombre de crèches, elle aura un personnel plus important. J’ai d’ailleurs parlé tout à l’heure de ces crèches que vous nous avez obligés à créer.
Par ailleurs, vous me dites que le nombre d’enseignants a augmenté. Encore heureux qu’ils soient plus nombreux qu’au début du siècle dernier ! J’ose même espérer que votre politique vise à faire progresser leurs effectifs afin que nos élèves puissent aller le plus loin possible dans leur cursus scolaire. Or vous avez supprimé une partie des RASED. Et ne me dites pas que ce n’est pas vrai !
Monsieur le secrétaire d’État, pourquoi les communes créent-elles des polices municipales ? Ne croyez-vous pas qu’elles s’en passeraient si les effectifs de la police nationale étaient suffisants ? J’en ai l’expérience dans ma commune où, très récemment, à la suite d’un problème qui est survenu, on m’a répondu qu’il fallait embaucher des maîtres-chiens pour garder certains équipements. Est-ce vraiment le rôle d’une commune ?
En Seine-Saint-Denis, il est question de remplacer les policiers par des entreprises privées de surveillance. Or ce service n’est-il pas mieux rendu par nos policiers ?
À Pôle emploi, il est fait appel à des entreprises privées pour placer des demandeurs d’emploi. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce n’est pas une réussite ! C’est même un échec global et, en plus, cela a coûté très cher !
En fait, monsieur le secrétaire d’État, nous n’avons pas du tout, vous et moi, la même conception de la fonction publique.
Vous faites des comparaisons avec d’autres pays, mais, historiquement, la France a toujours été un pays où le service public était très bien rendu. Pour ma part, ce que je souhaite, c’est que notre fonction publique donne envie aux étrangers de venir en constater toutes les qualités.
Je ne veux pas d’une fonction publique qui se cherche, en essuyant des remarques extrêmement acerbes de la part de la Cour des comptes. Car vous n’allez tout de même pas me dire que le rapport de la Cour des comptes est un satisfecit !
Enfin, s’agissant de l’évolution des salaires dans la fonction publique, vous parlez en euros courants, c'est-à-dire sans tenir compte de l’inflation. Or, selon les chiffres mêmes du ministère, le salaire net moyen des fonctionnaires d’État n’a augmenté en 2008 que de 0, 9 % en euros constants et, dans la fonction publique territoriale, il a même baissé de 0, 6 %. Dois-je en conclure qu’il y a quelque chose qui ne va pas dans ce ministère ?
Première observation : évidemment, le rapport entre dépenses de personnels et dépenses de fonctionnement global est un critère qui doit être utilisé en tenant compte de la singularité des situations. Il n’en demeure pas moins que ce critère prend évidemment en considération les dotations en faveur des politiques sectorielles, en particulier en matière sociale. Il est donc toujours valide.
Deuxième observation : les chiffres que je vous ai communiqués concernant les enseignants portent non pas sur le XIXe siècle, mais sur la fin du XXe siècle, celui qui s’est achevé il n’y a jamais que dix ans.
Troisième observation : non, monsieur Mahéas, les RASED n’ont pas été supprimés, et je sais de quoi je parle. Leur nombre a été limité, mais le dispositif « Réussite éducative » compense cette limitation. Là encore, je sais de quoi je parle : ma commune a mis en place un tel dispositif ; il mobilise aujourd'hui 45 personnes pour un montant global de 300 000 euros. On ne peut donc pas dire qu’il n’y a pas eu de compensation. §
Quatrième observation : vous dites que la fonction publique ne doit pas faire l’objet de comparaisons internationales. Bien sûr que si ! Aujourd’hui, le marché des États est comparable à celui des entreprises, même si, pour autant, les méthodes entrepreneuriales ne sont pas transposables à la fonction publique. Simplement, les comparaisons des résultats dans l’éducation nationale, par exemple, nous permettent de voir, au regard du coût par élève, si notre système est performant ou non. Refuser les comparaisons, c’est fermer les yeux sur le monde qui nous entoure.
Cinquième et dernière observation : les statistiques sur les salaires dont j’ai fait état sont évidemment en euros constants et tiennent donc compte de l’inflation. Le tableau que je vous ai transmis fait apparaître le net et le brut. Vous pourrez constater par vous-même que ce que j’ai indiqué concernant l’évolution des salaires dans la fonction publique correspond strictement à la réalité.

Nous en avons terminé avec le débat sur les effectifs de la fonction publique.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 4 novembre 2010 :
À neuf heures trente :
1. Débat sur la politique de coopération et de développement de la France.
2. Débat sur le rôle de l’État dans les politiques locales de sécurité.
À quinze heures :
3. Questions d’actualité au Gouvernement.
4. Suite de l’ordre du jour du matin.
5. Débat sur les effets sur la santé et l’environnement des champs électromagnétiques produits par les lignes à haute et très haute tension.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures trente-cinq.