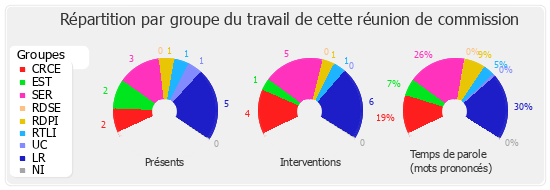Commission des affaires sociales
Réunion du 8 février 2022 à 15h30
Sommaire
La réunion

Mes chers collègues, avant de commencer, je vous demande d'observer un instant de recueillement en hommage à Olivier Léonhardt, qui était membre de notre commission. (Mmes et MM. les commissaires observent quelques moments de silence.)
Dans le cadre de la mission d'information sur l'adéquation du passe vaccinal à l'évolution de l'épidémie de covid-19, nous entendons maintenant Mme Alice Desbiolles, médecin de santé publique, qui s'exprime ici en son nom personnel.
J'indique que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo qui sera retransmise en direct sur le site du Sénat et disponible en vidéo à la demande.
Je salue ceux de nos collègues qui participent à cette réunion à distance, dont la présidente, Catherine Deroche, que je remplace cet après-midi.
Je rappelle que l'objet de notre travail est de chercher à vérifier que le passe vaccinal, un instrument conçu dans un contexte donné - celui du variant Delta -, est toujours adapté quelques semaines plus tard, alors que nous avons en quelque sorte « changé d'épidémie », le tout dans un contexte d'incertitudes pour l'avenir que nous ne méconnaissons pas.
Entre les pro et les antivaccins, dans un contexte qui se prête à un certain manichéisme, il peut être difficile de faire entendre une voix singulière qui ne méconnaisse pas les apports de la vaccination tout en interrogeant l'outil spécifique qu'est le passe vaccinal.
Nous souhaiterions donc recueillir votre analyse sur ce que peut être l'apport du passe vaccinal dans le contexte actuel.
Je vous demanderai de commencer par un court propos liminaire, afin de laisser du temps aux échanges. Je demanderai à chacun d'être concis dans les questions et les réponses.
Je vais maintenant, conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, vous demander de prêter serment.
Je rappelle que tout témoignage mensonger devant une commission d'enquête parlementaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, Mme Alice Desbiolles prête serment.
Je suis médecin de santé publique et épidémiologiste. Je précise que je n'ai pas de conflits ou de liens d'intérêt à déclarer. Je m'exprime non pas au nom des institutions pour lesquelles je travaille ou collabore, mais en mon nom propre. Les éléments que je vais vous apporter résultent d'une réflexion pluridisciplinaire. Je remercie très chaleureusement les confrères et les consoeurs qui m'ont aidée à répondre aux questions qui m'ont été soumises, ainsi que les ingénieurs, les polytechniciens, les immunologistes et les épidémiologistes - la liste est non exhaustive - qui m'ont accompagnée dans ma réflexion.
Vous m'avez interrogée sur les indicateurs mobilisés durant cette crise et sur l'importance des modélisations. Au regard des mesures mises en place, qui ont un impact sur la santé dans toutes ses dimensions, il importe de mettre dans la balance, à la fois, des indicateurs spécifiques « covid » et des indicateurs « non-covid » relatifs à la santé physique, mentale et sociale, ainsi que, pour les enfants, des indicateurs pédagogiques.
Je me félicite que des données sanitaires quotidiennes aient été mises à disposition via l'open data depuis le début de l'épidémie, notamment grâce au travail de Santé publique France, de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) et de l'application TousAntiCovid. Des rapports hebdomadaires étaient également disponibles aux niveaux national et régional. Nous avons eu accès à des données de qualité.
Néanmoins, il faut noter un certain manque de transparence. Certaines données ne sont pas publiées alors qu'elles sont disponibles : je pense par exemple aux données de réanimation pour et avec covid, en particulier chez les enfants. Il en va de même des données sur les comorbidités rapportées par âge et par statut vaccinal et des données relatives aux patients intubés. Je souligne également la présence d'indicateurs erronés : d'après les données de Santé publique France, 30 % des hospitalisations covid sont en fait des hospitalisations avec covid et non pour covid, un taux qui peut grimper à près de 50 % pour la tranche d'âge 20-39 ans. Les données sont alors difficiles à interpréter de manière rigoureuse et pertinente.
Idem pour le niveau de tension en réanimation : l'indicateur qui est disponible sur TousAntiCovid n'a pas vraiment de sens puisqu'il rapporte le nombre de patients hospitalisés en réanimation, en soins critiques et en soins continus aux seuls lits de réanimation. Si l'on rapporte le nombre de patients de trois services au nombre de lits d'un seul service, l'indicateur n'a plus aucun sens et l'estimation est forcément surestimée.
Je précise que des écarts au protocole ont été notifiés dans le dernier bulletin publié par Santé publique France. Des classes d'âge ont été regroupées en un groupe 15 à 64 ans pour les données en réanimation, alors qu'elles étaient auparavant présentées en deux classes - 15 à 44 ans et 45 à 64 ans -, ce qui est problématique : le risque de terminer en réanimation pour covid grave n'est pas le même selon l'âge. Le surpoids, une comorbidité importante responsable à elle seule, d'après un bulletin épidémiologique de Santé publique France, de 15 % de la mortalité en 2020, a disparu de ce dernier point épidémiologique : ce facteur a été très probablement intégré dans la ligne « patients sans comorbidités », ce qui augmente artificiellement le poids de ces patients. C'est un biais majeur pour l'interprétation des données.
Par ailleurs, aucune communication écrite n'est faite dans les points épidémiologiques de Santé publique France sur les causes des décès covid chez l'enfant : au vu de la sensibilité du sujet, il serait pertinent de pouvoir évaluer de manière claire cet indicateur. Nous n'avons pas de communication sur le nombre d'enfants en réanimation pour ou avec covid, et pas de résultat de la Drees sur l'évaluation vaccinale pour la tranche d'âge 11-18 ans.
Je constate aussi que les données sont présentées de façon de plus en plus partiale, ce qui ne respecte pas la neutralité et l'objectivité qui devraient pourtant être de mise dans ce domaine. Ainsi, le dernier bulletin épidémiologique de Santé publique France conclut que la part des patients ne présentant pas de comorbidités a augmenté. C'est une façon quelque peu orientée de présenter les choses : il aurait fallu préciser sur le fait que plus de 80 % des patients en réanimation ont, d'après leurs données, au moins une comorbidité.
Je note également un recours quasi systématique aux modélisations pour justifier des décisions avant leur mise en oeuvre ou a posteriori pour arguer de l'efficacité de ces décisions. Les modélisations présentent un niveau de preuve extrêmement faible, insuffisant au regard des enjeux sanitaires qui en découlent. Le même argumentaire pourrait s'appliquer au passe.
Toujours sur les modélisations, aucune évaluation de leur pertinence et de leur conformité à la réalité n'a été réalisée. Des travaux menés par des ingénieurs de Polytechnique, dont je reparlerai, montrent un décalage très important entre la réalité et ce qui avait été prévu par les modélisations, ce qui pose question.

Je vous remercie pour votre langage très direct. Je voudrais revenir sur certains points.
Nous avons mené jusqu'à présent un certain nombre d'auditions d'acteurs institutionnels : elles ne nous ont pas vraiment éclairés les déterminants précis de la décision de transformer le passe sanitaire en passe vaccinal. D'après vous, quelles données permettaient de soutenir l'introduction du passe vaccinal en décembre dernier ?
Selon moi, le passe sanitaire, comme le passe vaccinal, vise à éviter la question de la vaccination obligatoire et à inciter les personnes à se faire vacciner. Peut-on isoler l'impact du passe vaccinal sur la vaccination et sur la maîtrise de l'épidémie ?
Le passe vaccinal a été instauré en décembre dernier, en pleine vague Delta. Il s'est confirmé depuis qu'Omicron est plus contagieux, mais bien moins virulent que Delta. On parle aujourd'hui d'un sous-variant d'Omicron. Le passe vaccinal est-il toujours pertinent sur un plan sanitaire ?
Vous me posez la question du rationnel scientifique : existe-t-il des données probantes sur l'efficacité du passe vaccinal ? On peut commencer par s'interroger sur le passe sanitaire : à ma connaissance, aucune étude de bonne qualité, dotée d'un fort niveau de preuve, ne démontre une quelconque efficacité.
La mise en oeuvre de ce passe s'est appuyée sur des modélisations. Dans un avis du 6 juillet 2021, le Conseil scientifique indique que ces modélisations « sont faites avec l'hypothèse que les vaccins réduisent le risque d'hospitalisation de 95 %, le risque d'infection de 80 % et le risque de transmission en cas d'infection de 50 % ». Il faut préciser que le critère de jugement principal dans les essais cliniques randomisés de Pfizer était le nombre d'infections symptomatiques confirmées par un test PCR positif, et non l'effet du vaccin sur la prévention des formes graves et sur la diminution du risque d'hospitalisation ou de décès. Ces données ne sont d'ailleurs toujours pas disponibles.
Les données observationnelles en vie réelle confirment un impact positif de la vaccination sur la prévention des formes graves et de la mortalité chez les personnes à risque. C'est un élément très important, mais les données de vie réelle émanant des études observationnelles américaines produites à la même époque sur Delta sont complètement discordantes avec cette observation. Une étude par appariement de la Mayo Clinic montrait une efficacité vaccinale de 42 % pour Pfizer sur les infections, qui était le critère de jugement principal de l'essai clinique randomisé en juillet 2020, alors même que Delta n'avait pas encore complètement remplacé les souches précédentes. Selon un rapport des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), les charges virales étaient équivalentes chez les personnes en situation d'échec vaccinal avec Delta et chez les non-vaccinés.
Les modélisations sont susceptibles d'avoir de nombreux biais. Il n'existe donc pas de données probantes permettant de montrer l'efficacité du passe vaccinal pour sécuriser des lieux, voire les sanctuariser, un des principaux arguments avancés pour mettre en place cette mesure si ma mémoire est bonne.
L'impact positif du vaccin sur la diminution de la contamination et de la propagation ne faisait pas partie des critères de jugement principaux des essais cliniques randomisés de Pfizer. On a bien vu d'ailleurs l'échec de ces dispositifs, avec de nombreuses contaminations dans les lieux soumis au passe : l'étude ComCor de l'Institut Pasteur, menée sur la période du 23 mai au 13 août 2021, évaluait le taux de contamination dans les bars à plus de 90 % et à 240 % dans les boîtes de nuit.
Un autre argument avancé en faveur du passe sanitaire était qu'il permettait d'inciter à la vaccination : effectivement, on a noté une augmentation de la couverture vaccinale. Mais l'important est tout de même la prévention des formes graves ou létales de covid-19, notamment chez les personnes à risque. Or ce fut malheureusement un échec chez les populations les plus vulnérables. La France présente l'une des couvertures vaccinales les plus basses d'Europe de l'Ouest chez les plus de 80 ans. Des pays comme l'Irlande qui n'ont pas mis en place de passe sanitaire ou vaccinal présentent 100 % de couverture vaccinale chez les plus de 70 ans. La Finlande présente une couverture vaccinale de 94 % chez les plus de 80 ans, et au Portugal 100 % des personnes âgées étaient vaccinées avant même la mise en place d'un passe. Il en va de même pour le Danemark, avec un taux de 100 % chez les plus de 80 ans. Ces données proviennent de l'European Center for Disease Prevention and Control (ECDC).
L'intérêt majeur est d'augmenter la couverture vaccinale chez les personnes à risque, celles qui présentent des comorbidités, notamment le surpoids et l'obésité, ou qui sont âgées : de ce point de vue, les mesures n'ont pas atteint l'effet escompté. Si la vaccination présente un bon bénéfice individuel pour les personnes à risque, on peut se demander quel est le bénéfice collectif sur la dynamique infectieuse.
Un autre argument en faveur du passe était qu'il allait permettre de réduire la saturation des hôpitaux. D'après un rapport interne de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) qui a été publié, les déprogrammations ne s'expliquent pas par la prise en charge des patients non vaccinés : la plupart sont liées à des vacances de poste au bloc opératoire, notamment en raison du départ d'un grand nombre d'infirmières.
Une étude publiée par le Conseil d'analyse économique évalue à 4 000 le nombre de morts qui auraient été évités grâce au passe. Je préciser que certains auteurs de cette étude sont juge et partie, puisque l'un d'entre eux en particulier est membre du Conseil scientifique. Je ne remets pas du tout en cause l'expertise, je dis simplement que ces résultats doivent être interprétés avec précaution au regard de l'absence d'indépendance de certains auteurs.
Ensuite, c'est non pas le passe qui évite les décès, mais la vaccination. Le passe ne peut pas être évalué par comparaison avec une absence totale de mesures, comme le font souvent les études. Une myriade d'interventions sont envisageables : cibler la vaccination sur les plus fragiles, aller vers, se déplacer en zone rurale chez les personnes âgées et les personnes moins connectées. La mise en place du passe vaccinal a conduit à environ 800 000 primo-injections, mais elles n'ont pas concerné les personnes les plus fragiles. Inciter les plus jeunes, qui ne sont pas les plus à risque de forme grave ou létale de covid-19, à se faire vacciner peut même s'avérer contre-productif en termes de disponibilité et d'accès aux doses pour les personnes qui en auraient vraiment besoin. Tout le monde ne peut pas se connecter facilement à des plateformes en ligne. Cette situation dénote en quelque sorte un échec de la politique du « aller vers » et la nécessité d'une approche plus proportionnée de la vaccination, tournée vers les personnes les plus à risque.
Le niveau de preuve de l'utilité de la mise en oeuvre du passe en population générale est insuffisant. Cette mesure peut produire des dommages collatéraux, comme le pointait l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans une note d'intention en avril 2021 : perte de confiance d'une partie de la population à l'égard des scientifiques et des politiques, risque d'abîmer le contrat social, risque de baisse de confiance dans toute intervention de santé publique, notamment dans les politiques de vaccination autres que contre la covid. L'hésitation vaccinale constitue pour l'OMS l'une des principales menaces pour la santé publique. Selon une étude de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) publiée dans Nature Medicine, le passe semble contribuer à augmenter l'hésitation vaccinale des personnes vaccinées, alors même qu'elles se seraient fait vacciner sans ce dispositif.
Je rappelle que le passe est demandé pour entrer à l'hôpital, dans les centres de protection maternelle et infantile (PMI) ou les plannings familiaux.

On ne demande rien à un patient. En revanche, le passe est demandé aux visiteurs.
Personnellement, il ne m'était pas possible d'entrer ailleurs qu'aux urgences sans passe, et il s'agissait d'un hôpital public de l'AP-HP. En tant que médecin, cette situation m'a profondément choquée.
J'ai prêté serment aujourd'hui, et vous constaterez que je présente des données rigoureuses - je suis prête à répondre à la contradiction que vous pourriez m'apporter sur le fond -, mais j'ai aussi prêté serment auprès de mes pairs lorsque j'ai été admise dans le cercle des médecins. Et aux termes du serment d'Hippocrate, « je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. »

Pourrait-on déterminer des critères épidémiologiques pertinents pour évaluer l'efficacité du passe vaccinal et prendre la décision d'y mettre fin ? Les auditions que nous avons eues jusqu'à présent ne nous ont pas permis de définir des critères solides pour estimer à un certain moment que les conditions sont réunies pour arrêter le passe vaccinal.
Le professeur François Alla a publié une tribune le 24 janvier dernier dans Le Quotidien du Médecin.
Il m'a aidé à préparer cette audition, et je l'en remercie chaleureusement.

Il estime que l'aide à la décision des experts et agences comme Santé publique France s'est transformée en service après-vente des décisions déjà prises. Partagez-vous ce constat ?
Plus généralement, comment voyez-vous le rôle joué par ces agences, notamment en termes de qualité des données récoltées, de mode de présentation de ces données et du niveau de transparence assuré auprès du grand public ?
L'enjeu du passe est, je le répète, non pas l'efficacité vaccinale mais la saturation des hôpitaux. Le passe repose sur un outil, la vaccination, dont les effets sur la diminution de la transmission et de la contamination ne sont pas avérés dans les essais cliniques randomisés. Empiriquement, on peut tous constater que le vaccin et l'immunité naturelle ne bloquent pas la transmission et la contamination : on peut se faire recontaminer et on peut contaminer.
L'objectif était de sanctuariser des lieux, d'inciter à la vaccination et de réduire la saturation des hôpitaux.
S'agissant de la couverture vaccinale des personnes les plus à risque, elle ne dépend pas du passe : des pays qui n'ont pas mis en place de passe ont tout de même atteint 100 % de couverture vaccinale de ce public et d'autres sont parvenus à ce taux avant d'instaurer un passe.
S'agissant de la saturation des hôpitaux, elle ne dépend pas du nombre de patients covid hospitalisés : le vrai problème, c'est la fuite du personnel et les lits qui ne peuvent pas être ouverts du fait de ce manque de personnel.
S'agissant de la sécurisation des lieux, on peut tous expérimenter empiriquement que, vacciné ou pas, il est possible de transmettre le virus ou d'être contaminé dans les endroits en question. Il est très difficile de fixer des indicateurs pour un dispositif dont chacun peut constater la vacuité. Cela ne signifie pas qu'il ne faut rien faire ; au contraire, il faut déployer des actions très fortes de promotion de la vaccination dans le respect du consentement des individus, en orientant celle-ci sur les personnes les plus à risque. Pour cela, nous avons besoin des données sur les comorbidités, distribuées par tranches d'âge, notamment en réanimation, pour cibler les personnes qui se retrouvent en réanimation.
Il m'est donc difficile de vous proposer des critères d'évaluation d'un dispositif qui, de toute façon, repose sur un outil dont l'effet sur la réduction de la transmission et de la contagiosité n'a pas été évalué. Le dispositif est à la base biaisé.
La question du recours à l'expertise scientifique pendant la crise est très importante. Richard Horton, le rédacteur en chef du Lancet, une très grande revue médicale, a publié un éditorial en septembre 2020 dans lequel il déplorait que la « science » qui a guidé les gouvernements depuis le début de l'épidémie n'ait été incarnée que par des modélisateurs d'épidémies et des infectiologues. La pluridisciplinarité n'a pas été prise en compte, notamment dans le Conseil scientifique. Alors qu'il existe des agences indépendantes dont les missions sont régies par le code de la santé publique - je pense à Santé publique France, qui avait géré la crise précédente de la grippe, à la Haute Autorité de santé (HAS) et au Haut Conseil de la santé publique (HCSP) -, c'est une structure créée ad hoc, le Conseil scientifique, qui a émergé. J'ai le plus grand respect pour ses membres, mais cette instance a « shunté » toutes les autres.
Un article très intéressant rédigé par des membres du Haut Conseil de la santé publique publié dans La Santé en action en juin 2021, intitulé « L'expertise sanitaire en temps de crise », pointe que le choix des membres du Conseil scientifique s'est fait par cooptation, ce qui induit un risque de collusion entre experts et de promotion d'une seule orientation. Normalement, l'expertise doit se faire de façon pluridisciplinaire, et le choix des experts retenus doit être beaucoup plus large. Cet article précise qu'il n'y a pas eu de validation externe et indépendante des avis produits par le Conseil scientifique, c'est-à-dire de regard par les pairs et de discussions potentiellement contradictoires. Or du dissensus résulte le consensus. La confrontation de points de vue potentiellement contradictoires doit conduire au point de vue le plus nuancé et le plus efficace.
Non seulement ce débat scientifique contradictoire, qui est habituellement organisé par les institutions, n'a pas eu lieu, mais il n'est même pas accepté. Un avis du Conseil scientifique du 19 janvier 2022 précise, dans sa partie sur l'amélioration de la communication et de l'information que « ni l'impératif de liberté d'expression et de démocratie, ni les principes de controverses scientifiques ne sont facilement compatibles avec la médiatisation d'opinions non documentées formulées par des personnes se prévalant d'une légitimité scientifique auprès du public ». François Alla dénonçait le rôle de service après-vente des agences sanitaires qui ne servaient qu'à enregistrer des décisions déjà prises par l'exécutif. Chacun en pensera ce qu'il voudra.
Deux chercheurs ont fait un travail d'évaluation des modélisations qui ont justifié des mesures draconiennes, non fondées sur les preuves, qui ont eu des dommages collatéraux majeurs. Ils indiquent qu'il n'existe pas d'évaluation rétrospective publique des modélisations utilisées en France, alors que l'évaluation fait normalement partie intégrante des bonnes pratiques de la modélisation mathématique. Le travail d'évaluation des modélisations et des scénarios de l'Institut Pasteur, de l'Inserm et de l'Imperial College qu'ils ont conduit aurait été attendu des institutions. Je rappelle que les modélisations de l'Imperial College ont servi de base aux décisions de confinement de la France et d'une bonne partie du monde.
Ces chercheurs ont pris l'exemple de la Suède, le seul pays qui a pris des mesures mais n'a pas confiné sa population pendant la première vague - car il y a tout un continuum d'interventions entre ne rien faire et confiner une population. D'après les modélisations de l'Imperial College, si ce pays ne prenait aucune mesure durant la première vague, 90 000 décès étaient attendus : la réalité est toute autre, car il y a eu moins de 10 000 décès durant la première vague.
Il est donc important de réaliser toujours une évaluation a posteriori. Sur les onze modélisations qu'ils ont testées, il n'y a eu que deux cas de figure dans lesquels la situation réelle était comprise entre les valeurs des différents scénarios ; dans les neuf autres cas, la réalité se situait en dehors de ces valeurs et, dans huit cas sur neuf, il y avait même une surestimation de la réalité. Un biais en faveur d'une surestimation semble donc présent : les scénarios médians, qui étaient souvent utilisés comme les plus probables, surestimaient la réalité dix fois sur onze.
La modélisation épidémiologique est extrêmement difficile : une bonne anticipation de la réalité est l'exception et l'erreur est la norme. Au regard de la rétrospective qu'ils ont publiée, on peut conclure que les modélisations n'apportent pas un niveau de preuve suffisant pour supporter la mise en place d'interventions de santé publique à fort impact. Le biais en faveur d'une surestimation peut favoriser l'adoption de mesures plus restrictives que nécessaire. Je précise que les modélisations en Suède prévoyaient un nombre de décès cinq à six fois plus élevé que la réalité et que seul un confinement strict permettrait d'empêcher une saturation majeure de l'hôpital, qui n'a pas du tout eu lieu.

Je précise qu'en Suède, il y a 10 millions d'habitants, pour une densité de population de 19 habitants au kilomètre carré.
Ces informations sont prises en compte dans la modélisation de l'Imperial College : M. Neil Ferguson s'appuie sur des données disponibles par pays. Il s'agit de comparer non pas la France et la Suède, mais la Suède à elle-même, et de rapporter les modélisations de l'Imperial College concernant la Suède avec la situation réelle de l'épidémie dans ce pays, où la densité de population est bien évidemment moindre qu'en France, dans certaines zones.

Quelle est la position de Santé publique France par rapport aux recommandations du Conseil de défense sanitaire ?
Lors d'une audition, le professeur Delfraissy a dit qu'il fallait mettre en place le passe sanitaire pour « booster » la vaccination. Récemment, dans un média, il a avancé qu'il ne s'agissait pas tout à fait d'un vaccin, mais en quelque sorte d'un traitement. Pouvez-vous nous éclairer : est-ce un simple problème sémantique, ou y a-t-il une incohérence ?
En ce qui concerne le positionnement de Santé publique France, mieux vaut leur demander leur avis. Je ne peux pas m'exprimer en leur nom.
Vous soulignez cependant un point important. Santé publique France a présenté des données de bonne qualité, mais les écarts au protocole que l'on constate dans le dernier bulletin de Santé publique France sont profondément regrettables pour la confiance, ce que je déplore profondément. Avant ces écarts majeurs, qui biaisent la présentation et l'interprétation des données, les données présentées étaient claires, et l'outil Géodes notamment était pertinent. Le suivi épidémiologique des maladies, et non exclusivement de la covid, est une de leurs missions.
Concernant votre deuxième question, Camus disait que mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde. Je ne me permettrais pas d'interpréter ce que M. Delfraissy, pour qui j'ai un grand respect, a voulu dire.
Si l'on attend généralement d'un vaccin qu'il empêche l'infection, réduise la contagiosité et bloque la transmission, ces éléments, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne correspondent pas aux critères principaux retenus dans les essais cliniques randomisés. Cela ne semble être le cas ni de ce vaccin ni de l'immunité naturelle, qui protègent visiblement des formes graves au moyen d'une immunité profonde, mais ne protègent pas de l'infection et de la transmission.
Pour arguer de l'immunité collective et de « l'effet troupeau », on attend d'une couverture vaccinale très forte qu'elle limite, bloque ou interrompe la transmission d'un agent infectieux. Par exemple, pour bloquer la transmission de la rougeole, il faut une couverture vaccinale d'au moins 95 % dans l'ensemble de la population.
Nous en sommes à plus de 80 % de la population française adulte vaccinée. Mais le virus va probablement continuer à circuler et atteindre l'endémicité, si ce n'est pas déjà le cas, notamment du fait de réservoirs animaux très importants. Que le virus devienne endémique ne signifie pas qu'il ne faut plus rien faire : il faut cibler la protection sur les personnes à risque consentantes.
C'est peut-être cette contagiosité du virus malgré la vaccination qui a poussé M. Delfraissy à dire que ce vaccin n'était pas un vaccin au sens classique du terme, mais davantage un traitement. À mon sens, il reste tout de même un vaccin, dans la mesure où il est inoculé à des personnes saines pour préparer la réponse du système immunitaire, et qu'au regard des données observationnelles en vie réelle disponibles aujourd'hui, il réduit le risque de formes graves ou létales dans les populations à risque.

Merci pour ces explications très claires, notamment concernant la place des experts dans cette crise. Ce qui me trouble, c'est que lorsque le Gouvernement instaure le passe vaccinal à la place du passe sanitaire, il ne s'appuie sur aucun bilan. C'est une habitude de ce gouvernement : il élargit l'expérience sans s'appuyer sur des données scientifiques, ce qui sème le doute dans la population, car cela amène des informations contradictoires.
Aujourd'hui, il semble que les écoles sont particulièrement atteintes par la circulation du virus. Des positions contradictoires s'opposent, entre ceux qui disent qu'il faut étendre l'obligation vaccinale aux enfants et ceux qui rejettent un tel élargissement.
Concernant les politiques d'aller vers, je suis très frappée par votre comparaison des taux de vaccination des plus de 80 ans dans différents pays - certains atteignent même le taux de 100 %. Dans nos territoires, de nombreuses personnes nous interpellent : alors qu'elles souhaitent se faire vacciner, elles sont isolées et n'ont pas accès au vaccin, car, par exemple, elles n'ont plus de médecin traitant. Qu'en pensez-vous ?
Ce virus continue à se propager, mais nous ne disposons pas de vraie politique vaccinale mondiale, et les inégalités dans l'accès aux vaccins sont frappantes. Notre groupe demande la levée des brevets, car tant que la population mondiale ne sera pas vaccinée, il nous semble qu'on ne pourra pas protéger la population à l'échelle mondiale. On a déjà vu cela dans le cas d'autres maladies : il a fallu que la majorité de la population mondiale soit vaccinée pour que la poliomyélite disparaisse. Qu'en pensez-vous ?
Je suis attachée à l'evidence-based medecine, à la médecine fondée sur des preuves ; je suis très attachée à ce que les politiques de santé publique soient fondées sur les données « probantes », et à la rigueur méthodologique et scientifique.
Dès lors que les mesures concernent toute la population, y compris des personnes très fragiles comme les enfants, le niveau de preuve doit être extrêmement rigoureux, et la balance bénéfice-risque doit indiscutablement pencher en faveur de l'intervention. Pour la plupart des décisions qui ont été prises, cela n'était pas le cas. Je pense aux confinements, aux fermetures d'écoles, aux passes : toutes ces interventions n'étaient pas fondées sur des preuves. Une étude de l'université Johns Hopkins montre que, dans 53 pays, il n'y a pas de corrélation qui justifie une potentielle efficacité des mesures de confinement.
Concernant la vaccination, actuellement, le niveau de preuve - sur lequel je me fonde, et sur lequel les agences de santé publique doivent normalement se fonder - est suffisant pour proposer la vaccination aux populations bien identifiées qui présentent des risques de formes graves de covid, afin de leur assurer une protection individuelle. Il faut néanmoins une réévaluation régulière, compte tenu de la très grande rapidité de l'évolution virale.
Le niveau de preuve est suffisant pour conclure à l'acquisition d'une protection durable et forte contre les formes sévères de la covid à la suite d'une infection naturelle, quel que soit le statut vaccinal.
Et le niveau de preuve est clairement insuffisant pour arguer d'un bénéfice collectif de la vaccination de masse des individus à faible risque de formes graves de covid, d'autant plus dans le contexte d'un échappement potentiel d'Omicron vis-à-vis du vaccin.
Si l'on dit « les antibiotiques, c'est pas automatique », c'est parce que, d'après l'OMS, l'antibiorésistance constitue avec l'hésitation vaccinale l'une des principales menaces pour la santé publique au XXIe siècle. En matière d'antibiotiques, l'arsenal thérapeutique dont nous disposons est de plus en plus restreint, à la fois du fait d'une absence de recherche clinique sur ces médicaments et en raison de l'augmentation de la résistance de nombreux agents infectieux. Il y a là un péril pour les générations futures.
Pour la vaccination, le risque d'échappement doit être considéré. Je ne dis pas que c'est effectivement le cas, mais il y a un risque d'échappement immunitaire, du fait d'une pression de sélection sur les variants pouvant conduire à un échappement vaccinal. Une publication du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) montre que, pour limiter ce risque et économiser l'efficacité de l'outil vaccinal sur les personnes à risque, il convient d'en avoir, comme avec les antibiotiques, un usage mesuré, proportionné, fondé sur des preuves. Cela implique une vaccination prioritaire des personnes à risque que sont les personnes âgées et les personnes présentant des comorbidités, notamment le surpoids - je regrette que ce dernier facteur ait été retiré des données de Santé publique France - et l'obésité, si elles sont consentantes.
Concernant les écoles, la circulation virale dans les écoles n'est que le reflet de la circulation virale communautaire. Il est important de préciser que les enfants sont l'une des populations les moins à risque de formes graves ou létales de la maladie. Il est même peut-être contre-productif d'essayer à tout prix de les empêcher de se contaminer avec Omicron, alors que cette contamination est peut-être inévitable, d'où l'intérêt d'une vaccination des personnes à risque. On estime que 16 % des Français ont été en contact avec le SARS-CoV-2 depuis le 1er janvier dernier, soit un Français sur six.
Chercher à limiter à tout prix l'infection chez les enfants peut même se révéler contre-productif, puisque le risque de formes graves augmente avec l'âge. Je prends un exemple pour illustrer mon propos, même si les deux maladies n'ont rien à voir : mieux vaut attraper la varicelle enfant, car même si les symptômes sont très impressionnants, le risque de forme grave de varicelle augmente avec l'âge. Des personnes qui n'ont pas contracté la varicelle durant l'enfance ont un risque de pneumopathie varicelleuse accru à l'âge adulte. Il y a d'ailleurs un vaccin, mais ce dernier n'est pas recommandé, car on a constaté une augmentation du nombre de formes graves chez les adultes vaccinés - je précise que je connais ces questions, car j'ai un diplôme de vaccinologie.
Il faut réfléchir globalement sur les rapports entre bénéfice et risque, et faire très attention aux mesures prises concernant les enfants, en prenant en compte le fait que la santé physique et mentale des enfants est complètement dégradée. Il faut également voir que les inégalités sociales en matière de santé ont explosé. Il serait important que Santé publique France mette ces données à disposition ; celles qu'on arrive à recueillir à l'oral montrent que la plupart des enfants décédés avec le SARS-CoV-2 depuis le début de l'année souffraient de lourdes comorbidités et sont morts d'autre chose.
Il faut remettre les choses en perspective, pour que les mesures prises dans les écoles soient elles aussi fondées sur des preuves, au même titre que les protocoles sanitaires que l'on impose aux enfants. L'OMS ne recommande pas de faire des activités physiques avec un masque sur le visage, alors qu'on impose cela aux enfants, à l'encontre du bon sens et des données scientifiques. Le port du masque dans les écoles ne fait l'objet d'aucun rationnel scientifique ; aucun essai clinique de bonne qualité ne prouve un quelconque intérêt du port du masque chez les enfants - et je ne parle pas du port du masque en extérieur.
Vous posiez la question des personnes âgées en zone rurale, vers lesquelles il faudrait effectivement aller pour encourager la vaccination. La plupart des personnes non vaccinées sont hésitantes vis-à-vis de la vaccination ou n'ont pas accès aux soins, qu'il s'agisse de personnes âgées en zones rurales, de migrants ou de personnes en situation de précarité. On peut imaginer que le passe, nécessaire pour accéder à certains lieux de soins - telle est en tous cas mon expérience -, peut aussi représenter une barrière à l'accès aux soins et peut-être même à la vaccination. Il faudrait en tous cas évaluer ce point.
Concernant la vaccination dans le monde, il serait intéressant que, dans un souci d'efficacité de lutte contre cette pandémie, la plupart des pays vaccinent leur population à risque, plutôt que dans certains pays l'on vaccine des populations qui n'ont pas de risque de développer des formes graves, comme les enfants ou les adolescents, et dont les contingents lors des essais sont extrêmement faibles, ce qui pose par ailleurs un problème méthodologique.
Une seule maladie a été éradiquée par une couverture vaccinale très large : la variole. Dans certains pays où il était très compliqué de vacciner toute la population, notamment en Afrique, une méthode par cerclage avait été privilégiée : n'étaient vaccinées que les personnes qui avaient été en contact avec un cas de variole. Le virus de la variole a ainsi pu être éliminé.
La poliomyélite est une autre maladie en cours d'éradication, même si le virus circule encore, notamment dans les pays qui connaissent une grande instabilité géopolitique, comme la Syrie ou l'Afghanistan.

Je suis très étonnée par votre intervention, qui remet en question beaucoup de choses que nous avons entendues lors de nos auditions. Nous serions partis sur de mauvaises bases.
Alors que le groupe socialiste défendait la vaccination obligatoire, avec l'idée qu'un taux de 95 % de la population vaccinée permettrait d'éradiquer le virus, nous constatons qu'avec Omicron, le vaccin n'a qu'une efficacité limitée au niveau de la contagiosité, et n'est intéressant que contre les formes graves.
Si tous les épidémiologistes que l'on entend à longueur de journée pouvaient arrêter de dire chacun sa vérité, cela nous permettrait de comprendre la situation !
Pour nous, le passage du passe sanitaire au passe vaccinal était une manière peu courageuse d'obliger à la vaccination. Mais pourquoi ne revient-on pas sur la politique de vaccination, en insistant sur la vaccination des personnes à risque de formes graves, plutôt que de continuer sur un discours vaccinal pour la totalité de la population, alors que vous nous dites que cela n'est pas fondé sur des preuves probantes, non seulement en France, mais dans le monde entier ?
Cela me perturbe beaucoup. Vous avez parlé des enfants. Mercredi dernier, nous avons entendu M. Fontanet nous dire qu'il faut vacciner les enfants de 5 à 11 ans. J'entends votre argument d'un potentiel échappement vaccinal similaire à la situation des antibiotiques, mais il disait encore hier soir à la télévision qu'il fallait vacciner les enfants.
Comment reprendre en main la situation, et évaluer de manière indépendante les travaux du Conseil scientifique et les décisions du Conseil de défense sanitaire, qui nous a imposé le confinement en 2020 ?
Comment remettre en piste la Haute Autorité de santé et Santé publique France, pour que ces institutions coordonnent leurs travaux, s'appuient sur des preuves, et que l'on fasse éventuellement un mea culpa ? Nous constatons le manque d'aller vers, le faible taux de vaccination des plus de 80 ans. Mais comment repenser la politique menée ?
Je vous crois lorsque vous nous dites que les modélisations se trompent presque toujours. Mais cela remet en question tout ce qu'on nous dit depuis deux ans. Mercredi dernier, nous auditionnions encore des membres de l'Institut Pasteur et de l'Inserm qui défendaient l'intérêt de ces modélisations.
Je comprends la difficulté que vous éprouvez. Il serait d'ailleurs intéressant de demander à ces instituts d'évaluer leurs modélisations.
Pour parler de preuve scientifique en médecine, selon le rapport « Niveaux de preuve et gradation des recommandations de bonnes pratiques » de la HAS de 2013, il faut des essais randomisés de forte puissance, des méta-analyses d'essais comparatifs randomisés, ou des analyses de décisions fondées sur des études très bien menées. Il n'est jamais question de modélisations, qui sont beaucoup trop sujettes aux biais. Les pourcentages contenus dans le modèle de M. Cauchemez pour justifier la mise en oeuvre du passe vaccinal auprès du Conseil scientifique, dont j'ai parlé plus tôt, se fondaient sur des indicateurs non évalués par les laboratoires eux-mêmes et étaient complètement déconnectés de la réalité.
Dans son avis du 23 décembre 2020 sur la stratégie de vaccination contre la covid, la HAS recommandait initialement de vacciner uniquement les personnes à risque de formes graves, pour lesquelles la balance bénéfice-risque individuelle est clairement établie. Il était question d'une vaccination non obligatoire ciblée sur les personnes à risque, exactement comme on le fait concernant la grippe.
Nous parlons de pandémie, mais Richard Horton, le rédacteur en chef du Lancet, propose de parler de syndémie, c'est-à-dire une interaction entre un agent infectieux et des vulnérabilités, dont notamment l'âge, les comorbidités, ou d'autres facteurs de risque comme le gradient social, la pauvreté et la précarité, qui affectent la dimension sociale de la santé de manière majeure. Quand les politiques publiques augmentent la pauvreté, par définition, la santé des populations est dégradée. La question avait initialement été tranchée de manière cohérente : il s'agissait de vacciner les personnes les plus à risque, puisque le risque n'est pas le même selon l'âge et l'état de santé initial. Plus qu'une pandémie infectieuse, nous avons affaire à une syndémie multifactorielle.
Vous avez parlé d'« éradication » du virus, ce qui évoque la stratégie du zéro covid, portée en particulier en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Dans un article d'immunologie paru dans la revue Science de 2021, 90 % des immunologistes interrogés considèrent que le SARS-CoV-2 a une potentialité endémique majeure, du fait de réservoirs animaux de virus, tant chez des animaux domestiques que dans la faune sauvage, comme c'est d'ailleurs le cas concernant la plupart des pathologies émergentes.
L'éradication devient très compliquée du fait de la circulation du virus chez les non-humains ; il s'agit d'une zoonose, lors de laquelle un agent infectieux commun peut se transmettre de l'homme à l'animal, et inversement. Certains agents infectieux, comme la variole ou la poliomyélite, sont de bons candidats à l'éradication, car ils ne disposent pas de réservoirs animaux, et, car dans leurs cas les vaccins empêchent la circulation et la transmission. Ce n'est pas le cas du vaccin contre le SARS-CoV-2.
Le virus présente de très nombreux variants, et potentiellement, malheureusement, un échappement vaccinal - nous verrons ce point lorsque nous disposerons des données en vie réelle. Ces éléments font que le SARS-CoV-2 n'est pas un bon candidat à l'éradication. Tous les pays qui ont mis en place des politiques zéro covid draconiennes en sont globalement revenus, et ont acté l'échec de cette stratégie non fondée sur des preuves. Le fait d'enfermer des gens chez eux dans le cadre de mesures de confinement peut même s'avérer contre-productif, dans la mesure où ce virus se transmet notamment lors de contacts prolongés et rapprochés comme ceux qui ont lieu lors des repas familiaux, alors que la meilleure protection est la vaccination des personnes à risque, mais aussi la ventilation.
Je ne parle pas de la dégradation de l'état de santé consécutive à ces mesures, de l'augmentation de la sédentarité et du poids, qui est un facteur de risque majeur, de l'explosion des violences familiales, notamment des violences faites aux enfants. Des publications montrent une augmentation du nombre de bébés secoués lors des confinements. Des pédiatres disent dans des articles scientifiques que le domicile est plus à risque que la covid pour les enfants, du fait des accidents domestiques, des violences physiques, sexuelles, psychologiques.
Vous parliez d'obligation vaccinale, mais il faut bien voir que la médecine a normalement vocation à être suggestive et non pas normative. Le respect du consentement des individus est un des éléments majeurs de la médecine moderne et du droit de protection des patients, que l'on trouve dans la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé de 2002, dite loi Kouchner. L'article 36 du code de déontologie médicale dispose que tout patient, après une information loyale, doit pouvoir donner son consentement libre et éclairé sur ce qu'il estime être sa balance bénéfice-risque individuelle.
Je pense que l'obligation vaccinale est dangereuse en matière tant d'adhésion à la vaccination que de santé publique. On retrouve une hésitation vaccinale après la mise en place du passe vaccinal, y compris chez des personnes déjà vaccinées. On risque d'abîmer la confiance entre le médecin et le malade, sans même parler de la confiance entre la population générale et les scientifiques ou de celle entre les citoyens et les politiques.
Nous nous inscrivons dans l'« ère des pandémies », selon la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES). L'OMS alerte l'opinion sur le risque représenté par les agents infectieux. Il est plus qu'important d'adopter de manière rapide, à court, moyen et long terme, des politiques de santé publique qui aient du sens et qui n'abîment pas la confiance des populations.
Le SARS-CoV-2 n'est qu'un avant-goût d'autres pandémies. La liste Blueprint de l'OMS, diffusée depuis 2018 et contenant toutes les maladies à potentiel pandémique majeur, parle à côté de la covid, d'Ebola, de Marburg, d'une « maladie X », qui n'a pas encore émergé, mais qui aurait un profil pandémique majeur et qui présenterait un risque pour la santé des populations.
Il est important d'adopter une approche rationnelle et pragmatique dans la lutte contre les pandémies, à court, moyen et long termes, et cela ne peut se faire qu'en se fondant sur des preuves scientifiques et sur la confiance de la population.

Merci pour votre parole libre. Dans cette crise comme dans d'autres, la parole libre d'experts est essentielle.
Est-ce pour autant simple de porter une parole libre dans le cadre de cette crise sanitaire ? Si ce n'est pas le cas, aurions-nous pu faire quelque chose afin que les parlementaires et les citoyens soient mieux éclairés ?
Cette question est importante. Pour cette raison, j'ai précisé m'exprimer à titre personnel, sans conflits d'intérêts. M. François Alla a démissionné du Haut Conseil de la santé publique. Je cite ses propos, tenus dans un entretien dans Le Quotidien du Médecin : « On assiste aujourd'hui à un processus de décrédibilisation de toute voix discordante. C'est devenu très dur pour un expert de dire qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec les politiques. Les gens sont tétanisés, ils ont peur de passer pour des antivax ou des complotistes. » Effectivement, il est difficile de tenir une parole libre sur ce sujet.
Ce que l'on aurait pu faire collectivement, c'est mobiliser le dispositif d'agences sanitaires supposées indépendantes qui existent déjà, et permettre la tenue d'un débat contradictoire scientifique - je vous remercie d'ailleurs d'offrir à cette parole de santé publique nuancée, pragmatique et fondée sur des preuves d'avoir pu être portée dans un cadre institutionnel au moins une fois. Ce débat contradictoire est nécessaire, car la communauté scientifique médicale de santé publique est extrêmement fragmentée sur la gestion de la crise. Je ne suis pas la seule experte de santé publique ou épidémiologiste professionnelle à porter cette voix. L'impression a été donnée qu'il n'y avait qu'une seule voix scientifique, homogène et consensuelle, face à la gestion de cette crise, et qu'on ne pouvait emprunter qu'une seule voie pour lutter contre la pandémie, alors que ce n'était pas le cas.
Les solutions providentielles qui nous ont été présentées, comme le confinement, les fermetures d'écoles ou le vaccin, n'avaient rien de providentiel. Il n'y a pas de sauveur providentiel, si ce n'est nous-mêmes. Nous devons nous reconnecter avec les principes fondamentaux de la médecine et de la santé publique que sont l'appui sur des preuves et le consentement des individus.
Il est important de ne pas gâcher les ressources. Si le vaccin est une ressource précieuse, au même titre que les antibiotiques, il ne faut pas non plus gâcher les ressources économiques : d'après le rapport de la Cour des comptes du 9 septembre 2021, qui porte sur « les dépenses publiques pendant la crise et le bilan opérationnel de leur utilisation », la somme des dépenses de la crise s'élève à 49,6 milliards d'euros. Le testing à l'aveugle en population générale représente 1,6 milliard d'euros pour le seul mois de janvier dernier.
Il me semble que la santé publique est un sujet sérieux et doit reposer sur des données probantes. La gestion des fonds publics est un sujet sérieux. Quand on voit que 1,6 milliard d'euros sont dépensés par mois pour des tests dont la plupart n'ont pas lieu d'être, je trouve cela douloureux, notamment au regard d'autres secteurs sinistrés, comme la pédopsychiatrie. On parle beaucoup de la saturation des services de réanimation, mais il y a des enfants dont la santé mentale est complètement ravagée du fait de cette gestion de crise, et qui sont renvoyés chez eux alors qu'ils présentent un risque suicidaire majeur. Dans les centres médicopsychologiques, il y a en moyenne entre 18 et 24 mois d'attente pour obtenir un rendez-vous.
Il faut regarder ce que, dans le secteur médico-économique, on appelle l'efficience. Le coût de l'action doit être favorable par rapport à son efficacité ; l'action, au regard de son prix, doit être bénéfique pour la santé. La dépense publique représentée par les tests est autant d'argent non investi de manière durable et plus efficiente. Il en va de même pour la vaccination, même si cette dernière a un sens pour certains publics. Le contrôle des passes coûte énormément d'argent : par exemple, ce sont environ 60 millions d'euros qui sont rajoutés dans le budget des hôpitaux.
On m'a toujours appris que lorsqu'on prend une décision de santé publique, il faut tenir compte de l'efficacité des mesures à partir de données probantes, mais aussi de l'efficience, qui permet de déterminer la légitimité d'une mesure au regard de son coût pour la solidarité nationale.
Les interrogations éthiques et démocratiques doivent aussi être prises en compte. Quand bien même un passe sanitaire ou vaccinal serait efficace, ce qui, en l'état actuel des connaissances, n'est pas le cas, devrait-il être mis en place au regard de ses implications éthiques et démocratiques ?
Il est très important d'avoir une approche globale, sanitaire, médico-économique, démocratique, éthique, déontologique, et de mettre tout cela dans la balance, ce qui, à mon sens, n'a pas du tout été fait.

Je vous remercie d'avoir signalé les problèmes rencontrés par les services de pédopsychiatrie, et d'autres carences concernant le développement des enfants.
J'entends cependant difficilement que la vaccination n'est pas efficace. Tant sur le plan empirique qu'au regard des constats des experts, on peut remarquer une moindre contagiosité des personnes vaccinées et une efficacité de la vaccination, comme l'atteste notamment la diminution importante du nombre de décès en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), qui ont pratiquement disparu lors de la dernière vague.
Nous avons donc eu raison de convaincre ces personnes d'effectuer leur troisième dose, de vacciner les soignants.
Je suis d'accord avec vous : la vaccination des personnes âgées, notamment dans les Ehpad, est fondamentale.
Mais il faut bien voir que malgré les mesures prises « au nom de nos aînés », de nombreuses personnes sont décédées dans les Ehpad non pas tant de la covid que du fait de l'abandon, de la dépression, du désespoir, de la dénutrition et de la déshydratation - j'ai été personnellement concernée.
Lors du premier confinement, comme leurs proches ne venaient plus, énormément de personnes âgées en Ehpad ont fait un syndrome de glissement, du fait de leur isolement.
Les deux extrêmes de la vie dans nos sociétés, les bébés, les jeunes enfants et les personnes âgées, ont été profondément malmenés. Je ne veux pas jeter la pierre, mais persister dans une erreur n'en fait pas une vérité, et il n'est jamais trop tard pour réajuster les décisions au regard des données probantes. Je suis entièrement d'accord avec vous concernant l'importance de la vaccination dans les Ehpad, car le bénéfice individuel de la vaccination pour les personnes âgées est indiscutable.
Mais, encore une fois, la santé de ces personnes ne se résume pas à la seule covid. La dépression et l'isolement des personnes âgées sont des sujets très importants, et il ne faut pas les négliger.
Dans cette crise, on parle beaucoup de fragilité. Mais la fragilité et la vulnérabilité, ce n'est pas que le grand âge et les comorbidités vis-à-vis de la covid ; cela concerne aussi des enfants avec des parents maltraitants, des personnes qui sont dans la précarité ou qui n'ont pas accès aux soins. Lorsque l'on fait de la santé publique, il faut regarder les choses dans leur globalité, et considérer la santé dans toutes ses dimensions. La covid n'a pas le monopole de la vulnérabilité.
Selon l'OMS, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne se résume pas à l'absence de maladie ou d'infirmités. On ne peut pas réduire la santé aux seuls indicateurs covid, ou à la seule absence de covid.

J'ai deux questions simples.
Vous dites qu'il faut prioriser la vaccination sur les publics à risque. Je comprends la logique s'il faut choisir entre les publics. Je n'ai pas bien compris dans votre raisonnement pourquoi il ne faudrait pas vacciner les personnes sans comorbidité. D'abord, on peut avoir des comorbidités qu'on ne connaît pas ; ensuite, on sait que certaines personnes qui ont été hospitalisées pour des formes graves de covid étaient jeunes, sans comorbidité connue. Si on a assez de vaccins pour tout le monde, je ne vois pas où est le problème.
Vous mettez l'accent sur le fait que la santé est un concept global, qu'il n'y a pas que le covid dans la vie et que les mesures mises en place pour lutter contre le covid peuvent présenter des risques. Pourquoi opposer ces différents objectifs ? On peut très bien avoir, à la fois, une politique de vaccination efficace et une politique de développement des services publics et de lutte contre la pauvreté et la violence.
Il me semble que plusieurs raisons justifient de ne pas vacciner tout le monde.
Il est important de se fonder sur l'evidence-based medecine. Le bénéfice de la vaccination sur les personnes à risque est indiscutable ; on ne peut pas en dire autant pour des publics plus jeunes. Le critère de jugement principal dans les essais chez les enfants et les adolescents était le même que chez les adultes : le vaccin est considéré comme efficace si vous ne développez pas de covid symptomatique, mais on ne prend pas spécifiquement en compte les formes graves ou les décès.
S'agissant des données disponibles, le suivi médian est environ de deux mois et les effectifs sont tout de même très faibles, ce qui ne permet pas d'être sûr de la sécurité du produit que vous allez inoculer à des personnes saines. Je dis non pas qu'il y a un risque, mais que l'on ne sait pas. D'ailleurs, le Comité consultatif national d'éthique, dans son dernier avis sur la vaccination des enfants en suivant l'avis de la HAS, a insisté sur l'incertitude en termes d'innocuité du vaccin covid chez les jeunes, qui ne sont pas à risque de forme grave ou létale de covid-19. En termes de bénéfice individuel, il reste à démontrer que la vaccination de ce public, au regard du recul très faible que nous avons sur ce produit, est favorable. La pharmacovigilance est là pour cela, mais elle prend du temps.
Dans sa note d'avril 2021 sur les caveat de la vaccination obligatoire, l'OMS avait insisté sur l'importance d'avoir davantage de recul sur l'innocuité du produit que vous mettez en place. Je ne veux pas semer le doute : je pense que le bénéfice individuel est favorable chez les personnes à risque, mais pour un public jeune cela reste à mon sens à démontrer.
On a abordé l'aspect médico-économique : j'ai du mal à comprendre, en termes de gestion des fonds publics, pourquoi une intervention coûteuse est proposée, alors qu'une évaluation est en cours. Le site clinicaltrials.gov regroupe tous les essais cliniques en cours : les analyses de données ont lieu jusqu'en 2026 pour la vaccination chez les enfants.
Avec un suivi médian de deux mois et des effectifs trop faibles pour mettre en lumière de potentiels effets indésirables, il me semble prématuré, vu les données dont on dispose actuellement, de proposer la vaccination aux enfants et aux adolescents.

Vous partez sur un constat différent, celui d'un vaccin-médicament réservé aux personnes malades ou destiné à éviter les formes graves chez les fragiles, parce qu'il n'a pas d'effet sur la transmission. Or on nous a cité des chiffres, fondés sur des études : on nous a dit que le vaccin était efficace à plus de 90 %, quand on a toutes les doses, sur les formes graves et « seulement » à 40 % sur les transmissions.
Contestez-vous ces études ? Si j'ai bien compris votre raisonnement, vous dites que le vaccin n'agit pas sur la transmission, c'est la raison pour laquelle, en toute logique, il faut le cibler sur les personnes à risque puisqu'il a un impact sur la gravité de la maladie.
Vous craignez l'échappement vaccinal si on vaccine largement la population. Des études ont-elles porté sur ce point ?
S'il n'est pas souhaitable de vacciner tout le monde, c'est justement aussi pour la pression de sélection sur les variants, ce qui conduit à un gaspillage de la ressource en termes d'efficacité sur les personnes à risque.
Un éditorial du New England Journal of Medicine rappelait qu'il n'y avait pas de mesure de l'efficacité sur la contagiosité dans les essais cliniques randomisés, qui sont des essais à fort niveau de preuve. Toutes les études ne se valent pas : il y a une gradation dans le niveau scientifique. Des études rétrospectives, avec des cas témoins, reposant sur des données déclaratives ne constituent pas un fort niveau de preuve. La mise en place d'une intervention aussi massive et coûteuse doit reposer sur des essais à fort niveau de preuve, comme les essais cliniques randomisés. L'effet du vaccin sur la contagiosité ne fait pas partie des critères : c'est écrit noir sur blanc dans les reports d'essais cliniques des firmes.
On peut toujours trouver des études pour justifier ce que l'on a envie de montrer. Je m'appuie sur les données des industriels qui sont ceux qui commercialisent le produit. Je le redis, le critère de jugement principal est l'infection symptomatique validée par PCR positive.
Sur l'évolution virale, les coronavirus mutent et se recombinent, notamment avec des virus proches, dans de vastes réservoirs animaux qu'il faut surveiller étroitement, d'où l'intérêt de collaborer avec des vétérinaires. C'est ce que l'OMS appelle le one health, une seule santé : santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes sont intimement liées. Il se crée en permanence des variants et des sous-variants : c'est pour cela qu'il est illusoire de vouloir bloquer complètement le processus, notamment par le biais de la vaccination. Il faut donc se demander comment éviter de favoriser par nos interventions les souches potentiellement problématiques au sein de ce vaste répertoire de mutants et de variants. Je faisais le parallèle avec les antibiotiques. Si la vaccination covid s'étend à de larges populations qui n'en ont pas forcément besoin, elle risque d'induire un phénomène bien connu, une pression de sélection.
L'émergence de souches dominantes résistantes au vaccin sous différentes conditions a été récemment simulée par des chercheurs français du CNRS : dans une publication du début de l'année, il est montré que la stratégie optimale pour minimiser les dommages globaux de la pandémie consiste à focaliser la vaccination sur les personnes à haut risque de covid-19 grave afin de les protéger individuellement et efficacement, tout en évitant de sélectionner et de faire circuler des souches résistantes à partir de vastes populations de personnes à faible risque. Une accumulation de données observationnelles montrant le développement et la circulation préférentielle de variants et de sous-variants résistants dans de vastes populations vaccinées peuvent expliquer des explosions d'incidence de variants en échappement immunitaire, même dans des régions à forte couverture vaccinale. D'où l'intérêt, en d'autres termes, de cibler, d'économiser la ressource pour limiter l'échappement vaccinal.
Il faut aussi remettre les vaccins à jour, comme on le fait pour la grippe chaque année, pour anticiper les variants qui vont circuler.

Vous battez en brèche, avec beaucoup de certitude, les modélisateurs et les mesures de confinement prises en fonction de ces modélisations. Je ne suis pas scientifique, et je dois donc m'appuyer sur des gens en qui je crois pouvoir avoir confiance.
Contrairement à ce que vous avancez, M. Delfraissy a récemment indiqué que le vaccin permet de limiter la contagiosité du virus. Quelle est alors selon vous la gradation de la vérité ? Est-ce que M. Delfraissy ment, alors que vous dites la vérité ? Face à deux paroles aussi différentes, nous devons faire un choix entre deux positions qui l'une et l'autre disent s'appuyer sur des études.
Vous vous êtes appuyée sur le fait que l'OMS déconseille le port du masque lors de la pratique sportive. Mais l'OMS a également dit, au début de cette pandémie, que le masque ne servait à rien. Là encore, cela nous pose problème.
Vous indiquez qu'il reste à prouver que les confinements aient été utiles. Mais au regard du confinement décidé en catastrophe en Angleterre, il me semble que, à cette époque, nous n'avions pas vraiment le choix. Avec les connaissances dont nous disposions à l'époque, qu'auriez-vous fait ?
Concernant la contagiosité, il me semble que le professeur Delfraissy a lui-même admis que le but du passe sanitaire était non pas de réduire les contaminations, mais bien d'augmenter le nombre de primo-vaccinations, ce qui a eu lieu, mais pas dans le public cible des personnes à risque. On peut donc s'interroger sur l'efficacité de la mesure.
Je ne cherche pas à démontrer une conjecture, mais je m'appuie sur les données disponibles, notamment par le biais des études à fort niveau de preuve menées par Pfizer, où la contagiosité ne fait pas partie des critères de jugement. On ne peut donc pas statuer sur cette question, même si chacun peut constater de manière empirique que, vacciné ou non, on peut contracter cet agent infectieux. Il me semble que M. Delfraissy était revenu sur ce point.
Je précise que la charge de la preuve doit normalement incomber à la puissance qui met en place la politique publique, et que ce n'est pas à moi d'en démontrer la potentielle inefficacité. Si l'on veut faire les choses dans les règles de l'art, même si l'incertitude fait partie de la pratique, il faut disposer d'un fort niveau de preuve avant de mettre en place des interventions. Il ne faut pas inverser les rôles.
Concernant le port du masque, j'attends un essai à fort niveau de preuve qui démontre son efficacité, en particulier chez les enfants. Je ne dis pas que le masque ne sert à rien, et je ne veux pas tomber dans un manichéisme stérile : le port du masque a beaucoup d'intérêt dans certaines conditions, si l'on est malade par exemple.
À mon avis, si le port du masque était initialement déconseillé en population générale par l'OMS, c'est simplement en raison du risque de mésusage : ce n'est pas parce que l'on conseille de porter un masque que le masque sera bien porté - et je ne parle même pas des enfants. Pour être efficace, ce dispositif médical doit être porté de manière précise : le masque doit être changé régulièrement, ne doit pas être touché, et il faut une certaine rigueur. D'ailleurs, la Société française d'hygiène hospitalière ne recommande pas le port du masque FFP2 en population générale.
Je comprends votre difficulté à naviguer dans tout cela, ce qui est tout à fait regrettable. Le débat contradictoire, qui s'observe normalement dans les agences de santé publique, qui permet au dissensus de s'exprimer et au consensus d'émerger, n'a pas vraiment eu lieu dans les institutions. Il émerge maintenant, provoquant une certaine incompréhension.
Vous me demandez ce que j'aurais fait en l'état des connaissances dont nous disposions au début de l'année 2020. Les données chinoises permettaient déjà d'identifier les personnes à risque de formes graves, et, personnellement, j'aurais préféré que les mesures de protection soient davantage ciblées sur ces personnes, dans le respect de leur consentement.
Que se serait-il passé si nous n'avions pas eu de vaccin ? Que se passera-t-il quand un nouveau variant échappera au vaccin, ou lors de l'émergence d'une nouvelle maladie ? Il faut s'interroger sur ces questions pour anticiper et ne pas se retrouver pris au dépourvu. Une des conclusions du rapport de l'IPBES Échapper à l'« ère des pandémies » est qu'il faut insister sur la prévention et ne pas uniquement être dans la réaction.
J'aurais donc ciblé la protection sur les personnes à risque consentantes, en leur proposant dans un premier temps d'adopter des mesures de protection comme le port du masque FFP2 pour elles et le port du masque pour les personnes à leur contact, éventuellement, dans le respect de leur consentement, un autoconfinement volontaire et une mise à disposition de services pour leur permettre de limiter les interactions sociales. J'aurais ciblé les mesures sur ce public-là, et réduit la pression exercée sur l'ensemble de la population, selon le concept important en santé publique de l'universalisme proportionné, qui précise que des mesures proportionnées doivent être prises selon la vulnérabilité des personnes.
Cet alliage aurait permis une approche moins coûteuse sur tous les plans, sanitaire, social, économique, pédagogique, en matière d'inégalité, de démocratie, de confiance, et de rigueur scientifique.
La Suède a quand même moins d'impact négatif, et les pays qui ont adopté une politique zéro covid en reviennent, car elle n'est pas tenable.
L'OMS parle de fatigue pandémique. Il est important que la lutte contre un agent infectieux et l'adhésion des populations s'inscrivent dans la durée. Au-delà de l'efficacité des mesures, qui reste encore à prouver, il y a un risque de décrochage et de contre-productivité. L'adoption de mesures proportionnées en fonction des risques des individus, de leur vulnérabilité et de leurs capacités, dans le respect du consentement, me semble être la base en médecine et en santé publique.

Je vous remercie. Vous avez insisté sur le caractère documenté et pragmatique de votre intervention, mais il se trouve que les intervenants qui ne pensent pas comme vous nous disent la même chose. La situation est compliquée pour nous !
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
Mes chers collègues, la parution de l'enquête journalistique Les fossoyeurs de M. Victor Castanet a donné lieu à ce que d'aucuns appellent désormais l'affaire Orpea. L'ampleur des dysfonctionnements mis au jour appelle effectivement une remise en ordre. Ont été annoncées plusieurs catégories de travaux, de la part du Gouvernement - il aurait pu le faire bien avant -, qui a diligenté des enquêtes de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l'Inspection générale des finances (IGF), et de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale qui a notamment entendu le PDG du groupe.
Le souhait de la présidente de notre commission est, d'une part, de ne pas doublonner les travaux en cours et, d'autre part, de travailler sur un sujet susceptible, le cas échéant, d'avoir un débouché législatif. Notre commission pourrait ainsi s'intéresser au « contrôle du contrôle », en conduisant des travaux sur le cadre juridique des contrôles opérés dans les Ehpad mais aussi sur les moyens qui leur sont alloués, leur fréquence, leur qualité, leurs résultats et les suites qui leur sont données. Elle pourrait aussi constituer l'aiguillon nécessaire au maintien du calendrier ambitieux engagé par le Gouvernement.
À cette fin, nous pourrions constituer, au sein de notre commission, une mission d'information sur le contrôle des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). L'idée est celle d'une mission « agile », qui procède à quelques auditions plénières mais surtout à un travail sur pièces auprès des différents acteurs du contrôle.
À l'issue de cette réunion de commission, notre présidente saisira le Président du Sénat afin que cette mission d'information puisse être dotée des prérogatives d'une commission d'enquête si vous êtes d'accord sur cette démarche. Le calendrier s'est un peu précipité, car cet après-midi a lieu la dernière Conférence des présidents avant la suspension des travaux parlementaires. C'est pourquoi Catherine Deroche a informé l'ensemble des membres du bureau de la commission par un courrier vendredi dernier.
La Conférence des présidents pourrait prévoir que le Sénat se prononce le jeudi 17 février si la commission des lois confirme la recevabilité du sujet, qu'elle devrait examiner au cours de sa réunion du 16 février prochain.
Il n'y a pas d'observations ?

La commission d'enquête sur les hôpitaux est encore en cours, comme de nombreux autres travaux. La mission d'information pourrait-elle se transformer en commission d'enquête ?

La commission d'enquête sur les hôpitaux doit rendre son rapport en mars prochain.
Quel serait le calendrier de la mission d'information sur le contrôle des Ehpad ?

Je ne sais pas. La mission d'information ne comprendra pas d'autres membres que ceux de la commission des affaires sociales. Nous demanderons simplement qu'elle ait les pouvoirs d'une commission d'enquête, notamment de demander aux personnes entendues de prêter serment.

Pourquoi ne pas avoir demandé directement la création d'une commission d'enquête ?
Peut-on considérer qu'il s'agit d'une mission interne à notre commission ?

C'est la même chose que la mission d'information sur l'adéquation du passe vaccinal à l'évolution de l'épidémie de covid-19, dont l'une des auditions vient de se terminer.

L'ensemble des membres de la commission pourra-t-il participer aux auditions ?
Le rapporteur pourra-t-il faire venir les différents acteurs contrôlant les Ehpad ?

Tous les membres de la commission des affaires sociales pourront participer.
Le rapporteur agira comme bon lui semble.

La majorité sénatoriale n'en a proposé qu'un, mais il peut y en avoir deux !
Je sais que votre groupe s'est interrogé sur la possibilité de désigner un rapporteur. Je n'y suis pas opposé, pas plus que la présidente. Nous allons proposer, pour notre part, Bernard Bonne.

Le sujet est très intéressant. Peut-on l'élargir aux maisons départementales des personnes handicapées ?

Cet élargissement ne semble pas possible pour l'instant. Nous pourrons peut-être l'envisager en juillet prochain, en même temps que nous verrons si nous pouvons mener des missions d'information sur d'autres sujets, avec un autre gouvernement et d'autres parlementaires.

Le temps nous est compté : on ne peut pas élargir le périmètre d'enquête de la commission et travailler dans de bonnes conditions. La nomination de Bernard Bonne en tant que rapporteur nous semble être une bonne idée.
Je souligne toutefois un problème concernant le fonctionnement de cette commission, qui est très ouverte : les rapporteurs sont toujours issus des groupes Les Républicains (LR) ou Socialiste, Écologiste et républicain (SER), alors que ce ne sont pas les seuls groupes politiques représentés dans la commission.

J'entends bien votre remarque. M. Bonne n'est pas un rapporteur du groupe LR, mais un rapporteur de la majorité sénatoriale. Si l'opposition sénatoriale veut bien s'entendre sur le nom d'un rapporteur, cela ne me dérange pas. (Sourires)

Je voulais savoir pourquoi cette mission d'enquête était aussi ciblée sur le contrôle du contrôle. Certes, le livre Les fossoyeurs révèle un problème lié au contrôle des établissements, mais ce n'est pas le seul problème. Il y a aussi toute une philosophie autour de cette financiarisation du grand âge. Le temps nous est compté, mais doit-on vraiment s'en arrêter là ?

Oui, nous le devons, pour une raison toute simple : l'IGAS s'est vu confier une mission par le Gouvernement ; l'Assemblée nationale a mis en place des auditions sur le sujet.
Si nous allions sur les mêmes terrains que l'Assemblée nationale et que l'IGAS, nous ne serions pas audibles. Nous voulons trouver un créneau pour permettre à nos travaux d'être écoutés. Nos collègues de l'Assemblée nationale et les membres de l'IGAS étendront leurs enquêtes à d'autres sujets tout aussi importants.

Pour répondre à Mme Guidez, je pense que nous devons nous en tenir à la question des personnes âgées. Ce sont non pas les seuls Ehpad qui sont concernés, mais l'ensemble des lieux d'accueil des personnes âgées, y compris les résidences autonomie. Tous les lieux devront être étudiés, pour que l'on voie quels sont les contrôles adaptés à chaque type de structure.
Il est évident qu'en regardant la manière dont les contrôles sont effectués et peuvent être améliorés, nous irons bien plus loin que le simple contrôle : il faudra voir ce que l'on contrôle, les raisons pour lesquelles on contrôle, et quelles améliorations nous pouvons proposer pour la prise en charge des personnes âgées.
De nombreux rapports ont déjà été réalisés, et il ne faudra pas répéter à l'infini ce qui a déjà été dit. Le rapport Libault contient de nombreuses propositions. Le rapport d'information que Mme Meunier et moi-même avons signé a aussi apporté de nombreux éléments.

Je conclus de ces échanges que nous sommes d'accord pour demander l'octroi des prérogatives d'une commission d'enquête à cette mission d'information.
La commission demande au Sénat de lui octroyer les prérogatives d'une commission d'enquête, en application de l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et de l'article 22 ter du Règlement du Sénat.

La majorité propose la candidature de Bernard Bonne. Quelle est la candidature de l'opposition sénatoriale ?

Comme c'est l'usage au sein de notre commission, tous les membres de la commission des affaires sociales seront évidemment invités à assister aux auditions menées par la mission d'information, qui travaillera en toute transparence.
Mme Michelle Meunier et M. Bernard Bonne sont désignés rapporteurs de la mission d'information sur le contrôle des Ehpad.
La réunion est close à 17 h 30.