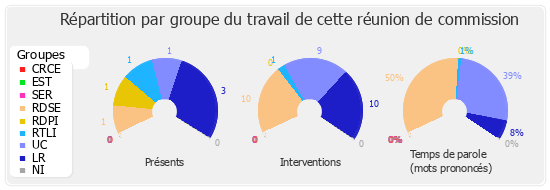Mission commune d'information sur le système scolaire
Réunion du 7 juin 2011 : 1ère réunion
Sommaire
- Audition de m. yves careil maître de conférences à l'iufm de bretagne (voir le dossier)
- Audition de m. jean-yves rochex professeur à l'université paris viii (voir le dossier)
- Audition de m. hervé masurel secrétaire général et de mme isabelle defrance responsable du département éducation santé et développement social desds du comité interministériel des villes (voir le dossier)
La réunion
La commission entend M. Yves Careil, maître de conférences à l'IUFM de Bretagne, membre du Centre de recherche sur l'éducation, les apprentissages et la didactique (CREAD), Université de Rennes I.

J'assume aujourd'hui la présidence en l'absence de M. Lagauche, pour les dernières auditions de notre mission d'information. Je propose à M. Careil de s'exprimer librement sur ses travaux de recherche, avant de passer aux questions.
Je vous remercie de votre invitation. Enseignant, devenu sociologue sur le tard, je suis à tel point attaché à mon indépendance à l'égard de tous les pouvoirs, politiques comme économiques, que je n'hésite pas à autofinancer mes recherches. Il peut donc arriver que mes propos déplaisent. C'est ainsi. J'ai eu, en vingt-deux ans, l'occasion de travailler auprès d'une grande diversité d'élèves, de la maternelle au lycée professionnel. J'ai enseigné aussi bien dans des coins de campagne isolés que dans des centres-villes, mais le plus souvent, aussi, dans des quartiers de relégation, en ZEP, sur des postes réputés difficiles. Je suis maître de conférences en sociologie depuis douze ans, à l'IUFM de Bretagne, où je participe à la formation initiale et continue des étudiants et enseignants, en même temps que je pilote une formation sur les quartiers sensibles à l'intention des futurs professeurs de lycée et collège, dont l'essentiel se trouve par la suite affecté dans les académies de Créteil et Versailles - plutôt, vous l'aurez compris, du côté du Val-Fourré et des Mureaux. Hélas, cette formation, plébiscitée par les stagiaires, et dont la reconduction avait reçu l'aval du rectorat, est condamnée à disparaître : manque de crédits, m'objecte-t-on !
Je mène, parallèlement, des travaux de recherche sur le long terme dans de nombreux domaines : sur les « réussites paradoxales » - celles de ces élèves issus de milieux modestes parvenus au plus haut niveau malgré le peu de chances que leur laissait la statistique, mais aussi sur la laïcité à l'épreuve de la montée en puissance des revendications identitaires, ou encore sur la difficulté croissante des élèves à se construire en même temps comme élèves et comme adolescents, traduction des tensions qui se nouent autour de l'instruction, de la socialisation et de la qualification lorsque l'on passe, comme c'est aujourd'hui le cas en France, d'un modèle éducatif républicain à un autre, d'inspiration néolibérale.
Les thèmes de ma recherche, qui forment un tout, portent sur la mutation de l'école primaire, sur les effets de la montée en puissance de la logique civile au détriment de la logique civique, sur la genèse du rapport au savoir au regard des effets ségrégatifs que produisent les nouvelles formes de la domination en matière scolaire, avec le développement des relations de concurrence entre établissements.
Sur la mutation de l'école primaire, je travaille depuis trente ans, m'intéressant de très près aux ambigüités du mouvement de rénovation pédagogique et, plus généralement, aux effets produits par l'évolution de la structure de recrutement des instituteurs sur les pratiques en classe, le rapport des enseignants aux parents mais aussi à leurs propres enfants. Tout ceci m'a amené à réfléchir, dès le milieu des années 1990, aux mécanismes qui sous-tendent la transformation progressive de l'école publique laïque en école néolibérale, au profit de « parents d'élèves professionnels », les mieux dotés en capital tant monétaire que culturel ou social, qui leur confère un sens aigu du « placement » scolaire, et les pousse à tirer profit de ce « marché noir » de l'école en contribuant le plus efficacement à la réussite scolaire de leur descendance.
J'admets que cette « contribution » ne fait pas tout. C'est l'élève qui apprend ; il n'est pas un pur réceptacle social, il réagit à son milieu, y compris son milieu d'origine, avec lequel il entretient un « débat » comme disait Canguilhem. D'où mon enquête de huit ans, qui a donné lieu à la publication, en 2007, d'un livre sur L'expérience des collégiens, relative à la genèse du rapport au savoir au regard de ces nouvelles formes de ségrégation, marquées par le développement de la concurrence scolaire. J'avoue que la lecture des Héritiers et de La reproduction m'a toujours laissé sur ma faim : Bourdieu et Passeron fondent leurs analyses sur les effets des pratiques en matière de transmission du capital culturel, mais ne disent rien de ces pratiques elles-mêmes. C'est à ces pratiques, qui sont au fondement de la réussite sociale, et de son envers, que je m'intéresse. Mais non pas par les méthodes quantitatives, qui, si je les pratique néanmoins et les enseigne, me laissent dubitatif. D'où ma méfiance à l'égard de l'enquête PISA de l'OCDE et, plus généralement, de l'approche économétrique aujourd'hui dominante en sociologie de l'éducation. Loin de moi le fétichisme des chiffres. Trois chiffres après la virgule ne mettent personne dans la vérité, et la corrélation statistique n'est pas sans multiples biais : on croit tenir une variable, et c'est une autre qui joue en sourdine. Il y faut une vigilance épistémologique aiguë. PISA peut fournir des informations intéressantes, mais c'est aussi un des leviers de l'acculturation utilitariste.
Je me suis donc attaché, dans ma recherche sur la genèse du rapport au savoir, à l'approche de terrain. Il s'agissait d'observer comment les collégiens de deux collèges très contrastés de Nantes - collège d'élite de centre-ville pour l'un, recrutement mixte entre quartier de relégation et zone pavillonnaire pour l'autre - construisaient leur rapport au savoir, à l'apprentissage, aux autres, à eux-mêmes, à leur avenir. Je me garderai de généraliser mes conclusions : la fragmentation qui marque désormais le système rend difficile toute approche autre que très sectorisée - d'où les limites de l'enquête PISA.
Compte, tout d'abord, le contexte géopolitique. L'agglomération nantaise ne porte pas, comme celle de Paris, l'empreinte de ses banlieues rouges. Elle se situe dans l'Ouest de la France, marqué par une tout autre histoire que l'Est ou le Sud. L'Ouest est une terre d'établissements publics soumis de longue date, depuis la loi Debré de 1959, à la concurrence déloyale du privé et qui n'a pas eu d'autre choix que de s'adapter. Le puissant courant de l'éducation populaire s'est progressivement soldé, au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, en un séparatisme social, déterminant dans les villes. Nantes ne fait pas exception. La ségrégation spatiale recouvre une ségrégation sociale, selon le modèle classique des cercles concentriques, depuis le centre-ville, havre des populations favorisées, jusqu'aux quartiers de relégations et aux zones pavillonnaires.
J'ai donc choisi d'une part, l'un des trois collèges du centre de Nantes et, d'autre part, sans aller à l'extrême de ce que Jean-Paul Payet appelle la « ségrégation à caractère simple » des quartiers de relégation, un collège à recrutement mixte, couvrant aussi des zones pavillonnaires, mixité qui produit une ségrégation à caractère complexe. Les parents, dans leur effort de contournement, y développent - pour peu que les chefs d'établissement acceptent de rentrer dans le jeu - ce que j'appellerai des stratégies du pauvre : on y fabrique des « bonnes » classes et des « mauvaises » classes, distinction qui se redouble d'une discrimination sociale et ethnique, les enfants d'origine maghrébine se retrouvant le plus souvent dans les mauvaises classes.
Si ces deux collèges sont très différemment marqués, je puis néanmoins tirer un constat d'ensemble : ils sont l'un et l'autre soumis à une forte pression concurrentielle du privé et s'adaptent à cette nouvelle donne en se créant un public de parents et d'élèves « attitrés » - au détriment de ceux qui ne le sont pas. Ce que j'ai constaté va au contraire des théories en vogue sur la mixité sociale : dans l'un et l'autre collèges - celui du centre-ville compte 15 % d'élèves modestes, qui se sentent d'ailleurs pris dans une forte ambivalence - le bénéfice que l'on pourrait attendre de la mixité est annihilé par l'adaptation à la donne concurrentielle, qui devient partie intégrante du processus de scolarisation, déterminant le partage entre bons et mauvais, influant sur les contenus et le rythme de l'enseignement, la quantité des devoirs, la qualité de la relation entre professeur et élève, l'attention des enseignants aux difficultés des élèves.
Les néolibéraux et néoconservateurs thatchériens n'hésitaient pas à déclarer que l'Etat était le problème et le marché la solution. Mon expérience de terrain me permet de dire que la concurrence est le problème, en aucun cas la solution.

Votre désaveu de la mixité sociale me confond. Le handicap n'est-il pas plus fort où la mixité est absente ?
Peut-être, si les établissements ne sont pas soumis à la pression de la concurrence, mais dès lors qu'ils le sont, le bénéfice pour les élèves modestes s'en trouve annihilé. Voilà ce que ne montrera jamais une approche économétrique de surface.

Je vous remercie de votre exposé. Vous avez parlé, en évoquant la mutation de l'école primaire, d'un « marché noir scolaire ». Qui en sont les « clients » ?
Je sais que ce genre de propos ne plaira ni à la droite, ni à la gauche institutionnelle. Disons, pour faire court, que les enseignants et les journalistes ont été les premiers à faire un usage privé de l'école publique pour leurs enfants. Cela a longtemps été tu. Aujourd'hui, la pratique explose.

Je vous remercie de votre exposé. Une précision : par pression concurrentielle, entendez-vous seulement celle de l'enseignement privé sur l'enseignement public ou aussi celle qui s'exerce entre établissements publics ?

Il est vrai que les choses ne sont pas vécues de la même façon selon les territoires. Il suffit de voir la pression concurrentielle qu'exerce certain lycée du 5e arrondissement sur ceux qui sont à dix kilomètres à vol d'oiseau. Pour qui veut être sûr de voir son enfant en classe préparatoire, rien ne vaut une inscription dès la sixième à Henri IV.
Le rapport entre privé et public a-t-il pour vous évolué ? L'école de classe n'a pas toujours été du côté de l'enseignement privé. J'ai longtemps été Breton avant d'être Francilien. Il y a cinquante ans, à Dinan, quand le lycée public accueillait les enfants des commerçants et de la petite bourgeoisie, l'école des Cordeliers formait les fils de paysans, qui amenaient le cochon pour payer la scolarité. Elle compte quelques anciens élèves célèbres, comme Charles Josselin ou Yannick Bodin ... Situation bien différente en Île-de-France : à Fontainebleau, lorsque j'y suis arrivé, l'établissement privé accueillait les gosses de riches mis à la porte du lycée public à Paris. Comment voyez-vous les choses aujourd'hui ?

Vous avez dit que la concurrence était le problème, pas la solution. Je suis assez d'accord là dessus. Ne pensez-vous pas qu'il faille lui préférer la complémentarité ?

Entendons-nous bien, je suis extrêmement attaché au libre choix des parents, mais je viens de l'école publique. Je pense à la complémentarité entre établissements.

Pensez-vous que la question relève de l'organisation territoriale du système éducatif, sur laquelle notre mission s'interroge ? Puisque vous avez enseigné en milieu rural, vous savez sans doute que l'enseignement agricole, qui jouit pourtant de beaucoup d'autonomie, n'en est pas pour autant à l'abri des déboires et des restrictions qui frappent l'enseignement public général.
L'autonomie territoriale peut-elle être une réponse pertinente ou accroîtrait-elle, au contraire, la pression concurrentielle, sachant que se pose la question du volume des moyens ? Autrement dit, et si je me fais l'avocat du diable, la manière d'octroyer les moyens peut-elle, pour vous, constituer une réponse ?
Je me définis comme un socio-historien. L'histoire donne, pour moi, leur poids aux enjeux du présent. La concurrence entre public et privé n'est pas de même nature en région parisienne et en Loire-Atlantique, où les établissements privés n'ont jamais été implantés au coeur des cités, mais en périphérie. Il n'en reste pas moins que l'écrémage s'y pratique. Le regard est peut-être plus bienveillant, mais dès que se pose un problème de discipline, on exclut l'élève, à la différence de l'enseignement public, qui a le devoir d'accueillir tout le monde, comme le rappelle Philippe Mérieux, pourtant fervent catholique. Il est évidemment beaucoup plus facile d'innover et de mettre en oeuvre une pédagogie profitable avec des élèves qui ne posent pas problème. Au niveau du lycée, plus sélectif, tout dépend de la localisation des établissements. A Nantes, les grands établissements, qu'ils soient publics ou privés, ont chacun leur composante, selon les quartiers. Les grands collèges privés accueillent les enfants de la bourgeoisie traditionnaliste bien-pensante, tandis que, parmi les trois établissements publics, l'un accueille les enfants de la bourgeoisie bohème, les « bobos », enseignants, architectes, l'autre ceux de la bourgeoisie libérale anticléricale dans la tradition du XIXe siècle, et le troisième, enfin, ceux de la bourgeoisie d'argent, qui va aussi vers le privé. Mais alors que la ville compte autant d'écoles privées que publiques, les premières se répartissent sur quatre des vingt secteurs.
La décentralisation ? Je m'en méfie. L'Etat doit plus que jamais jouer son rôle d'arbitre. Dans un de mes livres, publié en 1998, j'expliquais que les termes de la novlangue étant polysémiques, il ne fallait en user qu'en précisant le sens qu'on leur donnait. Il en va de même pour celui d'autonomie. Il peut signifier autogestion, indépendance à l'égard des pouvoirs, mais aussi fonctionnement managérial et partant, concurrence accrue entre établissements. Si un peu de concurrence ne nuit pas, exacerbée, elle conduit à se poser la question : quelle école veut-on pour quelle société ? Est-ce une société des égoïsmes et de l'entre-soi que l'on veut ? A vous de répondre, en prenant vos responsabilités.

Quand les enseignants sont moins impliqués, sont là un jour, n'y sont pas l'autre, les résultats ne suivent pas. C'est ainsi que les parents, fatigués des enseignants à mi-temps, qui n'assurent pas le suivi qu'ils souhaiteraient pour leur enfant, désertent l'école publique.
Vous faites bien de parler des enseignants à mi-temps. C'est, au sens propre, le résultat premier de ma recherche sur l'école primaire : sa mutation tient pour beaucoup à l'explosion du mi-temps. La courbe de ce que l'on appelle pudiquement les quotités variables est montée en flèche. Un instituteur sur sept, en Ille-et-Vilaine, est à temps partiel. Cela tient aussi aux origines sociales. Parmi les futurs professeurs des écoles, on trouve une bonne proportion de jeunes femmes qui, après avoir travaillé comme cadre dans le privé, rejoignent, à 30 ou 40 ans, l'éducation nationale, qu'elles jugent plus compatible avec leur vie de famille. Cette évolution est grave. Et me rend d'autant plus insupportable l'anéantissement de mes efforts à l'IUFM. Quand je pense qu'une formation entérinée par le rectorat, plébiscitée par de jeunes Bretons que l'on retrouvait ensuite, rassurés sur leur capacité à faire face, au Val-Fourré ou ailleurs, va disparaître faute de quelques sous, les bras m'en tombent ! Quant à la masterisation, c'est une catastrophe ! La vraie quadrature du cercle ! Ne comprenez-vous pas que les enseignants doivent être formés ? Quand donc en finira-t-on avec cette logique comptable ! Excusez ma colère, mais cette entreprise de casse est insupportable !

Dire que l'on se méfie de la décentralisation parce que l'Etat doit jouer un rôle d'arbitre est contradictoire. Si l'Etat est arbitre, c'est qu'il ne peut tout faire. Il faut donc laisser faire ceux qui sont mieux placés que lui.
Je ne préconise pas de revenir à l'uniformité d'autrefois, les enseignants ont besoin de souplesse. Je ne suis donc pas totalement opposé à la notion de projet, pour peu que l'on s'interroge sur son usage. Que veut-on en faire ? S'il s'agit de mettre de l'extraordinaire dans l'ordinaire de la classe, à quoi bon ? S'il s'agit de mettre en concurrence les établissements, à quoi bon ? La question à se poser est celle de la transmission du savoir. Car l'enjeu central de l'école n'est pas autre chose que le savoir, et son appropriation par l'élève, ce que trop de rénovateurs de la pédagogie des années 1970 ont eu tendance à oublier.
Quel usage, donc, fait-on des projets d'établissement, là est la question.

Mais à supposer que les projets visent tous le même usage, sont portés par l'équipe éducative, avec un objectif de bénéfice cognitif, ils s'inscrivent forcément dans une logique de la concurrence.
C'est ce qu'il faut s'employer à éviter : cela vous revient.

Vous avez évoqué les stratégies scolaires des « parents d'élèves professionnels ». La désectorisation se voulait précisément une réponse à ces stratégies réservées à des initiés.
Elle a accentué la ghettoïsation. On savait d'ailleurs que tel serait son effet : cela a été démontré, sur la base d'expérimentations, à la fin des années 1980. Le nombre de places dans les établissements réputés est réduit : les proviseurs sélectionnent encore davantage les élèves. C'est d'ailleurs un sujet sur lequel les cercles de réflexion du parti socialiste sont très partagés. La question de l'école touche aussi à la question urbaine, à celle des inégalités : dans une société inégalitaire, les solutions sont difficiles à trouver. Je le dis solennellement aux élus socialistes : n'allez pas décevoir le peuple de gauche. Les milieux populaires ne sont pas représentés politiquement, sinon à la marge. S'ils sont encore une fois les grands perdants, attention au retour de bâton.

Je n'entrerai pas ès qualités dans ce débat : ce n'est pas le lieu.
En France, on ne paye pas sa taxe d'habitation en fonction de son revenu, mais du lieu où l'on trouve à se loger. En Île-de-France, il suffit parfois de trois rues d'écart pour payer deux à trois fois plus. Il en va de même pour l'école : c'est où l'on habite que l'on envoie ses enfants à l'école. La question dépend donc malgré tout du territoire. Il y a bien des politiques, non pas de territoires, mais marquées par le territoire. Il est évident, par exemple, que le milieu urbain crée des ghettos. Dans ma ville, tout le monde sait bien quels secteurs sont marqués socio-culturellement. J'ai été professeur des collèges ; l'autonomie, pour moi, c'est aussi la liberté d'adapter à l'enfant l'enseignement à transmettre. On n'aborde pas les choses de la même façon avec un enfant qui apprend le français et un autre qui le parle parfaitement, avec celui qui, grâce à sa famille, a des activités culturelles, et celui qui n'est jamais entré dans un musée. L'enseignement a donc besoin d'adaptation, que ce soit seul ou en équipe. Je fais partie de ceux qui pensent que l'uniformisation, au collège, a été une catastrophe. Penser que tout le monde doit entrer au lycée n'est pas une bonne idée. Les enquêtes PISA sont certes à prendre pour ce qu'elles sont, mais vu le nombre d'enfants qui ne savent pas écrire, lire et compter à 11 ans, il n'est pas tolérable de dire qu'ils sont « en échec » ; pas plus qu'il n'est tolérable que 150 000 à 180 000 gosses disparaissent dans la nature à 15 ans - je pense à ceux qui sortent du système sans diplôme.
Il faut adapter l'enseignement, ce qui ne veut pas dire que les uns étudieront Voltaire, quand on fera travailler les autres sur un article de L'Equipe.
Certes, les enseignants doivent rester maîtres de la conception de leur enseignement, mais je ne crois pas, en revanche, à la liberté pédagogique. Les travaux de recherche sociologique montrent que les disciplines qui sont alors privilégiées ne sont pas les mêmes selon l'origine sociale...des professeurs. J'ai fait ma thèse de doctorat sur les écoles primaires d'un quartier sensible de l'agglomération de Nantes. Et cela juste au moment où le profil des enseignants se transformait : l'instituteur d'origine populaire était peu à peu remplacé, pour faire court, par la femme de cadre supérieur. On a vu se lancer des innovations pédagogiques, qui réclamaient des établissements bien équipés ; et c'est ainsi que l'on est allé, peu à peu, rechercher des financements auprès des parents, ce qui a fini par créer une hiérarchie entre les établissements. L'enfer est pavé de bonnes intentions.
Autrefois, l'instituteur enseignait les maths, le français, l'histoire. Et puis, à partir des années 1970, au nom de l'épanouissement, de l'éveil, on en est venu à ne plus même apprendre aux enfants l'orthographe grammaticale. On a vu le désastre, vingt ans après. Je suis moi-même tombé dans ce travers, je plaide coupable. Mais j'ai heureusement rencontré un vieux hussard de la République, un homme extraordinaire, qui allait voir les parents pour les convaincre de laisser leur enfant à l'étude, un homme qui me disait : « Si tu ne fais pas le programme dans cette classe, qui le fera ? ». Quand je vois que l'on ne met plus les moyens, aujourd'hui, pour former les enseignants, cela m'indigne.

Nous direz-vous un mot, pour finir, de ce que vous appelez les réussites paradoxales ?
Lorsque le contexte historique et politique est porteur, l'école joue son rôle d'ascenseur social. Ce fut le cas de l'école de Jules Ferry, qui, même si elle était ségrégative, a permis à des enfants du peuple de s'élever - ce qui explique le succès du récit républicain d'une école qui, en deux générations, promeut. A la fin des Trente Glorieuses, des sociologues ont travaillé sur ce point : ces enfants qui doivent tout à l'école étaient nombreux, je suis l'un d'eux. Depuis, les choses ont changé du tout au tout. Dans l'enquête que j'ai menée, je n'ai rencontré qu'un cas, et encore sous influence islamiste. Quand tout est à ce point bloqué, le discours du volontarisme n'a plus de sens. Allez dire à tous ces enfants : « Quand on veut, on peut » ! Terrible situation que celle où l'on voit se préparer une société d'héritiers, fermée, intenable. Intenable, je vous mets en garde.

Je souhaite la bienvenue à M. Jean-Yves Rochex, l'une des dernières personnes auditionnées par notre mission après presque six mois de travaux sur l'organisation territoriale du système scolaire et sur l'évaluation des expérimentations en matière scolaire.

Merci de votre invitation. J'appartiens à l'équipe de recherche en science de l'éducation EScol - acronyme pour « Education scolarisation » -, dont je ne suis plus le responsable. Fondée par Bernard Charlot en 1987, elle travaille sur les processus de production des inégalités scolaires, les dynamiques d'enseignement et d'apprentissage dans les milieux difficiles et, plus largement, sur les politiques d'éducation prioritaire depuis leur création. A ce propos, j'ai moi-même coordonné une zone d'éducation prioritaire (ZEP) en 1983. Je suis également rédacteur en chef de la Revue française de pédagogie, la principale publication académique francophone en matière d'éducation.

Quelle est votre évaluation de la politique d'éducation prioritaire ? Ses résultats ne sont pas à la hauteur des efforts consentis, affirment certains. Comment expliquer la persistance d'un nombre important de jeunes sortant du système scolaire sans qualification ? Enfin, quid du rapport au savoir dans les ZEP ?

Nous avons travaillé à une évaluation nationale et, plus récemment, internationale portant sur huit pays d'Europe, financée par le programme Socrates de l'Union européenne.
Une remarque préliminaire : la permanence du vocable utilisé - politique d'éducation prioritaire - masque une forte discontinuité de l'objet. Celui-ci est marqué par des relances gouvernementales, qui sont autant d'extensions successives de son périmètre. Aujourd'hui, cette politique concerne plus de 1 000 zones et 25 % des élèves du primaire et du collège, contre moins de 300 zones et 7 à 8 % des élèves à l'origine. En France comme en Europe, on lui assigne désormais pour objectif la « promotion » des « potentiels » individuels avec un référentiel psychologisant, et non plus la lutte contre les inégalités sociales fondée sur une analyse sociologique - courant auquel j'appartiens - comme à ses débuts dans les années 1981 à 1983.
Son évaluation repose principalement sur deux indicateurs statistiques nationaux : l'un porte sur le parcours des élèves - leur progression de classe en classe - ; l'autre sur leurs performances - ce que les élèves ont appris. Leur analyse fait apparaître que le différentiel entre les élèves scolarisés en ZEP et les autres n'a ni baissé ni augmenté. Ses résultats, peut-on en conclure, sont décevants au regard des espoirs qu'on plaçait dans cette politique dans les années 1980. Pour autant, la réalité socio-économique des quartiers urbains - les zones rurales ne sont plus guère concernées - s'étant notablement dégradée, elle a permis une moindre augmentation des inégalités scolaires au regard de l'aggravation des inégalités sociales. Outre cette analyse grossière entre ZEP et autres territoires, nous disposons de l'étude réalisée par des inspecteurs généraux (Catherine Moisan et Jacky Simon) en 1997. Celle-ci s'attache à identifier les causes des réussites et des échecs dans les ZEP. A l'instar des rares travaux de recherche menés sur le sujet, elle souligne l'importance d'un pilotage politique continûment axé sur l'amélioration des apprentissages des plus démunis, de la taille de la zone - qui ne doit pas être trop vaste -, et du rôle de la scolarisation à deux ans. Hélas, les chercheurs ne sont pas toujours entendus des politiques, une plainte récurrente, me direz-vous....
L'effort financier est difficile à calculer car, en sus de la dotation du ministère en personnels et en crédits, interviennent les collectivités territoriales et les partenaires. Il est, du reste, relativement modeste : un élève en ZEP coûte environ 10 % de plus. Cet effort a rarement été ciblé. Je m'explique : ont été retenus les territoires les plus en difficulté selon des critères fixés par chacune des académies, mais les niveaux scolaires n'ont pas été hiérarchisés. La France, contrairement à certains pays anglo-saxons, n'a pas mis l'accent sur les apprentissages initiaux. Je vous renvoie à la circulaire relative aux « réseaux ambition réussite » (RAR), dont le dispositif Eclair prend la suite. Elle a été construite autour du collège, considéré à tort comme le maillon faible de notre système scolaire. Les symptômes des inégalités scolaires y sont certes les plus apparents mais cela revient à traiter la fièvre sans s'attaquer au mal. La rédaction de cette circulaire a été finalement remaniée au moyen de copier-coller, après que les syndicats d'enseignants du primaire soient montés au créneau. Plus personne ne se souvient de l'expérimentation sur les CP à demi-effectifs lorsque M. Bayrou était ministre. On l'a bâclée ; peu d'enseignements en ont été tirés.

Existe-t-il des études sur l'impact de la préscolarisation à deux ans dans ces zones ?

D'après l'enquête d'Agnès Florin à Nantes, les résultats sont contrastés. La préscolarisation a des effets positifs à condition d'être une transition vers l'école, non une école en miniature. Or la scolarisation des enfants de deux à trois ans a nettement diminué partout en France, et surtout dans les ZEP.
D'autres pays européens ciblent sur les apprentissages premiers, la petite enfance avec des programmes intitulés « prendre un bon départ dans l'école ». Les résultats sont positifs. Pour les pérenniser, encore faut-il prévoir un accompagnement et un suivi dans les étapes ultérieures.
L'extension démesurée de la carte des ZEP a abouti non seulement à une dilution de l'effort mais aussi à une modification du projet initial. Le sigle de ZEP est désormais uniquement associé à la politique de lutte contre les inégalités et l'échec scolaires ; leurs concepteurs poursuivaient un autre but : transformer les territoires les plus en difficulté, ceux où les missions mêmes du service public étaient menacées, en des laboratoires du changement social où l'on inventerait d'autres manières de faire afin de réussir la démocratisation du système scolaire. Fait significatif, on ne parle plus de production d'inégalités à l'école, mais de politique ZEP.
On pourrait imaginer un recentrage de la politique ZEP sur les territoires les plus dégradés, soit les 250 RAR, identifiés pour la première fois en fonction de critères nationaux, tout en conservant le principe d'une dotation budgétaire différenciée en fonction des caractéristiques socio-économiques pour l'ensemble des établissements scolaires au fondement de la politique des ZEP - une rupture dans la tradition républicaine française. Ce système, qui suppose l'élaboration de critères fiables, transparents et démocratiques, présenterait l'avantage d'échapper à la dichotomie entre ZEP et non ZEP et de porter l'accent sur les zones les plus précarisées. La France aurait tout à intérêt à suivre cette voie que la Belgique francophone, dont la politique était calquée sur la nôtre, a ouverte.

Des politiques mal ciblées ou ciblées trop tardivement, j'en suis d'accord. Ne souffrent-elles pas également d'une mauvaise articulation avec la politique de la ville ?

Les pays qui font porter l'effort sur les apprentissages essentiels, quand bien même le suivi fait ensuite défaut, connaissent-ils une situation moins catastrophique que la nôtre au collège ?

Prenons l'exemple de l'Île-de-France où le conseil régional était confronté à la difficulté suivante. Il y a dix ans, l'académie de Versailles comptait deux fois plus d'établissements en ZEP que celle de Créteil. Si l'on avait appliqué les critères retenus par le rectorat de Versailles, il aurait fallu classer en ZEP la quasi-totalité de l'académie de Créteil, n'est-ce pas ?
Le collège ne serait pas le maillon faible de notre système, dites-vous... Mais à quoi sert-il lorsque le classement des élèves - bons, moyens, très faibles - est identique à l'entrée et à la sortie ? A quoi sert-il quand 150 000 à 180 000 jeunes disparaissent dans la nature en le quittant ? A quoi sert-il quand plus de la moitié des élèves orientés vers le lycée professionnel s'engagent dans cette voie contre leur gré ? Pour moi, le collège est la plus grosse erreur de ce pays !

Nous avons mené avec les ZEP des politiques mal ciblées, en effet. En 1998, lors de la deuxième relance de la politique d'éducation prioritaire, le Gouvernement a pris le contre-pied des préconisations du rapport Moisan-Simon, en augmentant le nombre de ZEP. De plus, on privilégie les activités en marge de l'ordinaire des classes, les projets, parce qu'ils sont plus visibles, plus attractifs et plus mobilisateurs pour les élèves. Prenons un exemple caricatural : à la demande de la Caisse des dépôts et consignations, nous avons évalué un immense projet culturel à Toulouse en 1989-1990 ; pour les financeurs, dont la politique de la ville et le rectorat, son succès reposait sur le nombre d'élèves participants. Soit, mais une fois le spectacle ou le journal des élèves terminé, qu'ont appris les élèves ? La tendance est à l'externalisation sous forme de projets marqués par des inaugurations - cela fait plaisir aux élèves et aux élus. Mais comment améliorer le cours ordinaire de l'enseignement ? Comment modifier les interactions entre le maître, les élèves et l'objet du savoir ? A l'occasion de l'écriture d'un journal, quels élèves tiennent la plume ? Le projet ne va-t-il diviser encore plus les élèves ? Sans être des empêcheurs d'innovation, nous devons poser ces questions.
La coopération avec la politique de la ville est nécessaire à condition que l'école n'y perde pas sa spécificité, le travail d'étude, pour se transformer en un lieu d'accueil d'ateliers socioculturels. Pour mon courant, les écoles sont destinées au travail d'étude, à l'acquisition des connaissances que le cours ordinaire de la vie ne suffit pas à apprendre.

Juste ! Si ce n'est que l'on ne reconnaît pas aux collectivités territoriales la légitimité pour intervenir sur le travail d'étude, dans le domaine pédagogique. Elles sont sollicitées pour les seuls projets périphériques.

Les collectivités territoriales financent de nombreuses actions d'accompagnement scolaire et d'aide aux devoirs après 16h30. Sans empiéter sur des compétences qui ne sont pas les leurs, elles pourraient participer à la réflexion sur les demandes de travail adressées aux élèves par les professeurs. Les retours sont importants pour ajuster le tir.

La participation des collectivités territoriales aux activités offertes me pose un cas de conscience car elle est fonction des richesses du territoire, donc source d'inégalités... Comment l'envisager ?

Les collectivités territoriales participent très souvent aux activités périscolaires sans intervenir sur la pédagogie. A Melun, enseignants, élus ainsi que le sous-préfet chargé de la politique de la ville se réunissent tous les mois. Dans le monde rural, cette participation doit être certainement plus réduite, par manque de moyens. Dans tous les cas, elle contribue à la réussite des élèves.

Au fond, toute la difficulté vient de la distinction entre le pédagogique et l'éducatif. En Île-de-France, le conseil régional pouvait financer certains projets de lycées avant qu'ils ne soient transformés en travaux personnels encadrés (TPE), notés par les professeurs. Résultat, l'année suivante, les proviseurs se sont donné le mot pour présenter cette activité sous la forme de projets, et non le TPE, afin d'obtenir à nouveau des financements...

De nombreuses initiatives, des collectivités territoriales, des associations ou encore des clubs de retraités de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN) prolifèrent autour de l'école. Pour moi, la question centrale est : favorisent-elles la démocratisation du système éducatif et de l'accès au savoir ? Certains projets sont efficaces sans être pertinents car, réservés à l'élite des élèves, ils accréditent l'idée d'une opposition entre laissés-pour-compte et élèves favorisés. Ainsi, dans un collège de l'Essonne, on considère que la « classe européenne » est réservée aux Européens... D'où la nécessité d'une évaluation systémique pour une vision globale des dispositifs et un repérage des effets pervers. Ces initiatives soulèvent effectivement la question de l'égalité des ressources - variables selon les territoires ou, à niveau égal, finançant des politiques différentes. En tant que citoyen, je considère qu'elles devraient viser des programmes identiques pour tous les élèves, particulièrement ceux de la scolarité commune.
Le collège ne fonctionne pas bien. En revanche, dire qu'il est le maillon faible relève d'une approche à courte vue. D'après les anciennes évaluations nationales en classe de sixième, le rapport de performances variait de 1 à 3 au niveau national, et de 1 à 6 dans certains établissements. Cette situation, durant les années au collège, ne variait pas, voire s'aggravait. L'imputation de causalité reste à démontrer : au collège, se produisent également des « ruptures de contrat didactique », des phénomènes d'adolescence, de plus grande rugosité sociale qu'à l'école primaire. D'où davantage de manifestations d'inégalités et de faits de violences qu'à l'école primaire. Le collège est donc devenu prioritaire, quand il faudrait inventer de nouveaux modes de traitement de la difficulté scolaire, et ce dès le primaire. Avec la politique volontariste de réduction des redoublements menée depuis trente ans - sachant que les redoublements sont de fait inefficaces -, on a abouti à un divorce entre la « carrière des élèves » et l'effectivité des acquisitions intellectuelles et cognitives requises pour passer dans la classe supérieure. Cet écart est d'autant plus grand que le collège se situe à la fin de la scolarité commune. Dans le panel de 1989, les élèves les plus faibles en classe de sixième sont passés plus rapidement en troisième que les élèves moins faibles ! Ce sont les « élèves TGV », pour reprendre le terme utilisé dans les cours de collège de la Seine-Saint-Denis.
L'académie de Créteil ne se limite pas à la Seine-Saint-Denis ...

et le Val-de-Marne dont les caractéristiques sociales et scolaires sont équivalentes à la moyenne nationale. En revanche, la Seine-Saint-Denis connaît la situation socio-économique la plus difficile en métropole. En 1983, ce département comptait seulement 5 ZEP tandis que la Nièvre abritait le plus grand nombre d'élèves en ZEP. L'explication tient au poids des instances politiques : en Seine-Saint-Denis, de nombreuses municipalités ont refusé le classement en ZEP ; elles y sont venues beaucoup plus tard. Aujourd'hui, le consensus sur la politique des ZEP est d'autant plus large qu'on ne sait plus sur quoi il se fonde. Il y a là un vrai travail scientifique et politique à mener.
J'en viens aux résultats observés dans les pays ayant mis l'accent sur la petite enfance, soit les États-Unis, la Grande-Bretagne et certains pays scandinaves. Aux États-Unis, les résultats sur le parcours scolaire sont peu probants. En revanche, quoique le lien de causalité soit fragile, ces programmes auraient des effets sociaux bénéfiques : moins de grossesses précoces, moins de délinquance. En Grande-Bretagne, on observe une difficulté à pérenniser les effets positifs au collège. Cette politique est, de toute façon, devenue assez minoritaire dans le système éducatif anglais.
L'intérêt des enquêtes PISA, sujettes à caution sur bien des points, est d'établir avec clarté l'intérêt du collège unique, promu par les pays scandinaves et repoussé par les pays à tradition sélective comme l'Allemagne, la Suisse ou la République tchèque : c'est le système le plus efficace et le moins inégalitaire. La Pologne en a tenu compte et a amélioré ses résultats d'une enquête à l'autre.

Ces meilleurs résultats observés dans les pays à collège unique ne s'expliquent-ils pas aussi par une plus grande efficacité de leur école élémentaire ?

Peut-être. Pour étudier cette question, il faudrait procéder à des études longitudinales dont vous connaissez le coût...
Autre éclairage intéressant : les résultats des élèves non redoublants de troisième sont aussi performants que ceux de seconde évalués par PISA. Autrement dit, notre système souffre d'une absence de démocratisation, et non le contraire.

Que pensez-vous des internats d'excellence et des établissements de réinsertion scolaire ?

Tout d'abord, le proviseur du lycée de Sourdun se fâche dès qu'on l'interroge sur son budget, ce qui complique l'évaluation du dispositif. Ensuite, la promotion d'individus supposés méritants, « à potentiel », qu'il faudrait « exfiltrer » de leur milieu social et scolaire jugé délétère relève d'une politique d'élargissement du recrutement des élites, non d'une politique de réduction des inégalités sociales socialement construites.

Le travail en amont, dès la préscolarisation, est important pour lutter contre l'échec scolaire. La scolarité commune allant du primaire au collège, ne faudrait-il pas établir un continuum dans l'acquisition du socle commun défini par la loi de 2005 ? Un élève qui ne parlait pas le français en CP mettra certes plus de temps à acquérir les connaissances, mais l'objectif doit être ses compétences à la fin de la scolarité obligatoire. Les enseignants du collège, plutôt que de se plaindre du niveau des élèves qu'on leur envoie du primaire, ne devraient-ils pas travailler, eux aussi, à l'acquisition du socle commun ?

Que pensez-vous, précisément, de la notion de socle commun, de sa définition et de son mode d'évaluation ?

Pour lui, une école commune n'avait pas de sens ; il y avait une école pour les riches et une autre pour les pauvres.
Professeur d'université, j'ai parfois tendance, moi aussi, à me demander ce que mes élèves ont appris durant leurs années de lycée... Plus sérieusement, il existe des effets de seuil : certains élèves de terminale ont un tel rapport à l'écrit qu'il est vain de leur demander d'étudier la philosophie, quelle que soit la qualité du professeur.
Il faut ménager des continuités à condition de conserver les ruptures : celles-ci sont structurantes dans la construction de la personnalité, tout comme la rupture entre école et famille. L'identification disciplinaire - la différence entre maths et physique, histoire et géographie - participe d'une culture commune. Ma religion n'est pas faite ; l'important est de ne pas calquer l'école sur le collège et le collège sur le lycée, disait déjà il y a 50 ans Henri Wallon.
La définition d'un socle commun, d'une culture commune, n'entraine pas forcément de réduction des inégalités scolaires, de la même manière que le SMIC n'a pas diminué les écarts salariaux. Ensuite, il existe deux façons d'envisager ce bagage : un kit de survie - c'est la conception dominante - et une conception que j'appelle propédeutique, en vue de préparer l'élève à des spécialisations ultérieures tout en autorisant des réorientations éventuelles. De fait, la culture commune doit se poursuivre au-delà la scolarité commune. La définition des compétentes du socle commun ne va pas dans ce sens : elles peuvent s'appliquer à des élèves de CM2 comme à des étudiants de licence. Résultat, leur contenu est défini par les tests. Or la prolifération de tests instrumentaux dans les pays anglo-saxons a singulièrement réduit l'enseignement : on y apprend seulement aux élèves à réussir aux tests... C'est le learning to the test.
Audition de M. Hervé Masurel secrétaire général et de Mme Isabelle deFrance responsable du département éducation santé et développement social desds du comité interministériel des villes
Audition de M. Hervé Masurel secrétaire général et de Mme Isabelle deFrance responsable du département éducation santé et développement social desds du comité interministériel des villes

Nous sommes ravis de vous accueillir dans le cadre de cette mission commune d'information.

Merci de nous avoir conviés aujourd'hui. Je vais commencer par vous donner quelques chiffres tirés du rapport de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles. Tout d'abord, les effectifs concernés se montent à 392 000 élèves dans les établissements publics du secondaire. Depuis quatre ans, la population des élèves dans les collèges situés en ZUS a diminué de 10 %, contre 3,5 % dans les autres établissements. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène : dans le cadre de la rénovation urbaine, certains collèges ont été transférés hors quartiers ZUS, mais cela ne concerne que peu de jeunes. L'assouplissement de la carte scolaire peut également expliquer cette diminution d'élèves, un certain nombre de parents souhaitant inscrire leurs enfants hors de ces quartiers.
Certains chiffres sont encourageants : les efforts consentis par l'éducation nationale en faveur des établissements scolaires publics en ZUS se traduisent par des résultats statistiques : le nombre d'enseignants en ZUS diminue moins vite que dans les établissements hors ZUS, ce qui signifie que le nombre d'enseignants y baisse moins vite que le nombre d'élèves. Aujourd'hui, il y a 20,1 élèves par classe dans les ZUS contre 22,6 élèves au niveau national. En revanche, les établissements en ZUS concentrent plus d'enseignants de moins de 30 ans qu'ailleurs : 20,7 % contre 13,6 % en moyenne.
En 2008-2009, près de deux élèves scolarisés sur trois en ZUS ont des parents appartenant à des catégories sociales défavorisées alors que moins d'un élève sur six a des parents venant de catégories favorisées. Ces chiffres sont nettement différents de ceux que l'on peut observer au niveau national.
Le taux de succès au brevet des collèges et au bac augmente plus vite dans les ZUS qu'ailleurs, mais il reste un retard important à combler.
Tous ces chiffres démontrent de façon objective qu'il est nécessaire de poursuivre, et peut-être même d'intensifier, les efforts consentis au titre de l'éducation prioritaire dans ces quartiers. En outre, la géographie de l'éducation nationale ne correspond pas exactement à celle de la politique de la ville, ce qui complique l'exercice.
J'en viens aux actions en faveur des élèves en difficulté menées par l'éducation nationale et par la politique de la ville.
Pour ce qui concerne l'éducation nationale, certains dispositifs sont très efficaces. Je pense en particulier à l'accompagnement éducatif avec les études du soir. Cette action était nécessaire et il est indispensable de la poursuivre, quelles que soient les difficultés budgétaires, car elle permet de renforcer l'égalité des chances.
Autre action très importante : les dispositifs CLAIR et ECLAIR qui permettront aux responsables d'établissement scolaires d'avoir une plus grande liberté de choix pour recruter leur équipe pédagogique.
Les dispositifs de lutte contre l'absentéisme scolaire des moins de 16 ans et contre le décrochage scolaire mériteraient d'être généralisés car ils sont très efficaces avec, notamment, les micro-lycées. Le Comité interministériel des villes (CIV) qui s'est réuni le 18 février 2011 a pris un certain nombre de décisions à cet égard.
D'autres actions sont mises en place en dehors de l'éducation nationale : je pense en particulier aux missions locales qui aident les élèves ayant quitté prématurément le système scolaire à trouver un emploi.
Il y a deux ans, un programme pour développer les internats d'excellence a été lancé, avec pour objectif la création de 20 000 places dans ces internats ou des classes labélisées pour les élèves issus de ces quartiers. Le terme d'internat d'excellence n'est sans doute pas très bien choisi, puisqu'il s'agit de réunir les conditions de travail qui permettent de parvenir à l'excellence pour les enfants qui ne trouvent pas dans leur milieu familial ni dans leur situation matérielle les conditions pour effectuer un travail scolaire satisfaisant.
S'agissant de l'orientation, maintenant, l'une des inégalités les plus fortes subie par les habitants, et donc les jeunes de ces quartiers, est l'absence de tout réseau relationnel. Le service public doit donc améliorer la qualité de l'orientation proposée aux jeunes et leur faire mieux appréhender le monde du travail. Le Comité interministériel des villes du 18 février dernier a estimé que le stage professionnel des élèves en troisième devait avoir un réel contenu : parfois, les élèves de ces quartiers obtiennent un stage, mais d'autres, victimes de discriminations, n'y arrivent pas, ce qui les empêche d'avoir un premier contact avec le monde du travail. Des efforts vigoureux doivent donc être menés, mais pas seulement par l'éducation nationale. La politique de la ville doit aider les principaux des collèges à se constituer un réseau d'employeurs susceptibles de proposer de tels stages.
J'en arrive à la politique de la ville. Dans le domaine scolaire, nous menons plusieurs types d'intervention, notamment avec les contrats urbains de cohésion sociale que nous finançons grâce à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, afin de lutter contre le décrochage scolaire et pour accroître le soutien scolaire grâce à des associations.
Le programme de réussite éducative (PRE) est doté de plus de 80 millions d'euros : les enseignants doivent détecter dans leur classe les élèves qui rencontrent des difficultés particulières. Ensuite, le maire est chargé, avec une équipe constituée autour de lui, de mettre en place des actions spécifiquement adaptées aux difficultés rencontrées par l'élève, que cela soit des rendez-vous avec des psychologues, des psychiatres, des activités théâtrales, un soutien dans telle ou telle matière... Bref, il s'agit de proposer du cousu-main et c'est ce qui fait toute l'originalité de ce programme qui s'adresse à chaque élève en difficulté. Les maires disposent d'une très large autonomie pour mener à bien ce programme, que la politique de la ville cofinance.
Nous participons bien sûr aux internats d'excellence avec des financements spécifiques, comme à la lutte contre le décrochage scolaire et contre l'absentéisme. Nous finançons des postes d'adultes relais, dont certains sont placés auprès des responsables des établissements scolaires pour améliorer les relations avec les familles. Nous finançons aussi les associations de femmes relais dont l'une des missions est de tisser des liens entre les établissements scolaires et les familles, ne serait-ce que pour traduire les bulletins scolaires lorsque les parents ne maîtrisent pas suffisamment notre langue. Elles incitent aussi les familles à venir rencontrer les enseignants et à participer aux réunions des écoles ou des collèges.
Le Comité interministériel des villes du 18 février dernier a aussi décidé de lancer dans 33 quartiers expérimentaux des avenants aux contrats urbains de cohésion sociale destinés à impliquer davantage le droit commun de l'État dans les domaines de la sécurité, de l'emploi et de l'éducation : les crédits viendront des ministères et non plus de la politique de la ville. Dans le domaine de l'éducation, des engagements précis seront pris par l'inspecteur d'académie dans le cadre d'un avenant signé avec le maire, notamment sur les moyens humains - enseignants mais aussi postes d'infirmières - dont disposent les écoles en ZUS.
En dépit des réserves de l'éducation nationale, nous avons prévu d'adapter éventuellement le contenu des enseignements aux caractéristiques des élèves qui fréquentent ces écoles. Si nous voulons élever le niveau scolaire dans ces quartiers, nous devrons nous interroger sur la nature même des enseignements dispensés. Il ne s'agit bien sûr pas de proposer des enseignements au rabais, mais de s'adapter à des élèves qui ne parlent pas le français chez eux. Il y a en effet une inégalité majeure lorsqu'on ne peut assimiler l'enseignement donné à l'école. La réflexion doit se poursuivre afin de parvenir à l'intégration de ces élèves. Nous devrons donc accroître les marges d'adaptation des programmes. Cette dernière réflexion est plus personnelle qu'institutionnelle.

Merci pour cette présentation.
Qui compose le Comité interministériel des villes ?
La coordination entre les actions de l'éducation nationale et celles de la politique de la ville est-elle satisfaisante ? Vous avez estimé qu'il n'était pas facile de faire évoluer l'éducation nationale. Les partenariats sont-ils suffisamment développés avec les collectivités territoriales ?
La loi Wauquiez a prévu plusieurs dispositifs en faveur de l'orientation pour tous. Sont-ils déjà en place ? Quels en sont les résultats ?

Le CIV est présidé par le Premier ministre et il regroupe la plupart des ministres, notamment le ministre de l'intérieur pour les questions de sécurité et de délinquance, celui de l'éducation nationale, de la justice, de la ville, du transport, du logement.
En ce qui concerne la coordination entre le ministère de l'éducation nationale et celui de la ville, nous avons fait des progrès, mais les marges de progression restent encore importantes... En septembre 2009, nous avons disposé d'un excellent rapport de la Cour des comptes sur l'articulation des dispositifs de la politique de la ville et de l'éducation nationale dans les quartiers sensibles...

qui a mis en lumière des dispositifs redondants. Des élagages sont encore nécessaires, surtout au niveau national. Une circulaire a été adressée aux préfets pour qu'ils examinent, site par site, si les dispositifs en place sont vraiment complémentaires. Reste qu'au niveau central, il conviendrait de s'interroger sur la pertinence de certains dispositifs.

Avez-vous le pouvoir de faire pression sur les ministères pour procéder à ces harmonisations ? Pouvez-vous déclencher un arbitrage ?

Le décret créant le secrétariat général du CIV lui permet de réunir l'ensemble des directeurs d'administration centrale. Lorsque nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, nous saisissons les cabinets des ministres et nous pouvons éventuellement demander un arbitrage auprès du cabinet du Premier ministre. En outre, les comités interministériels des villes permettent de trancher un certain nombre de problèmes.

Auparavant, il y avait les deux vice-présidents du conseil national des villes qui est une instance consultative composée d'élus locaux. Depuis la réforme de 2009, il n'y a plus que des membres du gouvernement.
En ce qui concerne l'orientation, les choses sont en train de se mettre en place, notamment avec les dispositifs d'information et le grand portail en lien avec l'Onisep.
Sur le décrochage scolaire, qui est le pendant sombre de l'orientation, nous sommes en train d'élaborer l'outil national de recensement des décrocheurs qui sera décliné, au niveau local, avec les plateformes d'accueil des décrocheurs. Nous souhaitons que la politique de la ville puisse être associée à ces actions.
Grace aux programmes de réussite éducative, nous connaissons un certain nombre d'élèves décrocheurs. De plus, les délégués des préfets peuvent réunir les différents services.

Je reviens à votre question sur les partenariats avec les collectivités territoriales. Les contrats urbains de cohésion sociale sont signés entre les préfets et les maires, les présidents d'EPCI, les présidents de conseils généraux et parfois les présidents de conseils régionaux. Ces contrats ont été signés en 2006 et 2007, et ils ont été prorogés jusqu'en 2014. Il s'agit d'une politique partenariale forte, ancrée dans les pratiques locales.
Au-delà de ces contrats, des comités de programmation se réunissent régulièrement pour décider quels types d'actions ils financent ou cofinancent.

Tout à fait. De plus, l'inspecteur d'académie signera les avenants par délégation du recteur : l'éducation nationale s'engage donc sur les moyens qui seront affectés à telle ou telle action dans la durée. Il s'agit d'une innovation très importante et qui n'a pas été facile à faire accepter par l'éducation nationale. Nous espérons que la prochaine génération de contrats, en 2014, généralisera ce type d'engagements.

Que pouvez-vous nous dire sur la préscolarisation des enfants de deux à trois ans ?
Il est essentiel de scolariser ces jeunes enfants pour qu'ils puissent acquérir le langage. En outre, il faut sensibiliser les parents aux enjeux de l'école afin qu'ils rebondissent sur ce qui a été dit, fait et enseigné en maternelle pour faciliter l'acquisition du langage. Nous avons bien conscience qu'il s'agit parfois d'un voeu pieux puisque certains parents ne parlent pas correctement le français. Mais nous espérons pouvoir sensibiliser les parents aux enjeux de l'école.
Il existe des ateliers sociolinguistiques financés par la délégation interministérielle à l'intégration.

Le ministère de l'intégration développe les formations linguistiques pour les parents au sein des collèges. Il est psychologiquement important que les cours se déroulent dans les locaux de l'école : cela renforce le lien entre les parents et les établissements scolaires.

L'accompagnement éducatif du soir devrait-il être obligatoire dans les ZUS ?
Nous avons demandé à l'éducation nationale de veiller à ce que les quatre volets de l'accompagnement éducatif soient proposés aux enfants dans les zones expérimentales.

La LoLF a-t-elle constitué un progrès ou apporté des contraintes supplémentaires ?

L'idée était bonne de vouloir identifier les contributions de chacun des ministères dans ces quartiers. Hélas, tous n'ont pas joué le jeu, d'autant que les règles n'étaient pas très claires. Ainsi, le fait que la géographie de l'éducation nationale ne soit pas identique à celle de la politique de la ville ne permet pas d'établir des comparaisons exactes. Le document de politique transversale (DPT) est donc nécessairement limité et il a été vertement critiqué dans le rapport de MM. Pupponi et Goulard sur la politique de la ville. Le CIV nous a demandé de missionner plusieurs inspections générales, dont celle des finances, pour adapter les systèmes d'information des ministères afin de parvenir à une vision exacte des moyens affectés aux quartiers.