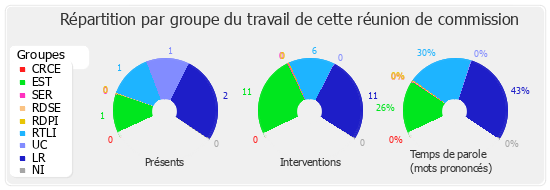Commission d'enquête Compensation des atteintes à la biodiversité
Réunion du 22 décembre 2016 à 14h35
Sommaire
- Audition des représentants de la fédération nationale des chasseurs et de la fédération nationale de la pêche en france (voir le dossier)
- Audition de m. thierry dutoit directeur de recherche en ingénierie écologique au centre national de la recherche scientifique cnrs mme claire etrillard ingénieure d'études et m. michel pech géographe ruraliste à l'institut national de la recherche agronomique inra m. harold levrel chercheur en économie écologique au centre international de recherche sur l'environnement et le développement cired et mme anne-charlotte vaissière économiste de la biodiversité au laboratoire montpelliérain d'économie théorique et appliquée lameta (voir le dossier)
- Audition des représentants de la fondation nicolas hulot pour la nature et l'homme fnh humanité et biodiversité la ligue pour la protection des oiseaux lpo world wildlife fund wwf union internationale pour la conservation de la nature uicn et france nature environnement fne (voir le dossier)
La réunion
Audition de M. Thierry duToit directeur de recherche en ingénierie écologique au centre national de la recherche scientifique cnrs Mme Claire Etrillard ingénieure d'études et M. Michel Pech géographe ruraliste à l'institut national de la recherche agronomique inra M. Harold Levrel chercheur en économie écologique au centre international de recherche sur l'environnement et le développement cired et Mme Anne-Charlotte Vaissière économiste de la biodiversité au laboratoire montpelliérain d'économie théorique et appliquée lameta

Notre commission d'enquête, réunie à la demande du groupe écologiste, s'intéresse à la compensation des atteintes à la biodiversité sur les grands projets d'infrastructures, mais aussi aux mesures contribuant à éviter et à réduire ces atteintes. Nous avons concentré notre réflexion sur quatre grands projets d'infrastructures : le suivi des mesures mises en oeuvre dans le cadre de la construction de l'autoroute A65, la réalisation en cours des mesures de compensation du projet de LGV Tours-Bordeaux, les inventaires et la conception des mesures de compensation pour le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, et enfin la réserve d'actifs naturels de Cossure en plaine de la Crau. Cela étant dit, les projets de dimensions plus modestes nous intéressent également. Nos interrogations portent principalement sur l'efficacité et l'effectivité des mesures de compensation écologique, mais aussi d'évitement et de réduction.
Je rappelle que tout faux témoignage et toute subornation de témoin serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du code pénal, soit cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende pour un témoignage mensonger.
Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, M. Thierry Dutoit, Mme Claire Etrillard, M. Michel Pech, Mme Anne-Charlotte Vaissière et M. Harold Levrel prêtent successivement serment.
Directeur de recherche au CNRS, je travaille sur les relations entre les espèces et les raisons de leur diversité. Au sein de l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale (IMBE) d'Avignon, nous nous sommes intéressés, voici quinze ans, à la première opération de compensation par l'offre : le site de Cossure, dans la plaine de la Crau.
Je m'intéresse en particulier à la possibilité de mettre en place des mesures de compensation effectives via la restauration de milieux dégradés. Les diverses expérimentations menées depuis une quinzaine d'années reposaient sur deux piliers : la mesure de l'équivalence écologique, et la restauration des milieux dégradés. Je travaille sur ce second thème.
Un premier bilan, issu de nos travaux expérimentaux et de la bibliographie internationale, montre qu'aucune opération de restauration menée depuis vingt ans n'est parvenue à une restauration intégrale. Trois raisons principales à cela : les conditions socio-économiques à l'origine des écosystèmes ont changé - ce sont les changements dits d'usage -, le climat a lui aussi évolué, et enfin les systèmes en question comportent des milliers de composantes en interaction depuis des centaines, voire des milliers d'années. Le vivant est un ensemble dynamique. C'est pourquoi les opérations de restauration se sont donné pour objectif non de reconstituer une carte postale, mais d'imprimer une trajectoire aux écosystèmes. En revanche, il est possible de restaurer des composantes ou des fonctions ; c'est ce que l'on appelle la réhabilitation.
Juriste de formation, je travaille au sein d'une communauté de recherche dédiée aux politiques publiques en matière agricole et environnementale. Je m'intéresse, avec mon collègue Michel Pech, à la compensation écologique depuis 2013. À l'époque, le ministère de l'environnement souhaitait conduire plusieurs expérimentations analogues à celle de la plaine de la Crau, notamment en Bretagne. Nous abordons la question de la compensation sous l'angle du foncier : quel est l'impact de celle-ci sur les terrains agricoles, les outils de maîtrise foncière sont-ils adaptés, comment les agriculteurs répondent-ils à la compensation, et comment valoriser davantage l'activité agricole par le biais de la compensation ?
Nous évoluons dans un contexte marqué d'un côté par l'urbanisation, l'anthropisation et un développement économique qui accentue la rareté de la ressource agricole ; mais aussi, d'un autre côté, par des démarches de protection de cette ressource et de conciliation entre la production agricole et les productions jointes.
Le cadre juridique de la compensation se caractérise par sa complexité. Plusieurs dispositifs coexistent. Il y a ainsi des dispositions relatives à la compensation dans les études d'impact, les plans et documents ayant un impact sur l'environnement ; au titre des atteintes à la continuité écologique ; dans les objectifs de conservation Natura 2000 ; dans le cadre des installations ayant un impact sur l'eau, des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), des installations classées ; dans le code forestier, à propos des défrichements ; et enfin en matière de réparation des dommages environnementaux. Les maîtres d'ouvrage perçoivent ces dispositifs comme contraignants, difficiles à mettre en oeuvre et peu efficaces.
Les mécanismes de compensation impactent le foncier agricole. Parfois, les mesures sont mises en oeuvre par l'agriculteur lui-même dans le cadre d'un aménagement agricole ; mais il arrive aussi que des aménagements non agricoles grignotent les terres, non seulement à travers le projet lui-même mais aussi via les mesures de compensation. Les maîtres d'ouvrage ont besoin d'espaces à la fois pour le projet et pour la compensation, avec cette double contrainte supplémentaire que la compensation doit être mise en oeuvre au plus près du site, et concomitamment à la réalisation du projet. C'est donc assez complexe, et le maître d'ouvrage est conduit à des arbitrages entre des terres à valeur agricole intéressante et des terres à plus grande valeur environnementale ; il doit également s'occuper de la maîtrise foncière, un sujet juridiquement lourd qui impose de passer des contrats avec le propriétaire, lequel a souvent mis sa terre en location... Enfin, il faut mettre en oeuvre des mesures de compensation efficaces, efficientes et pérennes.
Je travaille au laboratoire d'économie Agrocampus Ouest de l'INRA, à Rennes, sur quatre thèmes principaux : la politique agro-environnementale et son évaluation, la politique foncière, en particulier la compensation écologique, la politique des structures agricoles et le paiement pour services environnementaux et les biens publics.
Il convient de relativiser l'impact de la compensation écologique sur l'activité agricole, à travers le télescopage entre la rareté de la ressource foncière et le développement de la compensation - ce que l'on appelle souvent la double peine. Le problème doit être abordé plus sereinement, en distinguant les cas où l'aménageur met en oeuvre lui-même les mesures de compensation, ceux où il les confie à un opérateur, ceux où il acquiert des unités de compensation.
Quatre problématiques se posent dans cette situation. D'abord, l'acceptabilité, c'est-à-dire l'intérêt, pour le propriétaire, de mettre en oeuvre des mesures de compensation. Celles-ci modifient la nature de la terre, ce qui peut engendrer une plus-value ou une moins-value selon que sa valeur agronomique est inférieure ou supérieure à sa valeur environnementale. De plus, le choix des cultures s'en trouve altéré, d'où des degrés d'acceptabilité très variables. On voit apparaître des alliances entre le paiement pour services environnementaux et la compensation écologique, dans l'idée de valoriser ce service par une rémunération de l'action de l'homme en faveur de la nature.
Deuxième problématique, l'anticipation. On peut mettre en réserves des parcelles en vue de la compensation par la mise en oeuvre du droit de préemption des collectivités, à travers les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) et, en dernier ressort, par l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Troisième élément, la gestion du parcellaire par les collectivités, les agriculteurs, les Safer et les conservatoires d'espaces naturels, en fonction des opérations menées. La gestion d'une restauration ou d'un entretien de terrains de compensation sera différente. La nature des contrats peut évoluer en fonction de ces opérations.
Enfin, la pérennisation de la compensation est un enjeu majeur. Ainsi, la compensation de la destruction d'un milieu détruit appelle naturellement des mesures permanentes.
Il convient également d'améliorer la gouvernance territoriale, en organisant la mise en relation entre les aménageurs, les propriétaires fonciers et leurs fermiers, et d'intégrer davantage les mesures de compensation dans les politiques locales, à travers les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les plans locaux d'urbanisme (PLU), les zones d'aménagement différé, la préemption des Safer, afin d'anticiper la mise en place de la compensation. Il faudrait aussi s'intéresser davantage à la production agricole : les friches, de valeur agronomique moindre que les parcelles agricoles, peuvent, elles aussi, être mobilisées pour la compensation. Des données factuelles sur la valorisation faciliteraient le calcul coût-bénéfice et, par-là, l'information des acteurs.
La relation entre l'offre et la demande en matière de compensation mérite une remise à plat. Nos études ont mis en évidence une préférence de la profession agricole pour la compensation par la demande, ce qui pose le problème de l'adéquation entre cette demande et l'offre.
Autre difficulté, le risque d'éloignement spatial entre les sites endommagés et les sites de compensation. Soit on met en place des banques de compensation à proximité des grands ouvrages à venir, soit on relativise la notion de proximité pour travailler sur les aspects éthiques de cette obligation, car la compensation a alors des effets marchands sur la valeur des terres. Là encore, l'anticipation s'impose.
Troisième point, la nature de l'implication des agriculteurs. Lorsque ceux-ci participent à une compensation par contrat, leur production dans ce cadre doit-elle être considérée comme agricole ou environnementale ? Quelle sera la nature de leur revenu ?
Enfin, si les mesures de compensation sont pérennisées, les biens concernés peuvent être considérés comme des biens publics et doivent alors recevoir une protection technique, spatiale et temporelle conforme à cette réalité.
Spécialisée en économie écologique et institutionnelle, je m'intéresse à l'effet de la mise en oeuvre des politiques publiques de protection de la nature sur leur effectivité et leur efficacité. En matière de compensation écologique, je me suis intéressée aux contextes français et américain, à travers les banques de compensation mises en place en Floride.
On aurait pu imaginer l'émergence, pour des raisons d'efficacité, d'un marché mondial et libéral de la compensation écologique, or tel n'a pas été le cas. Dans le cadre de la compensation par l'offre, des opérateurs mutualisent les mesures compensatoires mises en oeuvre par plusieurs aménageurs. C'est un système de l'offre parce que l'opérateur organise à l'avance des opérations de restauration écologique qu'il propose ensuite aux aménageurs. Les services instructeurs disposent ainsi de davantage de temps pour des mesures de compensation de plus grande envergure ; le contrôle et le suivi s'en trouvent améliorés. C'est donc un marché qui reste fortement régulé : ainsi, la compensation doit être mise en oeuvre dans la même zone que l'impact initial, et les services instructeurs continueront à instruire les dossiers de demande d'autorisation des aménageurs.
Les règles d'application diffèrent selon les pays. En France, des sites naturels de compensation, comme celui de Cossure, ont été mis en place dès avant la loi sur la biodiversité. Aux États-Unis et dans d'autres pays, la solution retenue a été celle des banques de compensation.
La compensation par l'offre et la compensation par la demande sont complémentaires, car tous les milieux ne sont pas adaptés à la première. La loi biodiversité et ses décrets d'application posent des bases intéressantes d'encadrement de la compensation par l'offre, mais des imprécisions et des incohérences demeurent et en limitent l'efficacité. Les États-Unis, où une loi détaille les mécanismes de compensation par l'offre et par la demande, nous offrent un retour d'expérience de trente ans susceptible de nous aider à éviter les erreurs.
Au-delà des quatre projets d'envergure auxquels s'intéresse votre commission d'enquête, je me suis attachée, pour ma part, à étudier des aménagements de dimensions plus modestes qui présentent des difficultés en matière de contrôle et de suivi : zones d'activité commerciale (ZAC), zones d'activité industrielle (ZAI), zones pavillonnaires. Les responsables de ces projets ne sont pas toujours conscients de leurs obligations réglementaires.
Il nous manque en France un état initial des projets qui nous permettrait de faire le point sur les mesures « ERC » et de mesurer les effets de la loi sur la biodiversité. Pourquoi ne pas commencer par un territoire ou un projet pilote ? Enfin, les travaux actuels sur la loi concernent essentiellement la France métropolitaine et oublient l'outre-mer et les milieux marins, pourtant riches en biodiversité.
Je suis chercheur en économie écologique au Cired et professeur à AgroParisTech. Je travaille sur l'efficacité des mesures de compensation depuis plusieurs années en France et aux États-Unis. J'ai participé à un ouvrage collectif en 2015 sur le sujet. J'ai été l'animateur d'un groupe de travail sur la biodiversité au sein du comité pour l'économie verte, qui regroupe des associations, des élus, des syndicats, des économistes, des professionnels, etc. Il a publié un avis, qui identifie trois priorités : l'intégration, la planification et l'anticipation. Les cadres réglementaires, les formats de recommandations et les outils d'évaluation de l'équivalence sont très hétérogènes. Chaque bureau d'études utilise ses propres outils. On manque d'un cadre commun, ce qui génère des conflits et des contentieux. Il est urgent de définir l'équivalence, afin de tenir compte de tous les composants de la biodiversité : les végétaux, les animaux, mais aussi les fonctionnalités. Ce type d'outil existe déjà dans la loi sur la responsabilité environnementale. Dès lors que la loi fixe l'absence de perte nette de biodiversité comme objectif avec une obligation de résultat, une harmonisation s'impose. Il conviendrait aussi d'élaborer un outil cartographique pour faciliter la visualisation des enjeux et la planification. Enfin, il faut se doter d'outils pour veiller à la pérennité des mesures de compensation. La loi pose déjà le principe des obligations réelles environnementales. On pourrait envisager d'autres solutions, comme des cessions au Conservatoire du littoral ou aux conservatoires d'espaces naturels par exemple.
La bonne compensation dépend de la nature des atteintes au milieu. S'il s'agit d'une tourbière millénaire, aucune compensation n'est possible. S'il s'agit de terrains dégradés, il est possible d'agir. La question est de définir le seuil à partir duquel une compensation est acceptable ou non.
La compensation implique des coûts. Si parvenir à une absence de perte nette de biodiversité s'avère trop coûteux, il est pertinent de renoncer au projet. C'est ce qui se passe aux Etats-Unis. En Floride, les mesures de compensation pour le rechargement des plages étaient deux fois plus coûteuses que le projet, mais, comme celui-ci était jugé crucial, il a été maintenu.
Les sites naturels de compensation de la biodiversité facilitent la mutualisation et permettent une approche intégrée des mesures de compensation en visant de plus grandes surfaces, ce qui augmente leur efficacité. Il est aussi plus facile pour l'administration de procéder aux contrôles. Aux États-Unis, un agent est chargé en moyenne de suivre 200 dossiers, mais ceux qui s'occupent de banques de compensation suivent sept dossiers : les sites sont plus faciles à gérer et les coûts de transaction sont réduits. Toutefois, ces sites ne sont pertinents que pour des écosystèmes qui ne sont pas spécifiques. La plaine de la Crau est un écosystème très spécifique, ce qui explique l'échec, sur le plan économique, du plan de la Caisse des dépôts.

Avez-vous des liens d'intérêts avec un des quatre projets sur lesquels nous travaillons ?
Je suis président de la réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau. Nos travaux ont bénéficié d'un financement en 2008, en phase initiale, de la part de la Caisse des dépôts.
Je supervise une thèse qui bénéficie d'un financement de Vinci et aborde la LGV Tours-Bordeaux.
Mme Claire Etrillard, M. Michel Pech, et Mme Anne-Charlotte Vaissière déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.

Le cadre réglementaire évolue : loi sur la biodiversité, droit communautaire, protocole de Nagoya, etc. Les acteurs semblent se mobiliser. Estimez-vous que nous sommes sur le point de parvenir à un système cohérent, nous permettant de mieux prendre en compte la biodiversité, avec une meilleure connaissance des enjeux, des flux économiques ? Ou bien, à l'inverse, considérez-vous que notre société reste rétive à la compensation, qui serait perçue comme un obstacle aux opérations d'aménagement ?
Aux États-Unis, la réglementation a été durcie suite à un rapport de la Cour des comptes de 2005 qui dénonçait le manque d'effectivité de la loi. La compensation est devenue plus coûteuse et plus efficace. Cela s'est accompagné de la création d'un nouveau secteur économique puissant de la restauration écologique. Ce secteur représente 125 000 emplois quand le charbon n'en représente que 80 000... Aujourd'hui, ce sont ces entreprises qui intentent des procès si les réglementations ne sont pas respectées ! Le renforcement de la réglementation environnementale a ainsi créé un développement économique endogène, avec une professionnalisation des acteurs.
La loi américaine sur la compensation a beaucoup évolué en trente ans. Le législateur américain a compris qu'il fallait définir un cadre juridique très précis pour tenir compte du vivant, tout en offrant des marges de souplesse pour s'adapter si une restauration n'était pas efficace ou pour faire face au changement climatique.
Sommes-nous à la veille d'un système cohérent ? La loi sur la biodiversité a élevé le niveau d'exigence, avec la non-substitution des trois étapes de la séquence « ERC », son caractère obligatoire, la notion d'équivalence écologique, l'exigence de résultat, la possibilité d'obtenir des garanties financières, le principe d'obligation réelle environnementale. Toutefois aucun indicateur n'a été défini. Les garanties financières restent facultatives. Il serait judicieux de les rendre obligatoires dans les sites naturels de compensation.
Le cadre actuel ne garantit pas que les grands projets d'équipement, qui ont des effets durables sur l'environnement, s'accompagnent de mesures de compensation pérennes. Il est possible de réaliser des plans de gestion sur une longue durée. C'est une avancée. Toutefois, alors que les lignes directrices de la démarche « ERC » prévoient la possibilité de faire des cessions, la loi sur la biodiversité est muette sur ce point. Si la loi américaine offre une marge de souplesse pour s'adapter, notre loi reste très rigide et n'indique pas comment faire si une mesure n'est pas efficace ou comment s'adapter si l'environnement évolue.
La loi fait mention d'aires de services dans les sites naturels de compensation pour que les mesures de compensation aient lieu dans la même zone que celle impactée. Quand il s'agit d'une zone humide, l'idée est de rester dans le même sous-bassin versant ; quand il s'agit d'une espèce protégée, il faut viser l'aire de répartition de la population. La loi évoque la « proximité fonctionnelle », mais sans préciser. La proximité géographique n'est pas toujours suffisante : cela n'a pas de sens de compenser en dehors du bassin versant dans le cas des zones humides.
La loi sur la biodiversité facilitera-t-elle la reconquête ? La biodiversité ordinaire n'est souvent pas compensée, car la compensation se concentre sur les milieux protégés ou les espèces protégées. Seuls les impacts résiduels significatifs sont pris en compte. La compensation ne vise qu'une petite partie de la biodiversité. C'est un outil d'équilibre, pas de reconquête. Pour reconquérir la biodiversité, d'autres actions sont nécessaires, comme la désartificialisation des sols.
La loi sur la biodiversité comporte des avancées positives comme l'obligation réelle environnementale, doublée d'une obligation réelle sur le foncier. Elle favorise une meilleure compréhension des enjeux du dilemme entre la rareté du foncier agricole et les besoins fonciers des aménagements. Elle contribue au développement d'une ingénierie écologique. Si la concurrence entre les cabinets d'études est bénéfique, elle peut aussi s'accompagner d'effets pervers, incitant les aménageurs à recourir aux cabinets les moins chers pour mettre en place une compensation à moindre coût. Les mêmes autorités administratives sont compétentes pour l'évitement et la restauration, d'une part, et la compensation d'autre part. Il faudrait séparer.
Cette loi met aussi en avant l'économie agricole non marchande, ce qui implique de revoir l'articulation entre production agricole et production environnementale. Quel cadre fiscal appliquer à une exploitation qui tirerait la plupart de ses revenus de la compensation ? Il importe que le législateur précise le cadre. Se pose aussi la question de la valeur des terres. Les opposants à la compensation affirment que la compensation ponctionne des terres agricoles. Les études en cours montrent plutôt que les terres soumises à compensation ne sont pas celles qui ont une valeur agronomique élevée.

Cela dépend où ! Si la région ne comporte que des terres riches, les compensations les affecteront nécessairement !
C'est exact, mais dans la mesure du possible, les agriculteurs ou les Safer essaient d'échanger pour faire en sorte que les premières terres impactées soient celles qui ont une valeur agronomique très faible.

Cela représenterait donc une plus-value pour ces terres de faible valeur agronomique. Ai-je bien compris ?
La compensation écologique existe depuis 1976, mais à l'époque l'objectif était plutôt de conserver des espèces rares ou des espaces remarquables. Depuis, nous avons fait du chemin. En 2016, notre conception de l'environnement est plus intégrée.
La loi pour la reconquête de la biodiversité contient des apports juridiquement intéressants, tels que les obligations réelles environnementales ou la séquence ERC qui viendra compléter le principe d'action préventive, mais nous pouvons encore progresser. Par exemple, des incertitudes demeurent pour l'équivalence écologique, qui ne repose sur aucune méthode scientifique.
Pour ce qui est des opérateurs de compensation, l'agrément de l'État ne sera finalement pas exigé. Par ailleurs, les exploitants agricoles et forestiers n'ont pas été inclus dans la boucle, alors qu'ils sont visés au premier chef.
Quant à l'obligation de résultat, je ne sais pas si elle est totalement compatible avec cette équivalence écologique à géométrie variable.
Enfin, la compensation par l'offre peut constituer une opportunité pour réaliser de beaux projets environnementaux si elle ne débouche pas sur de la compensation à bas coût. Toutefois, il ne faut pas sous-estimer les risques que représente la distance entre les lieux de compensation et ceux où sont menés les projets, ou encore la disparité entre les régions.
Nous sommes dans une démarche de progrès, car les premiers discours sur la compensation prononcés en 2008 lors de l'opération Cossure ont beaucoup évolué grâce aux retours d'expérience de nombreux chercheurs. Aujourd'hui, nous sommes mieux à même de renseigner et de dimensionner la compensation, de sorte que les aménageurs ne prononceront plus ce discours de la restauration intégrale d'un écosystème. À mes yeux, une bonne compensation est celle que l'on peut atteindre, y compris grâce à la réhabilitation.
D'un point de vue plus général, la compensation peut permettre une reconquête, mais elle n'est qu'un élément de la conservation de la nature avant les séquences « éviter » et « réduire ». S'il est actuellement impossible de restaurer un écosystème fortement dégradé, on peut très bien procéder à une réaffectation de celui-ci. Les écosystèmes pourraient être très intéressants à l'avenir en termes de biodiversité et de nouvelles fonctions. En l'espèce, l'incertitude est très importante, car on ne peut jamais prédire le résultat des dégradations. Or ces données sont essentielles pour se positionner par rapport aux aménageurs.
Nous voudrions systématiquement connaître la liste de l'ensemble des espèces présentes au sein d'un écosystème affecté, ainsi que toutes leurs fonctionnalités. Or cela est impossible du fait de la complexité de la nature, quelle que soit l'échelle à laquelle on l'appréhende. L'oubli d'une seule fonction risque d'entraîner des effets secondaires indésirables. Soyons toujours modestes concernant nos connaissances sur le vivant et sur nos capacités de restauration. Nous pouvons l'être un peu moins sur nos capacités de réhabilitation, qui doivent s'additionner aux mesures d'atténuation, d'évitement et de conservation.

Je pensais que la compensation visait à compenser ce qui avait disparu, avec l'application des principes d'équivalence et de proximité. Selon vos propos, Monsieur Dutoit, la compensation serait autre chose. De plus, en l'état de nos connaissances, l'intégralité ne serait jamais atteinte et toutes les fonctionnalités ne pourraient être rétablies. La restauration dans un lieu différent bat en brèche les principes de proximité et d'équivalence. Cela étant, j'apprécie votre franchise sur ce sujet, ce qui n'est pas toujours le cas de l'administration.
Le débat porte aussi sur le conflit d'intérêts entre ceux qui sont chargés de tout faire : éviter, réduire et compenser. Les acteurs de la compensation ne comprennent pas bien le sens des critères imposés. Un vrai travail de fond doit permettre de trouver des solutions appropriées. Je me réjouis des progrès réalisés, car nous avançons dans le bon sens. Mais ce processus pourrait être accéléré avec un système moins opaque, plus transparent. Cela éviterait certaines interventions malheureuses d'agents de l'État, aucunement soucieux d'éviter la dégradation de milieux naturels.
Il serait très souhaitable que la science et le droit nous donnent les moyens de mieux progresser sur ces questions.

Je souhaiterais revenir sur l'exemple pertinent évoqué par M. Pech. Des terres agricoles ou forestières permettraient de dégager un revenu supérieur à des terres productives grâce à une rémunération de la compensation et de tout ce qui figure dans le cahier des charges.
Certes, la nature évolue en permanence et nos connaissances s'affinent. Des certitudes actuelles pourraient demain être remises en cause. N'est-il pas dangereux d'extraire de la réalité ces territoires, dont la nature agricole pourrait se révéler bénéfique plus tard ? En outre, la compensation ne risque-t-elle pas d'être sujette à une marchandisation et à une course au mieux-disant ?
Enfin, la nature du sol et de la vie qu'il abrite évoluent avec l'environnement. Or les raisons qui motivent la compensation peuvent localement modifier les conditions climatiques et la nature du sol. Comment pouvons-nous appréhender ce processus ?

J'ai cru entendre parler d'expropriation à titre de compensation. Cette approche est-elle purement théorique ?
Les compensations plus modestes sur les propriétés forestières communales gérées selon les procédures PEFC (Programme européen des forêts certifiées) présentent l'avantage d'assurer la pérennité de l'entretien et du fonctionnement de ces sites. Elles évitent ainsi de se tourner vers des terres agricoles.
L'état initial d'un territoire qui fait l'objet d'une cartographie n'est plus le même lors de la mise en oeuvre du projet. Qu'en est-il du nouvel inventaire ?
Monsieur Levrel, je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous affirmez que la production importe peu, pourvu que le nombre d'emplois ne soit pas modifié. C'est dépouiller encore le monde rural du peu de richesses qu'il possède que d'aller créer des emplois dans les grandes villes à titre de compensation.
Mais non !

Tant qu'à faire, continuons de complexifier la situation : un paysan tirera-t-il ses revenus pour moitié de l'agriculture et pour l'autre moitié des bénéfices non commerciaux ? Cette solution provoquerait un bazar innommable, mais elle ferait vivre les Parisiens.
Enfin, qui décide du ratio de compensation, qui est de 1 pour 1 dans certains territoires, et de 16 pour 1 dans d'autres ? Quelle est la règle ? Où se trouve le curseur ? L'usage me paraît en totale contradiction avec le droit.

Avez-vous étudié d'autres sites de compensation par l'offre en dehors de la plaine de la Crau ? La compensation par l'offre pourrait-elle servir la biodiversité ordinaire ?
S'agissant des terres agricoles et des terres à valeur environnementale, il faut à tout prix anticiper.
En matière agricole, nous assistons à l'apparition des plans agricoles départementaux, qui permettent à la profession agricole et à l'administration d'envisager les évolutions futures en termes d'aménagement. Ce plan est idéal pour mettre en oeuvre des modifications à l'échelon des politiques locales, agricoles, urbaines ou d'aménagement sur une période de dix ans ou vingt ans, et pour déployer les moyens nécessaires pour respecter un certain nombre de principes.
La loi pour la reconquête de la biodiversité règle nombre de problèmes qui étaient mis en avant par les juristes, les économistes, les agronomes et les écologues. Maintenant, le curseur se situe chez les politiques. Que veut-on pour l'agriculture ou l'aménagement de demain ? Quels sont les arbitrages qui s'imposent ? Je n'ai pas la réponse.
Concernant les expropriations, je dispose seulement d'enquêtes réalisées par des étudiants de l'école d'agronomie de Rennes sur la ligne LGV Le Mans-Rennes et mentionnant l'expropriation. Mais je n'ai pas vraiment réussi à obtenir des informations précises en la matière. S'agit-il de procédures d'expropriation ou de réorganisations foncières ?
Si, mais je ne m'interroge à ce sujet.
Je voudrais évoquer les conventions conclues avec les agriculteurs, et plus généralement, le recours croissant à la gestion conservatoire, système alternatif à l'acquisition du foncier et à la restauration de sites dégradés.
En réalité, le problème avec la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux est de trouver des terres à restaurer qui vaudront compensation. D'où le conventionnement avec les agriculteurs. Je ne suis pas contre cette pratique, mais elle risque de se généraliser, car elle est moins coûteuse, permet de surmonter le problème du foncier et suscite davantage l'adhésion locale, contrairement à l'achat du foncier qui pose problème.
Ce qui m'inquiète un peu avec ce type de démarche, c'est l'additionnalité. Dans l'absolu, l'artificialisation ou la fragmentation d'un sol avec une ligne à grande vitesse doit s'accompagner d'une action de compensation en vue de la désartificialisation. Or ce n'est pas le cas avec le conventionnement, qui peut être prévu avec les agriculteurs ou les forestiers pour compenser des impacts définitifs sur le sol. Quant aux éoliennes, ce sont des concessions de trente ans qui doivent à terme être retirées, à moins que le contrat soit renégocié. Dans ce cas, la question de l'additionnalité est vraiment discutable. D'ailleurs, l'incapacité à atteindre l'absence de perte nette de biodiversité en France s'explique par tous ces accords, ces arrangements locaux qui prennent des formes très différentes et valent compensation.
Cette dérive, il faut en avoir conscience pour mieux l'appréhender. Il convient à mon avis d'accorder plus de moyens aux administrations qui travailleront sur ce sujet. De plus en plus d'associations y passent une partie de leurs journées. C'est aussi le cas des DREAL au détriment d'autres actions. Si l'on compte financer ces besoins à moyens constants, on observera inévitablement une baisse de la qualité des actions menées.
Les marchés font-ils l'objet d'une marchandisation ?
Le cadre américain est extrêmement strict, car les frontières géographiques correspondent à des frontières écologiques. Pour les zones humides, les limites sont fixées par le périmètre des sous-bassins versants. De la même manière, des crédits de compensation sont vendus en fonction des observations effectuées sur le site et liées à la restauration écologique, aux différentes espèces et fonctionnalités, au suivi écologique des différentes composantes de la biodiversité.
À ma connaissance, c'est le premier marché qui est contraint par des limites spatiales et temporelles qui sont de nature écologique. Si les Américains ont réussi cela, c'est parce que le marché est au service d'une réglementation. Bien sûr, certains acteurs gagnent de l'argent si leur investissement produit les effets escomptés, car ce secteur est plutôt bénéficiaire. En revanche, si les résultats ne sont pas au rendez-vous, ils perdent tout !
Ce qui me paraît intéressant dans ce système, c'est que la nature ne supporte plus les risques financiers liés aux mesures compensatoires insuffisamment bordées. Pour illustrer mon propos, je citerai l'échec de la compensation en faveur de Port 2000. Un travail ambitieux de reméandrage valant compensation n'a pas fonctionné en dépit de l'exigence d'un conseil scientifique et de l'investissement de plusieurs dizaines de millions d'euros. Au final, c'est la nature qui a perdu. Dans le système d'investissement préalable, si le projet n'aboutit pas, les crédits de compensation ne sont pas octroyés et la compensation ne peut avoir lieu.
La financiarisation n'existe pas avec les marchés de compensation en l'absence de titrisation. L'achat d'un crédit de compensation n'est possible que si l'on génère un impact. En l'espèce, le marché secondaire n'existe pas, contrairement au marché carbone qui a donné lieu à des dérives importantes.
Quant à la création d'emplois en ville, je veux bien entendre cet argument, mais il ne faut pas se leurrer : la disparition de l'emploi dans les campagnes est liée à la révolution verte et non aux compensations. C'est l'agriculture moderne qui est à l'origine de la disparition de la population dans les zones rurales.
S'agissant du risque de marchandisation, tout le système repose sur le cadre réglementaire destiné à encadrer la compensation par l'offre. En la matière, les Américains ont essuyé les plâtres depuis trente ans et proposé des mesures intéressantes. Ils utilisent désormais des méthodologies d'évaluation de l'équivalence écologique partagées pour mesurer l'impact et la compensation. On peut parler d'échange d'unités. En France, des méthodes d'évaluation nationale sont en cours de développement. Ces orientations sont très positives.
De plus, aux États-Unis, les servitudes environnementales qui protègent les terrains de compensations sont perpétuelles. Évidemment, l'immunité perpétuelle pourrait être discutable, mais des engagements en faveur des enjeux environnementaux ont été pris par les propriétaires. En France, la situation n'est pas envisagée de la même façon.
Enfin, les comportements opportunistes ne peuvent perdurer dans le système américain, car les unités de compensation ne sont pas toutes disponibles à la vente dès le début de l'opération. Les crédits sont mis en vente progressivement selon le degré d'atteinte des objectifs. Par conséquent, certaines personnes qui investissent dans des banques de compensation ne pourront vendre une partie de leurs crédits qu'au bout de cinq ou dix ans en fonction du temps de restauration de l'écosystème. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'application de la compensation par l'offre ne nous semble pas appropriée à certains milieux, notamment en Floride, où la restauration des zones humides prendra une dizaine d'années. En définitive, le risque de marchandisation existe si l'on ne se réfère à aucune règle. Mais avec un cadre réglementaire bien détaillé, les contraintes seront fortes sur ceux qui mettent en place ces sites naturels de compensation. Il est intéressant de regarder ce qui a été fait à l'étranger avant de se lancer dans l'aventure.
Monsieur Trillard, vous avez évoqué la possibilité de réaliser de petites compensations à partir de plans de gestion des propriétés forestières. Il faut évidemment être très attentif au respect d'un principe d'additionnalité dans les mesures de compensation. Celles-ci ne peuvent pas remplacer des actions déjà prévues et déjà financées. La compensation doit véritablement apporter une plus-value.

À cet égard, la commune dont je suis le maire connaît un problème de zones humides qui est plutôt dissuasif. Au reste, la dénomination « zones humides » recouvre tellement de variétés que l'on ne sait plus sur quelle partie du territoire on se trouve en zone humide...
Dans le cadre d'une amélioration de l'environnement et des conditions de vie des habitants, on a récemment créé une forêt communale et obtenu la suppression de la ligne à moyenne tension qui desservait l'agglomération.
La zone humide et la forêt ne sont séparées que de 300 mètres. Sur la durée, la garantie est totale. Il y a une trame et un classement « espaces boisés classés » dans le plan local d'urbanisme (PLU). Il n'est donc pas question de faire n'importe quoi. Ensuite, le préfet a déclaré la forêt communale et a transmis la gestion à l'Office national des forêts (ONF). La forêt est aussi labellisée PEFC.
Les petits travaux dans des zones déclarées humides sont de nature à créer des problèmes. Pourtant, l'administration avait incité les maires à établir le plan de leurs zones humides, leur garantissant que cela n'aura aucune influence en matière d'urbanisme !
Les compensations ne peuvent pas être extraordinaires, mais on doit quand même respecter une cohérence. Cela dit, je suis bien conscient que le cas de ma commune n'est pas celui de la Crau !
Dans ce cas particulier, la plus-value écologique que la gestion de cette forêt pourrait apporter devrait être évaluée.
Plus généralement, je voulais insister sur le principe d'additionnalité. S'il n'apparaît pas directement dans la loi, ce principe est vraiment fondamental pour que l'argent de la compensation ne se substitue pas à de l'argent qui était normalement dédié à des mesures de conservation et de gestion de la biodiversité.
Monsieur Trillard, j'ai dû mal m'exprimer lorsque j'ai évoqué l'état initial. Je ne parlais pas de l'état initial qui figure dans les études d'impact ou les diagnostics environnementaux qui doivent être réalisés pour chaque projet. Je souhaitais plutôt évoquer la façon dont les services instructeurs, à une échelle donnée, vont instruire la séquence « éviter-réduire-compenser » (ERC). Celle-ci est-elle effectivement réalisée ? Est-elle déjà effective ? Quels en sont les résultats ? Y a-t-il un bon suivi ? Comment le contrôle est-il exercé ? Les agents vont-ils sur le terrain ? J'avais en tête ces petites enquêtes à l'échelle locale pour étudier l'application réelle et le réalisme de la séquence ERC en France, en partant d'un exemple.
Madame Jouanno, effectivement, si la biodiversité ordinaire n'est pas directement protégée, ce que prend en compte l'étude d'impact - l'ensemble des milieux, le sol, les continuités écologiques - est vraiment très large. Par ce biais, il arrive que des zones de biodiversité ordinaire soient prises en compte pour dimensionner des mesures de compensation. Quand on s'intéresse à une espèce protégée, quand on restaure un milieu, tout un cortège d'espèces, relevant parfois de la biodiversité ordinaire, est aussi pris en compte. Dire que la biodiversité ordinaire n'est pas prise en compte était donc un peu schématique.
Je ne suis pas sûre que la biodiversité ordinaire soit prise en compte plus ou moins fortement selon que l'on compense par la demande ou par l'offre.
Pour ce qui concerne l'implication des acteurs agricoles dans les compensations écologiques, j'ai eu l'occasion de réaliser une étude, en partenariat avec les chambres d'agriculture de Picardie, sur la perception qu'avaient les agriculteurs de la mise en place de mesures de compensation sur les terres qu'ils cultivent. De façon générale, les agriculteurs n'étaient pas partants pour mettre en place ces mesures, mais quelques-uns l'étaient. Nous avons pu déterminer que, dans les raisons de l'acceptation ou du refus, la durée était l'un des facteurs les plus importants. Ce n'est pas très étonnant quand on sait que le taux de fermage atteint presque 60 % en France. Les agriculteurs ne vont pas forcément pouvoir s'engager sur des mesures compensatoires très longues. Cela nécessite de penser une articulation.
Dans ces conditions, l'obligation environnementale réelle peut être intéressante, à condition, bien évidemment, comme cela est indiqué dans la loi, que le preneur à bail et le propriétaire se soient mis d'accord et que, sur ce terrain, les producteurs successifs puissent conserver ce plan de gestion des compensations.
Je souhaite éclairer le débat avec l'expérience américaine. Aux États-Unis, les agriculteurs sont bien plus souvent propriétaires des terrains. Nous avons pu constater que, dans la plupart des banques de compensation de Floride, les opérateurs de compensation sont d'anciens producteurs agricoles, qui ont changé de métier. Cela dit, les échelles sont totalement différentes et la culture n'est pas la même.
Je veux revenir sur la prise en compte de la nature ordinaire dans les processus de compensation. C'est une nécessité.
En effet, la nature ordinaire est beaucoup plus impactée que la nature extraordinaire par les aménagements. Or, par définition, la nature ordinaire, par opposition à la nature extraordinaire, n'a pas, a priori, de valeur patrimoniale, que ce soit en termes d'espèces, d'habitats ou encore de paysages. En revanche, elle remplit de nombreuses fonctions et peut rendre de nombreux services écosystémiques.
La nature ordinaire voit son importance de plus en plus reconnue dans le cadre des politiques de trame verte, de trame bleue. Les haies, les bandes herbacées ou les rivières peuvent être restaurées, non pas à des fins de restauration de la biodiversité, mais compte tenu de leurs fonctionnalités. La prise en compte spécifique de la nature ordinaire dans les processus de compensation doit passer par l'angle des services, et non par celui de la biodiversité. Ce point me paraît très important.
Cependant, les échelles rendent la prise en compte de la nature ordinaire compliquée. Pour qu'un système de haies ou de bande herbeuse soit efficace, il faut raisonner non pas en mètres carrés ou en centaines de mètres carrés, mais en maillage.
J'attire notamment votre attention sur le fait que, sur le site de Cossure, dans la plaine de la Crau, on réfléchit actuellement à prendre en compte la nature ordinaire du fait de la difficulté de vendre des unités de biodiversité.
Monsieur Gremillet, vous avez attiré mon attention sur les sols. Effectivement, les sols posent un problème en termes de restauration. Les sols, dans les écosystèmes, sont souvent considérés comme des boîtes noires : on regarde ce qui rentre et ce qui sort, mais on oublie de regarder ce qu'il y a dedans, à savoir, en l'espèce, la biodiversité « obscure ».
Il est de nombreuses espèces et de nombreux groupes d'espèces que l'on ne sait pas reconnaître, comme les champignons ou les algues. Par ailleurs, la plupart des sols ont mis plusieurs dizaines de milliers d'années à se former. C'est le cas des sols les plus évolués. Quelquefois, la restauration d'un écosystème peut consister à « dégrader » le potentiel agronomique d'un sol, qui a été acquis par des générations d'agriculteurs. On peut agir en retournant des sols qui ont été trop fertilisés par de nombreux apports d'azote chimique pour remettre en surface l'horizon minéral - le plus pauvre et le plus propice à une certaine biodiversité. La restauration des sols peut s'opposer à ce qui a été décidé au nom du génie agronomique pendant des centaines d'années.
J'ai eu l'occasion de travailler sur les calculs des ratios de compensation. J'ai connu trois étapes.
On a d'abord souhaité, au début de l'opération Cossure, consigner la fonction dans l'écosystème de chaque espèce - le moindre coléoptère, la moindre sauterelle... Nous en étions bien évidemment incapables ! On a donc très rapidement décidé de ne pas calculer les ratios de compensation espèce par espèce, fonction de chaque espèce par fonction de chaque espèce, habitat par habitat. Il est ressorti des négociations sur les ratios de compensation un compromis entre les capacités de l'aménageur, l'autorité de l'État en matière environnementale et la pression des associations de conservation de la nature. Un projet prévoyait une restauration de l'ordre de 10 à 15 hectares compensés par hectare détruit. Cela n'a jamais été appliqué, sauf dans le cas spécifique la pollution aux hydrocarbures par SPSE. Les derniers projets de compensation reposent sur des ratios de 1 hectare compensé pour 1 hectare détruit, voire de 1 pour 0,5. Au demeurant, ces ratios reflètent davantage la conjoncture économique que de réels calculs d'équivalence écologique.
Il est très difficile de mesurer l'équivalence écologique dès lors que l'on ne connaît pas l'ensemble du catalogue des espèces. Cependant, un travail important de bio-indication est réalisé actuellement pour mettre au point un outil d'estimation de cette équivalence. Toutefois, en matière d'écologie, l'oubli d'un paramètre peut avoir des effets secondaires terribles. On travaille beaucoup sur des indicateurs d'équivalence et sur des indicateurs de succès de la restauration.

Je vous remercie de vos explications.
Nous avons entendu parler, lors d'une précédente audition, d'un ratio de 16 hectares compensés pour 1 hectare impacté. Peut-on considérer que ce ratio n'existe plus aujourd'hui ?
Personnellement, je ne l'ai jamais vu mis en oeuvre.
Oui.

Les discussions qui devront avoir lieu sur les zones humides m'inquiètent fortement. L'expression de « zone humide » ne veut rien dire tant que l'on n'a pas expertisé précisément la zone ! Les cartographies ont souvent été faites depuis le volant des voitures.

L'impact du politique sur l'agriculture et sur l'espace est bien plus faible qu'on peut l'imaginer. En revanche, l'impact de la science est phénoménal.
Voilà un demi-siècle, dans le département des Vosges que je connais bien, les terres dont le revenu cadastral était le plus élevé étaient les vieilles terres de prairie naturelle. Aujourd'hui, la science ayant fait des progrès, ce n'est pas sur ces terres que le revenu agricole par hectare est le meilleur.
Tout va très vite et continuera à aller vite. Voyez ce qu'était la Champagne pouilleuse il y a cinquante ans et ce qu'elle est aujourd'hui !
Faut-il considérer les terres en compensation comme des biens publics ? Doivent-elles être sanctuarisées ? Ce choix aurait des conséquences lourdes.
Dans l'absolu, non, toutes les terres en compensation ne seront pas des biens publics. Quand on pérennise des mesures de compensation sur des terres, parce que l'emprise a causé des problèmes tels que la compensation devrait durer ad vitam aeternam, leur propriétaire en est dépossédé. Quand de l'argent est versé pour protéger ces terres, la nature de la parcelle n'appartient plus au propriétaire. Cela devient un bien public.
Quand les contrats portent sur de très longues durées ou sont à vie, comme ils peuvent l'être aux États-Unis, il est évidemment hors de question que le propriétaire récupère le bien et en dispose à sa guise, alors que l'on a passé des années à y cultiver d'une certaine façon pour compenser je ne sais quelle emprise. Ces cas devraient rester marginaux, mais ils peuvent exister.

Dans un demi-siècle, il y aura peut-être un nouveau projet qui pourrait amener à impacter de nouveau les terres.

En permanence, l'Homme façonne les territoires. On ne sait pas ce qui va se passer dans un demi-siècle ni même dans vingt siècles. C'est pour cela que j'ai évoqué une possible sanctuarisation.

Je reviens sur la propriété perpétuelle. Il n'y a que le domaine public qui soit inaliénable. Il faudrait que l'État intègre ces espaces dans son domaine. Les terres acquises par le Conservatoire du littoral ne sont pas inaliénables : le conseil d'administration peut en décider autrement, à la majorité des deux tiers, sauf décret en Conseil d'État défavorable. En principe, en droit civil, la durée maximale d'un bail est de quatre-vingt-dix-neuf ans.
Vous avez presque tous estimé que la loi prévoyait de nombreux outils. Mais, dans notre pays, le règlement a également une part très importante - je dirais même plus importante.
Sur la base des éléments qui sont aujourd'hui à votre connaissance, avez-vous l'impression qu'il manque des outils de nature législative en matière de biodiversité ? Les circulaires sur le littoral qui paraissent régulièrement permettent de mieux comprendre l'interprétation que l'administration fait de la loi. Pensez-vous que l'administration doive procéder de la sorte pour faire connaître sa doctrine administrative en ce domaine ? Si oui, pouvez-vous nous indiquer les orientations qui vous paraissent souhaitables ?
L'indépendance de l'autorité environnementale, notamment des nouvelles autorités régionales, est un point important. De fait, dans l'histoire récente des mesures compensatoires découlant des grands projets, le préfet doit assumer à la fois un aménagement et une exigence environnementale. Ce n'est pas tenable, d'autant que les enjeux politiques, économiques et sociaux de l'aménagement dépassent, in fine, les enjeux environnementaux, ce qui est bien normal. Cette situation ne peut plus durer.
Aux États-Unis a été créée une organisation, l'Interagency review team (IRT). Ce groupement d'acteurs, chargé de défendre l'intérêt public relatif aux questions environnementales, bénéficie d'un budget dédié. Ses moyens sont prélevés sur les budgets de fonctionnement des études d'impact. L'IRT valide les sites naturels de compensation, sur la base de critères exigeants, ainsi que les évaluations, les suivis, les équivalences. Elle intervient à un moment clé de la validation.
Je ne vois pas bien ce qui est prévu, en France, pour gérer ce besoin, qui semble important.
Le droit n'est pas ma discipline, mais le besoin de régulation juridique me paraît net si émerge un nouveau marché de compensation d'unités de biodiversité. Je vais essayer de l'illustrer très concrètement.
Actuellement, sur l'opération Cossure, une unité de biodiversité coûte 50 000 euros l'hectare TTC. Ce montant tient compte de notre capacité à avoir su réhabiliter une fonction de l'écosystème, qui est l'accueil des oiseaux steppiques.
Le décès d'un grand propriétaire de la plaine de la Crau a récemment libéré 900 hectares sur le marché. Chacun de ces hectares coûte 5 000 euros, éligibles au titre de la compensation ex post. Un aménageur qui a 50 000 euros à dépenser achètera, plutôt qu'un hectare sur le site de Cossure, 10 hectares de ces milieux steppiques dont l'intégrité est préservée, ce qui lui permettra d'agir sur une grande surface. Il sera soutenu par les gestionnaires d'espaces naturels.
Une régulation est nécessaire pour que l'aménageur qui s'est investi dans une compensation par l'offre puisse voir son projet aboutir.
Une régulation permettrait aux investisseurs de savoir où ils vont dans un contexte caractérisé par un marché très mouvant, des ratios de compensation qui vont en diminuant et une concurrence entre compensation par l'offre et compensation ex post. Il faut définir des règles pour éviter une compensation au moins-disant, ce qui serait vraiment une dérive terrible.
Monsieur Bignon, on a quand même, en matière de politique agro-environnementale et environnementale, des exemples, en France, d'échelons territoriaux, régionaux et locaux qui ont la main pour affiner des politiques décidées au niveau européen ou au niveau national.
Compte tenu des arbitrages qui devraient avoir lieu, notamment entre paiements pour services environnementaux (PSE), compensations et agro-environnement, ces échelons, sur la base de cahiers des charges ou de comités de pilotage locaux ou régionaux, pourraient affiner et rendre plus cohérentes l'ensemble de ces politiques.

Je vous remercie de vos interventions, qui éclairent encore davantage le débat. On voit bien que l'exemple américain inspire aujourd'hui beaucoup de personnes en France. Avez-vous regardé ce qui se passe ailleurs ?
Aujourd'hui, l'agriculture allemande est passée devant l'agriculture française, parce qu'elle a intégré les revenus énergétiques, non agricoles. Les services écosystémiques et de biodiversité commencent-ils aujourd'hui à entrer dans le modèle de l'agriculture allemande ?
On a découvert récemment qu'une offre de compensation agricole existait en Allemagne. La difficulté est que cette compensation agricole n'a pas été valorisée. Elle n'a pas fait l'objet de communication à l'échelle internationale. Claire Pellegrin prépare une thèse sur ce sujet. Je n'en ai pas encore les résultats. Les documents dont nous disposons étant en allemand, nous avons besoin de temps pour accéder à leur contenu.

L'agriculture allemande est très dynamique aujourd'hui. Sa grande force est de raisonner en termes de diversification des ressources.

En Allemagne, les panneaux solaires sont toujours couplés à la biomasse.
En France, on commence toujours par équiper les bâtiments les plus industrialisés. Ce n'est pas forcément ce qu'il faudrait faire. Au reste, ce n'est pas un mouvement global : seuls ceux qui ont déjà de l'argent s'y engagent.

Pouvez-vous nous fournir des liens qui nous permettraient de voir comment l'agriculture allemande se positionne aujourd'hui ?
Ma dernière question a trait aux prix. On en parle peu, mais cette dimension est assez centrale.
Au-delà du chiffre de 50 000 euros par hectare à Cossure, on sait que la Caisse des dépôts et consignations (CDC) réhabilite aujourd'hui un mètre carré pour 5 euros investis. D'ailleurs, la CDC n'est pas qu'un opérateur de compensation. Sa vision des choses me paraît beaucoup plus large.
Avez-vous d'autres indications de prix ? En particulier, à quel prix se chiffrent les expériences réussies de restauration de zones humides ? Ce point est très important pour nous.
De même, pour le monde agricole, on nous a parlé d'un coût entre 1 000 et 2 000 euros par hectare en gestion, intégrant des enjeux de biodiversité. Avez-vous des fourchettes de prix à nous communiquer ?
On voit bien que les modèles économiques iront à un moment vers l'évitement, parce que cela coûtera moins cher de faire des projets moins consommateurs d'espace.
Je vais vous faire une réponse d'écologue : tout dépend du niveau de dégradation et du niveau de restauration.
Dans le cas de la Crau, les opérations de restauration les plus lourdes ont consisté à retirer ou à retourner le sol pour éviter les résidus de pesticides ou d'engrais. Leur coût s'élèvera à quelque 20 000 euros par hectare, hors acquisition du terrain.
Dans le cas des semis d'espèce nurses, basés sur l'ingénierie écologique, le coût descendra aux alentours de 1 000 euros par hectare. Toutefois, le résultat sera très différent.
Grosso modo, plus l'intervention est lourde, plus on va intervenir sur le système, sur la partie abiotique, sur l'habitat, plus le coût sera élevé, mais plus on aura des résultats rapides, sans pour autant que ces derniers soient garantis sur le long terme. Plus les interventions reposent sur le génie écologique plutôt que sur le génie civil, moins ces interventions seront chères, mais moins le résultat sera rapide, tout en ayant le même questionnement sur leur durée de vie à long terme.
Il est donc très difficile de répondre à la question des coûts. Oui, on peut communiquer des fourchettes, mais les amplitudes sont extrêmement fortes.

Nous souhaiterions au moins pouvoir disposer des chiffres concernant les projets que vous connaissez, en zones humides ou autres.
En Floride, en prenant tout en compte - l'achat du foncier, la restauration et les fonds mobilisés pour la pérennisation -, on aboutit à un coût moyen d'environ 100 000 euros par hectare. Cette moyenne cache évidemment une forte variabilité.
Dans le New Jersey, où la densité de population est davantage comparable à la nôtre, puisqu'elle s'élève à quelque 300 habitants par kilomètre carré, comme la majorité des actions de restauration concernent des friches industrielles - c'est pour moi un bon exemple, parce qu'il y a une vraie désartificialisation -, le coût grimpe à 300 000 dollars par hectare. On voit évidemment les effets incitatifs d'un tel prix sur l'évitement et la réduction.
Voyez aussi le coût d'acquisition du foncier : à Cossure, les terres ont été acquises sur un verger fonctionnel et non une friche agricole, soit 4 millions d'euros pour 400 hectares. Ce coût élevé d'acquisition a augmenté d'autant les coûts de la compensation.
Le prix des unités de compensation augmente. Aux États-Unis, tout est négocié entre les services de l'État et les opérateurs de la compensation, mais l'État ne participe pas à la fixation du prix d'échange des unités entre les opérateurs et les aménageurs. Le décret actuel sur la compensation, qui a été porté à notre consultation, n'indique pas si l'État a un droit de regard sur le prix ni comment ce dernier sera fixé.
En Bretagne et en Limousin, la valeur des services écosystémiques dans les zones humides s'échelonne entre 800 et 1 500 euros par hectare.

C'est le coût de la prestation de l'agriculteur pour maintenir la zone humide ?
Oui, le coût du service que rémunère le demandeur, par exemple la collectivité locale...

Je vous remercie. N'hésitez pas à nous transmettre des exemples réussis de restauration de zones humides en France ou en Europe.
Il y a quelques mois, la Direction générale de l'environnement de la Commission européenne a publié une étude sur la séquence éviter-réduire-compenser (ERC) en Europe, comprenant des exemples de prix de la restauration, notamment en France et en Allemagne. Peu de chiffres sont disponibles pour la France, mais en région PACA, le coût de la restauration de la séquence ERC s'élève en moyenne à 5 % du budget total, mais voire de 0,17 à 25 %. En Allemagne, le coût moyen de la restauration - et non seulement de zones humides - varie de 20 000 à 60 000 euros par hectare, et atteint parfois plus de 100 000 euros. Cette étude est disponible en ligne.
Les décrets d'application pourraient être utilement complétés : le décret sur les sites naturels de compensation ne mentionne pas ce que deviendront ces sites de compensation à long terme, une fois la durée de la compensation terminée. Il faudrait pouvoir conserver le contact du maître d'ouvrage et de toutes les personnes ayant acheté des unités de compensation, qui restent responsables de la compensation si celle-ci est inefficace. Il n'existe pas non plus de règles sur la libération d'unités de compensation. Aux États-Unis, il n'est pas possible de vendre des unités de compensation dès le début. Il faudrait aussi mentionner dans le décret comment fonctionne cette libération progressive des unités, et préciser la gestion adaptative de restaurations à long terme : si la restauration est insuffisante ou en cas de force majeure, que devient le site naturel de compensation ? Enfin, un décret précise des choses sur l'agrément des sites naturels de compensation, mais il manque un décret socle commun sur la compensation, notamment pour préciser l'équivalence, la proximité et autres choses afin de traiter la compensation par la demande, cas le plus fréquent. Or cette compensation par la demande restera complémentaire des futurs sites naturels de compensation, même après leur développement.
Aux États-Unis, certains acteurs, comme les banques de compensation, qui réalisaient ces sites naturels de compensation étaient suspectés, à juste titre, de vouloir gagner de l'argent sur la nature ; un système de contrôle très fort a donc été mis en place. C'est seulement dans un deuxième temps qu'il en a été fait de même pour la compensation par la demande. Évitons cela en France et nivelons tout vers le haut.
Un rapport du Commissariat général au développement durable (CGDD) sera publié en janvier prochain.

Serait-il possible d'instaurer un système assuranciel souscrit par le maître d'ouvrage ou de garantie ? Personne ne peut garantir que le maître d'ouvrage sera encore là soixante ans après, au contraire de l'assureur. Cela fonctionne bien pour les carrières, les éoliennes, les installations classées.
Dans le droit actuel, un transfert de la dérogation à la stricte protection des espèces protégées est possible en cas de transfert d'activité. Par exemple, la Société du Grand Paris a une durée de vie limitée, elle construit le réseau. Une fois le réseau installé, un autre acteur, déjà identifié, prend le relais. Mais il faudrait clarifier les choses pour les petits projets comme les ZAC. À titre de comparaison, aux États-Unis, la responsabilité de la réussite de la compensation est transférée de l'aménageur à la personne tenant la banque de compensation. En France, on craint un risque de déresponsabilisation de l'aménageur achetant son crédit qui peut disparaître le lendemain. La réussite de la mesure tient à la personne tenant la banque de compensation, même si juridiquement, c'est plus complexe que cela.

Merci pour cette audition extrêmement instructive. N'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels compléments par écrit.
Audition des représentants de la fondation nicolas hulot pour la nature et l'homme fnh humanité et biodiversité la ligue pour la protection des oiseaux lpo world wildlife fund wwf union internationale pour la conservation de la nature uicn et france nature environnement fne
Audition des représentants de la fondation nicolas hulot pour la nature et l'homme fnh humanité et biodiversité la ligue pour la protection des oiseaux lpo world wildlife fund wwf union internationale pour la conservation de la nature uicn et france nature environnement fne

Nous recevons des représentants d'associations environnementales. Notre commission d'enquête sur la réalité des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité engagées sur des grands projets d'infrastructures ne s'intéresse pas uniquement à la compensation mais à toute la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC). Et si nous nous focalisons sur quatre grands projets, nous nous intéressons à l'effectivité et à l'efficacité des mesures de compensation partout ailleurs. M. Jean-David Abel, vice-président du réseau juridique de France Nature Environnement (FNE), est accompagné de M. Romain Écorchard, membre du réseau juridique de FNE. M. Pierre-Henry Gouyon est le président du conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme (FNH). M. Bernard Chevassus-au-Louis, président d'Humanité et biodiversité, est accompagné de M. Bernard Labat, chargé de mission sur le droit et l'économie. Mme Dominique Aribert est la directrice du pôle « conservation de la nature » de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO). M. Sébastien Moncorps est le directeur du comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Et Mme Christine Sourd, directrice adjointe des programmes chez WWF, remplace Mme Diane Simiu, qui n'a pas pu nous rejoindre.
Cette réunion est ouverte au public et à la presse et fera l'objet d'une captation vidéo, retransmise en direct sur le site internet du Sénat ; un compte rendu en sera publié.
Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, M. Jean-David Abel, M Romain Ecorchard, M. Pierre-Henry Gouyon, M. Bernard Chevassus-au-Louis, Mme Dominique Aribert, M. Sébastien Moncorps et Mme Christine Sourd prêtent successivement serment.
Avez-vous des liens d'intérêts avec les quatre projets que nous étudierons ?
La LPO a une convention d'expertise avec Cosea et Lisea sur les mesures compensatoires de la ligne à grande vitesse (LGV) Tours-Bordeaux.
Je suis salarié d'une association qui a déposé plusieurs recours contre le projet d'aéroport à Notre-Dame des Landes.

Sans répondre à toutes les questions que nous vous avons adressées, pouvez-vous nous présenter les points saillants qu'elles soulèvent, selon vous ?
La mesure de la biodiversité en France et de son évolution au cours de la dernière décennie doit être objective. Au-delà des inventaires réalisés par le Muséum national d'histoire naturelle, les grands indicateurs de la stratégie nationale que sont la fragmentation, l'usage de pesticides ou le nombre d'oiseaux sont tous au rouge, plus ou moins foncé. La fragmentation, par exemple, va croissant, en mailles de plus en plus petites et de moins en moins connectées. Parler de compensation sans évoquer la dynamique ERC est problématique.
La compensation est un concept ancien qui, bien qu'ayant fait l'objet d'améliorations successives, demeure un pis-aller. D'une part, on ne sait pas restaurer à l'identique un milieu. D'autre part, la restauration s'effectuant la plupart du temps sur une surface qui possède déjà sa propre biodiversité, celle-ci doit avoir été mesurée au départ pour éviter des pertes trop importantes. Recréer ex nihilo de la biodiversité n'est pas possible. Au total, il y a toujours une perte importante. Certains projets sont compensés sur des zones déjà protégées ou repérées. Dans le sud-est, les mesures de compensation décidées pour des projets lancés dans les années 1980 ou 1990 ne sont souvent mises en oeuvre que partiellement, voire pas du tout, et nos alertes sur ce point sont ignorées par les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). Deux autres problèmes de fond doivent être soulevés. Alors que la mise en oeuvre des séquences éviter et réduire suffirait souvent, les enjeux économiques priment et l'on renonce à cantonner un projet sur un secteur moins sensible. Cela nous conduit à l'autre problème de fond : l'instance qui autorise est aussi celle qui évalue.
Jeune juriste d'une association de protection de la nature et originaire de Nantes, j'ai travaillé sur le projet d'aéroport à Notre-Dame des Landes. L'addition de petits projets peut être aussi désastreuse qu'un seul grand projet - et ce, qu'ils soient menés par des autorités publiques ou par des acteurs privés. Le dispositif juridique organisant la compensation est dispersé entre plusieurs lois pas toujours cohérentes entre elles ; en tous cas, il n'est pas aisé à comprendre, ce qui nuit à son efficacité comme à celle des contrôles qu'il prévoit. Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévoient des dispositifs précis de compensation. Le contrôle administratif et judiciaire s'en trouve facilité. Inversement, là où l'on s'en tient à de grands principes, le contrôle ne peut être que très lâche. Nous plaidons pour une législation simple, claire et stable.
La biodiversité se porte bien quand on s'en occupe sérieusement. Ainsi, le nombre d'oiseaux communs dans les milieux agricoles a régressé de 40 %, alors que celui des oiseaux protégés ayant fait l'objet de plans de restauration a crû de 20 %. Et le nombre d'espèces de poissons en aval de Paris est passé de 3 à 30 depuis 1964 grâce aux politiques de l'eau. Qu'il s'agisse d'oiseaux, de chauves-souris ou de papillons diurnes, il faut des politiques dédiées.
Nous devons hiérarchiser les facteurs d'érosion de la biodiversité. Chaque année, environ 15 000 hectares sont artificialisés. Les trois quarts de cette transformation résultent de l'urbanisation, et 20 % de la création de zones industrielles et commerciales. Les grandes infrastructures de transport ne représentent quant à elles que 2 000 hectares par an. Dans le même temps, 100 000 hectares de prairies sont retournés chaque année. Ne nous trompons pas de cible et prêtons attention à tous les usages des terrains. Or, tous ne sont pas visés par les mesures de compensation.
Même si la compensation existe depuis 1976, ce n'est qu'en 2016 que la loi a supprimé les mots « si possible » pour exiger l'absence de perte nette. Cette obligation de résultat est bien tardive, et résulte surtout des directives européennes.
Le verbe « éviter » est ambigu. Il peut aussi bien signifier « ne pas faire » que « faire en évitant l'impact ». Il faudrait un encadrement juridique plus clair, car on voit bien à Notre-Dame-des-Landes que les contre-expertises effectuées à la demande du Gouvernement se font selon des procédures décidées au cas par cas, et parfois contradictoires entre elles. La séquence éviter est beaucoup moins transparente que les suivantes.
Le critère de proximité géographique est intéressant, mais doit être nuancé selon que le lieu retenu relève, ou non, d'un schéma directeur. De plus, l'équivalence écologique ne suffit pas, il faut veiller à une compensation sociale en compensant de préférence à proximité de personnes ayant perdu l'accès à la biodiversité.
Je ne suis pas hostile à la compensation par augmentation du statut de protection d'un espace, même si ce n'est pas vraiment de la compensation. Quant à la compensation par l'offre, pourquoi pas ? Mais il faut bien distinguer les métiers. L'ordonnateur ne doit pas être le maître d'ouvrage, dont la responsabilité ne peut être transférée. C'est au maître d'ouvrage de garantir l'effectivité de la compensation, qu'il la réalise lui-même ou via un opérateur. Il doit bénéficier d'une assurance-qualité. Et un contrôleur doit s'assurer que la compensation est effective et durable.
Actuellement, le recours au Conseil national de la protection de la nature (CNPN) est trop tardif. Les citoyens doivent être mieux informés sur la manière dont la compensation au titre des espèces sera réalisée.
Le document sur les oiseaux que je vous ai remis confirme les chiffres mentionnés. Je fais partie d'un groupe de travail sur la mise en place d'indicateurs dans le cadre de l'Observatoire national de la biodiversité. Nous y comparons les zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique (Znieff) des années quatre-vingt-dix avec celles des années 2000 pour mesurer la perte de biodiversité, en termes de surface et d'habitat : entre ces deux générations, 47 000 hectares ont été perdus, dont 27 000 hectares de prairies, surtout en zones humides. Le premier facteur de perte est, de loin, l'agriculture, qui transforme des espaces riches en biodiversité en terres de culture intensive - voyez la prolifération des champs de maïs à la place des zones humides. Les infrastructures prennent de la surface agricole et fragmentent l'espace, mais ne réduisent pas beaucoup les zones les plus sensibles pour la diversité : en tout, elles comptent pour 800 à 1 000 hectares sur les 47 000 évoqués. Les carrières ont un impact bien supérieur, puisqu'elles représentent environ 7 000 hectares. Les projets d'infrastructure, au final, concernent en priorité les surfaces agricoles et leur impact concerne en premier lieu la fragmentation.
Que dire de la LGV ? Notre travail sur la compensation de ce projet a concerné en premier lieu l'outarde canepetière et le vison d'Europe. Cette ligne a été conçue pour éviter, autant que faire se peut, les zones les plus sensibles. Dans la région Poitou-Charentes, zone majeure pour les outardes, le projet essaie d'éviter au maximum les zones de protection spéciale. Il y a néanmoins des impacts résiduels, mais les acquisitions foncières et les mesures de conventionnement mises en place commencent à produire leurs effets.
Le problème, pour ces grandes infrastructures, est que la déclaration d'utilité publique (DUP) ne porte que sur l'espace artificialisé par la voie et pas sur les espaces de compensation. Les opérateurs et les maîtres d'ouvrage éprouvent des difficultés pour trouver les espaces de compensation, car ils n'ont pas droit à l'expropriation. Ils sont donc en permanence dans la négociation mais, pour ce faire, ils ont besoin de vendeurs en face d'eux. Or on voit se développer dans ces territoires une résistance extrêmement forte des organisations agricoles, les espaces agricoles étant les premiers concernés par la compensation. En effet, pour compenser la perte de biodiversité, on utilise des terrains qui sont aujourd'hui soumis à une agriculture intensive classique. Or, dans le cas du vison d'Europe, des surfaces importantes étaient concernées, alors que l'on ne sait pas grand-chose sur sa biologie. Les associations ont donc proposé à la ministre de l'écologie de substituer, pour une partie des mesures, à une compensation surfacique une compensation par aménagement d'ouvrages périphériques pour éviter la mortalité du vison. Ce projet a été mené à terme, après avis du CNPN. La mise en oeuvre des mesures de compensation a finalement été l'occasion d'effectuer des aménagements d'ouvrages et de voiries efficaces pour réduire la mortalité du vison et dans un délai réduit, ce qui n'aurait pas été le cas autrement.
Je voulais prendre cet exemple, car c'est une manière de penser la compensation qui est assez ouverte, et qui ne se limite pas à une réflexion en termes d'espace. La fragmentation fait partie des sujets importants.
La loi de 2016 sur la biodiversité propose des compléments importants sur la séquence ERC. Les mesures compensatoires mises en oeuvre depuis la loi de 1976 n'ont été comptabilisées par personne. Or certaines d'entre elles ont, depuis, fait l'objet de projets d'aménagement sans que personne ne le remarque ou ne puisse l'empêcher. En fait, on ne sait pas quel a été le bénéfice de ces mesures compensatoires, faute d'avoir un tableau de bord. Là où la loi apporte un plus, bien entendu, c'est que l'Agence française pour la biodiversité (AFB) va être chargée de la mise en place de cette comptabilisation et de ce suivi.
Enfin, il serait intéressant d'avoir, à l'échelle des départements, des sites de compensation en lien avec les préoccupations de biodiversité de ces secteurs géographiques pour pouvoir faire une compensation intelligente. La compensation intelligente ne se réduit pas à compenser un hectare de perte de tel habitat par l'équivalent. Selon les zones géographiques et biogéographiques, on peut envisager éventuellement d'avoir des mesures de compensation qui ramènent de la biodiversité sur un certain nombre d'habitats qui disparaissent.
Par exemple, dans l'ouest de la France, il y a des zones humides importantes, qui sont essentiellement de la prairie pâturée ou fauchée. On pourrait très bien avoir de la recréation de roselières dans ces prairies, ce qui serait l'occasion de recréer des habitats qui ont largement disparu.
Derrière, se pose la question du foncier. Les opérateurs de compensation vont être soumis à un préalable, qui est d'être propriétaires des terrains pour pouvoir faire les aménagements. Cela reste la mesure la plus sûre pour que des mesures soient durables. Les mesures compensatoires qui visent à faire du conventionnement sont de courte durée, de cinq ans à cinquante ans selon l'ampleur du projet. Au-delà, rien n'est garanti sur le devenir des espaces qui ont fait l'objet de cette compensation.
En conclusion, je dirai qu'on attend beaucoup de la loi de 2016. L'enjeu est d'avoir des espaces et des opérateurs performants un peu partout en France. Il faudra peut-être attendre quelques années, mais l'intérêt est bien là.
J'en viens à Notre-Dame-des-Landes. C'est un vieux projet. La question des mesures compensatoires se pose, parce que personne n'arrive à trancher. Il faut surtout se demander quelle est la légitimité de ces vieux projets. Y a-t-il une utilité publique à ce projet ? Françoise Verchère, ancienne conseillère générale de Loire-Atlantique, l'a dit et écrit à plusieurs reprises : c'est faute d'avoir repensé l'utilité de ce projet qu'on en est arrivé là. Quelle que soit la solution qui sera choisie, nous aurons beaucoup de mal à sortir de cette situation. La question est bien celle de l'évitement, au sens d'éviter de faire, quand l'utilité publique n'est pas ou plus évidente. Or l'utilité publique en France n'est jamais mise en débat ; c'est le seul domaine de la décision politique. On voit les difficultés auxquelles cela peut mener.
Le dernier rapport de l'Observatoire national de la biodiversité souligne que la France connaît une évolution inquiétante du nombre des espèces, un état mitigé des milieux naturels, avec la destruction des habitats. La population d'oiseaux régresse, tout comme les populations de chauves-souris, les milieux humides ou les grands espaces en herbe.
Face à ce constat, il importe que les grands projets d'infrastructures ne viennent pas s'ajouter aux autres facteurs d'érosion de la biodiversité. Or leur responsabilité potentielle est importante, notamment en termes d'effet barrière - c'est-à-dire lorsque l'infrastructure devient une frontière qui ne peut plus être passée. Les projets d'infrastructure peuvent aussi contribuer à la dissémination des espèces exotiques envahissantes, sans parler des mortalités animales, des perturbations et pollutions connexes, telles que les nuisances sonores.
Les grandes infrastructures, surtout celles qui sont linéaires, posent un problème de transparence. C'est surtout vrai pour les anciennes infrastructures, les nouvelles étant soumises à un droit plus rigoureux. Or je ne pense pas qu'il y ait une incitation à la mise à niveau des anciennes.
Je voudrais aussi mettre l'accent sur les outre-mer. On a beaucoup parlé de la métropole, où des expériences et un élargissement des connaissances ont été rendus possibles par la loi de 1976. Les territoires d'outre-mer sont en revanche confrontés à des problématiques particulières et les fonctionnalités écologiques des espèces qu'ils abritent ne sont pas complètement connues. Ces zones, où l'on démarre bien souvent à zéro, devraient pouvoir bénéficier de moyens leur permettant d'atteindre le même niveau que l'hexagone.
Une évaluation est-elle possible ? Comme Dominique Aribert l'a dit, aucun fichier ne permet de suivre les anciennes compensations. On ne sait pas si les évaluations ont eu lieu, ni si elles ont été faites correctement. C'est très difficile à évaluer. On aurait aimé qu'il y ait un bilan avant la loi biodiversité, car il aurait alors été plus facile de légiférer. Maintenant qu'un fichier sera à notre disposition, il faudra faire des évaluations régulièrement, sans attendre vingt ou trente ans avant de se retourner sur ce qui aura été fait.
À mon sens, l'État doit avoir une vision inter-régions, inter-territoires. Il doit aider les territoires à monter en puissance dans ce domaine. Je souligne qu'en Guyane, peu de bureaux d'études sont compétents. Les porteurs de projet se retrouvent donc sans ressources sur lesquelles s'appuyer. Les associations sont quand même en train de faire des mémoires sur la compensation, mais la situation est un peu celle de l'Hexagone il y a vingt ans. Apparemment, la situation est meilleure à La Réunion.
Je ne me risquerai pas à donner une définition de la compensation. Pour le WWF, il convient d'atteindre l'objectif ambitieux de zéro perte nette de biodiversité. La meilleure compensation pourrait donc être celle qui n'a pas lieu. Certains grands projets d'infrastructures se retrouvent parfois bloqués sans que les bonnes questions aient été posées en amont. Par exemple, plutôt qu'un TGV, un train pendulaire ne serait-il pas plus approprié ? Toutes les solutions techniques disponibles doivent être utilisées pour minimiser l'impact sur l'environnement. Mais la prise de décision sur ces grands projets est trop fragmentée et compartimentée. Comment faire ? Je n'ai pas la solution, mais je ne peux que faire le constat que ce mode de décision nous place dans une sorte de seringue dont on a du mal à sortir. Le temps politique n'est jamais celui du projet et il est impossible de remonter le temps.
J'ai un problème d'ordre général avec toutes ces questions. Je déplore depuis un moment que notre vision de la biodiversité soit largement issue de la Genèse et d'une vision parfaitement statique du monde vivant, créé une fois pour toutes. J'entends souvent des gens qui pensent tenir un discours évolutionniste mais ne font que remplacer le mot « créateur » par le mot « évolution ». Au lieu de dire « le créateur a créé les espèces », ils disent « l'évolution a créé les espèces ». Darwin, dans L'origine des espèces, dit justement le contraire, c'est-à-dire que la création des espèces continue encore aujourd'hui. Il s'agit pour moi d'un élément essentiel de notre débat : la biodiversité ne doit pas être vue comme quelque chose de statique.
Je voudrais que vous vous rendiez compte à quel point nous sommes conditionnés par cette vision culturelle extrêmement fixiste du monde vivant, souvent justifiée par le fait que le temps de l'évolution ne serait pas le même que le temps de l'écologie. Or nous savons que cela est faux depuis longtemps. Les choses bougent, qu'on le veuille ou non.
Maintenir la nature en état est d'autant plus illusoire que nous sommes dans une période de changements globaux. Il y a bien évidemment le changement climatique, que tout le monde connaît, mais sans vraiment réaliser que ce dernier amène à d'autres changements. Par exemple, les pathogènes vont se déplacer, c'est-à-dire qu'on n'aura plus les mêmes maladies aux mêmes endroits.
Je le répète, espérer maintenir les choses en état est une bataille perdue d'avance sur le moyen terme, même si l'on peut y arriver sur le court terme.
Je ne veux pas dire qu'il ne faut rien maintenir mais je veux vous faire comprendre qu'il faut penser « réseau » plus que « maintien statique d'une surface telle quelle ». Pour moi, l'arrivée des trames vertes et bleues a représenté un vrai progrès par rapport aux visions plus statiques qui préexistaient. Ce constat impacte ma vision de la compensation.
Une mesure de compensation, si elle s'intègre dans un réseau, et même si elle n'est pas effectuée juste à côté de la zone à compenser, a plus de chances d'être utile que si elle a été faite à proximité de cette zone, mais en étant tout aussi fragile que le milieu qui préexistait et par conséquent soumise à un risque accru de disparition. Je veux vraiment insister sur cet aspect dynamique. Les choses avancent doucement d'un point de vue scientifique et encore moins vite au niveau ingénierie. Évidemment, des erreurs seront commises, mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire.
À mes yeux, l'AFB doit avoir une double mission : d'une part, faire des bilans, et, d'autre part, voir quelles sont les méthodes qui marchent, pour la compensation comme pour le reste.
C'est le message le plus important que je voulais faire passer.
Le domaine le plus touché actuellement est le domaine agricole. Nous en sommes tous convaincus. C'est vrai non seulement hors des champs, mais également dans les champs.
J'en viens au triptyque ERC.
Je ne suis pas certain qu'à long terme la compensation soit la meilleure solution - il y en aurait d'autres de type taxes, par exemple. Pour autant, dans l'état actuel des choses et de notre système juridique, la meilleure manière de faire de l'évitement et de la réduction, c'est de faire en sorte que la compensation soit chère. Pour qu'elle soit chère, il faut qu'elle soit effective, c'est-à-dire que les entreprises ne puissent pas y échapper. En d'autres termes, les mécanismes de compensation ne sont utiles que s'ils sont réellement obligatoires et suffisamment onéreux.
Ces deux principes posés, on peut bien sûr s'interroger sur ce qu'est vraiment une compensation. Qui doit la faire ? Comment les prestataires doivent-ils être choisis ?
À partir du moment où l'entreprise choisit son prestataire, il me semble qu'il y a un risque : le prestataire devient trop dépendant financièrement de l'entreprise, ce qui risque de lui faire perdre ses capacités critiques. Il existe également un risque que l'entreprise choisisse systématiquement le moins-disant, tant financier qu'écologique. De ce point de vue, le rôle de l'État est très important pour contrôler l'effectivité de la compensation et de son sérieux, mais également pour définir les méthodes à mettre en oeuvre pour que le bien commun soit respecté. Je suis certain qu'il est possible de faire mieux en réfléchissant davantage en termes de connectivité et de dynamique.
S'agissant de Notre-Dame-des-Landes, je partage l'opinion exprimée par les orateurs précédents : il aurait fallu agir bien plus en amont. En général, en France, au moment où les problèmes se posent, il est déjà extrêmement tard : les intérêts en jeu sont alors si considérables que les débats ne peuvent plus se dérouler sereinement.
Le comité français de l'UICN a mobilisé son réseau, qui regroupe à la fois des représentants du Gouvernement, d'établissements publics, d'organisations non gouvernementales (ONG), ainsi que différents experts scientifiques, pour réaliser une étude en 2011 sur la compensation écologique. Cette étude présente neuf recommandations pour améliorer l'application du principe de la compensation écologique.
Le comité français n'a pas regardé en détail les mesures compensatoires des différents projets sur lesquels va travailler la commission d'enquête. Nous avions uniquement émis une recommandation d'alerte au moment où les mesures compensatoires du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes étaient discutées. Il y avait eu à cette époque une importante controverse scientifique, relayée notamment au sein du CNPN, sur le calcul des mesures compensatoires.
Comme nous avons été particulièrement actifs dans l'élaboration du projet de loi sur la biodiversité, les principales recommandations ne vous sont pas inconnues. On les retrouve également dans la politique mondiale que l'UICN a adoptée sur les compensations relatives à la biodiversité lors de son dernier congrès mondial à Hawaï, en septembre 2016.
L'UICN a aussi beaucoup travaillé au niveau international, au sein du Business and biodiversity offsets program, qui a beaucoup contribué à la doctrine sur la compensation écologique.
La première recommandation s'intitule « Poser des limites au principe de la compensation » : la compensation ne doit pas être un prétexte pour autoriser tous les projets ; au contraire, lorsque les enjeux écologiques sont particulièrement importants, avec des habitats et des espèces très rares et menacés, le projet doit être refusé. C'est ce qui a été inscrit dans la loi.
La deuxième recommandation est de respecter la hiérarchie du triptyque ERC et de ne pas passer directement à la compensation. Cela veut dire que les maîtres d'ouvrage doivent présenter des scénarios alternatifs démontrant que toutes les possibilités ont été sérieusement étudiées pour arriver au scénario le moins impactant. Dans un deuxième temps, l'étude d'impact doit également préciser toutes les mesures de réduction des impacts qui ont été mises en oeuvre. Il s'agit par exemple de prévoir que certaines interventions ne se font pas lors des périodes de nidification d'espèces. Enfin, les mesures compensatoires ne doivent porter que sur les impacts résiduels. Il est clair qu'aujourd'hui les volets évitement et réduction des impacts ne sont pas suffisamment ambitieux ni détaillés. Par ailleurs, dans de nombreuses études d'impact, l'intégration des préoccupations de biodiversité devrait intervenir beaucoup plus en amont qu'actuellement.
La troisième recommandation porte sur l'additionnalité des mesures compensatoires. Cette recommandation a également été reprise dans la loi biodiversité. Les mesures compensatoires doivent apporter un plus. Le projet ne se réalise que grâce au financement de ces mesures, ce qui veut dire que l'on apporte des résultats nouveaux en matière de biodiversité, y compris sur un site qui n'est pas forcément très dégradé. J'ajoute que les mesures compensatoires ne doivent pas se substituer à des politiques ou des mesures déjà existantes. Les moyens déjà développés pour la gestion environnementale d'un site ne doivent pas être retirés au motif que des mesures compensatoires viennent d'être mises en place. Il s'agit d'apporter un plus.
La quatrième recommandation a pour objet le respect des spécificités écologiques des sites impactés et la prise en compte du contexte local. On revient sur les questions d'équivalence écologique, qu'il faut toujours essayer de traiter au mieux. La loi de 2016 prévoit la mise en place d'une compensation en fonction de l'espèce ou du type d'habitat que l'on dégrade. Nous sommes favorables à ce que les mesures compensatoires soient mises en place à proximité du site, et non pas dans des lieux très éloignés. Il faut garder cette intégration territoriale de la prise en compte de la biodiversité. Je pousse la réflexion jusqu'au bout en caricaturant un peu : on ne peut pas avoir des zones où l'on sacrifie totalement la biodiversité au prétexte que l'on accumule des mesures compensatoires dans d'autres.
La cinquième recommandation consiste à d'améliorer la prise en compte dans les mesures compensatoires de la biodiversité ordinaire, de la continuité écologique et des services éco-systémiques. La compensation écologique a un impact global sur le fonctionnement des milieux naturels. Aujourd'hui, la compensation écologique est beaucoup vue sous l'angle de la dérogation concernant les espèces protégées. Or, si d'un point de vue méthodologique, il est encore difficile d'évaluer et de quantifier les services écologiques, il importe de bien appréhender l'impact des projets et des mesures de compensation sur le fonctionnement global des milieux naturels.
Cette évolution aura d'ailleurs des vertus en termes de communication et de sensibilisation auprès du grand public et des aménageurs. Il s'agit d'éviter les discours du type : « Le pique-prune a bloqué l'autoroute ». De même, avec cette pédagogie, les aménageurs de l'A65 auraient compris que l'on attribue 1 362 hectares de mesures compensatoires pour une espèce de papillons. Il faut expliquer davantage aux aménageurs l'impact global des projets d'infrastructures sur les milieux naturels : par exemple, une perte de zone humide entraîne une modification hydrologique, une perte de service d'épuration des eaux, de stockage du carbone ou encore de régulation globale du climat.
Notre sixième recommandation est d'imposer la transparence dans la mise en place et le suivi des mesures compensatoires. Les informations ne sont pas facilement accessibles. De ce point de vue, l'obligation formulée par la loi de 2016 pour le maître d'ouvrage de déclarer la localisation de ses mesures compensatoires est positive, tout comme celle de faire remonter le résultat des mesures en place.
Notre septième recommandation est d'atteindre au minimum un résultat de non perte nette et de tendre vers un gain de biodiversité. La loi relative à la biodiversité apporte une clarification très nette en la matière puisque l'objectif est désormais imposé et identifié.
Notre huitième recommandation est de créer des outils pour améliorer la mise en oeuvre des mesures compensatoires, leur suivi et leur évaluation. Nous nous félicitons que le ministère de l'environnement ait mis en place des lignes directrices nationales sur l'application de la séquence ERC. Il faudrait compléter ces lignes directrices par des guides opérationnels ainsi que par un partage des bonnes pratiques et des expériences. Nous soutenons la création d'un observatoire de la compensation, qui pourrait être un centre de ressources de l'AFB.
Notre neuvième recommandation est l'approfondissement des réflexions sur les spécificités des milieux marins et ultra-marins, qui accueillent beaucoup d'espèces endémiques. Il s'agit d'habitats très sensibles et très menacés, impossibles à reproduire.

Merci de ces exposés qui rejoignent des propos que nous avons déjà entendus, ce qui nous aide à dégager quelques enjeux majeurs.
J'ai le sentiment que les associations de protection de l'environnement portent deux approches s'agissant de la compensation. Certains souhaitent éviter toute perte nette sur le territoire touché quand d'autres préfèrent une planification nationale de la reconquête de la biodiversité en réintégrant le stock lié à des décennies de création d'infrastructures qui ont provoqué une fragmentation problématique des milieux. On a beaucoup évoqué les données nationales agrégées. Ce deuxième point de vue va dans le sens de certains d'entre vous, qui ont déclaré : « Il faut que ce soit cher. » Le coût très élevé incite à l'évitement mais finance aussi d'autres actions de reconquête.
Les deux points de vue sont audibles. Les exigences diffèrent selon qu'une infrastructure touche une plaine de maïs ou au contraire un ensemble de milieux humides, comme Notre-Dame-des-Landes.
Nous ne sommes pas fixistes, l'enjeu ne se situe pas à deux kilomètres près. Toutefois, dans une logique de trame et de résilience, il faut éviter de sacrifier certains endroits quand on en privilégie d'autres parce qu'ils subissent moins de pressions économiques, agricoles ou urbaines. Si l'agriculture est le premier facteur affectant la biodiversité, les infrastructures ne sont pas anodines. Les tracés de l'A65 et de la LGV Bordeaux-Toulouse passent dans des endroits d'une exceptionnelle richesse. Ne minorons pas leur impact sur l'entomofaune, qu'on ne sait pas recréer et qui se situe à la base de la pyramide alimentaire.
Attention : les obligations de la séquence ERC augmentent tandis que les pouvoirs publics se désengagent fortement des politiques de biodiversité. Il serait absolument paradoxal que la compensation vienne remplacer les politiques volontaires et que la reconquête de la biodiversité soit financée par la destruction de milieux naturels.

Un équilibre doit évidemment être trouvé. Il ne peut y avoir d'un côté des réserves naturelles et de l'autre des endroits sacrifiés. Où se situe cet équilibre ?
Le mot « infrastructure » évoque immédiatement un grand machin. Or les trames assurent aussi de petites continuités. L'échelle peut être très petite. Il n'y a donc pas forcément besoin d'une planification à grande échelle.
Chercher à mieux protéger les milieux compensés que les milieux qui n'ont jamais été altérés n'est pas de bonne politique. Cela contraindrait à développer des outils de maîtrise foncière coûteux ou à développer une vision fixiste. Une prairie humide réhabilitée doit avoir exactement le même statut qu'une prairie humide restée en l'état, sans quoi on risquerait de « surdépenser » sous prétexte que l'homme a agi.
Si l'on artificialise un lieu, il faut en renaturaliser un autre. Nous préférons identifier un nombre restreint de zones profondément dégradées plutôt que d'améliorer à la marge des surfaces importantes, ce qui ferait courir le risque, assez rapidement, de hausses de prix du foncier liées à la recherche de terrain pour la compensation. C'est dans ce domaine de la compensation intensive de zones fortement dégradées que la planification serait utile. En outre, la renaturalisation d'endroits dégradés pourrait engendrer un meilleur bénéfice social.
Il me semble qu'il faut avoir des unités de compensation réparties à l'échelle de toute la France, avec une approche biogéographique.
Il faut d'abord penser à la désartificialisation. En France, on construit des routes sans jamais en détruire. En Autriche, quand une route est délaissée au profit d'une déviation, elle est détruite, semée et devient une prairie. La France a un immense réseau routier, avec beaucoup de départementales. Or les chouettes effraie sont au moins autant tuées sur ces petits axes que sur les autoroutes. L'impact des grandes infrastructures ne doit pas masquer celui, considérable, des autres. Nous avons tous à l'esprit des zones industrielles ou artisanales, ou des voiries qui ne servent plus et qui pourraient être désartificialisées
Sur le littoral du sud-ouest, on réfléchit au recul stratégique. N'est-ce pas l'occasion de réfléchir à des zones à renaturer ? Il faut planifier. Actuellement, on laisse à tous les aménageurs la charge de trouver des espaces à renaturer. Pourquoi ne pas les intégrer dans une logique de biodiversité dynamique ? La LPO a entrepris un travail avec la Caisse des dépôts et consignations dans les Alpes-Maritimes. Ce repérage, à l'échelle nationale, serait une tâche conséquente.

Les États-Unis ont une structure rassemblant tous les acteurs de la compensation. En France, l'AFB pourrait-elle, demain, jouer ce rôle ? Quelle gouvernance privilégier ?
La restauration des terres dégradées et la planification sont complémentaires. L'AFB vient de naître. Elle va devoir dans un premier temps exercer les missions qui l'étaient auparavant par des structures séparées. Cette période transitoire d'environ 2 ans pourrait en effet être l'occasion de réfléchir aux options que vous suggérez.
L'inventaire des terres artificialisées pourrait constituer la base d'un outil juridique pour exproprier des lieux en déshérence. Ce serait positif pour les écosystèmes dont la connectivité est importante.
En revanche, certains écosystèmes sont uniques, comme celui de coussouls de la plaine de la Crau. Celui qui lui ressemble le plus est situé en Hongrie. La transformation des anciens vergers en milieux naturels n'est pas équivalente pour les insectes. Tout ne peut pas se recréer avec de l'argent.
On assiste actuellement à un effondrement. Un équilibre dynamique se maintient grâce au mouvement. Si un satellite ou un vélo ralentit, il finit par s'effondrer. C'est le cas de la biodiversité. S'il est encore temps d'intervenir quand s'engage la dynamique d'effondrement, quand la chute advient, il est trop tard.
L'AFB doit se charger des tâches mentionnées, en revenant peut-être aux fondamentaux. Quand une espèce s'éteint, il est vraiment tard. Avant, nombre de sous-espèces ou de variétés ont été concernées. Il faut réfléchir à différents niveaux de la systématique. Chaque espèce de plante accumule beaucoup de diversité en son sein tandis que les nouvelles espèces d'insectes se recréent facilement : il y a donc souvent plus de biodiversité au sein d'une même espèce de plante qu'entre deux espèces d'insectes. Dès lors, dire qu'une espèce est égale à un point n'a pas de sens sur le plan biologique.
Certains déplorent que certaines zones soient riches en diversité et d'autres non : c'est pourtant précisément le sens du mécanisme de compensation. Toute la question porte sur l'échelle : à quel niveau systématique et à quelle échelle géographique accepte-t-on de perdre de la biodiversité pour en gagner ailleurs ? Le suivi des actions sera extrêmement important pour répondre à ces questions.
La mise en oeuvre des mesures de compensation est très peu suivie. Il faut les analyser à l'échelle du territoire, sachant qu'il est souvent plus intéressant de restaurer un système dégradé plutôt que d'améliorer une zone déjà en bon état.
La banque de compensation à l'américaine peut être intéressante pour aider la planification, en réunissant beaucoup de petits projets dans un grand.
Je note une contradiction. Nous cherchons à faciliter la mise en oeuvre des mesures compensatoires, malgré des limites telles que la disponibilité des terrains et les protocoles de restauration des milieux. Or la bonne compensation est celle qui n'existe pas. Pour lever cette contradiction, il faut favoriser l'évitement, afin que seuls les impacts résiduels aient besoin d'être compensés.
L'AFB serait utile pour inventorier les terrains susceptibles d'être utilisés pour la compensation, apporter une expertise technique, mettre en relation les acteurs et créer un observatoire des bonnes pratiques.
Quel opérateur pour coordonner la politique de compensation ? Je ne pense pas que ce puisse être l'AFB, qui résulte de la fusion d'organismes déjà très chargés. En outre, on demanderait à une structure publique de travailler sur des projets privés. Je plaide pour une structure publique-privée à la gouvernance très large, dont l'inventaire et les travaux seraient soumis au Comité national de la biodiversité et à l'AFB. Le travail doit être rigoureux.
Il serait bon de créer un groupe de travail sur l'expérience américaine de la banque. Le décret qui décrira le régime de responsabilité sera très important. Il faudra aussi obtenir des retours sur Cossure. Enfin, il faut penser à la durée : pour combien de temps restaure-t-on ? Il faut une certaine stabilité.
Faire de l'AFB l'acteur central de la politique de compensation poserait un problème majeur : elle assure la police de l'environnement, comment peut-elle contrôler ses propres interventions ?
On dit souvent que le prix régule le marché. Si le foncier est trop cher pour l'entreprise, peut-être est-ce le signe qu'il faut renoncer au projet ? L'État doit prendre ses responsabilités.

Nous avons entendu des choses contradictoires dans les différentes auditions. Je m'interroge sur le zéro perte nette : si l'on cherche à compenser, c'est bien que le milieu se trouve dégradé. Or les chercheurs du CNRS disent qu'il n'est pas possible de revenir à l'exact état antérieur.
On peut restaurer autrement, et revenir à un état aussi satisfaisant.

Les mots recouvrent parfois une certaine hypocrisie. Personne ne croira plus au zéro perte nette si l'on dit que le résultat de la compensation sera « un peu différent mais fort utile ». Compensation n'est pas restauration.
Selon que vous serez puissant ou misérable, les principes de proximité ou d'équivalence s'appliqueront ou non. Dans un projet soutenu par l'État, proximité signifie « globalement équivalent ». Mais pour un petit projet privé, cinquante hectares de terres agricoles doivent être compensées par cinquante hectares de terres tout à côté, sinon l'opération est refusée.
L'Agence ne saurait être juge et partie. En revanche, elle doit être un conservateur des hypothèques - car souvent, il n'y a aucun suivi de la compensation.
D'une région à l'autre, trop de différences subsistent. Telle DREAL réclame un indice 10 de compensation, telle autre un indice 3. Les pratiques locales sont trop variées d'un territoire à l'autre.
Enfin, l'État est trop souvent juge et partie. Les conflits d'intérêts sont fréquents. Il ferme les yeux ou non, selon les cas. Plus de clarté s'impose.
Le monde agricole se sent souvent maltraité. Pour le Canal Seine-Nord, Voies navigables de France (VNF) applique la compensation, sur 105 kilomètres, en prélevant de très bonnes terres agricoles. Or il existe d'autres zones beaucoup plus dégradées sur lesquelles pourrait s'effectuer la compensation. Je connais par exemple un village qui compte sur son territoire un site industriel orphelin si pollué que l'on ne peut même pas y installer de panneaux solaires. Personne ne fait rien car la dépollution est trop coûteuse. Voilà une piste intéressante pour une opération de compensation... C'est sur un point comme celui-ci qu'il nous faut mettre de l'ordre.

Dans le tableau que vous nous avez remis, je m'interroge sur les surfaces des catégories 13 et 14 : de nombreuses terres qui deviennent des serres pour le maraîchage ne sont plus des terres agricoles.
Les agences foncières, dans les départements, ont mené des actions en faveur des espaces naturels sensibles.
Dans mon département, tous les oeillets des marais salants ont ainsi été rachetés pour éviter la déshérence, grâce à quoi ils n'ont pas été bouchés et occupés par des caravanes.
Les terres humides sont-elles correctement cartographiées ? Il faudrait des règles précises, sur la base desquelles, éventuellement, on pourrait contester le classement. Je suis convaincu que dans certains cas, celui-ci a été fait de manière très imprécise.
Vous avez parlé des friches industrielles. Il y a aussi les friches agricoles, bâtiments abandonnés, véritables verrues qui se transmettent d'une génération à l'autre, sans qu'aucune solution soit trouvée.
Quant au milieu marin, je voudrais savoir quelle est votre position au sujet des zones économiques exclusives. Estimez-vous que les règles internationales sont satisfaisantes ?

Vous qui appartenez à des associations vigilantes, jugez-vous que l'État est moins regardant sur les grands projets ? Pensez-vous que la compensation pourrait servir à financer des politiques de conservation qui manquent de financements publics aujourd'hui ?
Les opérateurs nationaux sont proches de l'État et ils mènent souvent des opérations d'intérêt public. Mais il me semble que le traitement dépend surtout de la mobilisation locale. Telle petite commune est démunie face à des services de l'État tatillons, en revanche un projet local d'aménagement pourra susciter l'engouement et bénéficier de soutiens puissants auprès du préfet. Or, c'est ce dernier qui, à la fois, évalue l'impact de l'opération et délivre l'autorisation. Si dans les grands projets nationaux il existe une certaine transparence - les associations, des élus, s'expriment - dans ces projets locaux, voulus par des élus, des parlementaires, il est impossible de faire entendre qu'une implantation sur un autre site serait moins dommageable à la biodiversité. La loi sur la protection des milieux naturels n'est pas appliquée, les objectifs économiques de court terme l'emportent toujours. Il faudrait intervenir très en amont pour implanter les projets là où ils sont le moins nuisibles.
Les grands opérateurs possèdent une vraie expertise technique ; la qualité de leurs propositions incite à prendre celles-ci au sérieux. Les petites communes, elles, manquent de conseils et leurs dossiers s'en ressentent.
La compensation agricole n'a rien à voir avec la compensation écologique. Je précise aussi que lorsque l'État déclare d'utilité publique un projet, il n'y a plus à compenser la perte de capacité de production agricole.
Une partie des grands projets - ligne à grande vitesse, aéroport - se fait à l'initiative de l'État ou des collectivités locales, ce qui interroge sur le fait que le préfet soit également l'autorité environnementale. De plus, les avis en région, sont illisibles. Ils sont essentiellement une analyse au terme de laquelle on ne sait absolument pas quoi penser du projet. Le grand public ne peut rien y comprendre. La notion d'avis a été pervertie.
Les petits projets souffrent d'un déficit d'accompagnement. L'autorité administrative se borne à indiquer les étapes à suivre. On éviterait bien des problèmes si elle accompagnait plus les initiatives en amont. Peut-être n'est-ce pas son rôle...
Il y a une responsabilité du privé également, car l'État ne peut tout prendre en mains. Les chambres de commerce et d'industrie (CCI) peuvent également proposer des formations.
Les agents de la DREAL ne sont pas non plus suffisamment formés à l'accompagnement des projets.
Non, car ils sont obligés de rendre un avis.
Nous avions proposé qu'une autorité de régulation indépendante puisse effectuer l'analyse et le suivi des mesures de compensation.
Nous avons des leçons à prendre des Américains sur les procédures et le rôle de chacun des acteurs.

Nous cherchons des solutions et sommes preneurs de vos analyses écrites sur le maillon manquant, du côté des agences ou des services de l'État ; sur l'articulation entre la nouvelle loi et le dispositif juridique antérieur ; et peut-être sur la compensation financière, dont on peut se demander si elle est une piste pour la reconquête de la biodiversité, à condition bien sûr que la transaction soit honnête.
Il est difficile de répondre à cette question. Instinctivement, je dirais non. Mais si un projet public, un hôpital en zone de montagne par exemple, est indispensable mais nuisible au milieu naturel, il faut compenser. En revanche, se contenter de débourser de l'argent pour être autorisé à détruire, c'est un encouragement à ne rien faire.
La loi prévoit bien des unités de compensation, des sommes consacrées à la restauration.
Mais l'opérateur reste en responsabilité, dans la durée.

Il y a des situations de blocage où toutes les solutions sont bonnes à envisager pour qu'il y ait un gain écologique.
Si la compensation devait être purement financière, il faudrait que l'argent ne soit pas versé au budget général dans la loi de finances, mais serve bien à la compensation.