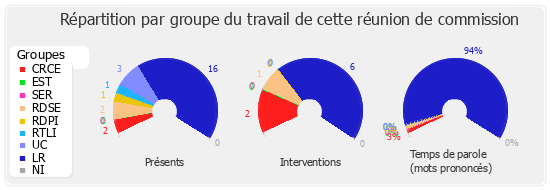Commission des affaires économiques
Réunion du 15 octobre 2008 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion
Au cours d'une première séance tenue dans la matinée, la commission a désigné ses rapporteurs budgétaires pour 2009 :
- Mission « Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales » : MM. Gérard César, Daniel Soulage, Jean-Marc Pastor et François Fortassin ;
- Mission « Economie » : MM. Pierre Hérisson, Gérard Cornu et Mme Odette Terrade ;
- Mission « Ecologie, développement et aménagement durables » : MM. Jean Bizet, Charles Revet, Jean-François Le Grand, Francis Grignon, Roland Courteau ;
- Mission « Recherche et enseignement » : MM. Michel Houel et Daniel Raoul ;

- Mission « Ville et logement » : MM. Pierre André et Thierry Repentin ;

- Mission « Participations financières de l'Etat » : M. François Patriat.
La commission a tout d'abord nommé M. Francis Grignon comme rapporteur sur le projet de loi n° 501 (2007-2008) relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports.

Sur proposition de M. Jean-Paul Emorine, président, la commission a ensuite désigné M. Daniel Soulage en qualité de rapporteur de la proposition de loi n° 214 (2007-2008) tendant à généraliser l'assurance récolte obligatoire, présentée par MM. Yvon Collin et Jean-Michel Baylet, sénateurs. M. Jean-Paul Emorine, président, a indiqué que cette proposition de loi serait discutée le 29 octobre 2008 lors de la séance mensuelle réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par le Sénat en application de l'article 48, dernier alinéa, de la Constitution, la Conférence des présidents ayant, par tirage au sort, donné au groupe Rassemblement démocratique et social européen la possibilité de choisir un texte à discuter lors de cette séance.
a rappelé qu'il avait déposé un amendement tendant à généraliser l'assurance récolte lors de l'examen du projet de loi d'orientation agricole, en novembre 2005. Il a ajouté que l'Union européenne avait accepté le principe d'une participation au financement de l'assurance récolte et que celle-ci pourrait prendre en compte d'autres risques tels que ceux de nature sanitaire pour devenir une « assurance aléas ». Il s'est montré favorable à la généralisation de l'assurance récolte. Il a toutefois considéré que, bien souvent, les petites exploitations ne dégageaient pas des marges suffisantes pour constituer une épargne et participer ainsi au mécanisme de la déduction pour aléas (DPA).
Enfin, sur proposition de M. Jean-Paul Emorine, président, la commission a décidé de surseoir à la désignation d'un rapporteur sur le projet de loi n° 2 (2008-2009) relatif à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à la simplification du droit de l'agriculture, de la pêche maritime et de la forêt.

Enfin, la commission a désigné M. Bruno Sido et Mme Evelyne Didier pour siéger au sein du Comité national de l'eau.
La commission a fait part de sa demande de saisine pour avis et a nommé M. Bruno Retailleau comme rapporteur pour avis sur le projet de loi n° 405 (2007-2008) favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.
La commission a désigné, outre le président Jean-Paul Emorine, MM. Jean Bizet, Gérard César, Daniel Soulage, Jean-Marc Pastor, Mme Odette Herviaux et M. Gérard Le Cam, pour représenter la commission à la réunion interparlementaire organisée par les commissions en charge de l'agriculture du Sénat, de l'Assemblée nationale et du Parlement européen, qui se tiendra à Bruxelles, les 3 et 4 novembre 2008.

En réponse à une intervention de M. François Fortassin, M. Jean-Paul Emorine, président, a rappelé que la commission veillait à ce que la composition politique des missions à l'étranger reflète celle de ses membres. Sur la demande de M. Gérard César, M. Jean-Paul Emorine, président, a indiqué que la mission en Russie, qui n'avait pu avoir lieu cette année à cause des élections sénatoriales, serait conduite en 2009.
La commission a procédé à l'examen du rapport et des amendements sur la proposition de résolution n° 6 rectifié (2008-2009) présentée par M. Jean Bizet en application de l'article 73 bis du règlement, relative au bilan de santé de la politique agricole commune (E 3878).

a tout d'abord annoncé la réunion, le 19 novembre prochain, à Bruxelles, des ministres de l'agriculture des 27 pays de l'Union européenne en vue de parvenir à un accord sur le « bilan de santé » de la politique agricole commune (PAC), conformément à l'engagement qui en avait été pris lors de sa dernière réforme, en 2003. Estimant qu'elle s'était globalement avérée être un succès depuis sa création et ne nécessitait pour l'instant que quelques ajustements ne devant pas remettre en cause l'équilibre du modèle agricole européen contribuant à l'indépendance et à la puissance économique de l'Union, il en a brièvement retracé l'histoire.
Créée voici une cinquantaine d'années, lors de la fondation des Communautés européennes, afin de faire disparaître toute pénurie et de garantir la sécurité alimentaire, la PAC a permis, grâce à des mécanismes contraignants fondés sur la préférence communautaire et les prix garantis, d'accroître de façon spectaculaire la production agricole européenne dans les années 60 et 70, et ce, jusqu'à produire des biens que le marché ne parvient plus à écouler. Les réformes des années 80 et 90 auront donc pour objectif, non seulement de maîtriser la production, mais également de lui faire prendre un virage environnemental, de la rendre compatible avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et de mieux encadrer le budget communautaire. La dernière réforme en date, remontant aux accords de Luxembourg de 2003, cherche à atteindre chacun de ces objectifs :
- elle instaure un régime de paiement unique par exploitation, indépendant du niveau de production -les « aides découplées »- et soumis au respect de normes environnementales contraignantes -l'« écoconditionnalité »- ;
- elle renforce la politique de développement rural au sein d'un deuxième pilier, qui va bénéficier de transferts du premier, consacré, lui, à la production -la « modulation » ;
- elle réduit le niveau des prix garantis dans certains secteurs ;
- elle fixe un cadre budgétaire stable et maîtrisé pour la période allant jusqu'à 2013 ;
- enfin, elle prévoit une clause de « rendez-vous » à mi-parcours, en 2008-2009, afin de dresser un bilan de cinq années de réforme et, sans attendre la prochaine fixée en 2013, de procéder aux adaptations limitées éventuellement nécessaires.
C'est dans ce cadre, a poursuivi M. Jean Bizet, rapporteur, que la Commission européenne a publié, en novembre 2007, une communication esquissant des pistes pour ce bilan. Après six mois d'échange avec les Etats membres, elle a rendu publiques, en mai de cette année, des propositions législatives plus abouties en vue d'une mise à jour de la PAC.
Dans ces documents, a continué M. Jean Bizet, rapporteur, la Commission part du constat que la PAC, qui a jusqu'ici globalement bien fonctionné, doit s'adapter au monde qui l'entoure pour faire face à ses nouveaux défis, qu'ils soient alimentaires, économiques, environnementaux, énergétiques ou territoriaux. Pour mettre l'Union en mesure d'affronter ces défis, la Commission préconise certaines adaptations faisant aujourd'hui débat :
- elle supprime ou modifie dans un sens plus contraignant, selon les secteurs, le système d'intervention, qui consiste à racheter ou à revendre aux agriculteurs, à prix garanti, leurs productions en cas de forte variation des cours ;
- elle augmente progressivement les quotas laitiers d'ici à 2015 et entend les supprimer à cette date ;
- elle généralise le découplage à l'ensemble des productions végétales, n'en conservant une partie que pour certaines productions animales ;
- elle assouplit le régime dit anciennement « de l'article 69 », qui permet de réorienter les aides au sein du premier pilier selon des priorités nouvelles et sous un certain plafond ;
- enfin, elle accroît la modulation de 8 points d'ici 2013, la faisant passer de 5 % actuellement à 13 % à cette date.
Face à ces propositions de la Commission tendant, de façon globale, à restreindre un peu plus encore les mécanismes de régulation des marchés agricoles, les Etats membres ont réagi très diversement. Cependant, une ligne de partage s'est opérée entre ceux, situés au Nord de l'Europe et de philosophie anglo-saxonne, qui les ont globalement approuvées au nom de la nécessité de libérer le marché et ceux qui, à l'instar de la France, souhaitent conserver des instruments permettant d'encadrer et de réguler un secteur agricole par nature volatile et imprévisible.
La France, a rappelé M. Jean Bizet, rapporteur, a rapidement mis en place des structures de débat entre professionnels, administrations, politiques et grand public pour discuter de ces mesures et déterminer sa position à leur égard. Le Président de la République, qui a pris la tête de l'Union au 1er juillet et sous la présidence duquel devraient aboutir les négociations, a fait de ce « bilan de santé » l'une de ses quatre priorités.
Enfin, le Parlement européen, qui n'interviendra dans le domaine agricole selon la procédure de codécision qu'au 1er janvier prochain, a rendu plusieurs rapports analysant le projet de la Commission et formulant des contre-propositions, dont le dernier devrait être rendu public le matin même de la réunion du Conseil « Agriculture et développement rural » du 19 novembre prochain.
Les négociations se poursuivent au sein de « groupes de haut niveau » visant à avancer sur le maximum de sujets pour ne laisser à l'arbitrage des ministres que les plus délicats, achoppaient sur quatre points principaux (la modulation obligatoire, l'intervention, les quotas laitiers et l'article 69 révisé). M. Jean Bizet, rapporteur, a indiqué que la proposition de résolution qu'il avait déposée la semaine précédente prenait position sur chacun de ces points. Soulignant qu'elle tentait de tenir compte des sensibilités exprimées au cours de la quinzaine d'auditions menées dans le cadre du groupe de travail sur le « bilan de santé » de la PAC qu'il avait présidé, il a décrit son contenu. Insistant tout d'abord sur son attachement à un modèle européen d'agriculture équilibré entre production quantitative et qualitative, respect de l'environnement et ancrage dans les territoires, puis observant la volatilité des marchés agricoles et le caractère spécifique des biens alimentaires, elle réaffirme la légitimité d'une politique commune forte, financée sur des fonds majoritairement communautaires, qui soit à même d'orienter et de stabiliser les marchés lorsque le besoin s'en fait sentir. Puis la proposition de résolution prend position sur les points plus techniques de la négociation :
- elle s'oppose au projet de modulation et insiste sur son attachement au maintien d'un socle productif fort, seul à même d'éviter la déprise dans les régions de production les plus fragiles ;
- elle s'oppose au démantèlement des mécanismes d'intervention, qui aurait pour conséquence de laisser les agriculteurs démunis face aux retournements des marché ;
- elle conditionne la disparition des quotas dans le secteur laitier à des mesures transitoires de soutien pour les régions de production dépendant le plus de cette filière ;
- elle demande un assouplissement des mécanismes de l'article 68, afin de réallouer les aides au profit de filières aujourd'hui en crise ou en difficulté ;
- enfin, elle formule une série de recommandations plus accessoires, comme le refus du découplage total de toutes les « petites productions végétales », la réévaluation plus fréquente des niveaux d'aide aux filières au regard de la conjoncture, le développement de mécanismes assurantiels, ou encore la nécessité de soutenir l'innovation dans le secteur agricole.
Puis M. Jean Bizet, rapporteur, a proposé de compléter ce texte afin de tenir compte de l'avancement des dernières négociations à Bruxelles, à travers des amendements tendant à :
- s'agissant de la modulation obligatoire, réduire son taux, augmenter le taux de cofinancement des mesures qu'elle permet de financer et ouvrir le champ de ces dernières à de nouveaux objectifs ;
- s'agissant de l'intervention, la limiter dans le temps ou dans les quantités au cours d'une campagne donnée, afin d'éviter qu'elle ne devienne pour les producteurs un débouché garanti ;
- sur les quotas laitiers, ne prévoir qu'une hausse modérée de leur plafond d'ici à 2013, instaurer des mesures d'accompagnement pour les régions potentiellement les plus touchées par leur disparition, mettre en place des dispositifs de gestion des volumes dans les zones d'appellation d'origine protégée (AOP) et maintenir des aides pour le stockage privé du beurre.
Sous réserve des ces quelques ajouts, il a proposé l'adoption de cette proposition de résolution, afin de soutenir le ministre en charge de l'agriculture dans des négociations finales, qu'il a qualifiées de très délicates.
Un large débat s'est alors ouvert.

a mis l'accent sur l'importance de la production énergétique agricole, demandant qu'elle soit mentionnée dans la proposition de résolution.

a estimé préférable de s'adapter à la régionalisation des aides, qu'elle a jugée inéluctable, plutôt que de s'y opposer totalement comme le soutient la proposition de résolution. Par ailleurs elle s'est inquiétée des transferts budgétaires ou « modulation » entre les aides à la production (« premier pilier » de la PAC) et les aides au développement rural non liées aux quantités produites (« deuxième pilier »), les aides à la production ayant permis de préserver l'existence de nombreuses exploitations.

a porté l'accent sur les évolutions contrastées selon les filières du revenu agricole dans les vingt-cinq dernières années. Il a souhaité que la proposition de résolution mentionne l'intérêt particulier que présente l'élevage ovin, notamment pour éviter la progression des friches.

Tout en déclarant partager certaines des idées formulées par la proposition de résolution, M. Gérard Le Cam a souligné la contradiction latente entre compétitivité agricole et respect de l'environnement. S'agissant des quotas laitiers, il a estimé que leur suppression à terme risquait d'entrainer la disparition de nombreuses exploitations. Il a également considéré que le découplage des aides était une aberration économique. Il a enfin condamné les effets de la spéculation sur les matières premières agricoles.

a tout d'abord mis l'accent sur la très forte volatilité qui a caractérisé l'évolution des quantités produites ainsi que des prix observés dans les productions agricoles au cours des années récentes, alors que la hausse continue du coût des intrants pesait sur les marges. Il s'est opposé à l'instauration d'un découplage total afin que les aides conservent un lien avec la production, avant d'insister sur la nécessité d'une solidarité entre céréaliers et éleveurs.

a plaidé pour le maintien des mécanismes d'intervention et des quotas laitiers, et a proposé qu'une évaluation de la PAC soit conduite avant 2013, compte tenu de l'absence de visibilité sur ses perspectives. En réponse à sa question sur la procédure d'élaboration des propositions de résolution européennes, M. Jean-Paul Emorine, président, a indiqué que le rôle de la commission des affaires européennes se limitait à une vision globale et que l'élaboration d'une résolution relevait de la pleine compétence de la commission permanente compétente au fond.

En réponse à M. Jean-Jacques Mirassou, qui soulignait la diversité du secteur agricole et la nécessité de s'appuyer en conséquence sur une concertation avec les différents acteurs, M. Jean-Paul Emorine, président, a rappelé que la proposition de résolution faisait suite aux travaux d'un groupe de travail, composé de douze sénateurs représentant l'ensemble des sensibilités politiques présentes au sein de la commission, qui avait procédé à des auditions de personnalités reconnues pour leur action, leur compétence ou leur expertise dans les problématiques agricoles.

Après avoir considéré qu'un découplage total des aides risquait de remettre en cause leur légitimité et de mettre ainsi en danger la PAC dans son ensemble, M. Paul Raoult a estimé que la proposition de résolution devait s'opposer résolument à la suppression des quotas laitiers, qui ont permis de maintenir en vie les petites et moyennes exploitations. Il a également fait valoir qu'il convenait de soutenir l'élevage dans toutes les régions, et pas uniquement en montagne. S'agissant du lien entre agriculture et environnement, il s'est inquiété de la perte de vitesse des mesures agri-environnementales. Enfin, il a souligné l'importance de l'objectif de sécurité et d'autonomie alimentaires pour l'Europe, s'inquiétant, à titre d'exemple, de la disparition des industries sucrières du Nord de la France.

a demandé que la proposition de résolution mentionne l'agriculture biologique, qui fait vivre de nombreux agriculteurs dans le respect de l'environnement.

Faisant valoir sa qualité d'élu de montagne, M. Pierre Hérisson s'est félicité des positions exprimées en faveur du maintien des quotas laitiers.
Notant que la proposition de résolution s'opposait à la régionalisation des aides parce qu'elle aurait pour effet d'instaurer une situation discriminatoire entre espaces régionaux, M. Alain Fauconnier a estimé qu'une telle situation existait déjà entre les régions françaises et qu'il ne pouvait donc être reproché à la régionalisation de la provoquer.

est intervenue au titre des amendements qu'elle avait déposés sur la modulation des crédits entre le premier et le second piliers de la PAC. Elle a considéré que, depuis la réforme de la PAC en 2003, le second pilier n'avait pas été suffisamment doté pour permettre un développement rural harmonieux, notamment pour les jeunes agriculteurs qui ont besoin de services publics et de services à la personne de qualité. Elle s'est prononcée en faveur d'une modulation obligatoire renforcée afin d'assurer au second pilier un meilleur financement.

Répondant aux intervenants, M. Jean Bizet, rapporteur, a apporté les précisions suivantes :
- une proposition de résolution permet d'exprimer l'avis de la représentation nationale sur un sujet d'actualité et d'appuyer les ministres négociant les textes s'y rapportant au sein des instances européennes. L'existence d'une majorité qualifiée parmi les 27 Etats membres en faveur de la suppression à terme des quotas laitiers rend stérile toute opposition frontale à cet égard et il convient en revanche de mettre en place des mesures de transition telles que la contractualisation entre producteurs et transformateurs ;
- la remise en cause par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de la fixation du prix du lait en 1997, au motif qu'elle ferait suite à une entente entre les professionnels du secteur, est scandaleuse et il est faux d'opposer les exigences de compétitivité et le respect de l'environnement, objectifs tous deux poursuivis par une agriculture moderne ;
- les relations entre producteurs et distributeurs posent problème, mais n'ont pas vocation à être traitées dans le cadre du « bilan de santé » de la PAC, même si la proposition de résolution appelle, à ce sujet, à une meilleure structuration des organisations de producteurs ;
- la spéculation financière sur les matières premières agricoles ne répond pas aux principes éthiques et moraux, mais il est très difficile de l'empêcher ;
- les règles de l'OMC doivent être réorientées, afin qu'il soit tenu compte des problématiques sociales et environnementales dans les négociations sur l'agriculture, absentes lors du lancement du cycle de Doha en 2001 ;
- l'absence d'accord d'ici aux prochaines élections présidentielles aux Etats-Unis aura des conséquences graves sur les rendez-vous de Copenhague et Postdam dans le cadre de l'après-Kyoto ;
- les revenus des agriculteurs s'effritent actuellement en raison d'une baisse du cours des céréales et du maintien à un prix élevé des intrants et il faut prendre garde à l'interdiction de molécules ou de produits de traitement des plantes pour lesquels il n'en existe pas de substitution, ce qui risquerait de provoquer indirectement une inflation des biens alimentaires. Le Gouvernement, conscient de ce problème, a proposé la mise en place de partenariats public-privé pour favoriser la mise au point de produits non rentables économiquement, mais indispensables pour de petites filières où les volumes de production restent faibles ;
- s'agissant de la modulation, le dispositif pourra profiter aux éleveurs par l'intermédiaire du mécanisme de l'article 69 révisé ;
- les excès de l'ultralibéralisme doivent être limités et il convient de conserver des outils d'intervention, quitte à réformer ceux existant actuellement pour en limiter l'usage dans le temps et les volumes. Le principe d'une clause de « rendez-vous » est pertinent et est d'ailleurs prévu par un amendement pour le secteur du lait en 2010 ;
- le « bilan de santé » de la PAC doit tenir compte des réalités de terrain et fera l'objet de textes nationaux d'application, examinés en 2009 par le Parlement ;
- le découplage total est inenvisageable, mais la suppression des quotas ne se traduira pas nécessairement par le développement de laiteries industrielles du fait des exigences liées à la notion d'écoconditionnalité, qui a un impact très positif sur les pratiques agricoles. En revanche, les contrats territoriaux d'exploitation (CTE), séduisants de par leur principe de contractualisation entre l'agriculteur et la société en vue de rémunérer de bonnes pratiques ne l'étant pas par le marché, avaient mobilisé des financements excessivement lourds :
- s'agissant du secteur sucrier, la couverture des besoins énergétiques peut offrir des débouchés majeurs pour la filière au niveau national, l'usage alimentaire en étant réduit d'autant ;
- l'agriculture biologique a fait l'objet d'une prise en considération importante dans le Grenelle de l'environnement, mais n'est pas traitée en tant que telle dans le « bilan de santé » de la PAC. Il existe en ce domaine une demande non satisfaite par la production nationale, mais par des importations de marchandises dont les qualités sanitaires sont parfois discutables ;
- le secteur de la transformation accapare la plus grande part de la valeur ajoutée liée à la commercialisation de produits bio, et pour y remédier, la filière devrait se structurer ;
- la suppression progressive des références historiques et l'harmonisation des soutiens entre filières rétabliront plus sûrement l'équité entre productions que la régionalisation ;
- le développement rural doit prendre toute sa place, mais pas au détriment du premier pilier et de la fonction productive de l'agriculture.
Puis la commission a examiné les treize amendements déposés sur la proposition de résolution.
Elle a adopté :
- l'amendement n° 1, présenté par Mmes Bernadette Bourzai, Odette Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, précisant que l'agriculture est soumise également à des aléas financiers, du fait de la spéculation sur les matières premières agricoles ;
- l'amendement n° 2, des mêmes auteurs, donnant une valeur prescriptive, et pas seulement descriptive, au rôle positif joué par la PAC ;
- l'amendement n° 3, des mêmes auteurs, soulignant la situation très difficile que traverse le monde de l'élevage, en raison notamment de la hausse de leurs charges et des conséquences de la crise de la fièvre catarrhale ovine (FCO), après l'avoir rectifié afin qu'il fasse référence aux crises sanitaires en général ;
- l'amendement n° 5, présenté par Mmes Bernadette Bourzai, Odette Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, instaurant un plafond de 300.000 euros par exploitation pour bénéficier des aides directes de la PAC ;
- l'amendement n° 10, des mêmes auteurs, plaidant pour un soutien particulier aux filières d'élevage, en tant qu'elles contribuent au développement des territoires ;
- l'amendement n° 11, des mêmes auteurs, appelant à la mise en place de mesures d'aides d'urgence pour le secteur ovin, très durement touché par la fièvre catarrhale, ainsi que de moyens permettant de lutter contre l'ensemble des épizooties animales ;
- l'amendement n° 12, des mêmes auteurs, demandant que soit effectué un bilan du marché du lait en 2010, afin d'examiner quelles seraient les mesures les plus adaptées à une sortie du système des quotas ne mettant pas en cause pas le tissu industriel existant, notamment dans les zones de production les plus fragiles ;
- l'amendement n° 13 rectifié, des mêmes auteurs, appelant la mise en place de fonds sanitaires mobilisant des moyens professionnels et publics et financés dans le cadre du premier pilier.
Ont en revanche été retirés par leurs auteurs les amendement suivants :
- l'amendement n° 4, présenté par Mme Bernadette Bourzai, prévoyant que le versement des aides directes devait être conditionné au maintien d'une partie de l'activité agricole, M. Jean Bizet, rapporteur, ayant fait valoir que la proposition de loi mentionnait déjà une telle exigence ;
- l'amendement n° 6, du même auteur, soutenant l'accroissement financier du second pilier de la PAC, dont les mesures concernent le développement rural ;
- les amendements n°s 7 et 8, présentés par Mmes Bernadette Bourzai, Odette Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant, d'une part, à supprimer le dispositif de la proposition de résolution s'opposant à la régionalisation des aides et, d'autre part, à promouvoir cette dernière ;
- l'amendement n° 9, des mêmes auteurs, supprimant l'introduction par la Commission européenne d'un seuil minimal, fixé à 250 euros par aide ou à un hectare, pour le versement des soutiens directs de la PAC. M. Jean Bizet, rapporteur, appuyé par M. Jean-Paul Emorine, président, ont mis en avant le fait que des exploitations se situant sous ces seuils, très rares en France, ne pouvaient être considérées comme exerçant une activité professionnelle.
La commission a alors adopté la proposition de résolution ainsi amendée, les groupes socialiste, apparentés et rattachés et communiste républicain et citoyen s'abstenant.
Puis la commission a poursuivi l'examen des amendements présentés sur le projet de loi n° 497 (2007-2008) de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (urgence déclarée).
- Présidence de M. Jean-Paul Emorine, président, puis de M. Gérard César, vice-président -