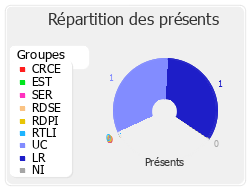Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation
Réunion du 2 octobre 2007 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion
La commission a tout d'abord entendu une communication de MM. François Marc et Michel Moreigne, rapporteurs spéciaux de la mission « Direction de l'action du gouvernement », sur des commissions placées auprès du Premier ministre : la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG) et la commission d'équivalence pour le classement des ressortissants européens dans la fonction publique.

de la mission « Direction de l'action du gouvernement », a présenté les conclusions du contrôle ainsi mené, avec M. Michel Moreigne, rapporteur spécial, au premier semestre de l'année 2007, en application des dispositions de l'article 57 de la LOLF, sur deux commissions placées auprès du Premier ministre.
Il a rappelé que ces contrôles budgétaires faisaient suite à la réalisation, par la Cour des comptes, en application de l'article 58-2° de la LOLF, d'une enquête sur « les commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ». Il a ajouté que cette enquête avait déjà donné lieu à la publication d'un rapport d'information des deux rapporteurs spéciaux.
Il a observé que quelque 40 structures, consultatives ou délibératives, placées auprès du Premier ministre, représentaient un enjeu budgétaire d'environ 15 millions d'euros.
a relevé que la commission avait proposé qu'au début de chaque législature, chacune des commissions fasse un bilan détaillé sur le coût complet de ses activités, ses missions et les suites concrètes de ses travaux concernant la législation, la réglementation et les pratiques administratives. Il a rappelé que la commission avait aussi préconisé la suppression de plusieurs commissions : la commission interministérielle de la météorologie pour la défense, le haut conseil du secteur public ainsi que le comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics.
Il a noté qu'il restait alors à apprécier la capacité des différentes commissions, placées auprès du Premier ministre, à s'inscrire dans cette démarche de transparence sur leurs coûts complets, de compte rendu de leur activité, et d'évaluation de la performance de leur action au regard des évolutions du droit et des pratiques administratives.
Il s'est demandé s'il était pertinent d'appliquer les mêmes critères à l'ensemble des commissions placées auprès du Premier ministre, compte tenu de l'extrême diversité de leurs moyens et de leurs missions.
Il a observé que le choix de la commission d'équivalence et de la CIEEMG s'était fondé sur plusieurs critères. En premier lieu, la commission d'équivalence était une structure légère, dont les charges de fonctionnement annuelles avaient été estimées à 35.668 euros par la Cour des comptes. A l'inverse, la CIEEMG était l'une des commissions placées auprès du Premier ministre parmi les mieux dotées, car elle recourait à 14 emplois équivalent temps plein travaillés (ETPT) et son budget annuel était estimé à 1 million d'euros.
a ensuite précisé que les missions de la CIEEMG relevaient des activités d'expertise militaire de l'Etat, tandis que les activités de la commission d'équivalence étaient civiles et concernaient une question transversale à l'ensemble des administrations : la prise en compte de la libre circulation des travailleurs dans l'espace communautaire. Il a précisé qu'elle se prononçait ainsi sur les modalités de classement dans l'un des corps ou des cadres d'emploi de la fonction publique française des ressortissants européens (y compris Français), lauréats des concours de notre fonction publique, qui avaient travaillé antérieurement dans l'administration d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
S'agissant de la commission d'équivalence, il a cité un exemple qui pouvait illustrer ses missions et relevé qu'un ressortissant européen reçu à un concours de la fonction publique française pouvait saisir la commission d'équivalence où le rapporteur tenait compte de la nature des missions de l'administration où il avait servi antérieurement, du niveau et de la durée des missions qu'il avait exercées ainsi que de la nature juridique de l'engagement qui le liait à l'autre administration qui l'avait employé. Il a ajouté que la commission d'équivalence était composée de son président, de représentants de trois ministères (fonction publique, affaires étrangères, budget), de l'administration d'accueil et - le cas échéant - du ministère chargé des collectivités territoriales ou du ministère chargé de la santé. Enfin, il a souligné que l'avis de la commission était consultatif, mais qu'il était généralement suivi.
a indiqué que la commission ne s'était réunie pour la première fois qu'en février 2005 et qu'il était donc encore trop tôt pour dresser un bilan définitif. Son démarrage plus lent que prévu avait toutefois justifié l'envoi d'une circulaire d'information aux directeurs des personnels des trois fonctions publiques, le 8 juillet 2005, pour qu'elle soit mieux connue. Il a indiqué que la commission s'était réunie neuf fois en 2006 pour examiner 122 dossiers.
Il a noté que si les coûts de fonctionnement étaient limités, le secrétariat de la commission était surdimensionné, de l'avis même de la commission d'équivalence. Il a souligné l'intérêt d'un calcul en coûts complets qui montrait que toutes les commissions placées auprès du Premier ministre étaient en mesure de faire un bilan financier annuel de leurs activités.
a ajouté que, ponctuellement, une économie budgétaire, de l'ordre de 2.000 euros, pourrait être opérée sur le recours à des collaborateurs externes.
S'agissant du compte rendu d'activité de la commission d'équivalence, il a relevé que des bilans, non seulement quantitatifs, mais également qualitatifs, étaient en cours d'élaboration.
Il s'est demandé s'il fallait adjoindre d'autres missions, comme le suivi contentieux, même si cela n'était pas la mission première de la commission d'équivalence.
A cet égard, il a précisé que la création de la commission d'équivalence avait répondu à une demande spécifique d'expertise, faute des moyens nécessaires dans les administrations françaises et en l'absence manifeste de pratiques homogènes. Il a estimé qu'après cette phase d'apprentissage, les activités de la commission d'équivalence pourraient être fortement réduites et largement transférées aux administrations d'accueil.
Il s'est félicité que cette perspective d'une commission allégée, se réunissant sur des cas exceptionnels, ait d'ailleurs été envisagée spontanément par son président.
Enfin, M. François Marc, rapporteur spécial, a résumé les principales caractéristiques de la commission d'équivalence : des coûts limités, une capacité à établir des comptes rendus financiers et d'activité et une existence envisagée comme temporaire. Il a estimé qu'elle devait ainsi être un modèle pour les autres commissions trop souvent créées pour répondre à des besoins ponctuels ou médiatiques.

a souligné que la CIEEMG représentait une structure plus importante en termes d'enjeux financiers, puisqu'elle employait 14 emplois et que son coût annuel s'élevait à 1 million d'euros. Par ailleurs, il a estimé que se posait la question d'un compte rendu de ses activités respectueux du secret de la défense nationale.
Il a noté que la CIEEMG intervenait dans le contrôle des exportations de matériels d'armement, lesquelles nécessitent l'obtention d'un agrément préalable (AP) puis d'une autorisation d'exportation de matériels de guerre (AEMG).
Après avoir décrit la procédure d'autorisation, il a indiqué que, pour définir la politique d'exportation d'armement de la France, la CIEEMG définissait des directives politiques qui faisaient apparaître un certain nombre d'évolutions : un accroissement des demandes portant sur des équipements considérés comme sensibles, comme les missiles, les drones et les satellites ; l'accession d'un nombre croissant de pays au statut de producteur d'armement ; l'émergence de nouveaux risques, comme le détournement vers des groupes terroristes ou le copiage de technologies de pointe ; la possibilité pour les sociétés à filiales d'obtenir des autorisations dans certains pays dont les procédures sont moins exigeantes ; enfin, le rôle croissant d'intermédiaires et de sociétés spécialisées dans le courtage d'armement.
Par ailleurs, il a indiqué que la France, tout en respectant les décisions de l'Organisation des Nations unies (ONU) sur les restrictions au commerce d'armement, s'était engagée, au niveau européen, dans une procédure de concertation et d'échange d'information avec ses principaux partenaires exportateurs d'armements (l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, la Suède et l'Espagne).
Il a noté que la procédure française avait été et restait critiquée par les industriels de l'armement, parce qu'elle opérait un contrôle plus étroit que d'autres Etats. Il a ajouté toutefois que des procédures de simplification avaient déjà été opérées et que d'autres modifications étaient en cours, comme la suppression de l'autorisation préalable pour la négociation de contrats d'armement ou l'allongement de la durée des AEMG. Il a ajouté que, suite au rapport remis au Premier ministre, au début de l'été 2006, par le député M. Yves Fromion, une nouvelle simplification était par ailleurs à l'étude depuis juin 2007, dans l'attente d'un bilan en juin 2008.
a ajouté que, lors de leur contrôle, il avait pu apprécier l'implication importante, aux côtés du SGDN, des ministères de la défense, de l'économie et des affaires étrangères. Ainsi, la CIEEMG se réunissait un jour par mois pour traiter, chaque année, 8.000 dossiers au titre des autorisations préalables et 16.000 dossiers d'autorisation d'exportation de matériels de guerre. Puis il a appelé à une véritable évaluation, en coûts complets, des besoins en fonctionnement qu'impliquait l'activité de la CIEEMG pour tous les ministères, y compris les agents en poste à l'étranger, et qui renforcerait la transparence budgétaire. Ensuite, il a appelé à l'élaboration d'indicateurs de performance, même si la démarche était délicate.
Il a ajouté que les infractions, comme l'absence de demande d'autorisation d'exportation d'armes, étaient évaluées par le SGDN à trois ou quatre par an. Il a souhaité que ces infractions puissent être commentées dans le compte rendu des activités de la CIEEMG, notamment dans le rapport au Parlement sur le contrôle des exportations d'armement.
En conclusion, M. Michel Moreigne, rapporteur spécial, a souhaité saluer la qualité du travail effectué par ces deux commissions. Il s'est déclaré convaincu que la préconisation d'un compte rendu d'activité régulier, comportant une analyse budgétaire en coûts complets et analysant l'impact des travaux des commissions sur les modifications de la réglementation et des pratiques administratives, pouvait être respectée par l'ensemble des commissions placées auprès du Premier ministre et sans doute, plus largement, par l'ensemble des commissions et instances placées auprès des différents ministres.
Il a ajouté qu'une telle démarche répondait à une exigence de transparence et qu'elle pourrait être aussi une source d'économies. Il a envisagé la suppression ou l'extinction de commissions dont l'expertise serait moins nécessaire, ou la simplification des procédures d'autres commissions qui, comme la CIEEMG, exerçaient des missions pérennes.

a souligné que les propositions formulées par les rapporteurs spéciaux pour améliorer le fonctionnement de ces commissions répondaient à l'exigence de réforme et de simplification des procédures administratives.

a mis en exergue l'importante activité de la CIEEMG et souhaité connaître le champ des 16.000 autorisations d'exportation de matériels de guerre (AEMG) examinées chaque année par cette commission.

s'est interrogé sur la fréquence des cas de refus d'autorisation d'exportation.

a justifié le bien-fondé de la procédure de contrôle des exportations d'armement par la nature sensible de ces biens.
Il a relevé que 5 % des dossiers étaient abandonnés en cours de procédure, compte tenu des risques d'un refus d'autorisation. Selon lui, l'activité de la CIEEMG devait concilier les principes de souplesse des procédures et de vigilance sur les transferts de technologie ou les ventes d'armes à certains pays.

En réponse à M. Jean Arthuis, président, M. Michel Moreigne, rapporteur spécial, a observé que le suivi de la localisation des productions d'armement relevait de la cellule d'intelligence économique du secrétariat général de la défense nationale (SGDN).

a souligné l'utilité de la procédure suivie par la France, en relevant que l'allégement des procédures en Angleterre avait au contraire conduit à une diminution des capacités d'expertise et de contrôle des opérations effectués par les industriels de l'armement. Il a relevé l'importance que l'information relative à la CIEEMG figure bien dans le rapport annuel au Parlement sur le contrôle des exportations d'armement.
Par ailleurs, il a souhaité connaître le positionnement de la commission interministérielle pour le soutien aux exportations de sécurité (CIEDES), nouvellement créée, par rapport à la CIEEMG.

a observé que les missions de la CIEEMG relevaient d'un champ différent de celles de la CIEDES et que leurs rôles respectifs seraient détaillés dans le rapport d'information.
Par ailleurs, il a relevé que le fonctionnement de la CIEEMG tendait à servir de modèle pour d'autres pays, comme Israël.

a montré que l'évolution du marché de l'armement nécessitait de prendre en compte de nouvelles réalités, comme le transit d'armes qui faisait l'objet de demandes d'autorisations spécifiques.
S'agissant des 16.000 dossiers annuels d'AEMG traités par la CIEEMG, il a fait valoir que la commission n'examinait en détail que les cas soulevant des difficultés.

s'est interrogé sur la nécessité que soient représentés à la CIEEMG, outre le SGDN, trois ministères, en charge respectivement de la défense, des affaires étrangères et de l'économie.
Par ailleurs, il s'est interrogé sur les effectifs de fonctionnaires qu'impliquaient les travaux de la CIEEMG.

a rappelé que la CIEEMG avait vocation à opérer une synthèse des points de vue de l'ensemble des administrations compétentes en matière d'exportation d'armement. Il a cependant relevé que ces besoins d'expertise impliquaient d'autres moyens en personnel que les 14 experts du SGDN directement en charge des activités de la CIEEMG : pour le seul ministère de la défense, 60 fonctionnaires d'administration centrale étaient impliqués dans les activités conduites par la CIEEMG.

a lui aussi estimé que le nombre de ministères représentés aux réunions de la CIEEMG, se justifiait par une application du principe de prudence.

a noté que la politique française de contrôle des exportations d'armements devait respecter les conventions internationales. Dans ce cadre, il a souligné qu'il était de plus en plus fréquent que les exportations d'armes s'opèrent avec des transferts de technologies, ce qui permettait aux pays clients de se doter de leurs propres capacités de production d'armes.

a souhaité savoir si le montant des vacations était adapté à la charge de travail des rapporteurs.

a relevé que la complexité des dossiers pouvait entraîner un important travail de recherche, mais que les rapporteurs attendaient d'abord de leurs activités une forme de reconnaissance.

A une question de M. Yves Fréville, il a répondu que la prise en compte des cours donnés dans l'enseignement supérieur, pour les reclassements dans la fonction publique, constituait un cas fréquent de saisine de la commission d'équivalence.
La commission a ensuite donné acte, à l'unanimité, à MM. François Marc et Michel Moreigne, rapporteurs spéciaux, de leur communication et en a autorisé la publication sous la forme d'un rapport d'information.
La commission a ensuite procédé à l'audition de M. Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, sur la situation financière internationale.

a rappelé que si M. Christian Noyer avait déjà été auditionné à quatre reprises par la commission, c'était la première fois qu'il était auditionné en amont de la discussion du projet de loi de finances. Il a précisé que le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) devait se réunir le jeudi 4 octobre 2007. Il s'est interrogé sur les conséquences, pour l'Europe et pour la France, de la crise des prêts hypothécaires à risque aux Etats-Unis (les « subprimes »), et sur la manière de limiter les « bulles » d'actifs.
En réponse, M. Christian Noyer a estimé que la crise des « subprimes » concernait un marché très limité, mais qu'elle s'était étendue à l'ensemble de la titrisation. Il a considéré que si le développement de la titrisation permettait de répartir le risque entre de nombreux acteurs, et favorisait donc le financement de l'économie, elle se traduisait également par une opacité dans la répartition du risque, ce qui pouvait nuire à la confiance en période de tension. Il a indiqué que les banques pouvaient être touchées directement, au niveau de leur bilan, ou indirectement, par l'intermédiaire des lignes de crédit accordées. Il a considéré que les banques françaises se trouvaient presque exclusivement dans le second cas de figure et que leur exposition était très limitée. Il a expliqué que, la crise des subprimes rendant difficile la valorisation des actifs titrisés, certains billets de trésorerie, finançant ces actifs, n'avaient pas été renouvelés, ce qui obligeait les banques à prêter davantage, alors même qu'elles avaient moins de ressources. Il a indiqué qu'en conséquence, les banques manquaient de ressources à court terme, d'1 à 3 mois. Il a estimé que si elles avaient du mal à en trouver, cela ne provenait pas d'une quelconque défiance vis-à-vis du « risque bancaire » lui-même, mais d'un simple problème de liquidité.
Il a indiqué que la BCE avait été « généreuse » en matière d'allocations hebdomadaires de refinancement, attribuant des allocations exceptionnelles à 24 heures les jours où la situation était tendue. Il a relativisé la manière alarmiste avec laquelle la presse avait rapporté certaines de ces opérations, soulignant que, dès lors qu'il s'agissait d'opérations à très court terme, si la BCE prêtait un jour 90 milliards d'euros, puis 50 milliards d'euros le lendemain, additionner ces deux chiffres n'avait guère de sens. Il a ajouté que la BCE avait, en outre, accru un financement à trois mois en août et en septembre 2007, inversant ainsi la proportion des financements de l'eurosystème, désormais constitués pour un tiers de financements à une semaine et pour deux tiers de financements à trois mois, afin d'alléger les besoins de financement à 1 mois, 2 mois et 3 mois.
Il a indiqué que la Réserve fédérale des Etats-Unis avait, dès le mois d'août, élargi la gamme des actifs admis en garantie, porté la durée de ses financements à un mois, et réduit de cinquante points de base son taux du guichet d'escompte. Il a considéré que cette diminution du taux d'escompte ne devait pas être interprétée comme une décision de politique monétaire. La réserve fédérale a, par la suite, le 19 septembre 2007, réduit le taux des fonds fédéraux de 5,25 % à 4,75 %.
a jugé que la crise des « subprimes » ne touchait pas de la même manière l'économie américaine et l'économie européenne, soulignant que l'économie américaine avait atteint son haut de cycle dès 2006, les deux économies présentant un décalage de 18 mois, et que c'était seulement aux Etats-Unis que les ménages avaient été directement touchés. Il a indiqué que la BCE s'était « mise en attente » et souligné que les analystes ne prévoyaient plus d'augmentation à court terme de ses taux d'intérêt.
Il a estimé que les banques centrales étaient, d'une manière générale, réticentes à considérer qu'elles devaient réguler les prix des actifs, parce qu'il n'était souvent pas possible de définir leur juste valeur, et que cela pourrait les amener à décider de hausses de taux beaucoup plus importantes que celles actuellement utilisées pour contrôler les prix des biens et des services. Il a, en outre, considéré que la BCE prenait déjà en compte indirectement les prix des actifs dans son analyse, par l'intermédiaire de l'évolution de la monnaie et du crédit, dont une forte croissance peut indiquer la constitution d'une « bulle ».
Il a jugé qu'au total la crise des subprimes avait été « salutaire », en conduisant les agents économiques à davantage de réalisme, et en mettant en évidence la nécessité d'améliorer la transparence du système financier, en particulier s'agissant de la titrisation.

a estimé que les propos de M. Christian Noyer étaient de nature à apaiser les craintes relatives à la crise des subprimes. Il s'est interrogé sur les conséquences de cette crise sur l'économie européenne.
En réponse, M. Christian Noyer a indiqué que la Banque de France n'avait pas remis en cause ses prévisions de croissance antérieures à la crise des « subprimes ». Il a souligné qu'avec une croissance de 0,6 % aux troisième et quatrième trimestres 2007, la croissance moyenne de l'économie française serait de 1,8 % en 2007, et estimé qu'elle serait vraisemblablement comprise en 2008 entre 2 % et 2,5 %, comme le prévoyait le gouvernement.

s'est interrogé sur l'ordre de grandeur du risque, pour les banques, de perte en fonds propres, sur le jugement qu'il convenait de porter sur le système de supervision financière en Europe, et sur la nécessité éventuelle de faire évoluer les méthodes de la BCE.
En réponse, M. Christian Noyer a indiqué que si les résultats trimestriels des banques françaises ne seraient connus qu'au début du mois de novembre, la Banque de France avait d'ores et déjà effectué un travail considérable afin de s'assurer que l'exposition des banques n'était pas de nature à menacer la stabilité du système bancaire. Il a estimé que si le résultat des banques serait vraisemblablement en recul au troisième trimestre, ce phénomène devrait demeurer modéré, soulignant que la part de la titrisation dans les actifs et les revenus des banques françaises était faible.
En ce qui concerne la régulation du système financier européen, il s'est félicité de la très grande proximité entre la Banque de France et la commission bancaire, qu'il préside, en tant que gouverneur de la Banque de France. Il a considéré qu'il s'agissait d'un avantage dont ne disposait pas, par exemple, la Banque d'Angleterre. Il a estimé qu'une telle proximité existait en revanche, par exemple, aux Etats-Unis, dans le cas des banques de réserve fédérales. Il a jugé que le comité européen des contrôleurs bancaires pourrait fonctionner auprès de la BCE.

s'est interrogé sur l'utilité d'une unification des organes de régulation financière en Europe.
En réponse, M. Christian Noyer a indiqué que les Pays-Bas avaient décidé de confier la responsabilité de la régulation des assurances à leur banque centrale, qu'une telle réforme était à l'étude en Italie et en Espagne, et que la Banque de France avait abordé le sujet avec le ministère de l'économie, des finances et de l'emploi. Il a cependant considéré que les régulateurs pouvaient demeurer distincts, soulignant qu'aux Etats-Unis, la Réserve fédérale, responsable du système bancaire, ne l'était pas des marchés financiers, qui étaient, eux, régulés par la Securities and Exchange Commission (SEC). Il a cependant jugé que les régulateurs devaient travailler en étroite collaboration.
En ce qui concerne les méthodes de travail de la BCE, il a, à nouveau, considéré que la BCE prenait déjà en compte les prix des actifs dans son analyse, par l'intermédiaire de l'évolution de la monnaie et du crédit. Il a, par ailleurs, souligné que de nombreuses études économétriques montraient que la « fonction de réaction » de la BCE n'était pas différente de celle de la Réserve fédérale. Si cette dernière pouvait parfois donner l'impression d'être plus réactive, c'était parce que l'économie américaine était plus cyclique. Il a considéré que s'il était toujours souhaitable que la BCE améliore sa politique de communication, cela était difficile. En effet, le président du conseil des gouverneurs doit s'adresser à la fois aux marchés et aux opinions publiques des différents Etats ayant adopté l'euro, très différentes d'un pays à un autre. Il a déploré que les médias n'accordent pas suffisamment d'importance aux déclarations des gouverneurs des banques centrales nationales, alors que ceux-ci étaient les plus capables d'adapter la communication de la BCE aux caractéristiques propres à chaque pays.

et Yves Fréville se sont interrogés sur les causes et les conséquences de l' « aplatissement de la courbe des taux ».

s'est inquiété du rôle croissant des « fonds souverains », mis en place par des Etats disposant d'un solde extérieur fortement excédentaire, comme la Chine ou certains Etats producteurs de pétrole, et acquérant des actifs à l'étranger. Il a souhaité faire le point sur l'application de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007, portant diverses dispositions intéressant la Banque de France, adoptée à son initiative, et qui supprimait le Conseil de la politique monétaire, ainsi que sur la réforme des retraites à la Banque de France.
En réponse, M. Christian Noyer a souligné que les taux d'intérêt à long terme avaient significativement augmenté en 2006 et 2007, et que l'on semblait donc assister à la fin de l' « aplatissement de la courbe des taux », le fameux « conundrum » (énigme) évoqué en 2005 par M. Alan Greenspan, alors président de la Réserve fédérale. On l'explique habituellement par l'importance des liquidités internationales due aux forts excédents de la Chine et des pays exportateurs de matières premières. Il s'est interrogé sur les causes de cette augmentation des taux d'intérêt à long terme, estimant qu'elle pouvait témoigner de la prise de conscience, par les investisseurs, du fait que les taux d'intérêt à court terme n'allaient pas « éternellement » demeurer au très bas niveau qui était le leur après le 11 septembre 2001, et que les titres à long terme étaient, par nature, plus risqués que les titres à court terme. Il a considéré que le véritable problème était non l' « aplatissement de la courbe des taux », mais le niveau élevé des taux interbancaires à trois mois, qu'il avait déjà évoqué. Il a, à nouveau, souligné la nécessité d'améliorer la transparence du système financier, afin de recréer un climat de confiance.
En ce qui concerne les fonds souverains, il a rappelé que la Norvège disposait d'un fonds alimenté par les revenus du pétrole, et cherchait à valoriser des actifs, dans une logique de fonds de pension. Il a indiqué ne pas disposer d'informations selon lesquelles le fonds récemment créé par la Chine obéirait à une logique d'acquisition d'actifs stratégiques à l'étranger.
Il a estimé que la loi du 20 février 2007 précitée avait été mise en oeuvre dans de bonnes conditions, en particulier en ce qui concernait la suppression du Conseil de la politique monétaire. Il a indiqué que les négociations avec les syndicats à la suite de la modification du code du travail avaient bien avancé. Il a ajouté que les retraites seraient progressivement alignées sur le régime de la fonction publique, avec une durée de cotisation de 40 ans et un relèvement à 65 ans de l'âge limite, l'intégration de la décote et de la surcote, la prise en compte des 6 derniers mois d'activité, et l'extension des cotisations à tous les éléments fixes de la rémunération. Il a précisé qu'un régime spécifique avait été maintenu pour les personnes effectuant les travaux les plus pénibles, notamment les papetiers-imprimeurs et les chauffeurs-convoyeurs.

s'est interrogé sur le montant du dividende que la Banque de France devait verser à l'Etat en 2008.
En réponse, M. Christian Noyer a indiqué que la Banque de France avait indiqué à l'Etat pouvoir verser 1,6 milliard d'euros, et que c'était ce montant qui figurait dans le projet de loi de finances pour 2008. Il a rappelé qu'en 2007, ce montant avait été de 950 millions d'euros en loi de finances initiale, 920 millions d'euros ayant effectivement été versés. Il a estimé qu'en y ajoutant plus d'1 milliard d'euros d'impôt sur les sociétés, la Banque de France serait en 2008 le principal contributeur au budget de l'Etat, avant même la Caisse des dépôts et consignations.
Il a indiqué qu'avant la réforme des retraites décidée en novembre 2006, l'engagement non couvert était de 6,6 milliards d'euros. Il a estimé, s'appuyant sur des calculs encore provisoires, que la réforme devrait ramener cet engagement à environ 6 milliards d'euros en 2007. Il a souhaité que la Banque de France continue de réduire cet engagement non couvert de 400 millions d'euros par an, par des provisionnements complémentaires.
Au total, M. Jean Arthuis, président, a jugé rassurants, pour la stabilité du système financier international, les propos du gouverneur.