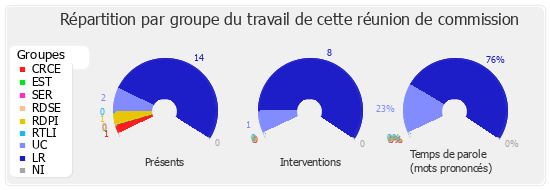Commission des affaires économiques
Réunion du 18 novembre 2008 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion
La commission a tout d'abord procédé à l'audition de M. Pierre Gadonneix, président directeur général d'EDF sur le projet de loi de programme n° 42 (2008-2009) relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.
a exprimé sa satisfaction de pouvoir être entendu par la commission des affaires économiques sur le projet de loi de programme relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, qui doit être examiné en janvier prochain par le Sénat. Il s'agit d'un texte important qui prend en compte les enjeux du développement durable et, à cet égard, EDF considère qu'elle a un rôle essentiel à jouer pour améliorer l'avenir énergétique de la France.
En préambule, il a fait valoir que les grandes orientations stratégiques de l'entreprise, qui visent à assurer la sécurité d'approvisionnement et à produire de l'énergie dans des conditions respectueuses de l'environnement, n'avaient pas été modifiées par la crise économique et financière actuelle.
Tout en reconnaissant néanmoins que cette crise ne saurait avoir aucun impact sur l'entreprise, il a rappelé qu'EDF, placée dans une posture relativement favorable par rapport à d'autres acteurs économiques, disposait de plusieurs atouts permettant d'en atténuer les effets. Ainsi, l'entreprise produit, distribue et commercialise un bien indispensable dont la consommation se substitue difficilement à d'autres énergies, ce qui confère à sa demande un caractère prévisible ; la structure de son capital, dans lequel l'Etat est majoritaire, garantit à l'entreprise la stabilité nécessaire à une politique industrielle de long terme ; enfin elle dispose d'un patrimoine industriel dont la valeur intrinsèque n'est pas affectée par les perturbations des marchés financiers. Cette crise ne remet pas en cause la vision à long terme d'EDF, qui repose sur les trois orientations fondamentales que sont la sécurité d'approvisionnement, le respect de l'environnement et les économies d'énergie, l'ambition étant pour l'entreprise de devenir un des leaders mondiaux dans la lutte contre le changement climatique. Sa stratégie s'inscrit donc parfaitement dans le cadre du projet de loi « Grenelle de l'environnement ».
a ensuite précisé que, pour répondre aux exigences environnementales, l'entreprise poursuivait différents axes stratégiques :
- le développement d'un programme d'investissement ambitieux. En 2005, l'entreprise a mis un terme à la baisse constatée depuis 2002 du niveau des investissements et souhaite désormais porter ceux-ci à un niveau deux fois supérieur à celui enregistré en 2005. EDF va investir dans l'amélioration de la qualité des réseaux de transport et de distribution et du développement des capacités de production d'électricité. La France vit depuis trop longtemps dans l'illusion de surcapacités en matière de production d'électricité, ce qui ne correspond plus à la réalité, surtout pour satisfaire la demande en période de pointe. Aussi, pour financer les investissements qui s'imposent, il est nécessaire que le tarif intégré d'électricité soit fixé à un niveau adéquat. Or, en 2008, EDF se retrouve dans une situation inédite où les recettes provenant des activités exercées en France sont inférieures aux dépenses d'investissement courant engagées sur le territoire national ;
- la relance du nucléaire civil au niveau mondial. La France est à cet égard en position favorable avec la construction du réacteur EPR à Flamanville dont le chantier progresse et dont le raccordement au réseau est prévu pour 2012. La Grande-Bretagne possède également un potentiel important de développement de la filière nucléaire, EDF devant prendre le contrôle de British Energy d'ici à la fin de l'année 2008. L'entreprise a également signé deux contrats avec une entreprise chinoise afin de construire et d'exploiter deux réacteurs EPR sur un site à proximité de Hong Kong. Elle est également en pourparlers aux Etats-Unis, pays dans lequel elle a créé une « joint-venture » et en Afrique du Sud, où elle a répondu à un appel d'offre en partenariat avec Areva, Bouygues et Alstom ;
- faire d'EDF un leader en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique. L'entreprise a opté pour une stratégie de développement d'une production électrique diversifiée reposant sur différentes filières parmi lesquelles l'éolien, la biomasse, l'énergie marine et le solaire. Ainsi, EDF Énergies Nouvelles, filiale de l'entreprise, a récemment fait l'objet d'une augmentation de capital, un partenariat a été lancé avec des constructeurs automobiles pour développer des concepts de véhicules électriques et des offres commerciales ont été développées auprès des consommateurs pour encourager l'utilisation de l'énergie solaire notamment.
a estimé que ces différents axes stratégiques étaient de nature à favoriser les économies d'énergie et la production d'électricité faiblement émettrice de dioxyde de carbone (CO2). C'est dans ce contexte qu'il a tenu à commenter certains aspects du projet de loi « Grenelle de l'environnement ».
D'un point de vue général, l'entreprise est favorable aux mesures prévues par ce texte. La France dispose d'un avantage par rapport à ses voisins européens puisqu'elle est, grâce à l'électricité nucléaire et hydraulique, qui représente 90 % de la production annuelle, le pays le moins émetteur de CO2. Ainsi, le parc de production d'EDF émet 42 grammes de CO2 par kilowattheure (kWh) produit soit neuf fois moins que la moyenne du parc européen. L'entreprise s'engage néanmoins à diminuer de 20 % ses émissions de CO2 sur la période de référence 1990-2020 définie par le protocole de Kyoto, en agissant principalement sur la modernisation de ses centrales thermiques qui servent à la production de pointe et représentent environ 5 % de la production. Cet élément n'exonère toutefois pas la France et EDF d'oeuvrer en faveur de la promotion des économies d'énergie.
Abordant ensuite les dispositions relatives à la consommation énergétique des bâtiments, M. Pierre Gadonneix a rappelé qu'EDF avait pris l'engagement de favoriser l'efficacité énergétique, faisant de cet objectif un des axes privilégiés de sa stratégie commerciale. 10 000 conseillers clientèle ont ainsi été formés à l'éco-consommation, 350 000 logements privés et 120 000 logements sociaux auront fait l'objet de rénovations thermiques entre juillet 2006 et juillet 2009 et 50 000 chauffe-eau solaires auront été installés dans les départements et collectivités d'outre-mer. L'entreprise a également procédé à la promotion des ampoules « basse consommation », signant un accord avec le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui prévoit la commercialisation, en moins d'un an, de 10 millions d'ampoules de ce type à un prix inférieur à deux euros. Il s'est par ailleurs félicité de ce que les pouvoirs publics développent l'instrument des certificats d'économies d'énergie, mécanisme qui a accru les efforts de l'entreprise en faveur de la réduction de la consommation.
Dressant ensuite un état des lieux de la situation énergétique des logements, il a indiqué que le chauffage électrique équipait un quart des 30 millions de logements existants, ainsi que les trois quarts des logements neufs construits chaque année, soit environ 300 000 logements. La règlementation thermique applicable impose des normes d'isolation spécifiques et plus contraignantes pour les logements équipés de chauffage électrique par rapport à ceux qui sont chauffés par des énergies fossiles, ce qui les rend plus économes en énergie. Le chauffage électrique s'est développé dans les logements neufs principalement pour des raisons liées au prix relatif des énergies, le tarif de l'électricité n'ayant augmenté que de 5 % en 5 ans contre 56 % pour celui du gaz. Enfin, il a fait remarquer que les logements français consommaient en moyenne moins que les logements allemands.
a estimé qu'à l'avenir la France aurait besoin de toutes les formes d'énergie disponibles et que la règlementation thermique devait laisser sa chance à chaque filière sans exclure a priori une forme de chauffage. Les efforts à réaliser dans ce domaine doivent s'orienter en priorité sur la performance énergétique et les économies d'énergie. A cet égard, des marges de progrès sont envisageables notamment grâce à des solutions faisant appel aux pompes à chaleur, aux chauffe-eau solaires ou à des matériaux isolants. Toutefois, ces solutions techniques nouvelles ne seront pas toutes disponibles d'ici à 2012 à des conditions techniques et économiques raisonnables, notamment les pompes à chaleur, pour être proposées dans les différents types de logement, notamment le logement collectif. En outre, les dispositions relatives au bâtiment du projet de loi « Grenelle de l'environnement » ne proposent pas un traitement spécifique de la question de l'eau chaude sanitaire qui n'a pourtant pas de rapport avec celle de l'isolation. Ainsi, les 11 millions de ballons d'eau chaude actuellement détenus par les ménages français consomment en moyenne 55 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an, 75 kWh pour certains logements, et sont programmés pour fonctionner la nuit, aux heures creuses, c'est-à-dire en faisant appel à la production d'électricité d'origine nucléaire, soit quasiment sans émissions de CO2 et à des conditions de tarif particulièrement favorable au pouvoir d'achat.
Il a expliqué que cette difficulté venait de ce que les consommations d'énergie dans les bâtiments au regard de la réglementation thermique sont comptabilisées en énergie primaire. Or, l'électricité n'est pas une énergie primaire, puisque sa production nécessite l'utilisation d'autres sources d'énergie, fossiles, minérales ou renouvelables, ce qui explique que la comptabilisation de l'électricité diffère selon qu'elle est exprimée en énergie primaire ou en énergie finale. Le passage d'une unité à l'autre est réalisé en appliquant à l'énergie finale un coefficient de 2,58, correspondant peu ou prou au rendement moyen des centrales de production. Dès lors que les consommations énergétiques dans les bâtiments sont décomptées en énergie primaire, il apparaît donc nécessaire de moduler le seuil des 50 kWh, puisque la production d'eau chaude sanitaire au moyen d'un ballon d'eau chaude sature, à elle seule, ce seuil. A cet égard, le texte de l'article 4 du projet de loi, tel qu'amendé par l'Assemblée nationale, est satisfaisant puisqu'il laisse ouvert, dans les constructions neuves, le recours aux différentes solutions énergétiques.
Puis M. Pierre Gadonneix a rappelé le rôle-clé joué par le parc hydraulique de l'entreprise pour la sécurité d'approvisionnement et la sûreté du système électrique national. Cette production, d'origine renouvelable, constitue un atout indéniable pour répondre aux pointes de consommation. A titre d'exemple, lors de l'incident du 4 novembre 2006, EDF a été en mesure de mobiliser, en moins de 20 minutes, près de 5.000 mégawatts (MW) de puissance supplémentaire au moyen de ses barrages hydro électriques pour limiter les conséquences de la panne d'électricité. En outre, EDF, premier exploitant hydraulique en Europe, a prévu d'investir près de 500 millions d'euros au cours des années 2006-2011 pour renforcer la sécurité et la performance des barrages, soit un doublement de l'effort par rapport à la période précédente, ce qui permet d'assurer la pérennité de ce patrimoine. L'entreprise est par ailleurs extrêmement attentive à favoriser la concertation et le dialogue entre les différents usagers de la ressource en eau pour créer les conditions d'une gestion équilibrée de cette ressource.
L'enjeu principal s'agissant de cette source d'énergie est celui du maintien de son potentiel de production. L'absence, dans le texte du projet de loi, de toute référence à un effacement des barrages qui constitueraient un obstacle à la continuité écologique est donc, à ce titre, un élément positif. Au demeurant, les barrages sont équipés de dispositifs permettant d'assurer la bonne circulation des espèces aquatiques.
En définitive, le président d'EDF a considéré que la France devait s'attacher à produire de l'électricité dans des conditions respectueuses de l'environnement, favorisant des émissions réduites de CO2, et a indiqué la totale disponibilité de l'entreprise pour relever ce défi.

tout en notant le caractère récent du parc nucléaire d'EDF, s'est interrogé sur les conditions dans lesquelles l'entreprise serait conduite, dans les années à venir, à financer le démantèlement de ses centrales.
En réponse, M. Pierre Gadonneix a fait valoir qu'il s'agissait d'un enjeu important pour EDF, traité en toute transparence. Il a indiqué que depuis 2005, date de l'ouverture du capital d'EDF, des sommes étaient provisionnées au sein d'un fonds dédié, extérieur à l'entreprise, pour assurer le paiement des dépenses afférentes au démantèlement. Ce fonds devrait, à terme, disposer de 16 milliards d'euros. Relevant qu'une opération de démantèlement et de remise en l'état d'un site représentait environ 12 % du coût de construction d'une centrale et réclamait des délais compris entre 10 et 20 ans, il a précisé que certaines opérations étaient actuellement en cours et que l'objectif était de remettre les sites dans un état identique à celui qui prévalait avant la construction de la centrale.

Après s'être interrogé sur les raisons pour lesquelles la centrale de Brennilis, première centrale nucléaire française, n'était pas encore démantelée, M. Bruno Sido a souhaité obtenir des précisions sur les conséquences des modifications, introduites par l'Assemblée nationale à l'article 4 du projet de loi « Grenelle de l'environnement », permettant de moduler le seuil des 50 kWh. Il s'est également interrogé sur les émissions réelles de CO2 liées au chauffage électrique, en prenant notamment en compte le fait que celui-ci est utilisé lors des heures de pointe pendant lesquelles la consommation est satisfaite par des moyens de production thermique, et sur la méthode utilisée pour déterminer le coefficient de conversion de 2,58 entre énergie finale et énergie primaire pour l'électricité, se demandant si ce calcul ne conduisait pas à pénaliser l'utilisation de cette source d'énergie dans les constructions neuves.

s'est demandé si la discussion du projet de loi ne constituait pas une occasion pour réaffirmer l'importance de l'électricité d'origine hydraulique, jugeant que de nombreux cours d'eau pouvaient encore être équipés de telles installations. Il a, à cet égard, estimé que les préoccupations de défense de certaines espèces aquatiques pouvaient conduire à pénaliser cette source de production et se heurter à l'objectif de développement des énergies d'origine renouvelable. Puis, il s'est interrogé sur le niveau du tarif de rachat par EDF de l'électricité provenant des éoliennes et sur les possibilités de valoriser la biomasse pour la production d'électricité.

Notant que la structure du parc de production d'EDF permettait de limiter les émissions françaises de CO2, M. Gérard Cornu s'est demandé si un développement supplémentaire des capacités hydrauliques ne serait pas de nature à limiter le recours à des moyens de production thermique. Puis, tout en jugeant indispensable de favoriser un accroissement de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique français, il s'est interrogé sur la soutenabilité, pour le consommateur, de l'augmentation du prix de l'électricité que cette évolution pourrait induire.

a demandé des précisions sur le calendrier de renouvellement des centrales nucléaires d'EDF et sur les perspectives d'enfouissement des lignes électriques, car leur impact visuel sur les paysages ne peut être ignoré des contraintes induites pour les exploitants agricoles. Il s'est interrogé, à cet égard, sur l'opportunité d'affecter aux exploitants de terres agricoles traversées par des lignes électriques une partie de la « redevance pylônes », dont seules les collectivités territoriales sont aujourd'hui bénéficiaires.

s'est tout d'abord étonné des déclarations du président d'EDF sur le caractère satisfaisant de la rédaction de l'article 4 du projet de loi « Grenelle de l'environnement » et s'est demandé si la fixation à 50 kWh du seuil de consommation maximale des constructions neuves à partir de la fin 2012 (fin 2010 pour les bâtiments publics et les bâtiments affectés au secteur tertiaire) ne serait pas de nature à interdire le recours au chauffage électrique par convecteur et à l'eau chaude au moyen d'un ballon, même en appliquant une modulation, dont le ministre d'Etat avait fait valoir, lors du débat à l'Assemblée nationale, qu'elle ne devrait pas excéder 20 %. Puis, soulignant l'impact visuel très négatif des éoliennes sur les paysages et rappelant les réserves récemment émises, à ce titre, par un ancien Président de la République, il s'est interrogé sur les surcoûts liés à cette source d'énergie, récemment mis en avant par une étude réalisée par l'Institut Montaigne. Enfin, il a fait part des insatisfactions de nombreuses petites et moyennes entreprises liées aux délais nécessaires pour obtenir d'EDF d'être raccordées et alimentées en électricité.

a demandé des précisions sur les efforts consentis par EDF dans le domaine de l'énergie solaire et des batteries pour développer les véhicules électriques. Se félicitant de la grande attention dont le réchauffement climatique fait désormais l'objet dans le débat public, elle a ensuite relevé qu'il était nécessaire d'être également très vigilant sur les problèmes liés à la préservation de la biodiversité.

s'est interrogé sur la possibilité pour un exploitant de moduler, en fonction de la demande, la puissance issue d'une centrale nucléaire.

Après avoir demandé des précisions sur les effets de la crise financière sur les sommes consignées dans le fonds dédié pour financer le démantèlement des centrales nucléaires, M. Louis Nègre s'est interrogé sur les délais qu'il était raisonnablement possible d'obtenir pour connecter une installation photovoltaïque au réseau et sur les effets pour la santé humaine du développement des ampoules à basse consommation.
En réponse à ces différentes interventions, M. Pierre Gadonneix a apporté les précisions suivantes :
- les travaux de démantèlement de la centrale de Brennilis avaient été démarrés mais ont été interrompus, pour une durée d'environ deux années, en raison d'une procédure contentieuse, introduite par une association et qui a aujourd'hui abouti. Ceci a pour effet d'accroître le coût de l'opération, laquelle est appelée, en tout état de cause, à se poursuivre dès que possible ;
- le coefficient de 2,58 utilisé pour convertir l'électricité en énergie primaire présente un caractère conventionnel et correspond au rendement moyen des centrales de production françaises ;
- il existe, en France, un potentiel limité de développement de l'électricité hydraulique dans la mesure où les grands sites sont déjà équipés. Selon certaines estimations, il serait possible de produire entre 2 et 7 térawattheures (TWh) supplémentaires chaque année, sur un potentiel total évalué à 70 TWh. Compte tenu de l'existence de demandes tendant à l'effacement de certains barrages et de la nécessité d'assurer, avec l'application du débit réservé, un flux régulier d'eau dans les cours d'eau, l'enjeu principal est de maintenir le solde net annuel de production hydroélectrique à son équilibre actuel ;
- l'électricité d'origine éolienne présente un coût supérieur à celle provenant des moyens thermiques ou nucléaire. Pour autant, cette réalité économique ne rend pas illégitime le recours à cette énergie, compte tenu des incertitudes qui entourent le niveau, dans les prochaines années, du prix de l'électricité. A cet égard, une augmentation du prix des énergies fossiles pourrait, à l'avenir, limiter ces surcoûts ;
- il existe encore un potentiel important pour augmenter le rendement de l'énergie solaire, notamment sous l'effet des gains liés aux progrès technologiques et à la diffusion de cette technique. En revanche, le coût de l'éolien se situe désormais vraisemblablement à son optimum économique et offre peu de possibilités d'amélioration ;
- le développement de la part de l'éolien dans le mix énergétique français met en lumière les deux questions que sont les impacts sur les paysages et le caractère irrégulier de la production d'énergie qui en résulte ;
- comparé à l'électricité d'origine thermique et nucléaire, l'éolien présente un surcoût de 50 % et le solaire de l'ordre de 500 %, même si, dans le second cas, ce surcoût est appelé à diminuer ;
- comme dans la plupart des pays, les surcoûts liés à la promotion des énergies renouvelables sont supportés par le consommateur, par l'intermédiaire, en France, du mécanisme de compensation des charges de service public de l'électricité (CSPE) ;
- l'énergie issue de la biomasse est appelée à se développer, même si son potentiel apparaît limité en raison de son coût et de la concurrence avec les usages alimentaires des productions agricoles ;
- l'âge moyen des centrales nucléaires françaises est de 23 ans, la plus ancienne ayant été mise en service il y a 30 ans. Les 58 réacteurs ont d'ailleurs été construits au cours d'une période relativement courte de 15 années. Même si la plupart d'entre eux n'atteindront pas cette durée, EDF espère que ces réacteurs, conçus pour fonctionner pendant 40 ans, pourront fonctionner jusqu'à 60 ans comme c'est déjà le cas pour nombre d'entre eux aux Etats-Unis présentant des caractéristiques techniques comparables. Il n'y a donc pas d'urgence à entamer, dès aujourd'hui, le renouvellement, du parc nucléaire et la construction du réacteur EPR sur le site de Flamanville répond avant tout à la nécessité de satisfaire les besoins supplémentaires de consommation. Dans l'attente de ce renouvellement, EDF a pour ambition de construire plusieurs centrales nucléaires à l'étranger. De la sorte, l'entreprise disposera des compétences humaines et scientifiques pour entamer, le moment voulu, le processus de renouvellement de son parc en France ;
- le modèle de réacteur EPR est appelé à être utilisé pendant une vingtaine d'années, dans l'attente du développement des réacteurs de quatrième génération. Par ailleurs, EDF est candidate pour assurer la construction du deuxième réacteur EPR, récemment annoncée par le Président de la République ;
- en comparaison de pays asiatiques, les Etats-Unis, le Canada ou le Mexique, la France est celui dans lequel les lignes électriques sont le plus massivement enfouies. La filiale d'EDF dédiée à la gestion du réseau de distribution, Electricité réseau distribution France (ERDF), consacre des investissements importants aux actions d'enfouissement, notamment pour renforcer la sécurité du réseau, considération qui prime sur le caractère peu esthétique de ces lignes ;
- les besoins de chauffage sont plus importants en hiver, mais pas nécessairement aux heures de pointes de consommation d'électricité. Dans ces conditions, le recours au chauffage électrique ne suppose pas nécessairement la mobilisation de moyens de production thermique. Selon différentes estimations, un kilowattheure de chauffage électrique émet entre 150 et 200 grammes de CO2 ;
- un ballon d'eau chaude consomme, à lui seul, 55 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an dans une habitation « standard ». Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de moduler de manière appropriée le seuil des 50 kWh ou d'exclure, dans le décompte des consommations d'énergie des constructions neuves, celles qui sont liées à la production d'eau chaude sanitaire pour permettre de continuer à équiper les logements neufs en électricité pour le chauffage et l'eau chaude ;
- EDF Energies Nouvelles, filiale d'EDF, a récemment lancé une augmentation de capital de 500 millions d'euros, notamment dans le but de financer un programme en faveur du développement de l'énergie solaire ;
- le développement de batteries électriques performantes et autonomes constitue un enjeu important pour diffuser la technologie des véhicules électriques. A ce titre, l'une des pistes envisagées pourrait s'appuyer sur les véhicules hybrides rechargeables qui permettent de lever ces difficultés. En l'état actuel des techniques disponibles, les batteries sont encore trop coûteuses, trop lourdes et peu autonomes ;
- il est possible de stocker de l'électricité grâce aux stations de transfert d'énergie par pompage (STEP) qui permettent de produire de l'électricité lors des pointes de consommation et d'utiliser l'énergie des centrales nucléaires, pendant la nuit, pour remonter l'eau dans une retenue, laquelle sera réutilisée pour produire de l'électricité. Cette technique nécessite cependant des investissements importants ;
- il est techniquement possible de moduler la puissance des centrales nucléaires, mais celles-ci sont avant tout conçues pour fonctionner de manière régulière et assurer des besoins de consommation « de base » ;
- le fonds dédié pour le financement des opérations de démantèlement est géré par des comités indépendants d'EDF et les sommes sont placées afin de limiter les risques. Ceci étant, la crise financière a eu nécessairement un impact sur le niveau de ces fonds, évalué à moins de 10 %. La loi oblige EDF à réalimenter ce fonds pour atteindre la somme de 16 milliards d'euros en 2011 ;
- certains consommateurs ont éprouvé des difficultés pour être raccordés au réseau au moment de la séparation entre les activités liées à la gestion du réseau et celles ayant trait à la commercialisation. Ces difficultés sont toutefois en passe d'être surmontées. S'agissant des délais de raccordement des installations de production, y compris celles d'une puissance modeste, ils peuvent être plus longs car il est nécessaire d'en examiner les conséquences en termes de sûreté pour les réseaux de distribution.
Présidence de M. Jean-Paul Emorine, président, puis de M. Pierre Hérisson, vice-président
Puis la commission a procédé à l'audition de M. Guy Paillotin, ancien directeur de l'INRA, auteur du plan Plan EcoPhyto 2018.
Précisant que le plan Plan EcoPhyto 2018 n'était en rien une oeuvre personnelle, M. Guy Paillotin a indiqué qu'il faisait suite à l'une des résolutions du « Grenelle de l'environnement » prescrivant de réduire de 50 % l'usage de produits phytosanitaires en dix ans si possible, suggérée par le ministre de l'agriculture et de la pêche, M. Michel Barnier. Ayant, à la demande de ce dernier, accepté de présider un groupe technique composé de représentants des différentes catégories d'acteurs et chargé d'instruire cette résolution, M. Guy Paillotin a souligné la qualité des fructueux débats qu'il a dirigés pendant six mois, la question des produits phytosanitaires n'ayant été que marginalement abordée dans le cadre du « Grenelle ». Les conclusions du groupe, largement consensuelles, ont été approuvées notamment par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et par l'association France nature environnement.
a fait observer que le postulat de départ d'une diminution de moitié des produits phytosanitaires en dix ans pouvait faire référence à plusieurs critères :
- les masses de produits actifs. Les fabricants de ces produits cherchant à accroître au maximum leur efficacité, il est en effet prévisible que leur masse totale diminue structurellement. Mais les associations environnementales n'ont pas souhaité retenir une telle référence ;
- l'impact des produits. L'absence d'indicateurs opérationnels rapportables sur la durée à un tel critère, mais également l'opposition des associations environnementales à la volonté des fabricants de ne retenir que l'impact des produits sur les exploitations agricoles et non sur l'ensemble de l'écosystème, ont conduit à abandonner également ce critère ;
- la fréquence d'intervention. Si la majorité des membres du comité était favorable à ce critère, il ne pouvait faire l'objet d'une consolidation rapide à l'échelle nationale ; il a par conséquent été aussi écarté ;
- enfin, la quantité de doses vendues rapportée à la dose unitaire spécifique de la substance active (NODU). Ce critère, simple, opérationnel et intégrable au niveau national, a finalement été retenu.
Soulignant que la France était parmi les premiers pays utilisateurs de produits phytosanitaires en volume total, mais qu'elle se situait dans la moyenne s'ils étaient rapportés à l'hectare, M. Guy Paillotin a insisté sur les risques que courait l'agriculture nationale, non seulement en termes d'image, mais surtout en dépendance vis-à-vis d'approvisionnements extérieurs, si elle ne remettait pas en cause son modèle de production intensive. Estimant qu'il ne faudrait pas compter, dans les premières années du moins, sur des innovations technologiques du secteur industriel pour tenir cet engagement de réduction, il a préféré parier sur la capacité du monde agricole à faire évoluer ses pratiques. Soulignant qu'il existait un rapport d'un à deux dans l'utilisation des produits de traitement entre les agriculteurs les plus et les moins vertueux, il a appelé à développer, valider et diffuser des méthodes de travail durables auprès du plus grand nombre d'entre eux, ainsi qu'à renforcer leur formation en jouant sur le volontarisme. Il a noté que la réglementation sanitaire française, concentrée sur l'efficacité des produits, ne permettait pas facilement de recourir à des techniques réduisant le recours aux traitements dès lors qu'elles donnaient moins de résultats en termes de production.
Anticipant la nécessité, après l'adaptation des pratiques, d'investir massivement dans l'innovation, il a regretté que les efforts en ce domaine soient dispersés en un grand nombre d'organismes de recherche. Appelant à un programme européen de recherche, il a observé que les industriels étaient davantage désireux de s'implanter sur les marchés émergents, où l'usage de produits phytosanitaires reste encore très limité, plutôt qu'enclins à engager des programmes de recherche sur de nouvelles molécules, les taux de rentabilité du secteur étant assez faibles. Remarquant que le souci d'une efficacité maximale des produits aboutissait à accroître la résistance des plantes à leur égard, il a, pour conclure, appelé à mobiliser fortement les acteurs en les encourageant à modifier leurs pratiques et en les convainquant qu'il en va d'abord de leur propre intérêt.
Cet exposé a été suivi d'un débat.

s'est inquiété de l'articulation entre le Plan EcoPhyto 2018 et le futur règlement communautaire visant à modifier la directive de 1991 sur l'utilisation des produits phytosanitaires. Il a regretté que ces deux textes, qui visent plus à protéger les utilisateurs de ces produits que les consommateurs de denrées agricoles, envisagent des interdictions importantes, alors même que les méthodes alternatives de production agricole n'existent pas encore. Ces impasses « technologiques » vont fragiliser gravement et durablement des filières, en particulier maraîchères, et conduire à des augmentations de prix des produits alimentaires. Il aurait souhaité qu'un examen plus équilibré de la situation permette de mieux prendre en compte le facteur temps, indispensable pour, d'une part, découvrir de nouvelles molécules innovantes, d'autre part, mettre au point des méthodes économiquement viables de substitution aux produits phytosanitaires, et enfin, assurer la formation des agriculteurs.

a constaté que les plantes se montraient de plus en plus résistantes à des produits phytosanitaires toujours plus efficaces : il existe donc bien un véritable problème de dépendance de la production agricole à l'usage de ces produits qui va rapidement conduire à de profondes difficultés écologiques et sanitaires. Il est regrettable que les industriels soient plus intéressés par la commercialisation des molécules existantes sur d'autres marchés que le continent européen, que par le développement de molécules nouvelles moins dangereuses pour la santé.

S'appuyant sur son expérience de viticulteur, M. Daniel Laurent a jugé extrêmement préoccupante pour l'avenir de pans entiers de l'économie agricole l'absence de délai permettant au producteur de trouver des substituts à la suppression de certaines molécules, surtout dans un contexte d'évolution rapide de la climatologie. Il a souhaité que le principe de réalité économique soit mieux pris en compte pour éviter la disparition de filières très utilisatrices actuellement de produits phytosanitaires.

a observé que l'intervention de M. Guy Paillotin rejoignait à bien des égards les informations obtenues au cours de ses auditions en tant que rapporteur des crédits du budget du ministère de l'agriculture et de la forêt destinés à garantir la sécurité et la qualité sanitaires de l'alimentation. Rappelant l'importance de la formule législative « si possible », il a souligné que la prise en compte du facteur temps était essentielle pour la formation et l'information des agriculteurs, la validation et la diffusion de méthodes de production alternatives, et enfin la recherche de nouvelles molécules. Tout en reconnaissant que certaines filières étaient mieux organisées, donc mieux préparées, que d'autres, il a estimé que la reconduction d'autorisations temporaires de 120 jours pour l'utilisation de produits désormais interdits, comme cela avait été le cas durant l'été 2008 pour un certain nombre des dizaines de molécules supprimées sans alternative, n'était pas un mode de fonctionnement satisfaisant ni susceptible d'être pérennisé. Enfin, il a considéré que les difficultés qu'allait créer le caractère drastique de cette nouvelle règlementation était un facteur supplémentaire pour décourager l'installation de jeunes agriculteurs. Aussi a-t-il évoqué l'idée d'un moratoire pour l'application de ces dispositions ou d'un conventionnement par type de production, permettant aux agriculteurs d'avoir une claire vision de l'avenir immédiat et à moyen terme.
En réponse à cette première série d'intervenants, M. Guy Paillotin a fait part des réflexions suivantes :
- la stagnation des rendements dans toutes les cultures qui utilisent des produits phytosanitaires, voire leur réduction, démontre qu'un mode de production agricole trop intensif conduit inéluctablement à une impasse ; il est donc impératif de sortir l'agriculture, notamment européenne, de la dépendance des produits phytosanitaires ;
- mais il est une seconde raison économique à ce mouvement : face à la demande sociale d'une agriculture « plus saine » qui se renforce, les concurrents de l'agriculture européenne qui utilisent peu d'intrants en font d'ores et déjà un argument commercial de vente qui rencontre un certain succès ;
- tous les acteurs responsables, y compris parmi les organisations non gouvernementales (ONG) de défense de l'environnement, sont conscients qu'il faut accorder du temps pour trouver des solutions alternatives ; reste qu'il faut se mettre d'ores et déjà en mouvement de façon à ce que des premiers résultats significatifs soient enregistrés dans les années à venir ;
- l'adhésion des agriculteurs à la démarche est indispensable, mais en réalité, beaucoup sont d'ores et déjà convaincus, à la fois au plan sanitaire (pour leur propre santé) et au plan économique (le coût des intrants ne cesse d'augmenter, les rendements stagnent et les consommateurs sont exigeants) ;
- d'ailleurs, aujourd'hui déjà, une partie significative des producteurs compte des taux d'utilisation de produits phytosanitaires très largement inférieurs à la moyenne : c'est donc que dès à présent, les techniques et méthodes de production permettent d'avancer ; si certains agriculteurs y arrivent, c'est en général qu'ils suivent des formations, acceptent des conseils, mutualisent les bonnes pratiques, etc... ; une part essentielle du succès du Plan EcoPhyto 2018 repose sur la généralisation de ces comportements, à mesure notamment du renouvellement des générations dans le monde agricole ;
- les productions dites « orphelines », c'est-à-dire celles, essentiellement maraichères et fruitières, pour lesquelles les industriels phytosanitaires n'engagent pas de recherches nouvelles et se retirent du marché car celui-ci, du fait de son étroitesse, n'est pas rentable, sont un problème en tant que tel qui n'est pas lié au Plan EcoPhyto 2018 et qui nécessiterait une réflexion ad hoc.

Observant que la recherche agronomique avait jusqu'à présent privilégié les plantes les plus rentables, qui sont aussi les plus fragiles et nécessitent de ce fait beaucoup d'intrants, de nombreux passages de traitement et des changements fréquents de variétés, M. Paul Raoult a jugé nécessaire de réorienter cette recherche sur des productions plus robustes permettant de limiter l'usage des produits phytosanitaires. Il a toutefois souligné qu'il n'était pas économiquement envisageable, même si la préservation de l'environnement, en particulier des nappes phréatiques, était essentielle, de supprimer totalement les traitements phytosanitaires et de ne pratiquer que de l'agriculture biologique.

a regretté que la recherche française ne se soit pas davantage préoccupée de développer les concepts d'agro-écologie sur lesquels s'appuient les modèles de production agricole intégrée, déjà largement mis en oeuvre dans certains pays. Il a suggéré la mise en oeuvre d'un dispositif fiscal qui renchérisse les prix des produits utilisant beaucoup d'intrants phytosanitaires et dont les ressources générées seraient destinées à la recherche agronomique publique. Enfin, il a proposé que la France adopte, pour la mise en oeuvre nationale de la PAC, le dispositif allemand allouant des droits à paiement unique (DPU) aux producteurs de fruits et légumes travaillant en production intégrée, ce qui leur permet de vendre leurs produits à des prix très compétitifs.
A cette seconde série d'intervenants, M. Guy Paillotin a répondu que :
- la valorisation des espèces qui nécessitent peu de traitements est à l'évidence une nécessité ; toutefois, il n'est pas raisonnable de demander la suppression de tout traitement : en matière agricole comme pour la santé humaine ou animale, il est normal de soigner les maladies ;
- mais pour poursuivre l'analogie, il est également indispensable, ne serait-ce que pour que les traitements continuent à être efficaces contre les maladies, de ne pas favoriser le développement de résistances par un usage massif et répété (exemple des antibiotiques) : il convient donc d'être mesuré ;
- il n'existe pas de mobilisation suffisante en faveur de la recherche publique, dont l'organisation n'est pas propice à la meilleure efficacité : il s'agit-là d'un problème politique qu'il revient aux élus nationaux de prendre en charge, de même, du reste, qu'il est de leur responsabilité de s'assurer que les crédits de la PAC sont utilisés de la manière la plus rationnelle et propice au développement durable.
En conclusion, M. Guy Paillotin a estimé indispensable de mobiliser les acteurs agricoles, de les convaincre que l'évolution que traduit le Plan EcoPhyto 2018 est une nécessité pour eux-mêmes, pour leur propre santé comme pour leur avenir économique.