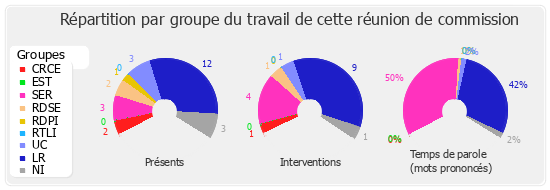Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale
Réunion du 16 juillet 2014 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion
La commission examine le rapport de Mme Isabelle Lajoux et le texte qu'elle propose pour la proposition de loi n° 719 (2013-2014), adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la sécurisation des transactions relatives à la zone d'aménagement concerté du quartier central de Gerland à Lyon.

Je vous propose de joindre à l'examen de cette proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, celle de notre collègue Gérard Collomb, qui présente le même objet. Elles visent à mettre un terme à un risque contentieux, en validant les contrats de vente ou de bail pris à l'occasion de l'établissement de la zone d'aménagement concertée du quartier central de Gerland à Lyon.
En effet, la légalité de ces actes est fragilisée par un vice de procédure remontant à plus de trente ans qui, s'il n'a jusqu'à présent donné lieu à aucun recours, pourrait à l'avenir être utilisé à des fins dilatoires, pour contester les futurs actes pris en application du nouveau plan d'aménagement du quartier Gerland.
La ZAC de Gerland a été créée au début des années 1980 sur des terrains initialement dévolus aux abattoirs municipaux de la ville de Lyon, fermés en 1967 à la suite de la délocalisation de l'activité dans une autre commune de l'agglomération. La création de la ZAC a permis de tirer parti de cette friche industrielle.
La partie Ouest de la parcelle a servi à l'implantation de l'ENS de Lyon, de l'INSERM ou de l'établissement français du sang. C'est dans la partie Est, cédée à des bailleurs sociaux ou à des personnes privées - ce qui a permis la construction de logements et de commerces et l'implantation du siège social de l'entreprise Sanofi - que se pose le problème : les opérations de cession des terrains sont entachées d'un vice de procédure susceptible de conduire à leur remise en cause. En effet, les terrains n'ont pas été formellement déclassés du domaine public de la ville de Lyon.
Même si les faits remontent à plus de trente ans et n'ont jamais fait l'objet d'aucun recours, cette remise en cause menace potentiellement la propriété de tous ceux qui se sont, en toute bonne foi, portés acquéreurs. Elle menace aussi le nouveau projet ambitieux d'aménagement de la ZAC de Gerland.
Telles sont les données du problème. De là, deux questions se posent : le vice de procédure allégué est-il réel ? Et si tel est le cas, la validation proposée est-elle acceptable ?
La première question appelle une réponse positive. En effet, la distinction entre le domaine public et le domaine privé d'une collectivité rend compte du fait que, parce qu'ils sont affectés à l'usage du public ou d'un service public, certains biens détenus par une personne publique doivent bénéficier d'une protection juridique particulière, qui se décline en trois traits : inaliénabilité, imprescriptibilité et insaisissabilité ; ceci afin d'assurer la pérennité de cette affectation et de les mettre à l'abri de toute cession ou de toute appropriation par des personnes privées. Les abattoirs municipaux étant un service public, il va de soi que les terrains sur lesquels ils étaient établis relevaient du domaine public de la collectivité.
Si l'administration peut en principe librement disposer des biens rattachés à son domaine privé, comme le ferait un particulier, tel n'est pas le cas pour les biens de son domaine public. Elle ne peut en principe les céder, sinon en procédant à leur déclassement de son domaine public vers son domaine privé. Ce déclassement procède de deux opérations distinctes. La première est matérielle : il s'agit de la désaffectation du bien initialement dévolu à l'usage du public ou à l'accomplissement du service public. Au cas présent, il s'agissait de la fermeture des abattoirs, intervenue en 1967, et de leur démolition. La seconde opération est juridique : la collectivité doit prendre formellement une décision qui constate le déclassement et le passage du terrain, qui ne fait plus l'objet d'une affectation à l'usage du public, dans son domaine privé. Le juge administratif n'accepte pas les déclassements implicites et exige une décision expresse, faute de quoi, il considère que le bien est toujours rattaché au domaine public de la collectivité concernée et demeure donc inaliénable. Il annule en conséquence les ventes, les échanges ou les dons consentis sur ce bien.
C'est là que le bât blesse, dans le cas de la ZAC de Gerland : si la désaffectation a bien eu lieu, à aucun moment la collectivité n'a formellement procédé au déclassement des terrains. Leur mise à bail ou leur vente pourraient donc être annulées, même trente ans après les faits. On ne peut exclure qu'à l'occasion du nouveau projet d'aménagement, des recours soient engagés sur ce fondement.
La proposition de loi, qui valide les opérations passées, vise à éviter ce désordre contentieux en rendant impossible une contestation sur le fondement de cette illégalité, afin de sécuriser des acquisitions opérées en toute bonne foi.
La validation est donc bien justifiée. Est-elle conforme au droit ? Il me semble que oui, parce qu'elle est très strictement délimitée.
Sans être systématique, la pratique des lois de validation est fréquente : on en compte entre dix et vingt selon les années. Elle n'en est pas moins exorbitante du droit commun, puisque l'intervention législative peut, le cas échéant, contrecarrer des décisions de justice et porter atteinte aux droits des justiciables. Elle est, partant, très encadrée par les jurisprudences constitutionnelle, administrative et judiciaire, ainsi que par celle de la Cour européenne des droits de l'homme. Ces jurisprudences sont très largement convergentes. Le Conseil constitutionnel soumet la conformité d'une validation législative à la Constitution au respect de cinq conditions, auxquelles satisfait la proposition de loi qui nous est soumise.
Première condition, la validation doit être justifiée par un motif impérieux d'intérêt général. Ce point, on l'a vu, est acquis : il s'agit d'éviter la remise en cause de situations acquises depuis trente ans et de permettre d'engager une nouvelle opération d'aménagement d'intérêt régional, voire national, avec la création d'un biopôle à Lyon.
Deuxième condition, la validation doit respecter les décisions de justice ayant force de chose jugée. À défaut, le principe de la séparation des pouvoirs serait méconnu. La proposition de loi réserve expressément ce cas.
Troisième condition, elle doit respecter le principe de la non-rétroactivité des peines et des sanctions. Cela va de soi pour ce texte qui ne porte pas sur une sanction.
Quatrième condition, l'acte validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le motif impérieux d'intérêt général visé par la validation soit lui-même de valeur constitutionnelle. Ce point ne fait pas non plus difficulté : les abattoirs municipaux étaient fermés depuis plus de dix ans au moment de la création de la ZAC, aucune atteinte n'a été portée à la continuité du service public.
Cinquième condition, enfin, la portée de la validation doit être strictement délimitée. La catégorie des actes validés doit être clairement définie, ainsi que le motif précis dont le législateur entend purger les actes contestés. Tel est bien le cas ici, le champs du texte étant strictement délimité : ne sont concernés que les actes de cession de terrain, de bail ou de concession d'usage emportant reconnaissance de droits réels, conclus dans le cadre de la ZAC de Gerland, et pour le seul motif tiré de l'absence de déclassement. Aucun autre type d'illégalité n'est couvert pas la validation.
La proposition de loi paraît donc tout à fait conforme aux exigences constitutionnelles comme aux exigences conventionnelles.
Pour conclure, je formulerai trois observations. La validation, tout d'abord, ne saurait valoir pour l'avenir : elle n'affectera que les actes antérieurs à la promulgation de la loi. À défaut, sa portée pourrait être jugée imprécise. En revanche, les actes légalement adoptés à partir de décisions validées ne pourront faire l'objet d'aucune contestation.
Deuxième observation, si la proposition de loi régularise les actes conclus en dépit de l'absence de déclassement, elle ne vaut pas, par elle-même, déclassement des terrains en cause. La ville de Lyon devra donc procéder au déclassement. Elle devra le faire, en tout état de cause, avant tout renouvellement de l'un des actes validés, soit, à leur échéance, les baux ou concessions d'usage consentis à l'époque. À défaut, le nouvel acte serait entaché de la même illégalité que celui qu'il renouvelle. J'ai alerté les représentants de la ville de Lyon sur ce point, qui m'ont assuré qu'ils entendaient bien procéder ainsi.
Enfin, l'illégalité ici couverte est une irrégularité formelle, jamais contestée en trente ans. Ce faisant, sa validation s'apparente à une simple régularisation, peu susceptible de nuire aux intérêts des justiciables. Elle est donc tout à fait opportune, et c'est pourquoi je vous propose d'adopter conforme cette proposition de loi.

Merci de cet excellent rapport, qui décrit avec précision la situation du quartier de Gerland. Qu'il soit bien clair qu'il s'agit, non pas d'y construire quelque stade, mais bien de la création d'une ZAC, engagée en 1983, sur les anciens terrains de l'abattoir, transféré dans une autre ville. L'École normale supérieure, des locaux d'activité, des bureaux y ont déjà été installés, et l'opération est presque achevée. C'est à l'occasion de la construction du siège de Sanofi, où seront employées 700 personnes, que l'on s'est aperçu de l'absence de déclassement. D'où cette demande de validation législative, destinée à sécuriser les opérations passées, sur lesquelles je précise qu'aucun contentieux n'est en cours. Il ne s'agit de rien d'autre, en somme, que de corriger une erreur formelle.

Gérard Collomb doit, comme cela peut arriver à chacun d'entre nous, assumer l'erreur d'un prédécesseur. Je ne doute pas que ce texte fera parmi nous, pour ainsi dire, jurisprudence et, s'il était adopté, nous pourrions alors vous saisir, si cela était nécessaire, du cas de la ZAC d'Aurillac, dont je ne doute pas que vous auriez à coeur de le régler par la même voie...

Je remercie notre rapporteur pour la précision de son exposé. Il nous arrive, de loin en loin, d'adopter de tels textes de validation. Le paradoxe dans le cas présent, c'est que la ZAC de Gerland a été créée par arrêté du préfet du Rhône... Un cas un peu similaire s'est présenté avec l'affaire du stade de France : nous avons dû valider la procédure de passation du contrat de concession.
Cela dit, il est urgent que la ville de Lyon procède rapidement au déclassement, pour éviter toute contestation sur les opérations futures.

Nous sommes favorables à cette régularisation, sans laquelle une opération d'aménagement d'intérêt économique serait mise en péril. Pour autant, nous sommes surpris de constater que sur une opération d'une telle envergure, le contrôle de légalité, dont on sait combien il est parfois tatillon, a fait défaut.

Je me réjouis que la ville de Lyon ait accueilli l'École normale supérieure anciennement dite de Fontenay-Saint-Cloud, dont j'ai été élève. Quand il a été question de la relocaliser à Lyon, les anciens élèves ont été sollicités, pour s'y opposer. Je suis un des seuls à avoir refusé de signer, estimant qu'à l'heure de la décentralisation, un tel projet était bienvenu.

Je vous remercie de vos observations. Il est important, pour le développement de la ZAC, de procéder à cette régularisation. M. Hyest a évoqué le cas du stade de France. Je rappelle que le Conseil constitutionnel avait jugé la première proposition de validation trop imprécise : tel n'est pas le cas de celle-ci.
La proposition de loi est adoptée sans modification.
- Présidence de M. Jean-Pierre Michel, vice-président -
Jean-Pierre Sueur est nommé rapporteur pour avis sur la proposition de résolution n° 578 (2013-2014), présentée par Mme Nathalie Goulet et M. François Zocchetto et les membres du groupe UDI-UC, tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe.

Le 4 juin 2014, nos collègues Nathalie Goulet et François Zocchetto et les membres du groupe UDI-UC ont déposé une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe. Compte tenu de son objet, cette proposition a été envoyée au fond à notre commission.
Lors de la réunion de la conférence des présidents du 9 juillet dernier, le groupe UDI-UC a fait connaître, par la voix de son président, qu'il demanderait la création de cette commission d'enquête au titre du « droit de tirage » pour l'année 2014-2015 et la saisirait à nouveau formellement le moment venu.
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 25 juin 2009 et à notre règlement, il nous appartient au préalable, y compris dans le cadre du « droit de tirage », de nous prononcer sur la recevabilité de cette proposition au regard de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qui fixe les conditions de création des commissions d'enquête. Il ne nous est cependant pas permis d'apprécier l'opportunité de la proposition lorsque nous en sommes saisis au fond, ce qui est aujourd'hui le cas, car c'est le droit imprescriptible des groupes que de déposer une demande de création de commission d'enquête dans le cadre de son « droit de tirage ».
Je vous rappelle que si nous étions saisis d'une demande de commission d'enquête portant sur des faits déterminés et non sur la gestion d'un service public, il nous faudrait préalablement saisir le garde des sceaux avant de pouvoir nous prononcer sur la recevabilité, ce qui demanderait du temps. Mais dans la mesure où il ne s'agit que d'enquêter sur la gestion de services publics, au cas présent les services de sécurité engagés dans la lutte contre les réseaux djihadistes ainsi que les services pénitentiaires, également confrontés à ce phénomène, et non sur des faits déterminés, il n'y a pas lieu de solliciter le président du Sénat afin qu'il interroge le garde des sceaux sur l'existence éventuelle de poursuites judiciaires en cours. C'est la jurisprudence constante de notre commission, qui reprend l'ancienne distinction entre les commissions d'enquête stricto sensu et les commissions de contrôle.
Les autres conditions de recevabilité sont respectées. En conséquence, je vous proposer de considérer que la proposition de résolution est recevable.
La proposition de résolution est déclarée recevable.
Enfin, la commission examine le rapport d'information de MM. Jean-Pierre Sueur et Hugues Portelli sur les « Partenariats public-privé ».

Ce rapport d'information, qui a été précédé d'une vingtaine d'auditions, formule treize recommandations, dont Hugues Portelli vous livrera le détail, tandis que je rappellerai les principes qui ont guidé nos travaux.
Les contrats de partenariat ont été créés par une ordonnance du 17 juin 2004 et ont donné lieu à une nouvelle loi en 2008. Il nous est apparu utile de faire le point après dix ans d'existence de cet outil. Nous n'entendons pas refaire ce qui a été fait : bien des travaux ont déjà été conduits, comme ceux de la Cour des comptes, du conseil général de l'environnement et du développement durable ou encore de l'inspection générale des finances, qui nous a été transmis par M. Moscovici le jour de son départ, largement cité dans notre rapport d'information, et que nous tenons à votre disposition. Mentionnons également, pour les partenariats public-privé dans le domaine universitaire, le rapport de M. Roland Peylet ; pour les prisons, les études du ministère de la Justice et le dossier paru dans la Gazette des communes pour les partenariats public-privé passés par les collectivités locales.
L'ordonnance initiale avait donné lieu à une saisine du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel, lequel, dans sa décision du 26 juin 2003, jugeant que la « généralisation de telles dérogations au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique serait susceptible de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics », définit les conditions dans lesquelles il peut être autorisé à faire appel à ces contrats, dont l'usage doit être réservé à des situations répondant à des motifs d'intérêt général tels que l'urgence qui s'attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou la complexité, plus particulièrement la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service déterminé.
Les contrats de partenariat : des bombes à retardement ? Tel est le titre que nous souhaitons donner à notre rapport. C'est bien une question que nous posons, sans lui apporter une réponse en bloc, car notre enquête nous a montré combien diverses sont les situations concernées. Nous considérons, contrairement à d'autres, que les contrats de partenariat méritent de figurer dans la panoplie des outils à la disposition de l'État et des collectivités territoriales. Sans leur être hostiles a priori, nous proposons de resserrer les conditions dans lesquelles il peut y être fait appel, pour sécuriser et la démarche et les finances des collectivités territoriales et de l'État. La mission d'appui aux partenariats public-privé - la Mappp -, créée en 2004 et rattachée au ministère des Finances, est chargée d'évaluer les projets portés par l'État, mais aussi d'assurer la promotion du partenariat public-privé. C'est ainsi que l'on entend, dans les colloques, son ancien président, M. Noël de Saint-Pulgent, s'en faire le prosélyte et en parler comme du souverain bien. Nous considérons qu'il n'y a pas lieu de réserver une telle publicité à cet outil, au détriment des autres, et c'est pourquoi nous vous proposerons de recentrer la Mappp sur sa mission première, fort utile, d'expertise.
Nous sommes très critiques sur le dispositif d'évaluation préalable. Bien des exemples montrent que l'on ne peut pas faire fond sur cette procédure. L'inspection générale des finances souligne ainsi que les délais de réalisation des projets en contrat de partenariat sont souvent sous-évalués, alors que le calendrier est déterminant et en conditionne la valorisation des gains socio-économiques associés au montage de l'opération. Ajoutant qu'un coefficient d'optimisation est parfois appliqué au coût de construction prévu dans le contrat, afin de traduire une éventuelle capacité du partenaire privé à réaliser des gains de productivité, elle relève que rien ne permet de s'assurer de l'existence de ces gains, ni de les quantifier. La Cour des comptes relève pour sa part que la comparaison des valeurs actualisées nettes donne l'avantage aux opérations réalisées selon le montage traditionnel de la maîtrise d'ouvrage publique (MOP), mais que l'analyse des risques, très subjective, le retourne en faveur des contrats de partenariat. La Mappp argue qu'en raison de la « faible culture du risque » du secteur public, ceux-ci seraient sous-estimés, d'où des dérapages importants dans les coûts de réalisation et d'entretien...
Si l'évaluation préalable est obligatoire pour les projets portés par l'État, son examen par la Mappp reste facultatif pour celles des collectivités territoriales, dont la rédaction est assurée par n'importe quelle officine : les résultats sont souvent consternants, et les prix à l'avenant.
La procédure elle-même n'est rien d'autre que la comparaison de deux hypothèses dont on ne sait rien, puisque les candidats, par définition, ne se sont pas manifestés. Plutôt donc que d'évaluer, par une sorte de méchant pari pascalien, des conjectures, mieux vaut, à notre sens, s'en tenir à une évaluation des capacités financières, en termes notamment d'échéances de remboursement, de la personne publique, collectivité ou État, qui porte le projet.
Outre que les données sont souvent biaisées, le manque d'informations quant à la soutenabilité budgétaire des engagements témoigne que la personne publique, souvent une collectivité, se contente de s'en remettre aux enjeux immédiats sans apprécier les risques sur toute la durée du contrat. M. Philippe Seguin, présentant, comme premier président, le rapport annuel de la Cour des comptes pour 2009, estimait que les risques pour la puissance publique du contrat de partenariat sont comparables à ceux du crédit revolving pour les particuliers. Prenant l'exemple du centre des archives diplomatiques du ministère des affaires étrangères, la Cour des comptes constatait que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public se traduisait par un surcoût de 41 % à la charge du contribuable et invitait les pouvoirs publics à une réflexion approfondie sur l'intérêt de ces contrats. Et Philippe Seguin de conclure : « L'État a fait preuve, dans toutes ces opérations, d'une myopie coûteuse. »
L'inspection générale des Finances estime que le recours à un contrat de partenariat « contraint sur plusieurs décennies les budgets des administrations publiques en augmentant la part de leurs dépenses dites « rigides », c'est-à-dire inévitables, et en limitant leurs capacités de redéploiement », créant ainsi « un effet d'inertie qui intervient, par ailleurs, sur des budgets publics déjà marqués par la prédominance de dépenses peu flexibles ». La Cour des comptes, quant à elle, estime que le choix du partenariat public-privé pour les prisons aboutit à des contraintes très lourdes pour le ministère de la Justice, et en particulier pour la direction de l'administration pénitentiaire, dont le budget se trouve, pour une large part, mobilisé par la dette à venir. Même constat dans le rapport Peylet, pour le plan Campus, qui fait peser une lourde contrainte sur le budget des universités. La Cour des comptes relève, enfin, s'agissant du recours aux contrats de partenariat pour les hôpitaux - l'un d'entre eux a, on s'en souvient, défrayé la chronique - que les investissements réalisés par la personne privée correspondent à un endettement public, qui devra faire l'objet de remboursement. Ces différents rapports s'accordent à souligner que l'estimation est souvent sous-évaluée, et qu'à long terme, les charges sont quasiment doubles de ce qu'elles auraient été avec un investissement classique selon la procédure de la loi MOP. Le choix du contrat de partenariat crée une dette durable, qui peut aller jusqu'à quarante ans, et que nous léguons à nos successeurs et à nos descendants.
Nous ne condamnons pas l'outil en soi, car il peut être utile, mais nous mettons en garde : le coût à long terme peut être disproportionné au regard de l'avantage immédiat. On inaugure un bâtiment sans que la collectivité ait déboursé un centime, mais vient inévitablement le moment de payer. Pour éviter aux collectivités de céder à la facilité, nous recommandons de mieux encadrer le dispositif.
Dans le contrat de partenariat, comme l'ont souligné Mmes Virginie Klès et Marie-Hélène Des Esgaulx dans le rapport de la commission d'enquête sur le contrat signé avec Écomouv', en choisissant le partenaire, en général un grand groupe, on choisit tout à la fois le financier - les banques -, le concepteur- l'architecte -, le constructeur - l'entreprise qui assurera toute l'exploitation, et tous ses sous-traitants. Cette intégration a certes un côté positif. Lorsque nous avons entendu les responsables des trois grands groupes, Eiffage, Vinci et Bouygues, l'un d'eux a déploré que de magnifiques bâtiments universitaires construits par son groupe aient fini, dix ans après, dans un état déplorable par défaut d'entretien. C'est que contraint à des arbitrages budgétaires, un universitaire préfèrera toujours allouer des crédits à l'achat d'un microscope électronique qu'à des dépenses d'entretien. Dans le contrat de partenariat, le partenaire privé assure l'entretien à long terme, et c'est là un avantage. Mais il a aussi un côté négatif : rien ne garantit, en effet, que l'agrégat d'entreprises retenu dans le contrat constitue le choix optimal pour toutes les fonctions. Dans un marché public classique, chaque fonction fait l'objet d'un choix réfléchi. Et toutes les entreprises peuvent concourir pour chacune de ces fonctions. Au regard de quoi le contrat de partenariat, ainsi que le relève le Conseil constitutionnel, est dérogatoire au droit de la commande publique.
Il est d'ailleurs paradoxal que certains le défendent au nom du libéralisme, alors que l'entreprise choisie aura la main sur la totalité des fonctions. La Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) et le Syndicat national du second oeuvre (SNSO), que nous avons reçus, disent eux-mêmes qu'ils n'arrivent pas, face à ces grands groupes, à faire valoir leurs prérogatives, et ne peuvent que s'incliner. Nous proposons que la loi prévoie des procédures pour mieux défendre l'accès des PME à ce dispositif.
Nous avons également reçu les instances représentatives des architectes, qui se sont toutes exprimées dans le même sens, afin que l'architecture ne fasse plus partie des contrats de partenariat. L'architecture d'un bâtiment public n'est pas neutre : celle d'une prison, par exemple, suppose une réflexion sur la détention. De même, quand un bâtiment, dans une ville, est essentiel pour l'urbanisme, il est bon que les élus puissent décider, préalablement, de son architecture.
Telles ont été nos réflexions. Notre rapport se veut un simple matériau, destiné à alimenter un futur texte visant à mieux encadrer le recours au contrat de partenariat.

Un rappel, tout d'abord, du contexte. Le Gouvernement a déposé un projet de loi qui comprend l'habilitation à transposer deux directives européennes sur la commande publique, venues actualiser les directives de 2004, et celle relative aux concessions. Tout cela s'intégrera dans l'ordonnance qui reprendra, dans une mise en perspective, l'ensemble des dispositions relatives à la commande publique. Notre rapport vise à jeter un éclairage sur le cas du contrat de partenariat - terme que je préfère à celui de partenariat public-privé, par lequel on vise non seulement les contrats de partenariat mais parfois aussi les délégations de service public.
Les critères actuellement retenus pour le recours au contrat de partenariat sont au nombre de trois : complexité du projet, urgence, efficience économique - soit une balance entre les avantages et les inconvénients, pour un projet, des différentes modalités de la commande publique. Dans les faits, le critère le plus souvent mis en avant est celui de la complexité. Nous proposons qu'en soit retenue une définition plus précise, reprenant celle de la directive de 2004, soit l'impossibilité, pour une personne publique, de définir par elle-même les moyens de nature à satisfaire ses besoins ou les solutions techniques ou financières que le marché peut offrir.
Nous proposons également de revoir la définition de l'urgence, en nous appuyant, là encore, sur la directive de 2004, ainsi que sur la jurisprudence du Conseil d'État, qui retient la notion d'urgence impérieuse.
Quant au critère de l'efficience économique, dont la définition est très floue, nous proposons, en raison de son caractère arbitraire et subjectif, de le supprimer. Ce sont là nos trois premières recommandations.
J'en viens à ce qui concerne l'accès à la commande publique.
Notre quatrième recommandation vise à réserver les contrats de partenariat à des opérations d'un coût minimal. Près de 80 % de ces contrats sont passés par les collectivités territoriales, pour un montant moyen d'environ 60 millions d'euros, mais souvent beaucoup moins pour certaines collectivités, quand la moyenne, pour les contrats passés par l'État, est de plus de 800 millions d'euros. Nous estimons, comme l'inspection générale des finances et la Cour des comptes, qu'utiliser un tel instrument pour des opérations d'envergure limitée est disproportionné. On pourrait envisager de fixer ce coût minimal autour de 50 millions d'euros.
Cinquième recommandation : réserver, par la loi ou le règlement, une part minimale de l'exécution du contrat aux PME et entreprises artisanales, qui, dans le système intégré qu'a décrit Jean-Pierre Sueur, sont souvent mal loties : les grands groupes attributaires veulent pouvoir choisir leurs sous-traitants en toute liberté.
Rien n'est aujourd'hui prévu pour garantir le paiement des entreprises qui participent à l'exécution du contrat. C'est ainsi que les sous-traitants sont souvent les derniers servis. Notre sixième recommandation tend à renforcer les garanties de paiement, à leur bénéfice.
Notre septième recommandation propose d'exclure le choix de l'équipe d'architecture du champ du contrat de partenariat. Ce choix devra faire l'objet d'un concours préalable. Se voir imposer, dans le cadre d'un marché global, un architecte que l'on n'a pas choisi pose, ainsi que l'a expliqué Jean-Pierre Sueur, toutes sortes de problèmes.
Vient ensuite une série de recommandations relatives à l'élaboration et à l'exécution du contrat de partenariat. Il s'agit, tout d'abord, de définir une doctrine afin d'éviter le recours au contrat de partenariat lorsqu'il est peu adapté au service recherché. Les organismes publics chargés de la rédaction de l'évaluation préalable et du conseil, devraient fournir un guide de lecture du contrat de partenariat, afin de décourager son emploi dans certains cas. Je pense aux domaines où la technologie évolue rapidement, mais aussi à ceux, comme la santé, où les évolutions réglementaires sont constantes. Faute de quoi l'on risque, pour un hôpital, par exemple, de se retrouver, in fine, avec des équipements hors normes. Telle est notre huitième recommandation.
Neuvième recommandation : favoriser la mise en place, par la personne publique, d'équipes projet, recouvrant les compétences nécessaires à tous les stades du contrat de partenariat, afin d'éviter que la collectivité ne se repose entièrement sur le partenaire, au risque de voir disparaître en son sein certains métiers, pourtant indispensables au suivi et au contrôle.
Notre dixième recommandation concerne la Mappp, qui, pour n'être pas juge et partie, devrait s'en tenir à son rôle d'aide à la décision, hors de toute mission de promotion du contrat de partenariat.
Les conditions d'une évaluation préalable objective ne peuvent, on l'a vu, être réunies. La Mappp joue à la fois, auprès de l'État, un rôle de conseil et de promotion, d'où notre recommandation précédente. Quant aux collectivités locales, elles recourent à des bureaux d'études qui produisent des évaluations pour le moins légères. Notre onzième recommandation tend à ramener l'évaluation préalable à ce qu'elle doit être : une analyse juridique et financière. Il s'agit de comparer, au plan juridique et technique, le contrat de partenariat à d'autres types de la commande publique, pour voir ce qui est le mieux adapté et de mener une évaluation financière en tenant compte des besoins de la collectivité. La France n'est pas le seul pays où le contrat de partenariat a posé de graves problèmes. Au point que le plan comptable élaboré par Eurostat en 2010, et qui s'impose aux États membres et à leurs collectivités territoriales, prévoit que l'institution diligentera, deux fois par an, des missions destinées à vérifier la bonne application des contrats de partenariat. Le fait est qu'en Belgique, ce type de contrat a été utilisé, en Flandres et en Wallonie notamment, pour externaliser la dépense vers des établissements publics, qui ont intégré ces contrats dans leurs dépenses d'investissement. Eurostat exige que ces dépenses soient réintégrées avant fin 2014, dans les budgets de fonctionnement. En France, la Cour des comptes avait heureusement attiré l'attention de l'État et des collectivités territoriales sur ces exigences du plan comptable, mais il reste indispensable, en tout état de cause, tant à l'État qu'aux collectivités territoriales, de disposer d'une évaluation de long terme, pour s'assurer que leur budget de fonctionnement pourra supporter le paiement de la redevance due à la personne privée.
Notre douzième recommandation propose de confier la rédaction de l'évaluation préalable à des organismes publics, indépendants et habilités. Dès lors qu'un montant minimal de 50 millions d'euros serait retenu, le nombre de dossiers soumis à la Mappp recentrée, de surcroît, sur sa mission principale, serait beaucoup moins important.
Treizième recommandation, enfin : les collectivités territoriales devront obligatoirement recueillir l'avis de la Mappp et de la direction départementale des finances publiques, pour savoir si elles sont en mesure, juridiquement et financièrement, de signer un contrat de partenariat.

Je vous félicite, tout d'abord, d'avoir engagé cet important travail : dès lors qu'une proposition de loi sur les partenariats public-privé pourrait être déposée et qu'un projet de loi sur la commande publique est en préparation, il est bon que nous nous accordions sur des recommandations.
On ne peut qu'être d'accord pour sécuriser le système, mais jusqu'où ? Attention à ne pas empêcher, de facto, le recours au partenariat public-privé. En choisissant, tout à la fois, de limiter les possibilités de recours au critère de complexité, d'exiger que l'urgence soit « impérieuse » et de supprimer le critère d'efficience économique, vous restreignez considérablement la faculté de recourir à un contrat de partenariat. Le critère de complexité devrait, à mon sens, recevoir une définition aussi souple que possible.
Attention, également, à ne pas encadrer le dispositif à l'excès. Retenir un montant minimal ? Soit, mais c'est encore restreindre les possibilités de recourir à ces contrats. D'accord pour réserver une part de l'exécution aux PME et artisans, mais cela ne règlera pas le problème soulevé par la Capeb et le SNSO, qui se plaignent surtout d'être pris à la gorge par les prix pratiqués par les grands groupes. Exclure du contrat le choix de l'équipe d'architectes, qui devrait faire l'objet d'un concours spécifique ? Je fais le pari que l'on retrouvera les mêmes architectes. Les opérateurs privés interviendront auprès d'eux pour leur demander de postuler. En tout état de cause, il est clair que le partenaire privé au contrat gardera toujours en ligne de mire la recherche de son propre profit. Est-il bien nécessaire, enfin, de fixer un montant minimum pour recourir à ce type de contrat, sachant que le partenariat public-privé est essentiellement le fait de l'État et des grandes collectivités, qui sont dotées des moyens financiers et techniques pour y pourvoir ?
Le partenariat public-privé peut constituer un outil utile : veillons à ne pas trop l'encadrer.

Ces contrats ont tout de même permis d'accélérer les programmes d'investissement de l'Etat, ce qu'il aurait été incapable de faire avec les procédures classiques. Je pense, même si l'exemple n'est pas forcément le mieux choisi, à la mise à niveau des lycées d'Ile-de-France, dont certains n'avaient pas été rénovés depuis un siècle.
Vous insistez sur l'évaluation des coûts financiers, mais il ne faut pas oublier les coûts techniques. Une collectivité, dès lors qu'elle est maître d'ouvrage, doit disposer des services compétents. Vous avez raison de souligner que si l'on avait de vraies comptabilités de bilan dans les collectivités, les coûts apparaîtraient clairement, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Moyennant quoi, le contrat de partenariat peut, en effet, devenir une bombe à retardement.
Les prisons en partenariat public-privé, on l'a vu lors des travaux de notre commission d'enquête en 2000, ont des avantages, mais il est vrai qu'elles grèvent considérablement, à terme, le budget de l'administration pénitentiaire. Cela dit, si elles avaient été conçues autrement, il aurait bien fallu engager les dépenses d'investissement et d'entretien - lesquelles manquent souvent à l'être, d'où l'avantage du partenariat public-privé.
Je rejoins vos préconisations sur la Mappp, qui permettront d'assurer un meilleur contrôle. Je comprends mal, en revanche, celle qui concerne les architectes, qui étaient d'ailleurs rétifs au partenariat public-privé.

Le projet architectural n'est pas sans conséquence sur l'équilibre d'ensemble du projet. Plutôt qu'interdire qu'il fasse partie du contrat, mieux vaudrait s'en tenir à une simple option.
Sous le bénéfice de ces quelques observations, je remercie les rapporteurs de leur sagacité.

Merci de vous être penchés sur ce sujet important, qui touche aux finances publiques. Si nous partageons certaines de vos préconisations, nous n'en restons pas moins très critiques à l'égard du contrat de partenariat dans son principe. Je garde en mémoire le triste souvenir des marchés d'entreprises de travaux publics sur les lycées d'Ile-de-France qui favorisaient les mêmes grands groupes qu'aujourd'hui et qui ont donné lieu à un énorme scandale et valu quatre ans de prison avec sursis au président du conseil régional d'alors...
Si nous manquons encore d'une évaluation sérieuse sur ce qui a et n'a pas fonctionné, reste que les exemples que l'on entend cités le sont plutôt pour leurs dérives. Chacun connaît celui de l'hôpital de Corbeil-Essonne. Au point que l'on peut se demander si l'accélération qu'autorise, au plan financier, le recours à de tels contrats ne finit pas, au bout du compte, par coûter plus cher au contribuable.
Les partenariats public-privé posent aussi un problème démocratique. Des exécutifs transfèrent à leurs successeurs, avec parfois beaucoup de légèreté, la responsabilité de payer les ardoises. J'ai en tête l'exemple d'une collectivité qui n'a pas hésité à s'engager dans un contrat de partenariat pour la construction de collèges, alors que ses capacités financières sont très fragiles. Qu'une collectivité puisse ainsi s'engager sans connaître ses capacités financières futures pose un vrai problème.
Vos propositions limitent certes les risques, mais les critères de recours aux partenariats public-privé restent vagues. Une collectivité pourra toujours arguer que du retard a été pris pour faire valoir celui de l'urgence.
Je suis favorable à votre préconisation sur l'architecture : elle ne doit pas faire partie de ces contrats, auxquels les architectes sont d'ailleurs vivement opposés. Je crois, pour ma part, à la capacité des jurys de concours d'architecture à faire preuve d'indépendance face aux grands groupes.
Cela étant, je reste convaincu que le partenariat public-privé est un dispositif qui pose problème et qui n'a pas fait la preuve de son efficacité.

Ce rapport est frappé au coin du bon sens. Le recours au partenariat public-privé peut être une solution de facilité, une fuite en avant. Il est important de rappeler qu'il ne doit pas être utilisé pour des opérations d'investissement traditionnelles, mais doit rester réservé aux opérations de grande envergure, et faire l'objet d'une analyse financière d'une grande précision. Car il ne faut pas oublier qu'il faudra un jour payer la facture.
Les recommandations de nos rapporteurs n'ont rien de déraisonnable, elles rejoignent d'ailleurs celles qu'ont formulées la Cour des comptes et d'autres instances. Sachant ce qu'est l'état des finances des collectivités locales, il est bon d'enfoncer le clou.

Je suis prêt à vous suivre sur plusieurs points, et ne me ferai pas le sectateur du partenariat public-privé, car il faut toujours, in fine, rembourser.

Il me semble utile de distinguer les partenariats public-privé passés par l'État et ceux conclus par les collectivités territoriales. Les premiers, qui concernent souvent de grands programmes, urgents à mettre en oeuvre, permettent de mobiliser des moyens dont l'État ne dispose pas seul.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre préconisation sur l'architecture. Je pense en particulier aux programmes de logement étudiant, où le volet architectural est totalement marginal.

Le critère premier est financier, ainsi que les principes constructifs, les questions d'habillage ne viennent qu'après.
D'accord pour sécuriser, mais en veillant à ne pas introduire des contraintes qui alourdiraient et renchériraient la procédure. Je prendrai l'exemple des PME. Dans ma région, concernée par de grands projets, nous avons retenu une solution efficace, qui a consisté à créer des lots, dont certains sont, ce faisant, accessibles aux PME et TPE. Pourquoi ne pas prévoir, pour l'exécution des contrats de partenariat, une obligation d'allotir ?
Construire dans le cadre de marchés public est plus onéreux que recourir au privé. Les logements sociaux bâtis sur le fondement des règles des marchés publics coûtent entre 15 % et 20 % plus cher. C'est là un vrai problème, qui aurait mérité de figurer dans votre rapport.
Vous préconisez, enfin, de supprimer le critère de l'efficience économique. Cela m'inquiète pour les petites collectivités, souvent dépourvues de services techniques qui, en recourant au partenariat public-privé, peuvent réaliser des opérations qu'elles seraient incapables de mener seules. J'ajoute que pour les ouvrages qui appellent, après leur construction, une fonction de gestion - je pense, par exemple, à un centre des congrès ou à un complexe sportif - il serait regrettable de se priver du choix du partenariat public-privé.

Je remercie nos deux rapporteurs pour leur travail. Je suis favorable au partenariat public-privé, pour autant qu'il soit bien encadré. Pour qu'un partenariat fonctionne bien, il faut que les partenaires s'entendent clairement sur le projet. Un mauvais fonctionnement tient souvent au fait que le partenariat a été, au départ, mal engagé. Il sera bon de différencier, dans le texte de loi à venir, les partenariats public-privé initiés par l'État et ceux qu'engagent les collectivités territoriales.
Yves Détraigne nous dit que ces contrats devraient être réservés aux projets exceptionnels, mais comment les définir ? Et cela voudrait dire que seules les grandes collectivités pourraient y avoir recours.
Retenir un montant minimal, que vous venez d'évaluer à 50 millions d'euros, me paraît un peu limitatif. Un exemple : une piscine est, par définition, déficitaire, ce qui conduit les collectivités à rechercher, dans le cadre d'un partenariat public-privé, des activités complémentaires, sous forme d'un centre aquatique, pour pérenniser l'équipement.
Votre douzième recommandation mérite que l'on s'y attache. Confier l'établissement de l'évaluation préalable, recentrée sur ses dimensions juridique et financière, à des organismes publics, indépendants et habilités nous aidera à répondre à des légendes urbaines qui, lorsque nous mettons en oeuvre des projets, ont tendance à enfler, soit dans l'opposition, soit dans la population.

Je rappelle que vos interventions, qui ne sont pas toutes convergentes, seront reprises dans le rapport, qui inclura le compte rendu de cette réunion. Cela me paraît de bonne méthode.
Notre intention, monsieur Reichardt, n'est pas d'interdire. Nous estimons que le contrat de partenariat est un outil utile dans la panoplie. Cependant, la loi de 2008 a introduit le critère de l'efficience économique avec l'idée d'élargir le champ de ces contrats. Or ce critère reste parfaitement indéfini : dire que les avantages doivent l'emporter sur les inconvénients ouvre à toutes les interprétations subjectives.
Notre souci était aussi d'éviter les tautologies. Arguer de la complexité d'un contrat de partenariat pour faire appel à un contrat de partenariat en est une. Construire une salle des fêtes n'est pas bâtir le viaduc de Millau.
Nous précisons les conditions d'accès à cette procédure, dans l'intérêt des finances publiques. Les Britanniques ont inventé le partenariat public-privé, qu'ils ont nommé PFI (Private Finance Initiative). Dans sa première formule, il a donné lieu à de nombreux sinistres. Elle a donc été revue, dans le sens que nous préconisons ici. Il s'agit de prévoir des garde-fous, en trouvant le bon équilibre. Nous espérons qu'il y aura un texte de loi, et que notre rapport aidera à trouver les bonnes formulations.
Autre tautologie, la loi de 2008 déclarait urgents, jusqu'en 2013, une dizaine de domaines parmi lesquels les universités, la politique de la ville, le logement social, la gendarmerie, la police... Autrement dit, à peu près tout. Le Conseil constitutionnel n'a pas manqué de censurer cette disposition.
S'agissant du coût minimal, nous citons le montant proposé par la Capeb, sans le reprendre à notre compte, car elle met sans doute la barre un peu haut.
La différence que vous voyez, monsieur Hyest, pour les lycées et collèges se voit partout : cela s'appelle la décentralisation. Je me souviens m'être rendu, jeune député, au ministère de l'Éducation nationale, pour la construction d'un collège. J'y ai trouvé, dans un bureau reculé, un fonctionnaire désabusé, qui m'a désigné du doigt une pile de dossiers...
Cela dit, depuis la décentralisation, nous avons construit, dans le Loiret, trente collèges magnifiques, sans recourir au partenariat public-privé. Et voilà que l'on entend dire, à présent, que cela est trop complexe... Et qu'il faut recourir à un contrat de partenariat !
Sortir l'architecture des contrats de partenariat répond à une demande unanime de la profession. Il ne faut évidemment pas qu'il y ait d'arrangements en sous main, ce serait, purement et simplement, un détournement.

Ne serait-ce que par respect pour la profession d'architecte, il nous parait bon de prévoir, préalablement au contrat, un concours ad hoc. Nous avons posé la question aux trois groupes que nous avons entendus, Eiffage, Vinci et Bouygues, qui nous ont tous dit qu'ils étaient tout à fait capables de fonctionner de cette façon.
Je note que M. Favier est très critique à l'égard des contrats de partenariat.
Nous avons posé, dans ce rapport, des garanties et des conditions raisonnables. Je souscris entièrement aux propos de M. Détraigne. L'idée de prévoir un allotissement dans le bloc du partenariat public-privé, avancée par M. Vial, me paraît bonne, mais je crains qu'elle ne soit irréalisable dans ce cadre : on ne peut contraindre le titulaire du contrat de partenariat à allotir.
À Luc Carvounas je précise que sans parler de recours « exceptionnel », le Conseil constitutionnel n'en a pas moins été très clair : le contrat de partenariat est dérogatoire au droit commun de la commande publique, où toute entité peut concourir. Il faut de sérieuses raisons pour y déroger.

La définition que nous proposons de la complexité ne fait que reprendre le droit de l'Union européenne. La définition que retient le code des marchés publics est antérieure à la directive, que nous reprenons ici.
Les contrats de partenariats doivent être engagés par des collectivités vertueuses. Il serait dangereux pour une collectivité d'y recourir au motif qu'elle a des difficultés financières, car elle ne fera que décaler sa dette dans le temps.
Bien des projets seront menés, à terme, par des intercommunalités. J'ai vu le cas, dans une intercommunalité dont fait partie ma commune, d'un projet communal mené sous forme de partenariat public-privé. L'intercommunalité, qui devait le reprendre, n'est pas chaude. Personne n'a envie de reprendre une dette sur trente ans. Multiplier ce type d'initiatives reviendrait à interdire les transferts. Les collectivités doivent avoir conscience que demain, bien des domaines seront gérés par les intercommunalités. D'où la nécessité de mener, sur les projets, une évaluation financière et juridique à long terme. Le projet de loi relatif à la commande publique va un peu dans ce sens.
Les contrats de partenariat concernent moins de 10 % de l'investissement public. Cela signifie, même si les sommes en jeu sont souvent très importantes, que ces contrats sont déjà marginaux dans la commande publique. Notre seul objectif est de les rationnaliser.

Il est des cas de partenariat public-privé rentables. Au Havre, un casino a été créé par ce moyen, et le casinotier rémunère la collectivité. Même chose pour le centre des congrès : le gestionnaire prendra à sa charge l'amortissement du bien. Il est évidemment d'autres cas où le partenariat ne peut être rentable, comme celui de la construction du Grand stade.

Bien que nous ne soyons pas favorables au partenariat public-privé, nous estimons utile, pour le débat démocratique, que les travaux des parlementaires soient publiés, et voterons donc pour la publication.
La commission autorise la publication du rapport.
La réunion est levée à 11 h 35