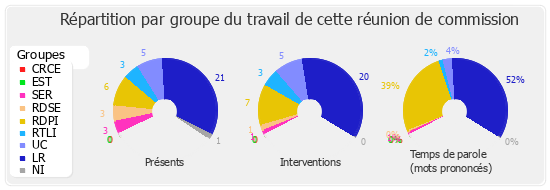Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
Réunion du 27 avril 2016 à 9h32
Sommaire
- Accord france-brésil
- Transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises - accord transfrontalier - examen du rapport et des textes de la commission (voir le dossier)
- Accord france-colombie
- Encouragement réciproque des investissements - examen du rapport et du texte de la commission (voir le dossier)
- Accord france-irak
- Encouragement réciproque des investissements - examen du rapport et du texte de la commission (voir le dossier)
- Accord france-monaco
- La place de la france dans le nouveau monde
La réunion
La commission examine le rapport de M. Antoine Karam et les textes proposés par la commission sur les projets de loi n° 153 (2015-2016) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil concernant les transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises et n° 298 (2015-2016) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil en vue de l'établissement d'un régime spécial transfrontalier concernant des produits de subsistance entre les localités de Saint-Georges de l'Oyapock (France) et Oiapoque (Brésil).

Nous examinons ce matin quatre rapports sur des conventions internationales. Deux accords avec le Brésil font l'objet d'un rapport commun présenté par notre collègue Antoine Karam.

Ces deux accords, qui font l'objet de deux projets de loi destinés à être votés conjointement, sont deux accords entre la France et le Brésil, le premier sur les biens de subsistance et le second sur les transports routiers internationaux.
Ces accords visent à accompagner l'ouverture du pont sur le fleuve Oyapock, qui marque la frontière entre la Guyane et le Brésil - le premier en établissant un régime d'exemption fiscal pour les habitants des communes frontalières, le second en fixant les conditions de circulation à la frontière des professionnels du transport routier.
Tout d'abord, quelques éléments sur la situation de la Guyane dans son environnement régional.
On l'oublie souvent, mais c'est avec le Brésil que la France partage, par l'intermédiaire de la Guyane, sa plus longue frontière terrestre : la Guyane est en effet séparée du géant sud-américain par une frontière de 725 km, dont une grande portion est matérialisée par le fleuve Oyapock, d'une longueur d'environ 500 km.
En dépit de cette proximité géographique, la Guyane n'a pas eu de liaison terrestre avec le Brésil pendant longtemps, avant la construction des premières routes. La distance entre Cayenne et Macapa, capitale de l'État brésilien d'Amapa, est de 790 km, dont 200 km de Cayenne à la frontière brésilienne. La circulation des biens et des personnes s'effectue par l'intermédiaire de pirogues qui traversent le fleuve Oyapock au niveau des communes frontalières de Saint-Georges de l'Oyapock en Guyane et d'Oiapoque au Brésil.
Du fait de cette contrainte géographique, les échanges entre la Guyane et le Brésil sont limités. En 2007, plus de 50 % des exportations guyanaises étaient destinées à la France hexagonale, contre 0,76 % vers le Brésil. Le Brésil n'arrivait qu'au 14ème rang des fournisseurs de la Guyane en 2009. Il existe toutefois une économie informelle qui vient tempérer ce constat. La faiblesse des échanges commerciaux entre la Guyane et son voisin brésilien s'explique aussi par la différence des réglementations en vigueur sur les deux territoires. Les normes européennes, qui s'appliquent en Guyane, sont globalement plus strictes que les normes auxquelles sont soumis les produits brésiliens, ce qui représente une entrave à leur pénétration sur le marché guyanais.
Concernant la circulation des personnes, chacun sait que la Guyane est confrontée à une importante immigration clandestine. D'après les chiffres communiqués par le gouvernement, la lutte contre l'immigration irrégulière a conduit en 2014 au démantèlement de 21 filières et à la mise en cause de 72 personnes. Cette forte pression migratoire s'explique par un écart de développement important entre la Guyane et l'État voisin de l'Amapa, le plus pauvre du Brésil - en 2008, le PIB par habitant de la Guyane, de 13 000 euros, était près de 10 fois supérieur à celui de l'État de l'Amapa. Les ressortissants brésiliens émigrent vers la Guyane pour des raisons essentiellement économiques, partant à la recherche d'un travail urbain ou sur les sites d'orpaillage. Pour beaucoup de Brésiliens, la Guyane est le vingt-huitième État du Brésil.
Parallèlement, le long du fleuve, et en particulier, en amont, près de la commune de Camopi, on constate une augmentation importante des violences et règlements de compte liés à l'orpaillage illégal. Des incidents assez graves ont encore eu lieu très récemment. Les orpailleurs clandestins s'organisent, saccagent et pillent les ressources au vu et au su des habitants mais également des autorités qui luttent tant bien que mal contre ce véritable fléau social, sanitaire et environnemental.
En raison de ces difficultés, la Guyane est le seul territoire français pour lequel l'obligation de visas de court séjour pour les Brésiliens n'a pas été levée, par dérogation à l'accord sur la libre circulation des personnes conclu entre le Brésil et l'Union européenne, et alors que les guyanais peuvent entrer librement sur le territoire brésilien. Les autorités brésiliennes réclament la suppression de cette obligation depuis des années. Dans un document que m'a transmis l'ambassade du Brésil exprimant la position du pays par rapport aux deux accords que nous examinons, cette exigence est encore réitérée.
J'en viens maintenant au pont sur l'Oyapock.
Le projet de construction d'un pont pour relier Saint-Georges de l'Oyapock, côté français, et la commune d'Oiapoque, côté brésilien, a été lancé le 25 novembre 1997 par les présidents Jacques Chirac et Fernando Henrique Cardoso. En tant que président du conseil régional de la Guyane, j'avais demandé au président Jacques Chirac de bien vouloir envisager qu'un jour les guyanais puisse emprunter la route transguyanaise, qui démarre au Venezuela, pour se rendre jusqu'en Argentine. Aujourd'hui toutefois, le pont n'est toujours pas ouvert ni inauguré. L'accord franco-brésilien relatif à la construction du pont a été signé en 2005, à l'occasion de la visite du président brésilien Lula en France. Cet accord a été approuvé par le Brésil en 2006 et par la France en 2007. Un appel d'offres a été lancé en 2008 pour une somme d'environ 50 millions d'euros, remporté par un consortium brésilien. La construction du pont s'est achevée en 2011. Une partie de la responsabilité relève des Brésiliens, qui n'ont pas mis en place d'infrastructures pour accueillir la police aux frontières, la douane et les services sanitaires. Sur les 590 km de route pour rejoindre Macapa, il reste environ 150 km à bitumer. Entre Oiapoque et Macapa, il y a pratiquement 10 heures à 12 heures de route et même davantage en période de saison des pluies. Ce pont, achevé depuis cinq ans, est devenu la risée de la presse en Guyane et au Brésil. Il commence en effet à se dégrader et des travaux de réfection seront nécessaires.
Pour vous faire une idée, il s'agit d'un pont à haubans de 378 mètres de longueur, comportant deux voies de 3,50 m de largeur et deux voies mixtes séparées pour piétons et cyclistes. Le tirant d'air minimal sous le pont est de 15 m, et les deux pylônes culminent à 83 m de hauteur.
Pourquoi un ouvrage aussi monumental entre deux communes isolées au coeur de l'Amazonie ? Le pont vise à faciliter les échanges avec le Brésil et à ouvrir la Guyane au reste du continent sud-américain. Il prend place en effet dans un réseau routier en projet, celui d'une « Transguyanaise » qui relierait Caracas à Macapa puis, au-delà, à Buenos Aires. Le pont est ainsi susceptible de favoriser le désenclavement de la Guyane en facilitant les échanges transfrontaliers. À l'évidence, il revêt aussi une signification politique : il constitue un « trait d'union » visible entre la France et le Brésil et matérialise ainsi le rapprochement entre nos deux pays.
Comme je l'ai déjà évoqué, le retard pris dans l'inauguration du pont est pour partie dû au fait que les accords nécessaires à son ouverture ne sont pas encore entrés en vigueur. Ce sont précisément ces accords que nous examinons aujourd'hui.
Je commencerai par présenter l'accord sur les biens de subsistance.
Cet accord, qui instaure un régime d'exonération fiscale pour l'acquisition de biens dits « de subsistance » effectués par les habitants des communes frontalières a été signé le 30 juillet 2014. Il fait suite à la signature d'un autre accord, conclu en avril 2014 sous forme d'échange de lettres, qui a institué un statut spécial de « transfrontalier » pour les habitants de Saint-Georges et d'Oiapoque. Cet accord est déjà entré en vigueur - il ne nécessitait pas d'approbation parlementaire préalable. Il dispense de l'obligation de visa les ressortissants des communes frontalières pour des séjours d'une durée inférieure à 72 heures dans la limite de ces deux communes. L'accord sur les biens de subsistance, que nous examinons aujourd'hui, vient compléter ce dispositif en exonérant les bénéficiaires du statut de transfrontalier de certains droits et taxes applicables aux produits acquis sur le territoire de l'État voisin.
Ces accords viennent formaliser les relations qui existent depuis longtemps entre Saint-Georges de l'Oyapock (4000 habitants) et Oiapoque (30 000 habitants). De nombreuses familles sont en effet dispersées sur les deux rives. Tous les jours, des enfants brésiliens étudiant au collège français traversent la frontière, de même que des enseignants français qui habitent sur la rive brésilienne.
L'accord cible spécifiquement les produits de consommation courante que les frontaliers sont le plus susceptibles d'acquérir lorsqu'ils se rendent sur l'autre rive du fleuve : nourriture, vêtements, chaussures, revues, produits d'hygiène et d'entretien. A l'inverse, alcools et tabac sont exclus du dispositif. En outre, l'accord limite le régime d'exemption aux biens faisant l'objet d'un usage courant et familial, à l'exclusion des marchandises importées à des fins de revente.
Cet accord devrait permettre d'intensifier les échanges entre les deux communes frontalières, avec pour effet d'engendrer un surplus d'activité bienvenu pour les commerces de ces deux communes. Les conséquences financières devraient par ailleurs être faibles dans la mesure où les franchises ne s'appliquent qu'aux particuliers et les produits fortement taxés, comme les alcools et le tabac, ne sont pas concernés. Le manque à gagner est évalué par les douanes à 12 000 euros par an maximum.
Le deuxième accord est relatif aux transports routiers internationaux.
Il vise à accompagner l'ouverture du pont sur l'Oyapock en fixant les conditions d'entrée et de circulation des professionnels du transport sur le territoire des deux États parties. Il ne concerne que les professionnels du transport de personnes et de marchandises, à l'exclusion des particuliers, soumis à des règles de circulation différentes.
Il s'agit d'un accord très technique. Je ne rentrerai pas dans le détail mais je me limiterai aux points les plus importants. Il ressort des principales dispositions de l'accord que tous les transports routiers internationaux effectués via le pont devront être réalisés sous couvert d'autorisations et sur la base de la réciprocité. S'agissant du transport de marchandises, les autorisations seront contingentées : leur nombre sera fixé annuellement d'un commun accord entre les Parties dans le cadre d'une commission mixte transfrontalière chargée de la mise en oeuvre de l'accord. Les transports devront en outre s'effectuer dans le respect des réglementations nationales - les transports effectués sur le territoire de la Guyane seront donc soumis à la réglementation européenne.
La commission mixte que j'ai évoquée sera présidée, du côté français, par le préfet de la Guyane. Les collectivités territoriales concernées et les représentants des milieux économiques participeront aux travaux de cette commission mixte. Suite aux entretiens que j'ai menés en Guyane sur le sujet, il semble en effet indispensable que les professionnels, notamment du transport routier, soient étroitement associés aux réunions de suivi afin qu'ils puissent exprimer et défendre leurs intérêts.
Un point n'a pas pu être réglé lors des négociations et a été renvoyé à un groupe de travail : il s'agit de la question des assurances exigibles pour franchir le pont. En effet, il existe actuellement de très importants écarts en matière de tarification et de couverture des risques entre les réglementations française et brésilienne. Les Brésiliens considèrent que des polices de responsabilité illimitée seraient trop coûteuses et nuiraient à leur compétitivité, tandis que les Guyanais redoutent une couverture insuffisante des risques et une forme de dumping.
Cette question n'a toujours pas été réglée mais ne fait pas obstacle en tant que telle à l'ouverture du pont. Si aucun accord n'a été trouvé d'ici là, le service des douanes aura l'obligation de délivrer et percevoir une « assurance frontière » au passage de la frontière.
L'ouverture du pont sur l'Oyapock aux transports routiers devrait avoir pour effet, à terme, d'intensifier les échanges commerciaux entre la Guyane et le Brésil, aujourd'hui limités. Cependant, il faut bien être conscient que les échanges ne devraient progresser que lentement. J'ai déjà indiqué qu'une des entraves aux échanges commerciaux réside dans l'écart entre les normes européennes, qui s'appliquent aux produits guyanais, et les normes brésiliennes. Cette entrave subsistera à l'ouverture du pont. D'autre part, les infrastructures routières ne sont pas encore en état d'accueillir le trafic. En particulier, des travaux doivent être réalisés du côté brésilien. Pour l'heure, la route est encore non bitumée sur une grande partie de sa longueur. À terme néanmoins, quand les travaux nécessaires auront été effectués, le pont devrait permettre d'ouvrir Cayenne vers Macapa et les autres grandes villes du Nordeste brésilien.
Pour conclure, j'insisterai tout particulièrement sur le fait que l'approbation de ces deux accords est nécessaire pour ouvrir enfin à la circulation le pont sur l'Oyapock, dont la construction est achevée depuis près de 5 ans déjà mais qui n'a toujours pas été inauguré. Ces deux accords ont le mérite de lever les derniers obstacles qui empêchent l'ouverture du pont.
En premier lieu, le Brésil craignait que l'ouverture du pont ne vienne souligner l'asymétrie des politiques de visas entre les deux pays. L'institution du régime de circulation transfrontalière, en plus d'autres cas ciblés de dispense de visas accordés récemment par la France, a contribué à apaiser ces inquiétudes. L'approbation de l'accord sur les biens de subsistance, qui complète le régime de circulation transfrontalière, parachèvera ce dispositif.
En second lieu, l'approbation de l'accord sur les transports routiers apparaît également indispensable pour envisager l'ouverture du pont. En effet, on peine à envisager d'ouvrir un pont sur lequel ne pourraient circuler que les particuliers -dont peu sont motorisés dans cette région- alors même que la construction d'un pont visait précisément l'intensification des flux humains et commerciaux, au-delà de la seule zone frontalière. D'autant que le pont est situé à presque 5 km de l'embarcadère et du centre-ville de Saint-Georges et d'Oiapoque, ce qui le rend peu praticable au quotidien pour les piétons.
Sous le bénéfice de ces observations, je recommande l'adoption de ces deux projets de loi. Le Brésil a approuvé ces deux accords en août 2015. Il est nécessaire que la France le fasse elle-même sans tarder, dans la perspective d'une ouverture du pont à l'automne 2016. Nous espérons vraiment qu'avant la fin de l'année ce pont sera ouvert aux populations et inauguré.
L'examen en séance publique est fixé au jeudi 12 mai 2016. La Conférence des Présidents a proposé son examen en procédure simplifiée, proposition à laquelle je souscris.

Je me souviens d'opérations de défrichage en Guyane, pour lesquelles l'utilisation d'une herbe adaptée provenant du Brésil était nécessaire. L'application des normes européennes contraignait à un transport via l'Europe, pour faire revenir sur le territoire guyanais une production de proximité. Le prix des semences s'en trouvait multiplié par trois. Cette situation perdure-t-elle ? Comment faciliter les échanges de marchandises entre le Brésil et la Guyane dans ces conditions ?

En effet, cette situation pose d'énormes problèmes. J'en donnerai un autre exemple. Le Brésil et l'Argentine font partie des plus grands producteurs de viande bovine. Lorsque la viande bovine d'Argentine ou du Brésil arrive en Guyane, elle passe par Rungis. Tout est dit.
Un grand nombre de produits traversent toutefois la frontière, longue de 700 km, de façon informelle. Le Brésil a toujours entretenu des relations commerciales informelles avec la Guyane. Mais aujourd'hui, les normes européennes exigent que l'on puisse passer par l'Europe et par Rungis pour pouvoir commercer avec le Brésil.

L'ouverture du pont est-elle susceptible d'entraîner une augmentation du nombre déjà important de femmes brésiliennes qui viennent accoucher en Guyane ?

La ville d'Oiapoque est passée de 2000 habitants à presque 40 000 habitants en trente ans. Saint-Georges possède un petit hôpital très bien organisé. Mais c'est aussi une ville où est distribué le RSA. Beaucoup de Brésiliens et de Brésiliennes obtiennent des titres de séjour et peuvent bénéficier du RSA après un délai de plusieurs années. Par ailleurs, beaucoup d'enseignants hexagonaux habitent côté brésilien, où les prix sont bien moindres qu'en Guyane. 75 % de la population de Saint-Georges de l'Oyapock est d'origine brésilienne. La langue portugaise y est très répandue. Il y a une belle cohabitation, comme on peut par exemple l'observer lors des matchs de football entre le Brésil et la France.

Lors de mon déplacement au Brésil, avec Josselin de Rohan, alors président de la commission des affaires étrangères, j'avais été surpris d'entendre que la production de viande brésilienne de qualité, très importante, serait susceptible de casser le marché européen de la viande si celui-ci était ouvert. Le pont est-il susceptible de permettre une ouverture du marché hexagonal à la viande brésilienne ?

Non, car le marché guyanais est un petit marché, qui doit respecter les normes européennes, puisque la Guyane possède le statut de région ultrapériphérique. Les règles imposées par Paris et par Bruxelles doivent être respectées.

Merci, cher collègue, pour ce témoignage sur ce dossier complexe mais essentiel.
Suivant l'avis du rapporteur, la commission adopte à l'unanimité le rapport ainsi que les projets de loi précités.
La commission examine le rapport de M. Jean-Paul Fournier et le texte proposé par la commission sur le projet de loi n° 669 (2014-2015) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.

Cet accord a pour objet d'assurer une meilleure protection juridique des investissements français en Colombie et réciproquement. C'est un accord classique. Il est d'autant plus opportun que la Colombie représente un potentiel important pour les entreprises françaises et que le processus de stabilisation politique, actuellement en cours dans ce pays, ouvre des perspectives nouvelles.
Tout d'abord, quelques éléments sur la situation économique et politique de la Colombie.
L'économie colombienne est particulièrement dynamique. Elle a connu une croissance solide et régulière depuis 10 ans, avec un taux de croissance de 4,7 % en moyenne. Avec un PIB de 400 milliards de dollars, elle est la 4ème économie d'Amérique latine, derrière le Brésil, le Mexique et l'Argentine. Le pays a bénéficié ces dernières années du cours élevé des matières premières et d'une demande externe forte. Le dynamisme de son économie lui a permis de réduire sa vulnérabilité externe, grâce à une politique d'accumulation des réserves internationales de devises et de consolidation de la dette : alors que la dette détenue par des investisseurs étrangers s'élevait à 39% du PIB en 2002, elle n'était plus que de 22,1% du PIB en 2015.
L'économie colombienne est actuellement affectée par la chute des cours des matières premières et notamment du pétrole, qui représente, selon les années, 50 à 55% des exportations, un tiers de l'investissement direct étranger et un sixième environ des recettes budgétaires du pays. En 2015, la chute des prix du pétrole a provoqué une dépréciation importante du peso, mais la croissance du PIB s'est maintenue à un taux honorable de 3,1%. En outre, les réserves de change du pays restent très élevées : en février 2016, elles s'établissaient à 46,3 milliards de dollars et elles représentaient 10,3 mois d'importations fin 2015.
Du fait de son dynamisme, la Colombie est regardée aujourd'hui comme un des nouveaux pays émergents susceptibles de prendre le relai des BRICS actuellement en phase d'essoufflement. Un nouvel acronyme a été forgé pour désigner ces pays : les « CIVETS », pour Colombie, Indonésie, Vietnam, Egypte, Turquie et Afrique du Sud. La COFACE, quant à elle, range la Colombie parmi les « PPICS » - pour Pérou, Philippines, Indonésie, Colombie et Sri Lanka. Autre signe de son dynamisme, la Colombie devrait bientôt devenir membre de l'OCDE : le processus d'adhésion, officiellement engagé en 2013, est actuellement en bonne voie.
La bonne santé économique du pays s'accompagne en outre d'une amélioration de sa situation sécuritaire. La politique dite « de sécurité démocratique » engagée par le président Uribe en 2002 a conduit à neutraliser progressivement les groupes armés illégaux. L'actuel président Juan Manuel Santos, élu en 2010 et réélu en 2014, a poursuivi les efforts de son prédécesseur pour tenter de mettre fin à un conflit de cinquante ans, qui a fait plus de 200 000 morts. En 2012, le gouvernement a officiellement engagé des négociations de paix avec la guérilla des FARC. Quatre des cinq volets de l'ordre du jour ont désormais été conclus. Les négociations portent actuellement sur le dernier point à l'ordre du jour : l'arrêt définitif des combats. Les discussions ayant pris du retard, la signature de l'accord de paix global, qui avait été annoncée pour mars 2016, a dû être différée. Cet accord global reste attendu prochainement. Sa mise en oeuvre sera supervisée par une mission politique composée « d'observateurs internationaux non armés », mise en place par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies de janvier dernier. Les premiers effets des négociations de paix sur le terrain devraient être observables à partir du premier semestre 2017. En attendant, du fait de la guerre et du narcotrafic, la violence reste à un niveau préoccupant dans le pays, mais l'Etat a multiplié les efforts pour améliorer cette situation ces dernières années, en coopérant avec la communauté internationale.
Dans ce contexte économique et politique globalement favorable, la Colombie représente une destination attractive pour nos investissements. Les flux d'IDE français vers la Colombie ont enregistré une forte croissance depuis une quinzaine d'années, passant de 2 milliards de dollars en 2002 à 16 milliards de dollars en 2014, soit environ 4% du PIB. La France occupe une place de choix en se positionnant traditionnellement parmi les six premiers investisseurs et comme le premier employeur étranger en Colombie, avec environ 100 000 employés directs. Avec 157 filiales de groupes français, la présence française est très diversifiée : grande distribution, hôtellerie, services, banques, assurances... sans oublier de nombreuses activités industrielles, agroalimentaires et énergétiques. Près de la moitié des filiales recensées appartiennent à l'un des 28 groupes du CAC 40 présents en Colombie, souvent pour servir un marché régional. Les filiales françaises réalisaient un chiffre d'affaire collectif de 13 milliards de dollars en 2014.
Par ailleurs, l'AFD intervient en Colombie dans le cadre des orientations formulées pour les pays émergents, c'est-à-dire dans le sens d'une croissance « verte et solidaire ». 1,2 milliards de dollars d'euros d'engagements ont été approuvés sous forme de 7 prêts. L'AFD s'efforce de promouvoir le savoir-faire français en soutenant la mise en place de coopérations décentralisées et en se positionnant dans des secteurs où il existe une offre commerciale française compétitive.
Les investissements colombiens en France sont quant à eux peu nombreux. Le stock d'IDE colombiens ne s'élevait qu'à 5 millions d'euros en 2014. Au cours des dernières années, on relève un seul investissement colombien d'importance en France : celui de la société Argos qui a racheté, en 2013, les actifs de Lafarge en Guyane.
Le service économique de l'ambassade et le bureau local de Business France interviennent à intervalles réguliers devant des représentants du patronat colombien pour présenter les nouvelles réalités de l'économie française et l'attractivité de notre pays, mais il convient de rester réaliste sur les perspectives réelles d'investissement en France : elles restent très limitées, a fortiori dans le contexte de très forte dépréciation du peso.
En conséquence, l'intérêt de l'accord que nous examinons se trouve bien davantage du côté des entreprises françaises désireuses d'investir en Colombie que l'inverse.
J'en viens maintenant à cet accord.
Je rappellerai d'abord que la France a passé près d'une centaine d'accords bilatéraux de protection des investissements. Notre pays dispose ainsi d'un des réseaux d'accords les plus denses au monde dans ce domaine. De manière générale, ces accords visent à assurer une meilleure protection juridique des investisseurs français contre les risques de nature politique qu'ils encourent à l'étranger, notamment dans les pays émergents.
L'accord que nous examinons est le premier accord de protection des investissements conclu par la France depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui a transféré les investissements étrangers directs dans le champ de l'Union européenne au titre de la politique commerciale commune. Depuis 2009, les investissement relèvent ainsi des compétences exclusives de l'Union et la Commission européenne a compétence pour négocier et conclure les accords de promotion et de protection des investissements. Toutefois, un règlement européen de 2012 prévoit que les Etats membres peuvent continuer à négocier et conclure des accords bilatéraux, sous réserve d'autorisation préalable de la Commission. Conformément à la procédure issue de ce texte, la France a demandé l'autorisation de conclure un accord de protection des investissements avec la Colombie à la Commission européenne, qui a donné son accord par décision du 14 mars 2014.
Sur le fond, cet accord contient la plupart des dispositions classiques des accords de protection des investissements, qui visent à assurer un environnement juridique sûr aux investisseurs.
La principale disposition consiste en la possibilité de recourir à un mécanisme arbitral de règlement des différends. En effet, si la propriété privée fait l'objet d'une protection de rang constitutionnel en Colombie, les procédures de règlement des différends, quand ils sont soumis à la justice locale, sont particulièrement longues, atteignant parfois 10 à 15 ans.
L'accord stipule également que chaque partie bénéficie du traitement de la nation la plus favorisée. Cette clause assure aux investisseur de bénéficier, sur le territoire de l'autre partie, d'un traitement au moins aussi favorable que celui accordé par cette dernière, dans des situations analogues, à ses propres investisseurs ou à des investisseurs d'un pays tiers.
L'accord limite en outre les possibilités d'expropriation et de nationalisation des investissements accueillis. Les parties ne peuvent ainsi exproprier ou nationaliser les investissements des investisseurs qu'elles accueillent sur leur territoire respectif que pour une cause d'utilité publique, de manière non-discriminatoire et moyennant le versement d'une indemnité.
De manière classique, l'accord stipule également que les parties encouragent les investissements de l'autre partie sur leur territoire. Cette stipulation ne crée cependant aucune obligation juridique pour les parties.
A côté de ces dispositions classiques, qui figurent dans la plupart des accords de protection des investissements, l'accord contient également des stipulations innovantes qui visent à assurer un équilibre entre la protection des investisseurs et le droit des Etats à réguler.
L'accord stipule par exemple que le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée ne doivent pas faire obstacle à l'adoption de mesures destinées au maintien de l'ordre public en cas de menace contre les intérêts de l'Etat.
La clause de libre transfert des revenus est atténuée par une exception en cas de menace de déséquilibre de la balance des paiements. Cette exception, qui prévoit que les parties peuvent adopter des mesures de sauvegarde temporaires lorsque les transferts de capitaux menacent l'équilibre de la balance des paiements, a fait l'objet de négociations serrées avec la Colombie : les Colombiens souhaitaient que cette possibilité de restriction aux mouvements de capitaux ne soient pas limitée dans le temps - le compromis trouvé prévoit finalement une limitation pendant une durée d'une année au maximum.
L'accord consacre une « exception culturelle » permettant aux parties de déroger aux stipulations de l'accord pour l'adoption de mesures destinées à préserver la diversité culturelle et linguistique. Cette clause, incluse dans l'accord à l'initiative de la France, avait fait l'objet de quelques réticences de la part de la Colombie.
Parmi d'autres dispositions innovantes, l'accord mentionne aussi l'obligation pour les entreprises de se conformer aux standards internationaux en matière de responsabilité sociale des entreprises. Il interdit également le « dumping » en matière de réglementation environnementale ou sociale pour attirer les investisseurs.
Le principal intérêt de cet accord est d'apporter à nos entreprises un degré élevé de protection juridique pour leurs investissements actuels ou à venir en Colombie. Il est particulièrement bienvenu dans la mesure où les investisseurs français sont très présents en Colombie dans le domaine des concessions de services publics : la société Transdev, par exemple, est présente dans le transport urbain, Veolia dans le secteur de l'eau et des déchets... Les grandes entreprises françaises envisagent également de se positionner sur de futurs projets, comme la construction de lignes de métro et de tramway dans plusieurs grandes villes colombiennes, de nombreux projets d'usines de traitement des eaux ou encore un grand programme des concessions routières - sur lequel Vinci est déjà pré-qualifié ... Les perspectives sont également nombreuses dans le domaine de l'aéronautique et de l'énergie.
De manière générale, il est clair que l'intérêt de nos investisseurs est fort pour ce pays, qui dispose d'un marché dynamique portée par une population jeune et nombreuse. Cet intérêt ne pourra que croître à l'avenir, avec l'adhésion prochaine de la Colombie à l'OCDE et la perspective de la signature d'un accord de paix avec les FARC dans un futur proche. Dans ce contexte, l'initiative a été prise par les présidents français et colombiens d'illustrer le renforcement de la relation entre la France et la Colombie par l'organisation de « saisons croisées » en 2017. La Colombie deviendra ainsi le deuxième pays après le Brésil avec lequel la France organise un tel programme.
Cet accord est d'autant plus opportun que certains de nos concurrents les plus sérieux, comme l'Espagne, disposent déjà d'un accord de protection des investissements et que d'autres, comme les Etats-Unis, bénéficient de dispositions équivalentes dans des accords de libre-échange. Face aux autres concurrents étrangers qui ne bénéficient pas d'un accord de protection des investissements, l'accord nous donnera un avantage comparatif.
Il permettra également aux entreprises qui souhaitent investir en Colombie d'être éligibles à la garantie investissement apportée contre les risques politiques par la COFACE. Cette garantie peut avoir au cas par cas un impact positif sur la tarification appliquée par les opérateurs privés. Il s'agit d'un bénéfice non négligeable pour nos entreprises, en particulier pour les PME, qui pourront ainsi plus facilement concrétiser leur stratégie d'internationalisation.
Sous le bénéfice de ces observations, je recommande donc l'adoption de ce projet de loi dont l'examen simplifié en séance publique est fixé au jeudi 12 mai 2016.

En ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent, la Colombie collabore très peu avec le Groupe d'action financière (GAFI). C'est un sujet d'autant plus important que tous les rapports sur le terrorisme montrent un lien avec le trafic de drogue. Cette convention ne prévoit apparemment rien en matière de lutte contre le blanchiment, domaine dans lequel la Colombie devrait pourtant faire des efforts.

Les travaux de Tracfin mettent bien en évidence qu'à côté des activités légales retracées dans les comptes financiers, l'activité des mafias représente des sommes très importantes. La Colombie apparaît comme la 4ème économie d'Amérique latine si l'on se réfère à ses comptes consolidés, mais il est possible qu'elle se situe en réalité à un autre rang en tant que premier pays producteur de cocaïne. Or cet accord ne semble pas prendre en compte cette réalité.

La Colombie est devenue un « bon élève » du GAFI et on peut espérer que les négociations de paix avec les FARC permettront d'avancer dans la lutte contre le narcotrafic.

La Colombie sera peut-être un de nos prochains sujets de travail. C'est incontestablement un des pays les plus dynamiques d'Amérique latine. En même temps, la Colombie fait face à un défi politique majeur qui consiste à réintégrer les FARC à la société après des années de violence. La Colombie doit être aidée dans cet effort.

Ma remarque concerne aussi bien cet accord que celui avec la République d'Irak. Il ne vous aura pas échappé qu'il comporte, comme la plupart des accords de ce type, le recours à l'arbitrage privé. Pourtant, depuis que l'Union européenne a commencé à négocier des accords avec le Canada et les Etats-Unis, la question du recours à l'arbitrage privé a été beaucoup débattue et on a assisté à une assez forte opposition de l'opinion à ce type d'arbitrage. L'année dernière, notre Haute Assemblée a adopté une résolution prévoyant que le recours à l'arbitrage privé ne devrait plus figurer systématiquement dans ce type d'accord. Depuis, le secrétaire d'Etat au commerce Matthias Fekl s'est exprimé à plusieurs reprises en faveur du recours à des tribunaux publics. Par souci de cohérence, le groupe communiste républicain et citoyen s'abstiendra sur ces accords.

Je voudrais apporter un élément d'information au débat s'agissant du narcotrafic. Dans les réseaux du narcotrafic, on a assisté ces dernières années à une substitution de Cosa Nostra par la `Ndrangheta calabraise. Aujourd'hui, la Guardia di Finanza et les Carabinieri ont donné des coups de boutoir à l'importation de l'héroïne et de la cocaïne colombiennes dans les ports de la Calabre. En la matière, les succès policiers ont été considérables, provoquant une déstabilisation de la route Colombie-Calabre.
Suivant l'avis du rapporteur, la commission adopte le rapport ainsi que le projet de loi précité.
La commission examine le rapport de M. Bernard Cazeau et le texte proposé par la commission sur le projet de loi n° 482 (2015-2016) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Irak sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.

Nous examinons aujourd'hui le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre la France et l'Irak sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements. Il fait suite à un précédent accord de partenariat avec l'Irak pour la coopération culturelle, scientifique et technique, ainsi que pour le développement.
Je veux indiquer d'emblée que cet accord, s'il représente un symbole politique fort dans la situation difficile que connaît l'Irak, ne comporte pas d'enjeu véritable autre que celui de garantir un environnement juridique stable, de nature à sécuriser les investissements français en Irak et à favoriser ainsi le développement économique de ce pays au-delà du seul secteur pétrolier.
C'est naturellement un signal important compte tenu de la crise actuelle que traverse l'Irak, et chacun comprend que les dispositions ne trouveront peut-être pas à s'appliquer immédiatement, mais au moins nous serons prêts le moment venu pour la reconstruction et la stabilisation de ce pays.
Tout d'abord, cet accord se présente comme un symbole politique fort dans un pays où la situation politique et sécuritaire est très difficile.
A la suite de l'avancée de Daesh dans le nord de l'Irak et de la prise de Mossoul, deuxième ville d'Irak qui a servi de catalyseur à notre prise de conscience de la gravité de la situation, la France a choisi d'apporter son soutien politique, diplomatique, militaire et humanitaire aux nouvelles autorités irakiennes du gouvernement conduit par M. Al Abadi dont le programme de réformes avait pour objectif le redressement du pays et la réconciliation nationale, notamment entre les communautés sunnites et chiites - chacun sait la part de responsabilité du gouvernement sectaire Maliki dans le creusement du fossé entre chiites et sunnites, mais à l'heure actuelle, il faut bien admettre que le processus de réconciliation nationale est à bout de souffle et que les marges de manoeuvre du Premier ministre irakien al-Abadi sont réduites : les principales revendications sunnites n'ont pas été satisfaites et les réformes annoncées tardent à être mises en oeuvre du fait de la pression iranienne et du conflit à l'intérieur de la majorité chiite. Les différends avec le Gouvernement régional Kurde, notamment financiers, n'ont pas davantage été résolus. La situation humanitaire est dramatique : les Nations unies estiment à plus de 3,3 millions le nombre de déplacés irakiens depuis 2004 et à 8,2 millions ceux ayant besoin d'assistance humanitaire en urgence. Toujours selon les Nations unies, le conflit aurait fait environ 32 800 morts dans la population civile, depuis le 1er janvier 2011. Chacun sait bien le sort tragique réservé aux minorités, en particulier Chrétiens d'Orient et Yézidis qui ont été torturés et déplacés, voire « vendus ». Seule petite note d'espoir : Daesh aurait perdu 40 % des territoires qu'il contrôlait au plus fort de son expansion en Irak et la reprise de Mossoul est désormais un objectif plus réaliste que par le passé. D'après le Président du Kurdistan irakien, Massoud Barzani, que nous avons rencontré, il sera plus facile de reconquérir Mossoul que de gouverner ensuite.
La situation économique est également difficile en dépit du potentiel économique incontestable de ce pays. Le coût des opérations militaires et la chute des prix du pétrole qui frappe une économie largement dominée par le secteur des hydrocarbures expliquent les difficultés actuelles de l'Irak. Le secteur des hydrocarbures représente 83 % des ressources budgétaires et 99 % des exportations. La croissance s'est établie à 0,5 % en 2015 contre 4,2 % en 2013 et contre une moyenne annuelle de 8 % sur la période 2008-2013. Pourtant l'Irak a un fort potentiel économique : troisième pays le plus peuplé du Proche et Moyen-Orient avec ses 34 millions d'habitants, il représente un des plus grands marchés de la région. Son PIB le classe 6ème économie du Proche et Moyen-Orient. Grâce au pétrole, c'est un pays à revenu intermédiaire avec un PIB de 4 700 dollars par habitant. L'Irak reste l'un des grands pays pétroliers avec une production de 160 millions de tonnes de Brut en 2014 ; il dispose des 5ème réserves de pétrole avérées au monde (20,2 milliards de tonnes, soit 8,8 % des réserves mondiales). On estime que la production actuelle, qui est légèrement inférieure à 5 millions de barils par jour, pourrait s'accroître d'environ 0,5 million de barils par jour avec des investissements significatifs. La croissance de l'industrie hors pétrole stagne autour de 1 % par an depuis 2004 : la diversification de l'économie et le renforcement de la compétitivité constituent donc des enjeux majeurs. En outre, les besoins de la reconstruction sont estimés à plus de 450 milliards d'euros : ils sont très importants notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'électricité, de l'eau, des transports, des hôpitaux, des médicaments, des logements et de l'agriculture. L'investissement public est insuffisant et les investissements privés sont plus que jamais nécessaires. Dans ce contexte, ces secteurs, en plus de celui des hydrocarbures, représentent des opportunités à terme pour les entreprises françaises.
À ce jour, la présence française et les investissements français en Irak sont relativement modestes et les investissements irakiens en France sont négligeables, puisqu'ils se situent, en 2014, à 500 000 euros et concernent de l'immobilier. Les investissements français en Irak, après avoir enregistré une progression régulière de 2009 à 2012, ont connu en 2013 et 2014 une baisse sensible : ils sont ainsi passés de 62,2 millions d'euros en 2012 à 33,1 millions d'euros en 2013 et à 19,9 millions d'euros en 2014. Selon notre service économique à Bagdad, ce dernier chiffre serait sous-estimé dans la mesure où les entreprises françaises réalisent de nombreux investissements qui ne sont pas comptabilisés par la Banque de France comme allant vers l'Irak, parce qu'ils transitent par des filiales ou des structures de support situées dans des pays tiers. Je précise que la communauté française présente en Irak ne compte que 80 personnes enregistrées au registre des Français de l'étranger et qu'une cinquantaine seulement d'entreprises françaises y sont implantées.
Dans le domaine de la construction, le cimentier Lafarge, avec un investissement de près d'1 milliard de dollars, est le premier investisseur français en Irak hors hydrocarbures. La société a trois cimenteries - dont deux au Kurdistan irakien - qui produisent 60 % du ciment fabriqué en Irak et 30 % du ciment consommé. Dans le domaine de la logistique, CMA-CGM est la première compagnie maritime à desservir l'Irak, détenant un tiers du trafic de conteneurs du port d'Umm Qasr, situé à l'extrême sud du pays et qui assure à lui seul 80 % du trafic du pays. Elle est candidate à l'offre de gestion globale de ce port actuellement en cours. Les investissements dans les hydrocarbures encore limités, sont en progression. Total, qui est le premier investisseur français en Irak, a remporté, en 2009, 18,75 % de l'exploitation du champ de pétrole d'Halfaya, qui devrait absorber à terme 4,5 milliards de dollars d'investissement. Air Liquide envisage d'investir dans la construction d'unités de production de gaz industriel à Bassora et au Kurdistan et sa présence en Irak devrait se renforcer à moyen terme. La présence française dans les autres secteurs est aussi en développement avec notamment Orange dans les télécommunications, Renault-Trucks dans l'industrie automobile, Schneider Electric dans le secteur de l'électricité, Sanofi Aventis dans le domaine des produits pharmaceutiques et Danone dans le secteur de l'agroalimentaire.
Dans ce contexte, l'accord de protection réciproque des investissements, dont nous sommes saisis, vient opportunément sécuriser les investissements français en Irak. Outre les problèmes sécuritaires déjà évoqués, les investisseurs français se heurtent en effet pour l'instant à la complexité du système règlementaire irakien, aux lenteurs administratives, à l'absence de sécurité juridique et judiciaire, voire à la corruption. Ils ne peuvent pas invoquer les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) relatives à la protection des investissements, ni les codes d'investissement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). L'objet de la convention que nous examinons est donc de leur apporter cette sécurité juridique qui fait défaut.
Cet accord, signé en 2010, est très proche du modèle français habituel d'accord sur les investissements - la France est déjà liée par une centaine d'accords bilatéraux de ce type, ce qui constitue d'ailleurs un atout pour notre pays.
Sur le fond, cet accord octroie aux investisseurs français une meilleure protection du droit de propriété - toute dépossession donnerait lieu au paiement d'une indemnité -, des droits de protection de la propriété intellectuelle, et garantit un traitement juste et équitable par rapport aux investisseurs nationaux et à ceux des autres pays tiers. Il contient en outre un dispositif classique de recours à l'arbitrage international, qui permettra à nos entreprises si elles sont victimes d'un préjudice du fait de la violation par les autorités irakiennes de leurs engagements conventionnels, de recourir à un tribunal arbitral international neutre et donc indépendant du gouvernement irakien. Il est enfin prévu que les Parties contractantes peuvent inscrire dans leur législation « les mesures nécessaires à la protection de l'environnement », mesure qui semble a priori de portée assez réduite dans le contexte actuel mais qui, sur le principe, ne peut que nous satisfaire.
Sous le bénéfice de ces observations, je recommande l'adoption de ce projet de loi, dont l'entrée en vigueur permettra également aux investissements français - et ce n'est pas négligeable - de bénéficier des garanties publiques de la Coface. Il devrait en outre offrir aux entreprises françaises un relatif avantage concurrentiel, au vu du très petit nombre d'accords de protection d'investissement conclus par l'Irak avec des pays étrangers.
L'examen en séance publique est fixé au jeudi 12 mai 2016. La Conférence des Présidents a proposé son examen en procédure simplifiée, ce à quoi je souscris, car cela permettra une adoption définitive plus rapide de cette convention, l'Assemblée nationale s'étant déjà prononcée favorablement.

Nous nous abstiendrons car c'est le même problème que pour le projet de loi autorisant l'accord de protection réciproque des investissements avec la Colombie, celui du recours à l'arbitrage privé, dont les règles sont certes fixées internationalement mais avec les défauts que l'on connait. Je dirai que le temps écoulé entre la conclusion de cet accord et sa ratification nous fait mesurer l'abîme qui sépare 2010 et 2016, s'agissant des conditions mêmes de son application, dont on voit qu'elle sera difficile dans la situation actuelle. Toutefois, s'il s'agit d'envoyer un signal que le retour à une situation normale en Irak s'accompagnera d'investissements privés et, je l'espère aussi, publics de la France, nous ne nous opposons pas totalement à cet accord. Pour cette raison, le groupe communiste républicain et citoyen s'abstiendra.

Sur les 450 milliards d'euros nécessaires pour la reconstruction de l'Irak, il y a matière pour les investisseurs français à trouver des débouchés. Il s'agit de prévoir l'avenir et la suite. Je pense que ce pays finira par retrouver une plus grande stabilité.

On peut le souhaiter en tout cas.
Suivant l'avis du rapporteur, la commission adopte le rapport ainsi que le projet de loi précité, avec 4 abstentions (Mmes Demessine et Aïchi, MM Billout et Vera). Il sera examiné par le Sénat en séance publique le 12 mai 2016, selon la procédure simplifiée.
La commission examine le rapport de M. Jean-Pierre Cantegrit et le texte proposé par la commission sur le projet de loi n° 348 (2015-2016) autorisant l'approbation de l'avenant n° 6 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco à la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale.

Monsieur le Président, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui le projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant conclu en 2014 entre la France et Monaco à la convention franco-monégasque de 1952 sur la sécurité sociale.
Permettez-moi avant tout de revenir, en quelques mots, sur la visite d'une délégation du Conseil national de Monaco au Sénat, les 9 et 10 mars derniers. Le groupe interparlementaire d'amitié que préside notre collègue M. Christophe-André Frassa a reçu cette délégation, conduite par son président, M. Laurent Nouvion. Elle a également été reçue par le président du Sénat, par le président de notre commission et par le président de la commission des affaires européennes. Un certain nombre d'entre nous avons pu alors nous entretenir avec nos collègues parlementaires monégasques. Ceux-ci, en particulier, se sont montrés très favorables à l'accord que je vais à présent vous présenter.
Cet accord a pour objet de permettre aux salariés exerçant leur activité en télétravail depuis le territoire français ou monégasque de relever de la législation de sécurité sociale de l'Etat dans lequel est établi leur employeur.
En pratique, l'intérêt de cet accord est d'abord pour les résidents français : du fait de l'exiguïté du territoire et du coût des loyers, 80% des salariés employés par des entreprises de Monaco ne résident pas sur le territoire de la Principauté. Plusieurs dizaines de milliers de salariés français se rendent donc quotidiennement à Monaco depuis la France.
Avec une croissance de 7,2% du PIB en 2014, l'économie monégasque est particulièrement dynamique. Elle est toutefois contrainte par l'exiguïté du territoire, puisque Monaco, avec une superficie de 2,02 km2, est le plus petit Etat du monde après le Vatican. La Principauté compte 36 950 habitants, ce qui en fait l'Etat avec la densité de population la plus élevée du monde. D'après le classement du groupe immobilier Knight Frank et de la banque Citi Private Bank, établi en 2007, Monaco est aussi la deuxième ville la plus chère du monde, derrière Londres, en ce qui concerne les prix de l'immobilier. Le prix moyen au mètre carré se situait autour de 15 000 euros en 2012 pour les résidences anciennes (hors secteur protégé), autour de 25 000 euros pour les immeubles plus récents autour du Carré d'Or, et plus de 35 000 euros pour les immeubles les plus prestigieux du Carré d'Or. Sur l'avenue Princesse Grace, l'artère la plus chère de la ville, les prix peuvent atteindre 100 000 euros.
Comme je l'indiquais, ceci a pour conséquence que la plupart des salariés qui travaillent à Monaco résident en France et se rendent chaque matin en voiture sur leur lieu de travail. En conséquence, les embouteillages sont fréquents sur la portion d'autoroute entre Nice et Vintimille, et se font particulièrement sentir au niveau de la sortie vers Monaco. L'augmentation de l'emploi salarié, de +2,5% en 2014 selon l'IMSEE, l'institut de la statistique de Monaco, pourrait être à l'origine de l'engorgement croissant du trafic. La configuration géographique de la côte à hauteur de Monaco contraint fortement les possibilités d'amélioration de la desserte de la Principauté. Aussi, le développement du télétravail pourrait permettre, même dans une modeste proportion, de décongestionner les réseaux de transport.
Pour améliorer les conditions de travail des salariés qui ne résident pas à Monaco, mais aussi pour alléger le trafic automobile « pendulaire » quotidien entre la France et Monaco et développer les activités économiques de la Principauté, les autorités monégasques ont donc souhaité encourager le télétravail.
Cette volonté passait par l'adoption d'un cadre législatif adapté. En particulier, une adaptation de la convention sur la sécurité sociale de 1952 entre la France et Monaco s'est avérée nécessaire. C'est l'objet de l'avenant que nous examinons.
La convention de 1952 prévoit l'assujettissement des travailleurs salariés à la législation de l'Etat où est exercée l'activité salariée. Elle précise par ailleurs que les travailleurs à domicile sont soumis à la législation du lieu de leur domicile. Par conséquent, aux termes de cette convention, en l'état, les télétravailleurs domiciliés en France sont assujettis à la législation de sécurité sociale française, même si leur employeur est établi à Monaco.
L'avenant signé en 2014 vient modifier cette convention pour permettre aux télétravailleurs français exerçant leur activité pour des entreprises monégasques - qui sont entre 500 et 5 000 d'après les autorités monégasques - d'être affiliés à la sécurité sociale monégasque. Réciproquement, les télétravailleurs monégasques pourront être affiliés à la sécurité sociale française, mais ce cas devrait concerner beaucoup moins de travailleurs, même si on ne dispose pas de statistiques en la matière.
L'assujettissement des télétravailleurs résidant en France au régime monégasque prive, certes, les régimes de sécurité sociale français des cotisations sur les salaires perçus, mais en contrepartie, pendant leur activité, la charge des prestations incombe au régime monégasque. En revanche, pour éviter de faire supporter au régime français de sécurité sociale la charge intégrale des soins de santé des télétravailleurs devenus retraités, l'avenant prévoit leur prise en charge par moitié par les caisses de sécurité sociale française et monégasque, sous réserve d'une durée de télétravail à Monaco d'au moins 15 ans. L'accord est donc équilibré.
Pour les modalités techniques du règlement financier relatif au partage des charges entre les caisses françaises et monégasques, l'accord renvoie à un arrangement administratif, qui est en cours d'élaboration.
L'accord a par ailleurs été assorti d'un engagement de Monaco à ne pas accueillir de transferts de siège de sociétés spécialisées dans le télétravail installées en France. Cette disposition, bienvenue, vise à prévenir ce qu'on pourrait appeler les « délocalisations ».
En outre, pour éviter un détournement des règles par les entreprises, l'avenant prévoit que les télétravailleurs bénéficiaires du nouveau régime devront être présents dans les locaux de l'entreprise pendant au moins un tiers de leur temps.
Enfin, de manière classique, les parties s'engagent à prendre toutes mesures de coopération utiles pour vérifier le respect de ces conditions et un bilan d'application sera réalisé à l'issue de trois ans après la date d'entrée en vigueur.
Cet accord est susceptible d'avoir des retombées positives en termes d'emploi. En effet, le développement du télétravail pourrait offrir du travail à des personnes actuellement sans emploi dans la région PACA. L'accord, en tout cas, devrait améliorer les conditions de travail, et donc de vie, des résidents français déjà employés à Monaco, qui pourront travailler, du moins les deux tiers de leur temps, depuis leur domicile. L'étude d'impact du projet de loi donne une fourchette pour le nombre de salariés susceptible d'être concernés par le télétravail à Monaco : entre 500 et 5 000 comme je l'ai déjà indiqué.
De plus, et ce n'est pas le moindre effet de cet accord, la mise en oeuvre de celui-ci devrait se traduire par un désengorgement de la circulation aux abords de la Principauté de Monaco, aux heures « de pointe » des jours ouvrés.
Sous le bénéfice de ces observations, je recommande l'adoption de ce projet de loi. La ratification de l'accord, en effet, améliorera les conditions de vie des salariés concernés, favorisera le développement de l'emploi en région PACA et permettra de décongestionner le trafic dans la région.
Les autorités monégasques ont d'ailleurs annoncé qu'elles attendaient la ratification de cet accord par la France avant de le ratifier elles-mêmes.
L'examen en séance publique est prévu le jeudi 12 mai 2016. La Conférence des Présidents a proposé son examen en procédure simplifiée, procédure à laquelle je souscris puisque la ratification en cause ne soulève pas de difficulté particulière.

Je ferai une remarque générale qui sort un peu du cadre de la convention. Selon des chiffres publiés par la presse concernant l'année 2015, la France est le pays d'Europe qui perd le plus de résidents millionnaires chaque année. On le sait, beaucoup de nos grandes fortunes partent à l'étranger, ce qui affaiblit notre économie. Toutefois, les Français ne peuvent pas s'exiler fiscalement à Monaco, en vertu d'une convention signée entre la France et la principauté sous la présidence du Général de Gaulle. Pourtant, étant donné qu'une convention fiscale prévoit le partage avec la France de la TVA collectée à Monaco, notre pays aurait intérêt à ce que nos concitoyens fortunés, s'ils doivent s'expatrier, s'installent à Monaco plutôt qu'ailleurs à l'étranger...

Je m'interroge sur le degré d'inquiétude qui doit être le nôtre quant à l'effet de la convention pour les Français aisés qui s'installent à Monaco en dépit du coût élevé du mètre carré...

Je tiens à souligner que cet accord est important pour des milliers de travailleurs français qui vont tous les matins travailler à Monaco. Beaucoup travaillent dans le secteur des services, et cet accord va leur faciliter la vie. Monaco est un pays avec des écarts importants entre quelques grandes fortunes et un grand nombre de femmes et d'hommes qui y travaillent, parfois pour un salaire proche du SMIC.

Je me réjouis que des Français puissent travailler à Monaco dans de meilleures conditions grâce à cet accord. J'espère que ces Français n'auront pas l'idée de se transformer en lanceurs d'alerte : j'ai entendu au conseil de l'Europe la semaine dernière le représentant de Monaco dénoncer vivement les lanceurs d'alerte et défendre le secret des affaires - ce qu'il a tenu à faire en langue anglaise !

Quel est l'écart de cotisations entre la sécurité sociale française et la sécurité sociale monégasque ? En d'autres termes, quel est l'intérêt pour les travailleurs français de changer de caisse et quel sera le bilan financier pour nos régimes de sécurité sociale ?

Je ne dispose pas à ce stade des données chiffrées qui me permettraient de répondre précisément à cette question. Comme je l'ai indiqué, l'accord est équilibré, et un règlement technique est en cours d'élaboration. Monaco prendra en charge les prestations dues aux travailleurs français pendant leur période d'emploi dans la principauté ; pour les retraités ayant travaillé au moins quinze ans dans celle-ci, un partage de la charge des prestations sera effectué entre les caisses françaises et monégasques.

Une réaction aux propos de M. Pozzo di Borgo : personne ne peut imaginer ici que les citoyens les plus aisés de notre pays puissent sacrifier leur patriotisme à des raisons purement financières ! (sourires).

Il faut faire attention aux clichés trop faciles. Les exilés fiscaux représentent plus d'un millier de Français à l'étranger, mais la fraude fiscale est pratiquée à partir du sol français. Il y a à Monaco des Français installés depuis très longtemps, qui pâtissent de la hausse des loyers et qui ont des problèmes pour se loger. L'accord a le mérite de soutenir ceux qui travaillent, il va dans le sens de la lutte contre le chômage en France. Par ailleurs, le fait de pouvoir cotiser aux caisses monégasques donne accès aux soins hospitaliers à Monaco, qui sont de bonne qualité. J'ajouterai que nous avons un problème avec les artisans français travaillant dans la principauté : les Français payent leurs impôts en France, or certains accords fiscaux de Monaco avec d'autres pays exemptent d'impôts les ressortissants de ces derniers. Un boulanger français, par exemple, sera ainsi davantage confronté à des problèmes de trésorerie qu'un boulanger italien.

Je suis surpris d'entendre que de nombreux Français de Monaco seraient payés au SMIC. Je suis l'élu d'un département où il y a beaucoup de travailleurs transfrontaliers, qui vont travailler à Genève où ils sont sensiblement mieux payés... La question de mon collègue M. Joyandet est intéressante, car le problème qu'elle soulève s'est posé avec la Suisse. Les travailleurs s'assuraient en Suisse à des coûts relativement élevés pour des prestations moins favorables que celles de la sécurité sociale française, mais ils revenaient au guichet de celle-ci quand ils se retrouvaient dans des situations difficiles.

Je crois en tout cas qu'il y a une réelle spécificité de la situation des travailleurs français à Monaco.
Suivant l'avis du rapporteur, la commission adopte le rapport ainsi que le projet de loi précité. Il sera examiné par le Sénat en séance publique le 12 mai 2016, selon la procédure simplifiée.
La commission auditionne M. Christophe Lecourtier, ambassadeur de France en Australie, sur « la place de la France dans le nouveau monde ».

Je suis très heureux de vous accueillir, Monsieur l'ambassadeur, au lendemain de l'annonce par l'Australie qu'elle a choisi la France pour ses sous-marins océaniques ; dans un communiqué, notre commission a salué cet accord très important pour les deux pays et pour la zone Pacifique dans son ensemble ; nous sommes passés en quelques années d'un « excès » de France en Australie - une phase de tension, cristallisée par nos essais nucléaires atmosphériques - à une « demande » de France, ce contrat historique en atteste. Monsieur l'ambassadeur, je ne vous présente pas nos deux rapporteur sur l'Australie, je sais que vous étiez avec Christian Cambon lundi au petit matin pour la célébration de l'ANZAC-Day, cérémonie du « point du jour » en commémoration des troupes australiennes et néo-zélandaises engagées dans la Grande Guerre, 6 000 Australiens étaient à vos côtés. Notre commission a choisi de travailler cette année sur l'Australie, notre mission s'y déplacera en septembre : cette audition, dans ce contexte tout à fait heureux, est l'occasion de vous interroger sur les relations bilatérales entre la France et l'Australie, mais aussi, plus largement et sans préjuger des nombreuses questions que ne manqueront pas de vous poser mes collègues, sur votre perception de l'ancrage, somme tout récent, de l'Australie à l'Asie.
Le métier d'un ambassadeur consistant à donner du contenu et de la perspective à la relation bilatérale entre la France et le pays où il exerce, vous mesurez le plaisir rare, en plus de l'honneur, que j'ai à venir devant vous au lendemain de l'accord annoncé par le Premier ministre australien. Cet accord va structurer les cinquante prochaines années des relations entre la France et l'Australie et il est le résultat d'une stratégie mise en place ces dernières années.
De très longue date, les relations entre nos deux pays se situaient dans une zone « grise » - avant 2014, aucun président de la République ne s'était rendu en visite officielle ou d'Etat en Australie, le voyage le plus élevé dans le protocole avait été, en deux siècles, celui du Premier ministre Michel Rocard en 1988. Trois raisons à cet état des choses : le contentieux des essais nucléaires français, qui a culminé dans les années 1990 avec un puissant mouvement d'opinion et le boycott de produits français en Australie ; les événements en Nouvelle-Calédonie et le soutien, supposé ou réel, des Australiens aux mouvements indépendantistes kanaks ; enfin, la politique agricole commune (PAC), dont la France a été le grand inspirateur et le grand bénéficiaire et qui était perçue comme un cheval de Troie en Australie où l'adhésion britannique à la Communauté européenne a été un véritable traumatisme, avec des conséquences dramatiques - et l'Australie a été l'un des principaux inspirateurs du groupe de Caïrns, pourfendeur de la PAC et de la France en particulier.
Ces trois raisons de tension avec la France ont progressivement disparu : nous avons cessé nos essais nucléaires atmosphériques dans le Pacifique, le processus politique mis en place en Nouvelle-Calédonie a été reconnu exemplaire et les réformes de la PAC ont ôté les éléments perçus comme nocifs du côté australien. Le terrain étant redevenu neutre, encore fallait-il construire une relation : c'est ce que nous avons fait, avec cette première visite d'Etat d'un président de la République française en Australie, au lendemain du G20 de novembre 2014.
Le contexte stratégique a profondément changé pour l'Australie. Depuis la fin de la Deuxième guerre mondiale au moins, l'île-continent vivait sous « la tyrannie de la distance », selon une expression consacrée, pour le pire et le meilleur - à l'abri, en particulier, des risques stratégiques qui touchaient le continent européen, et d'abord celui des Soviétiques. Depuis une décennie, l'émergence des marines chinoise et indienne, les tensions en mer de Chine, le réarmement des pays de la région, la Malaisie, Singapour, l'Indonésie, le Vietnam, aussi bien que les hésitations perceptibles des Etats-Unis à garantir un parapluie irrévocable de sécurité aux Australiens, tous ces éléments incitent l'Australie à vouloir assumer directement sa sécurité par elle-même dans la région. L'économie, ensuite : pendant 25 ans, l'Australie a connu une croissance ininterrompue, c'est même le seul pays de l'OCDE dans ce cas, avec des finances publiques saines, un endettement faible, un taux d'endettement tout à fait exemplaire. Ce « miracle australien » s'explique par la « mine » et la Chine, c'est bien le développement chinois qui a tiré la croissance australienne, focalisée sur les ressources minières - des millions de mètres cube de gaz, des millions de tonnes de minerai de fer et de charbon, ont servi aux Chinois à développer leurs infrastructures, leurs villes. Or, ce cycle s'estompe, la Chine change de modèle économique, ce qui a des conséquences directes pour les Australiens : il leur faut trouver comment pérenniser une croissance ininterrompue qui les a placés aux tout premiers rangs mondiaux pour la richesse par habitant. La société, enfin : longtemps « blanche », anglo-saxonne, abritée derrière une « White Australian Policy » qui interdisait l'immigration de populations non-européennes, la société australienne s'ouvre désormais aux flux migratoires de Chine, d'Inde, d'Asie du Sud-Est - aujourd'hui, 40% des habitants de Melbourne et Sydney, les principales métropoles, sont nés en dehors d'Australie, dont une forte proportion de ces pays de nouvelles migrations. Aussi cette société se trouve-t-elle aujourd'hui confrontée à la question du multiculturalisme; les responsables s'en réjouissent officiellement mais ils s'en inquiètent également, en particulier pour l'intégration de populations d'origine musulmane - avec des effets comparables à ceux que nous connaissons, malgré des différences de condition de vie évidentes, puisqu'une centaine d'Australiens seraient partis combattre en Syrie et en Irak, que l'Etat a confisqué les passeports de quelque 500 autres candidats au départ et qu'il surveillerait plusieurs milliers de citoyens pour cette raison.
L'Australie ne connaissait guère de risque stratégique, pas de problème économique ni de problèmes sociaux : en quelques années, la donne a changé, ce qui a rendu les Australiens désireux d'un dialogue avec nous. Nous avons proposé une stratégie au président de la République, en partant des questions et des attentes de nos interlocuteurs australiens - ce qui n'est guère une habitude du génie français, lequel a tendance à plaquer sur l'autre sa propre façon de voir les choses plutôt que de partir de ce que les autres attendent de nous.
Le président de la République a défendu cette stratégie consistant à dire aux Australiens que nous allions les aider à assumer leurs responsabilités de défense et de sécurité, à diversifier leur économie en investissant sur des nouveaux domaines où ils ont des avantages comparatifs qu'ils ignorent, pour s'être trop longtemps focalisés sur l'économie minière, et que nous allions également échanger sur des questions sociales qui nous sont communes. Au passage, les cent mille Français qui vivent en Australie sont un levier pour notre stratégie; l'émigration française est principalement composée de familles, qui viennent s'établir dans cette partie du monde pour des raisons très positives, passant le crible de l'immigration choisie australienne, organisée autour de listes d'emplois à pourvoir.
La question des sous-marins est au carrefour de ces trois axes : un lien direct, évident, avec la défense, mais aussi avec l'industrialisation de l'Australie, qui ne compte que 6% d'emplois industriels - et qui peut développer des niches de pointe, à haute valeur ajoutée - ainsi qu'avec les questions sociales puisque le partenariat établi pour 50 ans entrainera des échanges de centaines d'Australiens formés en France, dans des programmes intégrés à nos pôles de compétitivité, à l'université, aussi bien que l'ouverture d'écoles françaises à proximité des chantiers navals.
Plusieurs événements survenus l'an passé ont changé l'image de la France. Les Australiens trouvent notre pays éminemment sympathique, ils sont 1,2 million à venir chez nous chaque année, ils y dépensent autant que les Chinois ; mais c'est pour eux une « destination plaisir », associée à la qualité de vie, à la bonne chère, au charme, et c'est à Londres qu'ils pensent pour faire des affaires, c'est à l'Allemagne, aux Etats-Unis et au Japon qu'ils associent la qualité, l'innovation et la recherche. Nous avons travaillé sur ces représentations, avec le programme « Creative France », lancé par Laurent Fabius, en valorisant la créativité comme le chaînon manquant entre la tradition et l'innovation, un positionnement original, peu usité par nos concurrents. Or, avec les attentats de Paris et la COP 21, les Australiens se sont mis à regarder la France différemment, en particulier les jeunes adultes surtout tournés vers l'Asie.
Les trois-quarts des Australiens estiment qu'il faut faire quelque chose en matière de changement climatique, ce qui n'était pas la position traditionnelle du gouvernement australien; aussi, quand la France a décidé de se lancer, seule, dans l'organisation de la COP 21, cette prise de risque est très bien passée dans l'opinion australienne et le compromis passé à Paris a été vécu comme un succès. Les attentats, ensuite, une fois passé le moment de solidarité, très forte, avec un pays qui fait front, ont montré une France aux prises avec les problèmes de demain, et nous sommes redevenus modernes.
C'est l'ensemble de ces éléments qui ont conduit au choix de DCNS, nous avions la technologie, mais l'Australie nous a choisi parce qu'elle a accepté de s'engager avec nous dans un partenariat stratégique, une relation intime, forte, lancée pour les cinq prochaines décennies. L'Australie est souvent décrite comme un pays « adolescent », il semble qu'elle passe à l'âge adulte, en choisissant de manière plus libre avec qui elle sera partenaire : il y aura la Chine, devenue incontournable, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, pour des raisons historiques, mais aussi la France, qui est entrée, avec cet accord, dans le premier cercle des partenaires, c'est un fait très important pour les décennies à venir.

Je veux souligner l'importance de la mémoire dans la relation de l'Australie à la France. Je l'ai constaté pendant l'ANZAC Day le 25 avril, lors de la cérémonie, à quatre heures du matin dans la plaine de la Somme : quelque six mille Australiens étaient à nos côtés, c'est dire que la question compte encore aujourd'hui ! Les Australiens ont perdu 60 000 des leurs en Europe pendant la Première guerre mondiale, chaque famille porte aujourd'hui le souvenir d'un ascendant disparu, le Gouverneur général australien l'a rappelé lors des cérémonies.
Monsieur l'ambassadeur, tout le monde vous félicite aujourd'hui pour le succès français, mais nous savons, nous qui avons décidé de travailler sur la France et le nouveau monde, que vous vous êtes plutôt heurté au doute que notre pays puisse l'emporter face aux favoris qu'étaient l'Allemagne et le Japon : comment avez-vous réussi le tour de force de faire travailler tout le monde ensemble ? Les entreprises entre elles, au premier chef, mais aussi les différentes administrations ?

Cette victoire pour notre technologie, notre diplomatie, où vous avez joué un rôle majeur, n'était effectivement pas écrite d'avance; vous soulignez qu'elle a demandé une sorte de révolution culturelle de notre part, pour que nous partions des attentes de nos interlocuteurs plutôt que de notre vision du monde : cette démarche est-elle applicable sur d'autres zones, pour d'autres secteurs ? Notre outil diplomatique, ensuite, a-t-il disposé des moyens suffisants ? Quels sont les atouts de notre pays et ses faiblesses, pour étendre la démarche ? Comment, ensuite, gérer l'après, comment accompagner nos PME dans cette opportunité inédite que nous devons saisir - pour conforter aussi notre influence et jouer toute notre partition ?

Vous l'aurez compris, Monsieur l'ambassadeur, nous nous occupons de la France et du nouveau monde, mais aussi de ce que c'est, un bon ambassadeur, ce sera une partie du rapport de nos collègues - et je crois que vous avez tout pour nous y aider !

Merci pour cette mise en perspective de ce dossier technique. DCNS a fait des offres, le Gouvernement australien a donné son accord de principe, nous sommes entrés dans une négociation exclusive : tout n'est donc pas terminé. Que se passera-t-il en cas d'alternance politique lors des prochaines élections générales en Australie : cet accord peut-il être remis en cause ?
Vous n'avez pas cité le nom de Thales, qui est dans le capital de DCNS et qui a racheté ces dernières années plusieurs entreprises australiennes de l'armement; sa participation me paraît décisive : qu'en pensez-vous ?

Un ambassadeur a aussi une dimension politique : de ce point de vue, estimez-vous que le choix australien puisse avoir des conséquences sur nos relations avec certains des voisins de l'Australie, en particulier la Chine ?
Sur les écoles françaises qui ouvriraient près des chantiers navals : dépendraient-elles de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE), ou seraient-elles gérées localement ?

Monsieur l'ambassadeur, bravo d'être parvenu à faire venir le Président de la République en Australie : bien de vos prédécesseurs en avaient rêvé, vous l'avez fait. Je partage votre analyse sur la nouvelle attente de France et sur la dimension stratégique du partenariat mis en place. Sur l'importance de la mémoire, ensuite, il faut rapporter le nombre de soldats australiens morts pendant la Première guerre mondiale, à la population australienne de l'époque : les 60 000 victimes représentent 10% de la population masculine d'alors, c'est tout à fait considérable.
On se félicite, enfin, d'une victoire pour les groupes industriels français, mais ils faut compter avec les transferts de technologies, les filiales à l'étranger : avez-vous une idée plus précise des retombées pour notre commerce extérieur ?

La démarche que vous avez suivie vous paraît-elle pouvoir être dupliquée dans d'autres pays ? Je pense à la Norvège, qui va acheter des sous-marins et où certains considèrent que les jeux sont faits, que l'Allemagne l'emporterait à tous les coups - vous démontrez plutôt que les seules batailles perdues d'avance sont celles qu'on ne mène pas...
La Papouasie-Nouvelle Guinée, ensuite, décide de fermer le camp australien de réfugiés sur l'île papoue de Manus, outil d'une politique australienne très restrictive en matière d'accueil des migrants : quelle est la position de l'opinion australienne dans cette affaire ?

L'Australie, sixième pays plus grand au monde, très concernée par les thèmes de la mer et de l'environnement, est aussi aux tout premiers rangs pour les déchets plastiques, avec 65 kg par habitant et par an, source d'une pollution marine très importante : quelles mesures environnementales le pays prend-t-il contre ce phénomène ?

Je rejoins Christian Cambon pour souligner l'importance de la mémoire, mais aussi la profondeur de la relation des Australiens avec notre continent et son rôle dans la construction de l'identité australienne. Le déplacement de Michel Rocard en Australie avait été un geste fort et le processus politique en Nouvelle-Calédonie est, je le crois, un vecteur de nos relations fructueuses avec l'Australie.

Je rends hommage à notre ambassadeur, mais aussi à Laurent Fabius, qui a su faire travailler le Quai d'Orsay sur les questions économiques et de défense.
Une question : existe-t-il toujours, en Australie, une question arborigène et quels en sont les contours ?

La perspective de quarante années de partenariat assure l'avenir de notre Marine nationale elle-même comme force océanique et notre siège permanent au Conseil de sécurité, que certains voudraient remplacer par un siège européen. Je crois cependant qu'il faut se garder de tout triomphalisme : nos concurrents n'étant pas engagés dans des opérations mais seulement dans des manoeuvres militaires, ils ont doté leurs équipements des dernières technologies plutôt qu'ils n'ont cherché, comme nous le faisons du fait même de notre engagement dans des opérations, à les adapter aux adversaires éventuels : ce décalage d'engagement compte pour beaucoup dans notre succès.
Vous êtes notre ambassadeur pour toute la zone Pacifique, qui abrite les quatre-cinquièmes de notre zone économique exclusive; nous n'en tirons aucune ressource : a-t-on avancé de ce côté-là, ne serait-ce que dans la prospection, les études ? Enfin, où en est la Nouvelle-Zélande ?

Je vous félicite pour votre action, Monsieur l'ambassadeur, mais aussi pour votre état d'esprit positif, votre propos fait du bien et nous attendions cela depuis longtemps : vous nous donnez aussi une idée plus moderne du rôle de l'ambassadeur idéal... Une question : comment voyez-vous la diplomatie parlementaire ?

Votre enthousiasme communicatif, effectivement, nous fait du bien. Pouvez-vous nous préciser les aspects financiers de l'accord passé et du contrat à venir ? Pensez-vous que la méthode utilisée soit applicable à d'autres secteurs, en particulier à l'aéronautique et au ferroviaire ?

Je sais que vos fonctions antérieures vous ont sensibilisé aux questions d'intégration et ces compétences acquises vous ont certainement aidé dans cette négociation - c'est aussi un élément à prendre en compte dans la définition de ce qui fait un bon ambassadeur. Sur les conséquences des contrats à venir, la presse américaine se fait l'écho de la création de 4000 à 5000 emplois en France : qu'en est-il ?

Merci, Monsieur l'ambassadeur, vous nous faites du bien en nous parlant de la technologie française, de la France créative - et ce grand succès tient pour beaucoup à votre action. Cette réussite nous démontre, s'il en était besoin, que nous devons avoir confiance dans les potentialités de notre pays. Je vous remercie également d'avoir cité la COP 21 et je déplore que certains de nos collègues n'en mesurent pas l'importance.
Deux questions : cet accord aura-t-il une incidence sur nos relations avec les autres pays de la région ? Quelles sont les priorités pour son suivi ?

Comment l'Australie juge-t-elle l'attitude de Pékin en mer de Chine ? Les Australiens parlent-ils d'une menace ? Quelles suites aux cyber-attaques qu'ils ont subies ? Quelle répartition des rôles dans la défense collective, entre les différents pays de la région - en particulier les Etats-Unis ? L'Australie est-elle sur une position alignée sur celle des Etats-Unis, ou bien est-elle en train de s'autonomiser ?

Ce succès commercial avec l'Australie et ce que vous nous en dites, Monsieur l'ambassadeur, confirme ce que nous avons vu dans d'autres pays : la négociation commerciale est laissée aux industriels, les responsables politiques s'attachent quant à eux à créer un climat général de confiance à leur niveau. Je salue la mobilisation très large qui a permis cette victoire, en particulier celle du ministère de la défense. L'enjeu est effectivement le partenariat stratégique avec l'Australie, donc de conforter nos relations sur les sujets qui nous sont communs, où chacun cherche des solutions : c'est une fois ce climat de confiance et de travail instauré, que l'on obtient des succès commerciaux, nous le constatons dans bien des régions du monde. Dans quels autres secteurs voyez-vous des possibilités d'autres succès ?

La mémoire de la Première guerre mondiale est effectivement capitale dans les relations qu'entretiennent les Australiens avec notre pays - je pourrais citer plusieurs anecdotes avec d'anciens combattants centenaires encore présents aux cérémonies il y a une dizaine d'années. Les responsables politiques australiens sont au rendez-vous et nous apportent de l'aide pour la vie des sites mémoriels, mais aussi pour des relations vivantes avec nos territoires - je pense en particulier à l'école franco-australienne de Pozières, dans la Somme, c'est un exemple très intéressant.

Tel père, tel fils : votre père a été un excellent ambassadeur, je l'ai constaté à Beyrouth, vous voici engagé à votre tour. Cent mille Français vivent en Australie : espérons que certains des emplois liés aux sous-marins leur reviendront. Je me réjouis, également, de la création de nouvelles écoles.

Voici des éloges bien mérités, mais gardez en mémoire ce mot de Claude Brasseur : « Un homme qui reçoit une gifle est un homme giflé, un homme qui reçoit un hommage, est un homme âgé » (Sourires).
Sachez rester jeune, Monsieur l'ambassadeur !
Merci pour vos encouragements. Je crois que la règle d'or est bien de garder la tête froide, d'autant qu'une fois l'accord obtenu, l'essentiel est encore à venir.
Notre méthode a effectivement renversé des habitudes et des façons de faire. Le génie français a trop souvent consisté soit à foncer dans la mêlée, sabre au clair comme dans la bataille de Crécy - pour se retrouver vite à terre -, soit, façon La guerre des Gaules, à offrir la victoire à l'adversaire après s'être épuisés dans la discorde. Ce constat fait, nous avons adopté ce que l'on peut appeler « la stratégie de la tortue » : être modeste, discret, persévérant, avec un fort esprit d'équipe - qui sont autant de valeurs cardinales de la société australienne, les Australiens y sont très attachés et très attentifs, cela se voit dans la vie quotidienne, aussi bien dans leur goût pour les sports d'équipe que dans les récits de la Première guerre mondiale qui valorisent avant toute chose la camaraderie entre soldats, le fait de ne laisser personne sans secours. Ces qualités ne sont pas celles qu'on associe au génie français, nous les avons cultivées d'autant plus facilement que nous étions en position d'outsider et que nous savions que rien ne nous était acquis, que nous devions travailler beaucoup, tâcher de convaincre, persévérer. Nous avons travaillé en équipe, l'équipe France, comme pour l'interprétation d'une symphonie : à chaque instrument sa musicalité, mais avec une partition commune.
Nous avons commencé avec les entreprises elles-mêmes. Vous avez tout à fait raison de souligner l'importance de Thales : pour les Australiens, c'est une entreprise australienne tant le groupe est implanté dans le pays, elle entre dans la fabrication de sonars, de véhicules blindés, de fusils, de munitions, ou encore dans la réparation navale, c'est une entreprise emblématique de l'industrie de défense australienne. Le PDG de Thales, Patrick Caine, s'est très vite engagé. Nous avons élargi le cercle à Safran et à Schneider, mais aussi à une trentaine de PME françaises que j'ai fait venir pour associer leur savoir-faire très spécialisé et très largement reconnu : cet ensemble a montré la profondeur du partenariat que nous étions capables de nouer.
Il y a eu ensuite la mission confiée par le Medef à Guillaume Pépy, qui s'est rendue en Australie avec une importante délégation de chefs d'entreprises françaises, tous secteurs confondus. Les Australiens ont été très sensibles à notre bonne articulation entre la recherche et l'entreprise - nous sommes très bien classés par l'OCDE sur ce point, alors que l'Australie accuse un net retard -, et nous avons montré à cette occasion l'écosystème « France » dans son ensemble.
Il y a eu, en parallèle, l'engagement de toutes les administrations concernées, elles ont été coordonnées plutôt que concurrentes, en particulier le Quai d'Orsay et le ministère de la Défense, orchestrés par Laurent Fabius et Jean-Yves Le Drian ; tous les responsables sont venus sur place pour dialoguer avec les Australiens, crédibilisant l'offre globale de la France.
J'ai obtenu la nomination d'un représentant spécial pour l'Australie, en la personne de Ross McInnes, Président du Conseil d'administration de Safran, né australien, naturalisé français et dont le père est un patron de premier plan à Camberra : il a pu dire aux Australiens ce que ni le ministre, ni son ambassadeur, ni les patrons français pouvaient dire, ce lien a été important.
La diplomatie parlementaire a joué tout son rôle, et singulièrement celle de la Haute Assemblée, qui n'a pas ménagé ses efforts : il y a eu la mission conduite par le Président Jean-Claude Lenoir, qui a rencontré tout le monde sur place, il y a l'action du groupe d'amitié France-Australie, conduit par notre collègue Marc Daunis, il y a bien sûr votre commission, qui soutient notre action - le Sénat a été en première ligne.
Quel est le rôle de l'ambassadeur, dans une telle séquence ? Je crois qu'il doit avoir suffisamment d'autorité pour animer l'orchestre dans la durée - pour filer la métaphore symphonique -, tout en évitant l'écueil du caporalisme ; car en réalité, l'ambassadeur n'a aucun pouvoir sur tous ceux qui s'engagent dans le partenariat, qui en sont les acteurs. Chacun vient avec sa propre histoire et il doit pourvoir l'exprimer, la vivre, parce qu'elle n'est ni tout à fait la même ni tout à fait une autre que celle des autres, et l'ambassadeur est là pour faire partager la vision d'ensemble, proposer à chacun d'y contribuer au bon moment, sans froisser les sensibilités et en laissant à chacun sa part de lumière, de succès. C'est pourquoi, même si je suis très heureux de vos louanges, je sais qu'elles s'adressent à une équipe, le succès est collectif et l'essentiel du travail est devant nous.
Nous avons été choisis comme partenaire préféré, la négociation exclusive doit ouvrir sur la signature d'un contrat d'ici la fin de l'année - c'est le calendrier souhaité par le Premier ministre australien -, il nous faut maintenant honorer nos engagements : technologiques, industriels, mais aussi celui de l'accompagnement étatique - le président de la République a pu, à un moment clé, réaffirmer des engagements de l'Etat français qui ont pesé lourd dans la décision.
Quel sera l'équilibre financier de cet accord et son impact sur l'emploi, en particulier pour notre territoire ? Ces volets sont à construire, nous en connaîtrons le contenu une fois seulement le contrat signé. Ce que je peux vous dire cependant, c'est que les Australiens ont mis l'accent sur la qualité de l'offre plutôt que sur le seul prix...
C'est vrai, l'accent est clairement mis sur les transferts de technologie. Nous sommes crédibles parce que notre industrie de défense est souveraine et autonome, c'est une constante depuis six décennies. Ce partenariat stratégique passe par un partage d'éléments clés de notre défense, et si nous l'acceptons, c'est parce que nous sommes certains d'avoir en commun avec les Australiens les mêmes valeurs fondamentales, une même vision du monde. Mon expérience passée a fait de moi un militant de la diversité et de l'intégration, ce creuset est au coeur de la culture française et c'est un point de dialogue avec les Australiens. Je sais aussi que le partenariat stratégique ne se limite pas à participer à des manoeuvres communes, mais qu'il consiste à s'engager pour défendre des valeurs communes - et nous savons que les Australiens, comme ils l'ont si fortement démontré par le passé, ne se contentent pas de discours mais qu'ils passent à l'acte, bien plus nettement parfois que certains de nos voisins européens -.
La Chine est-elle perçue comme une menace en Australie ? Au début des années 2000, l'ancien Premier ministre John Howard disait que l'Australie n'avait pas besoin de choisir entre son histoire et son économie - c'est-à-dire entre les Etats-Unis et la Chine; je ne suis pas certain que cette formule soit encore d'actualité. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Australie, ce fait majeur est durable, la Chine se projette hors de ses frontières, dans l'environnement proche des Australiens, avec l'enjeu des routes commerciales de l'île-continent. Sur ce point, la France maintient le principe cardinal du droit international, en l'espèce le respect du droit de navigation dans les eaux internationales.
La question aborigène, en Australie, participe du débat sur le multiculturalisme, sur la diversité. L'Australie est une société de confiance et ce pays qui regarde surtout vers son avenir a encore parfois des difficultés à traiter son passé; le débat est intense sur l'inscription des Aborigènes dans la Constitution en tant que premiers habitants de l'Australie. Je suis certain que l'Australie va revisiter ces questions de manière dynamique et que nos amis australiens trouveront chez nous des débats qui font écho aux leurs.
Nos zones économiques exclusivement exclusives sont effectivement peu exploitées, même si des recherches auraient identifié des gisements d'hydrocarbures, qui pourraient devenir des sujets de coopération avec l'Australie, avec laquelle nous partageons la plus grande frontière maritime.
L'environnement est devenu un sujet majeur pour l'Australie, le Premier ministre actuel a été ministre de l'environnement et il est convaincu, comme nous le sommes en France, que l'environnement et l'économie vont de pair plutôt qu'ils ne s'opposent, qu'il faut les articuler par de l'innovation. Des mesures ont été prises pour plusieurs années, c'est un premier tournant et le Premier ministre australien sera plus actif encore s'il gagne les prochaines élections - dans le fond, il serait déraisonnable pour l'Australie de détruire l'image de pays de grande nature qui est la sienne, en particulier auprès des touristes chinois qui viennent toujours plus nombreux chaque année.

Pouvez-vous nous dire un mot sur l'organisation, institutionnelle, de l'Australie : l'institution du « Gouverneur général », héritée du passé, vous paraît-elle destinée à perdurer ?