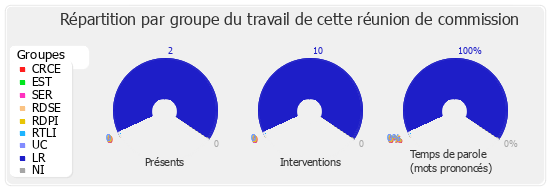Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale
Réunion du 11 avril 2012 : 2ème réunion
La réunion
Au cours d'une première séance tenue dans la matinée, la mission procède à l'audition de M. Pierre-Louis Bras, inspecteur général des affaires sociales.

Dans le cadre de nos auditions sur le financement des établissements de santé, nous entendons ce matin M. Pierre-Louis Bras, inspecteur général des affaires sociales. M. Bras a été directeur de la sécurité sociale et, au sein de l'inspection générale des affaires sociales, il a travaillé à plusieurs reprises sur les questions touchant à l'organisation et au financement des hôpitaux.
Nous vous avons fait parvenir quelques unes de nos nombreuses questions sur la tarification à l'activité (T2A) telle qu'elle a été mise en oeuvre en France, et sur l'architecture actuelle du financement des hôpitaux. Mais préalablement, nous souhaiterions connaître votre appréciation globale sur ce mode de tarification commun à la plupart des pays occidentaux, avec toutefois de nombreuses variantes dans ses modalités d'application.
Schématiquement, quels sont les points forts et les points faibles de la T2A telle que nous l'avons conçue en France ? Quels bénéfices a-t-elle apportés, quelles difficultés a-t-elle soulevées ?
La T2A ne constitue pas la totalité des ressources des établissements. Son poids est-il optimal ou excessif ?
Enfin, sur quels points l'ensemble du système de financement pourrait-il être amélioré ?
Avec la T2A, chaque établissement est financé en fonction de son activité, alors que les établissements pris globalement sont financés par l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (Ondam), enveloppe dont le montant est fixé chaque année par le Parlement. La T2A, combinée à certaines dotations spécifiques comme les missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (Migac), les forfaits ou les médicaments de la « liste en sus », n'est donc qu'un moyen pour répartir cette enveloppe entre les établissements.
Il faut également distinguer les tarifs et les coûts. Le tarif n'est pas un coût. La hiérarchie des tarifs a vocation à reproduire l'échelle des coûts selon les pathologies.
Enfin, dans notre mode de financement, les tarifs constituent une variable d'ajustement. L'Ondam se répartit entre les Migac et les dotations spécifiques d'une part, l'enveloppe consacrée aux soins d'autre part. De cette dernière, on déduit les tarifs en s'appuyant sur l'évolution prévisionnelle de l'activité.
Lorsque l'on évoque la contrainte financière qui pèserait sur les établissements, c'est moins la T2A que l'Ondam qui est en cause. La T2A sert à répartir une enveloppe fermée. Avec la dotation globale, les budgets des établissements étaient discutés dans une logique de rapport de force impliquant les élus, les médecins, les directeurs d'hôpitaux et les autorités sanitaires régionales. La T2A y a substitué l'application d'une règle automatique susceptible de garantir une meilleure allocation des ressources.
Ce mode de tarification influe nécessairement sur le comportement des établissements. Ceux-ci sont incités à augmenter leur activité, avec pour premier effet bénéfique une meilleure réponse aux besoins de santé. Avec la dotation globale, certains patients atteints de pathologies lourdes étaient renvoyés ou refusés en fin d'année, faute de crédits. La T2A évite de tels dénis de prise en charge. Elle doit également encourager les établissements à renforcer la qualité des soins en vue d'améliorer leur réputation.
La T2A est-elle inflationniste ? Entraîne-t-elle, de la part des établissements, une induction de la demande et des prises en charge inutiles ? Pour que ce soit le cas, il faudrait que les médecins entrent dans cette logique. Leur déontologie devrait les en dissuader et, à l'hôpital public tout au moins, leur rémunération n'est pas directement fonction de leur activité. Induire la demande parait plus difficile au niveau d'un hôpital qu'en médecine de ville, car les implications pour les patients sont plus lourdes.
L'évolution de l'activité hospitalière au cours de ces dernières années tient pour une bonne part à l'effet codage et à l'augmentation comme au vieillissement de la population. La T2A ne paraît pas avoir joué de rôle particulier. On constate par exemple que les séances de radiothérapie et de chimiothérapie comptent parmi les activités les plus dynamiques. A l'évidence, cela résulte de facteurs étrangers à la T2A.
La T2A pousse également les établissements à réduire les dépenses associées à chaque prise en charge. Cette recherche d'efficience s'effectue-t-elle au détriment de la qualité des soins ? Force est de constater qu'il y a très peu de données à ce sujet. Des études ont été menées aux Etats-Unis. Certaines ont pu mettre en évidence des résultats inquiétants, mais on ne peut pas en transposer les résultats dans notre pays car les situations ne sont pas comparables. Il y a très peu d'éléments sur la situation en Europe et il n'est vraiment pas évident de répondre à cette question.
La faiblesse majeure de notre mode de tarification hospitalière est à mon sens notre incapacité à apprécier, en routine, la qualité des prestations et des prises en charge. Par rapport au Royaume-Uni ou à l'Allemagne, la France accuse un retard significatif dans la production d'indicateurs de qualité. Des efforts ont été engagés avec la procédure de certification des établissements, le recueil d'informations sur les infections nosocomiales et les indicateurs de qualité de la Haute Autorité de santé (plateforme Qualhas). Mais nous sommes loin de la généralisation des indicateurs globaux de résultats sur un grand nombre de prises en charge, tels qu'ils sont publiés en Allemagne, où est également effectué un classement des hôpitaux faisant apparaître les situations anormales. Il n'y a pas en France d'indicateur de mortalité après prise en charge, alors que le Président de la République en avait demandé dès septembre 2008 la généralisation.
Notre système d'évaluation apparaît ainsi déséquilibré car si l'on peut apprécier la performance économique des établissements, grâce à la T2A, on ne peut en revanche suivre la qualité des prises en charge et leur performance clinique.

Au cours de nos précédentes auditions, l'opinion des praticiens hospitaliers sur la T2A, exprimée par leurs organisations syndicales, nous a semblé très critique, en décalage d'ailleurs avec l'appréciation plus mesurée des présidents de commissions médicales d'établissements. Avez-vous un sentiment analogue ?
Est-il exagéré, voire provocateur, d'affirmer que la T2A ne trouve son efficience qu'au détriment de la qualité, en provoquant notamment des sorties prématurées ou des réductions excessives de séjours ?
La T2A comporte-t-elle à vos yeux un risque de sélection des patients, les établissements cherchant à écarter ceux qui présentent les pathologies les plus coûteuses ?
Des missions conduites par l'IGAS il ressort que les médecins ont commencé à s'approprier l'outil T2A. Celui-ci est désormais pleinement intégré dans le dialogue établi, au sein de l'établissement, sur l'organisation des services et de l'activité.
La T2A favorise les démarches de spécialisation, les établissements ayant intérêt à recentrer leurs activités sur les domaines pour lesquels ils sont les plus efficients. Ces démarches sont plutôt bénéfiques si elles ne remettent pas en cause le maillage de l'offre de soins.
En revanche, je ne crois pas que la T2A ait réellement conduit les établissements à sélectionner leurs patients. Cela supposerait que les médecins maîtrisent toutes les complexités de la tarification pour évaluer a priori le rapport entre le coût de prise en charge du patient et sa valorisation par la T2A La dernière version de la T2A, la « V11 », prévoit en outre des tarifs différents selon le niveau de gravité. C'est un élément de complexité supplémentaire, mais aussi l'assurance que les coûts inhérents aux malades les plus lourds seront bien pris en compte.
Enfin, je souligne à nouveau le déséquilibre lié au fait que la performance en termes de qualité n'est pas mesurée, contrairement à la performance économique.
La qualité du service rendu au patient est l'un des éléments à prendre en compte. Dans certains pays, elle est mesurée chaque année en routine dans tous les établissements. Les patients répondent à des questionnaires sur des aspects tels que la qualité de l'information ou la prise en charge de la douleur. Les indices de satisfaction sont suivis dans le temps et l'on peut réaliser des comparaisons entre établissements. Ce type de questionnaire doit être mis en place en France en 2013.
D'autres indicateurs sont bien entendu nécessaires pour évaluer la qualité clinique, comme les taux de réadmission ou de mortalité.

La T2A fait-elle obstacle à la mise en place des parcours de soins, en incitant les établissements à conserver leurs patients au détriment d'une véritable prise en charge coordonnée ? Est-il envisageable de mettre en place un financement des parcours de soins ?
La tarification au parcours relève d'une vision futuriste. Elle est expérimentée aux Etats-Unis. Le « bundled payment », ou paiement par épisode de soins, est pratiqué par Medicare ou certains assureurs privés. Il s'agit d'attribuer une rémunération forfaitaire globale pour les différents acteurs intervenant dans la prise en charge d'une pathologie sur une durée donnée. C'est un système complexe qui suppose de parvenir à déterminer un tarif global, ainsi que l'existence préalable d'une autorité en charge de l'organisation du parcours et de la répartition des paiements entre les professionnels. On voit mal sa transposition dans notre système de soins.
Certaines pratiques en vigueur dans des pays étrangers, comme la pénalisation des réadmissions, mériteraient d'être étudiées pour favoriser la qualité.
En ce qui concerne la coordination des soins, on peut constater que la T2A incite plutôt les établissements à orienter leurs patients vers des structures d'aval, en particulier les services de soins de suite. Cela va dans le sens d'une meilleure organisation des soins.
La difficulté est beaucoup plus grande lorsqu'il s'agit de coordonner les prises en charge entre l'hôpital et la médecine de ville. En France, le médecin libéral est isolé. Dans la plupart des pays européens qui ne pratiquent pas le paiement à l'acte - l'Angleterre, l'Espagne, la Suède - les médecins traitants travaillent en équipe avec des infirmières et des assistants. Ces structures sont beaucoup plus à même d'assurer la coordination avec l'hôpital.

Je partage votre point de vue selon lequel il ne faut pas imputer à la T2A une contrainte financière qui est liée à l'Ondam. Au cours de nos auditions, la question a été posée de l'équilibre entre la T2A et les autres sources de financement, notamment les Migac. La T2A représente environ 80 % du financement des établissements de santé. Certains intervenants ont suggéré qu'il faudrait en ramener la part à 70 %, en réévaluant parallèlement les Migac qui subissent actuellement des réductions importantes. Qu'en pensez-vous ?
Je suis assez étonné de ce débat sur la part idéale que devrait occuper la T2A dans le financement des hôpitaux. Pour le moment, les fonds alloués correspondent aux caractéristiques de l'activité des hôpitaux et à la répartition entre dépenses de soins et d'intérêt général. Si cette activité venait à évoluer, c'est-à-dire si l'hôpital soignait moins pour effectuer davantage de missions d'intérêt général, il faudrait que la proportion respective des différents financements change. La question est donc : faut-il donner de nouvelles missions à l'hôpital venant s'ajouter à ses missions traditionnelles de soins et qui seraient financées par le biais des Migac ? Pour le moment, il me semble difficile d'identifier des pans entiers d'activité dont le financement devrait être modifié.
La question du financement de l'enseignement et de la recherche est différente. L'enveloppe a été traditionnellement calibrée de façon historique, sans lien réel avec l'activité des établissements. Aujourd'hui, l'enveloppe consacrée aux dépenses de recherche comporte un socle fixe, fonction principalement des charges de personnel, une part modulable liée aux performances de l'établissement et une part variable destinée au financement de projets et de structures. Cependant, il n'existe aucune garantie quant au fait que ce qui est attribué aux hôpitaux correspond à ce qui est effectivement dépensé. Cela est d'autant plus problématique que la recherche n'est pas une dépense courante mais un investissement. Elle devrait par conséquent être financée en fonction des opportunités qui existent et non de contraintes autres. Certes, le système évolue puisque la DGOS a annoncé que le socle fixe disparaitrait dans les cinq prochaines années. L'Igas était allée plus loin en proposant de financer la recherche quasi-exclusivement par projets, ce qui n'est pour le moment le cas que dans le cadre du projet hospitalier de recherche clinique (PHRC). Cela permettrait d'identifier des projets, de les faire évaluer par des pairs puis de les sélectionner en tenant compte, bien entendu, des contraintes financières globales. Quand des laboratoires effectuent des recherches à l'hôpital public, le financement se fait par projets. Il pourrait en être de même pour la recherche publique. L'Igas proposait également qu'il revienne au Parlement de voter l'enveloppe recherche et que celle-ci soit exonérée des mesures de régulation infra-annuelle.
Les dépenses d'enseignement étant intégrées dans la même enveloppe que celle de la recherche, l'incertitude sur l'utilisation des fonds est identique. Les missions d'enseignement étant très liées aux soins, il est difficile de connaître leur coût exact. Il serait cependant souhaitable de clarifier les choses.
Pour les autres missions d'intérêt général, les dotations historiques ont été calculées sur la base d'une comptabilité analytique relativement frustre au moment de la mise en place de la T2A. Plus tard, lorsque l'Igas a mené ses travaux sur le financement des Migac, la plupart des ARH n'avaient pas fait le point sur l'utilisation et la pertinence des enveloppes. J'ignore comment a évolué la situation depuis mais je sais qu'il est politiquement difficile de remettre en cause des dotations historiques, souvent considérées comme des avantages acquis, et d'effectuer des contrôles approfondis sur l'utilisation des enveloppes.
Je n'ai pas travaillé spécifiquement sur les aides à la contractualisation mais je trouve problématique qu'elles soient aujourd'hui devenues le mode de régulation infra-annuel de l'Ondam alors même qu'elles sont l'instrument du dialogue entre les ARS et les établissements de santé et qu'elles correspondent à des besoins concrets et réels. Il serait à mon sens beaucoup plus pertinent d'opérer la régulation infra-annuelle sur les tarifs, comme cela est déjà le cas en matière de régulation pluriannuelle. On pourrait imaginer qu'en cas de dépassement prévisible de l'Ondam les tarifs soient abaissés, ou plutôt que la mise en réserve de début d'année soit prise en compte dans la détermination des tarifs. Les conséquences seraient réparties sur l'ensemble des établissements, sans pénaliser les opérations contractualisées.

La Cour des comptes estimait en 2009 que les effets inflationnistes de la T2A pourraient être évités par la mise en place de tarifs dégressifs à partir d'un certain niveau d'activité. Qu'en pensez-vous ?
J'évoquais plutôt une régulation globale répartissant sur tous les établissements les efforts nécessaires au respect de l'Ondam. Il me paraît difficile de mettre en place des tarifs dégressifs par établissement. Ce n'est pas parce qu'un établissement se développe qu'il faut le pénaliser a priori. L'évolution démographique du bassin de population, la réputation de l'établissement, justifient que celui-ci accueille de plus en plus de patients. Pour mettre en place des tarifs dégressifs, il faudrait que les ARS soient en mesure de définir une norme d'activité à ne pas dépasser par établissement et par spécialité, ce qui est extrêmement lourd. L'utilisation d'une base historique inciterait quant à elle à l'immobilisme en termes d'activité. Les objectifs quantifiés de l'offre de soins (OQOS) visaient à réguler le niveau d'activité. Ils ont été abandonnés, il me semble avec raison. Il est nécessaire que les ARS soient en mesure d'apprécier la pertinence des actes effectués dans les établissements de santé mais je suis dubitatif sur cette volonté de planifier l'activité de l'ensemble des établissements de France. Pourquoi vouloir prévoir ce qui est imprévisible ? Avec la T2A, l'argent suit le malade. La puissance publique doit simplement veiller à ce que la répartition de l'offre de soins sur le territoire reste la plus équitable possible tout en laissant suffisamment de souplesse aux établissements de santé.

Je souhaiterais revenir sur la question de la sélection des malades. Certains CHU refusent d'accueillir des malades, notamment pour des opérations cardiaques, lorsqu'ils considèrent que ceux-ci présentent des risques trop importants. Cela leur permet d'afficher de meilleurs résultats dans les classements entre établissements de santé effectués dans les magazines. Cette situation est-elle également liée à des raisons budgétaires et de tarification ? Les dirigeants de centres hospitaliers et les chefs de services ont peut-être parfois un intérêt commun à refuser des malades, non seulement trop lourds à prendre en charge sur le plan financier, mais qui risquent également de nuire à la réputation de l'hôpital en raison de la gravité de leur état.
La version 11 de la classification des GHS valorise le niveau de gravité des séjours et doit normalement permettre de mieux prendre en compte les malades les plus lourds. Je comprends qu'un chirurgien estime qu'un malade présente trop de risques pour être pris en charge dans son établissement, mais je ne pense pas que ce jugement médical puisse être influencé par des considérations économiques.
Les classements effectués dans les magazines ont quant à eux une portée limitée dès lors que les pouvoirs publics ne sont pas en mesure de construire des indicateurs de qualité et de mortalité ajustés sur le risque. Utiliser des données frustres telles que les indicateurs de mortalité brute n'a que peu de sens. D'autres pays ont développé des indicateurs ajustés sur le risque et la littérature sur ce sujet est abondante. Je rappelle que le Président de la République avait demandé en 2008 à ce que soient mis en place des indicateurs de mortalité ajustés sur le risque. Cela n'a pas encore été fait en France. Pourtant, dans le domaine de la chirurgie cardiaque et thoracique, des méthodes d'ajustement développées et validées au niveau européen sont aujourd'hui utilisées sur la base du volontariat, sans être accessibles au public ni aux autorités publiques. Le travail à fournir pour construire ces indicateurs est encore considérable.

Concernant le parcours de soins, l'accueil en soins de suite et de réadaptation ne permet pas nécessairement aux patients, notamment ruraux, d'être pris en charge à proximité de leur domicile. Il faudrait améliorer les coopérations entre établissements pour maintenir en milieu rural des équipements indispensables tels que les services de soins de suite et de réadaptation ou de gériatrie. Les praticiens ne me semblent pas suffisamment formés pour prendre en compte ces exigences de proximité. J'ai rencontré hier une patiente qui suit une chimiothérapie et vit en milieu rural, à soixante-dix kilomètres du CHU la prenant en charge : une de ses séances a été annulée en raison de ses résultats sanguins ; si la prise de sang n'avait pas été effectuée le matin même au CHU mais la veille, près de chez elle, la patiente aurait évité un aller-retour fatigant pour elle et coûteux en transports sanitaires. Certes, les choses s'améliorent, mais je n'ai pas le sentiment que les médecins soient suffisamment sensibilisés, à la fois aux exigences de maîtrise des dépenses de sécurité sociale et à celles du parcours de soins et de la collaboration avec les autres acteurs de santé.
J'aurais une autre question concernant le développement de services tels que l'hospitalisation à domicile qui ne correspondent pas forcément aux besoins existants. Le corps médical et paramédical se raréfie dans certaines zones tandis que se développent des services nouveaux qui ne sont pas forcément en accord avec les besoins de la population. Développer l'hospitalisation à domicile est une bonne chose mais cela ne doit pas se faire au détriment d'autres services.

Est-il nécessaire de revoir l'échantillon permettant d'établir l'échelle nationale des coûts (ENC) afin d'améliorer sa représentativité ? Quel bilan dressez-vous du processus de convergence tarifaire ?
L'Inspection générale des finances (IGF) est actuellement en train de travailler sur la construction de l'ENC. L'agence technique de l'information sur l'hospitalisation (Atih) souhaiterait bien entendu disposer d'un échantillon plus vaste, mais elle souligne que cet élargissement aurait un coût. Les établissements volontaires doivent avoir mis au point une bonne comptabilité analytique et l'Atih doit s'assurer de la qualité des données qui lui sont transmises.

Les représentants des Hospices civils de Lyon que nous avons rencontrés étaient très sévères sur la qualité de l'ENC.
L'ENC ne sert pas à fixer le tarif mais simplement à établir une hiérarchie entre les séjours. L'Igas a travaillé sur la correspondance entre la hiérarchie des coûts et celle des tarifs. Les distorsions sont nombreuses. Pour l'hôpital public, elles représentent un milliard d'euros, soit des survalorisations de 7 % et des sous-valorisations de 6 % à 7 %. Dans le secteur privé, les survalorisations sont en moyenne de 12 % et les sous-valorisations de 10 %. Pour justifier ces distorsions, on évoque souvent des objectifs de santé publique sans pour autant que la logique en apparaisse clairement. Il s'agit parfois de maintenir des situations acquises. Par exemple, dans le secteur privé, la cataracte demeure très survalorisée car diminuer les tarifs risquerait de mettre en difficulté certaines cliniques. Cependant, à partir du moment où l'enveloppe est fermée, le fait de laisser subsister des rentes pour certains séjours conduit à des pertes pour d'autres types de séjours. Enfin, les distorsions de tarifs ont parfois un caractère incitatif. Ainsi, les tarifs des césariennes ont été dévalorisés par rapport à ceux de l'accouchement par voie basse. Il y a certainement des césariennes non justifiées et il faut contrôler la pertinence des actes. En revanche, dès lors qu'une césarienne est nécessaire, elle doit être tarifée correctement. De même, la chirurgie ambulatoire bénéficie d'incitations tarifaires, mais l'hospitalisation complète est parfois privilégiée à juste titre. Il serait plus judicieux d'encourager ce type de prise en charge par le biais des aides à la contractualisation. L'outil tarifaire est-il un bon outil d'incitation et de contrôle de la pertinence des actes ? Les actes doivent être payés à leur juste coût et l'Igas recommande plutôt une plus grande neutralité des tarifs par rapport à l'ENC. Celle-ci devrait parallèlement être améliorée, surtout dans le secteur privé où l'échantillon est particulièrement restreint.
Ce dernier point renvoie à la question de la convergence tarifaire qui se fait essentiellement vers des GHS du secteur privé, eux-mêmes calculés sur des bases qui ne sont pas toujours pertinente. Sur le principe, il est logique de payer de la même manière des prestations homogènes réalisées sous des contraintes homogènes. Si la V11 a permis d'améliorer certaines choses, il reste des questions non réglées, notamment concernant le coût du travail à l'hôpital public, supérieur de 10 %, selon certaines études, à celui du secteur privé. Mais il est difficile d'envisager une diminution des salaires de 10 % à l'hôpital pour réaliser la convergence. La question du traitement du coût du travail dans la convergence n'a pour le moment pas reçu de réponse politique claire.

Les établissements ne disposent d'aucune marge sur les grilles de salaire et ne pourraient compenser les écarts de coût du travail que par une baisse de la masse salariale.
Il est pourtant difficile de penser que parce que les personnels des hôpitaux publics coûtent 10 % plus cher, ils devraient être 10 % moins nombreux. Deux autres sujets ne sont pas encore éclaircis. Le premier est celui de la précarité, qui est souvent avancée par les hôpitaux publics pour expliquer leurs surcoûts. En effet, les personnes isolées ont des durées moyennes de séjour supérieures de 16 % à celles des autres patients. Pour autant, la Mig précarité n'a pas été calculée de façon suffisamment précise pour bien prendre en compte ce facteur. Le second sujet est celui de l'impact des prises en charge non programmées. Les projets d'études se sont succédé sans que l'on soit en mesure d'expliciter le problème et de l'objectiver.
Enfin, la convergence ne peut se faire que si les modes de rémunération sont équivalents dans le public et le privé, c'est-à-dire si, au-delà du calcul des GHS, est traitée la question de la rémunération des médecins et des dépassements d'honoraires. Comment faire converger alors qu'une partie de la rémunération des prestations effectuées à la clinique, à savoir les dépassements d'honoraires des praticiens du secteur 2, échappe à la régulation ?

Les coûts liés à la part d'activité non programmée devraient pouvoir être mesurés sur l'ensemble du territoire.
Tout le monde s'accorde à dire que les opérations non programmables engendrent un surcoût mais les méthodes susceptibles de le mesurer ne font l'objet d'aucun consensus.

Le problème est pourtant connu et des solutions ont été trouvées pour des sujets plus complexes.

La T2A incite les établissements à devenir plus performants. Or la performance implique des investissements en moyens humains, matériels et immobiliers. Ces investissements pèsent très lourd dans le budget des établissements de santé. Pensez-vous que la T2A doit continuer de financer les investissements immobiliers ou que des solutions alternatives peuvent être trouvées? La même question se pose aujourd'hui pour les établissements médico-sociaux.
Le financement des investissements immobiliers des établissements est aujourd'hui mixte, puisqu'il repose d'une part sur l'autofinancement et l'emprunt, l'un et l'autre s'imputant sur les recettes d'exploitation, et d'autre part sur des subventions. Cela peut paraître bancal, mais intégrer les investissements dans la T2A oblige les établissements à plus de rigueur dans leurs décisions. Certains établissements ont en effet rencontré des difficultés financières en raison d'investissements surdimensionnés lancés sur la base de prévisions d'activité irréalistes. D'autres subissent des difficultés de même type à la suite d'investissements pourtant pertinents. Il n'y a pas de réponse évidente à la question du financement de l'investissement. Dans un pays comme le Royaume-Uni, l'investissement est financé par le National Health Service, qui est propriétaire des biens immobiliers, et chaque établissement paie un droit d'usage du capital. Cela permet de lisser les à-coups.

Les établissements ont parfois contracté des emprunts structurés dont certains peuvent être toxiques. Est-ce une situation répandue ?
Elle existe mais je ne dispose pas de données précises. Il est étonnant que certains établissements aient choisi d'aligner leurs remboursements d'emprunts sur l'évolution de variables aussi totalement déconnectées de leur activité et de leurs ressources que le rapport entre le dollar et le yen. Je ne comprends pas que la régulation dans ce domaine ne soit pas plus stricte et n'empêche pas la spéculation. Rien n'impose la mise en concurrence et les emprunts peuvent être négociés de gré à gré.

Je suis président d'un conseil général qui a contracté des emprunts structurés et cela nous a pour le moment été bien plus bénéfique que des emprunts à taux fixe de « bon père de famille ». L'essentiel est de diversifier les sources de financement.
Les emprunts structurés ont été développés à un moment où les banques réalisaient qu'elles ne faisaient plus de marges suffisantes sur les emprunts à taux fixe classiques. Elles ont donc mis au point des produits moins soumis à la concurrence car difficiles à comparer entre eux. Il faut plus de régulation dans ce domaine et empêcher les établissements de prendre des risques inconséquents.

Si la Fédération hospitalière de France a pu considérer ces opérations comme un peu aventureuses, celles-ci étaient souvent faites de bonne foi et dans un esprit de bonne gestion. Quel regard portez-vous sur les opérations de partenariat public-privé comme celle de l'hôpital sud-francilien ? Ne reviennent-elles pas très cher ?
Cela semble en effet être le cas mais je n'ai pas étudié le dossier de façon suffisamment précise pour être en mesure de me prononcer.

Dans les autres pays, les résultats des comparaisons effectuées entre établissements de santé sont-ils, comme en France, publiés dans la presse ? D'autres canaux sont-ils utilisés ?
L'accueil médical ordinaire représente une part importante de l'activité des services d'urgences, ce qui coûte très cher à la sécurité sociale. Comment faire en sorte que les services d'urgences puissent se concentrer sur leur coeur de métier ? La solution réside-t-elle par exemple dans la mise en place de maisons médicales à proximité des hôpitaux ?
Pour répondre à votre première question, les pays ont adopté des attitudes très différentes. En Allemagne, les indicateurs sont avant tout développés à l'attention des autorités publiques et des équipes elles-mêmes. Il n'y a pas de volonté de les rendre accessibles au public. A l'inverse, l'Angleterre a fait le choix de la transparence pour permettre aux patients de choisir de façon éclairée. Le site internet « NHS Choices » donne accès à une liste d'indicateurs pour chaque hôpital, au classement annuel effectué par la Care quality commission, au taux de satisfaction des patients ainsi qu'à l'appréciation du personnel soignant sur la qualité des soins fournis, deux indicateurs mesurés annuellement dans chaque établissement. Ceci étant, malgré les efforts déployés pour la rendre accessible, l'information n'en est pas nécessairement plus facile à maîtriser et à comprendre, et le patient anglais reste fidèle à ses deux sources d'information traditionnelles : son médecin généraliste et son entourage. Les médecins généralistes peuvent d'ailleurs relayer les informations fournies par le site « NHS-Choice ». De façon plus générale, ces médecins ont leur propre appréciation des établissements de santé et sont à l'origine d'effets de réputation difficiles à mesurer.
Concernant les urgences, la question se pose depuis plusieurs années mais je ne suis pas en mesure d'y apporter une réponse précise.

Le coût supplémentaire lié au fonctionnement actuel des services d'urgences a-t-il été mesuré ? L'engouement pour les urgences hospitalières s'est développé depuis plusieurs années, même dans les zones où les gardes sont correctement assurées par la médecine de ville. Il s'agit là d'une évolution des mentalités qui conduit des familles entières à ne plus fréquenter que les urgences. Le système de régulation en amont des urgences fonctionne correctement. Ce sont les mentalités qui doivent évoluer.
Je n'ai pas d'estimation de coût à vous fournir. Les actes effectués aux urgences ne coûtent pas nécessairement plus cher qu'ailleurs. Les coûts fixes restent importants et il est difficile de savoir à partir de quel niveau de fréquentation les urgences doivent redimensionner leurs services et font donc face à des surcoûts injustifiés.

Les urgences véritables ne représentent que 2 % à 3 % de l'activité des services d'urgences et leur encombrement s'explique par les failles de l'organisation et de la coordination des soins en de nombreux points du territoire.
Les classements publiés dans la presse ne me semblent pas avoir une influence véritable sur le comportement des patients. Ceux-ci font avant tout confiance à leur médecin référent.

Aux Hospices civils de Lyon, la direction nous a expliqué que 40 % des urgences relevaient de la « bobologie » et que la consultation coûtait environ 190 euros contre 23 euros chez un médecin généraliste. La solution n'est-elle pas de mettre en place une maison médicale dans l'enceinte même de l'hôpital ?
Par ailleurs, la T2A doit-elle être étendue à la psychiatrie ?
Les difficultés rencontrées pour le secteur MCO seraient à mon avis multipliées par dix si l'on tentait d'appliquer la T2A à la psychiatrie. En tout état de cause, le modèle ne peut pas être identique. Les modes de prise en charge en psychiatrie sont tellement divers qu'il est difficile de les standardiser. Cependant, sans aller jusqu'à la T2A, il est certainement possible de parvenir à une meilleure allocation des budgets entre les établissements.
La mission procède à l'audition de MM. Jean-Luc Harousseau, président de la Haute Autorité de santé, Dominique Maigne, directeur, Thomas Le Ludec, directeur de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.

J'ai le plaisir d'accueillir le professeur Jean-Luc Harousseau, président de la Haute Autorité de santé, qui est accompagné de M. Dominique Maigne, directeur de la Haute Autorité, et de M. Thomas Le Ludec, directeur de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.
Nos travaux sur la tarification à l'activité nous ont amené à nous interroger sur les relations entre le mode de financement des établissements de santé et le service médical rendu aux patients. Il nous a donc paru essentiel de bénéficier, sur ce point, des éclairages de la Haute Autorité de santé.
La T2A est fréquemment accusée de biaiser les décisions médicales, soit en encourageant des actes qui ne sont pas nécessaires, soit au contraire en réduisant les séjours et en dégradant la qualité des soins, ou encore en sélectionnant les patients et en incitant les établissements à délaisser des pathologies jugées non rentables. Nous souhaiterions savoir si la Haute Autorité a effectué des évaluations à ce sujet et surtout, si elle travaille sur les relations entre le financement des hôpitaux d'une part, la qualité et la pertinence des soins d'autre part.
Aujourd'hui, la tarification répercute de manière assez mécanique les coûts constatés, à l'issue d'un processus complexe. Serait-il possible d'y introduire une dimension qualitative, voire de définir les tarifs par référence aux meilleures pratiques ? Il semblerait que certains pays - les Etats-Unis, le Royaume-Uni - se soient engagés en ce sens. Où en sont les réflexions en France ?
Créée comme la T2A en 2004, la Haute Autorité de santé ne comptait initialement pas, parmi ses compétences, l'évaluation médico-économique des établissements de santé, laquelle s'est ajoutée à nos activités en 2008. Lors de ma prise de fonction en février 2011, certains membres du précédent collège, instance exécutive de la Haute Autorité, opposaient encore que cela ne relevait pas de sa mission, centrée, non pas sur les ressources, mais sur l'état de l'art et les bonnes pratiques. A l'évidence, les difficultés financières des dernières années ont incité à lier l'amélioration de la qualité à une meilleure utilisation des ressources.
Initialement, les recommandations de bonnes pratiques de la HAS n'avaient pas non plus vocation à réguler l'offre de soins : dans la version V2007, la certification des établissements de santé n'aboutissait qu'à un constat et des recommandations, sans risque de non certification. Les choses ont changé : la certification V2010 peut donner lieu à une non-certification ou à un sursis à certification, ce qui confère à la HAS une fonction de régulation des soins.
Nous accréditons les médecins en fonction de leurs bonnes pratiques, dont l'objectif premier est d'éviter les risques. Mais cette accréditation se limite, pour l'instant, aux anesthésistes et chirurgiens du secteur privé, car elle ouvre droit à une aide financière de l'assurance maladie pour la souscription de leur responsabilité civile professionnelle. Nous réfléchissons actuellement à l'élargissement du mécanisme d'accréditation aux équipes hospitalières.
Autre évolution, les recommandations sur les pratiques cliniques. Pendant des années, elles n'ont pas été suivies d'effet, car les médecins en avaient rarement connaissance. Pour y remédier, la dernière convention que nous avons passée avec les médecins de ville lie le paiement à la performance à l'application des bonnes pratiques cliniques.
Loin d'être sa vocation initiale, la régulation des soins est donc une activité récente de la HAS. Depuis ma prise de fonction et l'arrivée de la nouvelle équipe, notre mission s'est dédoublée : évaluation de l'état de l'art d'une part, promotion de la qualité des soins dans une optique de régulation des dépenses d'autre part.
Il s'agit d'abord de veiller à la pertinence des actes et des séjours : c'est notre objectif prioritaire. A la demande de la direction générale de l'offre de soins (DGOS), nous sommes en train d'évaluer les actes pratiqués dans les établissements publics et privés, dans des domaines où l'on constate de surprenantes variations régionales sur des interventions courantes comme les césariennes programmées, les appendicectomies, les interventions sur le canal carpien. Nos méthodes traditionnelles, héritées de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (Anaes), se caractérisaient par une grande rigueur scientifique, mais aussi une certaine lenteur. Nous avons bien compris que la situation financière actuelle imposait une accélération des études, que nous menons désormais en partenariat avec les professionnels, afin de déterminer les conditions optimales de réalisation des gestes. Au total, nous évaluerons une vingtaine d'actes et de séjours hospitaliers dans le programme 2012-2013.
Nous travaillons également avec l'Agence nationale d'appui à la performance (Anap) sur la chirurgie ambulatoire pour redéfinir ensemble les indications et les modalités des actes. Réaliser une évaluation médico-économique contribuera, dans ce domaine aussi, à renforcer la régulation de l'offre de soins.
Autre politique menée actuellement, la définition d'indicateurs associés à la certification. Les indicateurs avaient pour l'essentiel un caractère transversal. Ils relevaient de la DGOS pour les infections nosocomiales, la HAS suivant la qualité des soins et la gestion pratique des dossiers et des hospitalisations. Depuis 2011, nous développons des indicateurs centrés sur les pathologies qui seront utilisés pour la certification, mais qui pourront également servir d'outil si l'on souhaite introduire la qualité des soins parmi les éléments servant de base à la tarification. A ce sujet, la coordination des informations en direction du public se renforce en ce moment. Il faut davantage d'indicateurs de performance clinique, notamment en matière de mortalité. Leur mise en place est difficile, faute de paramètres homogènes de recrutement et de prise en charge des patients, mais elle sera achevée dans les mois à venir.
La HAS n'a donc pas pour mission de tarifer ni de contrôler. Néanmoins, elle joue un rôle préparatoire : elle évalue l'état de l'art, établit des bonnes pratiques et émet des recommandations, permettant aux décideurs de prendre en compte la qualité des soins dans la tarification. La HAS n'avait pas été consultée sur la mise en place de la T2A pour les activités MCO. Elle l'est actuellement sur son extension aux soins de suite et de réadaptation.
Enfin, nous participons à la réflexion sur le paiement à la performance à l'hôpital, mis en place dans d'autres pays. En Grande-Bretagne, l'évaluation de la qualité des soins effectuée par le National institute for health and clinic exercice (Nice) sert de base au National health service (NHS) pour l'établissement de la tarification. Cela dit, nous devons encore attendre les effets de la réforme, toujours en cours. Aux Etats-Unis, Medicare a lié ses financements à la qualité des soins dans les établissements. Les résultats, s'ils ont été appréciables en termes de financement, ne sont pas particulièrement probants en matière de qualité. En effet, une étude récente parue dans le New England journal of medicine a révélé que la mortalité à trente jours n'était pas différente selon que les établissements étaient ou non payés à la performance. Nous sommes donc prêts à contribuer à ce type de démarche. Mais il faut raison garder : le paiement à la performance n'est pas la panacée, tout au moins en termes de résultats cliniques.

Une des caractéristiques de la tarification hospitalière en France est qu'elle s'inscrit dans une enveloppe fermée, l'Ondam. Dès lors, la tarification à l'activité ne correspond ni aux coûts constatés, ni même aux coûts de référence définis par les meilleures pratiques. Ce mode de financement interpelle-t-il la HAS dans sa mission de définition de bonnes pratiques ? Avez-vous des propositions pour améliorer le système, par exemple la sortie de certains actes de l'Ondam ?
En outre, est-il possible à la HAS de garantir que la T2A, poussée à la limite de sa logique, ne nuit pas à la qualité des soins, voire à la sécurité des patients, et à une gestion non discriminatoire par les établissements des personnes nécessitant des soins ?
Enfin, que faut-il privilégier dans le paiement à la performance : la performance économique, critiquée par les opposants à la T2A, ou la performance médicale ? Comment trouver un équilibre ?
La définition de la performance est plurielle, elle peut être économique ou clinique. Aux Etats-Unis, le paiement à la performance du programme Medicare a été évalué au regard du taux de mortalité à trente jours, mais aucune amélioration médicale n'a été relevée. Au sein de l'HAS, nous avons fait le pari que l'amélioration de la qualité des soins serait génératrice d'économies. Certes, elle peut entraîner des surcoûts liés à l'utilisation de nouvelles technologies médicales. Mais nous pensons qu'elle améliore le pronostic et la sécurité des patients et limite les complications. C'est ainsi qu'un accident vasculaire cérébral (AVC) pris en charge à temps et selon des bonnes pratiques coûtera, à terme, moins cher. Nous oeuvrons pour réconcilier la performance clinique et la performance économique.

C'est donc en visant la performance clinique que l'on atteindra la performance économique. Est-ce bien dans ce sens que vous envisagez les choses ?
C'est un postulat que la HAS n'a pas pour le moment démontré. C'est pourquoi notre travail, pour les années qui viennent, consistera à encourager, en particulier pour les pathologies chroniques, la mise en place d'un parcours de soins coordonné entre l'hôpital et la médecine de ville, assorti indicateurs de performance à la fois clinique et économique. Nous réfléchissons déjà à la définition de ces parcours pour les trente affections de longue durée (ALD), ce qui conduira inévitablement à s'interroger sur leur financement. Il n'appartient pas à la HAS d'intégrer des critères de performance dans les tarifs. En revanche, à l'instar du Nice pour le NHS en Grande-Bretagne, elle peut conseiller les décideurs, mission qu'elle poursuit déjà en fournissant des indicateurs.
Les études que nous menons sur la césarienne programmée, les interventions sur le canal carpien et l'appendicectomie démontrent la convergence entre la qualité des soins et la meilleure utilisation des ressources, en particulier du fait du moindre recours à certains actes. Par exemple, grâce au renforcement de l'accompagnement de la patiente, le taux de recours à la césarienne programmée diminue : l'intérêt de la patiente et l'intérêt économique se rejoignent.
La HAS n'a pas les moyens de savoir si la T2A influe négativement sur la qualité des soins et nous ne disposons pas d'étude à ce sujet. Nos opérations de certification ne font pas apparaître de conclusion sur ce point. On constate peu de difficultés de certification pour les établissements de soins de suite et de réadaptation, qui ne sont pas soumis à la T2A. En revanche, la certification révèle des situations très disparates entre les établissements hospitaliers en MCO, y compris pour les CHU, alors que tous ces établissements sont également concernés par la T2A. Pour le moment, il est impossible de relier ces différences constatées lors de la certification à un effet de la T2A. Nos travaux sur la pertinence des actes nous fourniront des informations sur d'éventuels effets inflationnistes de la T2A. En revanche, aucun outil ne permet aujourd'hui d'apprécier si la T2A conduit à des réductions injustifiées de séjours ou à une diminution de la qualité de prise en charge.
Contrairement à la HAS, l'Atih dispose d'outils pour mesurer la segmentation des séjours. Dans notre procédure de certification des établissements, nous évaluons, quant à nous, l'efficience et la pertinence des pratiques professionnelles, plus que la performance économique. Nous incitons les établissements à s'engager dans une démarche d'évaluation de la qualité.
En collaboration avec la DGOS et l'Inserm, nous travaillons sur la prise en compte de la qualité dans le modèle de financement en recherchant un équilibre entre la logique de résultat et la logique d'effort. Aujourd'hui, 18 % des établissements ont obtenu une certification sans réserves, mais il convient aussi de récompenser les efforts de ceux qui, parmi les 82 % restants, tenteront de rejoindre le peloton de tête. Un modèle sera élaboré en 2012 et son expérimentation est prévue en 2013 sur un panel représentatif d'établissements.

La T2A peut-elle inciter les établissements à garder les patients plus longtemps, faisant ainsi obstacle à l'organisation d'un parcours de soins ?
Le parcours de soins est un grand enjeu de santé publique : 15 % des patients, atteints de pathologies chroniques, représentent 60 % des dépenses de santé. Nous devons réfléchir à optimiser la prise en charge de ces maladies chroniques. Le parcours de soins peut être simple dans le cas d'une pathologie aiguë, comme l'infarctus du myocarde ; il est plus complexe dans le cas d'une maladie chronique, qui implique à la fois les soins de ville, l'hôpital et éventuellement les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes (Ehpad), tous ayant des modes de rémunération différents. Je ne me permettrais pas de dire que la T2A est un obstacle à la mise en place du parcours de soins. La HAS se contente, jusqu'à présent, d'émettre des recommandations sans entrer dans la question du financement. L'article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 confie à la HAS l'évaluation des expérimentations visant à optimiser les parcours de soins des personnes âgées en risque de perte d'autonomie, en vue notamment de prévenir leur hospitalisation et de mieux gérer leur sortie d'hôpital. La HAS est consultée sur la conception de ces prototypes, mais la question du financement n'est pas abordée. Il faut bien commencer par définir ces parcours et les mettre en place. Nous sommes prêts à travailler avec tous les acteurs dans cette perspective.

J'avoue m'être interrogé sur le bien fondé de l'audition de la HAS au sujet de la T2A. Mais, vous nous confirmez que vos travaux sur la pertinence des actes permettront de mesurer certains effets inflationnistes éventuels de la T2A. Des études sont-elles en cours sur les opérations de la cataracte et les césariennes programmées ?
En outre, pourquoi un établissement de mon département doit-il fermer, faute de pouvoir recruter un chirurgien, alors même qu'il a été certifié ? Quels sont les critères de certification ?
La troisième itération de la certification, dans la version V2010, est en cours. Nous avons évalué la moitié des 2 800 établissements concernés. Cette démarche a favorisé l'amélioration des pratiques et le développement d'une culture de la qualité et de l'autoévaluation. Pour autant, l'évaluation clinique n'en est qu'à ses débuts, en l'absence d'indicateurs de résultats, tels que les indicateurs de morbidité ou de mortalité.
Cette troisième certification est plus aboutie que les précédentes : nous sommes plus sévères et émettons des réserves majeures sur les pratiques prioritaires, à savoir tout ce qui a trait à la sécurité des patients. A terme, en se fondant sur nos conclusions, l'ARS peut décider de la non-certification d'un établissement.
Nos étudions déjà la prochaine itération de la certification en nous fondant sur les enseignements de la version V2010. Elle reposera sur des évaluations plus fréquentes, tournées vers la sécurité du patient et les résultats cliniques. Elle sera également en lien avec l'accréditation des professionnels de santé. Enfin, si la certification peut être utilisée pour la mise en place du paiement à la performance, elle doit également mener à la restructuration des hôpitaux qui ont de mauvaises pratiques.
Nous menons actuellement quatre études sur la pertinence des actes. La première, sur la césarienne programmée, est achevée. La note de cadrage sur l'appendicectomie est en ligne. Celle sur l'amygdalectomie sera publiée cet été. Enfin, des travaux sur l'opération de la cataracte sont programmés, tout comme dans le domaine de la chirurgie orthopédique.
Autre chantier, la mise en place d'une grille d'analyse des soins de suite. A ce sujet, une note sera produite à la rentrée prochaine, puis un guide complet en janvier 2013.
Au total, ce sont environ vingt sujets liés à la pertinence des soins qui sont à l'étude. Nous voulons y associer les professionnels en prise directe avec les malades et la littérature scientifique internationale. La semaine prochaine, un groupe de travail se penchera ainsi sur la thématique de la pertinence des actes, de son appropriation par le personnel médical à la synergie avec les pratiques courantes.
S'agissant de la certification, 18 % des établissements ont été certifiés, 72 % ont fait l'objet de réserves et de 8 % à 9 % ont bénéficié d'un sursis à certifier, parce qu'ils ne présentaient pas les critères nécessaires à l'évaluation au moment de la visite. Un délai de six à dix-huit mois est accordé aux établissements qui doivent se mettre à niveau, afin qu'ils mènent un chantier-qualité. Nous transmettons aux ARS des informations semestrielles relatives à la planification des visites, les décisions de certification et des fiches regroupant l'ensemble des résultats d'inspections et de contrôle. Il revient ensuite aux ARS de se prononcer sur la non certification des établissements, que ceux-ci connaissent des difficultés momentanées - difficultés de recrutement des hôpitaux psychiatriques par exemple - ou qu'ils ne présentent pas le niveau de compétence requis pour assurer leur offre de soins.

Il semble que les ARS donnent volontiers une accréditation aux établissements prêts à mutualiser leurs moyens. Existe-t-il une volonté d'opérer des rapprochements entre public et privé pour maintenir une offre de soins dans des bassins démographiques en crise ?
Les autorisations d'activité délivrées par les ARS s'appuient sur la certification sans y être liées. Evidemment, un sursis à statuer ou une non certification amène les ARS à se pencher sur le retour à un niveau de qualité suffisant. Ce sont surtout des établissements ayant redéployé leur activité vers le médico-social qui sont concernés, du fait de leur difficulté à faire fonctionner les quelques lits médicaux qui leur restent.
La coopération entre établissements prend la forme d'un groupement de coopération sanitaire (GCS) qui consiste le plus souvent à mutualiser des moyens, par exemple un bloc opératoire. Dans ce cas, la certification s'applique à chaque établissement, mais une seule évaluation est effectuée pour la partie gérée en commun. Dans le cas, très rare, où le GCS donne lieu à la création d'un nouvel établissement, la certification porte sur le nouvel ensemble.

Lors des réunions du Comité national d'organisation sanitaire et sociale (Cnoss) dont je suis membre, la volonté de regroupement entre établissements m'a semblé ténue. Y a-t-il beaucoup de GCS-établissements de santé ?

Quelle est la différence entre un GCS-établissement de santé et un groupement hospitalier ?
La notion juridique diffère de l'appellation. On distingue les GCS-établissements de santé et les GCS de moyens. Les établissements peuvent également coopérer au sein de communautés hospitalières de territoire, parmi lesquelles figurent les groupements hospitaliers.

Que pensez-vous de l'extension de la T2A aux soins de suite et de réadaptation et à la psychiatrie ? Comment financer les activités ne relevant pas de la T2A, en particulier les missions d'intérêt général et aide à la contractualisation (Migac) ? Peut-on leur appliquer des critères de qualité ?
Notre programme de travail sur la médecine de parcours intègre bien entendu les soins de suite et de réadaptation et la psychiatrie. La HAS a par ailleurs été consultée sur l'extension de la T2A au financement des établissements de soins de suite et de réadaptation.
Nous ne sommes pas en charge du modèle de financement, mais je peux simplement préciser que dans le cadre des travaux sur le financement intégrant la qualité, les établissements qui participeront à l'expérimentation bénéficieront de dotations empruntant le canal des Migac. Par ailleurs, dans les actuels compartiments des Migac, aucun n'intègre la dimension qualité. C'est l'ambition du chantier en cours que de modifier cette situation.

Quel regard portez-vous sur la prise en compte de la qualité dans le financement de la recherche au sein des missions d'enseignement, de recherche, de référence et d'innovation (Merri) ? Comment éviter le saupoudrage des crédits qui réduisent les chances d'aboutir à des recherches pertinentes ?
Le programme de recherche en qualité hospitalière (PREQHOS) ne représente qu'une petite ligne budgétaire. Nous sommes associés à son pilotage.
En tant qu'ancien chercheur, j'aimerais que la recherche prenne plus de place dans les missions de la HAS. La qualité passe aussi par l'égal accès aux technologies et thérapeutiques innovantes. Cela relève pleinement de notre action sur l'évaluation des actes, des médicaments et des technologies. Nous devons être particulièrement réactifs pour mettre à la disposition de tous les résultats des dernières recherches. En autorisant un programme de recherche assorti d'une évaluation, la HAS a permis la mise en place d'un nouveau mode de pose de valves cardiaques, par voie percutanée, avec un bénéfice clinique et économique incontestable.