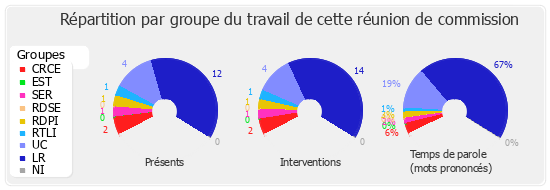Commission des affaires sociales
Réunion du 30 juin 2021 à 9h35
Sommaire
La réunion
Audition du professeur didier pittet président de la mission indépendante nationale sur l'évaluation de la gestion de la crise covid-19 et sur l'anticipation des risques pandémiques
Audition du professeur didier pittet président de la mission indépendante nationale sur l'évaluation de la gestion de la crise covid-19 et sur l'anticipation des risques pandémiques

Nous accueillons ce matin le professeur Didier Pittet, président de la mission indépendante nationale sur l'évaluation de la gestion de la crise de la covid-19 et sur l'anticipation des risques pandémiques.
J'indique que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo retransmise en direct sur le site du Sénat et disponible en vidéo à la demande.
Nous nous interrogeons principalement sur l'organisation de l'État dans cette pandémie et notamment du ministère de la santé et de ses agences. Ce fut l'objet de la commission d'enquête que nous avons diligentée à partir de juillet 2020 et dont les conclusions ont été rendues en décembre. Par ailleurs, notre collègue Bernard Jomier préside actuellement une mission de suivi de la crise sanitaire portant, en particulier, sur les questions d'organisation territoriale et de l'anticipation d'éventuelles prochaines épidémies.
Je vous laisse la parole pour un propos liminaire, avant de la passer aux collègues qui souhaitent vous interroger.
Pr Didier Pittet. - Merci beaucoup pour votre invitation.
Je vous rappelle, en premier lieu, que nous avons rendu un premier rapport d'étape au président Emmanuel Macron en octobre 2020. Ensuite, la mission a été prolongée compte tenu de la seconde vague épidémique qui a sévi. Sur le souhait du président Macron, le second rapport devait faire suite à la demande du directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) de voir chaque pays mener des évaluations sur sa gestion de la crise sanitaire. Nous avons rendu ce rapport à la veille de l'Assemblée mondiale de la santé ayant lieu chaque année la troisième semaine du mois de mai. Nos échéances peuvent ainsi paraitre décalées mais elles étaient simplement liées à l'agenda de travail.
La manière dont nous avons travaillé est fortement biaisée par ma formation scientifique. Nous avons choisi une première approche quantitative et comparative des différents pays au regard du seul élément exploitable aujourd'hui, je veux parler de l'excès de mortalité. Sur la demande d'Emmanuel Macron, nous avons également cherché à travailler sur les aspects sanitaires, sociaux, économiques et de politiques publiques, ce qui constitue une démarche unique parmi les pays ayant mené une telle évaluation de la crise. La plupart des pays se sont en effet concentrés sur les seules questions sanitaires. Les travaux à l'étranger seront rendus également à partir de 2022 alors que nous avons travaillé sur une crise qui n'était pas terminée.
Outre la démarche quantitative, nous avons eu une approche qualitative. Nous avons mené des entretiens et des auditions avec des personnes dont les noms resteront anonymes mais je peux vous indiquer avoir entendu des préfets, des ministres, des personnalités de la société civile, des experts scientifiques, etc. Ensuite, nous avons fait attention à avoir plusieurs experts pour permettre de faire des recoupements. Le rapport fait plus de 200 pages et comprend aussi 250 pages d'annexes scientifiques pour lesquelles l'interprétation que nous avons fournie est destinée aux lecteurs non scientifiques.
Je tiens à souligner enfin que nous avons été totalement indépendants dans cette approche. C'était un souhait fort d'Emmanuel Macron dans sa lettre de mission. À titre d'illustration, nous avons eu accès à tous les documents demandés.
Cette mission a constitué un gros travail mené avec quatre autres experts : Raoul Briet, président de la première chambre de la Cour des comptes, Laurence Boone, chef économiste de l'OCDE, Anne-Marie Moulin, professeur de médecine et d'histoire de la médecine et Pierre Parneix, ancien président de la société française d'hygiène hospitalière. Chacun d'entre nous était épaulé par un ou deux scientifiques de nos équipes pour générer des données qui restent uniques jusqu'à présent.
Merci de nous avoir donné le contexte de ce travail. La garantie d'anonymat des entretiens a certainement dû aider à l'indépendance et à la liberté des expressions.

Merci pour ce rapport. Avec Véronique Guillotin et Christine Lavarde, nous avons eu l'occasion, dans le cadre de travaux de la délégation à la prospective, de rendre un rapport sur le numérique et la crise dont certains constats rejoignent les vôtres.
Une première observation portera sur le classement, selon le nombre de décès, des pays plus ou moins infectés. Certains pays aux stratégies dites « zéro virus », fondées sur des moyens numériques très strictes, présentent des nombres de décès très faibles. Au niveau mondial, la France est classée au 136e rang en nombre de décès avec une gestion qui a connu des retards. Notre stratégie était celle de vivre avec le virus par opposition à d'autres pays dont la stratégie, plus efficace semble-t-il, était basée sur des mesures plus strictes mais non généralisées et plus courtes. Cela mérite d'y regarder de plus près.
Mon deuxième point concerne la faiblesse de l'anticipation dont vous parlez et que nous avons pu constater. La France ne s'était pas donné tous les moyens notamment numériques de préparer cette crise. Un numérique plus intrusif permettrait, par le biais de croisement de données, de cibler davantage les personnes vulnérables et limiterait tant la globalité que la durée des confinements et, avec eux, leurs conséquences sociales et psychologiques. Avez-vous fait une analyse aussi précise ? Avez-vous des préconisations au regard de ce qui s'est fait ailleurs notamment en termes de cellules d'anticipation d'éventuelles crises sanitaires ?

Je vais vous poser les questions que souhaitait vous poser Bernard Jomier, qui préside la mission de suivi. Vous pourrez répondre ensuite à René-Paul Savary, à Bernard Jomier, qui n'est pas présent, et aux autres collègues sénateurs.
Je lis les questions de Bernard Jomier :
« Vous appelez à confier la constitution et la gestion des stocks stratégiques à un unique opérateur placé sous la responsabilité du SGDSN. Pensez-vous qu'il faille revenir à un opérateur dédié à la préparation et à la réponse aux urgences sanitaires comme l'EPRUS ou peut-on maintenir Santé Publique France dans cette mission ? Votre proposition de confier au seul SGDSN la responsabilité de l'opérateur chargé de la gestion des stocks stratégiques est-elle justifiée par son positionnement interministériel ou s'explique-t-elle aussi, au moins en partie, par le fait que le ministère de la Santé et la DGS n'ont pas été en capacité d'assurer une tutelle stratégique efficace de Santé Publique France dans ses missions de sécurité sanitaire ?
Quel bilan faites-vous des comités d'expertise scientifique qui se sont multipliés pendant la crise ? Quelles ont été selon vous les conséquences de la multiplication de ces comités sur la lisibilité et la crédibilité de la parole scientifique ? Pouvez-vous revenir sur les raisons qui vous conduisent à recommander le rattachement du Haut Conseil de la santé publique à la Haute Autorité de Santé ? Souhaitez-vous faire du HCSP l'organe de coordination de l'expertise scientifique en cas de crise sanitaire ? Dans quelle mesure faut-il revoir son organisation et ses missions pour s'assurer qu'il s'appuie sur l'expertise scientifique existant au sein d'agences comme Santé Publique France ou l'ANSM ?
Pr Didier Pittet. - Sur la gestion des stocks stratégiques et la nomination d'un délégué à la prévention des risques infectieux, il est fait référence à d'autres modes d'organisation qui ont été vus dans le passé, à l'époque où Didier Houssin, que je connais bien, était DGS.
Il manque un délégué à la prévention du risque infectieux auprès de la DGS. Vous avez aujourd'hui un délégué à l'antibiorésistance, ce qui est très bien, mais ça n'est qu'une partie de la prévention du risque infectieux. Il conviendrait donc d'étoffer l'expertise au niveau de la DGS par quelqu'un qui supervise la prévention des risques infectieux, incluant l'antibiorésistance.
La gestion des stocks stratégiques a été déficiente, mais elle l'était déjà en 2011, à l'époque de l'EPRUS, puisque quand le RETEX a été fait en 2013 suite à la crise du H1N1 de 2011, on a déjà vu que l'EPRUS avait des difficultés à mobiliser des stocks. Or, cette difficulté n'a pu que s'accroître, puisque l'EPRUS a progressivement fondu et, finalement, ça n'est pas l'expertise de Santé Publique France que de gérer des stocks. Santé Publique France, c'est d'abord la santé publique, la veille sanitaire, la capacité à faire des campagnes de prévention, de la médecine et de la prévention au sens large. Une entité dont l'expertise est de dire : « Faut-il des masques ? Combien en faut-il par personne et par jour et pour combien de temps ? » suffit. Ensuite, préparer les stocks et acheter les masques, c'est de la logistique. Or, la logistique est un autre métier et il nous semblait que le SGDSN en interministériel était vraiment le lieu où l'on peut faire de la gestion des stocks stratégiques dans le domaine de la santé, dans celui de la sécurité ou dans d'autres domaines. Il s'agirait d'un véritable opérateur. Il faudrait également développer la culture de crise, qui manque dans beaucoup de pays du monde. Développer cette gestion de crise en interministériel bénéficierait à l'ensemble des ministères et répondrait à une double mission, d'une part, en temps de calme, de vérifier la gestion des stocks et d' entraîner dans chaque ministère des gens qui seraient habilités à réagir à la crise et, d'autre part, en temps de crise, d'activer tout cela. Notre vision tendait à généraliser l'aspect gestion de crise. Celle-ci est un métier. Vous avez vu qu'au cours de cette crise des tas d'épidémiologistes sont nés un peu partout (un politicien en Suisse a dit que c'était une épidémie d'épidémiologistes), mais il y a l'épidémiologie de terrain et l'épidémiologie d'intervention et ce sont ces gens-là, et pas tous les épidémiologistes, qui sont spécialisés dans la réaction à la crise. Comme la culture d'entreprise, qui consiste à ce que tout le monde respecte les consignes ou fasse les exercices du feu, il faut avoir une culture de la gestion de crise. Cela aurait un sens de la développer au plan interministériel de manière à ce qu'elle puisse être utile à tous les ministères. Dans cette culture de gestion de crise, il y a la gestion des stocks, qui n'est pas simple : il y a des renouvellements de stocks, les stocks tournants ou des décisions à prendre par rapport aux lieux où se font ces stocks. C'est un métier en soi et il est quelque peu injuste de le confier à Santé Publique France.
Merci beaucoup, c'est très clair. Cela correspond au constat que l'on avait fait dans le cadre de la commission d'enquête. Il y avait également les questions sur le HCSP et les questions de René-Paul Savary sur les données de santé. Je vous laisse continuer.
Pr Didier Pittet. - Il a beaucoup été discuté en France de la nomination d'un conseil scientifique, mais il faut savoir, quand on a une vision panoramique, à l'échelle mondiale, que cela a été partout pareil sous des formes différentes. En Suisse, le conseil scientifique s'est appelé « task force » et était composé de plus de 80 personnes, avec des sous-groupes. En France, on a confié à Jean-François Delfraissy la mission de monter un conseil scientifique. En Italie, ils ont un Institut de santé publique, qui s'est constitué en conseil scientifique et est allé chercher des expertises scientifiques.
Aucune crise ne se ressemble. Il faut donc toujours une expertise scientifique différente. Là, il s'agissait d'une pandémie liée à un virus et il fallait des virologues et des épidémiologistes de terrain. Vous avez vu que même parmi les spécialistes virologues, vous aviez par endroit des spécialistes du coronavirus. Ce professeur Christian Drosten dont vous avez entendu parler est non seulement un virologue, mais aussi un coronavirologue qui a passé sa vie dans le coronavirus. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit à l'origine du premier test développé : une semaine après, Pasteur l'avait développé car tout le monde se parle. Vous avez toujours besoin d'experts scientifiques et vous devez aller chercher les meilleurs. Dans chaque pays, la réflexion consistait à savoir quels sont les experts dont on pourrait avoir besoin et quels secteurs seront touchés. Certains pays ont créé de grandes commissions avec beaucoup de sous-groupes, d'autres ont mis en place une commission sanitaire et une commission économique. Petit à petit, on s'est rendu compte qu'il fallait des économistes, des sociologues, etc, mais au départ la crise était essentiellement sanitaire.
On continue donc à dire qu'il faudrait un conseil ad hoc, pas forcément scientifique, mais dans lequel il devrait y avoir des scientifiques, des membres de la société civile, des représentants des agences et des sociétés savantes, de manière à pouvoir formuler des recommandations pour que les politiques publiques puissent être appliquées au mieux et que les politiques puissent prendre leurs décisions en toute connaissance de cause.
En France, vous avez plusieurs agences qui ont été créées il y a de nombreuses années, aux dépens du ministère de la Santé, dont on a diminué les moyens pour les conférer aux agences. Les agences deviennent souvent indépendantes et il devient ensuite difficile de les faire travailler ensemble. L'objectif est d'être sûr que vous pouvez aller chercher l'expertise dont vous avez besoin. C'est dans ce sens que vont nos recommandations. L'expertise doit d'abord avoir des moyens : il faut que les gens soient intelligents, qu'ils puissent travailler, qu'ils aient des ordinateurs assez puissants si ce sont des analystes et qu'ils soient indépendants. C'est pourquoi nous avons pensé à cette capacité d'indépendance potentielle que vous avez au niveau de la HAS. Vous avez un HCSP qui a fait un travail magnifique, un travail de milice en quelque sorte : ces gens-là sont habitués à vous rendre 6 ou 8 rapports chaque année et, cette année, ils en ont rendu à la pelle alors qu'il s'agit d'un petit groupe. Préserver cette indépendance au sein de la HAS avec des structures qui travaillent ensemble, mais peuvent conserver ce degré d'indépendance, nous paraît très important.
C'est tout une réflexion qu'il faut avoir. En dépit d'agences très compétentes, la difficulté qu'éprouvent les experts à travailler ensemble provient principalement de raisons administratives c'est-à-dire d'un excès d'administration.
S'agissant du numérique, c'est évident qu'il s'agit d'un outil clef. En France, il y a eu des manques en matière de réactivité du numérique qui ont été corrigés par la suite.
Concernant l'accès aux donnés, j'ai discuté avec le professeur Arnaud Fontanet qui a pu travailler, mais avec beaucoup de retard, sur des données pour analyser les facteurs de risques. Le vrai problème est que les données existent sans que les chercheurs y aient accès. Pour les questions de santé chroniques, l'accès aux données à intervalles très espacés suffit mais pas en période de crise. Il faut vraiment engager une réflexion sur ce sujet. Il faudrait que vous trouviez les moyens législatifs pour qu'en situation de crise l'accès aux données soit ouvert. Lorsque l'on conduit des investigations épidémiologiques de terrain, pour des petits clusters dans les hôpitaux - c'est mon métier -, il faut faire des enquêtes de terrain avec des définitions de cas qui changent au jour le jour. Il faut mener des entretiens individuels avec les soignants et parfois même aller au domicile de l'infirmière, par exemple, pour remonter à la source du cluster. Pour vous donner des comparaisons, à Bâle, la santé publique a engagé la police judiciaire pour obtenir les informations nécessaires aux enquêtes pour la covid. L'épidémiologie de terrain est en effet très difficile. Si de surcroît des quantités de données ne sont pas accessibles alors c'est dramatique ! Par exemple, il est impossible de répondre à la question de la dangerosité des transports publics sans accès aux données épidémiologiques. Les bases de données sont généralement remarquables mais les épidémiologistes font face parfois à une incapacité de les croiser et de les exploiter. C'est vraiment dommage de savoir que les données sont là sans pouvoir s'en servir. La France est tout de même loin d'être le seul pays dans ce cas.
Je partage à titre personnel votre avis sur cette question des données. En étant trop frileux, on perd une manne de renseignements, ce qui peut se répercuter par une mauvaise gestion de la santé publique. Sur ce sujet, il y a eu le rapport de la délégation à la prospective évoqué par René-Paul Savary. Nous allons lancer au sein de la commission des affaires sociales une mission spécifique sur les données.
Pr Didier Pittet. - Il vaut mieux le faire en période de calme pour qu'en période de crise on puisse y avoir accès sans débat.

Monsieur le professeur, les conclusions de votre rapport ne sont pas tendres. Vous indiquez que notre pays aurait connu des faux pas en matière de pilotage. Vous soulignez toutefois - et nous en sommes très conscients ici - que la mobilisation du personnel hospitalier a permis de compenser toutes ces erreurs. Votre mission préconise trois axes de travail dans la préparation aux nouvelles crises. Quelles anticipations préconisez-vous concernant le variant delta ?
Pr Didier Pittet. - Tous les pays ont manqué d'anticipation. Tous avaient prévu des plans pandémie à la suite de la grippe et pourtant très peu d'entre eux les ont utilisés pour la covid ; je suppose que ceux qui les ont mis en place n'étaient plus là.
Pour répondre à la question concernant le variant delta, il faut savoir que tous les virus évoluent naturellement sous forme de variants. C'est un processus darwinien qui leur permet de survivre. Beaucoup de ces variants ne comportent aucun avantage sélectif et disparaissent. Comme tous les autres variants, celui dénommé delta est né de la pression de sélection que le virus subit. Dès que des séquençages ont pu être réalisés, on a compris que le SARS-CoV-2, qui est un coronavirus, mutait assez souvent. Par la suite, il a augmenté sa cadence de mutation parce qu'il a senti la pression de sélection de l'entourage qui se renforçait. Le variant alpha est par exemple apparu et a pris de la place au Royaume-Uni.
Le variant delta, comme le variant alpha, est plus contagieux que la forme première du virus. C'est tout à fait normal puisque pour qu'un variant prenne le dessus sur les autres, il faut qu'il soit plus contagieux. Le variant delta l'est aujourd'hui de 50 à 60 % en comparaison au variant alpha qui, lui-même, était plus contagieux de 40 à 50 % que les formes de virus qui courraient à l'époque. Actuellement, on estime qu'entre 10 % et 20 % des contaminations ont lieu par le variant delta en France. Il va progressivement prendre le dessus mais la bonne nouvelle demeure que le vaccin et l'immunité protège contre le variant delta.
Les variants qui sont le plus à craindre naissent dans les pays où les taux de vaccination sont les plus élevés parce qu'il s'agit d'une course entre les variants et les vaccins. Parce qu'il sent de plus en plus de résistance, le virus est logistiquement programmé pour s'adapter et ainsi survivre.
Je rappelle tout de même qu'aucun variant ne résiste à l'hygiène des mains, à la distance sociale et au masque. Bien que la vaccination permette de reprendre des activités, il faudra de toute manière garder les gestes barrières. La clef du succès réside dans le faible nombre de cas de contamination permettant ainsi de remonter les chaînes de transmission et d'y mettre fin. Le virus ne va jamais disparaître et nous allons devoir apprendre à vivre avec lui. Nous sommes tous infectés dans l'enfance par quatre grandes familles de coronavirus contre lesquelles nous développons presque tous des anticorps avant l'âge de vingt ans.
Pr Didier Pittet. - Ce sont des virus qui vivent avec nous, qui malheureusement nous font des petits rhumes ou des petits accès de pneumonie de temps en temps. Nous allons devoir vivre avec ce virus. Il faudra des années pour que 99 ou 100 % d'entre nous soient immunisés contre la covid-19 et après on n'en parlera plus. C'est pour cela que la vaccination nous aide à accélérer ces étapes de la vie avec le virus.

Monsieur le professeur, j'aimerais connaître votre avis sur le fait de savoir s'il n'aurait pas fallu renforcer les pouvoirs de nos préfets de départements, qui connaissent bien les élus locaux. Nous, sénateurs, représentons les élus locaux et sommes attentifs à ce qu'ils soient associés à toutes les décisions. Personnellement, je regrette que les préfets de départements n'aient été que des courroies de transmission, n'aient eu aucune prérogative, n'aient pas su s'adapter aux réalités de terrain alors qu'on leur en avait donné la possibilité et les moyens. Dans la partie cévenole du Gard, c'est une aberration d'avoir imposé le port du masque alors qu'il n'y a qu'un habitant tous les dix kilomètres carrés, mais c'était la règle. Si l'on avait donné plus de prérogatives à nos préfets de départements, associés à nos élus locaux, je pense que la gestion de la crise aurait été mieux appréciée par nos concitoyens. Je voudrais donc connaître votre avis à ce sujet.
Pr Didier Pittet. - C'est une très bonne remarque. Un des grands apports de ce rapport réside dans les comparaisons internationales. En France, vous avez un système centralisé et il faut territorialiser. La clé du succès est d'arriver, avec un système centralisé, à mettre en oeuvre sur le terrain la plus juste façon de faire, ce qui est quelque peu contre nature car vous avez toujours fonctionné comme un pays centralisé. Laissez-moi vous rassurer : nous avons comparé les pays centralisés aux pays purement décentralisés, comme l'Allemagne et la Suisse. En Suisse, les cantons sont gérés par ce que vous appelleriez des préfets et chacun avait sa liberté de fonctionnement, sauf au tout début de la crise, où la confédération a pris en central toutes les décisions comme en France, en Allemagne et ailleurs. Il a fallu ensuite appliquer. On disait à chaque responsable de canton : « Allez-y, faites votre boulot ». Cela a marché tant que les choses étaient simples, mais la Suisse et l'Allemagne ont très mal géré la deuxième vague. Proportionnellement, vous avez moins de dégâts en France par habitant qu'en Suisse et en Allemagne, alors que ces pays avaient été relativement protégés de la première vague et que la France, l'Italie et l'Espagne ont été d'abord heurtés par la première vague. Cette capacité à faire travailler en région est une des clés du succès.
A contrario, en Suisse et en Allemagne, les « préfets » avaient la liberté de décider. Pendant la deuxième vague, tous les magasins étaient fermés dans le canton de Genève, alors qu'ils étaient ouverts dans le canton de Vaud, à soixante kilomètres de distance, et tous les Genevois sont allés faire leurs courses dans le canton de Vaud. C'était complètement chaotique. Alors, quelle est la bonne formule ? Je ne le sais pas. Je pense que la France a réussi à territorialiser. Cela a étonné beaucoup de monde au début. Je me souviens que les journalistes me disaient : « Est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait des jauges vertes, oranges et rouges ? » Rappelez-vous, au début, les gens ne supportaient pas ça et ils le réclament aujourd'hui. Il faut donc que l'on soit tous extrêmement humbles. Personne n'avait jamais vécu un phénomène tel que celui-là et nous devons apprendre à fonctionner avec lui.
J'ai discuté, après avoir rendu le rapport au Premier ministre, avec son secrétaire général, qui me racontait qu'ils sont pratiquement tous les jours en contact avec chaque région par visioconférence pour mettre en place ce que l'on appelle en épidémiologie l'implémentation, c'est-à-dire la traduction sur le terrain des consignes données au niveau central. L'exemple que vous donnez est logique : aujourd'hui, s'il fallait prendre des décisions pour le Gard, on ne rendrait probablement obligatoire le masque que dans certaines situations. Mais effectivement, au début, on avait tendance à donner des directives. En Suisse, les « préfets », au mois de novembre, allaient vers le ministre de la Santé en lui demandant de reprendre le contrôle en central car la situation était devenue ingérable. Il n'y a donc pas de système idéal, mais il faut être capable de s'adapter. Après, il ne faut pas que les lois vous en empêchent. Comment les adapter dans ce sens ? Je ne peux pas vous le dire car je ne suis pas un expert. Vous avez raison, il faut s'adapter au mieux sur le terrain tout en gardant une cohérence au niveau national. Or, les États fédéraux ont eu beaucoup de peine à le faire. Je peux vous dire que c'est en débat chez nous maintenant.

Vous avez parlé des gestes barrières. Faut-il les prioriser ? Y en a-t-il de plus importants que les autres ?
Une autre question rapide. On a vécu une troisième vague après votre rapport : pensez-vous que votre rapport a été utile et a-t-on mieux géré cette troisième partie de crise ?
Question suivante : y aurait-il un risque de quatrième vague si le vaccin ne se développe pas assez vite en France ? Comment gérer ce type de crise et comment retrouver une pédagogie forte vis-à-vis des Français qui redeviennent frileux vis-à-vis du vaccin ?
Une autre question sur le numérique intrusif et liée à la pédagogie envers les Français et ce pays assez rebelle. Vous disiez dans votre rapport que la confiance dans les gouvernants est souvent mise en défaut et, pourtant, les Français ont bien joué le jeu des confinements. Comment trouver un équilibre ?
Sur les stocks stratégiques, on ne pense jamais aux pompiers. Pourquoi ne pourrions-nous pas en confier la gestion à ceux qui savent faire, à savoir les pompiers, qui ont cette logique centralisée et décentralisée en même temps.
Dernier point : vous parliez de pédagogie. Comment assurer une information fiable face à cette démultiplication de pseudo-experts qui déversent une forme de savoir incroyable sur les chaînes d'information en continu.

Merci, Monsieur le professeur, de vos propos clairs. Je n'ai pas lu votre rapport, mais j'ai envie de le faire maintenant.
J'aimerais vous entendre sur la population vulnérable, dont on a beaucoup parlé, notamment des personnes âgées en EHPAD, avec la situation de protocoles confus que l'on a connue en France. Mais je voudrais également vous entendre sur la population fragile, migrante, dans la rue, dont on a très peu parlé. Avez-vous des éléments à nous communiquer à ce sujet ?
Vous venez de parler des enfants. Je vous ai lu sur les conséquences catastrophiques de la fermeture des écoles pour les enfants et les familles, mais vous dites également que tant que les classes seront ouvertes, il sera difficile de faire en sorte que le virus cesse de circuler. Sur la vaccination, vous ne souhaitez pas d'obligation vaccinale, mais vous rappelez que rien ne se fera sans vaccination. Ce ne sont pas des contradictions, j'en ai bien conscience, mais tout cela n'est pas très simple.

Vous avez évoqué la création d'un conseil ad hoc associant scientifiques et société civile, ce qui est très large. Comment voyez-vous la prise en compte de la démocratie sanitaire dans la gestion d'une crise et pensez-vous qu'associer la société civile aurait permis de mieux garantir en amont la confiance de la population et de mieux prévenir ses hésitations vis-à-vis de la vaccination ?
D'autre part, la mission appelle à la réalisation d'un état des lieux, aux plans national et régional, des capacités de soins critiques, en opposition aux capacités de soins en temps normal. Pensez-vous que les moyens, les équipements et les personnels formés en soins critiques avaient été sous-dimensionnés au départ, sachant que vous rappelez dans votre rapport que la gravité de l'épidémie a été sous-estimée de janvier à février 2020 ? Quel regard portez-vous sur la coopération entre acteurs publics et privés, et notamment sur le rôle des élus et des collectivités et leur mobilisation pour fournir des masques et des solutions hydro-alcooliques au début de la crise et pour mettre en place des centres de vaccination ?
Pr Didier Pittet. - En ce qui concerne les gestes barrières, les deux principaux sont l'hygiène des mains et la distance sociale. Cette dernière peut parfaitement remplacer le masque qui reste néanmoins utile en intérieur lorsque les gens sont proches. Tout dépend aussi si les personnes auxquelles nous sommes confrontées sont vulnérables ou non vaccinées. Pour un temps, si ce n'est pour toujours, il faudra a minima conserver l'hygiène des mains.
Sur la question de savoir si la troisième vague a été mieux gérée que les précédentes. Oui, elle a été très bien gérée. En France, c'est très clair que la gestion s'est améliorée avec le temps. Ce n'est pas le cas pour tous les pays.
S'agissant de la question d'une éventuelle quatrième vague, il y aura nécessairement des clusters d'infection. Dans l'idéal, il faudra tous les comprendre et tous les interrompre. Le risque de quatrième vague existe mais la progression de la vaccination le réduit. Le vaccin permet d'éviter la transmission du virus d'une personne à une autre. Pour autant, la vaccination n'est pas en elle-même suffisante ; il y aura toujours des personnes non vaccinées et les vaccins ne sont pas efficaces à cent pour cent. L'efficacité des vaccins utilisés en Europe comme Pfizer ou Moderna s'établit autour de 90 ou 95 % - ce qui reste excellent. De plus, l'immunité des personnes vaccinées très âgées n'est plus aussi performante. Pour résumer, plus le nombre de personnes vaccinées augmente, moins il y a de risque de voir apparaître des clusters importants et plus notre système de santé sera protégé permettant ainsi d'assurer les autres soins. Dans tous les pays du monde, un retard, qu'il nous faut rattraper, a été pris dans les soins ne concernant pas la covid.
J'en viens à un autre sujet. Oui, le virus va circuler parmi les enfants et c'est tant mieux ! L'immunité de la population doit augmenter pour atteindre à terme les cent pour cent. En guise de comparaison, l'immunité collective pour la rougeole n'est assurée qu'à partir de 98 %. Lorsque ce seuil n'est pas atteint alors les petits clusters qui se forment peuvent avoir des conséquences très graves pour les jeunes adultes. Les foyers épidémiques de covid qui émergeront dans les écoles ne seront pas graves en soi tant qu'ils restent sous contrôle. Il faut être cohérent avec les gestes barrières sans excès pour qu'ils restent socialement acceptables. Il faudra promouvoir le test. Avoir une faible proportion de tests positifs reste la clef du succès. Cela vaut la peine de lutter autant contre la covid car je ne souhaite cette maladie à personne. Outre les dégâts en termes de mortalité qu'elle cause chez les personnes âgées, elle provoque des longs covid chez une part des personnes jeunes infectées, sur lesquels on ignore encore beaucoup de choses. Pour éviter la quatrième vague, il faudra continuer à aller se faire tester, à s'isoler le cas échéant et à utiliser les passeports sanitaires. En outre, l'automne ne sera pas simple car la grippe sera bien présente. Étant donné qu'elle n'a que très peu circulé l'année dernière, l'immunité de la population est très faible. Il faudra donc se faire vacciner contre la grippe pour éviter des surcharges hospitalières et des infections mixtes : covid et grippe. J'insiste sur un point ; la pédagogie et l'information sont très importantes pour que les gens comprennent pourquoi il faut se faire tester et appliquer les autres bons gestes.
Ensuite, vous posiez la question du numérique intensif. Il faut trouver un équilibre dans le travail que vous allez faire. En donnant accès à l'information, vous rendrez service aux Français et à la santé publique. Il est normal que le numérique prenne une place plus importante dans notre vie. Néanmoins, il ne faut pas que le numérique intensif heurte les opinions des populations et soulève des oppositions trop fortes. Il faut en faire comprendre l'importance.
Sur la question des stocks et du rôle des pompiers, je vois cela d'un oeil plutôt favorable. Il faut qu'un rôle de centralisation à l'échelle du pays soit jouer de manière à ce que les bonnes informations remontent en central et qu'en périphérie les acteurs concernés puissent avoir ce dont ils ont besoin aussi vite que possible.
Au sujet de l'infodémie, selon le terme créé par l'OMS pour désigner l'épidémie d'informations qui a sévit pendant la crise sanitaire, je tiens à dire que c'est un phénomène global ; la Suisse l'a expérimentée aussi bien que la France. En revanche, nous avons la chance en Suisse de ne pas avoir de chaines d'information en continu lesquelles ne font pas toujours appel aux meilleurs experts des sujets. C'est quelque chose qui peut avoir des répercussions importantes. En France, au mois de septembre 2020, ce phénomène a joué un sale tour, si je puis dire, aux décisionnaires. Il faut corriger ça ; on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Si on met le doute dans la population, on peut le payer très cher. L'OMS travaille sur ce sujet de l'infodémie. Nous, les épidémiologistes, connaissons très bien ce phénomène et nous nous efforçons à réagir très vite aux mésinformations.
Madame Meunier, vous parliez de la vulnérabilité des Ehpad. Notre mission a formulé toute une série de recommandations à leur destination. Les Ehpad en France, comme les établissements médico-sociaux (EMS) en Suisse, sont les parents pauvres de la prise en charge. Pourtant, on a besoin de plus en plus d'expertise que ce soit en termes d'accompagnement ou de soutien sanitaire et médical. Nous recommandons, en premier lieu, au sujet de la médicalisation des Ehpad, d'avoir dans les centres de gériatrie des médecins gériatres qui puissent aller travailler dans ces établissements. Nous préconisons ensuite d'avoir au sein de la direction générale de la Santé (DGS) un délégué à la prévention du risque infectieux qui piloterait cette politique sur le terrain en faveur notamment de ce public à haut risque d'infection.
Concernant les plus fragiles et les oubliés de la crise sanitaire, notre rapport rend compte d'une enquête sociologique que nous avons conduite en Seine-Saint-Denis, un département désavantagé où les problèmes d'injustice sociale sont nombreux. Nous formulons des recommandations pour ces zones. Pour la vaccination, il faut aller sur le terrain : installer des tentes en bas des immeubles, ne pas hésiter à sonner à la porte des personnes. Il faut apporter le vaccin aux populations hésitantes ou qui ont du mal à comprendre ou à se déplacer. Je crois que le Gouvernement est très sensibilisé à cette question.
Le sujet de l'obligation vaccinale est épineux. Nous sommes partiellement coupables parce que parmi les soignants, on retrouve une grande hétérogénéité des taux de vaccination. Les médecins sont davantage vaccinés que les infirmières par exemple. En Suisse, les taux de vaccination dans les EMS peuvent varier de 10 à 98 %. Les responsables des Ehpad, qu'ils soient médecins, directeurs ou infirmiers doivent jouer un rôle de modèle pour convaincre les équipes. En Suisse, il est impossible, en droit, de rendre obligatoire la vaccination mais on peut trouver des chemins détournés. Si une infirmière veut travailler en pédiatrie, qui est un secteur très demandé, alors elle doit être vaccinée contre la rougeole. La covid toutefois est une maladie qui ne tue pas assez, en comparaison d'Ebola par exemple, pour facilement instituer des conditions strictes de vaccination. À titre purement personnel, je préconiserai pour le début de l'automne d'instituer une stratégie « zéro covid » pour les soignants qui travaillent dans des Ehpad en leur laissant le choix entre deux options : soit être vacciné ou soit réaliser deux tests par semaine.

Oui, mais il faut des tests.
Pr Didier Pittet. - Oui, mais en France vous avez de la chance, parce que les tests sont gratuits. En Suisse, les tests n'étaient pas gratuits, on a dû se battre pendant neuf mois pour obtenir la gratuité d'une partie des tests.

Mais si on ne se vaccine pas en France, c'est à cause de ça !
Pr Didier Pittet. - Effectivement, on passe d'une éthique individuelle à une éthique collective. C'est pour cela que le débat autour des soignants est extrêmement important, puis il y a le débat dans le reste de la population. Chez nous, le ministre de la Santé est très clair. Il dit : « Nous rouvrons toute une série d'activités et soit ceux qui ne sont pas vaccinés ne pourront pas entrer dans les lieux clos, soit il y aura des décès et il faudra les assumer ». On ne peut pas arrêter toute une société parce que quelques personnes refusent soit d'être testées, soit d'être vaccinées. Je pense qu'il va falloir continuer à travailler dans ce sens-là. Par exemple, sur la question des écoles, fermer les écoles est catastrophique. Les pauvres petits Italiens ne vont pas à l'école depuis 18 mois. Les Allemands ont fait 6 mois sans école. Au-delà de l'éducation des enfants, il y a les problèmes à la maison, la violence et toutes les autres problématiques. Aujourd'hui, on sait mesurer la chute du PIB, mais pas l'impact de la fermeture des écoles dans dix ans. Or, c'est prioritaire. Au sein du Gouvernement, cela a souvent été répété, y compris par Emmanuel Macron : « Oui, nous nous battons pour maintenir les écoles ouvertes. » Faire davantage de télétravail pour garder les écoles ouvertes faisait sens au moment où l'on prenait des mesures collectives. Aujourd'hui, on peut avoir de l'épidémiologie de terrain et des interventions pour maintenir le nombre de cas à un niveau faible, on n'a plus besoin de ces mesures collectives. On a surtout besoin d'être présent sur le terrain pour pouvoir maintenir les écoles ouvertes. Cette question de l'application est compliquée. Dans tous les pays du monde, à part certains dans lesquels la démocratie n'existe pas, on est exposé.
Ensuite, vous revenez sur la question du conseil ad hoc, qui vise à être là de manière adéquate au bon moment et dans lequel il faut inclure la société civile. En France, vous avez des associations et France Assos Santé avec des moyens pour répondre à ces questions. Dans ce rapport, on recommande, au moment où vous constituez un conseil ad hoc, à introduire la société civile. Cela aidera certainement pour les problèmes d'hésitation vaccinale.
Vous posez ensuite la question des soins critiques. Soyons clairs : il n'y aura jamais assez de lits de réanimation et de soins intensifs. Il ne faut pas se leurrer, on ne peut pas avoir quatre fois le nombre de lits de réanimation que l'on a aujourd'hui car il faut avoir le personnel capable de s'occuper des malades. Par contre, il faut que la distribution de ces lits soit le plus homogène possible au sein des territoires en fonction des besoins. Il ne faut pas forcer ces secteurs à ce qu'ils fonctionnent avec 90 ou 98 % de taux d'occupation des lits car ces domaines sont, par essence, sujets à des variations. On le voit dans notre hôpital : en période de grippe, le taux d'occupation des lits est de 120 %, ce qui ne va pas. Il faut donc arriver à trouver de bonnes mesures, notamment un nombre adéquat de lits de soins critiques. Le nombre est sans doute à la limite d'être adéquat en France, mais il faut être sûr que l'on ait les moyens d'augmenter ces capacités lorsque c'est nécessaire. On a un peu moins parlé des lits non critiques : en Italie et en Inde, on n'avait simplement pas d'oxygène. On a vu que l'on pouvait éviter l'hospitalisation en réanimation en oxygénant les malades en dehors de la réanimation quand cela était possible. Il y a eu en France un magnifique exemple d'adaptation de ce phénomène-là et il faut que tout cela soit réétudié pour avoir des volumes adéquats. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vraie prévention de la surcharge en réanimation a lieu en amont, par un travail sur l'intervention de terrain au moment où l'épidémie est là. L'épidémiologie de terrain a dû être adaptée en France comme partout dans le monde, mais il y avait au départ un déficit, que n'avaient peut-être pas tous les systèmes de santé publique dans le monde. Je pense que, dans chaque région, les élus locaux, en partenariat avec les responsables des hôpitaux, doivent discuter de ces capacités d'accueil, mais aussi des capacités de transfert. On l'a vu quand vous avez dû transférer des patients du Grand Est dans le reste de la France comme dans les pays étrangers. C'est normal que cela se passe comme ça car le Grand Est a eu la malchance d'être tout à coup affecté en premier par un phénomène inattendu. Ces choses-là vont se reproduire, donc il faut mieux se préparer. Quand il s'est agi de réaliser ces transferts, vous avez magnifiquement réussi. La solidarité entre pays a très bien joué sur la question des transferts de malades, à la différence d'autres sujets, comme les masques ou les tests. Je pense donc qu'il faut évaluer les capacités d'accueil en soins critiques et revoir les capacités des centres d'urgence. Vous avez tout de même un système de santé, pour ce qui est des urgences, qui a été pénalisé depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Cela ne se passe pas depuis un an ou deux. Il va donc falloir reconstruire tout ça et c'est en cours.

Professeur, vous avez parlé de conseils scientifiques et d'experts et je voudrais faire remonter une remarque d'une profession qui a eu l'impression qu'il fallait mettre le pied dans la porte pour être entendue, les vétérinaires, qui sont pourtant des experts des zoonoses de la vaccination de masse. Vous avez cité le cas d'une transmission par les chats et nous aurions besoin de vétérinaires dans ce genre de cas.
Nous avons eu la chance d'entendre les autorités israéliennes. Sur la question de la quatrième vague, elles parlaient de la durée de la couverture vaccinale, en disant qu'elles surveillaient avec attention le moment où il allait falloir revacciner et y étaient prêtes. La question est en fait celle du top départ pour vacciner. Est-ce que vous êtes dans la même démarche ?

Je voudrais revenir sur ce que vous a demandé Bernard Jomier sur la proposition n° 4 de vos recommandations. Il avait axé sa question sur l'ex-EPRUS, mais je voudrais élargir le propos car on a constaté en France des pénuries importantes en termes de médicaments et de grosses difficultés au niveau des vaccins. Ces pénuries s'aggravent et s'accentuent, il y a eu d'ailleurs de nombreux rapports sur ce sujet. Puisque vous proposez de confier la gestion des stocks stratégiques nationaux de produits de santé à un opérateur unique, j'aimerais savoir si votre proposition englobe une mission de production des médicaments et des produits de santé. Cela nous intéresse beaucoup avec Cathy Apourceau-Poly car nous sommes porteurs, au niveau de notre groupe, de cette proposition qui est de plus en plus soutenue en France et en Europe.
D'autre part, quand vous dites que les transferts des patients se sont merveilleusement bien passés, je pense qu'il faut nuancer vos propos, professeur, parce que cela a eu des conséquences psychologiques parfois très graves, avec un isolement des patients. Cela nous interroge toutes et tous sur la question des fermetures de lits, et pas seulement des lits d'urgence. Il y a eu beaucoup trop de fermetures de lits en France, tous les professionnels le disent et nous n'avons pas une capacité hospitalière d'accueil des patients suffisante.

Monsieur le professeur, vous avez dit qu'il fallait être humble dans la critique de la gestion et je crois que c'est vrai, car en janvier 2020, même la ministre de la Santé se demandait si le virus allait venir en Europe. Il est certain que quand la consommation de médicaments, comme les anesthésiques, est multipliée par mille, c'est compliqué pour tous les pays. Je pense que nous avons eu beaucoup de difficultés et de retard pour tester massivement et surtout isoler les cas contacts. Comment peut-on mieux se préparer pour le faire et le faire accepter par la population ?

Professeur, vous avez indiqué dans l'une de vos réponses que la population à vingt ans était pratiquement totalement immunisée contre quatre familles de coronavirus. Avez-vous des retours sur l'immunité des enfants qui ont été exposés au virus et que pensez-vous de la vaccination des enfants ?

Nous avons entendu parler d'une troisième vaccination sur laquelle j'aimerais avoir votre retour.
Par ailleurs, dans votre rapport, vous parlez des retards de diagnostic, notamment concernant le cancer, et de la surmortalité que pourraient provoquer ces reports. Il y a certainement d'autres maladies. Vous vous appuyez sur un article de la revue « The Lancet », notamment au Royaume-Uni, en août 2020, en disant que cette surmortalité pourrait s'étaler sur les cinq ans à venir. Quelles sont les préconisations, puisque l'on parle de cinquième et de sixième vagues ?

L'armée a une certaine expérience de gestion de crise. Elle réalise régulièrement des exercices sur d'éventuelles attaques chimiques ou bactériologiques. Les militaires ont-ils pu apporter leur expérience et les avez-vous auditionnés ?

Dans cette mission, vous émettez une petite déception, celle de ne pas avoir eu le temps d'aborder l'aspect de la recherche scientifique et pharmaceutique. Vous dîtes même qu'on aurait pu espérer qu'une nation comme la France soit à l'origine de traitements et de vaccins. Pouvez-vous développer ces propos ?

J'écouterai la réponse à la question de ma collègue Nadia Sollogoub sur les vétérinaires avec une grande attention et j'ai, pour ma part, trois sujets de question.
On constate que les contaminations se trouvent à leur niveau le plus bas au cours de cette période d'été cette année comme l'année dernière. À l'issue de ces deux ans, avons-nous identifié les causes ? Peut-on y déceler des raisons climatiques ou les confinements ont-ils permis cette accalmie ? Peut-on en tirer des conclusions pour les années futures ?
Avons-nous, à ce jour, suffisamment de recul sur les traitements mis en place permettant de réduire les besoins en lit de grande réanimation ?
Enfin, lors d'une de nos auditions, nous avons appris que cinq milliards de documents avait été publiés sur la covid. Comment faire le tri parmi toutes ces informations publiées et comment peuvent-elles être contrôlées ?
Pr Didier Pittet. - Concernant la collaboration avec les vétérinaires, elle a été améliorée puisque récemment le docteur vétérinaire Thierry Lefrançois a été intégré au conseil scientifique. Quant au concept du one health, qui représente l'avenir de ces enjeux de santé, nous aimerions qu'il y ait un délégué pour la prévention du risque infectieux au niveau interministériel. Beaucoup de progrès ont tout de même été fait sur cette question puisque, depuis 2012, l'OMS et l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) ont commencé à collaborer. Il faut prendre l'habitude de travailler ensemble sur ces questions notamment de zoonose.
S'agissant de la troisième dose, ce n'est pas certain qu'il faille y recourir. Aujourd'hui, on donne déjà une troisième dose à certains patients les plus immunodéprimés parce qu'on le pratiquait déjà depuis longtemps pour d'autres vaccins. Pour les patients vulnérables, est-ce qu'une troisième dose sera nécessaire ? La plupart des États s'y prépare pour le début 2022 surtout. Quant à une troisième dose pour toute la population, personne ne sait si cela sera nécessaire parce qu'on ne dispose pas du recul suffisant et que tout dépend du vaccin utilisé. Les vaccins à ARN messager Pfizer et Moderna ont une capacité à produire des cellules mémoires en plus grande quantité que les vaccins classiques. Faudra-t-il se faire vacciner à intervalle régulier comme tous les un, deux ou trois ans ? On ne sait pas. Est-ce qu'avec l'immunité atteinte il n'y aura pas une compétition entre les familles de coronavirus qui entrainera un déclin de la covid ? On ne le sait pas non plus. En conclusion, les Etats se préparent à organiser une troisième vaccination. Israël sera le premier pays à le décider compte tenu de son avance en la matière. Ce que je peux dire c'est que si une troisième dose a lieu, elle devra se faire avec les vaccins à ARN messager. Enfin, et en tout état de cause, étant donné l'impact massif du virus sur nos sociétés, ce serait dommage de se priver d'une manière de régler le problème de la covid le plus vite possible en refusant la troisième dose.
Ensuite, je suis favorable à ce qu'une unité centrale spécialisée comme l'Eprus gère les stocks stratégiques tant que ce sont les spécialistes en santé qui identifient la nature et la quantité des médicaments à stocker. Par analogie, il existe au niveau de l'OMS une liste restrictive des médicaments essentiels à stocker. Bien sûr, une belle stratégie consiste à non seulement préparer logistiquement les réponses aux graves crises mais aussi à produire les médicaments dans nos territoires. Néanmoins, nous ne sommes pas allés aussi loin dans le rapport par manque de temps. Il faudrait engager la réflexion pour les vaccins et tous les autres médicaments mais, en tout cas, Emmanuel Macron détient une liste détaillée de tous les composants des vaccins et leur chaine de production.
Sur le sujet des transferts de patients entre régions ou entre pays, je suis d'accord avec vous. S'ils se sont avérés médicalement et techniquement une réussite, ils se sont aussi révélés comme des situations dramatiques au plan social et émotif. Il vaut mieux les éviter autant que possible. Toutefois, au regard des besoins qu'ont été ceux de la région Grand Est au plus profond de la crise, par exemple, on ne peut pas imaginer avoir de telles capacités d'accueil en permanence. Il faut donc trouver des moyens de pallier le manque de lits grâce notamment à la collaboration entre le public et le privé. Sur ce point, la France s'est améliorée avec le temps mais on peut toujours faire mieux. En Suisse, ce partenariat était une réussite jusqu'à ce que les structures privées, guidées par la recherche de rentabilité, n'abandonnassent les structures publiques pour reprendre leur activité habituelle.
Sur le « tester, tracer, isoler », il est certain qu'au départ, la démarche a été handicapée par le manque de tests. Tous les pays y ont été confrontés. En Suisse, les tests et même les écouvillons ont vite manqué. Néanmoins, la doctrine en France a été quelque peu défaillante également. Le développement des tests sérologiques n'était pas aussi urgent que celui des tests diagnostics. Ensuite, au moment du déconfinement, la France a été le pays qui testait le plus mais a péché par le traçage des cas positifs et leur isolement. En effet, il faut des équipes d'épidémiologistes de terrain et en particulier des fins limiers si je puis dire. Une amélioration a eu lieu tout de même. Par comparaison, à Genève, l'équipe de santé publique d'intervention compétente ne comportait que sept personnes au début de la crise pour un canton d'un demi-million d'habitants. Avec la structure créée, ils sont aujourd'hui trois cents personnes et ils devront garder cet effectif. C'est la clef du succès pour avoir un été avec un faible taux de contamination et un automne pendant lequel les clusters sont maitrisés pour garder le plus possible d'activités ouvertes.
J'en viens désormais au sujet de l'immunité des enfants et de la pertinence du vaccin pour eux. Quand les enfants s'infectent et que tout se passe bien, tant mieux. Ils sont immunisés. Il n'y a pas de mortalité chez l'enfant. On constate quelques syndromes inflammatoires graves mais pas inconnus, comme le syndrome de Kawasaki, et ce n'est pratiquement jamais mortel. Cependant, à long terme, on ne sait pas ce que sera l'effet de cette maladie. Le virus a un entropisme, c'est à dire une capacité à se coller à certains endothéliums - la couche interne des vaisseaux notamment les artères du coeur ou les artères nourricières des neurones. Je le redis : je ne souhaite cette maladie à personne. Plus vite on vaccine, mieux ce sera.
Pr Didier Pittet. - Donc les enfants seront vaccinés.

À partir de quel âge ?
Pr Didier Pittet. - Vous savez, les essais cliniques chez l'enfant sont toujours plus longs car on est toujours plus prudent. On descend âge après âge, du jeune adulte à l'enfant. Aujourd'hui, on vaccine les enfants contre la rougeole ou la varicelle : si on avait une épidémie mondiale de varicelle, ce serait une catastrophe autrement plus compliquée à gérer que la covid. On fait des vaccins chez les enfants et c'est grâce à ces vaccins que l'on prévient et éradique les maladies, comme la variole. Donc on y arrivera, mais pas avant d'avoir les données de sécurité vaccinale chez l'enfant. C'est l'évolution normale.
Sur les retards diagnostics, je dirais : « Oui, bien sûr, mais. » Prenons un exemple simple : l'endoscopie digestive. Il y a quinze ans, en Suisse, on recommandait, à partir de 65 ans, une endoscopie par an. Aujourd'hui, on sait que l'on n'a pas besoin d'une endoscopie chaque année, mais d'une tous les trois ans ; et on a des gastro-entérologues qui se construisent des piscines ou achètent des bateaux. Dans cette médecine-là, on ne sait pas toujours jusqu'où il faut aller. Si pendant trois mois, on n'a pas fait d'endoscopie digestive aux personnes qui devaient en faire une tous les trois ans, il n'y aura probablement pas un gros impact sur le cancer du côlon. Peut-être que le gastro-entérologue devra retarder le moment où il construira sa piscine. Je le dis à dessein car il faut bien comprendre que, dans le domaine de la médecine préventive, on a des recommandations qui sont les plus logiques possibles, mais pour lesquelles on n'a pas toujours toutes les informations. Par contre, dans certaines maladies cancéreuses, dans notre hôpital, l'oncologue-chef me dit que le service a souffert de la crise car il a beaucoup travaillé, mais qu'il n'y a pas eu de perte de chance chez tel type de malade, car rien de ce qui se faisait d'habitude n'a été changé. Il faut donc remettre l'église au milieu du village. Oui, cette étude de « The Lancet », la seule disponible à l'époque, fait des évaluations à cinq ans et considère possible de manquer un tel nombre de cancers avec un tel impact et qu'il faut se rattraper. Mais il ne faut pas que l'on se rattrape bêtement, en faisant toutes les endoscopies en retard. Il faut regarder quels sont les malades qui mériteraient que l'on rattrape ce temps perdu. Il y a eu une période pendant laquelle on a moins fait de transplantations d'organes, notamment du rein. Par contre, pendant la première vague, nous avons fait une transplantation du foie qui s'est très bien passée. Il faut donc peser les choses et les étudier pour corriger le plus vite possible ce qu'il faut corriger, en évitant de peindre le diable contre la muraille. Je crois que la vie continue, les hôpitaux doivent reprendre leurs activités rapidement alors qu'il y a des gens qui sont fatigués ou démotivés. Il faut faire une balance du risque de manière à éviter ces pertes de chance, qui évidemment vont avoir un impact : si la pandémie n'avait pas eu lieu, on n'aurait pas ce doute là. Mais je crois qu'il faut les relativiser, c'est important.
Nous parlions de l'armée. Quand on demandait ce que l'armée pouvait faire, on nous a répondu qu'elle était déjà très occupée. Je le crois volontiers. Il est vrai que, pour certaines situations, l'armée est très utile. En Suisse, on y a fait momentanément appel. On utilise également beaucoup la protection civile. Je crois que l'armée peut aider pour la gestion logistique. On pense que la réserve sanitaire pourrait être revue, avec une formation permanente et une meilleure capacité de mobilisation. Il y a des réflexions à mener et je pense que l'armée peut considérablement aider le SGDSN à concevoir le concept de « stock strategy ».
Sur la recherche scientifique, Emmanuel Macron m'a dit que nous avions été complaisants et je lui ai dit qu'il avait raison car nous n'avons tout simplement pas eu le temps. Au fond, dans cette mission, on nous demandait d'évaluer et de donner des conseils pour que des choses puissent être faites immédiatement. Suite au rapport d'étape, des choses ont été mises en place au mois d'octobre. On aurait voulu que Sanofi Pasteur sorte un vaccin, peut-être deux. Ils vont arriver, ces vaccins. Il y a eu un peu de malchance à un moment donné, ce qui arrive toujours en recherche, une vision un peu différente, puis des accords sur la vision et il y a en tout cas aujourd'hui deux vaccins non conventionnels, dont l'un est un mRNA et l'autre tout à fait nouveau, en avancement. Nous aurions peut-être voulu davantage d'innovations françaises, mais il y en a eu quand même. La France a été le premier pays au monde à prendre un décret sur le prix des solutions hydro-alcooliques, ce qui a permis à chacun d'en acquérir à moindres frais. Vous avez également été les premiers à édicter des normes pour la fabrication des masques hygiéniques. Il y a eu en fait beaucoup plus de choses que l'on imagine. Néanmoins, si l'on veut savoir pourquoi les choses ne se sont pas passées comme souhaité, il faut revenir des années en arrière : pourquoi le patron de Moderna, un Français, est-il allé s'installer aux États-Unis ? Toutes les start-ups en Suisse vont s'installer aux États-Unis. C'est une réflexion de fond, mais c'est une autre mission. Je pense que, dans le domaine de la réflexion sur la production des vaccins, la France est le pays qui est allé le plus loin. Mais vous avez raison, le rapport n'aborde pas aussi bien cette question qu'il aurait pu le faire, aussi bien pour des raisons de temps que de constitution de la mission.
Concernant le climat, vous parlez de saisonnalité du virus. Pour l'instant, celui-ci a tendance à être plus facile à transmettre en automne et en hiver, mais ce n'est pas ce qu'on appelle pour autant un virus saisonnier. Il est capable de frapper dans l'hémisphère Sud : l'Australie est de nouveau confinée. Donc, pour l'instant, on peut dire que l'automne ne sera pas propice à une meilleure situation, mais on ne peut pas parler d'une véritable saisonnalité du virus.
Est-ce que le confinement a été efficace ? Oui, mais c'est une mesure extrême, qui ne consiste pas à contrôler un cluster, mais à contrôler tout le monde. On a tous été pris dans cette même façon de faire car il n'y en avait pas d'autre, sauf si on avait eu la chance d'avoir des épidémies extrêmement localisées, ce qui correspond à ce qui se passe aujourd'hui : on saute sur les clusters et on essaie de mieux les comprendre et de les stopper. Néanmoins, cela devient compliqué quand il y en a trop. Pour revenir à la question posée au début, le « zéro covid » n'était pas jouable : il aurait fallu pour cela confiner toute l'Europe en même temps pendant douze, seize ou vingt semaines et ensuite tout reprendre tous ensemble au même moment. Cela a fonctionné à Taïwan, mais ce pays a un Center for disease control absolument exemplaire, avec un ministre de la Santé, devenu Premier ministre, qui est un épidémiologiste de terrain et une méfiance permanente envers la Chine. À Taïwan, on sait où vous êtes chaque fois que vous utilisez votre carte de crédit ou que vous passez dans un endroit où il y a des caméras de télévision (et il y en a partout) et votre voisin téléphone à la police quand vous sortez de chez vous. « Tester, tracer, isoler », ça veut dire quelque chose de différent en France, à Taïwan, à Singapour et au Vietnam. Ce que ces pays érigés en modèles ont fait n'était pas jouable pour nous. Je vous rappelle qu'à Wuhan, au début, votre porte d'entrée était clouée avec des planches pour que vous ne puissiez pas sortir de chez vous. Il paraît quand même très compliqué d'établir ça en France.
Et pourtant, Taïwan connaît aujourd'hui un redémarrage de l'épidémie parce que seuls 6 % de la population sont vaccinés car la Chine bloque l'entrée des vaccins pour des raisons politiques. L'Australie, qui n'arrive pas à vacciner assez rapidement, en est au sixième confinement. Vous avez entendu que Sidney était confiné, mais vous n'avez peut-être pas entendu que tous les territoires étaient bloqués le lendemain soir : si vous étiez dans le Nord pour les vacances, vous rouliez en urgence jusqu'à la frontière car celle-ci fermait à minuit pour quinze jours. L'Europe ne pourrait pas fonctionner comme cela car nous sommes trop dépendants les uns des autres. Je crois donc que ceux qui ont proposé le « zéro covid » n'ont pas tout à fait compris ce que cela voulait dire, ce qui ne signifie pas que l'épidémiologie d'intervention sur le terrain n'est pas fondamentalement importante.
Est-ce que les traitements ont fait des progrès ? Pour ce qui est de la prévention, il n'y a pas d'autre traitement préventif que les gestes barrières aujourd'hui. Quand vous contractez la maladie, les corticoïdes, les stéroïdes, sont les seuls médicaments qui permettent une nette amélioration parmi les traitements précoces. D'autres médicaments sont toujours au stade de l'essai thérapeutique. Pour l'instant, il nous manque un antiviral.
Pr Didier Pittet. - Il y a certes les anticorps monoclonaux mais c'est une technique qui coûte très cher. On en donne seulement que dans certaines situations.

En France, nous nous en sommes procurés.
Pr Didier Pittet. - Certes mais c'est seulement pour une certaine catégorie de malades. J'ai étudié les anticorps monoclonaux dans le domaine de la sepsis. C'est très difficile de montrer un véritable bénéfice, en tout cas lorsque les personnes sont très malades. Il faut être réaliste, c'est la prévention et la vaccination qui sont, aujourd'hui, nos outils principaux.
Enfin, la dernière question portait sur l'ampleur des publications. On a déjà vécu ça à certaines époques. Dans la vie académique, c'est publier ou périr ! Les scientifiques ne sont pas forcément compétents sur la covid mais ils veulent surfer sur la vague, pour utiliser une métaphore. Après avoir mené leurs études, ils ont tous envoyés leurs travaux aux journaux qui ont connu une pression immense. Quand on est vraiment un expert, on peut compter sur son équipe pour faire le tri dans les publications. La plupart n'a pas besoin d'être lue. Mon équipe ne me donnait même pas un article à lire par semaine. Beaucoup d'études ne voulaient rien dire. Les journaux scientifiques ont été tellement débordés que le principe de revue par les pairs n'a pas bien fonctionné. Les vrais spécialistes des sujets n'avaient pas de temps à y consacrer. Ils étaient, eux, les pieds dans la boue ! Des moins bons articles ont donc été publiés en grand nombre et ont nourri l'infodémie. Il nous a fallu répondre et réagir, parfois un peu tard mais nous avons lutté contre cette épidémie d'informations. De plus, certains journaux scientifiques ont un modèle de commerce prédateur. Il faut payer pour être publié ce qui accroît les chances de publier de très mauvais articles. C'est un vrai problème sur lequel l'OMS va travailler.

Merci beaucoup ! J'ai trouvé votre intervention vraiment passionnante à titre personnel. Vous avez été très clair dans vos explications. Vos propos rejoignent certains des diagnostics ou des préconisations que nous avons formulés lors de notre commission d'enquête et j'en suis ravie.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.

Nous examinons le rapport d'information de notre collègue Frédérique Puissat sur le bilan des réformes en matière de dialogue social et de négociation collective.

Madame la présidente, mes chers collègues, le rapport que je vous présente ce matin est le fruit de plusieurs mois de travaux, entamés en janvier dernier, et de plus de vingt auditions.
La mission qui m'a été confiée par la commission des affaires sociales porte sur le bilan des réformes en matière de dialogue social et de négociation collective. Ce bilan se concentre plus précisément sur la série de réformes entamées en 2014-2015 qui ont visé à moderniser le dialogue social et à donner une plus grande place à la négociation collective, et qui se sont conclues par les ordonnances « travail » de septembre 2017.
Même si l'on peut saluer un mouvement de réformes ambitieux, il ressort de ces auditions que leurs effets sont encore peu perceptibles pour des raisons en grande partie culturelles. Je vous présenterai une série de préconisations qui, sans remettre en cause le cadre mis en place par ces réformes, visent à lui apporter des améliorations ciblées et, surtout, à favoriser une meilleure appropriation par les acteurs du dialogue social.
Les partenaires sociaux tiennent traditionnellement une place importante en France, qui s'exprime notamment par la gouvernance paritaire d'un certain nombre d'organismes et de régimes de protection sociale. Cette importance se traduit également par le rôle normatif de la négociation collective, et en particulier de la convention de branche à laquelle la procédure d'extension confère un fort taux de couverture.
Au niveau national et interprofessionnel, le principe d'un rôle subsidiaire de la loi par rapport à la norme négociée a été reconnu par la loi « Larcher » de 2007. Si la lettre de l'article L. 1 du code du travail est généralement respectée, il conviendrait que son esprit le soit davantage, que les invitations à négocier soient plus sincères et que le Gouvernement tienne davantage compte des compromis trouvés par les partenaires sociaux.
Le dialogue social en France présente cependant des faiblesses importantes : un taux de syndicalisation très faible et un paysage syndical fragmenté ; un modèle conflictuel de relations sociales qui rend difficile l'atteinte de compromis ; un dialogue social souvent perçu comme une contrainte et se résumant par conséquent à un exercice formel.
Un dialogue social plus fécond serait pourtant de nature à améliorer le climat social, et donc la qualité des relations de travail, mais pourrait également avoir des effets économiques positifs. Cette idée a inspiré la récente vague de réformes qui ont cherché à faire une plus grande place à la négociation collective, et en particulier à la négociation d'entreprise, avec en point d'orgue les ordonnances du 22 septembre 2017.
Les réformes de la représentativité syndicale - en 2008 - et patronale - en 2014 - constituaient un prérequis afin de renforcer la légitimité des acteurs de la négociation collective. Le principe majoritaire est également apparu comme une condition de la montée en puissance des accords collectifs. Il est devenu la règle pour les accords d'entreprise depuis le 1er mai 2018.
Un référendum d'entreprise peut toutefois permettre de valider, à la demande d'organisations syndicales signataires, un accord minoritaire. Les ordonnances de 2017 ont également donné la possibilité à l'employeur de déclencher ce référendum, sauf si l'ensemble des organisations signataires, représentant au moins 30 % des suffrages, s'y opposent.
Ce pari de la négociation collective s'est concrétisé par une réécriture de certaines parties du code du travail selon une organisation ternaire distinguant les règles d'ordre public, le champ de la négociation collective et les dispositions supplétives s'appliquant en l'absence d'accord. Cette modernisation a permis de donner une plus grande latitude aux partenaires sociaux dans l'organisation de la négociation collective. Au niveau de la branche comme au niveau de l'entreprise, ils peuvent conclure, dans le respect des règles d'ordre public, un accord de méthode précisant le calendrier, les thèmes et les modalités de la négociation. La loi « Rebsamen » de 2015 puis les ordonnances de 2017 ont rationalisé le « mille-feuilles » des négociations obligatoires au niveau de l'entreprise.
Inspirées par l'idée d'améliorer le fonctionnement du marché du travail, les réformes récentes ont cherché à donner une plus grande place à la négociation d'entreprise, soit le niveau le plus proche des besoins du terrain, en remettant en question le principe de faveur. Les ordonnances de 2017 ont ainsi classé en trois blocs les thèmes pouvant faire l'objet de négociations, consacrant une primauté de principe de l'accord d'entreprise.
Au cours de la période récente, le législateur a également créé des catégories d'accords dont les stipulations peuvent se substituer à certaines clauses du contrat de travail. Les ordonnances de 2017 ont simplifié et unifié les différents régimes existants en créant les accords de performance collective (APC).
Ces réformes ont par ailleurs visé à favoriser le dialogue social dans les petites entreprises. Elles ont notamment cherché à assouplir les règles de conclusion des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical en prévoyant des modalités alternatives de conclusion d'accords.
Tous les quatre ans, les salariés des entreprises de moins de 11 salariés sont appelés à voter dans le cadre d'un scrutin régional sur sigle, dit « élection TPE ». Ce vote contribue, en étant additionné avec les résultats des élections professionnelles, à mesurer l'audience des organisations syndicales et permet l'élection de représentants au sein des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI). 265 000 salariés des TPE et employés à domicile ont pris part au dernier scrutin organisé du 22 mars au 6 avril dernier, soit un taux de participation de 5,44 % qui doit nous interpeller.
L'un des volets les plus emblématiques de ces réformes est la fusion des institutions représentatives du personnel (IRP). Les ordonnances de 2017 ont créé une instance unique de représentation du personnel, le comité social et économique (CSE), en lieu et place des IRP existantes : délégués du personnel (DP), comité d'entreprise (CE) et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). La mise en place du CSE est obligatoire dans toutes les entreprises d'au moins 11 salariés depuis le 31 décembre 2019.
Une place importante est donnée à la négociation collective dans la mise en place et la définition des modalités de fonctionnement et des missions de la nouvelle instance. Les partenaires sociaux ont également acquis une plus grande marge de manoeuvre pour fixer l'agenda social de l'entreprise.
Le cadre d'exercice du mandat des élus a parallèlement évolué : les représentants du personnel au CSE ne peuvent effectuer plus de trois mandats successifs et le rôle des représentants suppléants a été réduit ; quant au volume total d'heures de délégation, il a logiquement diminué avec la fusion des IRP.
L'ordonnance permet aux partenaires sociaux de simplifier davantage encore l'organisation du dialogue social dans l'entreprise en confiant au CSE, qui devient un conseil d'entreprise, la compétence de négociation des accords d'entreprise détenue par les délégués syndicaux.
J'en viens aux premiers éléments de bilan de ces réformes. Les données quantitatives indiquent que la négociation collective est depuis plusieurs années engagée dans une dynamique positive, tant au niveau de l'entreprise que de la branche. D'après le bilan publié par la direction générale du travail (DGT), le nombre d'accords d'entreprise a connu une croissance de 30 % entre 2018 et 2019. Ce dynamisme est toutefois en partie en trompe-l'oeil car il est notamment porté par une proportion croissante de textes signés par l'employeur uniquement. S'agissant de la mise en oeuvre de la fusion des IRP, on dénombrait, au 2 juin 2020, 81 371 CSE mis en place (couvrant près de 10,8 millions de salariés) et 39 354 procès-verbaux de carence (concernant environ 1,1 million de salariés).
D'un point de vue plus qualitatif, on peut constater une appropriation lente et conservatrice des réformes par les acteurs du dialogue social. Le bilan d'étape de la fusion des IRP ne permet pas de constater une forte dynamique nouvelle en faveur du dialogue social : la négociation sur la mise en place du CSE, dont le calendrier était contraint par la loi, s'est souvent résumée à un exercice convenu et formel. De même, en matière de négociation collective, les entreprises ne se sont pas saisies de toutes les opportunités ouvertes par les réformes, à l'image de la possibilité de conclure un accord de méthode.
Il semble que l'appropriation des ordonnances de 2017, qui sont venues après beaucoup d'autres réformes, soit difficile tant pour les employeurs que pour les salariés. Il paraît donc prématuré de tirer dès à présent des conclusions générales et définitives de ces réformes dont il y a lieu de penser que l'objectif - donner du pouvoir aux acteurs de la négociation collective - reste pertinent.
Dans l'attente des conclusions définitives du comité d'évaluation des ordonnances de 2017, il convient, avant d'envisager de nouvelles modifications du cadre actuel, de donner la priorité à l'accompagnement des acteurs afin qu'ils s'approprient les réformes, en mettant l'accent sur les TPE-PME.
Ces réformes ont apporté une réelle simplification du cadre du dialogue social dans l'entreprise. En particulier, la création du CSE a clarifié le paysage des IRP. En revanche, certains effets indésirables ont été relevés. En particulier, les accords de mise en place du CSE ont rarement prévu la mise en place de représentants de proximité comme la loi le leur permet. Il en résulte une centralisation parfois excessive et une perte du lien de proximité. Quant à l'usage des APC, qui reste limité quantitativement, il est parfois marqué par un déséquilibre en faveur des employeurs.
En outre, certaines mesures n'ont pas ou peu produit d'effet. Ainsi, la création du conseil d'entreprise représente un échec manifeste : très rares sont les entreprises qui se sont saisies de cet outil. Pour sa part, le référendum d'entreprise reste peu utilisé par les employeurs pour valider un accord minoritaire car il est considéré comme un outil à double tranchant.
La crise sanitaire a dernièrement révélé certaines potentialités et certaines limites des réformes. Ainsi, la négociation collective a été un levier permettant aux entreprises de s'organiser pour faire face à la pandémie. Dans ce contexte, les APC sont également apparus comme un recours dans le but de maintenir l'emploi et d'éviter les procédures de licenciement économique.
Par ailleurs, le dialogue social dans l'entreprise s'est réorganisé avec créativité à la faveur des assouplissements prévus dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il n'en reste pas moins qu'au sein du CSE, dont le rôle et les attributions sont conséquents, les représentants du personnel n'ont pas nécessairement la capacité à hiérarchiser les priorités ou à travailler en délégation. Une des leçons à tirer de la crise est que le dialogue social gagnerait sans doute en efficacité s'il était recentré sur la vie de l'entreprise et sur les préoccupations immédiates des salariés.
Le premier axe des préconisations de mon rapport vise à permettre aux partenaires sociaux dans l'entreprise de se saisir des potentialités des réformes. Dans cette perspective, il convient tout d'abord de continuer à décloisonner les instances.
La réforme du CSE n'a pas remis en cause le monopole syndical au premier tour des élections professionnelles. Pourtant, une ouverture des élections professionnelles à des listes non syndicales aurait pour intérêt de faire tomber certains préjugés réciproques entre acteurs du dialogue social et d'intégrer une représentation de l'ensemble de la collectivité de travail, y compris des éventuels contestataires, dans le cadre du CSE. Elle constituerait également une opportunité pour les organisations syndicales de regagner la confiance des salariés en étant ainsi mis en concurrence et participerait d'une meilleure information des salariés sur le rôle et les réalisations des syndicats.
Il pourrait donc être envisagé, au moins dans les entreprises n'excédant pas une certaine taille, de rendre le monopole syndical au premier tour optionnel en autorisant un protocole d'accord préélectoral à le prévoir. À défaut d'accord, les élections des représentants du personnel au CSE seraient ouvertes aux listes non syndicales qui seraient présentées par une proportion minimum des électeurs. En conséquence, il serait cohérent de préciser dans la loi que l'exigence de proportionnalité femmes-hommes, interprétée de manière restrictive par la Cour de cassation, s'applique aux listes non syndicales.
Par ailleurs, l'intégration des syndicats dans la gouvernance de l'entreprise constitue l'un des enjeux qui restent à traiter à l'issue des dernières réformes. Prévue dès le début des années 1980, la représentation des salariés au sein des conseils d'administration a été progressivement renforcée. En 2019, la loi « Pacte » a ainsi abaissé de douze à huit administrateurs le seuil au-delà duquel la présence de deux administrateurs salariés est obligatoire.
Cette présence de représentants des salariés au sein du conseil d'administration permet de garantir la prise en compte des intérêts de l'entreprise au-delà des seuls intérêts financiers. Comme le montrent plusieurs exemples étrangers, à l'instar de l'Allemagne et des pays nordiques, il est possible d'aller plus loin dans ce domaine. Le nombre de salariés à partir duquel la présence de représentants des salariés au conseil d'administration est obligatoire, qui est aujourd'hui de 1 000, pourrait ainsi être progressivement abaissé. En outre, il conviendrait de supprimer l'incompatibilité entre un mandat d'administrateur salarié et un mandat de délégué syndical, cet assouplissement pouvant également contribuer à faire disparaître certains préjugés.
Je préconise par ailleurs des mesures visant à favoriser l'innovation dans la négociation d'entreprise.
En premier lieu, la prise en charge partielle des cotisations syndicales par l'employeur est possible sous certaines conditions, récemment précisées de manière restrictive par la Cour de cassation. Pour encourager les initiatives de terrain visant à stimuler l'adhésion syndicale, il serait opportun de préciser dans la loi le cadre dans lequel un accord d'entreprise peut prévoir cette prise en charge, en précisant qu'un tel dispositif peut éventuellement bénéficier aux seuls syndicats représentatifs.
En second lieu, dans le but de favoriser l'innovation en matière de relations sociales, certaines entreprises se sont dotées d'un cadre permettant d'expérimenter des projets d'évolutions d'accords collectifs existants en amont d'une éventuelle révision. Il serait pertinent de donner une base légale à ces protocoles d'expérimentation qui peuvent permettre de surmonter un certain conservatisme de la négociation d'entreprise.
La relative faiblesse du dialogue social en France résulte en grande partie d'une formation insuffisante des acteurs. Cette lacune commence dès la formation initiale, notamment celle des futurs dirigeants. Il conviendrait donc d'intégrer davantage de formations au dialogue social et à la négociation collective au sein des cursus universitaires et des écoles de commerce.
Les formations communes aux représentants des salariés et des employeurs, inscrites dans la loi depuis 2016, peuvent favoriser le développement d'une culture partagée de la négociation collective. De telles formations, qui restent aujourd'hui confidentielles, doivent être vivement encouragées. Plusieurs leviers seraient de nature à renforcer le recours à cet outil : lancer une campagne nationale d'information ; demander aux branches de réaliser un bilan annuel de la mise en oeuvre de ces formations communes ; modifier les règles relatives au financement de ces formations par le Fonds paritaire pour le financement du dialogue social. Afin d'améliorer leur attractivité, il serait pertinent de rendre les formations communes éligibles au compte personnel de formation (CPF).
Les crédits dédiés à la formation des acteurs de la négociation collective s'élèvent à 36,6 millions d'euros en 2021, soit sensiblement le même niveau qu'en 2015. Il conviendrait pourtant d'augmenter les moyens donnés aux acteurs pour se former à chaque nouvel élargissement du rôle de la négociation collective.
Certains ajustements permettraient enfin de fluidifier le dialogue social dans l'entreprise. En particulier, il serait opportun d'autoriser l'utilisation par les syndicats de la messagerie électronique de l'entreprise pour communiquer avec les travailleurs, dans les limites définies dans l'entreprise par une charte de bonnes pratiques.
Dans le cadre des mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, les procédures d'information et de consultation du CSE et les règles de la négociation collective ont été exceptionnellement assouplies afin de garantir la continuité du dialogue social et de la vie de l'entreprise. En particulier, certains délais ont été réduits par ordonnance jusqu'au 10 octobre 2020. A la lumière de cette expérience, jugée positive par les directeurs des ressources humaines, il pourrait être procédé à une revue d'ensemble de ces délais afin de déterminer lesquels pourraient être utilement être réduits de manière pérenne sans porter atteinte à la liberté syndicale ni aux droits du CSE.
Le second axe de mes préconisations tend à confirmer la branche professionnelle dans son rôle de régulateur.
La loi définit depuis 2016 les missions dévolues aux branches : celles-ci ont pour missions de définir les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables et de réguler la concurrence entre les entreprises. Toutefois, le renforcement du rôle de la branche se heurte au constat de la fragmentation du paysage conventionnel. Le rapport Poisson de 2009 recensait ainsi plus de 900 branches professionnelles, dont 687 conventions collectives enregistrées par le ministère du travail, nombre d'entre elles étant inactives.
La loi « El Khomri » a défini 5 critères permettant au ministre du travail d'engager une procédure de fusion de champ d'application de conventions collectives et fixé aux partenaires sociaux l'objectif d'atteindre « environ 200 branches professionnelles » dans les trois ans. Cet objectif est aujourd'hui proche d'être atteint. Jusqu'à présent, cette restructuration s'est principalement réalisée sur la base de regroupements volontaires.
Le processus de restructuration du paysage conventionnel apparaît cependant inachevé et doit être poursuivi. Toutefois, alors que le Président de la République avait indiqué en 2017 vouloir parvenir à un paysage de 50 à 100 branches, la fixation d'un objectif chiffré n'apparaît aujourd'hui plus pertinente. L'État et les partenaires sociaux doivent plutôt viser la constitution de branches fortes, à même d'assurer les missions qui leurs sont confiées. Par ailleurs, il pourrait être utile de préciser de manière explicite dans la loi la possibilité, pour les partenaires sociaux d'un même champ conventionnel, de définir des règles spécifiques s'appliquant à certaines catégories d'entreprises et de salariés.
À la suite de la décision du Conseil constitutionnel qui a censuré la possibilité d'engager une procédure de fusion « afin de renforcer la cohérence du champ d'application des conventions collectives », une intervention législative est nécessaire pour déterminer, après concertation avec les partenaires sociaux, les critères sur la base desquels cette cohérence devra s'apprécier. La loi pourrait également fluidifier le processus de restructuration des branches, en laissant les partenaires sociaux définir le délai qu'ils se donnent pour parvenir à la conclusion d'une nouvelle convention collective et en laissant les négociations se dérouler avant de définir la branche de rattachement.
Le critère de représentativité patronale au niveau multi-professionnel devrait être révisé pour tirer les conséquences de la réduction du nombre de branches. Concernant plus généralement les règles de la représentativité patronale, lesquelles sont actuellement remises en cause par certaines organisations professionnelles estimant qu'elles ne permettent pas une représentation équitable des TPE, notamment dans le secteur du bâtiment, une éventuelle intervention de l'État en l'absence de consensus entre les partenaires sociaux devrait être prudente afin de ne pas perturber les équilibres existants.
Le rôle de régulation de la branche s'exerce notamment en matière de fixation des salaires minima conventionnels. Depuis les ordonnances de 2017, le ministère du travail considère que le champ dans lequel l'accord de branche prime sur l'accord d'entreprise en la matière se limite au seul salaire de base. Il serait souhaitable que le législateur intervienne pour préciser de manière explicite le rôle des branches en matière de détermination des salaires, en y incluant éventuellement les primes.
Je recommande enfin de confier à la négociation de branche le thème de la valorisation des parcours des élus. Il s'agit d'un enjeu majeur pour lequel la marge de progrès reste importante en vue de lever les freins à l'engagement syndical. La loi « Rebsamen » de 2015 a tenté d'y apporter des réponses en créant plusieurs outils, parmi lesquels la création d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Cependant, devant le faible nombre d'accords d'entreprise en la matière, il serait pertinent de remonter ce thème dans le « bloc 1 » de la négociation collective.
Voilà, mes chers collègues, les principaux résultats de cette mission d'information. La nécessité d'une pause dans les réformes, alors que la dernière vague n'a pas encore été complètement absorbée, est largement ressortie de mes auditions. Ce principe s'applique notamment, à mon sens, à la tendance du législateur, constatée dans plusieurs textes actuellement en navette - tel le projet de loi Climat et résilience -, à vouloir alourdir de manière impérative les missions du CSE, alors que celui-ci reste, de l'avis des co-présidents du comité d'évaluation des ordonnances, « une instance en devenir ».
Au total, si je partage la conviction selon laquelle la négociation collective peut répondre aux enjeux actuels, force est de constater que des freins restent à lever pour qu'elle prenne toute sa place. Le cadre relativement souple mis en place par les ordonnances offre de nombreuses possibilités que les partenaires sociaux doivent maintenant se donner les moyens d'utiliser. Reste qu'un meilleur accompagnement des entreprises, notamment des TPE-PME, est attendu. Je vous remercie.

Je vous remercie pour votre présentation, il était important que nous puissions faire le point sur les récentes réformes du dialogue social.

Je vous remercie, madame le rapporteur. Nous sommes en 2021 et, depuis 2015, nous avons eu les lois des ministres Rebsamen, El Khomri puis Pénicaud. Nous avons beaucoup modifié le code du travail. Avant de proposer une nouvelle réforme, je crois qu'il faut d'abord appliquer la loi et évaluer les effets des réformes récentes. Je soutiens vos propositions mais il faut ralentir le rythme des réformes et mesurer les effets dans le temps des dernières lois qui ont été promulguées.

Le sujet est complexe et je suis d'accord sur le fait qu'on a du mal à s'y retrouver à force de modifier la loi ; c'est particulièrement le cas pour les acteurs dans les entreprises.
Vous avez donné le taux de participation aux élections professionnelles, il est encore plus faible qu'aux élections politiques. Je considère que les syndicats sont trop politisés et trop éloignés du terrain. J'ai en tête l'exemple d'une PME où les salariés ont reçu de syndicats des tracts dont les revendications ne correspondaient pas à la situation de l'entreprise.
Il faut s'appuyer sur les représentants du personnel qui connaissent bien l'entreprise. Contrairement à d'autres pays, nous vivons le dialogue social comme un affrontement et il se concentre souvent sur des sujets qui sont décorrélés des réalités du terrain. Nous avons besoin de représentants du personnel mais il faut détacher le dialogue social d'une approche politicienne.
Je rejoins le rapporteur sur ses propositions. Il faut renforcer la pédagogie et les branches doivent davantage affirmer leur rôle.

Je remercie le rapporteur et je rejoins mes collègues sur le fait que, par des lois successives, nous avons essayé de stimuler le dialogue social avec un succès relatif. Or, il s'agit moins d'une question juridique que de pratique. Je connais bien le modèle rhénan et ce qui se passe notamment dans l'entreprise Bayer, où le dialogue social est beaucoup plus naturel au sein de l'entreprise.
S'il y a du dogmatisme chez les représentants du personnel, on constate aussi chez les représentants du patronat un intérêt relatif pour le dialogue social. Il y a, chez les employeurs, un investissement inégal et beaucoup de dirigeants de TPE-PME s'engagent assez peu.
Je rejoins les remarques d'Alain Milon. Il faut faire une pause dans les réformes et renforcer l'acculturation au dialogue social dans le cadre existant.

Je remercie le rapporteur pour sa présentation. Ses conclusions sont conformes à ce que nous avons entendu lors des auditions.
Je ne sais pas si les syndicats font trop de politique ! Oui, le taux de syndicalisation est très faible mais on en est au même niveau pour les partis politiques. Je vous renvoie au taux de participation aux élections régionales et départementales de ce week-end. La légitimité des syndicats, souvent remise en cause, est la même que celle des élus politiques.
Si les syndicats font de la politique, ils défendent avant tout les salariés. Je prends le cas de l'entreprise Bridgestone : les syndicats ont fait de la politique en dénonçant un patronat qui se moquait des salariés et n'investissait pas dans l'entreprise. Si c'est cela faire de la politique, alors ils l'ont fait pour les salariés, pour dénoncer les fonds de pensions et les attitudes du patronat.
Pour nous, le dialogue social dans l'entreprise ne doit pas seulement accompagner l'employeur : il doit permettre aux salariés de porter leurs revendications dans des instances représentatives. J'insiste sur la représentativité. Les élus du personnel sont les représentants légitimes des salariés. Il faut plus de justice sociale de proximité, fondé sur des garanties collectives solides.
Je pense qu'en inversant la hiérarchie des normes, en réduisant les droits des organisations syndicales, en supprimant les CHSCT, en réduisant les heures de délégation, les réformes successives ont affaibli le dialogue social.

Comme j'aime à le dire, le futur ministre du travail devra aussi être le ministre du temps libre, car après celles de 2015, 2016, et 2017, et sans parler des contraintes qu'a fait peser la crise sanitaire sur l'organisation des entreprises, nous avons vraiment besoin d'une pause dans les réformes du droit du travail. C'est une des préconisations du rapport.
Les syndicats ne suscitent guère l'enthousiasme. Quand on les interroge, les étudiants avouent ne pas connaître les syndicats. Ceux-ci font néanmoins ce qu'ils peuvent pour trouver une audience et remplir leurs missions. Certains ont développé des services pour les employés, ce qui leur permet de conserver quelques adhérents. Nous restons hélas les derniers de la classe en termes de syndicalisation, avec un taux de 8,8 %, contre 66,5 % au Danemark ! Nous avons pourtant une culture de la négociation collective.
Un certain nombre d'anciens représentants syndicaux, comme M. Jean-Claude Mailly, nous ont dit regretter le Commissariat au plan, qui valorisait l'apport syndical et permettait de déterminer les grands axes de l'organisation du travail et les conditions de la compétitivité de nos entreprises à un horizon de vingt ou trente ans. Il manque aujourd'hui une telle instance de réflexion.
Les représentants du personnel parviennent malgré tout à mener des négociations donnant lieu à des accords ayant valeur normative. Penchons-nous dès lors sur les moyens de dynamiser les rencontres et les occasions de négocier, pour améliorer la compétitivité de nos entreprises.

Merci beaucoup. Je vous propose à présent d'autoriser la publication du rapport d'information.
Il en est ainsi décidé.
La réunion est close à 12 h 20.