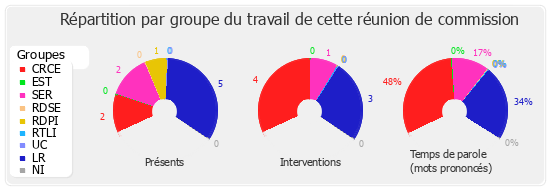Commission des affaires économiques
Réunion du 7 mai 2014 : 1ère réunion
Sommaire
La réunion
La réunion est ouverte à 10h10.

C'est un honneur que de recevoir M. Pascal Lamy, dont je rappellerai simplement qu'il a été directeur général de l'Organisation mondiale du commerce entre 2005 et 2013 et qu'il est aujourd'hui, notamment, président d'honneur du think tank « Notre-Europe - Institut Jacques Delors ».
Vos fonctions, votre position, vos compétences largement reconnues font de vous un observateur privilégié de la situation économique et sociale de la France et de l'Europe, car la connaissance fine de ce qui se fait ailleurs dans le monde permet de voir autrement ce qui se fait ici. C'est ce regard à la fois proche et distancié qui nous intéresse tout particulièrement.
Vous venez de publier un ouvrage dont le titre exprime ce qui est pour vous l'ambivalence de la situation de notre pays : Quand la France s'éveillera. Ce titre sonne comme un constat sévère, puisque si l'on doit s'éveiller, c'est que l'on est endormi, assoupi, ou à tout le moins insuffisamment mobilisé, mais il exprime aussi un certain optimisme quant à l'avenir de notre économie et à la force de ses atouts.
Vous dénoncez dans cet ouvrage la tendance de certains, en Europe et en France, à céder à ce que vous appelez la delectatio morosa. J'ignore si sévit en Europe une morosité un peu morbide, mais certains indicateurs objectifs montrent que tout ne va pas pour le mieux : croissance en berne, chômage élevé, accroissement de la pauvreté, inversion de la tendance historique à la réduction des inégalités de revenus et de patrimoine au sein de nos sociétés, montée du vote d'extrême droite dans nombre de pays européens, à commencer par le nôtre...
Quel diagnostic portez-vous sur la situation économique de la France et de l'Europe ? Y a-t-il selon vous des facteurs de blocage de la croissance européenne et française ? Quel regard portez-vous sur les politiques économiques menées en France et en Europe ? Agit-on sur les bons leviers structurels ou conjoncturels ? Se mobilise-t-on sur les bons enjeux et les bonnes priorités ?
J'ai lu, dans une interview, votre analyse sur les barrières non tarifaires. Elles touchent au domaine des valeurs et de la précaution, aux préférences collectives en matière de perception et de gestion des risques. Je souhaite vous interroger sur la levée de ces barrières qui est l'objectif de la négociation en cours sur le traité transatlantique entre l'Europe et les États-Unis. Ne peut-on craindre de se voir imposer par les États-Unis des normes de précaution ne répondant pas à nos pratiques en matière de santé ou d'environnement ?
Je vous remercie de votre invitation. C'est la première fois depuis quarante ans que je viens devant vous libre de toute contrainte institutionnelle. Ma parole sera de ma responsabilité, sans engager en rien les institutions au service desquelles j'ai travaillé. C'est une situation assez inédite qui ne m'est pas désagréable... N'étant pas porteur d'un discours institutionnel, mon propos liminaire sera bref, et je m'efforcerai plutôt de répondre aux questions que vous venez de me poser.
Il n'est pas anormal, à la veille des élections européennes, de s'intéresser à l'Europe. Au demeurant, j'observe que le Sénat a toujours manifesté un intérêt particulier pour le sujet, qu'il a su témoigner d'une approche et d'un savoir-faire rares dans nos institutions et que j'ai toujours éprouvés comme un soutien à l'intégration européenne, même si certaines nuances politiques y transparaissent.
Comment se profile, à longue vue, l'économie mondiale ? Dans les dix années à venir, on peut s'attendre à une croissance moyenne de 6 % pour les pays émergents, de 3 % pour les États-Unis, de seulement 1,5 % pour l'Europe. Telles sont les perspectives. Cette hiérarchie est le produit des forces qui déterminent la croissance économique, dans le monde globalisé qui est le nôtre.
Comment s'explique ce chiffre de 1,5 % pour l'Europe ? C'est la somme de la productivité globale des facteurs de production, estimée à 2 % au cours des dix années à venir, et du taux d'accroissement de la population active en Europe, qui sera de - 0,5 %. Je précise que ce chiffre de 2 % de productivité constitue le haut de la fourchette d'estimation. Les perspectives sont donc assez sombres pour notre modèle de civilisation européenne, qui repose sur une économie sociale de marché très redistributive - en matière d'éducation, de santé, de retraites, de logement.... Mme Angela Merkel ne manque pas de le souligner sur toutes les tribunes : l'Europe, c'est 7 % de la population mondiale, 20 % de la production mondiale et 50 % des dépenses mondiales de protection sociale. On peut trouver que c'est trop. On peut aussi estimer, c'est mon cas, que c'est ce qui fait notre identité européenne, étant entendu cependant que ce modèle n'est soutenable que s'il est nourri par la croissance. Si la croissance est insuffisante, au-dessous de 2 %, il se grippe et le débat politique sur les conditions du partage devient alors très vif. C'est un trait qui nous distingue des États-Unis.
La faiblesse de la croissance européenne ne doit pas être ordonnée à de seules considérations économiques et conjoncturelles, car le problème est aussi de nature identitaire : si l'Union européenne ne trouve pas le chemin d'une croissance à 2 %, alors nos peuples seront insatisfaits dans leur identité, avec les conséquences que cela produit.
La principale faiblesse de l'Union européenne dans le monde tient à ceci qu'elle est le seul continent qui vieillisse à ce point. Nous serons d'ailleurs suivis par la Chine, qui paiera sa politique incroyablement intrusive de l'enfant unique, dans les décennies à venir.
Dans la répartition de la ressource énergétique, ensuite, l'Europe est mal dotée. Cette faiblesse structurelle fait de nous un gros importateur d'énergie. Cela nous place dans une situation de dépendance stratégique et pèse sur notre compétitivité. On sait que les producteurs d'énergie ont tendance à consommer chez eux l'énergie la moins chère et à exporter le reste. Et cela est encore plus vrai depuis la révolution du gaz de schiste aux États-Unis, lesquels resteront, dans les décennies à venir, notre principal concurrent.
Notre troisième faiblesse qui, sans être structurelle, n'en est pas moins bien ancrée, tient au rétrécissement de la part qu'occupe l'Europe sur la frontière technologique. Elle en occupait 30 % il y a trente ans, contre 40 à 50 % pour les Américains. Elle ne compte plus aujourd'hui que pour 15 à 20 %, contre 60 % pour les États-Unis, tandis que les pays émergents montent en puissance à mesure qu'ils forment des ingénieurs et que s'élabore leur droit de la propriété intellectuelle. Cette tendance au recul de l'Europe n'est pas inéluctable, mais elle est lourde. Les produits de demain seront de plus en plus immatériels, et, pour le dire vulgairement, le contenu en jus de cervelle comptera bien davantage que l'huile de coude. C'est là un enjeu crucial pour nos systèmes de formation.
Dernier facteur handicapant, enfin, la faiblesse relative de notre productivité dans le secteur des services, qui donne un important avantage comparatif aux Américains en matière de prix, grâce à un véritable marché intérieur des services. Ce marché, en Europe, est unifié à hauteur de 30 % du secteur, quand il l'est à 80 % pour l'industrie. Or, l'économie moderne intègre de plus en plus industrie et services. Des objets comme les téléphones mobiles ou les tablettes sont bien des produits industriels, mais ce versant matériel ne compte que pour 5 % dans la valeur ajoutée. Tout le reste, c'est du « jus de cervelle » : design, applications, brevets, distribution...
Quelles sont, en regard de ces faiblesses, nos forces ? C'est essentiellement notre masse critique, la largeur et la profondeur de notre marché. C'est là une force tant en termes de concurrence internationale que de gains potentiels en productivité. L'Europe sait l'utiliser pour faire face à la concurrence internationale - ses parts de marché n'ont pas bougé ces dix dernières années, quand celles des États-Unis et du Japon se sont effritées - mais elle peine, en revanche, et c'est là tout l'enjeu du marché intérieur des services, à gagner en productivité.
Voilà qui nous donne une feuille de route. Combler notre faiblesse démographique ne sera pas facile. La solution est toujours passée, dans l'Histoire, par l'immigration, qui se heurte cependant à des réticences, culturelles et politiques. Toute évidente qu'elle soit au plan théorique, il faut l'évaluer à l'aune de sa faisabilité politique. Reste qu'il faudra, en tout état de cause, que l'Europe importe de la force de travail pour préserver son modèle d'économie sociale de marché.
En matière d'énergie, nous savons, au plan théorique, comment remédier à nos faiblesses : par la transition énergétique et les politiques d'efficacité énergétique. L'Europe a longtemps été pionnière sur la scène internationale en matière environnementale, mais il nous reste énormément à faire tant la politique énergétique commune demeure dans les limbes et tant est large le spectre des différences entre nos modèles nationaux, en termes de recours à des énergies de substitution aux énergies fossiles, de prix ou de gestion de l'efficacité énergétique.
Pour la frontière technologique, la solution passe par l'investissement. Sachant que seule une partie sera porteuse d'innovation, les tickets seront de plus en plus importants. Au niveau de la production finale, il n'existe plus que des éléphants qui ont bâti leur succès sur une vision, certes, mais en appuyant sa mise en production sur des capitaux considérables. Nous ne pourrons bénéficier d'effets d'échelle qu'à condition de concentrer nos efforts sur l'excellence, ce qui suppose une volonté politique car c'est plutôt le saupoudrage, en matière de recherche, qui prévaut aujourd'hui.
Le marché intérieur des services pourrait être source de productivité, donc d'emplois. À cet égard, je rappelle une chose que l'on oublie trop souvent : les économies les plus productives et les plus compétitives sont aussi celles qui ont les taux de chômage les plus bas.
Dans cette équation européenne, comment se situe notre pays ? Les problèmes que la France doit affronter pour maîtriser la dépense publique, lutter contre le chômage de masse et la perte de compétitivité se jouent largement, à mon sens, au niveau national. La preuve en est que, dans un même cadre européen, les performances nationales sont loin d'être comparables. L'Europe, il est vrai, peut néanmoins jouer un rôle de catalyseur et constitue le niveau pertinent pour réaliser des économies d'échelle en matière d'investissement dans les infrastructures, la recherche et développement, ou des programmes de mobilité à des fins d'apprentissage sur le modèle d'Erasmus, qui participent à la lutte contre le chômage des jeunes.
Nous devons en passer par une phase de désendettement - que je n'appelle pas austérité - mais aussi remédier au manque d'investissement commun dans les programmes d'avenir. C'est là un enjeu majeur pour la prochaine législature européenne, et la composition de la prochaine Commission européenne sera, de ce point de vue, déterminante.
Concernant le deuxième point soulevé par le président dans son introduction, je rappellerai d'abord que la négociation du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement - le TTIP - s'inscrit dans un basculement historique du commerce international et de sa régulation, laquelle vise à réduire ou éliminer les obstacles illégitimes aux échanges. Reste à trouver une définition consensuelle de ce qui est « illégitime ». Je vous renvoie à mon petit livre paru en anglais aux presses universitaires de Cambridge, qui fait le tour de la question.
Depuis deux millénaires, on s'emploie à réduire surtout les obstacles tarifaires aux échanges. C'était déjà le but du premier traité de commerce, entre le roi de Crète et le pharaon d'Égypte, qui visait à lever des barrières érigées pour protéger les producteurs nationaux de la concurrence étrangère. Ce monde des barrières douanières est derrière nous, même si, comme les étoiles mortes, on en perçoit encore çà et là la lumière. Nous sommes entrés dans une phase de la mondialisation qui conduit à la multilocalisation des forces de production, au point que l'on ne peut plus parler de « made in... ». Le commerce international repose à 60 % sur les composants et les pièces détachées et la part des importations dans un produit, qui était de 20 % il y a vingt ans, est de 40 % aujourd'hui et sera de 60 % dans vingt ans. Cette interpénétration détruit la notion de frontière. Grâce à des disciplines comme celle de l'OMC, le commerce international a remarquablement résisté à la crise économique et l'on a évité le choc en retour de pulsions protectionnistes, mais là n'est pas l'essentiel : alors que 60 % de la production dépend des importations, ériger des barrières douanières n'a plus de sens.
Le commerce n'est pas libre pour autant. Il existe des barrières réglementaires nationales ou régionales, qui, destinées à protéger le consommateur de risques divers, établissent et administrent un niveau de précaution - crash tests pour les véhicules, sécurité des aliments, des jouets, des briquets, protection des données privées, régimes prudentiels pour les banques et les assurances, et j'en passe. Que ces mesures tendent à se multiplier dans le monde témoigne des progrès du développement, les populations qui en bénéficient étant poussées à se tourner vers la question des valeurs. Mais cela aboutit, du même coup, à voir se juxtaposer des échelles de valeurs très différentes. Si bien que la gageure n'est plus tant de réduire ou d'éliminer les obstacles au commerce international - aucune population n'acceptera de renoncer à ses standards pour le favoriser et aucun Parlement ne le ratifierait, fût-ce seulement pour renoncer à un taux résiduel maximum de pesticides dans les fleurs coupées - que d'éliminer ce qui fait problème, c'est-à-dire la multiplicité des systèmes de normes. Cette recherche de la convergence réglementaire est un exercice beaucoup plus compliqué, mais qui n'est pas étranger aux Européens : c'est ce qui a fait la différence entre le marché commun d'avant 1992 et le marché intérieur d'après.
Ce processus est en partie encadré par les règles de l'OMC, notamment dans l'accord sur les barrières techniques au commerce et celui sur les barrières sanitaires et phytosanitaires, mais seulement dans les principes. Les organes de régulation, nationaux comme internationaux, responsables des standards ne sont pas des organes commerciaux, mais scientifiques ou techniques. L'idée qu'ils puissent négocier entre eux des standards communs est assez complexe à mettre en oeuvre. L'objet du TTIP - sachant que sur un volume d'échanges entre l'Europe et les États-Unis de quelques 1 000 milliards par an, les droits de douane moyens ne dépassent pas 2 à 2,5 % - est d'arriver à une convergence réglementaire de 80 %, en retenant des standards communs pour la sécurité des voitures, le nettoyage des poulets, la protection des données privées, etc. Autant de sujets, dont certains peuvent être très sensibles, puisque la perception du risque est étroitement corrélée aux échelles de valeur et aux préférences collectives des pays participant à l'échange.
Mon sentiment est que la négociation sur ce traité a été présentée comme une négociation classique. Or, elle est d'une toute autre nature, et cela mériterait d'être souligné, ne fût-ce que pour répondre à des questions légitimes, qui émanent des deux bords de l'Atlantique : la convergence se fera-t-elle au détriment de la protection ? On a souvent le sentiment que les Européens sont très précautionneux, quand les Américains sont plus habitués au risque. Mais il est beaucoup de secteurs techniques où ils sont en réalité plus précautionneux que l'Europe. Il n'y a pas, par exemple, de voitures diesel aux États-Unis et si les camions diesel demeurent autorisés, c'est uniquement parce que le syndicat des camionneurs a été assez fort pour l'obtenir. N'oublions pas que ce sont les Américains qui ont inventé le principe de précaution dans les années 1970, avec le Clean Air Act, quand les Européens en restaient au principe du pollueur-payeur.
La négociation sera longue, complexe, et doit, compte tenu de la sensibilité du sujet, donner lieu à un large débat, mais ce qui, à mon sens, sera retenu, in fine, c'est le niveau de précaution le plus élevé d'un côté ou de l'autre. Les normes s'aligneront sur les normes les plus élevées. Si l'on ne peut se contenter d'en faire une position de principe sans entrer dans le détail technique, c'est néanmoins dans cette optique qu'il faut se placer.

Vous avez souligné l'importance du facteur productivité, ainsi que de l'investissement en faveur de l'innovation, très inférieur en France à ce qu'il est dans le reste de l'Europe et a fortiori aux États-Unis. Mais vous n'avez pas abordé la question monétaire. Louis Gallois, que nous avons eu l'occasion d'entendre lorsqu'il avait la responsabilité d'EADS, nous a souvent dit combien la différence de parité entre le dollar et l'euro était problématique. La Banque centrale européenne (BCE) ne devrait-elle pas être plus audacieuse en matière de politique monétaire ? Une note récente de Bercy souligne qu'une dévaluation de 10 % de l'euro nous ferait gagner 0,6 point de PIB et 30 000 emplois à un an, 1,2 point de PIB et 150 000 emplois à trois ans. J'aimerais connaître votre point de vue.
Vous avez été directeur général de l'OMC et puisque vous évoquez ici la question de la convergence réglementaire, je dois vous dire que j'ai toujours été étonné, comme l'est la Fédération européenne des syndicats, que l'OMC accepte parmi ses membres, avec tous les avantages que cela confère, des pays qui ne respectent pas les critères de l'OIT, l'Organisation internationale du travail (Marie-Noëlle Lienemann approuve). Avec les conséquences que l'on sait et dont il fut longuement question au cours de notre séance publique d'hier - dumping social et concurrence déloyale.
J'en viens, enfin, à vos déclarations récentes sur les petits boulots payés en dessous du Smic comme solution au chômage des jeunes. Faut-il vous rappeler qu'entre 2008 et 2011, en pleine période de crise, le pouvoir d'achat des 10 % les plus pauvres des Français a reculé de 3,4 % pendant que celui des plus fortunés progressait de 3,5 % ? Que les 10 % des Français les plus riches accaparent 50 % du patrimoine national, tandis que les 50 % de Français les moins fortunés s'en partagent 7 % seulement ?
Vous comprendrez que la question est bien plutôt, pour moi, de la redistribution de la richesse globale et d'un partage équitable de l'effort, quand vous préférez faire porter l'effort par les jeunes, qui vivront, et c'est inédit, moins bien que la génération qui les a précédés. Et je ne suis pas seul à m'offusquer de l'inconvenance d'une telle déclaration, puisque Laurence Parisot, que l'on ne peut pas soupçonner de gauchisme, a réagi à celle de Pierre Gattaz sur le Smic en disant que cela revenait à prôner l'esclavage...

La définition que vous avez donnée de la croissance est celle de la croissance potentielle, qui prend en compte la productivité globale des facteurs et la démographie active. Or, la croissance potentielle, en France, ne correspond pas au chiffre que vous avez donné ; elle se situe à moins de 1 %, les économistes s'y accordent. Pouvez-vous éclaircir vos vues, car c'est un élément important pour nos débats sur la trajectoire budgétaire ?
Étant de ces hauts fonctionnaires qui ont sillonné le monde, vous avez certainement lu le dernier livre d'Hubert Védrine, qui craint que l'Europe ne devienne « l'idiot du village global ». Par où l'on rejoint ce que disait Yannick Vaugrenard sur la monnaie. Nous connaissons la théorie ricardienne, mais nous savons aussi qu'entre la théorie et la pratique, il y a parfois des béances, des souffrances. Mettre en concurrence directe des pays où l'on fait travailler les enfants dans des conditions proches de l'esclavage et des pays qui jouissent d'un haut niveau de protection sociale et environnementale, c'est prendre le risque d'énormes déflagrations. Je sais bien que la multiplication des échanges internationaux crée de l'interdépendance - et c'est à mon sens une bonne chose - mais il faut réintroduire un peu de concret, de réel : on ne vit pas dans un village virtuel. Il est bon que l'on fasse des efforts, en France, pour réduire le coût du travail. Mais si le renminbi et le dollar restent sous-évalués, à quoi serviront nos efforts ? Voyez ce qu'il s'est passé pour le photovoltaïque : l'Europe a commencé par montrer ses muscles avant de capituler en rase campagne devant la Chine. De même pour le Farm Bill américain, qui fait passer le soutien aux agriculteurs par des régimes assurantiels, lesquels nous font bien défaut face aux aléas climatiques, qui menacent autant la Vendée que la Floride, comme on l'a vu avec Xynthia.
Il faut travailler sur la réduction des écarts, la convergence réglementaire, certes, mais sans oublier le réel, au risque de voir s'accomplir la prédiction d'Hubert Védrine.

Quel est pour vous le bilan du grand mouvement de libéralisation qui a conduit à ce que l'on appelle la mondialisation ? Portez-vous sur lui un regard positif ou critique ? Certes, les échanges ont favorisé le développement et l'émergence de classes moyennes dans certains pays, mais j'observe, dans le même temps, que depuis la libéralisation des mouvements de capitaux, les paradis fiscaux n'ont fait que prospérer ; que les États, qui certes pouvaient avoir des prurits nationalistes mais qui incarnaient la souveraineté populaire, à laquelle nous croyons, qu'elle soit française, européenne ou mondiale, n'ont plus voix au chapitre puisque les normes internes dont décident les multinationales comptent parfois davantage que celles qu'édicte la puissance publique.
Vous aurez compris que pour moi, le bilan n'est pas positif. Les inégalités se sont accrues au sein des pays développés et de larges zones comme l'Europe. Certes, on commence à voir apparaître, en Chine et ailleurs en Asie, des mouvements de grève, mais avant qu'ils ne débouchent sur un minimum de règles sociales, nous pourrions bien avoir perdu toutes les nôtres. Alors que les tendances nationalistes se développent, en Inde, en Chine, en Europe, le concept de juste échange doit être porté dans le débat multilatéral et trouver rapidement à se concrétiser. N'oublions pas que les chocs de l'Histoire viennent souvent d'une incapacité à régler des problèmes économiques.
Je suis une européenne convaincue et je suis de près, depuis les années 1980, la situation en Europe. Or, plus le temps passe, plus je suis déçue. À chaque fois on nous promet que la libéralisation des échanges va nous apporter des millions d'emplois, et quand les choses vont mal, on nous dit qu'il faut libéraliser encore, que l'on n'est pas allés jusqu'au bout... Il ne faut pas s'étonner, à ce compte, que les peuples ne soient pas motivés par les élections européennes et ne croient plus aux discours qu'on cherche à leur vendre sur l'Europe....
Vous dites que la question est aussi nationale, puisque certains pays s'en tirent bien, d'autres mal. Mais c'est que le cadre qui a été fixé est favorable à certains, défavorable aux autres. La France aurait dû réagir de façon bien plus véhémente, car c'est une autre culture que la sienne qui s'est imposée en Europe. Le génie français s'est historiquement construit sur la détention publique du capital, le lien entre innovation individuelle, PME, capitalisme industriel familial et capitalisme public. Ce modèle, Colbert l'a porté, de Gaulle l'a porté, Mitterrand l'a porté... Aujourd'hui encore, 80 % des Français croient en ses vertus : ils veulent une renationalisation d'Alstom. Or, en Europe, le génie français est disqualifié, parce que l'idéologie libérale y domine, avec sa cohorte de privatisations et de suppressions d'aides publiques. Je ne dis pas qu'il fallait en rester au niveau de nationalisation qui était le nôtre, mais on ne nous a pas même laissé l'espace d'une mutation et des pans entiers de notre industrie ont disparu. Les Allemands réussissent, ils sont géniaux ? Mais c'est que le système est fait pour eux. L'euro fort les favorise. Nous ne sommes pas les seuls dindons de la farce, voyez les pays du sud de l'Europe. Vérité dans les brumes du nord, erreur sous le soleil du sud : est-ce là ce qu'on doit en conclure ?
Vous dites que la solution à une démographie déclinante passe par « l'importation d'une force de travail ». Je suis pour l'immigration, sans laquelle un pays ne respire plus, mais ne croyez-vous pas qu'il faudrait, pour commencer, que l'Europe se donne pour objectif premier le plein emploi, et s'en donne les moyens ?
Dans le modèle libéral que vous prônez, chacun doit se spécialiser dans ce qu'il est le mieux capable de faire. À ce compte, certains pays, comme le Niger, vont mettre du temps à émerger...Je ne crois pas à la spécialisation internationale, et fais bien davantage confiance à l'écosystème humain, qui est le terreau de l'innovation. Les industriels français du textile ne disaient pas autre chose quand ils expliquaient que les délocalisations feraient perdre une part de l'innovation. Car on ne sait jamais d'avance où surgira l'innovation, si ce sera dans la fibre, dans la manière de tisser, dans celle de traiter le tissu, ni comment la modernité viendra se greffer sur la diversité des anciennes pratiques. Perdre la diversité de ces pratiques, c'est perdre en capacité d'innovation. Et si l'on part, à l'inverse, de la recherche fondamentale, dans laquelle la France est performante, force est de constater que l'on n'arrive pas à faire entrer nos résultats dans le cycle économique de l'innovation.
Pour moi, le modèle de société que vous prônez, et qui tend à spécialiser les gens là où ils sont bons - mais surtout là où ils sont moins cher - est tout simplement suicidaire, car il détruit l'écosystème humain.
Les Français, chaque fois qu'on leur donne la parole, votent contre les traités de libre échange ; 88 % d'entre eux, et y compris Jean Arthuis, qui est pourtant un libéral, sont contre le TTIP. L'Europe parle d'une voix quand il s'agit de vanter le libéralisme, mais bien des discordances apparaissent quand il s'agit de défendre les Européens les plus faibles. Et de quelle Europe parle-t-on ? Les études de la Commission européenne montrent que ce traité favorisera certains secteurs et en défavorisera d'autres. Vous ne devinez pas lesquels ? Les machines-outils allemandes en profiteront, l'agroalimentaire et l'agriculture française en pâtiront. Je veux bien que ce soit l'intérêt général de l'Europe, mais je m'étonne d'une conception de l'intérêt général qui sacrifie une partie de l'Europe au profit d'une autre.

Pouvez-vous confirmer que nous sommes entrés dans une phase de désindustrialisation de la France ? Ce que disait Marie-Noelle Lienemann est juste : d'où viennent les machines-outils de nos ateliers industriels ? Rarement de France. Ne serions-nous pas en train de reproduire l'erreur qui fut naguère celle des Britanniques, laissant dépérir leur industrie et misant sur le développement des services, sans parvenir à compenser les destructions d'emplois ? La désindustrialisation est-elle, pour vous, une fatalité ?
Je me souviens, du temps que j'étais député, avoir participé à plusieurs sommets de l'OMC où vous étiez vous-même commissaire européen, à Seattle, à Doha. Les pays industrialisés discutaient avec les pays émergents, et l'on parvenait, au terme de discussions qui traînaient d'année en année et laissaient aux pays émergents le temps de s'organiser, à des résultats qui avaient toujours un train de retard.
Vous dites que votre parole est libre et évoquez, avec raison, la question de l'énergie. La France est-elle en train de commettre une erreur ? Le dossier du gaz de schiste, qu'avait ouvert Louis Gallois, s'est refermé. Et quel avenir réserve-t-on au nucléaire, secteur où nous sommes compétents ? Où est la politique de l'énergie en Europe ? J'aimerais, sur ces questions, voir développer votre point de vue.
La TVA sociale, votée par la précédente majorité, sous l'impulsion du président de la République, constitue-t-elle, à votre sens, un moyen de faire face à la concurrence des pays émergents ?

Vous avez parlé de convergence réglementaire, et Yannick Vaugrenard a relevé que pour rendre le commerce international plus juste, une convergence en matière de droit du travail était tout aussi souhaitable. J'y ajoute la convergence en matière environnementale, car les atteintes portées à l'environnement provoquent aussi des distorsions de concurrence. Vous avez souligné combien le coût de l'énergie pesait sur la compétitivité. Or, les modes d'extraction non conventionnels de carburant et la multiplication des déchets peuvent provoquer des dégâts considérables sur l'environnement. On ne peut donner une prime à ceux qui ne le prennent pas en compte, d'autant que les atteintes à l'environnement ne s'arrêtent pas aux frontières.

Dans le cadre du partenariat transatlantique, il est question de plier les législations en vigueur aux normes du libre-échange. On parle d'autoriser les entreprises qui verraient leur fonctionnement entravé ou leurs gains limités par une réglementation nationale à réclamer une compensation au gouvernement en cause ! Ne voyez-vous pas là une atteinte portée à la libre gouvernance de chaque pays ?
Je n'ai pas, sur la monnaie, les mêmes positions que Louis Gallois. Le problème des taux de change exige d'être analysé avec les bons chiffres : non pas les taux nominaux constatés sur les marchés, mais le taux de change effectif réel, c'est à dire corrigé des effets de prix et pondéré en fonction de la nature des flux commerciaux auxquels il s'applique. Or ce taux est stable, entre l'euro et le dollar, sur vingt ou trente ans. J'ajoute que ce n'est pas la BCE qui a la responsabilité politique des changes - même si la politique monétaire a, via les taux d'intérêt, des effets induits sur le change - mais le Conseil Ecofin.
Je ne suis pas de ceux qui, selon un tropisme bien hexagonal, brandissent la dévaluation comme une solution miracle. La dépréciation d'une monnaie n'est pas sans effets néfastes. Certes, elle dope la compétitivité de ceux qui exportent, mais quid de ceux qui importent ? Une dévaluation a sans conteste un impact économique et social négatif, car elle remet en cause la compétitivité d'un certain nombre d'acteurs de l'économie, en particulier quand le pays doit importer beaucoup d'énergie. Quant au reste, je rappelle que dans les échanges avec les États-Unis, le surplus industriel de l'Europe est de 300 milliards ; c'est sur la zone euro que la France perd des parts de marché.
Sur la question des normes sociales internationales, vous avez raison. Lorsque j'étais commissaire européen, mon mandat était d'établir un pont entre OIT et OMC. Et lorsque je suis devenu directeur général de l'OMC, j'ai fait ce que j'ai pu...Le système international est ainsi fait que les État décident, à l'OMC, des critères de régulation du commerce international, à l'OIT, des standards sociaux internationaux, à l'UIT (Union internationale des télécommunications), de la répartition des fréquences, au Codex alimentarius, filiale de l'organisation mondiale de la santé et de la FAO, des standards en matière de sécurité alimentaire. Il en est ainsi depuis 1948. Les porteurs de la cohérence entre ces séries de règles, ce sont deux cents États souverains. Quand ils souscrivent à des disciplines en matière de standards sociaux, ils sont censés les respecter. L'OIT a son mécanisme de règlement des différends, mais qui reste lettre morte faute de volonté politique des États membres. J'ai tenté de bâtir des ponts, mais dans les limites de ce qu'un pays comme l'Inde d'un côté, les États-Unis de l'autre considéraient admissible.
Vous me reprochez mes propos sur les jeunes. Je suis un homme libre, et je dis ce que je pense. Il s'agit de leur trouver du boulot. Si le chômage des jeunes était à 5 ou 10 %, comme en Suisse ou en Allemagne, je n'aurais pas dit ce que j'ai dit. Mais quand on est dans la zone rouge, il faut mettre en cause quelques lignes jaunes. Je m'indigne de voir que mon pays tolère un chômage des jeunes qui atteint 25 %.
J'ai participé au gouvernement à l'époque où Jacques Delors était Premier ministre ; le problème de la France était alors l'inflation. J'étais et je reste socialiste, mais alors que l'inflation atteignait 15%, l'indexation des salaires, conquête sociale qui préservait le pouvoir d'achat des salariés, ne pouvait pas tenir. C'est un gouvernement de gauche qui l'a remise en cause. Pour protéger les salariés eux-mêmes ! Il est des moments où il faut envisager les choses sous un autre angle si l'on ne veut pas rester encalminé. Chez moi, en Normandie, je vois des jeunes de 15 ans dont les parents n'ont jamais eu de boulot...C'est intolérable. Regardons un peu ce qui se fait chez nos voisins.
Avec des problèmes similaires aux nôtres, ils ont trouvé des solutions. Pourquoi donc n'y vient-on pas ?
Sur le taux de croissance potentiel, Bruno Retailleau, vous avez raison : nous sommes, en France, un peu en dessous de celui de l'Europe. La cause n'en est pas démographique, elle est affaire de productivité, et de compétitivité, coûts et hors coûts. C'est une bonne nouvelle, car c'est un facteur sur lequel il est plus facile d'agir. Louis Gallois, sur ce sujet, a dit ce qu'il fallait, comme l'a écrit le Commissariat général à la stratégie et à la prospective.
Je ne partage pas le point de vue d'Hubert Vedrine quant au risque que courrait l'Europe de devenir « l'idiot du village global ». C'est un eurosceptique de talent, je suis un postnational poussif...Notre itinéraire n'est pas le même, même si nous sommes partis et arrivés à peu près au même point. Il relaie une légende bien française qu'aucun chiffre ne vient étayer. Comment prétendre que l'Europe est l'idiot du village global quand son excédent industriel sur les États-Unis est de 300 milliards ? La politique commerciale de l'Europe ne souffre d'aucune faiblesse structurelle, et l'Europe ne se protège ni mieux ni moins bien que d'autres. Tenir un tel discours ne me semble pas le meilleur moyen de mobiliser les troupes.
Le renminbi chinois n'est plus sous-évalué. C'est ce que nous apprend le FMI, grand arbitre des beautés en la matière. En taux de change constant effectif réel, il s'est réévalué de 25 % ces dix dernières années, même s'il a un peu décroché à court terme. Les Chinois savent bien qu'ils n'internationaliseront pas leur monnaie si elle reste faible. Il est vrai que le compte de capital de la Chine n'est pas libéralisé : aussi étrange que cela puisse paraître, ce n'est pas une exigence pour appartenir au FMI - les règles internationales sont ce qu'elles sont aussi longtemps qu'on ne les change pas. Quant au salaire chinois, il se réévalue de 15 % par an. Et de temps en temps, on voit se déclencher des grèves. Peu à peu, l'excédent commercial chinois se réduit, à mesure que la consommation intérieure prend le relai.
La compatibilité des mesures de subvention américaines contenues dans le Farm Bill avec les règles existantes à l'OMC n'a pas été examinée. Un tel examen devrait avoir lieu devant l'OMC. L'Union européenne pourrait en avoir l'initiative, mais on sait qu'elle n'est pas très allante pour se lancer sur ces questions de subvention à l'agriculture, pour des raisons que l'on comprend bien...
Ce que Marie-Noëlle Lienemann appelle libéralisme, je l'appelle ouverture des échanges. Il y a là une nuance sémantique de taille. Ouvrir n'est pas déréguler. L'ouverture des échanges a donné de très bons résultats. Elle a réduit la pauvreté dans le monde. Il est vrai que cela a pu être au prix d'une augmentation des inégalités au sein des pays développés. C'est pourquoi je parle, dans mon livre, d'une mondialisation Janus, faite de forces et de courants contraires, qui exigent de savoir prendre le vent. L'équilibre entre les marchés et les sociétés, comme on l'a déjà vu par le passé, est mis en cause par une nouvelle phase de la globalisation, conduisant à un désencastrement, pour reprendre le terme de Polanyi, entre l'économie et la société au niveau mondial. Je suis de ceux qui pensent qu'il existe des solutions. Ce n'est pas un hasard si les pays dont les systèmes sociaux sont les plus sophistiqués sont aussi les plus performants. Quant au principe du juste échange, il est, j'en suis d'accord, de nature à rétablir un équilibre des échanges, à condition que les partenaires se mettent d'accord sur ce qui est juste...On se mord un peu la queue.
Le raisonnement qui semble prévaloir en France sur l'Europe est typique de notre propension à l'autoflagellation. On cherche toujours des causes externes à nos problèmes. Regardez l'Allemagne, qui était, après la réunification, « l'homme malade » de l'Europe. Les Allemands n'ont pas réclamé que l'on change l'Europe, mais se sont lancés dans une opération de redressement qui les a sortis de la mouise.
Aussi longtemps que l'on restera dans cet état d'esprit intellectuellement commode qui consiste à attribuer à d'autres qu'à nous-mêmes la responsabilité de nos problèmes, on ne sortira pas de la dérive qui détériore, depuis quarante ans, nos finances publiques ; nous entraine, depuis trente ans, dans le chômage de masse ; dégrade, depuis dix ans, notre compétitivité. On ne résoudra le problème qu'en sortant de cette attitude intellectuelle erronée.
Quant au génie français, il n'est en rien disqualifié. Je vais remettre à Jean-Pascal Tricoire, PDG de Schneider Electric, le prix du financier de l'année. Voilà une entreprise mondialisée, qui fait 95 % de son chiffre d'affaires hors de France où elle a su remporter de grands succès et se positionner sur les marchés émergents dans un métier d'avenir.
Je sais bien que cela dérange, chez nous, mais c'est une des raisons principales de son succès. D'accord avec Marie-Noëlle Lienemann sur les vertus de l'écosystème en économie, mais à quel niveau ?
La désindustrialisation est imputable, pour l'essentiel, à l'insuffisance des marges. Les entreprises françaises n'ont pas de quoi investir. Mais il n'y a là rien de fatal. Regardez les Britanniques dont l'industrie était déclinante il y a vingt ans : sa part dans leur PNB est aujourd'hui plus forte que chez nous. Si les marges restent ce qu'elles sont en France, cela peut être fatal à notre industrie, plus exposée que les services à la concurrence internationale.
Sur le gaz de schiste, Jean-Claude Lenoir, j'ai tendance à partager les positions de Louis Gallois, mais on ne nous donne pas les moyens d'en vérifier la justesse... Nous ne pouvons pas nous passer du nucléaire ; cette énergie, qui émet moins de CO2 et nous apporte un avantage comparatif, doit entrer dans notre mix. Il est vrai que l'on manque d'une politique énergétique européenne et que les écarts entre les choix nationaux sont excessifs. Y remédier suppose une volonté politique, y compris de la part de la Commission européenne qui pourrait mettre sur la table des propositions à faire adopter à la majorité qualifiée.
Vous m'interrogez, enfin, sur la TVA sociale. Qu'on l'appelle ou pas sociale, la question est de savoir si une hausse de TVA est la bonne solution et si l'on fait peser sur le consommateur une plus grosse part du coût de la redistribution.
C'est lui qui payera, in fine. Doit-on faire porter davantage le poids du financement de la sécurité sociale sur le consommateur ? J'ai tendance à penser que c'est une mesure souhaitable, car elle est de nature à redresser notre compétitivité.
Tout à fait d'accord, Claude Dilain, sur l'environnement. L'empreinte environnementale de nos systèmes de production n'est pas soutenable à trente ou quarante ans. Le problème se pose de la consommation d'énergie, mais aussi d'eau. Soit la régulation est multilatérale - c'est le sens des négociations, qui piétinent depuis dix ou vingt ans, sur le changement climatique - soit elle passe par des mesures aux frontières, pour équilibrer les différences. Pour l'Europe, cette dernière option n'est pas une solution : l'empreinte carbone des exportations européennes est plus mauvaise que celle de ses importations, parce qu'elle s'est spécialisée dans des secteurs très carbonés - machines-outils, automobile, aciers spéciaux... Préconiser, dans ces conditions, une solution frontalière reviendrait à subventionner les importations de l'Europe... La voie royale reste dans une solution globale. J'espère qu'on finira par la trouver.
Le TTIP vise à négocier, René Nicoux, de la convergence réglementaire. À la demande des Américains, un mécanisme de règlement des différends, dit Investor-State Dispute Settlement, est sur la table de négociation. Il permettrait à une entreprise d'attaquer un État souverain dès lors qu'elle estimerait que le non-respect par celui-ci des conditions de l'accord lui est dommageable. Autant je verrais bien l'intérêt d'élaborer un mécanisme propre de règlement des différends si nous signions un traité de libre-échange avec le Népal, le Sri Lanka ou la Birmanie, autant j'en vois mal l'intérêt dans un traité entre l'Europe et les États-Unis, où les systèmes judiciaires sont de qualité standard et n'ont pas la réputation de trancher en faveur de celui qui allonge la plus grosse enveloppe...

Je vous remercie de cet échange, qui a fait apparaître quelques divergences d'appréciation...

Je reviens sur le chômage des jeunes. Si l'on prend le taux de chômage sur l'ensemble d'une classe d'âge et non celui des seuls jeunes actifs, ceux qui sont sur le marché du travail, comme vous le faites, on constate que nous sommes plutôt dans la moyenne basse de l'Union européenne, parce que nous avons beaucoup de jeunes scolarisés longtemps. Je ne dis pas pour autant que le chômage des jeunes n'est pas un problème, mais...

Chaque année, il me revient de vous présenter le bilan d'application des lois relevant du champ de compétences de la commission des Affaires économiques.
Le rapport établi cette année prend en compte vingt-six lois. L'étude de certains textes trop anciens n'étant plus jugée pertinente, le bilan dressé en 2014 mesure l'application des lois promulguées depuis 2003 et jusqu'au 30 septembre 2013, soit de la loi du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom à la loi du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction - les ordonnances Duflot.
Comme en 2013, afin d'apprécier l'objectif du Premier ministre énoncé dans la circulaire du 29 février 2008 relative à l'application des lois, sont retenues les mesures réglementaires prises dans un délai de six mois suivant la promulgation des textes, soit jusqu'au 31 mars 2014.
Sur les vingt-six lois concernées, neuf sont totalement applicables. Trois des quatre lois promulguées entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2013, qui entrent pour la première fois cette année dans le bilan de la commission, sont d'ores et déjà totalement applicables, cela vaut d'être mentionné : la loi relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, la loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social et la loi habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction.
Ce dernier texte est certes formellement considéré comme étant d'application directe, mais on peut relever que les sept ordonnances prévues ont été adoptées dans les délais et que six d'entre elles ont d'ores et déjà été ratifiées dans le cadre de la loi Alur. Je me félicite que la ministre ait pris la peine, ainsi qu'elle s'y était engagée, de venir par deux fois présenter ces textes devant notre commission. L'idéal serait évidemment que texte des ordonnances pour lesquels le gouvernement demande habilitation nous soit présenté en même temps que la loi d'habilitation elle-même. Mais c'est sans doute un rêve...

Il est également satisfaisant de constater que contrairement à l'année dernière, aucune des lois entrant dans notre bilan n'est totalement inapplicable. En revanche, l'étude des dix-sept lois partiellement applicables aboutit à un bilan mitigé.
Exception faite de deux textes - la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion et la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, qui ont respectivement donné lieu à un décret en Conseil d'État et à deux décrets simples - aucune mesure réglementaire n'a été prise depuis le dernier bilan établi par notre commission, pour les lois qui entraient déjà l'an passé dans le périmètre de notre étude. Ainsi en est-il, par exemple, de la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, applicable à 85 %, de la loi du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés, applicable à 50 %, ou de la loi du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, applicable à 80 %. Nous ne pouvons que très amèrement le regretter.
Regrettons aussi que la loi du 8 décembre 2011 relative aux certificats d'obtention végétale, unique loi d'initiative sénatoriale entrant dans notre examen, soit celle qui affiche le taux d'application le plus faible, soit 12 %. Les décrets encore attendus pour ce texte, issu d'une proposition de loi présentée par Christian Demuynck et plusieurs de ses collègues, avaient été annoncés pour la fin du premier semestre 2013, mais n'ont toujours pas été publiés. Nous devons être conscients que lorsque l'on donne la main, dans une proposition de loi, à l'administration centrale, en renvoyant à des décrets, sans que celle-ci ait participé à la genèse du texte, il y a de fortes chances que les décrets d'application ne voient jamais le jour...
Sur les vingt-six lois dont nous suivons cette année l'application, quatorze ont été votées selon la procédure accélérée, parmi lesquelles quatre qui, promulguées entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2013, entrent pour la première fois dans le cadre de notre étude. Cela mérite d'être souligné. Huit autres d'entre elles, cependant, promulguées entre 2004 et 2011, ne sont, aujourd'hui encore, que partiellement applicables. Ainsi en est-il, par exemple, de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, applicable à 90 %, ou de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, applicable à 85 %.
Le rapport d'application à six mois prévu par l'article 67 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit n'a été remis, depuis notre dernier bilan de 2013, que pour une seule loi. Il s'agit du rapport sur la mise en application de la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, présenté au Parlement le 14 mars 2014, soit près de seize mois, au lieu de six, après la promulgation du texte concerné.
Comme l'année dernière, je tiens enfin à déplorer la défaillance dont fait preuve l'administration en ce qui concerne la remise des rapports au Parlement. Les chiffres sont éloquents : sept seulement des rapports prévus dans les textes entrant cette année dans notre périmètre ont été remis, quand trente-cinq sont encore attendus. Prévoir systématiquement la remise d'un rapport quand on ne peut obtenir l'adoption d'un dispositif dans la loi est une solution de facilité à laquelle il serait bon, vu son inefficacité, de renoncer... Je vous encourage, en revanche, à solliciter aussi régulièrement que possible le Gouvernement par des questions écrites précises sur la mise en oeuvre des lois dont l'examen a été assuré par notre commission.

Pour finir, je me félicite de la coopération mise en place entre la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois et les commissions permanentes. Le principe du binôme, en faveur duquel nous plaidions, est désormais rodé.
Après le rapport d'information sur le tourisme de Luc Carvounas, Louis Nègre et Jean-Jacques Lasserre, publié en octobre dernier, qui dressait un bilan en demi-teinte de la loi du 22 juillet 2009, un rapport contrôlant l'application de la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services est en cours de rédaction par nos collègues Claude Bérit Débat, pour la commission des Affaires économiques, et Jean-Claude Lenoir, pour la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois. Ce rapport, qui, j'en suis certain, sera riche de précieuses recommandations, devrait être remis au cours de la première quinzaine de juillet.
Je compte sur vous, lors du débat en séance publique sur ce bilan d'application des lois prévu en juin, pour souligner les avancées réalisées au cours de l'année écoulée en même temps que dénoncer les lenteurs dans l'édiction des mesures réglementaires attendues. J'insiste sur la sobriété dont nous devrions faire preuve dans les demandes de rapports : cela est à peu près aussi efficace que d'humidifier un Stradivarius...

Nous savons ce qu'il en est de ces rapports que nous demandons dans les textes, qui ne sont rien d'autre qu'une manière de nous donner bonne conscience, mais ont un coût : n'oublions pas que pour produire ces documents qui finiront dans des placards sans être lus, on mobilise des agents de l'administration centrale. La commission des finances serait fondée à faire usage, à l'encontre de telles demandes, de l'article 40.
Le contrôle de l'application des lois est, en temps normal, une charge modeste : deux rapporteurs sont désignés pour examiner l'application d'une loi, puis la commission se réunit pour autoriser la publication du rapport. Au point que l'on peut s'interroger sur l'utilité d'une commission pour le contrôle de l'application des lois, créée dans les conditions que l'on sait. Je le dis en vue de nos échéances de septembre... En revanche, observer comment une loi se met en place est extrêmement utile. Il me semble que c'est à la commission compétente qu'il revient d'examiner comment sont pris les décrets sur les textes dont elle a assuré l'examen au fond. C'est ce que nous faisions à l'Assemblée nationale, avec des binômes bipartisans. Cela est de bonne méthode, et c'est un débat que nous aurons dans les mois à venir.

Les rapporteurs devraient avoir mission d'assurer le suivi. Dans certains cas, comme celui de la loi Alur, vu le nombre de décrets attendus...

il serait bon d'établir des priorités.
Pour les rapports auxquels on tient vraiment, il serait bon de solliciter la ministre. Je pense à l'application de l'article de la loi SRU relatif aux communes défaillantes. On ne peut pas se contenter des chiffres qu'on lit dans les journaux, dont on ne sait pas s'ils sont exacts. Je pense aussi aux rapports prévus par la loi Alur. Il est vrai que certains rapports ne servent pas à grand-chose, mais il y a aussi des sujets que la haute administration rechigne à aborder, parce qu'elle ne sait pas bien comment régler le problème en cause... Il faudrait solliciter la ministre pour lui faire part de nos priorités.

Cela pourrait prendre la forme d'une question écrite au ministre concerné. L'idée que le rapporteur du texte et le président de la commission signent un courrier au ministre quand ils estiment urgent qu'un rapport soit rendu me paraît bonne.

L'administration est en phase de rédaction des décrets requis par la loi Alur, dont j'ai été co-rapporteur. Certains de ces décrets devraient être prioritaires : il serait bon de saisir la ministre avant que ne soient rendus des arbitrages qui ne seront pas sans conséquence sur l'application de la loi.