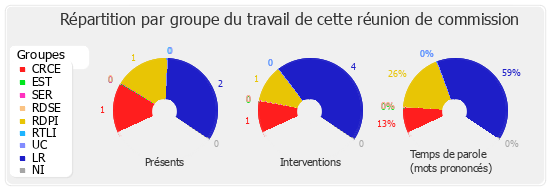Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation
Réunion du 14 mai 2014 à 10h10
Sommaire
- Stabilité financière : a-t-on progressé depuis 2008 ?
- Audition conjointe de mm. jean beunardeau directeur général de hsbc france et directeur de la banque de financement d'investissement et de marchés en france didier duval responsable de la sécurité financière et de la prévention de la fraude au sein de la direction de la conformité du groupe crédit agricole laurent le mouel responsable des affaires réglementaires et prudentielles au sein de la direction des risques du groupe crédit agricole gérard rameix président de l'autorité des marchés financiers et christian walter professeur d'économie au collège d'études mondiales de la fondation de la maison des sciences de l'homme titulaire de la chaire éthique et finances (voir le dossier)
La réunion
Stabilité financière : a-t-on progressé depuis 2008
Audition conjointe de Mm. Jean Beunardeau directeur général de hsbc france et directeur de la banque de financement d'investissement et de marchés en france didier duval responsable de la sécurité financière et de la prévention de la fraude au sein de la direction de la conformité du groupe crédit agricole laurent le mouel responsable des affaires réglementaires et prudentielles au sein de la direction des risques du groupe crédit agricole gérard rameix président de l'autorité des marchés financiers et christian walter professeur d'économie au collège d'études mondiales de la fondation de la maison des sciences de l'homme titulaire de la chaire éthique et finances
La commission procède d'abord à l'audition conjointe sur le thème : « Stabilité financière : a-t-on progressé depuis 2008 ? », de MM. Jean Beunardeau, directeur général de HSBC France et directeur de la banque de financement, d'investissement et de marchés en France, Didier Duval, responsable sécurité financière et prévention de la fraude au sein de la direction de la conformité du Groupe Crédit Agricole, Gérard Rameix, président de l'Autorité des marchés financiers, et Christian Walter, professeur d'économie au collège d'études mondiales de la fondation de la maison des sciences de l'homme, titulaire de la chaire éthique et finances.

Ambitieuse, l'audition conjointe de ce matin pose, de manière volontairement quelque peu provocante, la question de savoir si la stabilité financière a progressé depuis 2008. Est-il possible de répondre à cette question ? Sommes-nous présomptueux de la poser ?
L'étude et la compréhension des systèmes financiers est l'une des marques de fabrique de notre commission des finances qui, depuis de longues années, a été souvent à la manoeuvre en matière de législation, de préparation de textes, tant au niveau national qu'à l'échelle communautaire, en particulier par le biais de propositions de résolution. Nous sommes à l'affût pour tâcher de comprendre les nouveaux sujets, les nouvelles technologies en matière de marchés financiers.
J'ai notamment en tête ce que nous avons fait en 2012 à propos du shadow banking - la finance de l'ombre. Notre commission a par ailleurs probablement été la première en France à réfléchir au bitcoin. Ce ne sont là que des exemples de notre souci de bien embrasser, dans le champ de l'étude et de la législation, tous les sujets qui peuvent se présenter en matière financière.
Depuis 2009, chacun sait que la régulation bancaire et financière a progressé à l'échelle mondiale, avec les règles de Bâle III, ou à l'échelle européenne, avec CRD 4, ainsi qu'en matière de réglementation des marchés, avec la directive MIF 2, ou encore s'agissant des chambres de compensation, avec l'arrivée d'EMIR. Tout ceci a été décliné à l'échelle française par la loi de régulation bancaire et financière de 2010, et par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires de 2013. Nous nous interrogions hier, en séance publique, avec le secrétaire d'Etat, Christian Eckert, sur la publication des textes d'application de celle-ci.
Comme chacun le sait, ces régulations sont des garanties supplémentaires. Ce sont des moyens forcément coûteux pour encadrer les risques. Nos réflexions nous conduisent souvent à nous interroger sur la proportionnalité des efforts entrepris par rapport aux effets qu'ils peuvent produire sur le tissu économique. Il est particulièrement important d'y voir clair en matière de régulation, mais il est aussi important de pouvoir compter, dans une période comme celle que nous vivons, sur une production de crédits qui réponde aux besoins de développement ou simplement de financement du fonds de roulement des entreprises, notamment petites et moyennes.
Or, si nous savons bien qu'il faut toujours tenir compte de certaines préoccupations s'agissant de la solidité du système financier, nous nous heurtons davantage, sur nos territoires, aux limites de ce nouvel arsenal de mesures prudentielles, que nous n'en percevons empiriquement les avantages.
Nous voyons par ailleurs réapparaître des méthodes de titrisation, et nous nous interrogeons sur le point de savoir si elles sont réellement exemptes de tous les défauts, voire de tous les péchés de la génération d'avant 2008. De même, nous sommes parfois fondés à penser que certaines transactions financières demeurent tout aussi opaques et obscures qu'elles l'étaient avant l'éclatement des crises financières.
Au terme de cette vague de réglementations, les structures et les méthodes du secteur financier ont-elles changé ? L'adaptation n'est-elle pas purement superficielle et fonction du jour qui passe, des modes, des fantaisies des puissants ? Les risques ont-ils disparu ? Se sont-ils déplacés ? Sont-ils mieux maîtrisés ? Les comportements ont-ils évolué ? Un trader ne reste-il pas un joueur ? Une machine qui fabrique des transactions ne reste-t-elle pas une machine, avec l'amplification des comportements que cela peut induire ? Vous allez nous aider à réfléchir à ces questions, et à trouver des réponses parfaitement affûtées pour chacune d'elles.
Je me tourne en premier lieu vers Gérard Rameix, qui veille depuis déjà quelques années sur les marchés financiers français et européens. Sans doute va-t-il nous aider à entrer dans le sujet par une mise en perspective des principales évolutions du paysage financier et des nouveaux risques que cela fait apparaître.
J'hérite d'un sujet qui, comme vous l'avez souligné, est difficile : a-t-on progressé depuis 2008 en matière de stabilité financière ? Si je devais répondre en un seul mot, je répondrais oui, certainement ! La question est de savoir si l'on a suffisamment progressé, sans créer d'autres inconvénients économiques. Les progrès sont très nets et je peux le démontrer par quelques exemples.
Mon doute porte sur le fait de savoir si ces progrès ont été assez rapides. Cela peut paraître long, puisque nous travaillons sur un agenda qui a été fixé par les G20 de 2009 et de 2010 ; en 2014, nous ne sommes toujours pas arrivés au bout ! Il est nécessaire de le faire et de vérifier que les dispositions déjà adoptées se mettent en oeuvre correctement, ce qu'on ne peut encore dire complètement.
En second lieu, la finance joue un rôle très complexe. Les risques peuvent à la fois être microéconomiques et être décelés dans les différents établissements ou chez les différents acteurs, mais il existe aussi des risques systémiques. Incontestablement, on est dans un régime de taux d'intérêt et d'injection de liquidités exceptionnel qui ne peut pas durer. On aura, selon moi, véritablement progressé que lorsqu'on sera revenu à une situation normale.
Les progrès ont d'abord été organisationnels et institutionnels. En Europe, ils sont assez nets. Nous avons ainsi créé les autorités européennes de surveillance (AES) dans les secteurs de l'assurance, des banques et des marchés financiers, qui constituent la voix et le bras armé des régulateurs. Je passe beaucoup de temps auprès de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), qui n'existait qu'à l'état embryonnaire avant 2008.
En France, nous nous sommes organisés autour de deux pôles, un pôle prudentiel et un pôle de marché, avec des représentations croisées. Cette organisation est convenable et efficace. Je siège, en tant que président de l'AMF, au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ; Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, est représenté par le sous-gouverneur Robert Ophèle à toutes les séances du collège de l'AMF. On a donc, tant au niveau français qu'européen, un système institutionnel profondément rénové.
Je citerai deux grands chantiers, et d'abord celui de la régulation prudentielle bancaire, déjà mentionné. La situation des banques est profondément différente de celle qu'elles connaissaient en 2007-2008. Il n'existe jamais d'évolutions sans quelques inconvénients, mais elles sont incontestablement globalement plus solides. Elles le seront davantage à partir de novembre prochain, lorsque sera passé le test de la revue de la qualité des actifs (asset quality review ou AQR), avec une prise en main de la régulation bancaire par la Banque centrale européenne (BCE).
Le second grand chantier est celui de la mise en oeuvre du règlement européen dit European market infrastructure regulation (EMIR). On comptait, avant la crise, environ 60 trillions de dollars de contrats dérivés, de gré à gré. On a entrepris des deux côtés de l'Atlantique de les réguler en grande partie. Depuis quelques semaines, toute banque ou tout acteur financier qui, en Europe, négocie de tels contrats doit les reporter à un « trade repository », sorte de banque de données de ces contrats. À partir du début de l'année prochaine, une grande partie sera obligatoirement sujette à une compensation centrale par une chambre de compensation, facteur de sécurité majeure.
Les régulateurs, à la suite d'une impulsion politique extrêmement forte des chefs d'État et de Gouvernement, réunis dans les différents G 20, ont engagé, aux États-Unis comme en Europe ou dans d'autres zones géographiques, des efforts très importants pour essayer de limiter les possibilités de risques systémiques.
Pour autant, est-on sûr qu'aucun accident ne peut survenir ? Sincèrement non. Sur les deux chantiers que j'ai cités, nous ne sommes pas au bout du chemin. Dans le cas des banques, le processus de revue de tous les actifs bancaires en Europe, qui est à ma connaissance inédit, est très lourd et comporte des risques. Je lisais ce matin même qu'un grand intervenant germanique estime qu'on a tort de le faire aussi tôt...
Quant au règlement EMIR et au Dodd-Frank Act, même si les États-Unis ont six mois ou un an d'avance, nous n'avons pas encore pris la mesure de l'obligation de compensation centrale et de ses effets sur le système. Je suis moi-même surpris du fait que les experts ne soient pas d'accord sur les conséquences des différentes mesures.
Deux d'entre elles sont majeures. La première est la compensation centrale, qui comporte des contraintes financières pour les acteurs de cette compensation, un contrat devant être pour partie provisionné dans les comptes de la chambre de compensation pour couvrir les risques de son exécution.
Pour la partie des contrats non soumis à compensation, parce n'étant pas suffisamment normée, il existera des appels de marges obligatoires entre acteurs. Une banque ne pourra plus négocier un dérivé de gré à gré ou over-the-counter (OTC) sans entrer dans un mécanisme de calcul d'appel de marges avec sa contrepartie. Les économistes spécialistes de ces matières évaluent entre un et cinq les effets de la fixation d'un seuil de marge. C'est dire si on est dans un domaine où les conséquences économiques sont assez incertaines.
Pour être très schématique, certains estiment qu'il s'agit là d'une catastrophe, le produit risquant de devenir coûteux du fait d'appels de marges significatifs ; les entreprises non financières qui veulent se couvrir ne pourraient plus le faire, et l'on réintroduirait donc un facteur d'instabilité et de risques. D'autres estiment que le chiffre de 60 trillions de dollars était trop élevé et que le réduire de moitié n'emportera aucun impact économique.
Je suis personnellement incapable de savoir qui a raison ! Il est nécessaire d'avancer progressivement et empiriquement. Il existe peu de mesures, et les deux positions que j'ai résumées sont en fait des postures de négociation ou de principe. Je n'ai aucun doute quant à la direction à suivre, qui est bonne, mais difficile à paramétrer.
La seconde incertitude est systémique. Pour moi, la crise des subprimes vient de la mauvaise solution apportée à l'éclatement de la bulle, par injection massive de liquidités qui ont finalement donné lieu à des débordements énormes. Je crains, même si on n'avait pas le choix, qu'on en ait accumulé encore davantage ! Tant qu'on ne les aura pas résorbées, on subira des menaces considérables.

Je me tourne à présent vers Jean Beunardeau. Comment procède-t-on au sein d'un groupe mondial comme le vôtre ? Quelles sont les responsabilités qui incombent à votre filiale française et, dans ce cadre, compte tenu des échanges que vous avez certainement avec vos homologues en charge d'autres exploitations, pouvez-vous nous faire partager une vision globale des progrès effectués, s'ils existent ?
directeur général de HSBC France, directeur de la banque de financement, d'investissement et de marchés en France. - HSBC France, ce sont 10 000 salariés, 300 agences, mais la moitié de l'activité est constituée par la banque d'investissement et de marché, qui génère la moitié des résultats et occupe 1 200 personnes. Nous regroupons à Paris toutes nos opérations de dette souveraine des pays de la zone euro, France et hors France, ainsi que l'essentiel des activités de dérivés actions pour le groupe dans son ensemble, que les clients soient en France, en Asie, ou aux États-Unis.
Nous échangeons en permanence avec le groupe. Comme beaucoup de groupes anglo-saxons, celui-ci fonctionne de manière matricielle. Des lignes mondiales gèrent chacun des métiers, qui sont également gérés localement, en coordination avec l'ensemble. Certains pays sont gérés depuis Paris.

Pourquoi ne faites-vous pas cela Londres ? Ma question est un peu provocatrice !
Historiquement, quand HSBC a acheté le Crédit commercial de France (CCF), c'est à Paris que se situaient ces compétences, plus développées à l'époque que celles de Londres. Nous nous sommes beaucoup battus pour que ces activités demeurent ici. Ce n'est pas toujours rationnel, mais nous y tenons, moi le premier !

Nous ne pouvons que vous soutenir dans cette volonté de préserver cet outil !
Comment les choses ont-elles évolué depuis 2007-2008 ? Assez profondément, et je citerai trois grands champs de modifications.
En premier lieu, nous avons pris conscience, après vingt ans d'extension financière, qu'un certain nombre de risques gérés dans les banques de marché étaient mal calculés voire ignorés. Durant vingt ans, le développement des opérations de marché a été massif. Il en existait six risques que l'ensemble des acteurs des marchés financiers avaient mal cernés.
Le premier risque résidait dans la croyance que tout actif était liquide, qu'il existait toujours une offre, une demande et un prix, et que, le jour où l'on voulait en sortir, quelqu'un était là pour l'acheter. Ceci s'est révélé faux. Les SICAV monétaires comportaient des produits structurés extrêmement longs, trop compliqués pour qu'on puisse leur fixer un prix simple ; en 2008, aucun prix n'existant, ils n'étaient plus liquides, et généraient des risques imprévus.
On pensait en second lieu qu'une dette souveraine, dans un pays développé, ne comportait aucun risque de défaut. C'était une croyance largement répandue : ce n'était pas exact.
En troisième lieu, les traders et ceux qui construisaient les modèles de marché, avaient tendance à considérer les risques identifiés comme extrêmement faibles, proches de zéro. On avait oublié qu'ils pouvaient se matérialiser une fois sur 10 000 ou sur 100 000, et que cela avait des effets importants.
En quatrième lieu, la croyance en la solidité et la stabilité de la notation des agences était un peu trop forte. Un double A, un triple A, un simple A était considéré comme une notation intrinsèque qui devait durer, alors que celle-ci est valable à un instant donné et peut évoluer.
En cinquième lieu, on a cru qu'il était possible, entre banques de premier rang, de se prêter de l'argent à chaque instant, sans risque de contrepartie bancaire. Or, la crise a démontré que toutes n'avaient pas la même solidité de bilan, et qu'en cas d'incertitudes sur la solidité d'une banque, le financement devenait plus difficile.
Enfin, les modèles de marché bâtis pour gérer des produits compliqués ne rendaient pas compte à 100 % de la réalité, mais d'une partie de celle-ci ; il fallait donc les affiner ou ne pas les croire entièrement, et ceci devait nécessiter des marges de précaution.
Second champ de prise de conscience, plus psychologique : les banquiers ont compris qu'il y avait eu quelques excès dans leurs comportements, et que cela avait nui à la qualité de la compréhension et de la confiance avec les autres acteurs économiques en général - un peu trop de court-termisme, peu de responsabilité vis-à-vis des produits compliqués vendus à d'autres professionnels. Je ne parle pas ici des produits destinés aux particuliers, à propos desquels on a toujours pensé qu'il fallait faire attention, mais de ceux qui s'adressaient aux professionnels. Si le professionnel achetait un produit dont il n'avait pas vu les risques, tant pis pour lui ! C'est ainsi que l'on agit dans beaucoup de secteurs entre professionnels. On s'est aperçu que ce n'était pas acceptable sur la durée.
Enfin, peut-être aurait-il été nécessaire de revenir aux priorités de financements de l'économie, devenues, dans les banques, quelque peu secondaires par rapport aux opérations de marché.
Le troisième champ d'évolution - le plus important d'ailleurs - touche le cadre réglementaire, cité par Gérard Rameix ; il est lié à des lois et à des règlements ; il a complètement modifié le domaine dans lequel nous oeuvrons et les paramètres d'exercice de nos métiers.
Les premiers paramètres concernent les exigences prudentielles. Pour prendre le même niveau de risques, il faut deux fois plus de capital qu'auparavant ; un financement d'une certaine maturité doit aujourd'hui être cinq fois plus long qu'auparavant. Par ailleurs, lorsqu'on dispose de fonds propres, le ratio de levier impose de prendre moins de risques nominaux.
Tout ceci a modifié la façon de faire : le couple rentabilité-risque a baissé. On prend moins de risques parce qu'on a davantage de fonds propres en face. L'activité est donc forcément moins rentable, mais le modèle est plus stable.
La réglementation nous a forcés à mener tout un travail sur la résolution bancaire. Ainsi, si une banque n'est plus capable d'assurer sa solvabilité, elle doit être gérée de manière organisée, et l'on ne peut plus dire qu'elle ne peut jamais faire défaut du fait des effets systémiques trop importants que cela entraîne. Ceci a donné lieu à un énorme travail sur les stress tests. Toutes les banques ont dû adopter une culture à plus long terme, afin de gérer leur extinction de manière ordonnée. En matière de structuration des banques, on est encore dans le flou, surtout pour un groupe comme le nôtre, les réglementations étant différentes selon les zones géographiques et pas toujours achevées.
Enfin, le mécanisme de surveillance unique (MSU) fait que les banques ayant, en zone euro, le même superviseur en la personne de la BCE, l'homogénéité va changer les comportements. La tentation de prendre des risques différents sera donc plus faible.
En conséquence, il en résulte un coût d'intermédiation bancaire forcément plus élevé. Nos matières premières sont les fonds propres et les liquidités. S'il faut plus de fonds propres et de liquidités longues pour le même crédit, ceci coûte plus cher à l'emprunteur. Ceci est partiellement compensé par le fait que, l'activité étant moins risquée, elle est moins chère - mais cela ne compense qu'une petite partie de ce coût supplémentaire.
Ce métier doit par ailleurs travailler avec des rentabilités plus faibles. Les grandes banques l'ont déjà dit à leurs actionnaires. Les attentes du secteur bancaire en la matière ont toutes été revues à la baisse. Auparavant, le chiffre de retour sur fonds propres était de 15 % ; aujourd'hui, tout le monde vise environ 12 %.

Merci de nous avoir fait partager cette problématique d'ensemble, tout en nous rappelant les responsabilités spécifiques du centre de Paris au sein des activités de marché du groupe HSBC.
Je me tourne à présent, pour compléter notre tableau, vers les représentants du Crédit agricole, qui vont peut-être s'exprimer de manière plus technique, puisqu'en charge de ces sujets au sein d'une direction de la conformité. Ils vont sans doute mettre l'accent sur les contraintes réglementaires nouvelles, et la manière dont elles sont perçues par les exploitants. Quel est le dialogue interne, au sein de votre grande maison, entre votre service, en charge de la revue des risques et du contrôle des procédures, et ceux qui assurent l'exploitation du fonds de commerce bancaire ? Vous aime-t-on, en quelque sorte ?
A-t-on progressé depuis 2008 ? Incontestablement ! Le système financier est aujourd'hui plus sûr, et ce pour deux raisons principales : le cadre réglementaire est renforcé, et les structures de contrôle étendues.
En effet, depuis le 1er janvier 2014, les règles Bâle III s'appliquent en Europe au travers du règlement sur les fonds propres des banques dit CRR, et de la transposition en France de la directive CRD 4. Ces mesures induisent, ainsi qu'on l'a déjà évoqué, par un renforcement des fonds propres : il faut aujourd'hui plus de fonds propres aux banques pour pratiquer leurs activités. Ceci se traduit également par une meilleure prise en compte de certains risques, notamment en matière de contreparties liées aux opérations sur instruments dérivés, par une meilleure gestion de la liquidité des banques au travers d'un ratio de liquidités de court terme (LCR) et, enfin, par un contrôle de l'effet de levier excessif. Aujourd'hui, le ratio de levier n'est pas encore réglementaire, mais il fait l'objet d'un rapport à l'autorité de contrôle, et fera l'objet d'une publication à partir de l'année prochaine.
Le cadre réglementaire est également renforcé en raison de mesures spécifiques permettant d'améliorer la transparence des marchés financiers, déjà évoquée par Gérard Rameix, notamment à propos du règlement EMIR sur les infrastructures de marchés, qui permet de réduire les montants de dérivés gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. Ceci augmente les exigences de contrôle des risques et de fonds propres pour les contreparties centrales, et oblige à un recensement des opérations de gré à gré qui ne seraient pas compensées.
Le renforcement du contrôle sur les agences de notation a également été évoqué. C'est une des grandes leçons de la crise financière qui permettra également de renforcer la transparence sur les méthodologies de ces agences.
Le système financier est également plus sûr aujourd'hui en raison de structures de contrôle étendues. L'adossement du contrôle bancaire à la BCE, à travers le MSU est une étape très importante, qui va changer radicalement le contrôle bancaire dans les pays membres du MSU. En France, treize établissements de crédits qui représentant 95 % des actifs bancaires seront soumis au contrôle direct de la BCE. On est aujourd'hui en phase de transition, et ce contrôle sera effectif à partir du 30 novembre 2014. Cette phase se traduit par une revue complète du bilan des banques, qui seront soumises aux contrôles de la BCE.
Ces AQR constituent une opération de très grande ampleur, couvrant aussi bien les procédures que les montants de provisionnement des banques, la bonne qualification des crédits, entre les crédits non performants et les crédits sains, l'évaluation des risques sur le portefeuille de négociations. Au total, ce sont 50 % des actifs pondérés par les risques des banques qui seront revus intégralement par les équipes de la BCE, en lien avec les superviseurs nationaux - en France, les équipes de l'ACPR.
Cet exercice se prolongera jusqu'en juillet 2014 ; il sera suivi pendant l'été par un stress test organisé par l'autorité bancaire européenne, en lien avec la BCE. Ce test permettra de mesurer la capacité des banques de la zone euro à maintenir un ratio de fonds propres dur supérieur à 5,5 % en situation de marché très stressé. À l'issue de cet exercice de très grande ampleur, les résultats et les éventuelles mesures correctrices seront publiées juste avant l'entrée en fonction du MSU. Les doutes qui pourraient subsister sur la qualité des actifs de certaines banques de l'Union européenne devraient être définitivement levés.
La mise en oeuvre du nouveau cadre réglementaire et prudentiel est une étape très importante, qui renforce la stabilité financière. Elle n'est néanmoins pas exempte d'un certain nombre de préoccupations pour les banques. La mise en place de ce nouveau cadre doit se faire de manière harmonisée ; ses effets et son impact global doivent être mesurés de manière précise.
La mise en place du MSU ne doit pas se faire au détriment des spécificités du secteur bancaire français. Il se caractérise par un certain nombre de spécificités, parmi lesquelles le financement de l'immobilier, qui passe majoritairement par un financement à taux fixe pour le client, le risque de taux étant porté par les banques et au travers d'organismes de caution mutuelle, comme le Crédit Logement. Ces spécificités ne sont pas complètement prises en compte aujourd'hui dans l'évolution vers le MSU, comme on le voit au travers des AQR.
Autre particularité : la banque-assurance et le poids des banques mutualistes. En France, les banques mutualistes jouent un rôle très important. Il ne faudrait pas que le MSU se traduise par une harmonisation trop poussée du modèle bancaire avec un modèle anglo-saxon, un financement de l'immobilier à taux variable et un poids de la banque-assurance réduit.
Le MSU, qui va entrer en vigueur à compter de l'année prochaine, est un point très important. Il est tout à fait légitime de partager la charge des crises bancaires et des restructurations entre les créanciers et les actionnaires des banques. Néanmoins, ce partage doit se faire à due proportion du risque que fait courir chaque secteur bancaire à l'ensemble du système.
Enfin, nous devons séparer nos activités de dépôt et de financement et certaines activités de banque d'investissement.

Savez-vous comment nous y prendre ? Vous nous tenez des propos généraux, presque des propos de régulateur, mais nous attendions une expérience plus concrète !
En matière de mise en oeuvre de la loi française, on assiste à un contrôle très strict de l'ACPR, la loi lui ayant confié la responsabilité de surveiller cette frontière entre les activités de trading et les activités de financement traditionnel. Une liste des activités qui doivent être « filialisées » doit être produite en juillet de cette année. Les banques travaillent aujourd'hui à identifier ces activités, en lien avec l'ACPR. Son contrôle s'exerce de manière très précise, et l'on voit mal comment on pourrait classer en activités utiles au financement de l'économie des activités qui seraient, selon la loi, considérées comme de pure spéculation.
Les banques jouent un rôle majeur dans le dispositif de lutte contre le blanchiment. Les banques formulent également des déclarations de soupçons auprès de TRACFIN. 30 000 ont été transmises par les professionnels assujettis à déclaration, dont 80 % par les banques en 2013.
Les banques ont également un rôle de surveillance du respect des embargos en matière de sanctions internationales et de gel des avoirs.
Le dispositif anti-blanchiment a été relayé par la troisième directive européenne mise en oeuvre en France en 2009. Il est important de relever que la notion d'approche par les risques permet aux banques d'apprécier ceux-ci, par une cartographie lors de l'entrée en relation avec le client, en fonction de son environnement, de son type d'activité, etc.
La notion de corruption est également intégrée dans les dispositifs anti-blanchiment à travers la troisième directive, qui met en oeuvre la notion de personne politiquement exposée (PPE), qui réclament une surveillance particulière.
La troisième directive a également introduit une notion de blanchiment de fraude fiscale. Nous portons donc un regard particulier sur ce volet. Ceci permet également à un groupe comme le Crédit agricole, à consonance mondiale, de décliner les processus mis en place par les régulateurs français et européens.
Enfin, les banques jouent également un rôle important en matière de lutte contre la fraude. Il s'agit d'un enjeu majeur, notamment en matière de fraude liée aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, de cybercriminalité, tant pour la banque que pour ses clients, notamment à travers le fishing.

Pour clore ces interventions liminaires, je me tourne à présent vers le professeur Christian Walter, qui occupe une chaire au collège d'études mondiales. Ceci mérite peut-être, tant cet intitulé est large, un mot de commentaire.
Le collège d'études mondiales est un lieu installé au sein de la Fondation de la maison des sciences de l'homme, créé par son administrateur, Michel Wieviorka, qui regroupe une quinzaine de chaires dont le but est de porter des réflexions qui paraissent pertinentes à une échelle internationale, en mettant en place un réseau de partenariats, de relations et d'invitations de chercheurs étrangers.
Ainsi, la chaire « éthique et finance », qui a été quelque temps installée à l'Institut catholique de Paris, est aujourd'hui au sein du Collège d'études mondiales depuis septembre 2013.
Je propose d'appréhender la question qui m'a été posée à travers un axe particulier, suivant trois parties : les modèles, le cadre réglementaire et les représentations collectives. Que calcule-t-on ? Quelles sont les normes et les croyances collectives ? Il s'agit ici d'entrapercevoir ce qui est en jeu, depuis 2008, dans l'évolution de la stabilité financière et dans les impasses auxquelles nous sommes, aujourd'hui encore, confrontés.
La chaire a cherché à examiner la question de la nature des modèles et de la relation entre les modèles et les croyances, élément qui n'a pas été pris en considération dans le diagnostic établi à la suite de la crise de 2008 - dans l'ensemble extrêmement documenté, fourni, abondant, complet. Il ne s'agit pas uniquement d'une crise de l'expertise, de la technique, des marchés financiers, de l'éthique, des comportements, de la mesure de risque, mais également d'une crise de la connaissance que l'on a, et que l'on cherche à avoir, de l'incertitude économique et financière.
L'usage courant, en matière de réflexion sur les modèles, les considère d'un double point de vue, soit descriptif, soit prescriptif. Le point de vue descriptif est connu : le modèle est supposé décrire le monde, il est face au monde. Comme l'ont rappelé les précédents intervenants, le monde est vu comme une réalité et, face au monde réel complexe, le modèle est perçu comme trop simple. Par conséquent, le risque de modèle vient de l'écart entre la simplicité apparente du modèle et la complexité apparente du monde.
Dans cette manière de penser les modèles, la seule erreur qui puisse advenir est une erreur humaine. L'usage des modèles peut être un mauvais usage, les données peuvent être de mauvaises données, et l'on considère donc que le risque de modèle renvoie à un risque de type pragmatique - son usage - ou syntaxique - son écriture.
La variante de cette approche descriptive est une approche prescriptive : le modèle sert à proposer tel ou tel type d'intervention, de couverture, de protection, d'action politique, économique ou financière. Dans les deux cas, descriptif comme prescriptif, les modèles sont pensés comme étant face au monde, comme étant une partie de la réalité, pour reprendre les termes de Jean Beunardeau.
De ce point de vue, le risque sera mal mesuré, parce que l'on pense que la mesure se portera sur le monde - la mesure du monde. Or, il me semble que la crise de 2008 fait intervenir un autre phénomène, qui a été noté par les linguistes dans les années 1960, que l'on appelle le phénomène performatif. Qu'est-ce qu'un énoncé performatif ? Parler peut donner lieu à des énoncés descriptifs - « le verre est plus ou moins rempli d'eau » -, prescriptifs -« Ouvrez, fermez la porte » -, mais il existe des situations dans lesquelles, lorsque deux individus passent devant l'officier ministériel, les paroles : « Je vous déclare mariés » ne constituent ni un énoncé descriptif, ni un énoncé prescriptif. Avec des mots, il a été changé quelque chose dans le monde. On dit qu'on a fait des choses avec des mots : l'énoncé a été performatif.
Dans le domaine de la finance, il est important de bien tenir compte de cette caractéristique performative des modèles financiers, y compris des modèles mathématiques et des modèles de risques, qui ne sont pas seulement les descriptions du monde, mais plus précisément des mises en forme du monde, au sens précis où les mots font des choses. De ce point de vue, la performativité des modèles de la finance est un élément qui n'a pas été pris en compte dans l'ensemble des mesures qui ont porté sur le système financier, dans le but d'assurer sa stabilité.
L'on voit qu'il n'y a pas seulement une question de risque mal mesuré, de modèle impropre à saisir le monde réel, mais davantage une question qui concerne la relation entre le modèle et le monde qu'il façonne. Le mot « performatif » vient du vieux français « parformer », qui veut dire « mettre en forme », l'anglais « to perform » en étant une variante. Ceci signifie que quelque chose se passe dans la mise en forme du monde professionnel. Il n'y a pas de pratique professionnelle - gestion des portefeuilles, contrôle des risques, risques de crédit - qui ne soient pas mise en forme par des théorisations mathématiques abstraites.
Cette performativité pourra emprunter deux canaux : un canal intuitif, celui des normes et de la réglementation, et un canal moins connu, celui des outils et instruments de calcul, au sens où un instrument de gestion, au sens très large, un ratio, un tableau de bord, un reporting, un modèle mathématique, un logiciel, ne sont pas que des objets techniques mais également des vecteurs de modification du monde.
Ceci m'amène à ma seconde partie : la notion de règle du jeu et de cadre réglementaire. Ces règles du jeu transforment les acteurs économiques et sociaux en acteurs au sens théâtral du mot, ce qui rejoint la notion de performation ou de « performance » en anglais ; les outils de gestion, les instruments de calcul, les modèles de risques ne sont pas que des mesures de risques, mais également des scripts ou des scénarios, qui disent quel rôle doivent jouer les acteurs qui sont dans les places financières, en train de mettre en oeuvre ces modèles et ces réglementations.
Quel est l'enjeu dans le mécanisme de performativité du monde par les modèles ? Il me semble que c'est une façon de se représenter l'incertitude économique et financière qui se déploie dans un ensemble de croyances collectives. Ce qui est en jeu, c'est la façon dont on pense les variations économiques et financières. Soit on les voit comme des variations continues, régulières, que l'on peut à tout instant rectifier, corriger et gérer, soit on les voit comme discontinues, irrégulières, présentant des cassures, des sauts, des moments d'hétérogénéité.
La loi relative à la racine carrée dans Bâle III fait l'hypothèse qu'il n'existe pas de cassure en économie, cette loi ne s'appliquant que dans un cadre très précis dans lequel existe une continuité des variations économiques et boursières. À l'inverse, toute économie dans laquelle l'incertitude serait perçue de manière discontinue ne pourrait justifier une loi comme celle relative à la racine carrée du temps. Cette loi est une application moderne de Leibniz. Natura non facit saltus : la nature ne fait pas de saut ! Marshall, dans ses principes d'économie politique, l'a appliqué en 1890 ; c'est devenu la base des modèles économiques actuels.
Cependant, la nature saute bel et bien. La loi relative à la racine carrée du temps est donc une illustration du principe de Leibniz, mais n'est pas vérifiée par l'économie réelle.
Lorsque les réglementations ou les croyances collectives instrumentent, mettent en oeuvre un risque considéré comme continu, avec pour seule dimension la volatilité, alors que le monde réel semble discontinu, l'écart entre ces deux représentations conduit à augmenter le risque systémique. La réduction de la volatilité se traduira par une augmentation de l'erraticité. En voulant réduire le paramètre lisse de la continuité, on court le risque d'augmenter le paramètre des chocs.
En conclusion, de manière extrêmement schématique, ce qui est en jeu dans l'évolution des réglementations actuelles, c'est la compréhension des fondements des cadres conceptuels des différentes directives destinées à détecter les éléments qui se trouvent mobilisés pour justifier les types de réglementations en cause.
Dans un certain nombre de cas, on se trouve face à une théorisation conceptuelle qui continue à proposer une vision continuiste des variations économiques et financières. Mon impression est qu'il y a là un danger potentiel qui, pour l'instant, n'est pas encore complètement résolu par les dispositifs dont le but est de stabiliser le système économique et financier.

Merci de nous avoir associés à ces réflexions, de nous avoir aidés à faire fonctionner nos esprits critiques, et de nous avoir rappelé que la technique n'est jamais vraiment neutre, qu'elle reflète et véhicule des représentations ou des croyances.

Je remercie chacun des intervenants pour leurs éclairages. Je me félicite que l'on ait organisé cette table ronde sur un sujet sensible, sur lequel beaucoup de nos concitoyens restent dans l'expectative et, pour certains, dans l'inquiétude. Ils ont le sentiment - et ils nous le rappellent de temps à autre - que les effets de la crise financière ont été immédiats en 2007 et 2008 mais que, à l'inverse, les chantiers de réglementation sont très lents à s'organiser, que la mise en place de la taxe sur les transactions financières, annoncée depuis tant d'années, tarde par exemple à se concrétiser.
Gérard Rameix évoquait des désaccords entre les différentes expertises, suggérant que tout cela entraîne des atermoiements, des retards. Certains de nos concitoyens ont l'impression qu'il existe une forme de complaisance des régulateurs vis-à-vis des milieux bancaires et financiers, les choses ne s'organisant pas aussi vite qu'ils auraient pu le souhaiter. Ceci, je crois, légitime nos propres interrogations et le souci qui est le nôtre de mieux éclairer la situation réelle.
Je suis, pour ma part, porteur d'une forme de scepticisme depuis un certain nombre d'années à propos de ces sujets. Je me souviens des débats que nous avons eus en 2003, notamment à propos de la loi de sécurité financière, lorsqu'elle avait été débattue au Sénat. J'étais à l'époque porte-parole de mon groupe, et nous avions eu des débats riches, mais je me souviens également des réticences fortes dans la culture dominante de l'époque vis-à-vis d'un accroissement de la réglementation.
Je citerais l'exemple des agences de notation. Jean Beunardeau a affirmé qu'on a pris conscience, depuis la crise financière de 2008, que la stabilité des notations des agences était à l'époque un élément de risque mal mesuré. Je ne suis pas totalement en accord avec cette façon de voir les choses ! Quand nous avons débattu de la loi sur la sécurité financière, au Sénat, en 2003, nous avons pu faire état de la situation d'Enron, aux États-Unis, où les agences de notation, la veille de la chute d'Enron, continuaient à attribuer un triple A à cette entreprise ! Toutes les appréciations financières portées par les milieux de la régulation étaient positives. Le vers était donc dans le fruit. Ce n'est donc pas en 2008 que le regard est devenu plus objectif. La situation était déjà clairement fondée sur des bulles spéculatives, dénoncées ici et là, et qui devaient produire les effets que l'on regrette tous. D'autres bulles apparaissent encore dans le paysage. Le scepticisme doit donc rester de mise pour ce qui concerne notre action législative et quant aux préoccupations qui doivent être les nôtres en la matière.
À ce sujet, je voudrais, au-delà de ce qui a été dit, poser quatre questions. En matière de réglementation bancaire, les choses ont avancé : les exigences sont plus lourdes, les besoins en capitaux ont été renforcés, certains ratios ont été améliorés, la prise de risques est aujourd'hui réduite en ce qui concerne les financements. De plus, la séparation des activités bancaires a été votée il n'y a pas si longtemps : bref, le cadre a sensiblement progressé.
Pour autant, des questions demeurent à propos de la sphère financière, parmi lesquelles la rémunération des dirigeants ou des traders et leurs bonus. Le plafonnement des rémunérations variables est-il le bon outil, le seul, pour maîtriser la prise de risques des traders ? Les bonus élevés sont-ils les seuls facteurs de motivation dans les banques d'affaires ?
On a pu constater ces dernières années de fortes divergences entre pays quant à la définition des preneurs de risques, soumis aux limitations salariales. En France, leur nombre serait passé de 3 250 personnes en 2012 à seulement 357 en 2013 pour BNP Paribas. Comment expliquer cette évolution ? Quel contrôle a-t-on sur les classifications ? Existe-t-il des salariés de banques gagnant plus d'un million d'euros par an, non compris dans le périmètre des preneurs de risques ? On a l'impression d'un flottement généralisé. Quel est le public concerné par ces rémunérations ? Pourquoi les chiffres évoluent-ils de façon aussi importante d'une année sur l'autre ?
Concernant le trading à haute fréquence (THF), le livre du journaliste Michael Lewis, « Flash Boys », a récemment fait sensation en exposant ces pratiques, accusant le trading haute fréquence de manipuler les cours. Le trading haute fréquence s'est développé à très vive allure ces dernières années, et procurerait à ses utilisateurs un avantage indu en matière de fixation des prix. Le marché est-il, de ce fait, largement faussé, au détriment des acteurs standards ? L'encadrement du trading haute fréquence dans la directive MIF 2 va-t-il suffire à régler ce problème ? Pourquoi ne l'avoir pas tout simplement interdit ? Une régulation allant jusqu'à l'interdiction de telles pratiques, souvent douteuses, constituerait-elle un sacrilège ?
Enfin, notre commission s'est déjà penchée sur le shadow banking ; dans la crise financière, on sait que le poids des géants de la gestion d'actifs n'a cessé de croître, à la faveur notamment des besoins de financements des retraites dans les pays anglo-saxons. D'après la banque d'Angleterre, la gestion d'actifs représenterait aujourd'hui 87 000 milliards de dollars, soit une année de PIB mondial ou trois-quarts des actifs détenus par les banques. C'est en outre un secteur très concentré, les dix premières sociétés de gestion représentant environ 30 % du secteur. N'y a-t-il pas là un risque de bulle très important dans certaines catégories d'actifs ? Les comportements moutonniers ne peuvent-ils conduire à des situations totalement incontrôlables en la matière ?
D'une façon générale, peut-on considérer que le shadow banking est en train de prospérer activement ? N'est-on pas en train de créer un système financier à deux vitesses, un système bancaire régulé, où on a pris conscience des risques et où on a mis en place un certain nombre de dispositifs, et un autre, non bancaire, mais en plein développement, aspirant à la fois les activités et les risques, qui nous mettrait en situation de grand péril pour l'avenir ?
Le trading haute fréquence n'est pas un problème technique. Si on souhaite l'interdire en France, nous pouvons le faire facilement. Le problème est de savoir si l'on a intérêt à l'interdire. Je ne le pense pas ! Je ne suis pas un avocat du trading haute fréquence. Je pense que c'est une pratique assez douteuse. Ses avocats disent qu'il est utile, réduit les « spreads », ces écarts entre le prix du vendeur et le prix de l'acheteur, qu'il accroit la liquidité et la performance des marchés. J'ai entendu beaucoup de discours de spécialistes généralement employés par les sociétés qui gagnent de l'argent avec le trading haute fréquence. Je ne partage pas ce point de vue.
Néanmoins, sur le marché des actions, le trading haute fréquence représente, selon les places, environ 40 % des ordres. La France prépare, en ce moment, une opération très importante, avec la mise sur le marché d'Euronext. Les quatre marchés - Amsterdam, Bruxelles, Paris et Lisbonne - vont être vendus et retrouver ainsi leur autonomie. Pour le financement de l'économie française et d'une partie de la zone euro, c'est très important. Sans trading haute fréquence, on change le plan d'affaires de la société que l'on met sur le marché. Ceci emporte des conséquences économiques assez importantes. Ce n'est pas un problème technique, mais un problème de choix politique.
En second lieu, je pense que deux questions se posent aux régulateurs. J'ai lu avec intérêt les précédents ouvrages de Michael Lewis, et surtout un certain nombre d'articles sur ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Je connais par ailleurs les travaux que l'AMF mène sur ce sujet. Il existe deux sujets différents. Le premier est juridique et est en train de prospérer, notamment aux États-Unis, et nous nous attachons à le faire prospérer en France. Il s'agit de déterminer si des infractions boursières, au sens du droit positif, peuvent être commises par les opérateurs du trading haute fréquence. Ce n'est pas une question très simple. Dans certains cas, la réponse est oui. Il faut arriver à le prouver. C'est ce qu'essaye de faire le procureur de New York, qui pense que des avantages anormaux ont été donnés aux acteurs du trading haute fréquence. S'il arrive à les qualifier juridiquement, il pourra les pénaliser, sans en interdire la pratique.
Il s'agit donc de vérifier si certains comportements, qui reposent sur la vitesse et le nombre d'ordres annulés, constituent des infractions boursières. Pour répondre à cette question, un très long travail technique d'ingénieur et d'informaticien est nécessaire, le trading haute fréquence se caractérisant par l'émission de centaines de milliers d'ordres, qu'il faut étudier.
Le second sujet est plus politique. Considère-t-on, à partir d'un raisonnement économique ou éventuellement éthique, qu'il faut restreindre, voire interdire, le trading haute fréquence ? La position française est plutôt de répondre oui. Nous avons présenté des positions dans le cadre des discussions sur la directive MIF 2 ; ces positions ont été pour partie retenues. Des équipes de techniciens de l'AMF travaillent aujourd'hui au sein de l'AEMF pour essayer de préciser dans les règlements d'application de cette directive certains points cruciaux en matière de trading haute fréquence. J'insiste sur le fait que cela n'a, selon moi, de sens qu'à l'échelle de l'Union européenne.
Les moyens techniques sont assez simples : il s'agit du pas de cotation, c'est-à-dire la variation minimale de prix à partir de laquelle on peut passer un nouvel ordre. Plus on cherche à diviser le réel en intervalles très petits, plus on donne un avantage au trading haute fréquence. Plus les pas de cotations sont larges, plus il est difficile de faire du trading haute fréquence.
Faut-il réglementer le taux d'ordre annulé ? Accepte-t-on que l'on puisse envoyer des ordres en rafale et de les annuler 5 ou 6 millisecondes après ? Ce sont là les questions qui vont être discutées concrètement au plan européen ?
Le principal problème réside dans le fait que le trading haute fréquence est né de la technologie, de l'éclatement des transactions entre de multiples places, qu'on a sans doute à tort favorisé aux États-Unis et en Europe. Les spécialistes de l'informatique ont du coup exploité ces possibilités techniques. Si on veut les limiter, il faut le faire tous ensemble, de façon cohérente, les échanges se faisant sur toutes les places en même temps.
Quant au shadow banking, le questionnement est pertinent. Il est repris dans toutes les instances. C'est une des questions majeures de la régulation actuelle. N'oublions pas que nous sommes face à des monnaies flottantes et à des transferts de capitaux libres. Dès que l'on impose une contrainte, les capitaux, les monnaies, les taux peuvent se déplacer. Le système est extrêmement plastique.
Cependant, je ne partage pas votre inquiétude sur le monde de la gestion d'actifs, que je connais relativement bien, et que nous sommes chargés de réguler en France : la gestion n'est pas un terrain de non-régulation. Les chiffres que vous avez cités sont exacts : les montants gérés par l'assurance-vie ou par les sociétés de gestion, qui se recoupent d'ailleurs partiellement, sont du même ordre de grandeur que le PIB, voire supérieurs à une année de PIB. Ce sont des montants colossaux, mais il y a d'énormes contraintes, des produits liquides et une régulation.
Certes, celle-ci n'est pas parfaite, ni sans faille. On a cité les fonds monétaires : on a eu très peur, il y a cinq ou six ans, lorsqu'on s'est aperçu qu'on avait des produits triple A parmi les fonds monétaires qui cessaient d'un seul coup d'être liquides. Pour autant, il ne faut pas penser que ce secteur n'est pas globalement régulé. Il ne s'agit pas de la même régulation que la régulation bancaire et les fonds monétaires doivent notamment s'y prêter très sérieusement, mais on ne peut pas dire que l'absence de régulation est totale - fort heureusement !

Madame la sénatrice suffit ! On est ce que l'on est, pas ce que l'on a été ou ce que l'on sera !
Gérard Rameix nous a dit - et je partage son avis - que nous ne sommes pas dans la stabilité financière, notamment tant qu'il y aura autant de liquidités dans le monde. Je ne lui demanderai pas où la prochaine bulle va éclater, car cela fait partie des risques. Il y a toujours une bulle en préparation. Je voudrais toutefois qu'il nous en dise plus sur le sujet transatlantique. L'Europe est-elle dans un bon rapport de force avec les Etats-Unis, compte tenu de cette donnée ?
Ma seconde question s'adresse plutôt aux banquiers. Le modèle économique bancaire va profondément changer sous l'effet des normes prudentielles, de la régulation, de la supervision, etc. Je pense qu'il serait intéressant de se revoir entre juillet et novembre, lorsque nous aurons les résultats de la revue bancaire, avant le 15 novembre. Il est clair que les banques vont de moins en moins financer les entreprises. Celles-ci devraient se tourner vers le marché - ce qu'elles font du reste déjà. La place de Paris est-elle en bonne position pour amorcer ce changement, notamment par rapport aux petites et moyennes entreprises performantes et aux entreprises intermédiaires ?

Ma première question porte sur la trading haute fréquence. J'ai eu une conversation avec un ancien banquier, ancien membre de l'AMF à ce sujet. Cela conforte ce que Gérard Rameix a évoqué : le contrôle de cette activité échappe aujourd'hui à l'homme. Pour contrôler la conformité de 5 à 10 minutes de trading haute fréquence, dont on sait qu'il fonctionne 24 heures sur 24 dans le monde entier, il faut six mois de travail à l'AMF ! Confirmez-vous ce chiffre ? A-t-on la capacité de contrôler cette activité ? Si la réponse est négative, faut-il la maintenir ?
En second lieu, qu'en est-il de l'évolution du nombre des filiales de banques françaises dans les paradis fiscaux, territoires à fiscalité privilégiée, où règne une certaine opacité ? Y a-t-il eu des progrès depuis 2008 de ce point de vue ?

Si on a le sentiment que l'Europe est prête à appliquer Bâle III, qu'en est-il de l'Amérique du Nord, qui ne semble pas être tout à fait dans les mêmes dispositions ?
Les articles de la presse économique font tous état du fait qu'à Wall Street, les choses se passent comme du temps de Lehmann Brothers. On nous explique même que les réglementations Obama sont régulièrement contournées ! Les mêmes causes devraient, à terme, amener les mêmes effets, d'autant que la planche à billets a fonctionné pour soutenir la croissance aux États-Unis. En réalité, c'est surtout l'Europe qui paye les dégâts.
Pensez-vous que les dispositifs que nous sommes en train de mettre en place depuis deux ou trois ans ont une chance de faire en sorte que nous soyons en partie épargnés par la future déflagration qui, à l'évidence, nous menace ?
En second lieu, pensez-vous que les réglementations que nous mettons en place soient suffisantes ? Je ne le pense pas, pas même à travers la directive Barnier, mais si l'on veut éviter que les États soient amenés à financer ces catastrophes, il faudrait des systèmes d'assurances qui fonctionnent !
En troisièmement lieu, si la Réserve fédérale des États-Unis (FED) dispose de larges possibilités d'interventions, ce n'est pas le cas de la BCE, dont tout le monde sait qu'elle est incapable de faire face à certains enjeux. À ce titre, la supervision unique est un dispositif intéressant et constitue un début. Combien d'établissements sont concernés dans la zone euro ?
L'euro est aujourd'hui trop fort. La planche à billet américaine fonctionnant, la monnaie européenne devient une sorte monnaie de réserve, pénalisant ainsi nos exportations, notre croissance et notre économie. Pensez-vous qu'il faille aménager le statut de la BCE afin de faire face à la fois aux risques potentiels qui nous menacent, et pour bénéficier d'une politique plus en phase avec l'idée que l'on se fait de la zone euro, qui devient une zone économique ?

Qu'est-ce que la stabilité financière ? On parle beaucoup des banques, mais la stabilité financière ne recouvre pas que cela. Selon la BCE, que je cite, « la stabilité financière est une situation dans laquelle le système financier qui englobe les intermédiaires, les marchés et les infrastructures de marchés est capable de résister aux chocs, en réduisant la probabilité d'une interruption du processus d'intermédiation financière, qui serait suffisamment important pour perturber l'allocation optimale des ressources ». La récession, selon moi, ne constitue pas non plus la stabilité financière : il faut aussi un peu de croissance pour avoir de la stabilité financière !
Le G20, après les crises de 2007 et de 2008, a réclamé une réforme des institutions, des méthodes, des régulations, aux États-Unis et en Europe. De nouveaux cadres de référence ont été mis en oeuvre, redéfinissant le rôle des régulateurs, mettant en place des normes nouvelles pour les acteurs financiers. Il nous a été demandé d'adopter de nouvelles règles communes de surveillance entre grands pays et d'assurer une meilleure protection des consommateurs et des épargnants. Cela a-t-il avancé depuis 2008 ? Les réponses ne sont pas évidentes ! Les choses ont-elles progressé ? Gérard Rameix l'a affirmé. Est-on sûr que ceci va éviter la répétition de crises aussi graves ?
On ne peut en être sûr !

Si cela tue la croissance sans éviter les crises les plus graves, cela pose question !
Ces nouvelles règles permettront-elles que la finance soit au service d'une croissance renouvelée ? Ne risquent-elles pas de brider les innovations financières et la croissance elle-même ? Certaines innovations sont certes mauvaises, mais cela me fait penser au principe de précaution en général : on n'a plus le droit de faire quoi que ce soit ! Or, quand on n'innove pas, on régresse !

Merci à Jean Germain de nous replacer dans le droit fil de la conception même de cette audition. Il a formulé des questions qui étaient à la base de notre démarche collective.

La titrisation est largement à l'origine de la crise financière. Aux États-Unis, elle a d'ailleurs fait l'objet d'une régulation dès 2009.
Cependant un certain nombre d'intervenants, parmi lesquels le gouverneur de la Banque de France, ou le président de la BCE, voudraient relancer la titrisation, en levant un certain nombre de contraintes supplémentaires pour les produits titrisés qui, selon eux, pourraient servir à financer l'économie.
Ceci présente-t-il un risque ? Comment distinguer la bonne titrisation de la mauvaise ? La mauvaise titrisation est évidemment celle dont les dérives ont conduit à la crise financière. Quels sont les risques si l'on relançait ce processus ?

Y a-t-il d'autres questions ? Je n'en vois pas. La parole est aux intervenants.
S'agissant de la rémunération, il est vrai que, dans un certain nombre de transactions financières, le résultat met plusieurs années à apparaître. Quand on prévoit une rentabilité, un certain risque existe et il n'est pas sûr que le bénéfice se concrétise. On a parfois eu tendance, dans le passé, à rémunérer immédiatement ceux qui avaient réalisé un ensemble de transactions financières intelligentes, dont la rentabilité espérée était bonne, alors que la rentabilité réelle s'est révélée très éloignée de ce qui était attendu. On a donc créé, dans de tels cas, une incitation à une prise de risques excessive, la rémunération étant asymétrique. Il ne faut cependant pas croire non plus qu'il s'agit d'une règle générale, les managements des banques lissant les rémunérations des traders.
Quant aux directives CRD 3 et CRD 4, elles ont mis en place des mécanismes qui, de mon point de vue, sont efficaces. Il en existe trois.
Le premier réside dans le différé de la rémunération avec clause de reprise : si un certain département voit, après deux, trois, quatre ans, que les résultats des transactions ne sont pas à la hauteur de ce qui était prévu, on peut reprendre les rémunérations qui ont été attribuées. Cela se pratique : nous en avons tous des exemples.
En second lieu, une partie de ces rémunérations est versée en titres, en actions de la banque, et n'ont pas le droit d'être couvertes. Quand les banques sont mal gérées et que les cours baissent, la rémunération réelle que touchent les traders est plus faible que prévue. Ils ont donc collectivement intérêt à faire en sorte que le titre se tienne bien.
Le troisième mécanisme repose sur le plafonnement des variables à 100 ou 200 %. On constate les effets de ces mesures sur les comportements qui, dans les salles de marchés, misent sur le long terme et se révèlent moins individuel.

HSBC France est-elle concernée par le dispositif fiscal de la taxe à 75 % ? Si tel est le cas, est-ce un obstacle à l'attractivité de la présence, à Paris, d'équipes complexes ?
Oui, HSBC France est concernée par cette taxe, mais pas sur des montants considérables. C'est effectivement un sujet : nous ne relocaliserions aujourd'hui pas certains collègues de Londres à Paris pour exercer leur activité.
Concernant le trading haute fréquence, je partage ce qu'a dit Gérard Rameix. HSBC ne le pratique pas. Nous n'avons jamais été convaincus par ses avantages pour la liquidité des marchés. Nous sommes incapables de citer quelque argument que ce soit en sa faveur !
Quant au shadow banking, lorsqu'on crée un secteur très réglementé, la nature ayant horreur du vide, les gens qui ont besoin de financement vont voir ailleurs ! C'est humain, et c'est parfois très utile, car certaines idées intelligentes ont besoin d'être financées et n'entrent pas dans le cadre du financement organisé et réglementé.
Les risques sur l'économie en général ne sont toutefois pas les mêmes. La différence entre le shadow banking et la banque réside dans le fait que le premier finance ces projets sur ses propres fonds, alors que les banques prêtent l'argent de leurs déposants. Perdre celui-ci crée donc un risque systémique réel.
Je rejoins ce qu'a dit Gérard Rameix à propos du trading haute fréquence. Il me paraît très important de bien voir que ce qui fonde le trading haute fréquence est une compréhension continuiste des risques financiers. Plus on continuise cette perception des risques, plus on légitime le trading haute fréquence. On est au coeur du débat leibnizien, au sens où il existe pratiquement là deux courants de pensée : si on est leibnizien, on considère le trading haute fréquence comme légitime parce qu'il est continu ; si on ne l'est pas, on le considère comme dangereux.
L'enjeu est donc bien dans la régulation et dans la manière dont les cadres conceptuels des directives se représentent l'incertitude économique et financière : est-elle « continuisable » ou non ? Il y aura deux manières d'agir concrètement, selon que l'on a ou non telle ou telle conviction.
À Columbia, à Cambridge, à la LSE, cette idée commence progressivement à faire son chemin. On voit apparaître une alternative forte, au sens français du terme, entre continuisation ou discontinuisation. Les techniques, les instruments, les calculs, les mesures, et les réglementations font référence à l'une ou l'autre des écoles de pensée en s'appuyant dessus. Si l'on décide par exemple d'affecter un poids de risques au calcul de rémunération de bonus, avec une mesure continue du risque, le bonus sera élevé ; avec une approche discontinue, il sera bien plus faible.
Il en va de même pour ce qui est de la question de la réglementation et du shadow banking : si on régule le système à partir d'une vision continuiste de l'économie, donc fausse, peut-être crée-t-on des arbitrages réglementaires sur une partie non réglementée.
J'ai dit que la technique n'est pas neutre du point de vue de ce qu'elle conditionne ; nous ne sommes pas dans un monde positiviste. Je pense qu'il est aujourd'hui important de faire passer dans les calculs, les instruments, et les réglementations une compréhension discontinue des variations économiques et financières.
Pour en terminer avec le trading haute fréquence, je sens qu'une différenciation est en train de se faire, au sein du monde anglo-saxon, entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Nos amis anglais ont publié il y a un an un rapport d'experts de 150 ou 200 pages commandé par le Trésor et la Banque d'Angleterre, pour en vanter les mérites économiques. Ce sont des tenants de Leibniz et de la continuité. Ils le sont toujours et je pense qu'ils vont essayer de nous freiner dans l'application de la directive MIF 2.
En revanche, aux États-Unis, où un grand nombre de firmes gagnent beaucoup d'argent, le débat est totalement ouvert, et ceci va nous être extrêmement utile.
Deux des difficultés majeures, pour nous, régulateurs, ont été fort bien illustrées dans vos questions. La première est de lutter contre le scepticisme généralisé. Si celui-ci conduit à baisser les bras, cela ne sert à rien ! C'est pourquoi l'AMF a intitulé son plan stratégique : « Redonner du sens à la finance ». Il faut que la finance elle-même considère qu'elle a un sens, et que les acteurs non financiers estiment aussi qu'on a besoin de la finance. J'ai une conviction : sans finance, on n'a pas de croissance ! Quand on est régulateur, il faut essayer d'avoir le moins possible de risques systémiques, mais aussi un système financier efficace. D'ailleurs, dans la définition que Jean Germain a citée figure le fait que le système d'allocation des fonds aux projets des acteurs non financiers doit être optimal. Nous ne l'oublions pas.
Je ne suis pas trop pessimiste sur ce point. Comme l'a dit Nicole Bricq, par un paradoxe de l'histoire, la crise des subprimes née aux États-Unis nous conduit à adopter un modèle de financement plus proche du modèle nord-américain que celui que nous avions à la fin du siècle dernier. Celui-ci était un modèle très bancaire, avec seulement un peu de financement par le marché. Aux États-Unis, les encours de crédits se trouvent moins dans les banques qu'ils ne le sont chez nous, et davantage sur le marché, ou dans des entités que l'on peut classer dans le shadow banking.
Nous avons adopté une régulation bancaire plus stricte : il nous faut donc ouvrir des portes. C'est pourquoi je ne partage pas l'inquiétude exprimée par l'un d'entre vous à propos de la titrisation. Je pense que la titrisation des subprimes a été un travail de fraudeurs ! L'outil, en lui-même, n'est pas en cause. Ce n'est pas parce qu'un conducteur sous l'emprise de l'alcool est entré dans un arbre qu'il ne faut plus utiliser la voiture !
Une titrisation honnêtement réalisée et professionnellement présentée a son utilité économique !
C'est un des problèmes les plus faciles à résoudre, parmi les questions que nous avons traitées aujourd'hui. Si un produit frelaté obtient une note triple A, c'est catastrophique, mais une banque sérieuse - il y en a - peut offrir un véhicule avec des créances sérieuses et les présenter sérieusement ! Le seul inconvénient réside dans le fait que c'est plus cher que le bon vieux crédit bancaire, l'intermédiation bancaire étant relativement bon marché en termes de marges par rapport à la titrisation, qui est plus compliquée. Cela mit à part, il n'y a pas de risques énormes en tant que tel.
Ce qui a été catastrophique dans le cas des subprimes, c'est le fait que des banques allemandes ou des sociétés de gestion françaises ont acheté du papier issu d'une titrisation au carré, voire au cube. À la fin, elles pensaient quasiment acheter une obligation. Or elles achetaient un papier que plus personne, au bout du compte, pas mêmes des banquiers très sophistiqués, ne pouvait évaluer ! Nous avons réalisé des titrisations à la française à la Commission des opérations de bourse (COB) lorsque j'ai débuté comme directeur général ; nous en avons fait à l'AMF : nous n'avons jamais eu le moindre problème !
On doit donc progressivement basculer vers un modèle qui recourra à des financements plus diversifiés, qui feront appel à la gestion, au marché, aux assureurs. C'est un défi pour les régulateurs, mais aussi pour le législateur et pour l'ensemble de la sphère européenne. Il n'y a pas de raison de ne pas y parvenir ! Je ne suis pas pessimiste.
Aujourd'hui, le financement bancaire plafonne, comme l'illustrent les statistiques de la Banque de France, mais il existe également des financements obligataires très abondants. Je ne pense donc pas que ce soit le manque de financement qui freine globalement la croissance européenne.
Il faut en effet de la confiance.

Il faut des outils pour syndiquer des crédits, des émissions obligataires. Il est évident que la plupart des entreprises, moyennes en particulier, n'iront pas directement sur le marché avec leur seule signature.
C'est plus difficile. On a de grandes banques en France. Pour répondre à la question de Francis Delattre, il existe 13 banques françaises et 128 européennes qui seront supervisées directement par la BCE. Nous représentons environ 10 % de celles-ci, notre système étant plus concentré.

Il faut aussi tenir compte des décisions que l'on a prises concernant les fonds de pension, dont on n'a pas voulu, ou de l'assurance-vie. En réalité, 90 % du crédit bancaire financent aujourd'hui les investissements des entreprises.

Le problème des fonds de pensions résulte de responsabilités prises il y a vingt ans !
Pour résumer ma pensée, le crédit bancaire avec un crédit accordé sur sept ou huit ans, qui reste dans le bilan de la banque, va continuer à se faire. Il sera un peu plus difficile et plus cher. On va chercher des solutions alternatives, généralement un peu plus coûteuses que la marge d'intermédiation bancaire. Il faut en effet des spécialistes, des agences de notation ; il faut étudier le portefeuille de créances, avoir une structuration juridique plus complexe que celle qui existait dans les grands réseaux bancaires, dont certains sont ici.
La question posée par Nicole Bricq au sujet de la zone euro et du dollar est extrêmement compliquée. Je ne sais si j'ai la capacité d'y répondre. On est là dans deux mondes différents. Les États-Unis sont allés plus loin et plus vite que nous pour remettre de l'ordre, créer des liquidités ; ils ont obtenu une parité du dollar relativement favorable par rapport aux autres devises et sont en avance sur nous en termes de reprise de la croissance.
Ils sont face à un défi bien plus fort que le nôtre, puisqu'ils doivent reprendre ces fameuses liquidités. Lorsque Ben Bernanke a parlé pour la première fois de réduire le quantitative easing, la chose a eu immédiatement un impact très fort sur les marchés. En Europe, le paysage est différent. On a eu recours à des techniques équivalentes. Mario Draghi a réussi à faire en sorte que les taux de crédits des principaux Etats se rapprochent. On ne peut pas dire que le financement, dans les pays du Sud, soit parfaitement organisé, mais on a fait des progrès.
Beaucoup d'observateurs et d'économistes pensent que l'on est trop conservateur, et qu'il faudrait que la BCE fasse ce qu'a fait Ben Bernanke il y a deux ans. Je serai plus nuancé. Il faut naviguer entre deux risques, celui de freiner la croissance et celui de recréer des bulles. Pour l'instant, je suis moins critique que beaucoup de gens à l'égard de la BCE. Son parcours, durant ces dix-huit derniers mois, n'est pas si mauvais.
On est assez content de l'avoir eue ! En France, on est toujours très critique.

Ce n'est pas la critiquer de dire qu'on pourrait lui donner plus de moyens !
Elle va en avoir besoin pour la supervision bancaire.
Énormément !

Il faudra y revenir lors d'une autre audition. Les seules banques qui ne sont soumises à aucune régulation, ni à aucun contrôle sont, d'une certaine façon, les banques centrales. C'est le paradoxe des choses, que nous avions notamment essayé de traiter aux États-Unis, l'année dernière. Le bilan d'une banque centrale, par définition, est sans limite.
En conclusion, nous avons depuis 2008 considérablement intensifié notre action le plus concrètement possible pour essayer de rassurer les épargnants et mieux les protéger. C'est très lent et très difficile. Ils sont d'ailleurs toujours démarchés par des personnes qui leur font des offres malhonnêtes. Des opérations hyperspéculatives leur sont offertes, ou des produits totalement exotiques, mais on les protège globalement mieux qu'auparavant.
J'espère que l'on va revenir à une allocation de l'épargne moins défavorable aux entreprises françaises. Il faut que les épargnants se disent que, s'ils ont du temps devant eux, ils peuvent investir à profit, y compris dans des actions de grandes entreprises françaises. Beaucoup d'épargnants français ont manqué le passage du CAC 40 de 3 500 à 4 500, car ils ne désiraient plus entendre parler d'actions. Je pense que c'est une erreur pour eux
C'est vrai, mais tous n'avaient pas acheté à 6 000 ! Nous avons réalisé une étude démontrant que, sur vingt-cinq ans, le placement en actions est meilleur que le placement immobilier, hors impôt, qui a pourtant été phénoménal - à condition d'avoir réinvesti les dividendes. La réalité est donc plus complexe qu'il n'y paraît !

Encore faut-il ne jamais avoir besoin de son argent, et de se contenter de faire la liste de ses plus-values potentielles !
On a aujourd'hui un biais défavorable à l'investissement dans l'économie productive, hors impôt.
Je pense qu'il faut persévérer. On n'a pas tiré toutes les conséquences de la crise. On ne peut dire qu'on a maîtrisé tous les nouveaux risques. Il y en a d'autres. Je ne partage pas l'idée qu'on va droit vers l'éclatement d'une nouvelle bulle. C'est là une vue très noire de la situation.
Je pense que l'on peut gérer la sortie de crise, mais on a encore besoin d'au moins deux à trois ans pour stabiliser le système et en retrouver un plus sain. Je pense que l'on peut y arriver.
J'aimerais revenir sur un certain nombre de questions concernant l'efficacité des mesures qui ont été prises. Est-on allé assez loin ? Pourra-t-on éviter une crise aussi grave à l'avenir ?
L'efficacité de ces nouvelles mesures est certaine. Gérard Rameix évoquait la longueur de l'agenda et le fait que l'on était dans une zone d'incertitude. Il s'agit en effet d'une réforme réglementaire de très grande ampleur, qui suppose que l'on procède lentement, et que l'on mesure tous les effets potentiels sur l'économie. Néanmoins, les banques ont d'ores et déjà largement anticipé ces évolutions. Elles se sont adaptées, notamment en termes de gestion de la liquidité. Une enquête du comité de Bâle, qui repose sur les cent plus grandes banques internationales, et qui a lieu tous les six mois, montre qu'au 30 juin 2013, le ratio de liquidité de court terme était de 114 % en moyenne, très supérieur aux 60 % qui s'appliqueront à compter du 1er janvier 2015. De la même façon, les fonds propres se sont considérablement renforcés. On a aujourd'hui un ratio moyen qui était, en juin 2013, de 9,5 %, bien supérieur aux 7 % qui sont aujourd'hui exigés.
Ces réformes portent donc leurs fruits. Faut-il aller plus loin ? L'idée est plutôt de prendre en compte l'impact de toutes ces réformes, d'en mesurer l'effet sur le financement de l'économie. Un certain nombre de dangers existent en effet à vouloir aller plus loin, la proposition de la Commission européenne sur la séparation des activités représentant une inquiétude majeure pour les banques.
Concernant la titrisation, je rejoins totalement les propos de Gérard Rameix. Il peut paraître paradoxal de voir qu'un outil qui a été présenté, sûrement à tort, comme un véhicule de propagation de la crise, est aujourd'hui favorisé par l'évolution de la finance, notamment par l'évolution réglementaire, puisque c'est précisément pour réduire les contraintes de liquidités et d'effet de levier que les banques sont poussées à sortir de leur bilan des actifs qu'elles avaient coutume de porter jusqu'à leur maturité.
Néanmoins, il faut souligner que le cadre réglementaire qui encadre ces titrisations a considérablement évolué. Là où, par le passé, il fallait par exemple 10 euros de fonds propres pour investir dans une tranche de titrisation notée simple A, il faudra dorénavant 65 euros, soit une multiplication par plus de six des exigences de fonds propres.
De la même façon, les exigences de contrôle interne, qui encadrent la manière dont cette activité est gérée par les banques, ont également considérablement été renforcées.
Par ailleurs, en Europe, les actifs qui sont titrisés sont généralement de très bonne qualité. En France, sont principalement concernés les crédits immobiliers, dont on sait que le taux de perte est très faible. Sur ces actifs, les risques que l'on a pu voir apparaître à l'occasion de la crise des subprimes sont limités et contrôlés.

Je voulais remercier les intervenants pour leurs réponses, notamment Gérard Rameix, pour les précisions qu'il nous a apportées sur le trading haute fréquence, qui reste un point délicat, le taux de 40 % des transactions qui se font au travers de ce dispositif représentant un poids considérable.
Un point n'a cependant pas été développé : j'aimerais demander son point de vue à Christian Walter, qui est en charge d'une chaire sur la finance et l'éthique, sur la rémunération dans la sphère financière. L'une des causes de la crise dans laquelle nous avons été plongés, et l'un des problèmes qui subsiste réside dans la question des rémunérations des preneurs de risques, des bonus et des montants très élevés qui sont alloués. Pouvez-vous nous donner votre avis sur ce thème ?

J'aurais souhaité ajouter deux brèves remarques, avant que vous ne nous apportiez les conclusions nécessaires.
Laurent Le Mouel a évoqué le crédit immobilier et les caractéristiques du système français. Nous savons pourtant qu'il demeure une dichotomie fondamentale entre le système de crédit immobilier à la française, dont la garantie repose sur l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur et, d'autre part, le système de crédit immobilier à l'anglo-saxonne, qui a été importé par beaucoup d'autres pays, comme par exemple l'Espagne, où la garantie repose sur la valeur de l'actif acheté grâce au crédit. C'est le système du « mortgage » qui, lorsque le marché s'inverse, induit bien entendu des pertes et déstabilise le système financier dans son ensemble.
J'avoue ne pas comprendre comment il se fait qu'une leçon aussi évidente que celle de la crise financière de 2008-2010 n'ait pas été retenue par nos homologues, et par les grands spécialistes des différents pays dont il s'agit. Après le désastre de Dublin, par exemple, on ne s'est jamais posé la question de savoir si le système ne devrait pas être monté autrement.
Enfin, je voudrais profiter de la présence de Gérard Rameix pour lui demander, du point de vue de la législation boursière, qui est l'un des éléments qui doit concourir à l'efficience des marchés, à leur transparence et à la bonne connaissance des offres, s'il lui semble normal que le management d'un grand groupe industriel cède 70 % de l'activité de celui-ci, envisageant ainsi de modifier très substantiellement la réalité économique dudit groupe, sans que cela implique pour l'initiateur de l'offre d'achat de proposer à l'ensemble des actionnaires de racheter leur part de capital, sans procéder à un ramassage, un maintien de cours ou une offre publique sur 100 % du capital. Bien entendu, chacun voit à quelle situation concrète je fais allusion !

En Allemagne, le coût du logement est 50 % moins cher qu'en France, à type de logement équivalent. Est-ce le mode de financement - dont tout le monde prétend qu'il est parfait - qui amène ce résultat ? Ceci entraîne incontestablement une vraie difficulté par rapport au coût de la vie, à la croissance et même aux salaires. C'est un de nos handicaps. Est-ce lié au mode de financement ?
S'agissant de la question des excès de rémunération, la technique n'est pas éthiquement neutre. Un choix technique est un choix éthique. On peut inciter ou dissuader. C'est là que l'on retrouve la question du calcul mathématique, les modélisations incitant à des prises de risques excessives.
J'aurais tendance à mettre un frein aux moteurs, grâce à une technique différente, complétant éventuellement une réglementation externe qui n'est pas, en soi, suffisante. Si on réglemente par l'extérieur sans mettre de freins aux moteurs, la technique nous embarquera toujours dans une direction qui n'est pas celle de la réglementation. Il faut donc changer la technique elle-même pour qu'on arrête d'inciter les individus à prendre des risques excessifs, qu'ils sont persuadés de pouvoir prendre, du fait des croyances dont nous avons précédemment parlé.

Or, la technique n'est pas issue d'un vote émis par les parlements démocratiquement élus, mais constatée dans une pratique professionnelle !
Pour répondre à la question du président Philippe Marini, en droit, le management peut céder les actifs, dès lors qu'il respecte le droit des sociétés, c'est-à-dire l'intérêt social et une procédure transparente vis-à-vis du marché. Ceci peut paraître paradoxal puisque, dès lors que vous achetez 31 % des actions d'une société cotée, vous devez faire une offre sur la totalité du capital, sous le contrôle du régulateur ; à l'inverse, si vous achetez 70 % de l'entreprise, vous pouvez négocier avec le seul management.
La situation est différente si le groupe qui cède ses actifs est contrôlé ; l'AMF peut alors demander à l'entité qui contrôle le cédant de désintéresser les actionnaires minoritaires de la cible dont la stratégie change brutalement, si le marché n'est pas assez liquide, ou s'il existe des problèmes.
En l'état actuel, seul le code AFEP-MEDEF, qui se situe du point de vue de la gouvernance, recommande dans un tel cas que l'assemblée générale des actionnaires soit saisie. En Grande-Bretagne, sauf erreur de ma part, dès lors qu'un management voudrait céder plus de 25 % de l'activité, il lui faudrait une autorisation de l'assemblée générale, mais c'est plutôt une particularité britannique.
Je l'ai dit et écrit, je pense que les deux affaires, qui sont exceptionnelles de ce point de vue, de groupes discutant de façon très avancée pour céder des actifs importants, sans processus d'offre, méritent de donner lieu à une réflexion sereine, qui peut être assez longue, parce que compliquée.
Certaines entreprises comme la FNAC ont, dans le passé, procédé à des distributions d'actions, et fait sortir du périmètre une société cotée pour en créer une autre, la FNAC étant maintenant cotée de façon indépendante.
Une réflexion juridique doit donc être menée. Le droit n'est pas neutre non plus. Il faut le faire à partir de conceptions économiques, éthiques, et de comparaisons internationales. On peut se poser la question de savoir s'il faut modifier le droit des sociétés pour suivre l'exemple anglais. On peut aussi se demander s'il faut des ajustements au droit des offres, mais je ne suis pas encore capable de répondre à cette question.