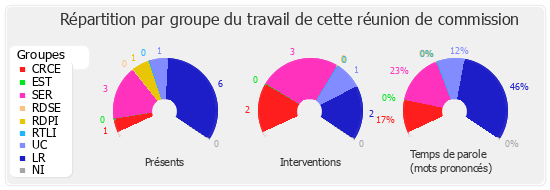Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale
Réunion du 22 novembre 2016 à 17h45
Sommaire
La réunion
La commission entend M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le projet de loi de finances pour 2017.

Nous sommes honorés que vous ayez accepté cette audition car il est peu courant de vous recevoir dans cette commission. Nous en avons en effet eu l'occasion de vous inviter à plusieurs reprises mais vos divers engagements, notamment un voyage à Saint-Pierre-et-Miquelon, vous ont empêché de venir nous rencontrer.
Vous venez ce soir nous présenter les crédits affectés à la mission « Justice » dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017 que nous examinons, contrairement à ce que nous entendons parfois dire. Nous préparons nos rapports pour avis avec soin et nos rapporteurs vous poseront des questions à l'issue de votre présentation.
Je suis ravi de répondre à votre invitation et je vous présente mes regrets de n'avoir pas toujours pu être à la disposition du Parlement. Vous connaissez mon attachement au fonctionnement du bicaméralisme. J'essaye d'illustrer au mieux cette maxime selon laquelle le Gouvernement est à la disposition du Parlement.
Je vais vous présenter la mission « Justice » dont l'examen s'est achevé, il y a une quinzaine de jours, à l'Assemblée nationale et qui a été voté à l'unanimité des membres présents, les rapporteurs de l'opposition s'étant abstenus positivement, considérant que ce budget n'était pas vraiment critiquable et permettait d'espérer un redressement. Ces mots devraient sonner positivement à vos oreilles, puisque vous avez créé une mission d'information sur le redressement de la justice. Nous suivons ses travaux avec attention et j'espère que nous les facilitons car j'ai donné des consignes pour que le ministère réponde le plus exhaustivement possible à vos différentes demandes. Si vous le souhaitez, je viendrai devant votre commission avant de lire vos conclusions qui sont d'ores et déjà pour nous source d'inspiration.
Je connais vos dispositions aimables à l'égard de la justice dont nous partageons le souci qu'elle puisse disposer de moyens à la hauteur des responsabilités qui sont les siennes. De ce point de vue, le budget de la mission correspond à cette intention. D'ailleurs, le diagnostic à partir duquel il a été construit transcende les clivages politiques : nous sommes tous d'accord pour dire que le fonctionnement de la justice doit s'améliorer. Lorsque vous m'aviez auditionné avec la commission des finances sur la loi de règlement, j'avais dit que des marges de progrès pouvaient encore être franchies. Lors des débats internes au Gouvernement, j'ai tout fait pour obtenir un budget à la hauteur des défis. Ce n'était d'ailleurs pas une surprise pour mes collègues puisque j'avais indiqué lors de mon arrivée à la Chancellerie, il y a dix mois, que la loi de finances était ma seule priorité car, à mes yeux, les textes votés n'ont d'intérêt que s'ils sont correctement appliqués. L'institution judiciaire doit bénéficier des moyens garantissant à la fois son impartialité, son indépendance et son bon fonctionnement.
Je suis donc heureux de vous présenter un budget dont l'augmentation est la plus forte depuis le début du quinquennat. Par rapport à l'an passé, l'augmentation se monte à 520 millions d'euros. J'ai décidé d'affecter ces moyens en priorité aux juridictions, car celles-ci connaissent de grandes difficultés, tant en ce qui concerne les justiciables que le personnel. Votre rapporteur Yves Détraigne disait à juste titre que « la justice est un service essentiel pour le bon fonctionnement de notre société. Elle est servie par des magistrats, des greffiers et d'autres agents qui ont un grand sens du service public ». Il est donc légitime que nous oeuvrions ensemble pour que leurs conditions de travail soient dignes. Cela passe d'abord par la création de postes. Avec ce projet de loi de finances, nous proposons d'en créer 600 dans les juridictions, soit 238 emplois de magistrats et 362 emplois de greffiers et d'agents administratifs. Ces créations de postes sont complémentaires d'une revalorisation des statuts et d'une réflexion sur les missions. La loi sur la justice du XXIème siècle a ainsi réorienté un certain nombre de fonctions qui pesaient sur les juridictions et qui vont relever d'autres structures, étatiques ou décentralisées.
Les crédits destinés au fonctionnement des juridictions augmentent de 12 %. Ces 355 millions d'euros permettront de soulager les juridictions et de commencer à mettre fin à l'embolie que chacun constate ici ou là.
Le ministère de la justice est le premier constructeur de l'État. Pour 2017, le budget dédié à la construction augmente de 31 %. Cela permettra de financer de grandes opérations en cours à Strasbourg, à Cayenne, à Pointe-à-Pitre ou encore à Lisieux. Des opérations seront lancées l'an prochain à Lille, à Basse-Terre ou encore à Mont-de-Marsan où je suis allé visiter la semaine dernière le tribunal de grande instance dont l'état est en-deçà de ce qui m'avait été annoncé. Nous devons également maintenir en état les juridictions, les remettre aux normes et en améliorer l'accessibilité. Entre 2012 et 2017, à côté des grands travaux, il y aura eu plus d'une centaine d'opérations de cet ordre.
Nous nous attachons aussi à gérer de façon rigoureuse ce ministère dont la gestion souffre d'une mauvaise réputation. Nous avons cherché des pistes d'amélioration de la dépense publique. Avec le secrétaire d'état chargé du budget, Christian Eckert, nous avons lancé une mission commune pour identifier les marges de progression et optimiser les dépenses. En 2017, nous passerons au crible les frais de justice. Vos rapporteurs nous avaient demandé en 2016 d'être vigilants pour éviter des arriérés importants qui ont des conséquences néfastes pour les auxiliaires de justice : certains d'entre eux refusent même parfois leur concours faute de paiement de leurs missions antérieures. Quand je suis arrivé à la Chancellerie, je me suis engagé à réduire les délais de paiement dès 2016. Nous sommes sur la bonne voie. En janvier, nous avions quatre mois de retard. En raison du dégel que le Premier ministre a accordé au printemps et de la mobilisation des différentes cours d'appel, nous sommes passés à un mois. Les chefs de cour que vous rencontrerez ne pourront que corroborer mes dires. Il y a quelques semaines, j'ai obtenu que, dans le décret d'avance, 40 millions d'euros soient dédiés aux frais de justice. Néanmoins, j'ai souhaité qu'en 2017 nous réalisions des économies sur ces frais. Le déploiement progressif de la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) devrait se traduire par des économies, même si je connais ses carences actuelles.
J'ai également engagé la réforme du secrétariat général. Nous ne répondrons pas à l'embolie de la justice par un accroissement des moyens, car plus nous améliorerons l'institution judiciaire, plus elle génèrera des demandes. Des réformes de structure sont donc nécessaires. C'est pourquoi la réforme du Secrétariat général doit être menée à bien : c'est une structure horizontale qu'il nous faut construire dans une administration qui a beaucoup plus l'habitude de la verticalité avec la protection judiciaire de la jeunesse, la direction de l'administration pénitentiaire, les services judiciaires et les deux directions législatives. Ayant demandé au secrétaire général d'engager une réforme profonde, je lui ai donc affecté 80 emplois de plus pour prendre le tournant du numérique. Pour l'instant, notre équipement informatique est en retard, en dépit des plateformes régionales créées. Les premières mesures prises pour regrouper les services centraux du ministère dans un immeuble situé porte d'Aubervilliers nous ont permis d'économiser 6 millions d'euros de loyers.
Avec l'augmentation du budget, l'accès à la justice et au droit sera facilité. Deux mesures importantes ont ainsi été prévues par la loi pour la justice du XXIème siècle. La première est le développement des services d'accueil unique du justiciable (SAUJ). J'étais récemment à Angers, à Mulhouse et à Strasbourg : la mobilisation des personnels des greffes permet d'offrir ce service de proximité. Nous travaillons aussi à l'intégration des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) et des tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) au sein des tribunaux de grande instance (TGI).
Lors des débats sur la loi de finances pour 2016, vous aviez dit votre inquiétude pour l'aide juridictionnelle. Pour 2017, elle s'élèvera à 454 millions d'euros, soit une progression de 15 % qui se décompose ainsi : 371 millions d'euros de subventions et 83 millions d'euros de ressources extrabudgétaires. Avec ces crédits, je vais pouvoir honorer les engagements passés avec la profession fin 2015 et je vais pouvoir instaurer une unité de valeur unique revalorisée, servant de base au calcul de la rétribution des avocats. Aujourd'hui, nous avons trois montants : 26,5 euros, 27,5 euros et 28,5 euros. L'Assemblée nationale a voté l'amendement que j'ai déposé et qui porte cette valeur à 32 euros, au lieu des 30 euros initialement prévus en loi de finances. Ce montant unique est le fruit d'une nouvelle concertation avec le Conseil national des barreaux.
S'agissant des justiciables, le plafond de ressources pour bénéficier de l'aide juridictionnelle passera de 929 euros en 2012 - montant inférieur au seuil de pauvreté - à plus de 1 000 euros en 2017. Cela permet d'inclure dans le champ de l'aide juridictionnelle 100 000 justiciables supplémentaires.
Le budget dédié à l'aide aux victimes, dont les dépenses ont crû régulièrement ces dernières années, augmente. Nous atteindrons les 25 millions d'euros, contre 10 millions d'euros en 2012. Comme l'action des bureaux d'aide aux victimes est déterminante, nous en avons créé 116 : ce dispositif est donc généralisé à tous les TGI.
J'en viens à la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) : les rapports successifs de Mme Cécile Cukierman ont mis l'accent sur le manque de postes, notamment lors de la loi de finances pour 2015. En 2017, la PJJ aura les moyens d'agir, grâce à l'augmentation de 4 % de son budget (les crédits hors CAS Pension passent de 663 à 690 millions d'euros) et à la création de 165 emplois. Je profite de l'occasion pour dire mon respect et ma gratitude à Mme Catherine Sultan, directrice de la PJJ. Nous avons encore beaucoup à faire, notamment avec le défi de la radicalisation auquel la PJJ s'est attaqué.
Il y a d'autres enjeux, comme la révolution numérique. Nous allons dédier 121 millions d'euros à l'informatique (+ 7 %). Cette décision correspond aux attentes des procureurs et des présidents. Déjà, en début d'année, j'avais débloqué 21 millions sur les 107 millions d'euros dégelés. Cette augmentation financera l'équipement courant, mais aussi le projet « Justice.fr », site d'information du justiciable ouvert au printemps dernier mais qui doit encore être développé afin que chacun puisse engager des démarches sans se déplacer.
Parmi les autres grands enjeux, nous devons adapter la prison. Vous connaissez bien sûr le problème de la surpopulation, des conditions de travail, mais aussi des conditions de détention qui sont éprouvantes. Depuis 2012, et si l'on inclut 2017, nous aurons construit 4 035 places de prison nettes. C'est beaucoup mais cela reste insuffisant. Le Premier ministre a d'ailleurs annoncé le 6 octobre un vaste plan de construction pénitentiaire : 32 nouvelles maisons d'arrêt et un centre de détention. Les préfets de 33 départements ont été mobilisés et je suis l'objet de nombreuses sollicitations de parlementaires. Les préfets devront nous rendre leur copie le 16 décembre. Début janvier, nous procéderons aux choix afin d'engager immédiatement les procédures d'acquisition et les travaux de construction. Ce programme n'a pas uniquement vocation à lutter contre la surpopulation mais aussi à garantir l'encellulement individuel. Nous prévoyons 1,158 milliard d'euros pour la construction de ces établissements et pour les quartiers de préparation à la sortie (QPS), structures permettant de prévenir la récidive. En outre, 150 millions d'euros sont destinés à la maintenance et à la rénovation des bâtiments. Depuis des années, la Cour des comptes nous invite à inscrire ce montant alors que l'entretien de ce patrimoine public a trop longtemps été considéré comme une variable d'ajustement. Depuis une décennie, il était habituel de prévoir 40 à 50 millions d'euros pour l'entretien alors qu'il en fallait 150. En outre, cette année nous devrons payer 170 millions d'euros aux entreprises avec qui l'État a conclu des partenariats public-privé. Je souhaite que nous entretenions notre patrimoine public qui est considérable : nous disposons de 1 200 implantations judicaires et de 188 prisons. Or, 70 % d'entre elles n'ont jamais été construites pour en faire des établissements pénitentiaires : il s'agissait de couvents ou de casernes... De plus, 72 % de ces bâtiments sont centenaires et nécessitent des travaux importants : plus nous les laissons se dégrader, plus les coûts de réhabilitation seront élevés. Les 150 millions inscrits vont permettre de poursuivre les travaux engagés, comme à la Santé qui rouvrira au deuxième trimestre 2018, mais aussi l'entretien des Baumettes et de Fleury-Mérogis. La sécurité des bâtiments est également essentielle : 40 millions d'euros lui seront consacrés afin que le droit à la sûreté ne soit pas que virtuel.
En outre, 1 255 emplois seront créés dans l'administration pénitentiaire, sous la responsabilité de son nouveau directeur, le préfet Philippe Galli : compte tenu de sa longue expérience, je n'ai aucun doute sur sa capacité à faire face aux nombreuses obligations que je lui ai imposées. Depuis 2012, 4 245 emplois pénitentiaires auront été créés, dont près de 2 500 emplois de surveillants et 1 150 emplois pour les services d'insertion et de probation. Ces recrutements ont été complémentaires d'une revalorisation de la rémunération des personnels. L'administration pénitentiaire voit donc son budget de fonctionnement progresser de 59 millions d'euros.
Nous avons également dégagé des moyens supplémentaires pour lutter contre la radicalisation et le terrorisme en milieu ouvert comme en milieu fermé. Le 25 octobre, j'ai annoncé l'ouverture d'un centre ouvert expérimental en Île-de-France. Les magistrats pourront faire figurer dans les contraintes pénales, dans les sursis avec mise à l'épreuve ou dans les contrôles judicaires des obligations de passage dans ce centre afin de désengager les individus de la violence. Pour ce qui est de la déradicalisation, les choses me semblent plus difficiles à mettre en oeuvre.
Pour le milieu fermé, l'administration pénitentiaire prendra diverses mesures : j'ai répondu à des questions d'actualité sur ces sujets. Nous allons réaffecter les 1 350 détenus radicalisés et les 358 détenus poursuivis sous le chef d'association de malfaiteurs à but terroriste. La semaine dernière, nous avons eu sept écrous de plus sous cette seule incrimination. C'est dire à la fois l'efficacité des services mais aussi la responsabilité qui pèse sur l'administration pénitentiaire.

Merci, Monsieur le ministre, d'avoir mentionné les travaux entrepris par la commission des lois, dans le cadre de la mission pluraliste que nous avons mise en place sur le redressement de la justice. Nos observations recoupent en grande partie les vôtres. Nous nous rendons dans les tribunaux et dans les établissements pénitentiaires : nous y rencontrons les responsables, mais aussi les agents des greffes et les magistrats ainsi que les agents des différentes composantes de l'administration pénitentiaire. La première chose qui nous est dite, c'est un certain désarroi individuel et collectif des magistrats de ce pays. Ils ont le sentiment d'être submergés par une tâche dévorante, d'avoir une fonction sociale parmi les plus nobles mais qui s'accomplit dans un contexte de pénurie. Ce sentiment est aggravé à chaque fois que les expressions publiques de tous ceux qui ont la charge de défendre la justice et la magistrature démontrent le peu de considération qu'ils ont à son égard. La considération ne doit pas être que matérielle : nous devons montrer le plus grand attachement à nos magistrats et à tout le personnel de cette administration car ils sont soumis à rude épreuve.
Deuxième observation : le budget de la justice n'a cessé d'augmenter au cours des dix dernières années, passant de 6,2 à 8,2 milliards, ce qui est considérable par rapport aux autres fonctions de l'État, et le budget pour 2017 ne déroge pas à la règle. Pourtant, les Français, les magistrats, les greffiers, les agents de l'administration pénitentiaire n'ont pas le sentiment que ce grand service national fonctionne mieux qu'il y a dix ans, tout au contraire. L'augmentation des moyens sans évolution profonde des modes de gestion et sans réforme ambitieuse des procédures et du périmètre de la fonction de juger ne donnera pas les résultats escomptés. À périmètre égal et à mode de gestion et d'organisation inchangé, l'augmentation des moyens ne sortira pas la justice de l'ornière. Des changements profonds sont donc nécessaires. La dernière loi de programmation pour la justice date de 2002. Nous devons accorder à la justice les moyens dont elle a besoin mais aussi lui demander de grands changements. Les représentants de la justice n'aiment pas que l'on mentionne les travaux de la Cour des comptes : ils considèrent qu'elle méconnait la spécificité de leurs missions. Pour autant, ses recommandations ne devraient pas rester lettre morte : nous avons besoin de tableaux de bord, d'études d'impact, d'évaluations. Les difficultés de la justice doivent être mises sur la table afin, ensemble, d'y remédier.
Depuis votre entrée en fonction, vous avez abordé ces questions par le bon bout, ce qui n'a pas toujours été le cas de vos prédécesseurs.
Nous poursuivons notre travail, bien que nous ayons été présomptueux de nous attaquer à cette fonction qui est l'une des plus importantes de l'État. Nous allons essayer d'apporter nos conclusions au cours du premier trimestre 2017.
Je vais maintenant passer la parole à M. Antoine Lefèvre, qui était membre de notre commission, avant de rejoindre celle des finances, où il s'occupe du budget de la justice.

Je suis ravi de me retrouver parmi vous. Oui, c'est une nécessité démocratique que de donner à la justice les moyens de son fonctionnement. En présentant demain mon rapport spécial sur les crédits de la mission « Justice », je soulignerai la volonté affichée par le garde des sceaux dès sa prise de fonctions de doter son ministère de moyens suffisants. Mais celui-ci reste sous tension. Son budget connaîtra en 2017 une progression dynamique de 4,8 %. Même si les charges à payer se sont accumulées en 2016, les moyens, hors dépenses de personnel, augmentent de 143 millions d'euros, soit une hausse de 4,6 %. Si le programme immobilier que vous avez annoncé est ambitieux, son financement est incertain : 1,2 milliard d'euros en AE, aucun CP avant 2018.
Je ne partage pas votre optimisme sur la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ). Après onze ans, difficile de comprendre qu'elle ne soit pas opérationnelle ! Je souhaite qu'elle le devienne car cela génèrera des économies. De plus, la PNIJ sera déterminante dans la lutte contre le terrorisme.
Le malaise dans le monde carcéral reste important. La prise en charge des détenus radicalisés est l'un des problèmes. Votre pragmatisme est bienvenu car, en la matière, il n'y a pas de vérité absolue, et l'expérimentation doit prévaloir. L'organisation des locaux entre en jeu, tout comme la diversité des équipes de direction. Certaines sont volontaires et très mobilisées.
J'ai visité plusieurs prisons - sans égaler encore M. Lecerf, qui en arrivait presque à écrire un guide Michelin ! Partout, se pose le problème des téléphones portables. Si nous savons brouiller la 2G, il semble difficile de faire de même avec la 3G et la 4G. Alors qu'on demande aux visiteurs, et même aux équipes médicales, de laisser leurs téléphones à l'entrée, il y en a des milliers dans les cellules. Il semble qu'en Allemagne, Siemens ait mis en oeuvre un dispositif de brouillage performant, mais onéreux. Qu'importe : j'ai vu à Fresnes ou à Osny qu'il était possible, depuis une cellule, de photographier le parking du personnel pénitentiaire, ce qui permet ensuite de l'intimider. Il y a eu plusieurs cas. Les détenus peuvent aussi contacter les victimes, ou continuer à gérer des trafics depuis leur cellule. Nous devons trouver une solution à tout prix.
Les Français ont du mal à percevoir le volume des moyens affectés à la justice. Une comparaison est éclairante : 3,7 milliards d'euros pour la justice, 3,9 milliards d'euros pour l'audiovisuel public ! Cela en dit long sur les priorités de l'État...
La réforme du secrétariat général, que vous avez initiée, accroîtra l'efficacité de votre ministère.

Voilà quelques années que je suis le rapporteur pour avis du budget « Justice judiciaire et accès au droit ». Cette année, mes remarques seront moins nombreuses. Est-ce pour des raisons conjoncturelles ? Ce budget va dans le bon sens : les points que je soulève chaque année sont mieux pris en compte... Mais sera-t-il exécuté ?
Les 600 postes prévus pour les services judiciaires sont principalement liés au plan de lutte contre le terrorisme. Seuls 32 postes renforceront les juridictions sur d'autres sujets. Le taux de vacance de postes dans les juridictions reste élevé, et le problème de la sous-consommation des plafonds d'emplois fixés chaque année demeure : en 2015, 850 emplois votés en LFI n'ont pas été créés. Pouvez-vous nous donner le solde net des créations d'emploi pour 2017 ? Ces créations seront-elles effectives ? Souvent, il faut attendre la fin de l'année pour qu'elles le deviennent. Les 32 postes que j'ai évoqués suffiront-ils ?
En matière d'aide juridictionnelle, ce budget ajuste le montant de l'unité de valeur pour la rétribution des avocats. Comment cette mesure est-elle financée, je pense notamment à l'augmentation décidée à l'Assemblée nationale ? Le Gouvernement envisage-t-il de rouvrir le chantier de la réforme de l'aide juridictionnelle ? Dans l'affirmative, autour de quels acteurs, et de quelles priorités ?
L'amélioration du pilotage des frais de justice reposera notamment sur la mise en oeuvre complète de la PNIJ. Celle-ci ayant été plusieurs fois reportée, pouvez-vous nous donner le calendrier de son déploiement ?
Le projet Portalis suscite de nombreuses attentes. Cette application, accessible par les juridictions comme par les justiciables, enregistrera l'ensemble des procédures civiles. Où en est-on ? La date de 2021 est-elle toujours pertinente ?

Quelle que soit ma sympathie pour votre action, et pour votre style, un rapporteur se prononce sur les faits. Et ce budget doit être envisagé dans la continuité des précédents.
Le patrimoine immobilier pénitentiaire est dans une situation dramatique. Je l'ai encore vu ce matin à Fresnes. Contrairement à la plupart des ministres de la justice de ces dernières années, je suis hostile aux partenariats public-privé (PPP) - ce n'est pas notre collègue Jean-Pierre Sueur qui me contredira. J'ai en effet constaté que, dans les prisons construites sous ce régime, les malfaçons sont nombreuses. Ne disposant plus du personnel technique nécessaire pour les évaluer, les établissements doivent s'en remettre à celui de l'entreprise qui a contracté le PPP. Ainsi, à Poitiers, il y avait tant de malfaçons que le directeur avait estimé les pénalités à 1,3 million d'euros. Le ministère a transigé à 15 000 euros ! Il est vrai que c'était avant votre arrivée...
Les autres établissements sont dans une situation déplorable, que tout l'argent de ce budget ne suffirait pas à rétablir. Parfois, il faudrait raser les bâtiments pour tout reconstruire. L'inaction de plusieurs gouvernements a été telle que la tâche à accomplir est énorme. Celle qui vous a précédé à ce poste a gelé les crédits pendant trois ans. Du coup, il faut mettre les bouchées doubles, à six mois des élections !
Vous recrutez dans l'administration pénitentiaire. Très bien, mais c'est le tonneau des Danaïdes, et l'évaporation est très rapide. Qu'il s'agisse de candidats ne se présentant pas aux concours, de personnes reçues choisissant une autre administration, ou de recrues quittant le service après un an ou deux, il y a un vrai problème de fidélisation des surveillants pénitentiaires. Comme la plupart des membres de cette administration sont issus du Nord ou des outre-mer, ils n'ont qu'une idée : retourner dans leur région d'origine. Et beaucoup d'établissements sont peuplés de stagiaires, ce qui laisse craindre pour la solidité des équipes. J'ajoute que cette profession se féminise, ce qui n'est pas le cas de la population détenue, qui, de surcroît, est rarement féministe. Cela peut poser des problèmes.
Je me réjouis que vous ayez mis un terme aux expérimentations engagées en matière de lutte contre la radicalisation. Le problème est qu'une bonne partie des détenus radicaux sont mélangés au reste de la population carcérale. Comment les isoler ? Celui qui a failli tuer un gardien avait fait l'objet d'une évaluation insuffisante... J'ai rencontré, lors de mes visites, les personnes chargées de gérer les unités de lutte contre la radicalisation. Elles sont sympathiques, mais totalement inexpérimentées. Souvent, il s'agit de jeunes tout juste sortis de la faculté de psychologie, tout contents d'être sous-payés pour leur premier emploi en maison d'arrêt... Inquiétant ! De même, notre renseignement pénitentiaire souffre d'un manque criant d'effectifs. Son personnel est dix fois moins nombreux que ce qu'on observe en Grande-Bretagne. De plus, il est souvent inexpérimenté.
La surpopulation carcérale est d'autant plus forte que les magistrats ne jouent pas le jeu des peines alternatives. D'ailleurs, s'il y a bien une catégorie de personnes qu'on est sûr de ne pas croiser dans les prisons, ce sont les magistrats ! Mis à part les juges d'application des peines - encore y passent-ils aussi peu de temps que possible - les magistrats connaissent mal le monde pénitentiaire.

Le budget de la protection judiciaire de la jeunesse continue de croître, même si cette évolution doit beaucoup au plan de lutte contre le terrorisme et la radicalisation. Ainsi, la présence humaine, dans un secteur durement frappé par la révision générale des politiques publiques, redeviendra plus forte. Certes, il faudrait encore davantage de moyens pour le secteur public comme pour le secteur associatif habilité.
Je souhaiterais interroger le ministre sur deux points.
A la veille d'un nouveau quinquennat - ne spéculons pas sur les sondages - le secteur associatif habilité est inquiet. Le fait que les crédits qui le concernent passent du titre 3 au titre 6 signifie qu'on quitte la logique de contrat pour une logique de subvention. Pourquoi pas ? Pour l'heure, les sommes attendues sont au rendez-vous. Il est toutefois nécessaire que leur pérennité soit garantie, car ces associations agissent pour accomplir une mission déléguée par l'État. Et nous savons qu'il est dans l'air du temps de réduire les crédits.
Les organisations syndicales du secteur public prennent acte de l'augmentation des crédits notamment permise par le plan de lutte contre la radicalisation, qui palliera le manque de personnel résultant des choix politiques antérieurs. Ils réclament toutefois l'assurance que les emplois ainsi créés seront permanents. Des équipes se structurent pour articuler milieu ouvert et milieu fermé et, avec un public jeune, la perspective est nécessairement pluriannuelle.
Je souhaite aussi faire quelques remarques au nom de mon groupe. Il semble en effet que cela soit la seule occasion de le faire, cette année.

Vous avez choisi de renforcer les investissements à destination de l'administration pénitentiaire. Or, mon groupe défend la dépénalisation d'un certain nombre d'actes. Le tout-carcéral n'est pas la solution. Hélas, plus on ouvre de prisons, plus on les remplit ! Nous regrettons l'absence, au cours de ce quinquennat, d'une réforme de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante. Enfin, les personnels d'insertion et de probation craignent d'être spécialisés dans la lutte contre le terrorisme, ce qui ferait peser sur eux une très lourde responsabilité. Ils sont les agents d'un service public, pas des voyants !

Je regrette l'abandon de poste de la majorité sénatoriale au moment de discuter du budget, car j'aurais eu plaisir à intervenir cette année encore sur les celui de la justice. J'aurais salué votre engagement, monsieur le ministre, dès votre nomination, à augmenter ses moyens, dans la continuité de la politique menée par Mme Taubira. Ce refus d'amender le budget qui nous est présenté, alors que c'est notre rôle essentiel et que de nombreux acteurs nous le demandent, est incompréhensible.
Je fais miens les propos de M. Portelli sur la déradicalisation. En 2013, personne n'en parlait ; c'est désormais un chantier de première importance. Mais toutes les méthodes ne se valent pas : quelques vidéos et des bonnes paroles ne feront pas changer d'avis un jeune apprenti terroriste... Un travail individuel doit être mené, qui doit mobiliser l'ensemble de la société : élus locaux, travailleurs sociaux, enseignants, magistrats, gendarmes, policiers, etc. L'aborder sous l'angle de la violence en prison n'est pas la solution. Le personnel pénitentiaire nous avait d'ailleurs dit, dans le cadre des auditions de la commission d'enquête sur la lutte contre les réseaux djihadistes, que les unités spécialisées seraient des cocottes-minute. Il vaut donc mieux disperser les individus radicalisés et les suivre individuellement. Je sais toutefois la complexité du problème - nombre de terroristes s'étaient connus et radicalisés mutuellement en prison...
Les services de renseignement étaient naguère présents partout en France, sauf là où des attentats se préparaient... Vous avez heureusement poursuivi l'action engagée par Mme Taubira, monsieur le garde des sceaux, en établissant un service du renseignement pénitentiaire. Combien d'agents le composent ? Quel est leur statut ? Former tout le personnel pénitentiaire à ce métier - car c'en est un - n'est pas la solution. À la prison de Fleury-Mérogis, que nous avons visitée, il n'y a qu'un seul officier de renseignement, assisté d'un surveillant... Quelle est la place du renseignement pénitentiaire dans le dispositif global de renseignement ? Gardez-vous sur ce point la position que vous aviez en tant que président de la délégation parlementaire au renseignement - s'il est possible de la dévoiler ?

C'est vrai, et M. Urvoas a d'ailleurs beaucoup contribué à l'enrichir.
Enfin, l'aumônier musulman national des prisons nous avait dit, dans le cadre des auditions de la commission d'enquête sur la lutte contre les réseaux djihadistes, que deux tiers des aumôniers musulmans en prison étaient bénévoles, et je ne crois pas qu'ils soient soumis à des conditions de formation théologique bien établies. Certes, l'État n'a pas à intervenir dans la nomination des imams, car les cultes s'organisent librement, mais les aumôniers des prisons, des hôpitaux ou des armées, eux, sont soumis à un agrément de l'autorité administrative : je suis partisan de soumettre sa délivrance à des exigences plus strictes en matière de formation.
Merci pour toutes ces questions précieuses, qui éclairent utilement la politique que nous menons.
Les téléphones portables en prison sont un fléau absolu. Entré en politique avec Michel Rocard, je ferai mien son goût du parler vrai en vous donnant quelques chiffres pour l'illustrer : nos services ont saisi 27 524 portables ou éléments de portables en 2014, 31 084 en 2015 et 21 886 du 1er janvier au 1er septembre 2016. Les appareils entrent en prison soit par projection manuelle - mais bientôt sans doute par des moyens plus sophistiqués - au-dessus l'enceinte de l'établissement, soit par les parloirs. Je remercie l'Assemblée nationale et le Sénat d'avoir modifié l'article 57 de la loi pénitentiaire pour placer les fouilles sélectives sous la responsabilité des établissements, dans le respect de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Nous devons lutter plus globalement en sécurisant les établissements, mais conduire simultanément une réflexion plus approfondie, car cela coûte cher et tous les établissements ne sont pas touchés... Le centre pénitentiaire d'Avignon n'a par exemple connu qu'une seule projection de téléphone portable depuis le début de l'année, grâce au glacis extérieur qui permet d'éviter l'approche de son mur d'enceinte.
Plus fondamentalement, je souhaite une évolution législative et réglementaire. La sécurité périmétrique des établissements relève pour l'heure de la police et de la gendarmerie. De la même façon que le législateur a étendu les pouvoirs des services de sécurité de la RATP et de la SNCF sur la voie publique, nous pourrions confier la sécurité périmétrique des prisons à l'administration pénitentiaire. Nous réglerions ainsi le problème des extractions, sujet difficile à gérer pour les cours d'appel, sur lequel le préfet Philippe Galli a d'ailleurs été missionné pour étayer le passage du diagnostic aux propositions concrètes.
Pour l'heure, la lutte contre le fléau que sont les portables en prison nous entraîne dans une dérive technologique et financière, car les brouilleurs commandés par le ministère se sont révélés rapidement obsolètes. Pour y mettre fin, l'administration pénitentiaire a engagé un dialogue compétitif avec neuf entreprises, qui sera conclu au premier trimestre 2017. Des tests sont conduits depuis novembre, afin de vérifier l'efficacité et de garantir l'adaptabilité technique des appareils, qui assureront dans le temps long aussi bien le repérage que le brouillage des portables. Une autre solution existe, que le Canada a mise en place : doter les cellules de téléphones filaires, dont les lignes seraient écoutables par l'administration pénitentiaire, dans le respect du code de procédure pénale.
La PNIJ est une sorte de serpent de mer. Je crois néanmoins toujours à la pertinence de l'outil. En 2006, il coûtait à l'État 25 millions d'euros ; il lui en a coûté 30 millions en 2012, et la facture atteindra 55 millions en 2016, compte tenu de la progression des demandes des enquêteurs, indexées sur l'évolution des technologies... J'ai organisé hier une réunion avec Thales pour évoquer des hypothèses d'adaptation. Aucune, pas même la réinternalisation du service, n'est écartée. Il est inadmissible que des procédures soient fragilisées par des problèmes techniques ; j'ai donc demandé au Premier ministre, qui l'a accepté, de diligenter une enquête technique, pilotée par le secrétaire général du ministère - que j'ai nommé il y a quelques semaines. C'est d'ailleurs, monsieur le président Bas, un magistrat de la Cour des comptes : preuve que je prends au sérieux les observations de la rue Cambon et les exigences d'amélioration de la qualité et de l'efficience du service rendu aux usagers. Le déploiement de la PNIJ sera en toute hypothèse poursuivi au rythme prévu ; Thales a commencé à réorienter ses pratiques.
Monsieur Détraigne, les chiffres des recrutements sont des cibles, dont l'atteinte dépendra des résultats aux concours. Nous savons que nous ne sommes pas un ministère attractif, et nous le déplorons. Beaucoup d'élèves surveillants pénitentiaires abandonnent leur scolarité à l'Enap, d'autres, une fois en poste, empruntent des passerelles vers d'autres types de métiers. Dans le présent budget, entre 40 et 50 millions d'euros sont dédiés à la réflexion sur la fiabilisation du personnel. La moitié des agents de Villepinte aspirent à repartir vers les Antilles ou dans le Nord-Pas-de-Calais. Beaucoup me disent qu'ils seront partis dans les cinq ans... sauf dans les établissements non parisiens, comme à Mont-de-Marsan ou à Béziers. J'ai néanmoins demandé aux directeurs de tenir les objectifs fixés, car on ne saurait déplorer la sous-administration de la justice et, simultanément, refuser de pourvoir tous les postes aux concours.
Un autre problème réside dans le temps de formation. L'énergie déployée par Mme Taubira commence seulement à produire ses effets puisqu'en 2016, le solde d'effectifs est enfin devenu positif avec 417 emplois nouveaux, du fait de 1 348 sorties des cadres et de 1 765 entrées. En 2017, les 1 200 sorties des services judiciaires seront compensées par 1 500 entrées, soit un solde positif de 300 emplois. Nous persistons à augmenter le budget, monsieur le président Bas, et cela va bien finir par se voir ! Théoriquement, l'administration pénitentiaire n'affichera en conséquence plus aucune vacance de postes en 2018. À l'Enap par exemple, trois promotions sont en formation au lieu d'une habituellement. Le nombre de magistrats a été augmenté de 30 personnes en 2015, 100 en 2016 et le sera plus encore en 2017. Le nombre d'auditeurs de justice en formation à Bordeaux est actuellement de 895, toutes promotions confondues.
Le nombre de postes ne relevant pas de la lutte antiterroriste est plus élevé que 32. Nous avons créé des magistrats référents en la matière dans chaque parquet, qui remplissent toutefois d'autres tâches. À Magnanville ou à Saint-Étienne-du-Rouvray par exemple, les parquets ont assumé cette mission, avant que le parquet antiterroriste de Paris ait repris la main. Nous avons beaucoup bénéficié du plan de lutte contre le terrorisme, car nous y avons vu un moyen d'améliorer le fonctionnement des juridictions, en facilitant la gestion des dossiers extraordinaires. Nous construisons en outre des équipes spécialisées, entourant les magistrats de juristes assistants, de greffiers assistants des magistrats et d'assistants spécialisés.
Sachant le temps qui me reste à passer à la Chancellerie, je ne relancerai pas la réforme de l'aide juridictionnelle. La difficulté réside dans la pluralité d'interlocuteurs représentant les avocats : le Conseil national des barreaux, le barreau de Paris, la conférence des bâtonniers... Je dirai d'ailleurs vendredi à l'occasion de la rentrée du barreau de Paris tout le bien que je pense de la diversité des représentants de la profession mais que parler d'une seule voix faciliterait la conduite des réformes... Nous revenons en tout cas à l'unité de valeur de base unique, portée de 30 à 32 euros. L'hypothèse d'une taxe n'a pas été retenue. Une évolution du système est toutefois nécessaire, car dans beaucoup de barreaux, certains avocats ne vivent que de l'aide juridictionnelle, ce qui n'est sans doute pas l'idée qu'ils se faisaient du métier en l'embrassant. Nous progressons simultanément dans la réflexion sur le métier d'avocat : nous avons unifié le concours d'avocat cette année, et j'ai demandé à maître Kami Haeri un rapport sur la fonction de jeune avocat.
M. Détraigne m'interroge également sur le calendrier de Portalis. Nous avons lancé justice.fr. À l'automne 2018, le portail des auxiliaires de justice sera ouvert, qui permettra d'élargir la communication numérique aux procédures introduites devant les tribunaux d'instance ou les conseils de prud'hommes : consultation en ligne des dossiers, possibilité de remplir en ligne les demandes d'aide juridictionnelle pour le compte de leurs clients, etc. Fin 2020, un bureau virtuel sera proposé aux magistrats ; en 2021, les applications existantes seront remplacées, tous les dossiers seront dématérialisés dans une unique chaîne civile et leurs pièces accessibles aux professionnels de la justice en tout point du territoire.
Je suis entièrement d'accord avec M. Portelli. Je ne suis pas non plus un ardent défenseur des partenariats public-privé, mais je comprends les raisons qui ont poussé l'administration à y recourir. L'administration de la justice ne saurait être contrainte par un cadre annuel, et les lois de programmation - il n'y en a eu que deux à ce jour, celle proposée par M. Méhaignerie en 1995 et celle de M. Perben en 2002 - ne sont pas contraignantes, ce que vos rapports parlementaires ont d'ailleurs souligné.
Les partenariats public-privé permettent de se contraindre budgétairement et d'éviter de rogner inévitablement sur le budget. Dans le Loiret par exemple, le centre pénitentiaire d'Orléans-Saran a été endommagé par les récentes inondations. Le préfet a organisé le transfèrement des prisonniers dans la nuit, mais le bâtiment est trop endommagé pour qu'ils le regagnent ; l'argent qui financera les travaux de réparation sera pris en repoussant les investissements prévus. C'est ainsi que l'investissement, depuis dix ans, a pris un retard considérable. En conséquence, l'État trouve le moyen de s'engager sur le long terme en contractualisant avec des partenaires privés. Cela coûte cher, mais les bâtiments sont construits ! Si les lois de programmation étaient suivies d'effets, l'intérêt pour les partenariats public-privé déclinerait logiquement.

Cela suppose une révolution des pratiques. À Saran, il faudra de plus prévenir les inondations futures, car l'établissement a été construit sur un terrain inondable...
L'an prochain, 170 millions d'euros seront dédiés aux partenariats public-privé.
Un mot sur la déradicalisation en prison. Je veux d'abord dire ma gratitude à Mme Isabelle Gorce, ancienne directrice de l'administration pénitentiaire, qui a lancé les premières unités dédiées. Celles-ci avaient d'abord vocation à contingenter les détenus prosélytes ; on leur a ensuite demandé de les déradicaliser... Il faudra d'ailleurs légiférer, puisqu'un amendement du Sénat a introduit ces unités de prévention de la radicalisation dans la loi : or elles n'existent plus. Il sera également nécessaire d'évaluer les détenus - sur une période longue, de l'ordre de quatre mois. Tous les détenus n'ont pas atteint le même degré de radicalisation : certains reviennent d'Irak ou de Syrie, d'autres ont consulté des sites djihadistes et ont réservé un billet d'avion pour Istanbul ! À Osny, la dangerosité de celui qui a tenté d'égorger un surveillant n'avait pas été évaluée. Il faudra utiliser les places disponibles dans les maisons centrales pour les détenus les plus dangereux. Je reconnais que nous avons dû faire appel, pour ces évaluations, à cinquante binômes éducateurs-psychologues contractuels parfois peu expérimentés. Mais nous n'allons pas nous en séparer alors qu'ils deviennent progressivement opérationnels, il y va de la bonne gestion de l'argent public.
Les magistrats sont tenus, durant leur scolarité à l'ENM, d'effectuer des stages en prison. Les parlementaires aussi devraient s'y rendre - ils peuvent d'ailleurs se faire accompagner de journalistes. Nous n'avons rien à cacher, et tout à gagner de cette transparence sur le fonctionnement de l'administration pénitentiaire.
Ainsi que la loi le permet désormais, le renseignement pénitentiaire fera bientôt partie du second cercle de la communauté du renseignement. J'ai donné la priorité à la construction de la structure administrative centrale pour traiter le renseignement collecté : ce bureau central du renseignement pénitentiaire sera rattaché à la sous-direction de la sécurité, que j'ai décidé de créer et qui sera opérationnelle le 1er février prochain. Le renseignement pénitentiaire regroupe 186 agents, et 51 recrutements sont prévus en 2017. Je reçois désormais chaque semaine un bulletin du renseignement pénitentiaire. Le cadre fixé par la loi du 3 juin 2016 est satisfaisant. Ses décrets d'application sont à l'étude au Conseil d'État. L'académie du renseignement a été missionnée sur les techniques utilisables ; des protocoles ont été construits et des officiers de liaison mis en place pour échanger avec les services de renseignement partenaires : la direction générale de la sécurité intérieure, le service central du renseignement territorial, et demain, j'espère, la sous-direction de l'anticipation opérationnelle (SDAO) de la gendarmerie nationale et la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris (DRPP). C'est un chantier de plusieurs années : dans la police par exemple, la formation d'un agent de renseignement dure cinq ans. Dans telle prison, le directeur s'est autoproclamé délégué local du renseignement pénitentiaire : j'ai dû y mettre un peu d'ordre, car on ne s'improvise pas agent de renseignement. Les besoins en personnel varient : certains établissements n'en ont pas besoin ; à Fleury-Mérogis, le renseignement mobilise déjà quatre personnes.
Ce sont des agents de l'administration pénitentiaire qui ont accepté de s'investir sur les questions de renseignement. Certains - dans les Antilles, par exemple - sont devenus très spécialisés, grâce à l'académie du renseignement.
Je ne dispose pas pour l'heure de statistiques fines sur le nombre d'aumôniers bénévoles et d'aumôniers indemnisés. Le nombre total d'aumôniers musulmans est passé de 178 à 217. L'agrément est donné par le directeur interrégional après enquête préfectorale et avis du directeur de l'administration pénitentiaire et du bureau central des cultes du ministère de l'intérieur.
Madame Cukierman, vous pouvez rassurer les syndicats de services pénitentiaires d'insertion et de probation : un relevé de conclusions a été signé fin juillet, après un important mouvement social, et contresigné par le président de la République, qui les a reçus le 27 juillet dernier. Ces signatures engagent le Gouvernement. Je ne maîtrise pas tout, car certains sujets sont de la compétence du ministre de la fonction publique, mais les discussions se poursuivent, et les engagements relevant de ma responsabilité, comme les recrutements consentis par Mme Taubira, seront respectés.
Les syndicats sont rétifs à la spécialisation des établissements. Nous avons écarté cette hypothèse, de même que le plan d'action contre la radicalisation et le terrorisme a exclu celle de spécialiser les emplois, et privilégié les renforts nécessaires dans certaines zones géographiques, afin de renforcer les actions éducatives.
Quant au programme de la protection judiciaire de la jeunesse, concernant le financement du secteur associatif habilité (SAH), le basculement des crédits du titre 3 relatif aux dépenses de fonctionnement vers le titre 6 relatif aux dépenses d'intervention procède d'une simple mise en conformité avec la nomenclature budgétaire - nous étions en effet le seul ministère gérant des établissements sociaux et médico-sociaux à procéder ainsi.

On ne pourra donc pas avoir recours à cet argument pour réduire les crédits.

Comme vous pouvez le constater, le Sénat examine de façon très approfondie votre budget et émettra des avis circonstanciés sur celui-ci. Votre audition nous aura éclairés sur bien des aspects de cette mission.
La réunion est close à 19 h 40